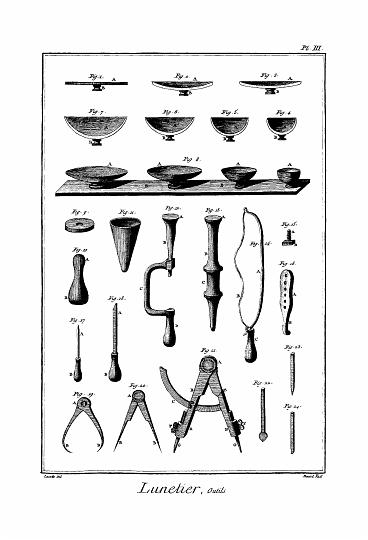(Géographie ancienne et moderne) ville de Syrie dans un désert de la Syrie, sur les confins de l'Arabie déserte en tirant vers l'Euphrate. Son nom hébreu est Tadmor, Thamor, ou Tedmor, selon Josephe, antiq. liv. VIII. ch. IIe qui la place à deux journées de la haute Syrie, à un jour de l'Euphrate, et à six de Babylone.
Ptolomée, liv. V. ch. XVe la met dans la Palmyrene, province de Syrie, et Procope aedif. liv. II. ch. XIe la place dans la Phénicie ; ce qui revient au même : car il parle de la Phénicie proche du Liban, qui est plus à l'orient que la Phénicie maritime. Il ajoute que Palmyre, qui avait autrefois été bâtie dans un désert, se trouvant dans une situation fort commode pour observer les Sarrasins, et pour découvrir les courses qu'ils faisaient sur les terres de l'empire, Justinien la répara, y mit une puissante garnison, la pourvut d'eau, et réprima par ce moyen les irruptions de ces peuples. Cette ville eut le titre de colonie romaine, et Etienne le géographe dit qu'on la nomma quelquefois Hadrianopolis.
Il reste encore de superbes ruines de cette ville, élevée dans un désert, possédée par les rois de Babylone, ensuite devenue capitale d'un état célèbre par ses richesses, par la puissance d'Odenat, et par le courage de Zénobie sa femme. Il n'est pas probable que la curiosité du lecteur en demeure-là : les ruines de cette ville sont trop intéressantes pour ne le pas porter à rechercher ce qu'elle a été, quand et par qui elle a été fondée, d'où vient qu'elle se trouve située si singulièrement, séparée du reste du genre humain par un désert inhabitable, et quelle a dû être la source des richesses nécessaires pour soutenir sa magnificence. Voilà bien des motifs de curiosité.
L'Ecriture, I. Rais, ix. Ve 18. et II. liv. Chron. VIIIe Ve 4. nous apprend que Salomon fit bâtir Tadmor ou Tedmor dans le désert, après qu'il eut fait la conquête du pays d'Hamath-Zoba ; et Josephe nous assure que c'est la même ville que les Grecs et les Romains appelèrent par la suite Palmyre, quoique les Syriens conservassent toujours le premier nom. Saint Jérôme pense que Tadmor et Palmyre ne sont que les noms syriens et grecs de la même ville. Ce qui semble fortifier cette opinion, c'est qu'à présent les arabes du pays l'appellent Tadmor. Mais il y a longtemps que tous les édifices que Salomon a pu élever dans ce lieu ne sont plus, puisque Nabuchodonozor détruisit cette Tadmor avant que d'assiéger Jérusalem.
On ne saurait raisonnablement se persuader que des édifices dans le goût de ceux de Palmyre, soient antérieurs à ceux que les Grecs établirent en Syrie ; aussi n'en est-il point parlé dans l'expédition de Cyrus le jeune, ni dans celle d'Alexandre le grand, ni dans celle du règne de Séleucus Nicanor, qui fit bâtir et réparer tant de lieux en Syrie. L'importance de cette ville, en qualité de place frontière, a dû être considérable même du temps de Séleucus Callinicus ; cependant l'histoire des Séleucides n'en dit mot.
Si nous examinons à présent l'histoire romaine, nous verrons qu'il n'en est pas encore fait mention quand Pompée fit la conquête de ce pays-là ; ce n'est que du temps de Marc-Antoine qu'il en est parlé pour la première fois dans cette histoire. Ce capitaine romain se voyant épuisé d'argent par les dépenses excessives qu'il faisait en Syrie, et n'ayant pas de quoi payer ses troupes, imagina de donner le pillage de Palmyre à sa cavalerie au lieu de paye, et elle s'y rendit dans l'espérance de s'y enrichir ; mais les Palmyréniens ayant été avertis de bonne heure des desseins d'Antoine, mirent à couvert leurs familles et leurs meilleurs effets de l'autre côté de l'Euphrate, dont ils défendirent si bien le passage avec leurs archers, que l'armée d'Antoine s'en retourna sans succès. Cependant les Palmyréniens outrés du projet du triumvir, prirent le parti de s'unir avec les Parthes, pour se mettre à couvert de l'avarice des Romains.
Les Palmyréniens étaient alors un peuple riche, commerçant et libre. Ptolomée marque les noms des différentes villes de l'état palmyrénien ; mais Pline, l. V. cap. 25. a ramassé en peu de lignes les circonstances les plus frappantes de Palmyre, excepté qu'il ne parle pas des édifices. " Cette ville, dit-il, est remarquable par sa situation, son riche terroir et ses ruisseaux agréables. Elle est environnée de tous côtés d'un vaste désert sablonneux qui la sépare totalement du reste du monde ; et elle a conservé son indépendance entre les deux grands empires de Rome et des Parthes, dont le soin principal est, quand ils sont en guerre, de l'engager dans leurs intérêts. "
Palmyre dans son état florissant, ne pouvait qu'absolument répondre à cette description. La situation en est belle, cette ville étant au pied d'une chaîne de montagnes à l'occident, et s'élevant un peu au-dessus du niveau d'une vaste plaine qu'elle commande à l'orient. Ces montagnes étaient chargées de monuments funèbres, dont plusieurs subsistent encore presqu'en entier, et ont un air vénérable. Elles étaient aussi couvertes de palmiers, de même qu'une partie du désert ; car les palmiers croissent dans les déserts sablonneux les plus arides. Abulfeda fait mention des palmiers aussi-bien que des figuiers de Palmyre, et les négociants anglais qui y allèrent d'Alep en 1691, rapportent y en avoir Ve plusieurs.
Il n'est point parlé de Palmyre dans le voyage que fit Trajan en cette partie de l'orient, ni dans celui d'Adrien, quoiqu'ils aient dû passer près de cette ville. On caractérise Palmyre de colonie romaine sur la monnaie de Caracalla. On trouve par les inscriptions qu'elle se joignit à Alexandre Sevère dans son expédition contre les Perses. Elle se distingua sous Galien par la politique et les vertus d'Odenat palmyrénien, que l'empereur déclara Auguste, et associa à l'empire. Odenat laissa après lui sa femme Zénobie, si célèbre par sa beauté mâle, sa science et ses conquêtes. On sait qu'Aurélien ayant pris Palmyre et fait cette princesse prisonnière, il l'amena à Rome pour orner son triomphe.
Sans doute que Palmyre, après avoir perdu sa liberté, eut un gouverneur romain. Justinien la fit réparer, et depuis lors, on n'apprend plus rien de Palmyre dans l'histoire romaine. On ne sait pas davantage ce qui est arrivé à Palmyre depuis Mahomet. Abulfeda, qui écrivait vers l'an 1321, est presque le seul qui en parle ; encore fait-il une mention très-succincte de sa situation, de son terroir, de ses palmiers, de ses figuiers, des colomnes anciennes et en assez grand nombre qu'on y voyait de son temps, de ses murs et de son château. Il est vraisemblable qu'il ignorait et le nom grec, et l'histoire de cette ville ; il ne l'appelle que Tedmor.
Enfin on connaissait si peu ses ruines avant la fin du dernier siècle, que si on en eut employé les matériaux à fortifier la place, ce qui aurait pu naturellement arriver, en conséquence d'une guerre entre la Turquie et la Perse, on saurait à peine aujourd'hui que Palmyre a existé : exemple frappant du fort précaire auquel sont sujets les plus grands monuments de l'industrie et de la puissance humaine !
Mais en 1691 des négociants anglais eurent la curiosité d'aller voir ses ruines. On a publié dans les Transactions philosophiques la relation qu'ils en ont faite avec toute la candeur et la vérité possible. C'est ce que reconnaissent les gens de lettres également habiles et curieux, qui entreprirent en 1751 le voyage exprès de Palmyre : je parle de MM. Dawkins, Wood et Bouvery.
Ces hommes illustres, riches, unis par l'amour qu'ils avaient pour les antiquités et pour les beaux arts, l'habitude où ils étaient de voyager, savants dans le dessein et dans l'art de lever des plans, fretèrent un vaisseau à leurs dépens, parcoururent les îles de l'Archipel, pénétrèrent dans l'Asie mineure, dans la Syrie, dans la Phénicie, dans la Palestine et l'Egypte, pour en voir les endroits les plus remarquables, moins encore pour connaître l'état présent de ce pays, que l'état ancien. Ils se pourvurent de livres, d'instruments de mathématiques, de présents convenables pour les turcs de distinction, et autres auxquels ils se trouveraient obligés de s'adresser dans le cours de leur voyage.
Ces savants ont copié toutes les inscriptions qu'ils ont rencontrées sur leur route : ils ont plus fait, ils ont même emporté les marbres en Angleterre, toutes les fois qu'ils l'ont pu. Ils ont eu soin de se pourvoir d'instruments pour creuser la terre ; et ils ont quelquefois employé les paysans à ce travail pendant plusieurs jours avec succès. Enfin de retour dans leur pays, ils nous ont donné les ruines de Palmyre, que le public désirait avec empressement. Cet ouvrage magnifique publié à Londres en 1753, en anglais et en français, contient 57 planches de forme d'Atlas, et qui sont admirablement gravées.
Il semble qu'on peut conclure par tout ce qu'ils nous en rapportent, qu'on a dû connaître les sources abondantes et continuelles des richesses de Palmyre, tout aussi-tôt qu'on a trouvé le passage du désert, et que dès le temps auquel le commerce a commencé d'attirer l'attention des hommes, on a dû faire cas de la situation d'une telle ville, qui était nécessaire pour entretenir la communication entre l'Euphrate et la Méditerranée, Palmyre n'étant qu'à environ 20 lieues de cette rivière, et à environ 50 de Tyr et de Sidon sur la côte.
Il est probable que les Phéniciens commercèrent à Palmyre, et que ses richesses sont dues au commerce des Indes, commerce qui doit avoir considérablement fleuri dans cette ville avant la naissance de Jesus-Christ ; car on trouve par les inscriptions, que vers ce temps-là les Palmyréniens étaient opulents, et donnaient dans le luxe. Aussi Appien les appelle expressément commerçans en marchandises des Indes, du temps de Marc Antoine.
Ainsi les Palmyréniens ont été en état de faire la dépense magnifique de leurs édifices, que les écrivains ont jusqu'ici attribué sans aucune preuve aux successeurs d'Alexandre, ou aux empereurs romains. En effet, le commerce donnait à Palmyre les richesses de l'orient et de l'occident ; car les caravanes de Perse et des Indes, qui viennent se décharger à Alep, s'arrêtaient alors à Palmyre ; de-là on portait les marchandises de l'orient qui lui venaient par terre dans les ports de la Méditerranée, d'où elles se répandaient dans tout l'occident ; et les marchandises d'occident lui revenaient de la même manière. Les caravanes de l'orient les portaient ici par terre en s'en retournant ; de sorte que comme Tyr et ensuite Alexandrie avaient eu autrefois tout le négoce de l'orient qui se faisait par mer, Palmyre eut aussi pendant quelque temps, et seule, tout le commerce qui se faisait par terre. D'ailleurs ce pays ne pouvait subsister que par le négoce ; mais la perte de la liberté de ses habitants ayant entrainé celle de leur commerce, la ruine de leur ville a été prompte.
Il est difficîle de deviner le siècle des édifices dont on voit les ruines par monceaux, et qui sont gravées dans le bel ouvrage dont nous avons parlé ; mais il est évident qu'ils sont d'une plus grande antiquité, que ceux dont les ruines sont encore élevées en partie. Si ces ruines sont les restes les plus considérables et les plus complete s de l'antiquité que l'on connaisse, cela vient sans doute de ce que le climat est sec, de ce qu'il y a peu d'habitants dans le pays pour les gâter, et de ce qu'étant éloignée des autres villes, on n'a pas pu en employer les matériaux à d'autres usages.
On sait que la religion des Palmyréniens était la payenne ; et il parait par la magnificence extraordinaire du temple du soleil, qu'ils rendaient un grand honneur à cette divinité, ainsi que les peuples de la Syrie dont ils étaient voisins.
On voit par l'histoire et par les inscriptions, que leur gouvernement était républicain ; mais il ne reste rien du tout de leurs lois et de leur police. On sait très-peu de choses de leurs coutumes ; leur méthode d'embaumer les corps était la même que celle des Egyptiens, et vraisemblablement ils avaient emprunté plusieurs autres coutumes de l'Egypte. Ils tenaient de ce pays-là la pompe extraordinaire des monuments pour leurs morts.
Enfin les Palmyréniens imitaient de grands modèles dans leurs manières, dans leurs vices et dans leurs vertus. Les coutumes qu'ils observaient dans leurs funérailles venaient d'Egypte, leur luxe de Perse, leurs lettres et leurs arts de Grèce ; situés au milieu de ces trois grandes nations, on peut raisonnablement supposer qu'ils en avaient adopté plusieurs autres choses. Qu'il est fâcheux de n'en pas savoir davantage d'un pays qui a laissé des monuments splendides, qui eut pour reine Zénobie, et Longin pour son premier ministre !
Il faut compter entre les monuments de Palmyre, le temple du soleil. Tout son enclos était un espace carré, fermé de chaque côté d'une haute et belle muraille, et orné de pilastres par-dedans et par-dehors. Cet enclos renfermait le temple environné de plusieurs rangs de colonnes de différents ordres, et d'environ cinquante pieds de hauteur. Il n'en reste plus que seize : ces colomnes soutenaient la couverture d'une galerie ; le temple avait 92 pieds de longueur, et 40 de largeur. Ce lieu est changé en une mosquée, avec des ornements à la mode des Turcs ; c'est-à-dire quelques inscriptions arabes, et des sentences tirées de l'alcoran, entrelacées de quelques feuillages. Tout l'espace de l'enclos est aujourd'hui rempli de méchantes huttes qui servent de demeure à des habitants également pauvres et misérables. Il n'y a peut-être pas de lieu au monde où l'on voie tout ensemble et plus de restes d'une ancienne grandeur, et plus de marques d'une désolation présente.
A la sortie de ce temple, on trouve dans l'espace d'un mille, une prodigieuse quantité de colonnes de marbre, dont quelques-unes sont debout, et les autres renversées dans la dernière confusion. Plus loin on aperçoit un grand nombre de ruines, mais parmi lesquelles on voit encore tant de grandeur, qu'on ne peut douter que Palmyre n'ait été une des plus belles villes de toute l'Asie.
En continuant à marcher du côté du nord, on découvre un obélisque considérable ; c'est une colomne composée de sept grandes pierres, outre son couronnement qui est au-dessus. La sculpture en est fort belle, ainsi que celle de tous les autres endroits. Sa hauteur est de plus de cinquante pieds ; et apparemment il y avait sur le sommet une statue que les Turcs ont mise en pièces. Sa grosseur au-dessus de son piédestal, est de douze pieds et demi.
A l'orient et à l'occident de cet obélisque, on voit deux autres colonnes, qui en sont éloignées chacune d'environ un quart de mille. Elles semblent se répondre l'une à l'autre ; et auprès de celle qui est du côté de l'orient, il y en a une autre rompue, d'où l'on juge qu'on en avait mis un rang tout du long dans cet endroit-là. On a mesuré celle qui est à l'orient, et l'on a trouvé qu'elle avait plus de 42 pieds de haut. Elle est grosse à proportion, et on y lit une inscription en langue grecque.
Cette inscription apprend que ceux qui avaient fait dresser cette colonne, étaient une nation libre, gouvernée par un sénat et par le peuple, et peut-être sous la protection de quelque puissant empire, tel que fut premièrement celui des Parthes, et ensuite celui des Romains, qui ont souvent disputé aux Parthes la domination de ce pays-là. Cette forme de gouvernement des Palmyréniens avait duré jusqu'au temps d'Aurélien qui prit cette ville en 272, sur la célèbre Zénobie, la seconde femme du grand Odenat, chef ou prince des Palmyréniens, et qui ne rendit pas son nom moins recommandable.
Odenat avait vengé sur les Perses la prise de l'empereur Valérien ; il avait vaincu la plupart des lieutenans de Sapor, et chassé de la Mésopotamie ce roi victorieux. Ces beaux exploits engagèrent Galien à lui conférer la qualité d'Auguste dans les provinces romaines, en-deçà et au-delà de l'Euphrate ; mais ses victoires furent bornées par sa mort. Le perfide Méonius son parent, l'assassina dans un festin l'an 267 ; et l'on soupçonna Zénobie d'avoir consenti à cette action, indignée de la tendresse qu'Odenat témoignait à son fils Hérode qu'il avait eu d'une autre femme.
Sans ce crime de cruelle marâtre, dont l'accuse Trebellius Pollion, on pourrait mettre Zénobie au nombre des plus grandes raretés qu'on ait vues sur la terre. Ce fut une belle femme, chaste, savante, courageuse, sobre, et sachant par politique boire beaucoup de vin dans certaines occasions. Voici son portrait : Mulierum omnium nobilissima orientalium foeminarum, et ut Cornelius Capitolinus asserit, expeditissima, vultu subaquilo, fusci coloris, oculis suprà modum vigentibus, nigris, spiritus divini, venustatis incredibilis : tantus candor in dentibus, ut margaritas eam plerique putarent habere, non dentes.
Elle avait beaucoup contribué aux victoires qu'Odenat remporta sur les Perses, et qui conservèrent l'orient aux Romains. Aussi fut-elle honorée de la qualité d'Auguste par le même Galien. Après la mort de son mari, elle se maintint dans l'autorité, et regna d'une manière très-vigoureuse et très-glorieuse. Elle se mit à la tête de ses troupes, força les Perses d'accepter la paix, et devint la terreur de toute l'Asie. Elle ne put souffrir que les Romains y tinssent aucune place que sous sa protection ; et les barbares ayant fait irruption de tous côtés dans leurs provinces, elle étendit ses conquêtes depuis les bords du Tigre jusqu'à ceux de l'Hellespont, prit le superbe nom de reine d'Orient, après que Zaba, l'un de ses plus grands capitaines, eut achevé de lui assujettir l'Egypte.
Cette princesse dont la valeur soutenue d'une prudence extraordinaire, avait subjugué tant de provinces de l'Asie, fut enfin obligée de céder aux armes romaines. Aurélien, qui avait défait les Sarmates, les Marcomants, et chassé tous les Barbares hors de l'empire romain, eut honte qu'une femme usurpât sur lui tant de pays : il se prépara à humilier cette reine ambitieuse. Il n'ignorait pas sa réputation ni ses exploits. Il savait qu'elle était aimée de ses soldats, respectée de ses voisins et redoutée de ses ennemis, et qu'elle égalait Odenat en mérite et en courage.
Il marcha donc contre elle avec toutes les forces de l'empire. Il la vainquit auprès de la ville d'Emese ; mais il lui en couta ses meilleures troupes. Il mit ensuite le siege devant Palmyre, où cette princesse s'était retirée, et où il trouva plus de résistance qu'il ne l'imaginait. Fatigué de la longueur du siege, et redoutant toujours les événements que pouvait amener le courage de Zénobie, il lui écrivit une lettre dans laquelle il lui marquait que si elle se remettait entre ses mains, il lui offrait la vie, un état honnête, et un lieu de retraite convenable à son rang. Cette illustre reine avait trop de cœur pour écouter de pareilles conditions. Voici la réponse qu'elle fit à Aurélien.
" Zénobie, reine de l'Orient, à l'empereur Aurélien. Personne jusqu'ici n'a fait une demande pareille à la tienne. C'est la vertu, Aurélien, qui doit agir dans la guerre. Tu me mandes de me remettre entre tes mains : comme si tu ne savais pas que Cléopatre aima mieux mourir avec le titre de reine, que de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le secours des Perses. Les Sarrasins arment pour nous. Les Arméniens se sont déclarés en notre faveur. Une troupe de voleurs dans la Syrie a défait ton armée. Juge ce que tu dois attendre, quand toutes ces forces seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec lequel, comme maître absolu de toutes choses, tu m'ordonnes de me rendre ".
Cette lettre n'inspira que de la colere à Aurélien ; il poussa le siege de Palmyre avec vigueur, et Zénobie n'ayant plus d'espérance d'empêcher la prise de sa capitale, en sortit secrètement. Aurélien en fut averti, et la fit suivre avec tant de diligence, qu'on l'atteignit lorsqu'elle était déjà dans le bac pour passer l'Euphrate : ce fut en 272, et la ville de Palmyre fut prise peu de jours après.
Quoique toute l'armée demandât la mort de Zénobie, Aurélien aima mieux la réserver pour servir d'ornement à son triomphe. Elle fut menée à Rome deux ans après, chargée de pierreries, de fers d'or aux pieds, et de chaînes d'or aux mains ; ensuite l'empereur lui permit de passer le reste de ses jours avec ses enfants en personne privée dans une maison qu'il lui donna, et dont on voit encore les ruines près de Tibur.
Mais Aurélien fit mourir les ministres qui avaient assisté Zénobie de leurs conseils. Entre ceux-là, Longin fut extrêmement regretté. On le soupçonna d'être l'auteur de la lettre dont nous avons donné la copie, et sa mort fut aussi glorieuse pour lui qu'honteuse pour l'empereur, dont elle a pour jamais flétri la mémoire. Longin mourut en philosophe, avec une constance admirable, consolant lui-même tous ceux que son malheur touchait de pitié et d'indignation. Je vais donc achever de faire connaître ce grand personnage.
Il se nommait Dionysius Longinus Cassius. On ignore le nom et la qualité de son père ; sa mère était sœur du fameux orateur Cornelius Fronto, petit-fils du philosophe Plutarque. Fronton enseigna longtemps l'éloquence dans Athènes avec beaucoup de réputation. Il y mourut, après avoir institué pour héritier son neveu Longin, qui était vraisemblablement syrien et natif d'Emèse : c'est pour cela que Zénobie le fit venir à sa cour, et l'admit dans son conseil.
Ce qui donne encore du poids à l'opinion que Longin était natif de Syrie, c'est une inscription que le savant Hudson a trouvée dans le comté de Chester, et qui prouve que les Longins étaient citoyens de Samosate en Syrie. Voici cette inscription : Flavius Longinus Trib. Mil. Leg. XX. Longinus filius ejus domo samosata.
Longin employa, comme il nous l'apprend lui-même, dans un fragment conservé par Porphyre, sa jeunesse à voyager avec ses parents, pour s'instruire de plus en plus dans les belles lettres et dans la philologie, en étudiant sous tous les hommes de son temps les plus célèbres. Son traité du sublime lui acquit la plus grande réputation, et fut cause qu'on lui donna le droit de revoir et de juger souverainement les ouvrages des anciens. C'est dommage que ce traité du sublime ne soit pas parvenu à nous tout entier, et qu'il s'y trouve même plusieurs endroits défectueux. Néanmoins tout défiguré qu'il est, il nous en reste encore assez pour nous faire concevoir une grande idée de son auteur, et pour nous donner du regret de la perte de ses autres ouvrages de critique. Le nombre n'en était pas médiocre. Suidas en compte jusqu'à neuf, dont il ne nous reste plus que le titre assez confus. Zénobie, après l'avoir appelé auprès d'elle pour s'instruire dans la langue grecque, en fit un de ses principaux ministres, et ce rang éminent lui couta la vie.
Il est vraisemblable que ce fut lui qui engagea la reine de Palmyre à protéger Paul de Samosate, qui avait été condamné au concîle d'Antioche ; et cette protection puissante empêchait pour lors qu'il ne fût chassé de son église. Il n'en a pas fallu davantage à S. Athanase pour assurer que Zénobie était juive de religion. Mais par quelle raison une princesse payenne n'aurait-elle pas protégé un savant qu'on lui recommandait comme malheureux et opprimé ?
Les anglais qui furent aux ruines de Palmyre en 1691, y recueillirent dès-lors plusieurs inscriptions grecques, et quelques-unes en langue palmyrénienne. On les a communiquées au public, et elles ont été imprimées à Utrecht en 1698, sous le titre de Inscriptiones graecae Palmyrenorum. On y en joignit en même temps quelques-unes en caractères du pays, dans l'espérance qu'on pourrait déchiffrer ces caractères pour en faire un alphabet ; mais personne n'a pu encore remplir ce désir, et peut-être que cette recherche doit être mise au nombre des curiosités inutiles.
Il n'en est pas de même de la médaille de la reine Zénobie, trouvée en 1690 dans les ruines de Palmyre, et que M. Vaillant le père a expliquée dans les mémoires de littérature, tom. II. in -4°.
Cette médaille est de bronze, et de petit moule ; mais quoique le métal n'en soit pas considérable, non plus que la grandeur, la rareté en récompense bien le prix et le mérite. Elle a d'un côté une tête de femme avec cette inscription : CEPT ZHNOBIA CEB. Sa coiffure est à la romaine, comme celles du temps de Salonine, femme de l'empereur Galien ; et quoique cette princesse soit étrangère, elle ne porte pas le nom de reine, ni le diadème. Elle prend le titre d'Auguste qui avait été accordé à son mari.
M. Seguin est le premier qui nous a donné le portrait de cette illustre conquérante, qu'il a mis dans ses médailles choisies au nombre des plus rares, avec le type de l'espérance au revers. Patin, dans son livre du moyen bronze, y a ajouté un second type de l'image de l'abondance. Tristan avant eux avait écrit une partie de la vie de Zénobie, quoiqu'il n'eut donné aucun monument de cette héroïne. (D.J.)
PALMYRE
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Géographie ancienne & moderne