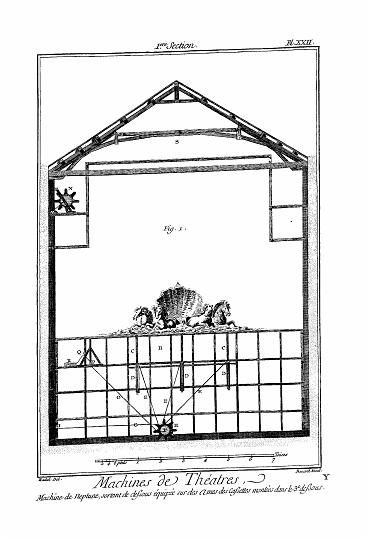S. f. (Belles Lettres) ce mot vient du grec , sur, et du verbe , j'envoye.
Ce terme n'est presque plus en usage que pour les lettres écrites en vers, et pour les dédicaces des livres.
Quand on parle des lettres écrites par des auteurs modernes, ou dans les langues vivantes, et surtout en prose, on ne se sert point du mot épitre : ainsi l'on dit, les lettres du cardinal d'Ossat, de Balzac, de Voiture, de madame de Sevigné, et non pas les épitres du cardinal d'Ossat, de Balzac, etc.
Au contraire, on se sert du mot épitre, en parlant des lettres écrites par des anciens, ou dans une langue ancienne : ainsi l'on dit les épitres de Cicéron, de Séneque, etc. Il est pourtant vrai que les modernes se sont servis du terme de lettres, en parlant de celles de Cicéron et de Pline.
Le mot épitre parait encore plus particulièrement restreint aux écrits de ce genre, en matière de religion : ainsi l'on dit les épitres de S. Paul, de S. Pierre, de S. Jean, et non les lettres de S. Paul, etc. (G)
On attache aujourd'hui à l'épitre l'idée de la réflexion et du travail, et on ne lui permet point les négligences de la lettre. Le style de la lettre est libre, simple, familier. L'épitre n'a point de style déterminé ; elle prend le ton de son sujet, et s'élève ou s'abaisse suivant le caractère des personnes. L'épitre de Boileau à son jardinier, exigeait le style le plus naturel ; ainsi ces vers y sont déplacés, supposé même qu'ils ne soient pas mauvais par-tout.
Sans cesse poursuivant ces fugitives fées,
On voit sous les lauriers haleter les Orphées.
Boileau avait oublié en les composant, qu'Antoine devait les entendre.
L'épitre au roi sur le passage du Rhin, exigeait le style le plus héroïque : ainsi l'image grotesque du fleuve essuyant sa barbe, y choque la décence. Virgile a dit d'un genre de poésie encore moins noble, sylvae sint consule dignae.
Si dans un ouvrage adressé à une personne illustre on doit annoblir les petites choses, à plus forte raison n'y doit-on pas avilir les grandes ; et c'est ce que fait à tout moment dans les épitres de Boileau, le mélange de Cotin avec Louis le Grand, du sucre et de la canelle avec la gloire de ce héros. Un bon mot est placé dans une épitre familière ; dans une épitre sérieuse et noble, il est du plus mauvais gout.
Boileau n'était pas de cet avis ; il lui en couta de retrancher la fable de l'huitre, qu'il avait mise à la fin de sa première épitre au roi, pour délasser, disait-il, des lecteurs qu'un sublime trop sérieux peut enfin fatiguer. Il ne fallut pas moins que le grand Condé pour vaincre la répugnance du poète à sacrifier ce morceau.
En général, les défauts dominans des épitres de Boileau sont la sécheresse et la stérilité, des plaisanteries parasites, des idées superficielles, des vues courtes, et de petits desseins. On lui a appliqué ce vers :
Dans son génie étroit il est toujours captif.
Son mérite est dans le choix heureux des termes et des tours. Il se piquait surtout de rendre avec grâce et avec noblesse des idées communes, qui n'avaient point encore été rendues en Poésie. Une des choses par exemple qui le flattaient le plus, comme il l'avoue lui-même, était d'avoir exprimé poétiquement sa perruque.
Au contraire, la bassesse et la bigarrure du style défigurent la plupart des épitres de Rousseau. Autant il s'est élevé au-dessus de Boileau par ses odes, autant il s'est mis au-dessous de lui par ses épitres.
Dans l'épitre philosophique, la partie dominante doit être la justesse et la profondeur du raisonnement. C'est un préjugé dangereux pour les Poètes et injurieux pour la Poésie, de croire qu'elle n'exige ni une vérité rigoureuse, ni une progression méthodique dans les idées. Nous ferons voir ailleurs que les écarts même de l'enthousiasme ne sont que la marche régulière de la raison. Voyez ODE et ENTHOUSIASME.
Il est encore plus incontestable, que dans l'épitre philosophique on doit pouvoir presser les idées sans y trouver le vide, et les creuser sans arriver au faux. Que serait-ce en effet qu'un ouvrage raisonné, où l'on ne ferait qu'effleurer l'apparence superficielle des choses ? Un sophisme revêtu d'une expression brillante, n'est qu'une figure bien peinte et mal dessinée ; prétendre que la Poésie n'a pas besoin de l'exactitude philosophique, c'est donc vouloir que la Peinture puisse se passer de la correction du dessein. Or qu'on mette à l'épreuve de l'application de ce principe et les épitres de Boileau, et celles de Rousseau, et celles de Pope lui-même. Boileau, dans son épitre à M. Arnaud, attribue tous les maux de l'humanité à la honte du bien. La mauvaise honte ou plutôt la faiblesse en général, produit de grands maux :
Tyran qui cede au crime et détruit les vertus.
Henriade.
Voilà le vrai. Mais quand on ajoute, pour le prouver, qu'Adam, par exemple, n'a été malheureux que pour n'avoir osé soupçonner sa femme ; voilà de la déclamation. Le désir de la louange et la crainte du blâme produisent tour à tour des hommes timides ou courageux dans le bien, faibles ou audacieux dans le mal ; les grands crimes et les grandes vertus émanent souvent de la même source : quand ? et comment ? et pourquoi ? voilà ce qui serait de la philosophie.
Dans l'épitre à M. de Seignelai, la plus estimée de celles de Boileau, pour démasquer la flatterie le poète la suppose stupide et grossière, absurde et choquante au point de louer un général d'armée sur sa défaite, et un ministre d'état sur ses exploits militaires ; est-ce là présenter le miroir aux flatteurs ? Il ajoute que rien n'est beau que le vrai ; mais confondant l'homme qui se corrige avec l'homme qui se déguise, il conclut qu'il faut suivre la nature.
C'est elle seule en tout qu'on admire et qu'on aime.
Un esprit né chagrin, plait par son chagrin même.
Sur ce principe vague, un homme né grossier plaira donc par sa grossiéreté ? un impudent par son impudence ? etc.
Qu'aurait fait un poète philosophe ? qu'aurait fait par exemple, l'auteur des discours sur l'égalité des conditions, et sur la modération dans les désirs ? Il aurait pris le naturel inculte et brute, comme il l'est toujours : il l'aurait comparé à l'arbre qu'il faut tailler, émonder, diriger, cultiver enfin, pour le rendre plus beau, plus fécond, et plus utile. Il eut dit à l'homme : " ne veuillez jamais paraitre ce que vous n'êtes pas, mais tâchez de devenir ce que vous voulez paraitre : quel que soit votre caractère, il est voisin d'un certain nombre de bonnes et de mauvaises qualités ; si la nature a pu vous incliner aux mauvaises, ce qui est du moins très-douteux, ne vous découragez point, et opposez à ce penchant la contention de l'habitude. Socrate n'était pas né sage, et son naturel en se redressant ne s'était pas estropié ".
On n'a besoin que d'un peu de philosophie pour n'en trouver aucune dans les épitres de Rousseau. Dans celle à Clément Marot il avait à développer et à prouver ce principe des Stoïciens, que l'erreur est la source de tous les vices, c'est-à-dire qu'on n'est méchant que par un intérêt mal entendu. Que fait le poète ? il établit qu'un vaurien est toujours un sot sous le masque ; et au lieu de citer au tribunal de la raison un Aristophane, un Catilina, un Narcisse, qu'il aurait eu bien de la peine à faire passer pour d'honnêtes gens, ou pour des sots ; il prend un fat, mauvais plaisant, dont l'exemple ne conclut rien, et il dit de ce fat, plus sot encore :
A sa vertu je n'ai plus grande foi
Qu'à son esprit. Pourquoi cela ? Pourquoi ?
Qu'est ce qu'esprit ? Raison assaisonnée,
....
Qui dit esprit, dit sel de la raison :
....
De tous les deux se forme esprit parfait,
De l'un sans l'autre un monstre contrefait.
Or quel vrai bien d'un monstre peut-il naître ?
Sans la raison puis-je vertu connaître ?
Et sans le sel dont il faut l'apprêter,
Puis-je vertu faire aux autres goûter ?
Passons sur le style ; quelle logique ! La raison sans sel fait un monstre, incapable de tout bien : pourquoi ? parce qu'elle est fade nourriture, qu'elle n'assaisonne pas la vertu, et ne la fait pas goûter aux autres. D'où il conclut qu'un homme qui n'a que de la raison, et qu'il appelle un sot, ne saurait être vertueux. Moliere, le plus philosophe de tous les poètes, a fait un honnête homme d'Orgon, quoiqu'il n'en ait fait qu'un sot, et n'a pas fait un sot de Tartuffe, quoiqu'il n'en ait fait qu'un méchant homme.
Pope, dans les épitres qui composent son essai sur l'homme, a fait voir combien la poésie pouvait s'élever sur les ailes de la philosophie. C'est dommage que ce poète n'ait pas eu autant de méthode que de profondeur. Mais il avait pris un système, il fallait le soutenir. Ce système lui offrait des difficultés épouvantables ; il fallait ou les vaincre, ou les éviter : le dernier parti était le plus sur et le plus commode ; aussi, pour répondre aux plaintes de l'homme sur les malheurs de son état, lui donne-t-il le plus souvent des images pour des preuves, et des injures pour des raisons. Article de M. MARMONTEL.
ÉPITRE DEDICATOIRE. Il faut croire que l'estime et l'amitié ont inventé l'épitre dédicatoire, mais la bassesse et l'intérêt en ont bien avili l'usage : les exemples de cet indigne abus sont trop honteux à la Littérature pour en rappeler aucun ; mais nous croyons devoir donner aux auteurs un avis qui peut leur être utile, c'est que tous les petits détours de la flatterie sont connus. Les marques de bonté qu'on se flatte d'avoir reçues, et que le Mécène ne se souvient pas d'avoir données ; l'accueil favorable qu'il a fait sans s'en apercevoir ; la reconnaissance dont on est si pénétré, et dont il devrait être si surpris ; la part qu'on veut qu'il ait à un ouvrage dont la lecture l'a endormi ; ses ayeux dont on lui fait l'histoire souvent chimérique ; ses belles actions et ses sublimes vertus qu'on passe sous silence pour de bonnes raisons ; sa générosité qu'on loue d'avance, etc. toutes ces formules sont usées, et l'orgueil qui est si peu délicat, en est lui-même dégouté. Monseigneur, écrit M. de Voltaire à l'électeur Palatin, le style des dédicaces, les vertus du protecteur, et le mauvais livre du protégé, ont souvent ennuyé le public.
Il ne reste plus qu'une façon honnête de dédier un livre : c'est de fonder sur des faits la reconnaissance, l'estime, ou le respect qui doivent justifier aux yeux du public l'hommage qu'on rend au mérite. Cet article est de M. MARMONTEL.
ÉPITRE (Histoire ecclésiastique) C'est une des parties de la Messe, et qui précède l'évangîle ; ou plutôt, c'est cette partie de la Messe chantée aujourd'hui par le sous-diacre, un peu avant l'évangile, et qui est un texte de l'écriture-sainte. Cette partie de l'écriture-sainte n'est jamais prise des quatre Evangiles, mais de quelque endroit de la Bible, et souvent des épitres de S. Paul, ou de celles des autres apôtres, ce qui leur a fait donner le nom d'épitre.
Pour connaître l'origine de l'épitre et l'usage de l'Eglise à cet égard, il faut remarquer que les Juifs faisaient lire dans leurs synagogues quelques endroits de la Loi et des prophetes, particulièrement dans les jours du sabbat. Les Chrétiens conservèrent parmi eux cette coutume ; ils commençaient la célébration de l'Eucharistie par la lecture des saintes Ecritures, selon le témoignage de Tertullien dans son Apologétique ; et comme les actes des apôtres et les épitres de S. Paul contenaient de grands exemples et des instructions très-utiles, on lisait ordinairement quelques endroits de l'un et de l'autre, mais le plus souvent des épitres de S. Paul, en sorte que par une espèce d'habitude, on a donné à cette lecture le titre d'épitre.
Quelques auteurs ont observé, que lorsque l'on lit un endroit des épitres de S. Paul, on commence par ce mot, Fratres, parce que cet apôtre appelait ainsi ceux à qui il écrivait : et quand on lit quelques passages de l'ancien et du nouveau Testament, on dit toujours, in diebus illis.
Cette lecture introduisit l'ordre des lecteurs, dont la fonction a cependant cessé depuis quelques siècles dans l'église catholique, où la lecture a été attribuée aux sous-diacres. Fleury, Histoire ecclés. Dict. de Richelet et de Trév. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
EPITRE
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Beaux-arts
- Catégorie : Littérature
- Affichages : 1755