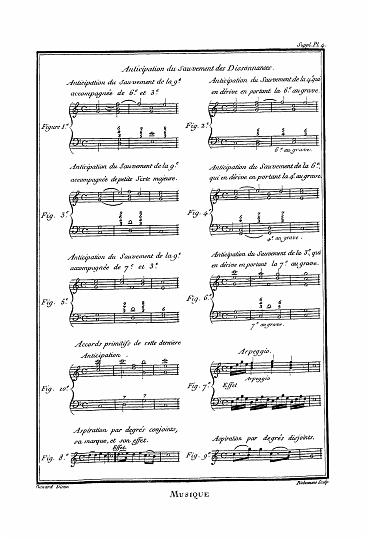S. m. (Littérature) auteur qui écrit des fables, fabulas, c'est-à-dire des narrations fabuleuses, accompagnées d'une moralité qui sert de fondement à la fiction.
Non-seulement un fabuliste doit se proposer sous le voîle de la fiction, d'annoncer quelque vérité morale, utîle pour la conduite des hommes, mais encore l'annoncer d'une manière qui ne rebute point l'amour-propre, toujours rebelle aux préceptes directs, et toujours favorable à ces déguisements heureux qui ont l'art d'instruire en amusant.
Les enfants nouveaux venus dans le monde, n'en connaissent pas les habitants, ils ne se connaissent pas eux-mêmes ; mais il convient de les laisser dans cette ignorance le moins qu'il est possible. Il leur faut apprendre ce que c'est qu'un lion, un renard, un singe, et pour quelle raison on compare quelquefois un homme à de tels animaux : c'est à quoi les fables sont destinées, et les premières notions de ces choses proviennent d'elles ; ensuite par les raisonnements et les conséquences qu'on peut tirer des fables, on forme le jugement et les mœurs des enfants. Plutôt que d'être réduits à corriger nos mauvaises habitudes, nos parents devraient travailler à les rendre bonnes, pendant qu'elles sont encore indifférentes au bien et au mal ; or les fables y peuvent contribuer infiniment, et c'est ce qui a fait dire à La Fontaine qu'elles étaient descendues du ciel pour servir à notre instruction :
L'apologue est un don qui vient des immortels,
Ou si c'est un présent des hommes,
Quiconque nous l'a fait, mérite des autels.
Esope, suivant tous les critiques, mérite ces autels : c'est à lui qu'on est redevable de ce beau présent ; c'est lui qui a la gloire de cette invention, ou du moins qui a si bien manié ce sujet, qu'on l'a regardé dans l'antiquité comme le père ou le principal auteur des apologues : c'est ce qui a engagé Philostrate à embellir cette vérité par une fiction ingénieuse. " Esope, dit-il, étant berger, menait souvent paitre ses troupeaux près d'un temple de Mercure où il entrait quelquefois, faisant au dieu de petites offrandes, comme de fleurs, d'un peu de lait, de quelques rayons de miel, et lui demandant avec instance quelques rayons de sagesse. Plusieurs se rendaient aussi dans le même temple pour le même dessein, et faisaient au dieu des offrandes très-considérables. Mercure voulant reconnaître leur piété, donna aux uns le don de l'Astrologie, aux autres le don de l'éloquence, et à quelques-uns le don de la Musique. Il oublia par malheur Esope ; mais comme son intention était de le récompenser, il lui donna le don de faire des fables "... Revenons à l'histoire.
Esope a cela de commun avec Homère, qu'on ignore le vrai lieu de sa naissance ; néanmoins l'opinion générale le fait sortir d'un bourg de Phrygie. Il florissait du temps de Solon, c'est-à-dire vers la 52e olympiade ; il naquit esclave, et servit en cette qualité plusieurs maîtres. Il apprit à Athènes la pureté de la langue grecque, comme dans sa source ; perfectionna ses talents par les voyages, et se distingua par ses réponses dans l'assemblée des sept sages. Sa haute réputation étant parvenue jusqu'aux oreilles de Crésus roi de Lydie, ce monarque le fit venir à sa cour, le prit en affection, et l'honora de sa confiance. Mais l'étude favorite d'Esope fut toujours la Philosophie morale, dont il remplit son âme et son esprit, convaincu de l'inconstance et de la vanité des grandeurs humaines : on sait son bon mot sur cet article. Chylon lui ayant demandé quelle était l'occupation de Jupiter, remporta d'Esope cette réponse merveilleuse : Jupiter abaisse les choses hautes, et élève les choses basses. Cependant il fut traité comme sacrilege ; car ayant été envoyé par Crésus au temple de Delphes, pour offrir en son nom des sacrifices, ses discours sur la nature des dieux indisposèrent les Delphiens, qui le condamnèrent à la mort. Envain Esope leur raconta la fable de l'aigle et de l'escarbot pour les ramener à la clémence, cette fable ne toucha point leur cœur ; ils précipitèrent Esope du haut de la roche d'Hyampie, et s'en repentirent trop tard.
Après sa mort les Athéniens se croyant en droit de se l'approprier, parce qu'il avait eu pour son premier maître Démarchus citoyen d'Athènes, lui érigèrent une statue, que l'on conjecture avoir été faite par Lysippe. Enfin pour consoler la Grèce entière qui pleurait sa perte, les Poètes furent obligés de feindre que les dieux l'avaient ressuscité. Voilà tout ce qu'on sait d'Esope, même en rassemblant divers passages d'Hérodote, d'Aristophane, de Plutarque, de Diogène de Laèrce et de Suidas. M. de Méziriac en a fait un bel usage dans la vie de ce fabuliste, qu'il a publiée en 1632.
Il n'est pas facîle de décider si l'inventeur de l'apologue composa ses fables de dessein formé, pour en faire une espèce de code qui renfermât dans des fictions allégoriques toute la morale qu'il voulait enseigner ; ou bien si les différentes circonstances dans lesquelles il se trouva, y ont successivement donné lieu. De quelque façon et dans quelque vue qu'il ait composé ses fables, il est certain qu'elles ne sont pas toutes parvenues jusqu'à nous, les anciens en ont cité quelques-unes qui nous manquent ; mais il n'est pas moins certain qu'elles étaient si familières aux Grecs, que pour taxer quelqu'un d'ignorance ou de stupidité, il avait passé en proverbe de dire, cet homme ne connait pas même Esope.
Il faut ajouter à sa gloire, qu'il sut employer avec art contre les défauts des hommes, les leçons les plus sensées et les plus ingénieuses dont l'esprit humain put s'aviser. Celui qui a dit que ses apologues sont les plus utiles de toutes les fables de l'antiquité, savait bien juger de la valeur des choses : c'est Platon qui a porté ce jugement. Il souhaite que les enfants sucent les fables d'Esope avec le lait, et recommande aux nourrices de les leur apprendre ; parce que, dit-il, on ne saurait accoutumer les hommes de trop bonne heure à la vertu.
Apollonius de Thyane ne s'est pas expliqué moins clairement sur le cas qu'il faisait des fables d'Esope, aussi ne sont-elles jamais tombées dans le mépris. Notre siècle, quelque dédaigneux et quelqu'orgueilleux qu'il sait, continue de les estimer ; et le travail que M. Lestrange a fait sur ces mêmes fables en Angleterre, y est toujours très-applaudi.
Quoique la vie du fabuliste phrygien, donnée par Planude, soit un vrai roman, de l'aveu de tout le monde, il faut cependant convenir que c'est un roman heureusement imaginé, que d'avoir conservé dans l'inventeur de l'apologue sa qualité d'esclave, et d'avoir fait de son maître un homme plein de vanité. L'esclave ayant à ménager l'orgueil du maître, il ne devait lui présenter certaines vérités qu'avec précaution ; et l'on voit aussi dans sa vie, que le sage Esope sait toujours concilier les égards et la sincérité par ses apologues. D'un autre côté, le maître qui s'arroge le nom de philosophe, ne devait pas être homme à s'en tenir à l'écorce ; il devait tirer des fictions de l'esclave les vérités qu'il y renfermait : il devait se plaire à l'artifice respectueux d'Esope, et lui pardonner la leçon en faveur de l'adresse et du génie. Nous autres fabulistes, pouvait dire Esope, nous sommes des esclaves qui voulons instruire les hommes sans les fâcher, et nous les regardons comme des maîtres intelligens qui nous savent gré de nos ménagements, et qui reçoivent la vérité, parce que nous leur laissons l'honneur de la deviner en partie.
Socrate songeant à concilier ensemble le caractère de poète et celui de philosophe, fit à son tour des fables qui contenaient des vérités solides, et d'excellentes règles pour les mœurs ; il consacra même les derniers moments de sa vie à mettre en vers quelques-uns des apologues d'Esope.
Mais ce digne mortel, qui passe communément pour avoir eu le plus de communication avec les dieux, n'est pas le seul qui ait considéré comme sœurs la Poésie et les Fables. Phèdre, affranchi d'Auguste, et dans la suite persécuté par Séjan, suivit l'exemple de Socrate, et sa façon de penser. Se voyant sous un règne où la tyrannie rendait dangereux tout genre d'écrire un peu libre et un peu élevé, il évita de se montrer d'une façon brillante, et vécut dans le commerce d'un petit nombre d'amis, éloigné de tous lieux où l'on pouvait être entendu par les délateurs. " L'homme, dit-il, se trouvant dans la servitude, parce qu'il n'osait parler tout haut, glissa dans ses narrations fabuleuses les pensées de son esprit, et se mit par ce moyen à couvert de la calomnie ". Préface du troisième livre de ses fables, qu'il dédia à Eutyche. Il s'occupa donc dans la solitude du cabinet à écrire des fables, et son génie poétique lui fut d'une grande ressource pour les composer en vers ïambiques. Quant à la matière, il la traita dans le goût d'Esope, comme il le déclare lui-même :
Aesopus auctor, quam materiam reperit,
Hanc ego polivi versibus senariis.
Il ne s'écarta de son modèle qu'à quelques égards, mais alors ce fut pour le mieux. Du temps d'Esope, par exemple, la fable était comptée simplement, la moralité séparée, et toujours de suite. Phèdre ne crut pas devoir s'assujettir à cet ordre méthodique ; il embellit la narration, et transporte quelquefois la moralité de la fin au commencement de la fable. Ses fleurs, son élégance et son extrême briéveté le rendent encore très-recommandable ; et si l'on y veut faire attention, on reconnaitra dans le poète de Thrace le caractère de Térence. Sa simplicité est si belle, qu'il semble difficîle d'élever notre langue à ce haut point de perfection. Son laconisme est toujours clair, il peint toujours par des épithetes convenables ; et ses descriptions renfermées souvent en un seul mot, répandent encore de nouvelles grâces dans ses ouvrages.
Il est vrai que cet auteur plein d'agréments, a été très-peu connu pendant plusieurs siècles ; mais ce phénomène doit seulement diminuer notre surprise à l'égard de l'obscurité qui a couvert la gloire de Paterculus son contemporain, et pareillement de Quinte-Curce, dont personne n'a fait mention avant le XV. siècle. Phèdre a presque eu le même sort ; Pierre Pithou partage avec son frère l'honneur de l'avoir mis le premier au jour, l'an 1596. Les savants de Rome jugèrent d'abord que c'était un faux nom ; mais bientôt après ils crurent rencontrer dans son style les caractères du siècle d'Auguste, et personne n'en doute aujourd'hui. Phèdre est devenu un de nos précieux auteurs classiques, dont on a fait plusieurs traductions françaises et de très-belles éditions latines, publiées par les soins de MM. Burmann et Hoogstraten, en Hollande, depuis l'édition de France à l'usage du Dauphin.
Après Phèdre, Rufus Festus Aviénus, qui vivait sur la fin du IVe siècle, sous l'empire de Gratien, nous a donné des fables en vers élégiaques, et les a dédiées à Théodose l'ancien, qui est le même que Macrobe. Mais les fables d'Aviénus sont bien éloignées de la beauté et de la grâce de celles de Phèdre ; outre qu'elles ne paraissent guère propres aux enfants, s'il est vrai, comme le pense Quintilien, qu'il ne leur faut montrer que les choses les plus pures et les plus exquises.
Faèrno (Gabrieli), natif de Crémone en Italie, poète latin du XVIe siècle, mort à Rome en 1561, s'est attiré les louanges de quelques savants, pour avoir mis les fables d'Esope en diverses sortes de vers ; mais il aurait été plus estimé, dit M. de Thou, s'il n'eut point caché le nom de Phèdre, sur lequel il s'était formé, ou qu'il n'eut pas supprimé ses écrits, qu'il avait entre les mains. Vainement M. Perrault a traduit les fables de Faèrno en français ; sa traduction qui vit le jour à Paris en 1699, est entièrement tombée dans l'oubli.
Je n'ai pas fait mention jusqu'ici de deux fabulistes grecs nommés Gabrias et Aphton, parce que le petit détail qui les concerne, est plutôt une affaire d'érudition que de gout. Au reste les curieux trouveront dans la Bibliothèque de Fabricius tout ce qui regarde ces deux auteurs ; j'ajouterai seulement que c'est du premier que veut parler La Fontaine, quand il dit :
Mais surtout certain Grec renchérit, et se pique
D'une élégance laconique :
Il renferme toujours son conte en quatre vers,
Bien ou mal ; je le laisse à juger aux experts.
Si quelqu'un me reprochait encore mon silence à l'égard de Locman, dont les fables ont été publiées en arabe et en latin par Thomas Erpenius, je lui ferais la même réponse, et je le renverrais à la Bibliothèque de d'Herbelot, à l'Histoire orientale d'Hottinger, ou à d'autres érudits, qui ont discuté l'incertitude de toutes les traditions qu'on a débitées sur le compte de ce fabuliste étranger.
Mais Pilpay ou Bidpay parait plus digne de nous arrêter un moment. Quoique ce rare esprit ait gouverné l'Indostan sous un puissant empereur, il n'en était pas pour cela moins esclave ; car les premiers ministres des souverains, et surtout des despotes, le sont encore plus que leurs moindres sujets : aussi Pilpay renferma sagement sa politique dans ses fables, qui devinrent le livre d'état et la discipline de l'Indostan. Un roi de Perse digne du trône, prévenu de la beauté des maximes de l'auteur, envoya recueillir ce trésor sur les lieux, et fit traduire l'ouvrage par son premier médecin. Les Arabes lui ont aussi décerné l'honneur de la traduction, et il est demeuré en possession de tous les suffrages de l'Orient. J'accorderais volontiers à M. de la Mothe que les fables de Pilpay ont plus de réputation que de valeur ; qu'elles manquent par le naturel, l'unité et la justesse des pensées ; et que de plus elles sont un composé bizarre d'hommes et de génies dont les aventures se croisent sans-cesse. Mais d'un autre côté Pilpay est inventeur, et ce mérite compensera toujours bien des défauts.
Enfin le célèbre La Fontaine a paru pour effacer tous les fabulistes anciens et modernes ; j'ose même y comprendre Esope et Phèdre réunis. Si le Phrygien a la première gloire de l'invention, le François a certainement celle de l'art de conter, c'est la seconde ; et ceux qui la suivront, n'en acquerront jamais une troisième.
Envain un excellent critique des amis de La Fontaine, M. Patru, voulut le dissuader de mettre ses fables en vers ; envain il lui représenta que leur principal ornement était de n'en avoir aucun ; que d'ailleurs la contrainte de la poésie, jointe à la sévérité de notre langue, l'embarrasserait continuellement, et bannirait de la plupart de ses récits la briéveté, qu'on peut en appeler l'âme, puisque sans elle il faut nécessairement que la fable languisse. La Fontaine par son heureux génie surmonta tous ces obstacles, et fit voir que les grâces du laconisme ne sont pas tellement ennemies des muses françaises, que l'on ne puisse dans le besoin les faire aller ensemble.
Nourri des meilleurs ouvrages du siècle d'Auguste, qu'il ne cessait d'étudier, tantôt il a répandu dans ses fables une érudition enjouée, dont ce genre d'écrire ne paraissait pas susceptible ; tantôt, comme dans le paysan du Danube, il a saisi le sublime de l'éloquence. Mille autres beautés sans nombre qui nous enchantent et nous intéressent, brillent de toutes parts dans ses fables ; et plus on a de gout, plus on est éclairé, plus on est capable de les sentir. Quelle admirable naïveté dans le style et le récit ! Combien d'esprit voilé sous une simplicité apparente ! Quel naturel ! quelle facilité de tours et d'idées ! quelle connaissance des travers du corps humain ! quelle pureté dans la morale ! quelle finesse dans les expressions ! quel coloris dans les peintures. Voyez l'article FABLE, où l'on a si bien développé en quoi consiste le charme de celles de La Fontaine.
Ce mortel, unique dans la carrière qu'il a courue, né à Château-Thierry en 1621, mort à Paris en 1695, est le seul des grands hommes de son temps qui n'eut point de part aux bienfaits de Louis XIV. Il y avait droit par son mérite et par sa pauvreté. Cet homme célèbre, ajoute M. de Voltaire, réunissait en lui les grâces, l'ingénuité, et la crédulité d'un enfant : il a beaucoup écrit contre les femmes, et il eut toujours le plus grand respect pour elles : il faisait des vers licencieux, et il ne laissa jamais échapper aucune équivoque ; si fin dans ses ouvrages, si simple dans son maintien et dans ses discours, si modeste dans ses productions, que M. de Fontenelle a dit plaisamment que c'était par bêtise qu'il préférait les fables des anciens aux siennes ; en effet il a presque toujours surpassé ses originaux, sans le croire et sans s'en douter.
Il a tiré d'Esope, de Phèdre, d'Aviénus, de Faèrne, de Pilpay, et de quelques autres écrivains moins connus, plusieurs de ses sujets ; mais comment les rend-t-il ? toujours en les ornant et en les embellissant au point que toutes les beautés sont de lui, et les défauts, s'il y en a, sont des autres. Par exemple, le fond de la fable intitulée, le meunier, son fils et l'âne, est empruntée de l'agaso de Frideric Widebrame, que Dornavius a donné dans l'amphitheatrum sapientiae socraticae, tom. I. pag. 502. in-fol. Hanovr. 1619. Dans l'auteur latin c'est un récit sans grâce, sans sel et sans finesse ; dans le poète français c'est un chef-d'œuvre de l'art, une fable unique en son genre, une fable qui vaut un poème entier. Chose étonnante ! tout prend des charmes sous la plume de cet aimable auteur, jusqu'aux inégalités et aux négligences de sa poésie. D'ailleurs on ne trouve nulle part une façon de narrer plus ingénieuse, plus variée, plus séduisante ; et cela est si vrai, que ses fables sont peut-être le seul ouvrage dont le mérite ne soit ni balancé ni contredit par personne en aucun pays du monde.
En un mot, le beau génie de La Fontaine lui a fait rencontrer dans ce genre de composition mille et mille traits qui paraissent tellement propres à son sujet, que le premier mouvement du lecteur est de ne pas douter qu'il ne les trouvât aussi-bien que lui. C'est-là vraisemblablement une des raisons qui ont engagé plusieurs poètes à l'imiter ; et tous, sans en excepter M. de la Mothe, avec trop peu de succès.
Nous ne prétendons pas nier qu'il ne se trouve dans les fables de ce dernier écrivain, de la justesse, une composition régulière, une invention ingénieuse, quantité d'excellentes tirades, d'endroits pleins d'esprit, de finesse et de délicatesse ; mais il n'y a point ce beau naturel qui plait tant dans La Fontaine. M. de la Mothe n'a point attrapé les grâces simples et ingénues du fablier de madame de Bouillon ; il semble qu'il réfléchissait plus qu'il ne pensait, et qu'il avait plus de talent pour décrire que pour peindre. Voyez encore à ce sujet l'article FABLE.
On loua excessivement celles de M. de la Mothe, lorsqu'il les récita dans les assemblées publiques de l'Académie Française ; mais quand elles furent imprimées, elles ne soutinrent plus les mêmes éloges. Quelques personnes se souviennent encore d'avoir oui raconter qu'un de ses plus zélés partisans avait donné à son neveu deux fables à apprendre par cœur, l'une de La Fontaine, et l'autre de la Mothe. L'enfant, âgé de six à sept ans, avait appris promptement celle de La Fontaine, et n'avait jamais pu retenir un vers de celle de la Mothe.
Il ne faut pas croire que le public ait un caprice injuste, quand il a improuvé dans les fables de la Mothe des naïvetés qu'il parait avoir adoptées pour toujours dans celles de La Fontaine : ces naïvetés ne sont point les mêmes. Que La Fontaine appelle un chat qui est pris pour juge, sa majesté fourrée, cette épithète fait une image simple, naturelle et plaisante ; mais que M. de la Mothe appelle un cadran un greffier solaire, cette idée alambiquée révolte, parce qu'elle est sans justesse et sans grâces.
Je suis bien éloigné de faire ces réflexions pour jeter le moindre ridicule sur le mérite distingué d'un homme des plus estimables que la France ait eus dans les Lettres, et dont l'odieuse envie n'a pu ternir la gloire. M. Houdart de la Mothe, mort sexagénaire à Paris en 1731, après avoir eu le malheur d'être privé de l'usage de ses yeux dès l'âge de vingt-quatre ans, était un esprit très-pénétrant, très-étendu ; un écrivain fécond et délicat : un modèle de décence, de politesse et d'honnêteté dans la critique. Ses ouvrages, en grand nombre, sont remplis de beautés, de goût et d'érudition choisie. Enfin les fables même qu'il a publiées, indépendamment des autres morceaux excellents qui nous restent de lui en plusieurs genres, empêcheront toujours qu'on ose le mettre au rang des auteurs médiocres.
Je ne dirai rien de nos voisins ; le talent de conter supérieurement n'a point passé chez eux, ils n'ont point de fabulistes. Je sai bien que le poète Gai a fait en anglais des fables estimées par sa nation, et que Geller, poète saxon, a publié des fables et des contes qui ont eu beaucoup de succès dans son pays ; mais les Anglais ne regardent les fables de Gai que comme son meilleur ouvrage, et les Allemands même reprochent à Geller d'être monotone et diffus. Je doute que ce qui manque à l'un pour être excellent, et que deux défauts aussi considérables que ceux qu'on reconnait dans l'autre, puissent être rachetés par la pureté du style, la délicatesse des pensées, et les sentiments d'amour et d'amitié qu'on dit que celui-ci a su répandre dans ce genre d'ouvrages ; et par la force de l'expression, et la beauté de la morale et des maximes qu'on accorde à celui-là. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
FABULISTE
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Beaux-arts
- Catégorie : Littérature
- Affichages : 4059