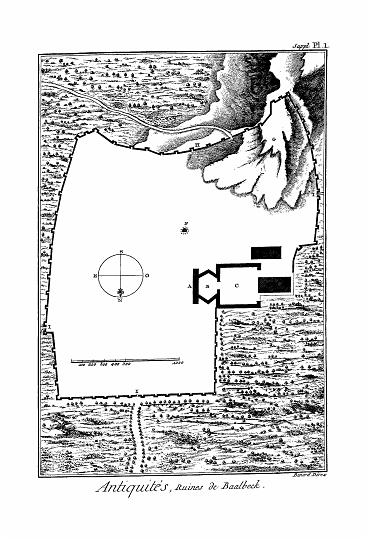S. f. (Art militaire et Histoire) différend entre des princes ou des états, qui se décide par la force ou par la voie des armes. C'est-là à-peu-près la définition de Grotius, qui dit que la guerre est l'état de ceux qui tâchent de vider leurs différends par la voie de la force.
Suivant Montecuculli, la guerre est une action d'armées qui se choquent en toute sorte de manières, et dont la fin est la victoire. Cette définition n'est pas absolument exacte, parce que lorsqu'un état puissant en attaque un plus faible, le but de la guerre dans le dernier n'est pas tant de remporter la victoire sur l'aggresseur, que de s'opposer à ses desseins.
Quoi qu'il en sait, l'idée de la guerre est trop commune et ses effets trop connus, pour s'arrêter à l'expliquer plus particulièrement. Comme les princes n'ont point de tribunal sur terre qui puisse juger de leurs différends et de leurs prétentions, c'est la guerre ou la force qui peut seule en décider, et qui en décide ordinairement.
Nous n'entrerons dans aucun détail sur les différentes circonstances qui rendent les guerres justes ou injustes. Nous renvoyons pour ce sujet au savant traité de Grotius, de jure belli ac pacis ; nous donnerons seulement une légère idée de la guerre offensive et de la guerre défensive. Elles peuvent se diviser chacune en guerre de campagne, et en guerre des siéges.
La guerre offensive est celle dans laquelle on se propose d'attaquer l'ennemi. Dans la défensive, on a pour principal objet de résister aux efforts de l'ennemi, et de l'empêcher de faire des conquêtes.
La guerre de campagne est celle qui se fait entre deux armées opposées. A l'égard de celle des siéges, elle consiste dans l'attaque et dans la défense des places.
Avant que d'entrer dans quelque détail sur ce sujet, observons d'abord que la guerre est un art qui a ses règles et ses principes, et par conséquent sa théorie et sa pratique. " Tous les Arts et tous les Métiers se perfectionnent par l'exercice. Si cette maxime a lieu dans les plus petites choses, à plus forte raison dans les plus importantes. Or qui doute que l'art de la guerre ne soit le plus grand de tous ? C'est par lui que la liberté se conserve, que les dignités se perpétuent, que les provinces et l'empire se maintiennent : c'est cet art auquel les Lacédémoniens autrefois, et ensuite les Romains, sacrifièrent toutes les autres sciences. C'est l'art de ménager la vie des combattants et de remporter l'avantage " Vegece, traduction de M. de Segrais.
L'étude d'un art si important doit, selon M. de Folard, faire la principale occupation des princes et des grands. Rien de plus brillant que la carrière d'un général qui fait servir sa science, son zèle, et son courage au service du prince et de la patrie : " quel est l'art, dit cet auteur, qui égale un particulier à son souverain, qui le rend dépositaire de toute sa puissance, de toute la gloire, et de toute la fortune des états " ? La guerre seule a cet avantage : peut-il être un motif plus noble et plus intéressant pour chercher à s'y distinguer !
Les règles ou les principes de la guerre qui en forment la théorie, ne sont autre chose que le fruit des observations faites en différents temps pour faire combattre les hommes le plus avantageusement qu'il est possible. Thucidide remarque que la fameuse guerre du Péloponnèse servit à augmenter l'expérience des Grecs dans l'art militaire ; parce que comme cette guerre fut souvent interrompue et recommencée, chacun s'appliquait à rectifier les fautes qui avaient été remarquées dans les campagnes précédentes.
La première idée qu'on a dû avoir lorsqu'on a formé des hommes pour combattre, a sans-doute été de les armer pour agir offensivement contre l'ennemi.
Les premières armes furent d'abord fort simples ; c'était de gros bâtons, ou des espèces de massues ou casse-têtes, ainsi qu'en ont encore aujourd'hui les Sauvages. On dut aussi se servir de pierres, qu'on jetait de loin avec la main : mais on trouva bientôt l'invention de la fronde, pour les jeter de plus loin et avec plus de force. Il y a apparence qu'on songea ensuite à armer les bâtons d'un fer pointu ; qu'on trouva bientôt après l'invention des épées ou des sabres ; et qu'à l'imitation des pierres qu'on lançait avec la fronde, on imagina l'arc pour lancer également les flèches : car toutes ces armes sont de la plus haute antiquité.
Après avoir armé les combattants, il fut aisé de s'apercevoir qu'en les faisant agir en foule et sans ordre, ils ne pouvaient se servir de leurs armes, et qu'ils s'embarrassaient réciproquement.
Pour remédier à cet inconvénient, on les forma sur des lignes droites, et l'on mit plusieurs de ces lignes les unes derrière les autres, pour en augmenter la force. Voyez RANGS et FILES.
Après avoir armé les troupes et leur avoir donné l'arrangement précédent, il fallut leur apprendre à se servir de leurs armes, et à se mouvoir en ordre de tous les sens ; c'est-à-dire qu'il fallut leur apprendre l'exercice ou le maniement des armes, et les évolutions. Voyez EXERCICE et EVOLUTION.
Les hommes en faisant usage de leurs armes contre l'ennemi, cherchèrent à se couvrir ou à se garantir de l'effet des siennes. Pour cet effet on imagina les armes défensives, telles que les casques, cuirasses, boucliers, etc. Voyez ARMES DEFENSIVES.
Les troupes étant armées ou exercées, il fallut les diviser en plusieurs corps, propres à agir et à se mouvoir facilement : de-là l'origine des compagnies, des cohortes, des régiments, des bataillons, etc.
On songea aussi à arranger ces différents corps entr'eux, comme les troupes le sont dans leurs corps particuliers, et l'on forma les ordres de bataille sur deux ou trois lignes de troupes. Voyez LIGNE DE TROUPES et ORDRE DE BATAILLE.
On ne s'avisa vraisemblablement pas dans les premiers temps de faire combattre les hommes à cheval ; mais il fut aisé de s'apercevoir bien-tôt du besoin de la cavalerie pour poursuivre l'ennemi, le disperser après sa défaite, et l'empêcher de se rallier.
Il y a apparence que la cavalerie fut d'abord destinée à cet effet, et qu'elle ne consistait guère qu'en troupes legeres : mais on vit ensuite que cette cavalerie pourrait encore rendre d'autres services ; qu'elle était propre en plaine à combattre l'ennemi, et que d'ailleurs par la rapidité de ses mouvements, elle pouvait se transporter bien-tôt d'un lieu en un autre et se tirer du danger bien plus promptement que l'infanterie : on forma donc des corps de cavalerie plus ou moins nombreux, suivant la nature des peuples et des pays où l'on faisait la guerre (a)
La cavalerie pouvant harceler l'infanterie en campagne, et essayer de la défaire sans craindre de se commettre par la facilité qu'elle a de se retirer, on imagina des armes de longueur pour la tenir en respect ; c'est-à-dire qu'on inventa les sarisses ou les piques, dont la longueur empêchait le cheval du cavalier de tomber sur le fantassin : par-là l'infanterie
(a) Il n'est pas question d'examiner ici si les anciens, au lieu de monter sur les chevaux pour combattre, les ont d'abord attelés à des chars. Nous renvoyons pour ce sujet à l'article EQUITATION. Il nous suffit que la cavalerie ait été de la plus haute antiquité dans les armées, et c'est surquoi les anciens auteurs ne laissent aucun doute.
put paraitre en plaine devant la cavalerie, et la combattre même avec avantage ; mais la cavalerie fut toujours jugée nécessaire dans les armées pour soutenir et fortifier l'infanterie dans les lieux ouverts, donner des nouvelles de l'ennemi, le poursuivre après la défaite, etc.
Il est vraisemblable que les différentes choses dont on vient de parler, occupèrent d'abord les nations guerrières, et que la fortification doit aussi son origine aux premières entreprises des puissances qui voulaient s'assujettir les autres. " D'abord, dit le comte de Pagan dans son traité de fortification, " les campagnes étaient les plus agréables demeures ; l'assurance des particuliers consistait en l'innocence de tous, et les vertus et les vices n'admettaient point encore de différence parmi les hommes ; mais lorsque l'avarice et l'ambition donnèrent lieu aux commandements et aux conquêtes, la faiblesse cédant à la force, l'oppression suivit les vaincus ". Les moins puissants se réunirent ensemble dans le même lieu, pour être plus en état de se défendre : de-là l'origine des villes. On s'appliqua à les entourer d'une enceinte, capable d'en fermer l'entrée à l'ennemi. Cette enceinte fut d'abord de simples palissades, puis des murs entourés de fossés ; on y ajouta ensuite des tours. Voyez FORTIFICATION.
A mesure que la fortification se perfectionnait, l'ennemi inventait différentes machines propres à en détruire les ouvrages : telles furent le bélier et les autres machines de guerre des anciens. Voyez BELIER, BALISTE, CATAPULTE, etc.
Ces machines ont été en usage jusqu'à l'invention de la poudre, qui donna lieu d'imaginer le canon, le mortier, les arquebuses, les mousquets, les fusils, et nos autres armes à feu.
L'invention ou la découverte de la poudre à canon, qui a donné lieu de changer l'ancienne fortification, n'a pas introduit beaucoup de nouveautés dans les armes offensives du soldat. Le fusil répond assez exactement aux armes de jet des anciens ; mais les armes défensives ont été abandonnées insensiblement dans l'infanterie, à cause de la difficulté d'en avoir d'assez fortes pour résister à la violence du fusil. La cavalerie a seulement des plastrons ou des devants de cuirasse, et les officiers des cuirasses entières, que les règlements les obligent de porter. Voyez ARMES DEFENSIVES.
Dans les commencements, où les armées s'éloignaient peu de leur demeure ordinaire, et où elles étaient peu de jours en campagne, les troupes pouvaient rester sans inconvénients exposées aux injures de l'air. Mais lorsqu'on voulut leur faire tenir la campagne plus longtemps, on imagina de leur donner des tentes ou des espèces de maisons de toile, que les soldats pouvaient porter avec eux. On forma alors des camps, et l'on fit camper les armées. Voyez CASTRAMETATION.
On pensa aussi alors à fortifier ces camps, pour les mettre à l'abri des surprises de l'ennemi, faire reposer les troupes plus tranquillement, et diminuer le grand nombre de gardes qu'il aurait fallu pour la sûreté du camp.
Toutes les différentes choses dont nous venons de parler, se sont insensiblement établies par l'usage parmi toutes nations policées. Celles qui y ont donné le plus d'attention et qui les ont portées au plus grand point de perfection, ont toujours eu un avantage considérable sur celles qui les avaient plus négligées. Ce n'est pas le grand nombre qui décide des succès à la guerre, mais l'habileté des chefs, et la bonté des troupes disciplinées avec soin, et formées dans tous les exercices et les manœuvres militaires. De-là vient que les Grecs, auxquels on est particulièrement redevable des progrès de l'art militaire, avaient trouvé le moyen avec de petites armées de vaincre les nombreuses armées des Perses. Rien de plus admirable que la fameuse retraite des dix mille de Xenophon. Ces grecs, quoiqu'en petit nombre au milieu de l'empire des Perses, ayant près de huit cent lieues à faire pour se retirer, ne purent être entamés par les forces d'Artaxerxès. Ils surmontèrent par leur courage et par l'habileté de leurs chefs tous les obstacles qui s'opposaient à leur retour.
Quelqu'utiles que soient l'exercice et la discipline pour former de bonnes troupes, l'art de la guerre ne consiste pas uniquement dans cet objet. Ce n'est qu'un moyen de parvenir plus surement à réussir dans ses entreprises : ce qui appartient essentiellement à l'art de la guerre, et qui le caractérise, c'est l'art de savoir employer les troupes pour leur faire exécuter tout ce qui peut réduire l'ennemi plus promptement, et le forcer à faire la paix ; car la guerre est un état violent qui ne peut durer, et l'on ne doit la faire que pour se procurer la jouissance des douceurs et des avantages de la paix.
Il est facîle avec de la bonne volonté, de l'application, et un peu de discernement, de se mettre au fait de toutes les règles ordinaires de la guerre, et de savoir les différentes manœuvres des troupes ; mais le génie de la guerre ne peut se donner ni s'acquérir par l'étude. Elle peut seulement le perfectionner. On peut appliquer à l'art de la guerre ce que l'Horace français dit du jeu d'échets comparé à l'art de faire des vers.
Savoir la marche est chose très-unie,
Jouer le jeu, c'est le fruit du génie ;
Je dis le fruit du génie achevé,
Par longue étude et travail cultivé.
Savoir toutes les manœuvres de la guerre, tout ce qui concerne l'ordre, la disposition et l'arrangement des troupes, tout cela quoique très-utîle en soi et absolument nécessaire en général, est chose très-unie. Mais faire la guerre avec succès, rompre les desseins de l'ennemi, trouver le moyen d'éluder sa supériorité, faire des entreprises continuellement sur lui sans qu'il puisse s'y opposer, c'est-là le véritable fruit du génie, et du génie achevé par longue étude et travail cultivé.
" Si un homme, dit M. le maréchal de Saxe, n'est pas né avec les talents de la guerre, et que ces talents ne soient perfectionnés, il ne sera jamais qu'un général médiocre : l'application rectifie les idées, mais elle ne donne jamais l'âme ; c'est l'ouvrage de la nature ".
Mais quelqu'avantage qu'on en ait reçu, si on ne cultive pas ses talents par l'étude et la méditation, il ne faut pas espérer, dit M. de Folard, que Dieu nous accorde la science de la guerre par infusion. " Cependant à voir, dit-il, le peu d'application que chacun apporte à s'y rendre capable, on croirait assez qu'elle s'apprend en un jour, et que cette lumière d'ordre, de ruse, d'artifice pour s'en bien démêler, de profondeur dans la conduite des guerres les plus difficiles, de prévoyance et de précaution qui nous éclaire, qui ne se perd ni ne s'éteint point dans les dangers les plus éminens, nait avec nous, et que nous sommes de ces génies extraordinaires que la providence se plait quelquefois à faire paraitre dans le monde et de loin, pour sauver ou renverser les monarchies ".
On ne peut acquérir la science de la guerre que par l'étude et par la pratique. La pratique seule sans la théorie ne peut jamais donner que des connaissances fort bornées. Il faut qu'elle soit aidée et soutenue par les lumières de la théorie.
On a Ve dans l'article ÉTUDE MILITAIRE, quelles sont les différentes connaissances qui servent de base au grand art de la guerre. Lorsqu'on est parvenu à se les rendre propres, il faut chercher dans les livres les règles et les principes de cet art important. " Ce n'est pas, dit M. de Folard sur ce sujet, dans la moyenne antiquité qu'il faut aller chercher nos maîtres ; c'est chez les Grecs et les Romains, lorsque ces peuples étaient dans leur force, et que leur discipline militaire, ou pour mieux dire, la science de la guerre qui renferme tout, avait été portée au plus haut point de perfection où ces grands hommes avaient pu la porter. C'est surtout chez les Grecs qu'il faut les chercher. Ce sont eux qui d'une routine (car la guerre n'était autre chose d'abord) posèrent des principes certains et assurés. Il y eut alors des maîtres et des professeurs pour l'enseigner, et l'expérience ne fut plus nécessaire pour former d'excellents officiers et des généraux d'armées ; elle ne servait que pour les perfectionner, comme Thucydide, Xenophon, et Plutarque nous l'assurent. Préface du V. vol. du comment. sur Polybe.
Comme l'étude de la guerre demande du temps, du travail, et de l'application, il se trouve bien des gens, qui, pour en éluder les difficultés, prétendent que cette étude n'est point nécessaire, et que la pratique peut seule apprendre l'art de la guerre. " Mais s'il était vrai, dit le savant auteur que nous venons de citer, que la guerre ne roulât que sur l'expérience, un royaume, par exemple, comme la France, approcherait de sa décadence selon le plus ou moins de temps qu'il se maintiendrait en paix, et dix ou douze années de repos ou d'inaction nous seraient plus ruineuses que quinze ou vingt années d'une guerre continuelle. Que l'on considère, dit toujours cet auteur, quinze ou vingt ans de service sur la tête d'un vieux officier qui ne connait que son expérience et sa routine, et qui se reposant vingt autres dans la paix, oublie ce qu'il a appris dans la guerre. Car qui peut disconvenir que l'expérience ne se perde et ne s'oublie par le défaut d'exercice ? Les officiers-généraux affoiblis par leur âge, ou abattardis par une longue paix, la noblesse amollie et devenue paresseuse sans aucun soin des armes, se livre à toutes sortes de débauches ; et les soldats à leur imitation, n'observent pas certaine discipline qui peut suppléer au défaut de la science de la guerre. Tous ceux qui tiennent pour l'expérience conviennent qu'il n'y a rien à faire, si elle n'est entée sur la prudence militaire : et cette prudence est-elle autre chose que la science qui nous fait voir les routes qui sont capables de nous conduire où nous tendons ? Tel qui a donné bataille dans un pays de plaine, se trouve embarrassé dans un terrain inégal. Il l'est encore plus dans un pays fourré. Il en donnera cinquante toutes différentes les unes des autres, par les différentes situations des lieux qui ne se ressemblent jamais. Souvent les deux champs de bataille diffèrent l'un de l'autre : ce qui n'est pas un petit embarras entre deux généraux ; et soit qu'on attaque ou qu'on soit attaqué, il y a mille changements, mille mouvements à faire très-dangereux et très-délicats, soit dans le commencement ou dans les suites d'un combat, sans compter le fort ou le faible d'une armée sur l'autre, qui peut être mis en considération, c'est-à-dire le plus ou le moins de cavalerie ou d'infanterie, le bon ou le mauvais de l'une et de l'autre. Comment tirer de l'expérience ce que l'on n'a jamais Ve ni pratiqué, et les autres choses qui n'en dépendent pas, etc. ". Nouv. découvert. sur la Guerre.
A toutes ces réflexions de M. de Folard, et à beaucoup d'autres sur la nécessité de la science militaire qu'on trouve en différents endroits de son commentaire sur Polybe, on peut ajouter que s'il faut qu'un officier voie exécuter tout ce qu'il a besoin d'apprendre, il lui sera presqu'impossible de se rendre habîle dans les différents mouvements des armées. Car lorsqu'il est employé à la guerre, il ne voit que la manœuvre particulière de la troupe à laquelle il est attaché, et non pas les mouvements des autres troupes qui sont quelquefois tous différents. Mais supposant qu'il puisse observer quelque disposition particulière dans les autres troupes, comment pourra-t-il en deviner la cause s'il ignore les principes qui peuvent servir à la dévoiler ? Il arrive de-là, comme l'expérience le démontre, que bien des officiers qui ont servi longtemps, et qui même se sont trouvés à de grands mouvements de troupes, ignorent la science de ces mouvements, et qu'ils ne pourraient ni les commander, ni les faire exécuter. L'expérience leur apprend seulement les petits détails de l'exercice et du service particulier, qu'on trouve partout, et qu'il est impossible d'ignorer, parce qu'on est chargé de le faire exécuter journellement ; mais cette partie de la police militaire, quoiqu'elle soit utîle en elle-même et qu'elle fasse honneur à l'officier qui la fait observer avec le plus de soin, ne forme pas la science militaire ; elle n'en renferme tout-au-plus que les premiers rudiments.
L'étude de l'art de la guerre peut tenir lieu d'expérience, mais d'une expérience de tous les siècles. On peut appliquer à cette étude ce que Diodore de Sicîle dit de l'histoire si utîle à tous les hommes, et principalement à ceux qui veulent posséder la science de la guerre. " C'est un bonheur, dit cet auteur, de pouvoir se conduire et se redresser par les erreurs et par les chutes des autres, et d'avoir pour guide dans les hasards de la vie et dans l'incertitude des succès, non une recherche tremblante de l'avenir, mais une connaissance certaine du passé. Si quelques années de plus font préférer dans les conseils les vieillards aux jeunes gens, quelle estime devons-nous faire de l'histoire qui nous apporte l'expérience de tant de siècles ? En effet elle supplée à l'âge qui manque aux jeunes gens, et elle étend de beaucoup l'âge même des vieillards ".
C'est ainsi que ceux qui ont étudié avec soin l'histoire des différentes guerres des nations, qui ont examiné, discuté tout ce qui s'y est observé dans la conduite des armées et des différentes entreprises militaires, peuvent acquérir par-là une expérience qui ne peut être comparée avec la pratique de quelques campagnes.
Comme peu de personnes sont en état de faire une étude aussi étendue de l'art de la guerre, il est à-propos d'indiquer les principaux ouvrages qui peuvent servir à donner les connaissances les plus nécessaires sur la théorie de cet art. Nous avons déjà Ve que M. Folard veut qu'on consulte les Grecs et les Romains. C'est chez eux qu'il faut chercher les vrais principes de l'art militaire ; mais le nombre de leurs auteurs sur ce sujet n'est pas considérable.
" Il y en avait autrefois une infinité, dit M. de Folard dans la préface que nous avons déjà citée, mais tout cela s'est perdu par les malheurs et la barbarie des temps. L'histoire nous a conservé les titres de quelques-uns de ces livres, et les noms de quelques auteurs qui avaient écrit de la guerre, entr'autres de Pyrrhus, roi des Epirotes ; car pour ce qui est des auteurs de la moyenne antiquité, c'est fort peu de chose. A peine ont-ils donné une idée de la guerre, tant ils sont abrégés. Il ne nous en reste qu'un au-dessus des autres, qui est Vegece. Onosander et l'empereur Léon, tous deux Grecs, n'en approchent pas ; et tous les trois ne sont guère plus étendus que nos modernes, mais ils sont plus savants, bien que la science des armées fût presque tombée et même oubliée de leur temps ".
Les anciens ouvrages qu'on peut consulter le plus utilement sur l'art de la guerre, outre celui de Vegece, sont la Cyropédie, ou l'histoire de Cyrus par Xénophon : la retraite des dix mille, et l'histoire de Polybe, les commentaires de César, la tactique d'Elien, etc.
Parmi les modernes, on peut lire le parfait capitaine du duc de Rohan ; les mémoires de M. de Turenne, insérés à la suite de la vie de ce grand capitaine, par M. de Ramsai ; ceux de Montecuculli, de M. le marquis de Feuquières ; les réflexions militaires de M. le marquis de Santa-Cruz ; le commentaire sur Polybe par M. le chevalier Folard ; l'art de la guerre par M. le maréchal de Puysegur ; les rêveries ou mémoires sur la guerre par M. le maréchal de Saxe, etc.
La science de la guerre est si étendue qu'on ne doit pas être surpris du petit nombre de ceux qui y excellent. Ce n'est pas assez que les généraux sachent ranger les armées en bataille, les faire marcher, camper, et combattre ; il faut qu'ils sachent encore préserver leurs armées des maladies qui pourraient les ruiner ou les affoiblir. Il faut aussi savoir encourager le soldat pour le faire obéir volontairement, et supporter patiemment les fatigues extraordinaires auxquelles il peut être exposé. Il faut avoir soin que les vivres ne lui manquent point, et que la cavalerie n'éprouve aucune disette de fourrage. C'est à quoi l'on doit toujours penser de bonne heure. C'est une épargne à contre-temps, dit Vegece, que de commencer à ménager les vivres lorsqu'ils manquent. Cet auteur observe que dans les expéditions difficiles, les anciens distribuaient les vivres par tête, sans avoir égard au grade ; mais on en tenait compte ensuite à ceux à qui on les avait ainsi diminués.
Outre ces différentes attentions, il y en a encore beaucoup d'autres, qu'on peut voir dans l'entretien de Cyrus et de Cambyse, rapporté dans le premier livre de la Cyropédie ; tout cela doit faire sentir combien la science de la guerre demande de travail et d'application. Cependant Polybe conseille encore à ceux qui aspirent au commandement des armées, d'étudier les Arts et les Sciences qui ont quelque rapport à l'art militaire. " Ajouter, dit cet auteur, des connaissances inutiles au genre de vie que nous professons, uniquement pour faire montre et pour parler, c'est une curiosité que je ne saurais approuver ; mais je ne puis non plus goûter que dans les choses nécessaires on s'en tienne à l'usage et à la pratique, et je conseille fort de remonter plus haut. Il est absurde que ceux qui s'appliquent à la danse et aux instruments souffrent qu'on les instruise de la cadence et de la Musique ; qu'ils s'exercent même à la lutte, parce que cet exercice passe pour contribuer à la perfection des deux autres ; et que des gens qui aspirent au commandement des armées, trouvent mauvais qu'on leur inspire quelque teinture des autres Arts et des autres Sciences. De simples artisans seront-ils donc plus appliqués et plus vifs à se surpasser les uns et les autres, que ceux qui se proposent de briller et de se signaler dans la plus belle et la plus haute des dignités ? Il n'y a personne de bon sens qui ne reconnaisse combien cela est peu raisonnable ". Histoire de Polybe, trad. de dom Vincent Thuillier, liv. IX. ch. IVe
Après avoir fait sentir la nécessité de l'étude de la guerre, entrons dans quelques détails sur ce qui en regarde l'exécution, ou les principales opérations.
La guerre ne doit s'entreprendre qu'après beaucoup de réflexions ; il faut avoir tout prévu et tout combiné, pour n'être pas surpris par les événements.
" Il y a deux sortes d'actions militaires, dit Polybe : les unes se font à découvert et par force, les autres par finesse et par occasion. Celles-ci sont en beaucoup plus grand nombre que les autres ; il ne faut que lire l'Histoire pour s'en convaincre. De celles qui se sont faites par occasion, on en trouve beaucoup plus qui ont été manquées que de celles qui ont eu un heureux succès. Il est aisé d'en juger par les événements : on conviendra encore que la plupart des fautes arrivent par l'ignorance ou la négligence des chefs. Ce qui se fait à la guerre sans but et sans dessein, continue le même auteur, ne mérite pas le nom d'actions. Ce sont plutôt des accidents et des hasards dont on ne peut tirer aucune conséquence, parce qu'elles ne sont fondées sur aucune raison solide ".
Avant de commencer la guerre, il est donc important d'avoir des vues et des desseins, qu'on se propose de suivre autant que les circonstances pourront le permettre. C'est ce qu'on appele, suivant M. de Folard, régler l'état de la guerre. Voyez ÉTAT DE LA GUERRE.
Lorsqu'on veut entreprendre une guerre, il faut commencer par des préparatifs de longue main, non seulement pour avoir le nombre des troupes nécessaires, mais encore de l'argent pour fournir à sa dépense. Henri IV. ayant formé le dessein de porter la guerre en Allemagne, M. de Sully sut ralentir son ardeur jusqu'à ce que ce prince eut dans ses coffres de quoi la faire pendant plusieurs années. Il faut des magasins considérables de munitions de guerre et de bouche dans les lieux à portée de ceux que les armées doivent occuper. Dans toute expédition, dit Vegece, le point capital est d'avoir toujours des vivres, et de ruiner l'ennemi en les lui coupant. Outre cette attention indispensable, il est important de prendre de bonne heure des arrangements avec les puissances auxquelles on pourrait causer de la jalousie, pour n'en être point traversé dans ses opérations : c'est ce que fit Louis XIV. dans la guerre de 1672.
Ce prince avait pris toutes les précautions que la prudence peut suggérer, pour n'être point distrait de la poursuite de son objet ; et si les événements heureux de cette guerre ne l'avaient pas excité à la continuer au-delà des bornes nécessaires pour humilier cette république, dont il avait lieu de se plaindre, il serait parvenu à son but sans obstacles de la part des puissances voisines.
Quelque nécessaires que soient les préparatifs dont on vient de parler, ils ne doivent pas faire toute l'application de celui qui veut commencer la guerre. " Il doit encore s'appliquer à connaître le génie de son ennemi et le caractère de ses généraux ; s'ils sont sages ou téméraires, hardis ou timides, s'ils combattent par principes ou au hasard ; avec quelles nations braves ou lâches ils ont eu à faire ;.... comment sont affectées ses troupes ; ce que pensent celles de l'ennemi ; lequel des deux partis a le plus de confiance, pressentiment qui élève ou abaisse le cœur.... Un général vigilant et sage doit peser dans son conseil ses forces et celles des ennemis, comme s'il avait à juger civilement entre deux parties. S'il se trouve supérieur en plusieurs endroits, il ne doit pas différer de profiter de son avantage ; mais s'il sent que l'ennemi soit plus fort que lui, il doit éviter une affaire générale, et s'en tenir aux ruses, aux surprises, et aux embuscades qui ont souvent fait triompher des troupes inférieures en force et en nombre sous de bons généraux ". Vegece, même traduction que ci-dessus.
Il faut connaître aussi le plus exactement qu'il est possible, le pays qui doit être le théâtre de la guerre ; savoir les secours qu'on en pourra tirer pour la subsistance des troupes et pour les fourrages et les incommodités qui pourront en résulter pour l'ennemi. Enfin ce n'est pas assez d'assembler une armée, il faut savoir auparavant où elle agira, et comment elle le fera. Lorsqu'on est une fois entré en campagne, il ne doit plus être question de délibérer, mais d'entamer avec vivacité les opérations qu'on s'est proposé d'exécuter. M. de Folard dit quelque part sur ce sujet, " que les lents et les engourdis à la guerre auront aussi peu de part à la gloire de ce monde, que les tiedes à celle du ciel.
Il ne faut pas toujours régler l'état de la guerre sur le nombre et la qualité des forces que l'on veut opposer à l'ennemi, qui sera peut-être plus fort. Il y a certains pays où le plus faible peut paraitre et agir contre le plus fort, où la cavalerie est de moindre service que l'infanterie, qui souvent supplée à l'autre par sa valeur. L'habileté d'un général est toujours plus avantageuse que la supériorité du nombre, et les avantages d'un pays. Un Turenne règle l'état de la guerre sur la grandeur de ses connaissances, de son courage, et de sa hardiesse. Un général qui ne lui ressemble en rien, malhabile, peu entreprenant, quelque supérieur qu'il sait, craint toujours, et n'est jamais assez fort ". Comment. sur Polybe, par M. le chevalier de Folard, tome V. p. 347.
On doit toujours commencer la guerre par quelque action d'éclat, et ne point se laisser prévenir par l'ennemi. " S'il incline à combattre, dit l'auteur que nous venons de citer, il faut aller au-devant plutôt que de l'attendre : que s'il évite un engagement, il faut le pousser à quelque prix que ce soit ; car un siège est très-difficîle lorsqu'on ne le fait pas ensuite d'une grande victoire ou d'un avantage considérable. Il faut observer toutes ces choses, lorsqu'on règle l'état de la guerre, et que l'on établit son plan avant de la commencer ; car lorsqu'on a médité à loisir sur ce qu'on est résolu de faire, et sur ce que l'ennemi peut raisonnablement opposer, on vient à bout de ses desseins ". Même ouvrage que ci-dessus, tome V. p. 350.
Il serait aisé d'ajouter beaucoup d'autres réflexions sur cette matière ; mais comme il ne s'agit point ici d'un traité sur la guerre, mais d'expliquer ce qu'elle a de plus général, nous donnerons seulement un précis de la guerre offensive et de la guerre défensive ; l'on dira aussi un mot de la guerre de secours.
De la guerre offensive. Dans la guerre offensive, comme on se propose d'attaquer l'ennemi, il faut être assez exactement informé de ses forces pour être assuré qu'on en aura de plus grandes, ou que l'on sera en état de faire des conquêtes avant qu'il ait le temps de rassembler son armée pour s'y opposer.
" Si le pays que l'on veut attaquer, dit M. de Feuquières, est bordé de places fortes, il faut attaquer le quartier qui y donne une entrée libre, et qui porte avec plus de facilité vers la capitale, à qui il faut, autant qu'il est possible, au commencement de la guerre, faire voir l'armée, afin d'y jeter la terreur, et tâcher par-là d'obliger l'ennemi de dégarnir quelques-unes des places de la frontière pour rassurer le cœur du pays.
Il faut ensuite tomber sur les places dégarnies pour ouvrir davantage le pays attaqué, faire apporter dans ces places après leur prise, tous les dépôts qui étaient dans les vôtres, et faire ainsi la guerre avec plus de commodité.
Lorsqu'on aura pénétré le plus avant qu'on l'aura pu faire, il faut faire camper l'armée en lieu sain et commode pour les fourrages, et même en lieu avantageux par son assiette, afin de pouvoir de-là faire des détachements considérables, pour réduire par la terreur des armes les extrémités du pays où l'on ne pourrait pas avec sûreté et commodité pour les vivres, se porter avec l'armée entière ". Mém. de M. le marquis de Feuquières, tome II. p. 15 et suivantes.
C'est particulièrement dans ces commencements qu'il faut user de diligence pour l'exécution des différents projets qu'on a formés. On vit d'abord aux dépens de l'ennemi, on ruine le pays par où il peut s'assembler, et l'on jette la terreur parmi les troupes et les peuples. " Une bataille, dit l'auteur que nous venons de citer, donnée à-propos dans un commencement de guerre, en décide presque toujours le succès : ainsi il ne faut point hésiter à la donner, si l'ennemi par quelque mouvement pour mettre ses troupes ensemble, se met à-portée de risquer un événement ".
Quelque incertain que soit le succès des batailles, il parait en effet que loin de les éviter au commencement d'une guerre, il faut chercher l'occasion d'en donner. " C'est un paradoxe, dit Montecuculli, que d'espérer de vaincre sans combattre. Le but de celui qui fait la guerre est de pouvoir combattre en campagne pour gagner une victoire ; et quiconque n'a pas dessein d'en venir-là, est éloigné de la fin naturelle de la guerre. On a bien vu, continue ce grand capitaine, des armées faibles en défaire de fortes en campagne ; mais on n'a jamais Ve une armée qui se renferme dans un camp fortifié pour éviter le combat, défaire celle qui l'attaque : c'est assez à l'aggresseur que de plusieurs attaques une seule lui réussisse pour le rendre victorieux ". Mém. de Montecuculli, liv. II. chap. VIe
Le gain d'une bataille peut avoir les suites les plus heureuses, lorsque le général a toute la capacité nécessaire pour en profiter ; mais sa perte en a ordinairement de si fâcheuses, qu'on ne doit la risquer qu'avec beaucoup de circonspection. Montecuculli qui conseille d'en chercher l'occasion au commencement de la guerre, observe néanmoins " que dans une matière si importante on ne peche pas deux fois ; et que quand le mal est arrivé, il ne sert de rien de se repentir et de rejeter sa faute sur celui-ci ou sur celui-là ; qu'il faut beaucoup de fermeté et de présence d'esprit pour pourvoir à tout, et ne pas préférer les murmures de la populace au salut public ; qu'il faut chercher à faire quelque coup d'importance sans tout risquer, parce qu'il n'y eut jamais de prudence à risquer beaucoup pour gagner peu. Mém. de Montecuculli, liv. III. chap. IVe
M. le maréchal de Saxe n'était point pour les batailles, surtout, dit-il, au commencement d'une guerre. Il prétend, dans ses mémoires, qu'un habîle général peut la faire toute sa vie sans s'y voir obligé : " Rien, dit cet illustre général, ne réduit tant l'ennemi que cette méthode (d'éviter les batailles), et n'avance plus les affaires. Il faut, ajoute-t-il, donner de fréquents combats et fondre, pour ainsi dire, l'ennemi petit-à-petit ; après quoi il est obligé de se cacher ".
Cette méthode est sans-doute plus sure et plus prudente que la précédente ; mais outre qu'elle demande beaucoup de science et de génie dans le général, il faut observer que si en agissant de cette manière on se commet moins, on réduit aussi l'ennemi moins promptement : la guerre est alors plus longue et moins décisive. On se ruine en détail sans rien faire de grand : c'est pourquoi cette conduite excellente dans la guerre défensive, ne l'est peut-être pas autant dans l'offensive. " S'imaginer faire des conquêtes sans combattre, c'est, dit Montecuculli, un projet chimérique. Les guerres des Romains qui étaient courtes et grosses, sont, dit-il, bonnes à imiter ; mais on ne les peut faire sans batailles. ".
M. de Puysegur pensait sur les batailles à-peu-près comme M. le maréchal de Saxe. Selon cet auteur, elles sont la ressource des généraux médiocres qui donnent tout au hasard ; au lieu que ceux qui sont savants dans la guerre, cherchent par préférence les actions où ils peuvent soutenir les troupes par leur savoir et leur habileté. Voyez BATAILLE.
Il est certain que si l'on peut sans donner de batailles exécuter les différentes choses que l'on s'est proposé, il y aurait une imprudence inexcusable à vouloir en risquer l'évenement : mais il y a plusieurs circonstances où elles sont inévitables. Si par exemple l'ennemi que vous avez en tête attend des secours considérables qui lui donnent la supériorité sur vous ; si les affaires du prince exigent qu'il tire de forts détachements de votre armée pour aller au secours d'un corps d'armée dans une province éloignée ; si les subsistances manquent et qu'il ne soit pas possible de s'en procurer sans chasser l'ennemi des lieux qu'il occupe : dans ces circonstances et dans beaucoup d'autres qui arrivent à la guerre, les batailles sont absolument nécessaires. M. de Turenne, qui savait les éviter quand il le fallait, en a donné plusieurs dans des cas de cette espèce ; et c'est par cette conduite qu'avec des armées inférieures, il a toujours su se conserver la supériorité sur l'ennemi.
Ce qu'il y a d'essentiel à observer dans les batailles, c'est de savoir se soutenir et ne point se décourager pour avoir été poussé et même battu dans quelques endroits de sa ligne. " C'est être habile, je le veux, dit Polybe, que de faire en sorte après avoir bien commencé une action, que la fin ne démente pas le commencement : mais la gloire est bien plus grande lorsqu'après avoir eu du pire au premier choc, loin d'en être ébranlé et de perdre la tête, on réfléchit sur les fautes que les bons succès font commettre à son ennemi, et qu'on les tourne à son avantage. Il est assez ordinaire de voir des gens à qui tout semble prospérer au commencement d'un combat, tourner le dos peu de temps après, et être vaincus ; et d'autres au contraire qui après des commencements très-desavantageux, savent par leur bonne conduite changer la face des choses, et remporter la victoire lorsqu'on s'y attendait le moins ". Histoire de Polybe, liv. XI. ch. IIIe
Polybe en donne pour exemple la bataille de Mantinée, gagnée par Philopemen sur Machanidas, tyran de Sparte.
Au commencement de cette bataille l'armée de Philopemen fut poussée, même mise en partie en déroute : mais ce grand capitaine ne s'épouvanta pas, et ne perdit pas l'espérance de faire changer la fortune ; il sut remédier au désordre de son armée, et trouver ensuite le moyen de remporter une victoire complete , dans laquelle il tua lui-même Machanidas.
Nous avons un exemple à-peu-près de même espèce, rapporté dans les mémoires de M. de Turenne, à la bataille de Nordlingue.
Dans cette bataille, l'aîle droite de l'armée de France fut entièrement mise en déroute, le centre battu, et l'aîle gauche un peu poussée. Malgré cela M. le Prince soutint le combat ; M. de Turenne battit l'aîle droite des ennemis ; et la nuit venant incontinent, les deux ailes qui avaient battu ce qui était devant elles, demeurèrent en bataille l'une devant l'autre. A une heure après minuit, l'armée ennemie commença à se retirer, &c.
Un des principaux avantages de la guerre offensive, c'est de faire subsister l'armée aux dépens de l'ennemi. Par cette raison, cette guerre peut être moins dispendieuse que la guerre défensive, où l'on est obligé de vivre sur son propre terrain.
" L'empereur Léopold Ignace se plaignant, dit M. de Santa-Cruz, " de ce qu'il ne savait où prendre des fonds pour payer ses armées, Walstein son général lui répondit, que le remède qu'il y trouvait était de lever une fois plus de troupes. L'empereur lui ayant repliqué comment il pourrait entretenir cent mille hommes, puisqu'il n'avait pas le moyen d'en faire subsister cinquante mille ; Walstein le satisfit, en lui représentant que cinquante mille hommes tiraient leur subsistance du pays ami, et que cent mille le tireraient du pays ennemi. "
Le prince d'Orange, suivant ce proverbe allemand, il est toujours bon d'attacher les chevaux aux arbres des ennemis, dit " que celui qui fait une guerre offensive peut, dans un malheur, avoir recours à son propre pays ; parce que n'ayant point souffert de la guerre, on y trouvera abondamment tout ce qui est nécessaire : au lieu que celui qui la soutient sur ses états, ne saurait en plusieurs jours faire les préparatifs convenables pour entrer dans le pays ennemi. Enfin en se tenant sur la défensive on ne peut que perdre, ou tout-au-plus conserver ce que l'on a, et en attaquant on peut gagner. Réfl. mil. par M. le marquis de Santa-Cruz, tome IV. ch. IIe
De la guerre défensive. La guerre défensive est beaucoup plus difficîle et plus savante que la précédente. Elle demande plus d'adresse, plus de ressource dans l'esprit, et beaucoup plus d'attention dans la conduite.
" Dans la guerre offensive on compte pour rien ce qu'on manque de faire ; parce que les yeux attentifs à ce qui se fait, et remplis d'une action éclatante, ne se tournent point ailleurs, et n'envisagent point ce qu'on pouvait faire. Dans la guerre défensive, la moindre faute est mortelle, et les disgraces sont encore exagérées par la crainte, qui est le vrai microscope des maux, et on les attribue toutes à un seul homme. On ne regarde que le mal qui arrive, et non ce qui pouvait arriver de pis, si on ne l'avait empêché ; ce qui en bonne partie devrait être compté pour un bien ". Mém. de Montecuculli, liv. III. ch. IIIe
M. de Feuquières observe qu'il est bien difficîle de prescrire des maximes générales dans cette espèce de guerre, parce qu'elle est toute, dit-il, dans la prudence et l'esprit de prévoyance de celui qui la conduit.
" On peut dire seulement qu'elle a été tout à fait imprévue, ou qu'elle n'a pas été prévue assez tôt, ou que la perte d'une bataille, ou de quelque place considérable, l'a rendue telle, quoiqu'elle eut eu un autre commencement.
Au premier cas, le peu de troupes qu'on a sur pied doit être ménagé ; l'infanterie jetée, selon la quantité des places qu'on a à garder, dans celle que l'on peut croire le plus indispensablement attaquée, abandonnant ainsi à l'ennemi celles qui dans la suite de la guerre pourraient être plus facilement conquises, ou qu'il pourra le plus difficilement conserver. La cavalerie doit être mise en campagne, mais en état d'avoir une retraite sure ; elle doit incommoder les fourrages et les convais de l'ennemi, empêcher que ses partis ne s'écartent trop de son armée, et ne jettent trop facilement la terreur dans le dedans du pays.
Le plat pays ne doit point être ménagé. Il faut en retirer dans les meilleures places tout ce que l'on peut en ôter, et consumer même par le feu tous les grains et fourrages qu'on ne peut mettre en lieu sur, afin de diminuer par-là la substance aisée de l'armée ennemie. Les bestiaux doivent être aussi renvoyés dans les lieux les plus éloignés de l'ennemi ; et autant qu'il se peut, couverts de grandes rivières, où ils trouveront plus de sûreté et une subsistance plus aisée ". Mém. de M. le marquis de Feuquières, tome II. pag. 2.
Quelque inconvénient qu'il paraisse y avoir à ruiner son pays, c'est pourtant dans des cas pressants une opération indispensable ; " car il vaut mieux, dit un grand capitaine, " se conserver un pays ruiné, que " de le conserver pour son ennemi... C'est une maxime, que nul bien public ne peut être sans quelque préjudice aux particuliers.... aussi un prince ne se peut démêler d'une périlleuse entreprise, s'il veut complaire à tout... et les plus grandes et ordinaires fautes que nous faisons en matière d'état et de guerre, proviennent de se laisser emporter à cette complaisance, dont le repentir nous vient quand on n'y peut plus remédier ". Parfait capitaine, par M. le duc de Rohan.
Lorsque la guerre n'a pas été absolument imprévue, qu'on a dû s'y attendre par les dispositions de l'ennemi, par l'augmentation de ses troupes, les amas de vivres et de fourrages dans ses places frontières ; alors on peut prendre des précautions pour lui résister. Pour cet effet on fait promptement de nouvelles levées de troupes ; on réunit ensemble dans les lieux les plus propres à fermer l'entrée du pays, celles qu'on a déjà sur pied ; et l'on forme des magasins de munitions de toute espèce dans les lieux les moins exposés.
On cherche aussi à tirer du secours de ses alliés, soit par des diversions, ou par des corps de troupes. Enfin l'on doit s'appliquer à faire en sorte de n'être point surpris, à bien démêler les desseins de l'ennemi, et à employer tous les expédiens que la connaissance de la guerre, et du pays peuvent suggérer pour lui résister.
Il arrive souvent qu'un prince qui fait la guerre à-la-fais de plusieurs côtés, n'est pas en état de la faire offensivement par-tout ; alors il prend le parti de la défensive du côté où il se croit le plus en sûreté ; mais cette défensive doit être conduite avec tant d'art et de prudence, que l'ennemi ne puisse s'en douter. " Le projet de cette espèce de guerre, dit M. de Feuquières, mérite autant de réflexions et de capacité, qu'aucune autre ; elle ne doit jamais se faire que du côté où l'on est sur de réduire l'ennemi à passer une rivière difficile, ou un pays serré, coupé de défilés, et lorsqu'on a sur cette rivière une place forte bien munie, que l'on saura être un objet indispensable, par l'attaque de laquelle on pourra présumer qu'il perdra un temps assez considérable pour avoir celui de la secourir ou de le combattre ".
Quoique la guerre défensive soit plus difficîle à soutenir que l'offensive, M. le chevalier Folard prétend que les généraux les plus mal-habiles sont ceux qui la proposent ; au lieu que les plus consommés dans la science des armes cherchent à l'éviter : la raison en est sans-doute, qu'il parait plus aisé de s'opposer aux desseins de l'ennemi, que d'en former soi-même ; mais avec un peu d'attention on s'aperçoit bien-tôt que l'art de réduire un ennemi à l'absurde, et de deviner tous ses projets, demande plus de capacité et d'intelligence que pour l'attaquer à force ouverte, et le faire craindre pour son pays. Si l'ennemi peut pénétrer qu'on a dessein de se tenir sur la défensive à son égard, il doit devenir plus entreprenant. " Ajoutez à cela, dit le savant commentateur de Polybe, qu'une défensive ruine l'état, si elle dure longtemps ; car outre qu'elle n'est jamais sans quelque perte, ou sans la ruine de notre frontière que nos armées mangent, c'est que comme on craint également que l'ennemi coule sur toute sa ligne de communication, pour couper ou pénétrer la nôtre pour faire quelques conquêtes, on se voit obligé de munir extraordinairement toutes les places de cette frontière, parce qu'elles se trouvent également menacées : et quel est le prince assez puissant, continue ce même auteur, pour fournir toutes ses forteresses de vivres et de munitions de guerre pour soutenir un long siège " ?
Lorsque par les événements d'une guerre malheureuse on est dans le cas de craindre de se commettre avec l'ennemi, il faut éviter les actions générales en plaine, et chercher, comme le faisait Fabius Maximus, à harceler l'ennemi, lui couper ses vivres et ses fourrages, s'appliquer à ruiner son armée en détail, en se tenant toujours à-portée de profiter de ses fautes, en occupant des postes surs et avantageux, où sa supériorité ne soit point à craindre ; en un mot " fuir, comme le dit M. Folard, toute occasion de combattre où la supériorité du nombre peut beaucoup, et chercher celles où le pays militera pour nous : mais il n'appartient pas, dit-il, aux généraux médiocres de faire la guerre de cette sorte ; et lorsqu'un prince est assez heureux pour avoir des généraux du premier ordre à son service, il n'a garde de les brider. Contre ceux-ci, Dieu n'est pas toujours pour les gros bataillons. M. de Turenne a fait voir mille fois que cette maxime était fausse, et elle l'est en effet à l'égard des grands capitaines et des officiers expérimentés. " Comm. sur Polybe, liv. V. chap. XIIe
Lorsqu'on veut empêcher l'ennemi de pénétrer dans un pays fermé de montagnes et de défilés, il est bien difficîle de s'assurer de les garder tous également ; car comme l'ennemi peut donner de la jalousie de plusieurs côtés, il vous oblige par-là de partager vos forces ; ce qui fait qu'on ne se trouve pas en état de résister dans le lieu où il fait ses plus grands efforts. Dans le cas de cette espèce, et lorsqu'on est à-peu-près égal en force à l'ennemi, il faudrait s'attacher à le mettre lui-même sur la défensive : c'est le moyen de déranger ses projets, et de l'occuper de la conservation de son pays. Si l'on peut réussir, on éloigne la guerre de ses frontières ; mais si l'entreprise parait trop difficile, il faut faire en sorte que l'ennemi ne trouve aucune subsistance dans les lieux où il aura pénétré, qu'il s'y trouve gêné et à l'étroit par un bon corps d'armée qui occupe un camp sur et avantageux, et qu'il ne lui permette pas de pouvoir aller en-avant. C'est un principe certain, que le partage des forces les diminue, et qu'en voulant se défendre de tous côtés, on se trouve trop faible partout : c'est pourquoi le parti le plus sur dans les occasions où l'on craint pour plusieurs endroits à-la-fais, est de réunir ses forces ensemble, de manière que s'il est nécessaire de combattre, on le fasse avec tout l'effort dont on est capable. C'est par cette raison qu'un général habîle qui a des lignes d'une grande étendue à garder, trouve plus avantageux d'aller au-devant de l'ennemi, pour le combattre avec toutes ses forces, que de se voir forcé dans des retranchements. Voyez LIGNE.
De la guerre de secours. Un prince secourt ses voisins à cause des alliances ou des traités qu'il a faits avec eux ; il le fait aussi souvent pour les empêcher de succomber sous la puissance d'un prince ambitieux que la prudence demande qu'on arrête de bonne heure : car, comme le dit très-judicieusement le chevalier de Ville, on ne doit pas rester tranquille lorsque le feu est aux maisons voisines ; autrement on en sentira bien-tôt les effets.
Lorsqu'on donne du secours à un prince en vertu des traités, la justice et l'équité exigent qu'on lui tienne exactement tout ce qu'on lui a promis, soit pour lui fournir un certain nombre de troupes, soit pour attaquer soi-même l'ennemi de son allié, si l'on est à portée de le faire.
Si l'on donne des secours à un prince pour l'empêcher d'être opprimé par une puissance formidable qui veut envahir son pays, la prudence demande qu'avant de le faire, on prenne toutes les sûretés convenables pour que le prince attaqué ne fasse pas la paix à votre préjudice et sans votre participation.
Pour cet effet, on doit exiger quelques places de sûreté qui puissent garantir la fidélité du prince auquel on donne du secours.
" Que si, comme il arrive souvent, dit M. de Feuquières, la jalousie que l'on aura sujet de prendre d'un prince inquiet et ambitieux, a formé les alliances dans lesquelles on est entré, et qu'on se trouve hors de portée de joindre ses troupes à celles de l'état attaqué, il faut en ce cas-là le secourir ou par argent qu'on lui fournira, ou par des diversions dans le pays de l'attaquant, qui le forcent à diviser ses armées, et qui l'empêchent de pousser ses conquêtes avec trop de rapidité ".
Lorsqu'un prince envoye un corps de troupes au secours d'un autre prince, " le général de ses troupes doit être sage et prévoyant, pour maintenir la discipline dans son corps, de manière que le prince allié ne fasse point de plaintes contre lui, et prévoyant, pour que ses troupes ne tombent dans aucun besoin pour les subsistances, et qu'elles ne soient exposées au péril de la guerre qu'avec proportion de ses forces à celles du prince allié, et enfin pour qu'il ne se passe rien à son insu dans le cabinet du prince allié, qui puisse être préjudiciable à son maître ". Mémoires de M. de Feuquières, tome II. pag. 32 et suiv.
De la guerre des siéges. Quoique nous ayons exposé fort brievement ce qui concerne les guerres précédentes, nous serons encore plus succints sur celle des siéges.
Nous observerons seulement qu'on ne doit entreprendre aucun siège que lorsqu'on a acquis quelque supériorité sur l'ennemi par le gain d'une bataille ou d'un combat, ou bien lorsqu'on est en état en se mettant de bonne heure en campagne, de finir le siège avant que l'ennemi ait eu le temps d'assembler une armée pour s'y opposer. Une armée qui fait un siège s'affoiblit toujours beaucoup : par conséquent si elle est de pareille force que celle de l'ennemi, elle devient alors inférieure ; c'est pourquoi pour éviter tout inconvénient à cet égard, il ne faut se livrer à ces sortes d'entreprises, que lorsqu'on peut présumer que l'ennemi ne pourra empêcher de les terminer heureusement. Il y a des places dont la disposition du terrain des environs est si favorable pour une armée d'observation, qu'il est difficîle à l'ennemi, lorsqu'on y est une fois établi, de vous y attaquer avec avantage. Mais comme ces situations ne sont pas ordinaires, les habiles généraux pensent qu'il faut être maître de la campagne, pour faire un siège tranquillement.
On doit avoir pour objet principal à la guerre, celui de pousser son ennemi et de l'empêcher de paraitre ; lorsqu'on y est parvenu, les sièges se font sans difficulté et sans inquiétude : à l'égard des différentes opérations du siège, voyez ATTAQUE DES PLACES, INVESTISSEMENT, CIRCONVALLATION, DEFENSE, SIEGE, TRANCHEES, etc.
Avant de finir cet article, observons que les succès à la guerre dépendent non-seulement du général, mais encore des officiers généraux qui sont sous ses ordres, et de ceux qui sont chargés du détail des subsistances : si le général n'en est pas bien secondé, les projets les mieux pensés et les mieux entendus peuvent manquer dans l'exécution, sans qu'il y ait aucune faute de sa part : on veut cependant le rendre responsable de tout ; et ce qui est encore plus singulier, tout le monde veut s'ingérer de juger de sa conduite, et chacun s'en croit capable. Cette manie n'est pas nouvelle.
" Il y a des gens, disait Paul-émile, qui dans les cercles et les conversations, et même au milieu des repas, conduisent les armées, règlent les démarches du consul, et prescrivent toutes les opérations de la campagne : ils savent mieux que le général qui est sur les lieux, où il faut camper et de quel poste il faut se saisir, où il est à-propos d'établir des greniers et des magasins ; par où, soit par terre soit par mer, on peut faire venir des vivres ; quand il faut en venir aux mains avec l'ennemi, et quand il faut se tenir en repos : et non-seulement ils prescrivent ce qu'il y a de meilleur à faire ; mais pour peu qu'on s'écarte de leur plan, ils en font un crime au consul, et ils le citent à leur tribunal.
Sachez, Romains, que cette licence qu'on se donne à Rome apporte un grand obstacle au succès de vos armées et au bien public. Tous vos généraux n'ont pas la fermeté et la constance de Fabius, qui aima mieux voir son autorité insultée par la témérité d'une multitude indiscrette et imprudente, que de ruiner les affaires de la république en se piquant à contre-temps de bravoure pour faire cesser des bruits populaires.
Je suis bien éloigné de croire que les généraux n'aient pas besoin de recevoir des avis ; je pense au contraire que quiconque veut seul tout conduire par ses seules lumières et sans consulter, marque plus de présomption que de sagesse. Que peut-on donc exiger raisonnablement ? c'est que personne ne s'ingère de donner des avis à vos généraux, que ceux premièrement qui sont habiles dans le métier de la guerre, et à qui l'expérience a appris ce que c'est que de commander ; et secondement ceux qui sont sur les lieux, qui connaissent l'ennemi, qui sont en état de juger des différentes conjonctures, et qui se trouvant embarqués comme dans un même vaisseau, partagent avec nous tous les dangers. Si donc quelqu'un se flatte de pouvoir m'aider de ses conseils dans la guerre dont vous m'avez chargé, qu'il ne refuse point de rendre ce service à la république, et qu'il vienne avec moi en Macédoine ; galere, chevaux, tentes, vivres, je le défrayerai de tout. Mais si l'on ne veut pas prendre cette peine, et qu'on préfère le doux loisir de la ville aux dangers et aux fatigues du camp, qu'on ne s'avise pas de vouloir tenir le gouvernail en demeurant tranquille dans le port : s'ils ont une si grande demangeaison de parler, la ville par elle-même leur fournit assez d'autres matières ; celle-ci n'est point de leur compétence ".
L'abus dont se plaint Paul-émîle dans ce discours dicté par le bon sens et la raison, nous montre, dit M. Rollin, qui le rapporte dans son histoire romaine, que les hommes dans tous les temps sont toujours les mêmes.
On se fait un plaisir secret et comme un mérite d'examiner, de critiquer, et de condamner la conduite des généraux, et l'on ne s'aperçoit pas qu'en cela on peche visiblement et contre le bon-sens et contre l'équité : contre le bon-sens ; car quoi de plus absurde et de plus ridicule que de voir des gens sans aucune connaissance de la guerre et sans aucune expérience, s'ériger en censeurs des plus habiles généraux, et prononcer d'un ton de maître sur leurs actions ? contre l'équité ; car les plus experts même n'en peuvent juger sainement s'ils ne sont sur les lieux ; la moindre circonstance du temps, du lieu, et de la disposition des troupes, des ordres même secrets qui ne sont pas connus, pouvant changer absolument les règles ordinaires. Mais il ne faut pas espérer qu'on se corrige de ce défaut, qui a sa source dans la curiosité et dans la vanité naturelle à l'homme ; et les généraux, à l'exemple de Paul-émile, font sagement de mépriser ces bruits de ville, et ces rumeurs de gens aisifs sans occupation et souvent sans jugement. Histoire rom. tome VIII. pag. 119.
Outre les différentes guerres précédentes, il y en a une particulière qui se fait avec peu de troupes par des détachements ou des partis, à laquelle on donne le nom de petite guerre ; ceux qui commandent ces petits corps de troupes sont appelés partisans.
Ils servent à mettre le pays ennemi à contribution ; à épier, pour ainsi dire, toutes les démarches du général ennemi : pour cet effet, ils rodent continuellement autour de son camp, ils y font des prisonniers qui donnent souvent des lumières sur ses desseins ; on s'instruit par ce moyen de tout ce que fait l'ennemi, des différentes troupes qu'il envoye à la guerre, et des fourrages qu'il ordonne. En un mot cette guerre est absolument nécessaire non-seulement pour incommoder et harceler l'ennemi dans toutes ses opérations, mais pour en informer le général ; ce qui le met en état de n'être point surpris. Rien ne contribue plus à la sûreté d'une armée que les partis, lorsqu'ils sont commandés par des officiers habiles et intelligens. Voyez PARTIS, PARTISANS, et l'article suivant.
Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la guerre de terre : la guerre navale ou la guerre de mer demanderait beaucoup plus de détails ; mais nous nous contenterons d'observer que cette guerre peut heureusement seconder celle de terre, dans les pays ou les royaumes à portée de la mer.
Les armées navales assurent les côtes, elles peuvent dispenser d'employer un grand nombre de troupes pour les garder. " Je pense, dit M. de Santa-Cruz sur ce sujet, qu'il faut que vos armées navales soient supérieures, ou n'en point avoir du-tout, à l'exception de quelques galeres qui servent toujours soit pour garder les côtes contre les corsaires, soit pour les secours. Un prince puissant sur mer évite la dépense de beaucoup de troupes, il se rend sans opposition maître des îles des ennemis, en leur coupant par ses vaisseaux tous les secours de terre-ferme ; il ruine le commerce de ses ennemis, et rend libre celui de ses états, en faisant escorter par des vaisseaux de guerre ceux des marchands, qui paient au-delà de l'escorte.
Celui qui est supérieur sur mer fait avec les princes neutres tous les traités de Commerce aussi avantageux qu'il veut ; il tient dans le respect les pays les plus éloignés, qui pour n'avoir pas eu tous les égards convenables, ont lieu de craindre un débarquement ou un bombardement. Quand même les ennemis, pour garder leurs côtes, seraient forcés de faire la dépense d'entretenir beaucoup de troupes ; si la frontière de mer est longue, ils ne sauraient vous empêcher de prendre terre, et de piller une partie de leur pays, ou de surprendre quelque place, parce que votre flotte qui menace un endroit, pourra au premier vent favorable, arriver infiniment plutôt à un autre que ne sauraient faire les régiments ennemis qui avaient accouru à l'endroit où votre armée navale les appelait d'abord ; et chacun comprend aisément qu'il est impossible que les ennemis aient cent lieues de côtes de mer assez bien garnies et retranchées, sans qu'il soit nécessaire pour empêcher un débarquement, que les troupes d'un autre poste accourent pour soutenir celles du poste où se fait la descente ".
Les forces navales sont en effet si importantes, qu'elles ne doivent jamais être négligées. " La mer, dit un grand ministre, est celui de tous les héritages sur lequel tous les souverains prétendent plus de part, et cependant c'est celui sur lequel les droits d'un chacun sont moins éclaircis : l'empire de cet élément ne fut jamais bien assuré à personne ; il a été sujet à divers changements, selon l'inconstance de sa nature. Les vieux titres de cette domination sont la force et non la raison ; il faut être puissant pour prétendre à cet héritage. Jamais un grand état ne doit être dans le cas de recevoir une injure, sans pouvoir en prendre revanche " ; et l'on ne le peut à l'égard des puissances maritimes, que par les forces navales.
" Dans l'établissement d'une puissance navale, il faut éviter, dit M. le marquis de Santa-Cruz, de risquer par le sort d'un combat votre marine naissante, et de tenir vos vaisseaux dans des ports où les ennemis pourraient les détruire.
Il faut bien payer les naturels du pays qui fréquentent les côtes ennemies, et qui vous donnent des avis prompts et surs de l'armement et des voyages de leurs escadres ; assembler secrètement vos vaisseaux pour attaquer une escadre des ennemis inférieure, et qui se serait séparée des autres ; si les ennemis sont en mer avec une grosse armée navale, ne faire cette année dans la Marine, que la dépense absolument nécessaire pour bien entretenir dans des ports surs vos gros vaisseaux et quelques frégates sur mer, afin que votre nation ne cesse pas entièrement de s'exercer dans la navigation, et qu'elle puisse traverser un peu le commerce des ennemis, qui est toujours considérable à proportion de leurs armées navales ".
Cet auteur donne différents conseils qui peuvent contribuer à la sûreté des corsaires qui courent sur l'ennemi. " Il faut, dit-il, qu'ils aient dans les ports marchands des correspondances avec divers patrons de felouques et d'autres legers bâtiments neutres, pour leur donner avis du temps que les bâtiments ennemis doivent sortir des ports sans escorte ; et si leurs navires gardes-côtes en sont sortis pour côtoyer, ou s'ils ont jeté l'ancre. Ces patrons doivent être d'une fidélité reconnue et de beaucoup de secret, pour pouvoir leur confier sur quelle côte ou sur quel cap ils rencontreront chacun de vos corsaires, depuis un tel temps jusqu'à tel autre : vos corsaires conviendront avec eux des signaux de reconnaissance, de peur qu'ils ne craignent d'en approcher ". Réflexions milit. de M. le marquis de Santa-Cruz, tome IV. ch. Xe (Q)
GUERRE ; envoyer à la guerre, aller à la guerre, se dit d'un détachement dont le général de l'armée donne le commandement à un officier de confiance, pour investir une place, pour couvrir ou attaquer un convoi, pour reconnaître l'ennemi, entreprendre sur les quartiers, sur les gardes ou sur les postes avancés, enlever des ôtages, établir des contributions, et souvent pour marcher en-avant, reconnaître un camp et couvrir un fourrage ou quelqu'autre manœuvre de l'armée.
Les détachements de guerre réguliers sont commandés à l'ordre, les officiers principaux y sont nommés ; l'état major de l'armée commande selon leur ancienneté, les brigadiers, les colonels, et les lieutenans-colonels ; les brigades qui doivent fournir les troupes sont nommées à l'ordre ; les majors de brigade commandent les capitaines à marcher, et prennent ce service par la tête, comme service d'honneur. Chaque troupe est de cinquante hommes ; quelquefois on met doubles officiers à chaque troupe ; les compagnies de grenadiers qui doivent y marcher sont nommées à l'ordre.
Ces détachements s'assemblent à l'heure et au rendez-vous marqués sur l'ordre : le commandant après avoir reçu du général les instructions et son ordre, se met en marche pour sa destination ; il envoye des nouvelles au général à mesure qu'il découvre quelque chose d'intéressant ; il s'applique à bien exécuter la commission dont il est chargé, et avec l'intelligence et la capacité qu'on est en droit d'exiger d'un officier que le roi a déjà honoré d'un grade supérieur.
Quelquefois le général de l'armée commande des détachements dont il veut dérober la connaissance aux transfuges et aux espions qui pourraient être dans son armée : on prend alors toutes les précautions nécessaires pour que rien ne transpire jusqu'au moment où l'on fait marcher les troupes que chaque major de brigade commande, et qu'il envoye avec un guide au rendez-vous général.
Le général n'est point assujetti à confier ces détachements aux plus anciens officiers généraux ; il peut et doit même les donner à ceux qui méritent le plus sa confiance, et surtout à ceux dans lesquels il a reconnu du zéle, de la prudence, et de l'activité, et qui ont prouvé leur désir de se rendre capables d'exécuter de pareilles commissions, en allant souvent en détachement même sans être commandés, pendant qu'ils ont servi dans des grades inférieurs.
On envoye souvent à la guerre de petits détachements irréguliers depuis cinquante jusqu'à trois cent hommes ; quoique les objets qu'ils ont à remplir paraissent de moindre importance que ceux des détachements réguliers, on verra par les détails suivants, quelle est leur utilité pour la guerre de campagne, et combien ils sont propres à développer le génie et à former des officiers utiles et distingués.
Anciennement on nommait partis ces sortes de petits détachements, et l'officier qui les commandait partisan. Ces partis se donnaient alors le plus ordinairement à des officiers de fortune ; et quoiqu'il n'y ait aucune espèce de service qui ne soit honorable, malheureusement il n'était pas d'usage pour des officiers d'un certain grade de demander à les commander. Aujourd'hui l'émulation et le véritable esprit de service ont changé ce système, qu'une vanité très déplacée avait seule établi. Les officiers les plus distingués d'un corps demandent ces petits détachements avec ardeur ; et les jeunes officiers qui désirent apprendre leur métier et se former une réputation, viennent s'offrir avec empressement, et même comme simples volontaires, pour marcher sous les ordres d'un officier expérimenté.
Feu M. le maréchal de Saxe avait souvent employé de petits détachements de cette espèce pendant sa savante campagne de Courtray ; sa position, le peu de troupes qu'il avait, la nécessité plus pressante alors que jamais d'être bien averti, lui avait fait choisir des officiers de réputation pour les commander. M. le comte d'Argenson saisit ce moment pour détruire à jamais un faux système, dont la nation eut pu rappeler le souvenir. Il obtint du Roi des pensions sur l'ordre de S. Louis et des grades, pour ceux qui s'étaient distingués.
Ces sortes de détachements ne sont jamais commandés à l'ordre ; les officiers, les soldats même qui marchent, ne suivent point leur rang. Le commandant avertit en secret les officiers dont il a besoin : ce sont eux qui choisissent dans leurs régiments le nombre de soldats de confiance et de bonne volonté qu'ils sont convenus de mener avec eux : ces petites troupes se rendent séparément au rendez-vous marqué ; elles ne portent avec elles que du pain, leurs munitions, et leurs armes. Pendant la dernière guerre, feu M. de Maeric et M. de Nyhel, lieutenant-colonel d'infanterie et major du régiment de Dillon, n'ont jamais souffert dans leur détachement rien qui put en embarrasser la marche ou les exposer à être découverts. Ils marchaient à pied à la tête de leur troupe ; un seul cheval portait les manteaux des officiers. Arrivés au rendez-vous, ils faisaient une inspection sévère, et renvoyaient au camp tous ceux qui n'étaient point en état de bien marcher et de combattre.
Rien n'est plus essentiel pour la tranquillité d'une armée, et pour avoir des nouvelles certaines de l'ennemi, que ces petits détachements ; ne marchant presque jamais que la nuit, s'embusquant dans des postes avantageux, quelquefois ces petites troupes suffisent pour porter le désordre en des postes avancés, et faire retirer de gros détachements qui se mettraient en marche. La méthode de M. de Maeric fut toujours d'attaquer fort ou faible en colonne ou par pelotons, dès qu'il ne pouvait être tourné, et que le fond et le nombre de la troupe ne pouvait être reconnu.
Le commandant doit avoir soin d'examiner les routes par lesquelles il peut se retirer, et d'en faire prendre connaissance aux officiers qui commandent les divisions, afin que chacune puisse se retirer séparément, si la retraite en troupe est trop difficîle ; il faut donc alors un rendez-vous et un mot de ralliement.
Il lui est important de savoir parler la langue du pays où il agit, et même celle de la nation contre laquelle on fait la guerre ; si cette partie lui manque, il doit choisir, en composant la troupe, des officiers propres à bien parler ces langues dans l'occasion. La connaissance du pays lui est absolument nécessaire ; il est bon même qu'il choisisse autant qu'il est possible pour son détachement quelques officiers ou soldats du pays où il agit.
Il faut surtout qu'il se mette en état de pouvoir rendre compte à son retour des chemins frayés, de ceux qu'on peut faire, des ruisseaux, des ravins, des marais, et en général de tout ce qui peut assurer, faciliter, ou mettre obstacle à la marche d'une armée dans le pays qu'il aura parcouru.
Ces connaissances sont essentielles pour le général et le maréchal général des logis de l'armée ; et l'objet principal de l'officier détaché est de les mettre en état de diriger l'ordre de marche de l'armée, sur le détail qu'il leur fait de la nature du pays et des terrains.
Lorsque ses connaissances et son intelligence lui permettent même de reconnaître l'assiette d'un camp en-avant, son devoir est de l'examiner assez pour pouvoir juger ensuite si l'état présent de son terrain se rapporte exactement aux cartes du général ; s'il est en état d'en lever un plan figuré, le compte qu'il rendra sera d'autant plus utîle et digne de louange.
Il doit faire observer une sévère discipline et un grand silence ; il n'annoncera jamais ce qu'il doit faire qu'à quelque officier de confiance qui puisse le remplacer ; il doit rendre compte aux jeunes officiers des motifs qui l'ont fait agir dans tout ce qu'il a fait avec eux. Tout officier qui donne la marque d'estime à un commandant de détachement de marcher de bonne volonté sous ses ordres, mérite de lui l'instruction qu'il désire d'acquérir.
Ces petits détachements que le soldat qui reste au camp sait être en-avant, sont aussi très-utiles pour empêcher la maraude et la désertion ; ils peuvent favoriser nos espions, intercepter ceux de l'ennemi ; en un mot cette espèce de service est également utîle aux opérations de la campagne, au service journalier de l'armée, à développer le génie, à faire naître les talents, et à former de bons officiers. Cet article est de M. le Comte DE TRESSAN.
GUERRE, (HOMME DE) c'est celui qui se rend propre à exécuter avec force, adresse, exactitude et célérité, tous les actes propres à le faire combattre avec avantage.
Cette partie de l'éducation militaire fut toujours en grand honneur chez les anciens, et le fut parmi nous jusqu'au milieu du dernier siècle. Elle a été depuis trop négligée. On commence à s'occuper plus sérieusement à la remettre en vigueur ; mais on éprouve ce qui doit arriver toujours de la langueur où l'on a laissé tomber les arts utiles. Il faut vaincre aujourd'hui la mollesse, et détruire l'habitude et le préjugé.
Les exercices du corps si nécessaires à l'homme de guerre, étaient ordonnés chez les Grecs par des lois que les Ephores et les Archontes soutinrent avec sévérité. Ces exercices étaient publics. Chaque ville avait son gymnase où la jeunesse était obligée de se rendre aux heures prescrites. Le gymnastique chef de ces exercices était revêtu d'une grande autorité, et toujours choisi par élection parmi les citoyens les plus expérimentés et les plus vertueux. Les jeux olympiques, Néméens, Isthmiens et les Pithiens, ne furent institués que pour juger des progrès que la jeunesse faisait dans les exercices. On y décernait des prix à ceux qui avaient remporté la victoire à la course, et dans les combats de la lutte, du ceste, et du pugilat. C'est ainsi que la Grèce, trop faible contre la multitude d'ennemis qu'elle avait souvent à combattre, multipliait ses forces, et préparait ses enfants à devenir également intrépides et redoutables dans les combats.
On en voit un exemple bien frappant dans l'action vraiment héroïque des trois cent Lacédémoniens qui défendirent le pas des Thermopyles ; le courage seul n'eut pu suffire à leur petit nombre pour soutenir si longtemps les efforts redoublés d'une armée presque innombrable, s'ils n'eussent joint la plus grande force et l'adresse à leur dévouement entier à la défense de la patrie.
Le même art fut cultivé chez les Romains ; et leurs plus grands capitaines en donnèrent l'exemple. Marcellus, César et Antoine, traversaient couverts de leurs armes des fleuves à la nage ; ils marchaient à pied et tête nue à la tête des légions, depuis Rome jusqu'aux extrémités des Alpes, des Pyrénées, et du Caucase. Les dépouilles opimes offertes à Jupiter Férétrien furent toujours regardées comme l'action la plus héroïque ; mais bien-tôt le luxe et la mollesse s'introduisirent, lorsque la voix de Caton et son souvenir eurent perdu leurs droits dans la capitale du monde. Si le siècle d'Auguste vit les Arts se perfectionner, les Belles-Lettres l'éclairer, les mœurs se polir, il vit aussi dégénérer toutes les qualités qui avaient rendu les Romains les maîtres de toutes les autres nations.
Les exercices du corps se soutinrent longtemps parmi les Scythes, les Gaulois, et les Germains ; mais il n'est point de nation où ils aient été plus longtemps pratiqués que chez les Français.
Avant l'invention des armes-à-feu, la chevalerie française décidait seule du gain d'une bataille ; et lorsque nous voyons dans les arsenaux les anciennes armes offensives et défensives dont elle se servait, nous avons peine à concevoir comment il était possible d'en faire usage.
La nature cependant n'a point dégénéré. Les hommes sont les mêmes qu'ils étaient ; mais l'éducation est bien différente. On accoutumait alors les enfants à porter de certains poids qu'on augmentait peu-à-peu ; on les exerçait dès que leur force commençait à se déployer ; leurs muscles s'endurcissaient en conservant la souplesse. C'est ainsi qu'on les formait aux plus durs travaux. L'éducation et l'habitude font presque tout dans les hommes, et les enfants des plus grands-seigneurs n'étaient point exempts de ces exercices violents ; souvent même un père envoyait son fils unique pour être élevé à l'exercice des armes et de la vertu chez un autre chevalier, de peur que son éducation ne fût pas suivie avec assez de rigidité dans la maison paternelle. On nommait cette espèce d'éducation nourriture ; et l'on disait d'un brave chevalier, qu'il avait reçu chez tel autre une bonne et louable nourriture. Rien ne pouvait dispenser de cette éducation militaire tous ceux qui prétendaient à l'honneur d'être armés chevaliers. Quelles actions héroïques de nos rois et de nos princes ne lisons-nous pas dans notre histoire !
Quoique l'usage des armes-à-feu ait changé le système de combattre dans presque toute l'Europe, les exercices propres à former l'homme de guerre se sont soutenus jusqu'à la minorité du feu roi ; mais alors les tournois et les combats de la barrière avec des armes pesantes dégénérèrent en course de bague et de têtes et en carrousels. Les armes défensives furent changées en ornements somptueux et en livrées galantes ; bien-tôt l'art de combattre de sa personne fut négligée ; la mollesse s'introduisit au point de craindre même de se servir de la seule arme défensive qui nous reste de l'ancienne chevalerie ; et la cuirasse devenant un poids trop incommode, on attacha l'idée d'une fine valeur à ne s'en plus servir.
Les ordonnances du Roi ont remédié à cet abus ; et la raison éclairée démontre à l'homme de guerre que lorsqu'il ne se tient pas en état de bien combattre de sa personne, il s'expose à devenir inutîle à lui-même et à sa patrie en beaucoup d'occasions, et à donner l'exemple de la mollesse à ceux qui sont sous ses ordres.
La valeur est sans-doute la vertu la plus essentielle à l'homme de guerre ; mais heureusement c'est la plus commune. Eh, que serait-il, s'il ne la possédait pas ?
Il n'est personne qui dans le fond de son cœur ne se rende justice à soi-même. L'homme de guerre doit se connaître, s'apprécier avec sévérité ; et lorsqu'il ne se sent pas les qualités qui lui sont nécessaires, il manque à la probité, il manque à sa patrie, à son roi, à lui-même, s'il s'expose à donner un mauvais exemple, et s'il occupe une place qui pourrait être plus dignement remplie.
Le mérite de l'homme de guerre est presque toujours jugé sainement par ses pareils ; il l'est encore avec plus de justice et de sévérité par le simple soldat.
On ne fait jamais plus qu'on ne doit à la guerre. C'est s'exposer à un déshonneur certain, que de négliger d'acquérir les connaissances nécessaires au nouveau grade qu'on est sur d'obtenir ; mais malheureusement rien n'est si commun.
Nous n'entrerons point ici dans les détails de la science immense de la guerre. Que pourrions-nous dire qui puisse égaler les écrits immortels des Vauban, des Feuquières, et des Puységur ?
Au reste, on se ferait une idée très-fausse de l'homme de guerre, si l'on croyait que tous ses véritables devoirs sont renfermés dans un art militaire qu'il ne lui est pas permis d'ignorer. Exposé sans-cesse à la vue des hommes, destiné par état à les commander, le véritable honneur doit lui faire sentir qu'une réputation intacte est la première de toutes les récompenses.
Nous nous renfermons ici dans les seuls devoirs respectifs des hommes. L'homme de guerre n'est dispensé d'en remplir aucun. Si par des circonstances toujours douloureuses pour une belle âme il se trouve dans le cas de pouvoir se dire comme Abner,
Ministre rigoureux des vengeances des rois ;
qu'il reçoive, qu'il excite sans-cesse dans son âme les sentiments de ce même Abner ; qu'il distingue le mal nécessaire que les circonstances l'obligent à faire, d'avec le mal inutîle et les brigandages qu'il ne doit point tolérer ; qu'au milieu des spectacles cruels et des désordres qu'enfante la guerre, la pitié trouve toujours un accès facîle dans son cœur ; et que rien ne puisse jamais en bannir la justice, le désintéressement, et l'amour de l'humanité. Article de M. le Comte DE TRESSAN.
GUERRE, (Droit naturel et Politique) c'est, comme on l'a dit plus haut, un différend entre des souverains, qu'on vide par la voie des armes.
Nous avons hérité de nos premiers ayeux,
Dès l'enfance du monde ils se faisaient la guerre.
Elle a regné dans tous les siècles sur les plus legers fondements ; on l'a toujours Ve désoler l'univers, épuiser les familles d'héritiers, remplir les états de veuves et d'orphelins ; malheurs déplorables, mais ordinaires ! De tout temps les hommes par ambition, par avarice, par jalousie, par méchanceté, sont venus à se dépouiller, se bruler, s'égorger les uns les autres. Pour le faire plus ingénieusement, ils ont inventé des règles et des principes qu'on appelle l'Art militaire, et ont attaché à la pratique de ces règles l'honneur, la noblesse, et la gloire.
Cependant cet honneur, cette noblesse, et cette gloire consistent seulement à la défense de sa religion, de sa patrie, de ses biens et de sa personne, contre des tyrants et d'injustes aggresseurs. Il faut donc reconnaître que la guerre sera légitime ou illégitime, selon la cause qui la produira ; la guerre est légitime, si elle se fait pour des raisons évidemment justes ; elle est illégitime, si on la fait sans une raison juste et suffisante.
Les souverains sentant la force de cette vérité, ont grand soin de répandre des manifestes pour justifier la guerre qu'ils entreprennent, tandis qu'ils cachent soigneusement au public, ou qu'ils se cachent à eux-mêmes les vrais motifs qui les déterminent. Ainsi dans la guerre d'Alexandre contre Darius, les raisons justificatives qu'employait ce conquérant, roulaient sur les injures que les Grecs avaient reçues des Perses ; les vrais motifs de son entreprise étaient l'ambition de se signaler, soutenue de tout l'espoir du succès. Il ne serait que trop aisé d'apporter des exemples de guerres modernes entreprises de la même manière, et par des vues également odieuses ; mais nous n'approcherons point si près des temps où nos passions nous rendent moins équitables, et peut-être encore moins clairvoyans.
Dans une guerre parfaitement juste, il faut non-seulement que la raison justificative soit très-légitime, mais encore qu'elle se confonde avec le motif, c'est-à-dire que le souverain n'entreprenne la guerre que par la nécessité où il est de pourvoir à sa conservation. La vie des états est comme celle des hommes, dit très-bien l'auteur de l'esprit des lois ; ceux-ci ont droit de tuer dans le cas de la défense naturelle, ceux-là ont droit de faire la guerre pour leur propre conservation : dans le cas de la défense naturelle, j'ai droit de tuer, parce que ma vie est à moi, comme la vie de celui qui m'attaque est à lui ; de même un état fait la guerre justement, parce que sa conservation est juste, comme toute autre conservation.
Le droit de la guerre dérive donc de la nécessité et du juste rigide. Si ceux qui dirigent les consciences ou les conseils des princes ne se bornent pas là, tout est perdu ; car les principes arbitraires de gloire, de bienséance, d'agrandissement, d'utilité, ne sont pas des droits, ce sont des horreurs ; si la réputation de la puissance d'un monarque peut augmenter les forces de son royaume, la réputation de sa justice les augmenterait de même.
Mais toute guerre est injuste dans ses causes, 1°. lorsqu'on l'entreprend sans aucune raison justificative, ni motif d'utilité apparente, si tant est qu'il y ait des exemples de cette barbarie : 2°. lorsqu'on attaque les autres pour son propre intérêt, sans qu'ils nous aient fait de tort réel, et ce sont-là de vrais brigandages : 3°. lorsqu'on a des motifs fondés sur des causes justificatives spécieuses, mais qui bien examinées sont réellement illégitimes : 4°. lorsqu'avec de bonnes raisons justificatives, on entreprend la guerre par des motifs qui n'ont aucun rapport avec le tort qu'on a reçu, comme pour acquérir une vaine gloire, se rendre redoutable, exercer ses troupes, étendre sa domination, etc. Ces deux dernières sortes de guerre sont très-communes et très-iniques. Il faut dire la même chose de l'envie qu'aurait un peuple, de changer de demeure et de quitter une terre ingrate, pour s'établir à force ouverte dans un pays fertîle ; il n'est pas moins injuste d'attenter par la voie des armes sur la liberté, les vies, et les domaines d'un autre peuple, par exemple des Américains, sous prétexte de leur idolatrie. Quiconque a l'usage de la raison, doit jouir de la liberté de choisir lui-même ce qu'il croit lui être le plus avantageux.
Concluons de ces principes que toute guerre juste doit se faire pour nous défendre contre les attaques de ceux qui en veulent à nos vies et à nos possessions ; ou pour contraindre les autres à nous rendre ce qu'ils nous doivent en vertu d'un droit parfait et incontestable qu'on a de l'exiger, ou pour obtenir la réparation du dommage qu'ils nous ont injustement causé : mais si la guerre est légitime pour les raisons qu'on vient d'alléguer, c'est encore à cette seule condition, que celui qui l'entreprend se propose de venir par ce moyen violent à une paix solide et durable.
Outre la distinction de la guerre, en celle qui est juste et celle qui est injuste, quelques auteurs politiques distinguent la guerre en guerre offensive et en défensive. Les guerres défensives sont celles que les souverains entreprennent pour se défendre contre d'autres souverains, qui se proposent de les conquérir ou de les détruire. Les guerres offensives sont celles que les souverains font pour forcer d'autres souverains à leur rendre ce qu'ils prétendent leur être dû. ou pour obtenir la réparation du dommage qu'ils estiment qu'on leur a causé très-injustement.
On peut admettre cette distinction, pourvu qu'on ne la confonde pas avec celle que nous avons établie, et qu'on ne pense pas que toute guerre défensive soit juste, et que toute guerre offensive soit injuste ; car il y a des guerres offensives qui sont justes, comme il y a des guerres défensives qui sont injustes. La guerre offensive est injuste, lorsqu'elle est entreprise sans une cause légitime, et alors la guerre défensive, qui dans d'autres occasions pourrait être injuste, devient très-juste. Il faut donc se contenter de dire, que le souverain qui prend le premier les armes, soit qu'il le fasse justement ou injustement, commence une guerre offensive, et que celui qui s'y oppose, soit qu'il ait ou qu'il n'ait pas tort de le faire, commence une guerre défensive. Ceux qui regardent le mot de guerre offensive comme un terme odieux, qui renferme toujours quelque chose d'injuste, et qui considèrent au-contraire la guerre défensive comme inséparable de l'équité, s'abusent sur cette matière. Il en est des princes comme des particuliers en litige : le demandeur qui entame un procès à quelquefois tort, et quelquefois raison ; il en est de même du défendeur : on a tort de ne vouloir pas payer une somme justement dû., comme on a raison de se défendre de payer ce qu'on ne doit pas.
Quelque juste sujet qu'on ait de faire la guerre offensive ou défensive, cependant puisqu'elle entraîne après elle inévitablement une infinité de maux, d'injustices, et de desastres, on ne doit se porter à cette extrémité terrible qu'après les plus mûres considérations. Plutarque dit là-dessus, que parmi les anciens Romains, lorsque les prêtres nommés féciaux avaient conclu que l'on pouvait justement entreprendre la guerre, le sénat examinait encore s'il serait avantageux de s'y engager.
En effet, ce n'est pas assez que le sujet de la guerre soit juste en lui-même, il faut avant que d'en venir à la voie des armes, qu'il s'agisse de la chose de la plus grande importance, comme de sa propre conservation.
Il faut que l'on ait au-moins quelque apparence probable de réussir dans ses justes projets ; car ce serait une témérité, une pure folie, que de s'exposer à une destruction totale, et se jeter dans les plus grands maux, pour ne pas en sacrifier de moindres.
Il faut enfin qu'il y ait une nécessité absolue de prendre les armes, c'est-à-dire qu'on ne puisse employer aucun autre moyen légitime pour obtenir ce qu'on a droit de demander, ou pour se mettre à couvert des maux dont on est menacé.
Je n'ai rien à ajouter sur la justice des armes ; on la déguise avec tant d'art, que l'on a quelquefois bien de la peine à découvrir la vérité : de plus, chaque souverain porte ses prétentions si loin, que la raison parvient rarement à les modérer : mais quelles que soient leurs vues et leurs démarches, toute guerre, dit Cicéron, qui ne se fait pas pour la défense, pour le salut de l'état, ou pour la foi donnée, n'est qu'une guerre illégitime.
Quant aux suites de la prise des armes, il est vrai qu'elles dépendent du temps, des lieux, des personnes, de mille événements imprévus, qui variant sans-cesse, ne peuvent être déterminés. Mais il n'en est pas moins vrai, qu'aucun souverain ne devrait entreprendre de guerres, qu'après avoir reconnu dans sa conscience qu'elles sont justes, nécessaires au bien public, indispensables, et qu'en même temps il y a plus à espérer qu'à craindre dans l'événement auquel il s'expose.
Non-seulement ce sont-là des principes de prudence et de religion, mais les lois de la sociabilité et de l'amour de la paix ne permettent pas aux hommes de suivre d'autres maximes. C'est un devoir indispensable aux souverains de s'y conformer ; la justice du gouvernement les y oblige par une suite de la nature même, et du but de l'autorité qui leur est confiée ; ils sont obligés d'avoir un soin particulier des biens et de la vie de leurs sujets ; le sang du peuple ne veut être versé que pour sauver ce même peuple dans les besoins extrêmes ; malheureusement les conseils flatteurs, les fausses idées de gloire, les vaines jalousies, l'avidité qui se couvre de vains prétextes, le faux honneur de prouver sa puissance, les alliances, les engagements insensibles qu'on a contractés par les suggestions des courtisans et des ministres, entraînent presque toujours les rois dans des guerres où ils hasardent tout sans nécessité, épuisent leurs provinces, et font autant de mal à leurs pays et à leurs sujets, qu'à leurs propres ennemis.
Supposé cependant, qu'une guerre ne soit entreprise qu'à l'extrémité pour un juste sujet, pour celui de sa conservation, il faut encore qu'en la faisant on reste dans les termes de la justice, et qu'on ne pousse pas les actes d'hostilité au delà de leurs bornes et de leurs besoins absolus. Grotius, en traitant cette matière, établit trois règles, qui peuvent servir à faire comprendre en peu de mots qu'elle est l'étendue des droits de la guerre, et jusqu'où ils peuvent être portés légitimement.
La première règle, c'est que tout ce qui a une liaison moralement nécessaire avec le but d'une guerre juste, doit être permis, et rien davantage. En effet, il serait inutîle d'avoir droit de faire une chose, si l'on ne pouvait se servir des moyens nécessaires pour en venir à bout ; mais il serait fou de penser, que pour défendre ses droits on se crut tout loisible et tout légitime.
Seconde règle. Le droit qu'on a contre un ennemi, et que l'on poursuit par les armes, ne doit pas être considéré uniquement par rapport au sujet qui fait commencer la guerre, mais encore par rapport aux nouvelles choses qui surviennent durant le cours de la guerre, tout de même qu'en justice une partie acquiert souvent un nouveau droit pendant le cours du procès ; c'est-là le fondement du droit qu'on a d'agir contre ceux qui se joignent à notre ennemi, soit qu'ils dépendent de lui ou non.
Traisième règle. Il y a bien des choses, qui, quoiqu'illicites d'ailleurs, deviennent permises et nécessaires dans la guerre, parce qu'elles en sont des suites inévitables, et qu'elles arrivent contre notre intention et sans un dessein formel ; ainsi, par exemple, pour avoir ce qui nous appartient, on a droit de prendre une chose qui vaut davantage, si l'on ne peut pas prendre précisément autant qu'il nous est dû. sous l'obligation néanmoins de rendre la valeur de l'excédent de la dette. On peut canonner un vaisseau plein de corsaires, quoique dans ce vaisseau il se trouve quelques hommes, quelques femmes, quelques enfants, ou autres personnes innocentes qui courent risque d'être enveloppées dans la ruine de ceux que l'on veut et que l'on peut faire périr avec justice.
Telle est l'étendue du droit que l'on a contre un ennemi en vertu de l'état de guerre : cet état anéantissant par lui-même l'état de société, quiconque se déclare notre ennemi les armes à la main, nous autorise à agir contre lui par des actes d'hostilité, de dégât, de destruction, et de mort.
Il est certain qu'on peut tuer innocemment un ennemi qui a les armes à la main, je dis innocemment aux termes de la justice extérieure et qui passe pour telle chez toutes les nations, mais encore selon la justice intérieure, et les lois de la conscience. En effet, le but de la guerre demande nécessairement que l'on ait ce pouvoir ; autrement ce serait envain que l'on prendrait les armes pour sa conservation, et que les lois de la nature le permettraient. Par la même raison les lois de la guerre permettent d'endommager les biens de l'ennemi, et de les détruire, parce qu'il n'est point contraire à la nature de dépouiller de son bien une personne à qui l'on peut ôter la vie. Enfin, tous ces actes d'hostilité subsistent sans injustice, jusqu'à ce qu'on se soit mis à l'abri des dangers dont l'ennemi nous menaçait, ou qu'on ait recouvré ce qu'il nous avait injustement enlevé.
Mais quoique ces maximes soient vraies en vertu du droit rigoureux de la guerre, la loi de nature met néanmoins des bornes à ce droit ; elle veut que l'on considère, si tels ou tels actes d'hostilité contre un ennemi sont dignes de l'humanité où même de la générosité ; ainsi tant qu'il est possible, et que notre défense et notre sûreté pour l'avenir le permettent, il faut toujours tempérer par ces sentiments si naturels et si justes les maux que l'on fait à un ennemi.
Pour ce qui est des voies mêmes que l'on emploie légitimement contre un ennemi, il est sur que la terreur et la force ouverte dont on se sert, sont le caractère propre de la guerre : on peut encore mettre en œuvre l'adresse, la ruse, et l'artifice, pourvu qu'on le fasse sans perfidie ; mais on ne doit pas violer les engagements qu'on a contractés, soit de bouche ou autrement.
Les lois militaires de l'Europe n'autorisent point à ôter la vie de propos délibéré aux prisonniers de guerre, ni à ceux qui demandent quartier, ni à ceux qui se rendent, moins encore aux vieillards, aux femmes, aux enfants, et en général à aucun de ceux qui ne sont ni d'un âge, ni d'une profession à porter les armes, et qui n'ont d'autre part à la guerre, que de se trouver dans le pays ou dans le parti ennemi.
A plus forte raison les droits de la guerre ne s'étendent pas jusqu'à autoriser les outrages à l'honneur des femmes ; car une telle conduite ne contribue point à notre défense, à notre sûreté, ni au maintien de nos droits ; elle ne peut servir qu'à satisfaire la brutalité du soldat effrené.
Il y a néanmoins mille autres licences infames, et mille sortes de rapines et d'horreurs qu'on souffre honteusement dans la guerre. Les lais, dit-on, doivent se taire parmi le bruit des armes ; je répons que s'il faut que les lois civiles, les lois des tribunaux particuliers de chaque état, qui n'ont lieu qu'en temps de paix, viennent à se taire, il n'en est pas de même des lois éternelles, qui sont faites pour tous les temps, pour tous les peuples, et qui sont écrites dans la nature : mais la guerre étouffe la voix de la nature, de la justice, de la religion, et de l'humanité. Elle n'enfante que des brigandages et des crimes ; avec elle marche l'effroi, la famine, et la désolation ; elle déchire l'âme des mères, des épouses, et des enfants ; elle ravage les campagnes, dépeuple les provinces, et réduit les villes en poudre. Elle épuise les états florissants au milieu des plus grands succès ; elle expose les vainqueurs aux tragiques revers de la fortune : elle déprave les mœurs de toutes les nations, et fait encore plus de misérables qu'elle n'en emporte. Voilà les fruits de la guerre. Les gazettes ne retentissent actuellement (1757), que des maux qu'elle cause sur terre et sur mer, dans l'ancien et le nouveau monde, à des peuples qui devraient resserrer les liens d'une bienveillance qui n'est déjà que trop faible, et non pas les couper. (D.J.)
GUERRE, (Jeu de la) c'est une manière particulière de jouer au billard plusieurs à-la-fais. Le nombre des personnes qui doivent jouer étant arrêté, chacun prend une bille marquée différemment, c'est-à-dire d'un point, de deux, et de plus, si l'on est davantage à jouer. Quand les billes sont tirées, chaque joueur joue à son tour, et selon que le nombre des points qui sont sur la bille lui donne droit : il est défendu de se mettre devant la passe sans le consentement de tous les joueurs. Celui qui joue une autre bille que la sienne perd la bille et le coup.
Qui touche les deux billes en jouant, perd sa bille et le coup ; il faut remettre l'autre à sa place.
Qui passe sur les billes, perd la bille et le coup ; et on doit mettre cette bille dans la belouse. Qui fait une bille et peut buter après, gagne toute la partie ; c'est pourquoi il est de l'adresse d'un joueur de tirer à ces sortes de coups autant qu'il lui est possible. Qui bute dessous la passe, gagne tout, fût-on jusqu'à neuf joueurs.
Les lois du jeu de la guerre veulent qu'on tire les billes à quatre doigts de la corde.
Il est défendu de sauver d'enjeu, à moins qu'on ne se soit repassé.
Qui perd son rang à jouer, ne peut rentrer qu'à la seconde partie.
Ceux qui entrent nouvellement au jeu, ne sont point libres de tirer le premier coup sur les billes, en plaçant les leurs où bon leur semble. Il faut qu'ils tirent la passe à quatre doigts de la corde.
Il faut remarquer que lorsqu'on n'est que cinq, on doit faire une bille avant que de passer.
Si on n'est que trois ou quatre, il n'est pas permis de passer jusqu'aux deux derniers.
Si celui qui tire à quatre doigts fait passer une bille, elle est bien passée.
Qui touche une bille de la sienne et se noye, perd la partie ; il faut que la bille touchée reste alors où elle est roulée.
Si celui qui touche une bille en jouant la noye et la sienne aussi, il perd la partie, et on remet la bille touchée où elle était. Si du côté de la passe on fait passer une bille espérant la gagner, et qu'on ne la gagne pas, cette bille doit rester où elle est, supposé qu'il y eut encore quelqu'un à jouer ; mais s'il n'y avait personne, on la remettrait à sa première place.
Quand un joueur a une fois perdu, il ne peut rentrer au jeu que la partie ne soit entièrement gagnée.
Les billes noyées appartiennent à celui qui bute, les deux derniers qui restent à jouer peuvent l'un et l'autre se sauver d'enjeu.
Si celui qui est passé ne le veut pas, il n'en sera rien. S'il y consent, il doit être préféré à celui qui n'est pas passé.
Celui qui par inadvertance joue devant son tour, ne perd que le coup et non pas la bille, c'est-à-dire qu'il y peut revenir à son rang. Qui tire à une bille la gagne ; et si en tirant le billard il touche une autre bille gagnée, elle est censée telle ; et la bille de celui qui a joué le coup doit être mise dans la belouse.
GUERRE
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Art militaire
- Affichages : 2020