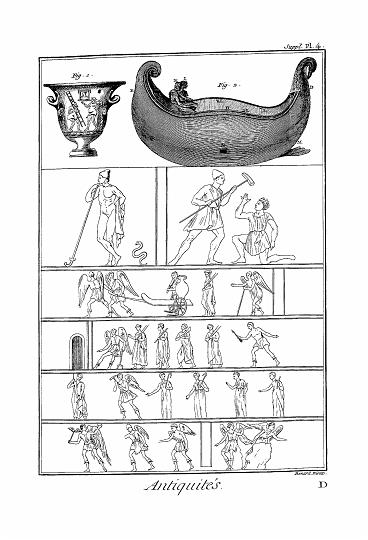(Géographie moderne) Salopiensis comitatus ; province d'Angleterre, autrement nommée Shrewsburg, et dont nous avons fait l'article ; mais je me suis proposé de parler ici des grands personnages qu'elle a produits dans les sciences ; il importe aux gens de lettres de les connaître.
Baxter (Richard), fameux théologien non-conformiste, devint un des chapelains ordinaires de Charles II. et refusa l'évêché de Hereford. Il mourut en 1691, dans un âge avancé. C'était un homme qui aurait tenu son rang parmi les plus savants de son siècle, s'il ne se fût pas mêlé de trop de choses, et en particulier, de répandre la métaphysique sur toutes sortes de sujets. Il mit au jour plus de cent livres, qui n'ont point passé à la postérité, quoiqu'ils soient écrits d'un style touchant et pathétique ; mais dans ce grand nombre d'ouvrages, il attaque toutes les sectes et tous les partis ; ce qui lui fait honneur néanmoins, c'est que l'âge changea la manière dont il jugeait des hommes, il devint tolérant sur la fin de ses jours ; il se convainquit de l'injustice qu'il y a à exercer des actes d'inhumanité, sous prétexte de faire du bien aux hommes, et de maintenir le bon ordre dans l'église ; enfin, il apprit à désapprouver les doctrines corrompues, plutôt qu'à damner ceux qui les professent.
Son neveu et son héritier, Baxter (Guillaume), se montra un excellent grammairien, et un fort habîle critique. Il mourut en 1723, âgé de 73 ans ; il était très-versé dans la mythologie, et entendait fort bien la plupart des langues de l'Occident et du Nord. Ses écrits lui ont acquis beaucoup de réputation dans la république des lettres ; il publia en 1719, son Glossarium antiquittatum britannicarum, dont il a paru une seconde édition en 1733, in-8°. avec des augmentations. Son Glossarium antiquittatum romanarum, a été donné depuis sa mort, à Londres, en 1726, in-8°. Cet ouvrage est rempli d'érudition grammaticale. Son édition d'Anacréon a été effacée par celle de M. Pauw, imprimée à Utrecht en 1732, in-4°. mais dans laquelle l'auteur n'aurait pas dû traiter avec tant de mépris, les notes de Baxter, et celles de Barnes, sur l'aimable poète de Téos.
Brooke (Robert), premier juge de la cour des plaidoyers-communs, sous le règne de la reine Marie, se rendit par son savoir, un des premiers jurisconsultes de son temps ; et mourut comblé d'estime en 1551. Il est auteur de divers ouvrages de droit, et entr'autres de celui qui a pour titre, le grand abrégé, la graunde abridgement ; c'est un extrait alphabétique de matières choisies du droit de la Grande-Bretagne : il s'en est fait plusieurs éditions, principalement à Londres, savoir en 1573, 1576, 1586, etc. et parmi ces éditions, les plus anciennes sont estimées les meilleures, comme il arrive ordinairement aux recueils de ce genre.
Gataker (Thomas), descendait d'une ancienne et bonne famille de Shropshire ; il naquit en 1574. et se montra par son érudition, un des savants anglais du dernier siècle ; il mourut en 1654, âgé de 80 ans. c'était un homme d'une lecture prodigieuse, et d'un jugement exact en matière de critique ; ses œuvres ont été recueillies, et imprimées à Utrecht en 1698, in-fol.
Son discours de la nature et de l'usage du sort, est le meilleur que nous ayons sur cette matière ; il y prouve avec raison, 1°. qu'il y a autant de superstition à un homme de penser que certaines choses déplaisent à Dieu, qui ne lui sont réellement point désagréables, que de supposer que la créature a un pouvoir qu'elle n'a réellement point. 2°. que plusieurs personnes, vraiment pieuses, ont joué, et jouent communément, par délassement et sans cupidité, à des jeux de hasard ; et que d'autres gens du même ordre, se sont trouvés et se trouvent exposés à divers inconvéniens, en refusant par scrupule, d'y jouer, lorsqu'ils y sont sollicités par les personnes avec lesquelles ils vivent en relation ou avec lesquelles ils ont des ménagements à garder. 3°. que les raisons sur lesquelles on condamne ces jeux, ont été cause de l'irrésolution de bien des gens, par rapport à l'usage nécessaire du sort dans les affaires sérieuses, et de la vie civîle ; par exemple, lorsque dans des marchés communs entr'eux, et d'autres cas semblables, ils ont été contraints d'y avoir recours, et se sont trouvés dans l'incertitude s'ils le pouvaient légitimement, ou non.
Sa dissertation latine, de novi Testamenti stylo, est une pièce curieuse ; il y prouve qu'il est fort incertain quelles langues sont des mères langues, mais qu'en tout cas, il est sur que la latine n'est pas de ce nombre, puisqu'elle a beaucoup de termes de la langue sabine et toscane, et qu'elle tire principalement son origine de la grecque, et surtout de la dialecte éolienne ; et il cite là dessus Dionys. Halicarn. Antiq. rom. lib. I. Eustath. in Odyss. lib. I. Quintilian. Instit. lib. I. cap. Ve et VIe Varro, de ling. lat. lib. IV. et IX. Suidas, in voce Naba. Julius Scaliger, de plant. lib. I. Joseph Scaliger, in Festum. Dan. Heinsius, de satyr. Horat. Hugo Grotius, de satisfact. christi, cap. VIIIe Jo. Meursius, in mantissa ad luxum romanum, c. XIIe Vossius, in praefat. ad lib. de vitiis sermonis. Laur. Ramirez, Pentecontarch. cap. VIe Conrad. Gesner, in Mithridate ; et Seron Mesigerus, in praefat. Polyglot.
Pour le prouver, il remarque que si nous prenons quelque auteur latin, nous y trouverons peu de lignes, où il n'y ait divers mots dont l'origine ne soit visiblement grecque ; il donne pour exemple, les cinq premiers vers de la première éclogue de Virgile : nous rapporterons ici les deux premiers.
Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi,
Sylvestrem tenui musam meditaris avenâ.
Il n'y a rien à dire du mot Tityrus, parce que c'est un nom propre, tu est doricum, . patulus, à pateo , recubo, cubo, , sub, ut super. , tego, et inde tegmen , dorice , fagus ; , sylva, sylvestris. , tendo, extendo ; , musa ; , meditor ; siccus, aridus ; , anima sicca ; ab , exsicco, ; unde ab ariditate, vox latina, avena.
Hyde (Thomas), savant d'une habileté extraordinaire dans les langues orientales, naquit en 1636, et mourut en 1706. professeur en arabe à Oxford, à la place du docteur Edmond Pocock. Il prouva sa science par son travail sur la polyglotte de Walton ; il corrigea non-seulement l'arabe, le syriaque, et le samaritain, mais il mit le Pentateuque persan en état de paraitre. Ce Pentateuque avait été imprimé à Constantinople en caractères hébraïques, M. Hyde le transcrivit en caractères persans ; ce que le savant archevêque Usser croyait impossible, à pouvoir même être exécuté par un persan naturel, parce qu'une lettre hébraïque répond souvent à plusieurs lettres persanes, de sorte qu'il est difficîle de démêler laquelle il faut prendre. Il traduisit aussi ce Pentateuque en latin.
En 1665, il publia une version latine des observations d'Ulugbeig, sur la longitude et la latitude des étoiles fixes, avec des notes ; il a joint à cet ouvrage les tables de la déclinaison et de l'ascension des étoiles fixes, de Mahomèdes Tizinus.
En 1674, il mit au jour le catalogue des livres imprimés de la bibliothèque bodléienne. En 1677, il publia les quatre évangiles et actes des apôtres, en langue malaise, et en caractères européens. En 1691, il donna, itinera mundi, seu cosmographia Abrahami Pertsol, cum versione et notis. En 1694, il publia à Oxford in-8°. de ludis orientalibus, libri duo. Enfin, son grand et beau traité de la religion des anciens Perses, historia religionis veterum Persarum, eorumque magorum, parut à Oxford, en 1700, in-4°. c'est un ouvrage où règne la plus profonde érudition.
M. Wood nous a donné la liste d'une trentaine d'autres ouvrages très-curieux, que le savant Hyde se proposait de publier, s'il vivait assez de temps pour les finir, ayant déjà travaillé à tous ; c'est un trésor que possède l'université d'Oxford.
Littleton (Edouard), garde du grand sceau d'Angleterre, sous le règne de Charles I. naquit dans la comté de Shrop, en 1589 ; fut nommé chevalier par le roi en 1635, garde du grand sceau en 1639, et la même année pair d'Angleterre. Il nous reste de lui des discours sur la liberté des sujets, et la prérogative du souverain ; ils ont été imprimés à Londres, en 1628 et 1677, in-fol. On les trouve aussi dans les collections de Rushworth. C'était, dit milord Clarendon, un homme de cœur, qui s'acquit une grande réputation par la profession des lois et du droit coutumier, de sorte qu'il était regardé comme le plus savant dans les antiquités de ce genre ; et dans les cours supérieures, il parut toujours avec éclat.
Littleton (Adam), philologiste habile, et savant grammairien, naquit dans Shropshire en 1627, et mourut en 1694. Le dictionnaire latin et anglais, qu'il a mis au jour, en 1678, in-4°. lui a fait beaucoup d'honneur ; on l'emploie dans les écoles, et on le réimprime perpétuellement ; cependant le dictionnaire de Cambridge mérite la préférence, à cause des autorités dont les mots sont appuyés ; mais le docteur Littleton, outre son dictionnaire latin, a publié plusieurs autres ouvrages, soit en belles-lettres, soit en théologie ; il entendait même les langues orientales, et dépensa la plus grande partie de son bien pour se procurer des livres et des manuscrits en ce genre.
Maynwaring (Arthur), écrivain politique du dernier siècle, naquit en 1668, et mourut en 1712. Il est auteur de plusieurs brochures pleines d'esprit sur les affaires politiques, et entr'autres, de la feuille hebdomadaire intitulée le Mêlange. Il aima sur la fin de ses jours, avec la plus forte passion, la célèbre actrice mademoiselle Oldfield, et la fit son exécutrice testamentaire ; elle fut sans contredit redevable à ses instructions, d'être devenue si excellente comédienne ; car comme il n'y avait personne qui entendit mieux que lui l'action du théâtre, il n'y avait aussi personne qui fût plus charmé d'y voir exceller mademoiselle Oldfield.
Whichcot (Benjamin), naquit dans le comté de Shrop, en 1609, et mourut chez son ami le docteur Cudworth. Ses sermons choisis parurent à Londres, en 1698, in-8°. avec une préface du comte de Shaftesbury, auteur des Charactéristicks : c'est une chose bien singulière de voir un homme si célèbre, et si peu croyant, éditeur de sermons ! mais en même-temps sa préface est si belle, et si peu connue des étrangers, qu'ils nous sauront gré d'en trouver ici un assez grand extrait.
Milord Shaftesbury observe d'abord, que quand on fait réflexion sur la nature de la prédication, que l'on considère l'excellence de cet établissement, le cas qu'on en a toujours fait dans le christianisme, le grand nombre de saints hommes mis à part pour cette grande œuvre, à qui l'on accorde tous les avantages possibles, pour avancer les grandes vérités de la révélation, et pour inspirer aux hommes du respect pour la religion ; quand on fait attention à la solennité des assemblées religieuses, à la présence respectable et à l'autorité de l'orateur chrétien, il y a peut-être lieu de s'étonner qu'on ne lui voit pas produire de plus grands et de plus heureux effets dans le monde ; on doit néanmoins reconnaître que cette institution est un si puissant appui de notre religion, que s'il n'y avait point d'assemblées publiques, ni de ministres autorisés, il n'y aurait, en fort peu de temps, non-seulement plus de christianisme, mais de vertus ; puisque nonobstant tous les secours de la prédication, et les appuis qu'elle fournit à la vertu, il s'en faut de beaucoup que les mœurs soient reformées, et que les hommes soient devenus meilleurs.
Mais quelque raison que nous ayons de penser toujours respectueusement de cette institution, et des bons effets qu'elle produit sur les hommes ; quelque avantageuse que soit l'idée que nous pouvons avoir du travail de ceux à qui le ministère de la parole est commis, il semble néanmoins qu'il n'est pas impossible qu'il n'y ait quelque chose de défectueux, et que le peu de succès ne doit pas être uniquement attribué à la malice, à la corruption, à la stupidité des auditeurs, ou des lecteurs.
On a Ve que dans quelques pays, et parmi certain ordre de chrétiens, le ministère de la parole n'a pas été entièrement consacré aux choses spirituelles ; mais qu'une grande partie de ces divines exhortations, a eu quelque chose de commun avec les affaires d'état. De quelque utilité que cela ait pu être aux hommes, ou à la paix du christianisme, il faut avouer que la prédication en elle-même doit être d'autant moins propre à produire une heureuse révolution dans les mœurs, à proportion qu'elle a servi à produire des révolutions d'état, ou à appuyer d'autres intérêts que ceux du royaume de Jesus-Christ. Nous ne trouvons pas non plus, que depuis que la politique et les mystères de la religion ont été unis ensemble, l'une ni l'autre en aient tiré beaucoup d'avantages ; du moins n'a-t-il jamais paru que la théologie soit devenue meilleure par la politique, ou que la politique ait été épurée par la théologie.
Entre les auteurs qui ont été zélés pour cette malheureuse alliance, et qui ont voulu faire un système de politique chrétienne, on nomme le fameux Hobbes, lequel, soit qu'il ait rendu quelque service au gouvernement civil, ou non, a du moins fait bien du mal aux mœurs ; et si les autres parties de la philosophie lui ont quelque obligation, la morale ne lui en a aucunement. Il est vrai que tout ce qu'il y a eu de grands théologiens dans l'église anglicane, l'ont attaqué avec beaucoup de zèle et d'érudition, mais si l'on avait travaillé avec le même soin à corriger ses principes de morale, qu'on a eu à réfuter quelques autres de ses erreurs, cela eut peut-être été d'un plus grand service à la religion pour l'essentiel. Je nomme ce philosophe, parce qu'en faisant l'énumération des passions qui tiennent les hommes unis en société, et les engagent à avoir quelque commerce ensemble, il oublie de parler de la douceur, de l'amitié, de la sociabilité, de l'affection naturelle, et des autres dispositions de cet ordre ; je dis qu'il oublie, parce qu'il est difficîle de concevoir qu'il y ait un homme assez méchant, pour n'avoir jamais éprouvé par expérience, aucun de ces sentiments, et pour pouvoir en conclure qu'ils ne se rencontrent point dans les autres.
A toutes les passions et à toutes les bonnes dispositions, cet auteur a substitué une seule passion dominante, savoir la crainte, qui ne laisse subsister qu'un désir immodéré d'ajouter pouvoir à pouvoir, désir qui, selon lui, ne s'éteint que par la mort ; il accorde aux hommes moins de bon naturel qu'aux bêtes féroces.
Si le poison de ces principes contraires à la saine morale ne s'était pas répandu au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, surtout dans le temps que le docteur Whichcot vivait, peut-être que lorsqu'il s'agissait des intérêts de la vertu, aurions-nous entendu moins parler de terreur et de châtiments, et davantage de rectitude morale et de bon naturel. Du moins n'aurait-on pas pris l'habitude d'exclure le bon naturel, et de rabaisser la vertu, qu'on attribue au seul tempérament. Au contraire, les défenseurs de la religion se seraient fait une affaire de plaider en faveur de ces bonnes dispositions, et de faire voir combien elles sont profondément enracinées dans la nature humaine, au lieu de prendre le contrepié, et d'avoir bâti sur leurs ruines ; car certaines gens s'y prenaient ainsi pour prouver la vérité de la religion chrétienne.
On établissait la révélation en déprimant les principes fondés dans la nature de l'homme, et l'on faisait consister la force de la religion dans la faiblesse de ces principes ; comme si un bon naturel et la religion étaient ennemis : chose si peu connue parmi les payens mêmes, que la piété par laquelle ils désignaient la religion (comme le nom le plus honorable qu'ils pouvaient lui donner), consistait en grande partie en de bonnes dispositions naturelles ; et qu'on entendait par-là non-seulement l'adoration et le culte de la divinité, mais l'affection des parents pour leurs enfants, celle des enfants pour la patrie, et en général celle de tous les hommes les uns pour les autres, dans leurs différentes relations.
On a eu raison de reprocher à quelques sectes chrétiennes que leur religion paraissait opposée au bon naturel, et n'être fondée que sur la domination, sur l'amour propre et sur la haine, toutes dispositions qu'il n'est pas aisé de concilier avec l'esprit de l'évangile. Mais on peut dire certainement de l'église anglicane, autant et plus que d'aucune autre au monde, que ce n'est pas là son esprit, et que c'est par des traits totalement opposés que cette église se fait connaître, plus que toutes les autres, pour vraiment et dignement chrétienne.
Wycherley (Guillaume), un des plus célèbres poètes comiques, naquit vers l'an 1640. Il étudia quelque temps à Oxford, quitta l'université sans avoir pris aucun degré, et se fit recevoir dans la société des jurisconsultes de Middle-Temple. Mais comme ce temps-là était celui du règne des plaisirs et de l'esprit, Wycherley qui avait de l'esprit et du goût pour les plaisirs, abandonna promptement l'étude seche des lois, pour des occupations plus agréables et plus à la mode. Il composa sa première pièce de théâtre intitulée l'amour dans un bois, représentée en 1672 avec un grand succès. Ce début favorable lui procura la connaissance de tous les beaux esprits de la cour et de la ville, et en particulier celle de la duchesse de Cleveland, qu'il fit d'une façon assez singulière.
Un jour que Wycherley allait en carosse du côté de S. James, il rencontra près de Pall-Mall, la duchesse dans sa voiture, qui mettant la tête hors de la portière, lui cria tout haut : " vous, Wycherley, vous êtes un fils de putain ; " et en même temps elle se cacha, et se mit à rire de toute sa force. Wycherley fut d'abord un peu surpris de ce compliment ; mais il comprit bientôt qu'il faisait allusion à un endroit de sa comédie, où il dit : " quand les parents sont esclaves, leurs enfants suivent leur destinée ; les beaux génies ont toujours des p... pour mères ".
Comme dans les premiers moments de la surprise de Wycherley les carosses avaient continué leur route, il se trouvait déjà assez éloigné ; mais notre poète revenu de son étonnement ordonna à son cocher de fouetter ses chevaux, et d'atteindre le carosse de la duchesse.
Dès qu'il l'eut atteint : " Madame, lui dit-il, vous m'avez donné un nom qui appartient généralement aux gens heureux. Votre grandeur voudrait-elle se trouver ce soir à la comédie de Wycherley. Eh bien, reprit-elle, si je m'y trouve, que lui arrivera-t-il d'heureux ? C'est, répondit le poète, que j'aurai l'honneur de vous y faire ma cour, quoiqu'en même temps je manque à une belle personne, qui m'a donné rendez-vous ailleurs. Quoi, dit la duchesse, vous avez l'infidélité de manquer à une belle femme qui vous a favorisé à ce point, pour une autre qui ne l'a point fait, et qui n'y songe pas ? Oui, reprit Wycherley, dès que celle qui ne m'a point favorisé, est la plus belle des deux ; mais quiconque, continua-t-il, demeurera constamment attaché à votre grandeur, jusqu'à ce qu'il en ait trouvé une plus belle, est sur de mourir votre captif. " La duchesse de Cleveland rougit et ordonna à son cocher d'avancer.
Comme elle était dans la fleur de la jeunesse, spirituelle, et la plus grande beauté qu'il y eut en Angleterre, elle fut sensible à un compliment aussi galant. Pour couper court, elle vint à la comedie du poète, elle se plaça comme de coutume au premier rang, dans la loge du roi. Wycherley se mit directement au-dessous d'elle, et l'entretint pendant tout le cours de la pièce. Tel a été le commencement d'un commerce, qui fit dans la suite beaucoup de bruit.
Mais le plus étrange, c'est que ce fut ce commerce même, qui mit Wycherley dans les bonnes grâces du duc de Buckingham, lequel passionnément épris de cette dame, en était mal-traité, et se persuada que Wycherley était heureux. Enfin, le duc ne recueillit aucun fruit de ses longues assiduités auprès de la duchesse, soit qu'elle fût retenue par la proximité du parentage qu'il y avait entr'eux, (car elle était sa cousine germaine), soit qu'elle craignit qu'une intrigue avec un homme de ce rang, sur qui tout le monde avait les yeux, ne put demeurer cachée au roi ; en un mot, quelle qu'en fut la raison, elle refusa de recevoir plus longtemps ses visites, et s'obstina si fort dans son refus, que l'indignation, la rage, et le mépris, succédèrent à l'amour dans le cœur du duc, qui résolut de perdre sa parente.
Cette résolution prise, il la fit observer de si près, qu'il sçut bien-tôt qui étaient ceux qu'il pourrait regarder comme ses rivaux. Lorsqu'il en fut instruit, il eut soin de les nommer ouvertement, et le poète ne fut pas oublié, pour faire encore plus de tort à la duchesse dans l'esprit du public. Wycherley apprenant de bonne-heure cette fâcheuse nouvelle, craignit extrêmement qu'elle ne vint aux oreilles du roi. Pour prévenir ce malheur, il pria instamment Wilmot, comte de Rochester, et le chevalier Charles Sidley, de représenter au duc, le tort extrême qu'il ferait à un homme qui n'avait pas l'honneur d'être connu de lui, qui le respectait, et qui ne l'avait jamais offensé. A peine ces MM. eurent commencé à en toucher quelque chose au duc, qu'il s'écria " qu'il ne blâmait point Wycherley, mais sa cousine ". Cependant, reprirent-ils, en le faisant soupçonner d'une pareille intrigue, vous le perdrez infailliblement ; c'est-à-dire, que votre grandeur travaille injustement à ruiner de fond en comble un homme de mérite.
Enfin ces MM. s'étendirent si fort sur les belles qualités de Wycherley, et sur les charmes de sa conversation, que le duc de Buckingham amoureux des avantages de l'esprit, permit qu'on lui présentât Wycherley, et il le retint à souper. Il fut si charmé de lui, qu'il s'écria dans son transport, " ma cousine a raison ; " et depuis ce moment, il fit de Wycherley son ami, et le combla de bienfaits. Comme il était grand écuyer du roi, et colonel d'un des premiers régiments de la couronne, il nomma Wycherley un des sous-écuyers, et capitaine-lieutenant de sa compagnie, dont il lui céda tous les appointements ; ces deux objets faisaient au moins trente-six mille livres de rente de notre monnaie, et faufilèrent agréablement Wycherley avec la noblesse de la cour et de la ville.
Il continua de travailler pour le théâtre. On avait déjà joué son misantrope (plain-dealer) en 1678, et en 1683, on représenta sur le théâtre royal, sa femme de campagne, the country-wife. Cet homme qui passait sa vie dans le plus grand monde, dit M. de Voltaire, en connaissait parfaitement les vices, et les peignait du pinceau le plus ferme et des couleurs les plus vraies. Dans son misantrope qu'il a imité de Moliere, il est certain que ses traits ont moins de finesse et de bienséance, mais ils sont plus forts et plus hardis ; la pièce anglaise est plus intéressante, et l'intrigue plus ingénieuse. Sa femme de campagne, est encore tirée de l'école des femmes de Moliere. Cette pièce anglaise n'est pas assurément l'école des bonnes mœurs, mais c'est l'école de l'esprit, et du bon comique.
Le roi Charles II, donna à Wycherley de grandes marques de sa faveur. Il lui rendit visite dans une maladie, et lui conseilla d'aller passer l'hiver à Montpellier, conseil qu'il accompagna d'un présent de cinq cent livres sterling, pour le défrayer. Il perdit néanmoins dans la suite les bonnes grâces du roi par son mariage avec la comtesse de Drogheda, qui le fit maître de tout son bien ; mais après la mort de cette dame, la donation lui fut contestée, enlevée ; Wycherley ruiné, fut arrêté par les créanciers, et mis en prison où il demeura sept ans, et n'en fut tiré que par la générosité de Jacques II, qui au sortir d'une représentation du plain-dealer, ordonna sur le champ de payer de sa bourse, les dettes de l'auteur.
Il prit le parti de disposer du douaire de sa première, en épousant une jeune personne, qui lui apporta quinze cent livres sterling, dont une portion servit à ses pressants besoins ; mais il mourut en 1715, onze jours après la célébration de ses noces. On avait publié à Londres en 1704 un volume de ses poésies mêlées, qui n'ont pas été reçues aussi favorablement du public, que ses pièces de théâtre.
Mylord Lansdowne a peint Wycherley avec beaucoup d'esprit et de vérité. Ceux, dit-il, qui sans connaître Wycherley autrement que par ses ouvrages, voudront en juger, seront portés à croire que la variété des images et des caractères, la profonde connaissance de la nature, les observations fines de l'humeur, des manières, et des passions des personnes de tout rang et de toute condition, en un mot, cette exacte peinture de la nature humaine, que l'on voit dans ses productions, jointe à beaucoup d'esprit et de force d'expression, que tout cela ensemble, dis-je, ne peut avoir été que le fruit d'une application et d'un travail extraordinaire ; tandis que dans le fond, nous devons le plaisir et l'avantage qu'il nous a procuré à sa grande facilité. S'il lui en avait couté pour écrire, je suis bien trompé s'il ne s'en serait pas épargné la peine. Ce qu'il a fait, aurait été difficîle pour un autre ; mais la massue ordinaire, qu'un homme ne pouvait lever, servait de canne à Hercule.
L'âcreté de ses satyres pourrait vous jeter dans une autre erreur, et vous faire penser que c'était un homme malin. Mais ce que le lord Rochester dit du lord Dorset, peut lui être appliqué ; " c'était le meilleur homme avec la muse la plus maligne. " Tout piquant et censeur sévère qu'il parait dans ses écrits, il était du caractère le plus doux et le plus humain, obligeant tout le monde, et ne voulant de mal à personne ; il n'attaque le vice que comme un ennemi public ; sensible à la plaie, il est contraint de la sonder ; ou tel qu'un conquérant généreux, il s'afflige de la nécessité d'user des voies de rigueur.
Le roi Charles II. qui était lui-même homme d'esprit, se faisait souvent un plaisir de passer ses heures de loisir avec Wycherley, comme Auguste avec Horace, et il eut même des vues fort avantageuses sur lui ; mais malheureusement l'amour vint à la traverse, l'amant l'emporta sur le courtisan, l'ambition fut la victime de l'amour, la passion dominante des plus belles ames.... Il y a des personnes qui critiquent sa versification. Il est certain qu'elle n'est pas nombreuse ; mais un diamant brute n'en est pas moins un diamant. (D.J.)
SHROPSHIRE
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Géographie moderne
- Affichages : 1016