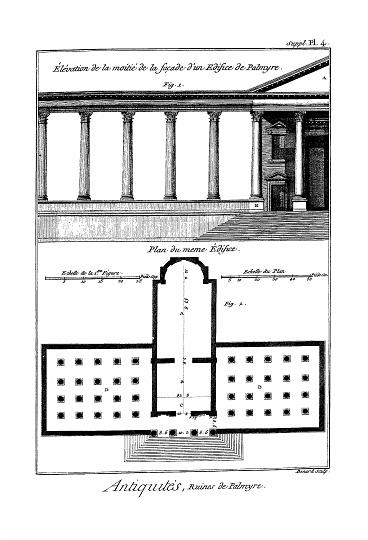(Géographie moderne) province méditerranée d'Angleterre, au diocèse de Worcester. Elle a 130 milles de tour, et contient environ 544 arpens.
La Saverne la traverse toute entière, et presque par le milieu du nord au sud, et reçoit en passant les eaux de trois ou quatre rivières. Elle est encore arrosée de la Stoure, et de la Salvarpe à l'orient, et de la Thame à l'occident, un peu au-dessous de la ville de Worcester : l'Avon venant du côté de Warwick, lave aussi un coin de cette province au sud-est.
Worcestershire est séparé au sud-est de Herefordshire par les montagnes nommées Malvernes, qui s'élèvent à la hauteur de sept milles. Cette province est une des meilleures de l'Angleterre. En été on y voit de belles et grandes campagnes couvertes de blé, d'excellents pâturages, et de forêts ; il s'y trouve aussi quelques puits d'eau salée, et quelques fontaines médicinales. Les haies sont bordées de poiriers, dont on presse le fruit pour en faire un excellent poiré. Les rivières qui l'arrosent lui fournissent beaucoup de poisson. En particulier la Saverne y nourrit quantité de lamproies, qui se plaisent dans les eaux limoneuses, telles que sont celles de cette rivière. L'air répond au terroir : il est sain et tempéré. Outre Worcester la capitale, il y a onze autres bourgs ou villes à marché. Enfin les muses ont fleuri de bonne heure dans cette province.
Dès le XVe siècle, Littleton (Thomas) se fit une grande réputation par son livre des tenures, ouvrage dont le chevalier Edouard Coke fait le plus bel éloge. L'archidiacre Nicholson, dans son english historical library, part. III. p. 169, London, 1699, observe que ce livre est entre les mains de tous ceux qui se destinent à l'étude, ou à la profession du droit municipal d'Angleterre, et qu'il a été imprimé plus souvent qu'aucun autre livre de droit. Quantité de ses éditions sont très-fautives ; et il faut s'en servir avec précaution, parce que les ridicules notes marginales de quelques possesseurs ignorants des copies manuscrites, se sont glissées dans le texte, et qu'on y cite sans rime ni raison, des cas auxquels l'auteur n'a jamais pensé... Un grand nombre d'articles de son droit commun, sont à présent changés par des actes parlementaires, et d'autres ne sont plus en usage. Par exemple, tout ce qui regarde les dons en frankemariage, etc. ne sert qu'aux disputes, à fournir quelques questions subtiles pour exercer les jeunes gens dans les collèges, ou inns de cour. A l'égard de quelques endroits qui paraissent obscurs à-cause de la briéveté à laquelle la méthode de l'auteur l'obligeait, on peut les trouver plus amplement expliqués dans le journal the year-book d'Edouard IV. où l'on verra souvent le sentiment de Littleton sur divers cas épineux, avec les raisons sur lesquelles il était appuyé ; d'autres sujets ont été traités plus amplement par Bracton et par Breton, que notre auteur a abrégés en ce qu'il y a de principal.
Habington (Guillaume), naquit dans le comté de Worcester, en 1605, et mourut en 1654. Ses ouvrages sont des poésies, sous le titre de castara, Londres, 1635, in -8. et en prose, l'histoire d'Edouard IV. roi d'Angleterre, Londres, 1640, en un petit in-fol. Nicholson trouve que l'auteur a donné une assez belle ébauche du règne d'Edouard IV. et qu'il a fait le portrait de ce prince dans un style fleuri d'une manière aussi ressemblante qu'on pouvait l'attendre d'un homme si fort éloigné par le temps, de l'original.
Hooper (Georges), évêque de Bath et de Wells, naquit dans le comté de Worcester, en 1640, et mourut en 1727, à 87 ans. Ses ouvrages sont remplis d'érudition en tout genre ; mais je ne citerai que deux, peu connus des étrangers, dont je donnerai, par cette raison, une courte analyse ; je veux parler de son traité du carême, et de ses recherches sur les anciennes mesures.
Son traité du carême parut à Londres en 1694, in -8°. L'auteur y prouve que dans le iv. siècle, lorsque la religion chrétienne commença d'avoir un plus grand nombre d'écrivains, la quadragésime, ainsi qu'on parlait dans ce temps-là, s'observait assez généralement par les chrétiens, pendant 40 jours. Si nous remontons vers le milieu du IIIe siècle, nous y trouverons déjà quelque détail de l'austérité avec laquelle les chrétiens observaient la semaine de la passion ; détail qui nous vient d'un des plus grands hommes de l'Eglise, qu'on avait consultés sur l'heure qu'on pouvait finir le jeune.
Cette grande austérité de la semaine-sainte, qui ne le cédait en rien à celle dont on a usé dans la suite, donne tout lieu de penser que les chrétiens de ce temps-là, n'ont pas laissé à la génération suivante, le soin d'y ajouter la dévotion des semaines précédentes ; surtout, puisque nous trouvons qu'Origène, maître de Denys, parle en termes exprès de la quadragésime, comme consacrée au jeune. Il est vrai que nous n'avons ce passage d'Origène que de la version de Rufin, qui n'était pas le traducteur le plus exact ; mais il n'était pas le plus mauvais ; ainsi il y a plus d'apparence qu'il a traduit ici fidèlement, que le contraire, n'y ayant aucune raison particulière de soupçonner de la falsification dans ce terme, plutôt que dans un autre de la période, ni de s'étonner qu'il soit parlé d'une chose si connue assez peu de temps après.
Il parait par le témoignage de Tertullien (qu'on peut mettre dans le second siècle, aussi-bien que dans le troisieme) qu'au sentiment de l'Eglise de son temps, les jours de la mort de Jesus-Christ, le vendredi et le samedi-saint devaient être consacrés au jeune, en vertu de l'autorité des apôtres ; qu'on n'était point obligé de jeuner d'autres jours, et comme en vertu d'un précepte divin ; mais que cela était laissé à la discrétion des fidèles, selon qu'ils le jugeaient à-propos. Cette espèce d'incertitude ne lui permettait pas naturellement d'en dire davantage, Ve le sujet qu'il traitait, ni de nous instruire des différentes coutumes des églises sur cette partie arbitraire du carême, quoique l'on puisse recueillir d'ailleurs, même de Tertullien, qu'on observait dès ce temps-là un espace plus considérable.
Mais pour remonter plus haut, et nous approcher d'avantage du siècle des apôtres vers l'an 190, après la mort de S. Jean Irénée, évêque vénérable, qui avait conversé particulièrement avec Polycarpe, comme celui-ci avec S. Jean et d'autres apôtres ; Irénée, dis - je, nous a instruit, quoique par occasion seulement, des pratiques différentes de son temps ; il nous apprend que les uns croyaient devoir jeuner un jour, les autres deux jours, ceux-ci plusieurs jours, ceux-là quarante jours.
Les recherches du savant Hooper sur les anciennes mesures des Athéniens, des Romains, et particulièrement des Juifs ont été imprimées à Londres en 1721, in -8°. L'auteur déclare dans sa préface qu'ayant lu avec soin sur cette matière deux traités curieux, qui parurent presque en même-temps en l'année 1684, l'un du docteur Cumberland, mort évêque de Peterborough, et l'autre du docteur Edouard Bernard, imprimé d'abord avec le commentaire du docteur Pocock sur Osée, qu'ayant aussi examiné les dissertations de M. Greaves sur le pied et sur le denier romain louées avec raison par les deux amateurs dont on vient de parler, il s'était attaché à rechercher plus exactement les mesures des hébreux ; et qu'ayant bâti sur les principes surs de M. Greaves, ayant suivi la méthode de l'évêque Cumberland et profité des riches matériaux rassemblés par le docteur Bernard, il s'était fait le système suivant.
Premièrement, qu'ayant examiné en général les différentes mesures pour la longueur, la capacité, le poids et le rapport qu'elles ont les unes aux autres, il a fixé les mesures anglaises auxquelles il voulait réduire celles des juifs, afin de s'en faire de plus justes idées. Ensuite, comme il fallait chercher la connaissance des mesures des juifs dans ce que nous en ont dit des écrivains de divers temps et de divers pays, et qu'il fallait réduire leurs différentes mesures à celles d'Angleterre, il a été obligé d'examiner quelques-unes des mesures modernes, mais sur - tout les anciennes mesures des Athéniens et des Romains ; et que muni de ces secours, il a rapporté et comparé ensemble ce que l'on a dit de plus vraisemblable touchant les mesures des juifs, et s'est mis en état d'en donner une connaissance aussi claire et aussi certaine qu'il est possible. Ses recherches sont donc divisées en quatre parties.
Dans la première, il examine les mesures en général, et particulièrement celles d'Angleterre, et quelques autres dont on se sert de nos jours à Rome, en Espagne, en Hollande et en Egypte. Dans la seconde, il recherche les mesures d'Athènes à cause des auteurs grecs qu'il faut consulter. Dans la troisième, il examine les mesures anciennes des Romains qui supposent la connaissance de celles d'Athènes, et dont l'intelligence est nécessaire pour se servir avec fruit des auteurs latins. Dans la quatrième, il s'agit des mesures des juifs.
Vient ensuite un appendix touchant les noms et la valeur des monnaies anglaises et des mesures en vaisseaux. Dans cet appendix, il dit que toutes les anciennes mesures anglaises de cet espèce que nous avons reçues des Saxons, venaient, selon toutes apparences, à ceux-ci des Sarrasins, aussi-bien que la monnaie anglaise. Il remarque que pour ce qui est des noms des vaisseaux connus en Espagne et en Italie, comme ceux de pipe, de botte, de barril, etc. il en chercherait l'origine dans la Méditerranée, et de-là chez les peuples orientaux, de qui venaient les choses contenues dans ces vaisseaux : car puisqu'il parait clairement que tous les poids sont phéniciens d'origine, et que les mesures en vaisseaux, même de l'eau, étaient absolument nécessaires aux Phéniciens pour leur provision dans leurs voyages par terre, aussi - bien que par mer ; qu'entre les liquides, le vin et l'huîle étaient des produits de leurs côtes, (le mot vin non - seulement, mais les noms fabuleux de Bacchus, de Sémélée, de Silene avec son âne dénotant cette origine), il est assez naturel de penser que les noms phéniciens des vaisseaux passèrent avec ce qu'ils contenaient dans les îles de la Grèce ; et que dans la suite lorsque les Sarrasins se furent rendus maîtres de cette mer, ils adoptèrent d'abord les noms orientaux qu'ils trouvèrent, et en donnèrent encore d'autres du même ordre ; c'est ce qu'on peut conjecturer par rapport à plusieurs vaisseaux du levant, non - seulement de ceux qui contiennent de l'eau, mais de ceux qui servent à naviger, car ils prennent souvent leurs noms les uns des autres. Ainsi il n'est point du tout hors de propos de les rechercher dans le sud-est, quoique les Saxons, les Danois et les Normands aient été grands navigateurs en leur temps, et qu'on puisse assez naturellement présumer qu'ils ont rapporté leurs noms germaniques en Angleterre.
Le docteur Jean Arbuthnot dans la préface de ses tables des anciennes monnaies, poids et mesures, etc. expliqués en plusieurs dissertations, donne une haute idée des recherches du docteur Hooper, et nous dit que si l'on examine l'unité de vue qui règne dans tout l'ouvrage, l'exactitude des calculs, la sagacité des conjectures, l'habileté à corriger, et à comparer ensemble les passages des anciens auteurs et l'érudition qui brille dans ses recherches, on est obligé d'avouer qu'elles surpassent tout ce qu'on avait encore publié sur cette matière.
Mais l'écrivain le plus fameux du comté de Worcester est Butler (Samuel), auteur d'Hudibras. Il naquit en 1612, selon les uns, ou plutôt vers l'année 1600, selon M. Charles Longueville, qui a pu en être mieux instruit que personne. Butler était fils d'un honnête fermier, qui le fit étudier à Worcester, et à l'université. Au goût de la Poésie, il joignit celui de la Peinture ; et l'on ne doit pas s'en étonner, car presque toutes les parties de la Poésie se trouvent dans la Peinture. Le peintre doit animer ses figures, et le poète prête un corps aux sentiments et aux expressions ; l'un donne de la vie à une belle image, et l'autre de la force et du corps à des pensées sublimes.
Après le rétablissement de Charles II. ceux qui étaient au timon des affaires faisant plus de cas de l'argent que du mérite, notre poète éprouva la vérité d'une sentence de Juvenal.
Haud facilè emergunt, quorum virtutibus obstat
Res angusta domi.
Jamais espérances ne furent plus belles que les siennes lorsqu'il vint à Londres. Devancé par sa réputation, il se vit accueilli de tout le monde, lu avec admiration et nourri de promesses de se voir honoré de la faveur du prince. Mais quelle fut sa récompense ? Il ne gagna par son génie, par l'agrément de sa conversation, par la régularité de ses mœurs, que la pauvreté et des louanges. Il ne retira pas du produit de ses vers de quoi le faire ensevelir ; mais il conserva sa santé jusqu'à la dernière vieillesse, et mourut en 1680 sans plaintes et sans regrets à l'âge d'environ 80 ans.
Il demeura sans tombe jusqu'à ce que l'Alderman Barber, depuis maire de la ville de Londres, eut la générosité d'honorer la mémoire de cet homme illustre, en lui érigeant un tombeau dans l'abbaye de Westminster.
C'est le poème d'Hudibras qui lui acquit sa grande réputation ; et quoiqu'il s'en soit fait plusieurs éditions, il n'y en a aucune qui égale le mérite de l'ouvrage. M. Hogarth, dont le génie semble avoir beaucoup de rapport avec celui de Butler, a gravé à l'eau-forte une suite de tailles-douces, contenant les aventures d'Hudibras et de Rodolphe son écuyer, qui ont tout le grotesque qui convient au sujet.
On a fait quantité d'imitations de cet agréable poème, parce qu'un ouvrage original n'a pas plutôt paru, que les barbouilleurs en font de mauvaises copies. Dès que Gulliver eut publié ses voyages, il se vit d'abord une multitude de parents qui naissaient comme autant de champignons, et qui fatiguèrent le public de leurs fades aventures. Le Beggar's opera a été accompagné d'une longue suite d'opéras insipides. Le bon Robinson Crusoé lui-même n'a pu se sauver des mains de la gent imitatrice. Je regarde de semblables productions comme autant d'avortons disgraciés, destinés par Apollon à servir de mouche aux beautés virginales.
On peut donner plusieurs raisons pourquoi des imitations ou des suites des pièces originales en approchent si rarement pour la beauté. En premier lieu, les écrivains d'un génie supérieur dédaignent d'être copistes ; comme ils trouvent en eux un riche fonds d'invention, ils ne cherchent point à emprunter des autres. Secondement, un auteur qui travaille dans un goût nouveau est si plein de son idée, il la combine sans-cesse de tant de manières, qu'il l'envisage sous toutes les faces où elle peut paraitre avec avantage.
Les essais qu'on a fait pour traduire Hudibras en latin, ou en d'autres langues n'ont point eu de succès ; et l'on ne doit pas se flatter que ce poème réussisse dans une traduction, parce que le sujet et les diverses parties qui y entrent sont burlesques, ne regardent que l'Angleterre dans un petit point de son histoire, et n'ont du rapport qu'à ses coutumes. On raconte dans ce poème (qui tourne en ridicule la guerre civile) une suite de petites aventures pour se moquer des têtes rondes qui faisaient cette guerre. Or tout cela n'a point de grâce dans une langue étrangère.
Il manque un commentaire complet sur ce poème, dont quantité d'endroits perdent de leur beauté, de leur force et de leur feu, faute d'être bien entendus aujourd'hui par les Anglais mêmes. On pourrait joindre à ce commentaire des observations sur l'économie, la conduite, les comparaisons et le style de ce poème, ce commentaire donnerait au plus grand nombre de lecteurs une connaissance plus juste des beautés qui s'y trouvent. Je voudrais aussi qu'on en remarquât les défauts, car l'auteur d'Hudibras a trop souvent affecté d'employer des images basses, et les expressions les plus triviales pour relever le ridicule des objets qu'il dépeint. Il ressemble souvent à nos bateleurs, qui craient donner de l'esprit à leurs bouffons par les haillons dont ils les couvrent. La bonne plaisanterie consiste dans la pensée, et nait de la représentation des images dans des circonstances grotesques.
Butler a pris l'idée de son Hudibras de l'admirable don Quixote de Cervantes ; mais à tous les autres égards, il est parfaitement original par le but, les sentiments et le tour. Voici quel a été son but. Comme le temps où l'auteur vivait était fameux par le zèle affecté qui regnait pour la religion et la liberté, zèle qui avait bouleversé les lois et la religion d'Angleterre en introduisant l'anarchie et la confusion, il n'y avait rien de plus avantageux dans cette conjoncture aux yeux de tous les royalistes, que d'arracher le masque à ceux qui s'en étaient servi pour se déguiser, et de les peindre des couleurs les plus ridicules ; c'est ce qui fait qu'il ne les censure pas d'un ton sérieux, mais toujours en plaisantant pour mieux frapper au but qu'il se propose.
Dans cette vue, le poète suppose que les maximes presque impraticables des puritains sur la rigide administration de la justice ont tourné la cervelle à son chevalier, de la même manière que la lecture des livres de chevalerie avait dérangé l'esprit de don Quixote. Le chevalier d'Hudibras se met donc en campagne pour rétablir chacun dans ses droits ; et il étend même sa protection à des ours qu'on mène à la foire, non pour leur profit, mais pour celui de leurs conducteurs, supposant que ces animaux ont été privés arbitrairement de leur liberté naturelle, sans qu'on leur ait fait leur procès dans les formes et par-devant leurs pairs. Comme tout le poème est sur le ton plaisant, les différentes aventures du pieux chevalier et de son ridicule écuyer sont dans le même gout, et finissent toujours plaisamment. L'économie et le tour du poème dans son tout ont quelque chose de si neuf, qu'on y a donné le nom de goût hudibrastique. Les uns l'appellent poème burlesque, les autres héroï-comique, et d'autres épi-comique ; mais ce dernier nom ne lui convient ni pour la mesure du vers, ni pour la manière brusque de finir par les deux lettres du chevalier et de la veuve.
Quoi qu'il en sait, le poème Hudibras a été souvent cité et loué par les plus illustres écrivains de son siècle et du nôtre, par le comte de Rochester, Prior, Dryden, Addisson, etc. Le héros de ce poème est un saint don Quixotte de la secte des Puritains, et le redresseur de tous les torts imaginaires qu'on fait à sa Dulcinée ; il ne lui manque ni rossinante, ni aventures burlesques, ni même un Sancho ; mais l'écuyer anglais est tailleur de métier, tartuffe de naissance, et si grand théologien dogmatique, que, dit le poète,
Mystères savait démêler
Tout comme aiguilles enfiler.
On a surtout loué dans Hudibras les parodies du merveilleux (Machinery) poétique ; telle est entr'autres sa description de la renommée, dont on sentira encore mieux le plaisant, si l'on veut la comparer avec la description sérieuse de la renommée par Virgile. Il ne se peut rien de plus bizarre que la figure et l'habillement de la renommée dans Hudibras : ses deux trompettes et les avis qu'elle vient donner sont d'un excellent comique.
Il est vrai que la versification du poète n'est pas harmonieuse, et qu'elle doit déplaire à ceux qui n'aiment que des vers nombreux et coulants ; ceux au contraire qui ne s'arrêtent qu'aux choses et aux idées, prendront un grand plaisir à la lecture d'Hudibras. Ce plaisir, dit un anglais, peut être comparé à celui que fait une jolie chanson, accompagnée d'un excellent violon ; au-lieu que le plaisir qu'on éprouve à la lecture d'un poème épique sérieux est semblable à celui que produit le Te Deum de M. Handel lorsqu'il touche lui-même l'orgue, et qu'il est accompagné des plus belles voix et des plus beaux instruments.
Hudibras est l'idole du parti de la haute-église, dont il est, pour ainsi dire, le bréviaire, tandis que le gros des non-conformistes regardent ce poème comme une pièce fort odieuse. M. Fenton, dans sa belle épitre à M. Southerne, faisant allusion au temps qui fait le sujet d'Hudibras, suppose plaisamment que lorsque les théâtres furent fermés, la comédie prit un autre habit et parut ailleurs, les conventicules lui servant de théâtres. La réforme qui suivit la mort du roi Charles I. ayant été aussi rigide qu'elle le fut, il était naturel à un poète d'un esprit aussi enjoué que M. Fenton, d'en railler ; mais c'est ce qu'il fait avec noblesse.
Ce temps, dit-il dans le langage des dieux, fut suivi d'un autre plus abominable encore, souillé du sang d'un grand monarque : la tragédie n'eut pas plutôt Ve sa chute, qu'elle s'enfuit, et céda sa place aux ministres de la justice. La comédie, sa sœur, continua toujours ses fonctions, et ne fit que changer d'habillement. Elle commença par composer son visage, et apprit à faire passer des grimaces pour des signes de régénération. Elle se coupa les cheveux, et prit un ton tel que celui d'un tambour de basque ou d'un bourdon. Elle instruisit ses yeux à ne s'ouvrir qu'à demi, ou à s'enfuir en-haut. Bannie du théâtre, elle prit gravement une robe, et se mit à babiller sur un texte.... Mais lorsque par un miracle de la bonté divine l'infortuné Charles remonta sur le trône de son père, lorsque la paix et l'abondance revinrent dans nos contrées, elle arracha d'abord son bonnet de satin et son collet, et pria Wycherley de soutenir ses intérêts, et de faire paraitre hardiment de l'esprit et du bon sens ; Etheridge et Sidley se joignirent à lui pour prendre sa défense, ils méritèrent tous, et reçurent des applaudissements. (D.J.)
WORCESTERSHIRE
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Géographie moderne
- Affichages : 1101