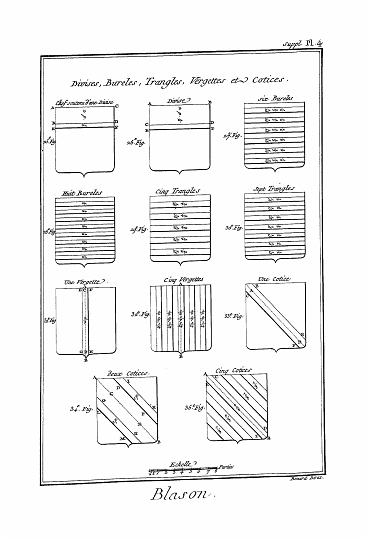S. f. (Grammaire et Morale) il se dit au singulier des passions violentes : ç'en est le degré extrême ; il aime à la fureur. Mais il est propre à la colere. Au pluriel, l'acception du terme change un peu. Il parait marquer plutôt les effets de la passion que son degré ; exemple, les fureurs de la jalousie, les fureurs d'Oreste. On dit par métaphore que la mer entre en fureur ; c'est lorsqu'on voit ses eaux s'agiter, se gonfler, et qu'on les entend mugir au loin. Quand on dit la fureur des vents, on les regarde comme des êtres animés et violents. Il y a une fureur particulière qu'on appelle fureur poétique ; c'est l'enthousiasme, voyez ENTHOUSIASME. Il semble que l'artiste devrait concevoir cette fureur avec d'autant plus de force et de facilité, que son génie est moins contraint par les règles. Cela supposé, l'homme de génie qui converse, deviendrait plus aisément enthousiaste que l'orateur qui écrit, et celui-ci plus aisément encore que le poète qui compose. Le musicien qui tient un instrument, et qui le fait résonner sous ses doigts, serait plus voisin de cette espèce d'ivresse, que le peintre qui est devant une toîle muette. Mais l'enthousiasme n'appartient pas également à tous ces genres, et c'est la raison pour laquelle la chose n'est pas comme on croirait d'abord qu'elle doit être. Il est plus essentiel au musicien d'être enthousiaste qu'au poète, au poète qu'au peintre, au peintre qu'à l'orateur, et à l'orateur qu'à l'homme qui converse. L'homme qui converse ne doit pas être froid, mais il doit être tranquille.
FUREUR, (Mythologie) divinité allégorique du genre masculin chez les Romains, parce que furor dans la langue latine est de ce genre. Les Poètes représentent ce dieu allégorique, la tête teinte de sang, le visage déchiré de mille plaies, et couvert d'un casque tout sanglant ; ce dieu, ajoutent-ils, est enchainé pendant la paix, les mains liées derrière le dos, assis sur un amas d'armes, frémissant de rage, et pendant la guerre ravageant tout, après avoir rompu ses chaînes. Voici la description qu'en fait Petrone dans son poème de la guerre Civîle entre César et Pompée.
.... abruptis ceu liber habenis,
Sanguinem latè tollit caput, ora que mille
Vulneribus confossa cruenda casside velat
Haeret. ... laevae. ... umbo,
Innumerabilibus telis gravis ; atque flagranti
Stipite dextra minax, terris incendia portat. (D.J.)
FUREUR, (Médecine) c'est un symptôme qui est commun à plusieurs sortes de délires ; il consiste en ce que le malade qui en est affecté se porte avec violence à différents excès, semblables aux effets d'une forte colere ; il ne parle, ne répond qu'avec brutalité, en criant, en insultant : et s'il cherche à frapper, à mordre les personnes qui l'environnent ; s'il se maltraite lui-même, s'il déchire, brise, renverse ce qui se trouve sous ses mains ; en un mot, s'il se comporte comme une bête féroce ; la fureur prend le nom de rage.
On ne doit donc pas confondre la fureur avec la manie, quoiqu'il n'y ait point de manie sans fureur ; puisque ce symptôme a aussi lieu essentiellement dans la phrénésie, assez souvent dans l'hydrophobie, et quelquefois jusqu'à la rage dans chacune de ces maladies ; mais aucune d'entr'elles n'étant aussi durable que la manie, parce qu'elle est la seule qui soit constamment sans fièvre ; c'est aussi dans la manie que la fureur qui la distingue de la simple folie, subsiste le plus longtemps.
Ainsi, comme on ne peut pas traiter de la manie sans traiter de la fureur, comme du symptôme qui en est le signe caractéristique, en tant qu'il est joint à un délire universel sans fièvre ; pour éviter les repétitions, voyez MANIE. Voyez aussi DELIRE, PHRENESIE, RAGE, RAGE CANINE, et l'article suivant (d)
FUREUR UTERINE, nymphomania, furor uterinus ; c'est une maladie qui est une espèce de délire attribué par cette dénomination aux seules personnes du sexe, qu'un appétit vénérien démesuré porte violemment à se satisfaire, à chercher sans pudeur les moyens de parvenir à ce but ; à tenir les propos les plus obscènes, à faire les choses les plus indécentes pour exciter les hommes qui les approchent à éteindre l'ardeur dont elles sont dévorées ; à ne parler, à n'être occupées que des idées relatives à cet objet ; à n'agir que pour se procurer le soulagement dont le besoin les presse, jusqu'à vouloir forcer ceux qui se refusent aux désirs qu'elles témoignent ; et c'est principalement par le dernier de ces symptômes, que cette sorte de délire peut être regardée comme une sorte de fureur, qui tient du caractère de la manie, puisqu'elle est sans fièvre.
Ainsi comme la faim, ce sentiment qui fait sentir le besoin de prendre de la nourriture, et qui porte à le satisfaire, peut, par la privation des moyens trop longtemps continués, dégénérer en fureur jusqu'à la rage ; de même le désir de l'acte vénérien qui est un vrai besoin naturel dans certaines circonstances, eu égard au tempérament ou à d'autres causes propres à faire naître ou augmenter la disposition à ressentir vivement les aiguillons de la chair, peut être porté jusqu'à la manie, jusqu'aux plus grands excès physiques et moraux, qui tendent tous à la jouissance de l'objet, par le moyen duquel peut être assouvie la passion ardente pour le coït.
Si l'observation avait fourni des exemples d'hommes affectés d'une envie déréglée de cette espèce, poussée à une pareille extrémité, on aurait pu appeler la lésion des fonctions animales qui en serait l'effet, fureur vénérienne ; nom qui aurait convenu à cette sorte de délire considéré dans les deux sexes : mais les hommes n'y sont pas sujets comme les femmes ; soit parce qu'en général les mœurs n'exigent nulle part d'eux la retenue, la contrainte, en quoi consiste la pudeur, cette vertu si recommandée aux femmes dans presque toutes les nations, même dans celles qui sont le moins civilisées ; parce qu'elle est une sorte d'attrait à l'égard des hommes, qui leur fait un plaisir de surmonter les obstacles opposés à leur désir, et qui contribue par conséquent davantage à entretenir le penchant des hommes pour les femmes, à favoriser la propagation de l'espèce humaine ; soit aussi parce que les hommes sont constitués relativement aux organes de la génération, de manière qu'il peut s'y exciter des mouvements spontanés ; d'où s'ensuivent des effets propres à faire cesser le sentiment de besoin de l'acte vénérien (ressource dont le moyen n'est dans les femmes que bien imparfaitement) ; et que d'ailleurs le libertinage du cœur est assez répandu pour qu'il y ait peu d'hommes qui ne préviennent même ce soulagement naturel par l'abus de soi-même, au défaut de l'usage des femmes, dans le cas où il ne peut pas être recherché, par bienséance, ou par tout autre empêchement. Voyez GENERATION, POLLUTION, MASTUPRATION. Ensorte qu'il peut y avoir à la vérité dans les hommes comme dans les femmes, une disposition à l'appétit vénérien, augmentée outre mesure, ainsi qu'ils l'éprouvent dans le priapisme, le satyriasis : mais elle n'est jamais portée jusqu'à dégénérer en fureur ; parce que le besoin est satisfait d'une manière ou d'autre, avant que ce dernier excès puisse avoir lieu. Voyez SALACITE, PRIAPISME, SATYRIASIS.
La mélancolie érotique n'a pas pour objet immédiat l'acte vénérien en général, mais le désir d'y procéder avec une personne déterminée que l'on aime éperdument. Voyez EROTIQUE.
Il ne faut pas non plus confondre le prurit du vagin avec la fureur utérine ; celui-là peut être une disposition à celle-ci, mais il n'en est pas toujours suivi ; il excite, il force à porter les mains aux parties affectées, à les frotter pour se procurer du soulagement, comme il arrive à l'égard de la demangeaison dans toute autre partie du corps, que l'on gratte dans la même vue, c'est-à-dire pour en enlever les causes irritantes. Mais dans le cas dont il s'agit ici, les attouchements se font sans témoin, sans indécence (voyez VAGIN), en quoi ils diffèrent de ceux qu'occasionne la fureur utérine ; ou s'ils sont faits avec affectation et par des moyens contraires à l'honnêteté, c'est l'effet de la corruption des mœurs, non pas un délire.
L'appétit vénérien, aestrum venereum (dont il a été omis de traiter en son lieu, à quoi il Ve être un peu suppléé ici, parce que le sujet l'exige ; voyez d'ailleurs GENERATION), ce sentiment qui porte aux actes nécessaires ou relatifs à la propagation de l'espèce, peut être excité, en le comparant à celui des aliments (voyez FAIM), par l'impression que reçoivent les organes de la génération, transmise au cerveau, avec des modifications propres à affecter l'âme d'idées lascives ; ou par l'influence sur ces mêmes parties de l'âme affectée d'abord de ces idées, indépendamment de toute impression des sens ; par laquelle influence elles sont mises en jeu, et réagissent sur le cerveau ; d'où il s'ensuit que l'âme est de plus en plus fortement occupée de sensations voluptueuses qui ne peuvent cependant pas subsister longtemps sans la fatiguer ; qui la portent en conséquence à faire cesser cette inquiétude attachée à la durée de toute sorte de sentiments trop vifs ; à employer les moyens que l'instinct lui apprend être propres à produire ce dernier effet. Voyez SENS, PLAISIR, DOULEUR, INSTINCT.
Si l'appétit vénérien est modéré, on peut suspendre les effets des sentiments qu'il inspire, des desseins qu'il suggère pour se procurer le moyen de le satisfaire ; comme on ne se porte pas à manger toutes les fois qu'on en a envie ; comme on se fait violence pendant quelque temps pour supporter la faim, lorsqu'on ne peut pas se procurer des aliments, ou qu'on a des raisons de s'en abstenir, enfin lorsque la faim n'est pas canine. Voyez FAIM CANINE.
Mais ainsi que selon le proverbe ventre affamé n'a point d'oreilles, et qu'on n'écoute plus la raison qui exhorte à ne pas manger ou à prendre patience, dans les cas où on ne peut avoir des aliments à sa disposition, le sentiment du besoin pressant de nourriture l'emportant alors sur toute autre considération, et se changeant souvent en fureur : de même en est-il du besoin de satisfaire l'appétit vénérien ; celui-ci comme sensitif, l'emporte sur l'appétit raisonnable : en sorte que, comme dit le poète,
Fertur equis auriga, nec audit currus habenas.
C'est ce qui a lieu surtout dans les femmes qui sont douées d'un tempérament plus délicat et plus sensible, dont la plupart des organes sont aussi plus irritables, tout étant égal, que ceux des hommes, surtout ceux des parties génitales.
Ainsi cet excès d'appétit vénérien qui est à cet appétit réglé ce que la faim canine, la boulimie, sont au désir ordinaire de manger, forme une vraie maladie, la salacité immodérée, dont le degré extrême dans les femmes, lorsqu'elle Ve jusqu'à déranger l'imagination, et porte à des actions violentes, est, ainsi qu'il a été dit ci-devant, la fureur utérine.
Les anciens attribuaient la cause de l'appétit vénérien excessif dans les deux sexes, à une vapeur qu'ils imaginaient s'élever en grande abondance de la liqueur séminale trop retenue et corrompue dans les testicules, qu'ils croyaient être portée par la moèlle épinière dans le cerveau, et y troubler les esprits animaux ; d'où doit, selon eux, s'ensuivre le désordre des idées, le délire relatif à celles qui sont dominantes.
Mais comme il n'est plus question depuis longtemps de vraie semence par rapport aux femmes, ou au-moins d'aucune liqueur vraiment analogue à la liqueur séminale virile, on a cherché ailleurs la cause prochaine commune aux deux sexes du sentiment qui les porte à l'acte vénérien ; il parait que l'on ne peut en concevoir d'autre que l'érétisme, la tension de toutes les fibres nerveuses des parties génitales, qui les rend plus susceptibles de vibrations, par les contacts physiques ou mécaniques ; en sorte que ces vibrations excitées par quelque moyen que ce sait, transmettent au cerveau des impressions proportionnées, auxquelles il est attaché de représenter à l'âme, ou de lui faire former des idées relatives aux choses vénériennes ; d'où s'ensuit une sorte de réaction du cerveau sur les organes de la génération, vers lesquels il se fait une nouvelle évasion de fluide nerveux, comme il arrive à l'égard de toutes les parties où s'exerce quelque sentiment stimulant, de quelque nature qu'il soit ; de sorte que par cette émission l'érétisme se soutient et augmente, au point que l'âme toujours plus affectée par la sensation qui en résulte, semble en être uniquement et entièrement occupée, et n'être unie qu'aux parties dont elle éprouve de si fortes influences.
Telle est l'idée générale que l'on peut prendre de ce qui produit immédiatement le désir des actes vénériens ; il reste à déterminer les différentes causes occasionnelles qui établissent l'érétisme des parties génitales dont il vient d'être parlé ; l'observation constante a appris qu'elles peuvent consister dans l'effet des douces irritations procurées à ces organes, et à ceux qui y ont rapport ; par les attouchements, par le coït, ou par l'action stimulante de quelques humeurs acres, dont ils sont abreuvés, humectés, ou par tout autre effet externe ou interne qui peut exciter l'orgasme ; tout cela joint à la sensibilité habituelle de ces mêmes organes.
Ainsi ces causes peuvent avoir leur siège dans les parties génitales mêmes, ou elles consistent dans la disposition des fibres du cerveau relatives à ces parties, indépendamment d'aucune affection immédiate de celles-ci ; dans la tension dominante de ces fibres, excitée par tout ce qui peut échauffer l'imagination et la remplir d'idées voluptueuses, lascives ; ainsi que la fréquentation de personnes de sexe différent, jeunes, de belle figure, qui font profession de galanterie ; les propos, les conversations, les lectures, les images obscènes, la passion de l'amour, les caresses de l'objet aimé ; et toutes ces choses établissent, augmentent d'autant plus cette disposition, qu'elles concourent avec un tempérament naturellement chaud, vif, entretenu par la bonne chère et l'oisiveté, dans l'âge où l'inclination aux plaisirs des sens est dans toute sa force.
Toutes ces causes morales et les conséquences qu'elles fournissent, regardent autant l'homme que la femme ; elles produisent des effets, elles font des impressions proportionnées à la sensibilité respective dans les deux sexes ; il ne peut y avoir de la différence entre les différentes causes procatartiques, qui viennent d'être rapportées, que par rapport aux causes physiques ; il faudrait donc à-présent voir de quelle manière celles-ci sont appliquées à produire les effets dans chacun d'eux ; mais quant à l'homme, ce n'est pas ici le lieu, voyez PRIAPISME, SATYRIASIS. A l'égard de la femme dont il s'agit expressément dans cet article, on peut dire encore que la plupart des causes physiques, les attouchements, les frottements, le coït, opèrent les impressions de la même manière dans les deux sexes, en tant qu'ils ébranlent les houpes nerveuses des parties génitales, y causent des vibrations plus ou moins fortes, produisent des chatouillements, des sensations délicieuses plus ou moins vives.
Ainsi ce n'est pas dans ces sortes de causes de l'orgasme vénérien que l'on trouve une autre manière d'affecter dans les femmes que dans les hommes ; ce ne peut être que dans celles qui sont propres à leur conformation, telles que 1°. la pléthore menstruelle, qui en distendant les vaisseaux de toutes les parties génitales, donne conséquemment aussi plus de tension aux membranes nerveuses du vagin, et les rend d'une plus grande sensibilité aux approches du temps des règles, laquelle subsiste ordinairement pendant qu'elles sont supprimées ; de manière que tout étant égal, les femmes sont plus disposées à l'appétit vénérien dans ces différentes circonstances, que dans toutes autres. 2°. La grande abondance de l'humeur salivaire, filtrée dans les glandes du vagin, qui étant portée dans ses vaisseaux excrétoires, les tient dilatés, tendus ; d'où suit le même effet que du gonflement des vaisseaux par le sang menstruel. 3°. La qualité acre, irritante de cette humeur, qui étant versée dans la cavité du vagin, excite une sorte de prurit par son action sur les nerfs, lequel produit dans les membranes de cette cavité une phlogose très-propre encore à les rendre susceptibles d'une grande sensibilité.
Toutes les différentes causes auxquelles il peut être attaché de produire un semblable effet, peuvent être rapportées à l'une de ces trois, ou à leur concours, différemment combiné avec le tempérament du sujet et les causes morales ci-devant mentionnées, pour établir la cause de l'appétit vénérien plus ou moins vif, à proportion de l'intensité de la disposition.
Ainsi on peut ranger parmi les choses qui peuvent contribuer à produire cette disposition, les drogues auxquelles on attribue une vertu spécifique pour cet effet, que l'on appelle par cette raison aphrodisiaques, c'est-à-dire propres à exciter aux actes vénériens. Celle qui a la réputation d'avoir le plus éminemment cette qualité, est la préparation des mouches cantharides. Voyez CANTHARIDES. Sennert vante aussi beaucoup l'efficacité du borax à cet égard : elle est si grande, selon lui, qu'une femme ayant bu un verre d'hypocras, dans lequel on avait dissous de cette drogue, en fut tellement échauffée pour les plaisirs de l'amour, qu'elle tomba dans une vraie fureur utérine. Un mélange de musc mêlé avec des huiles aromatiques, introduit par quelque moyen que ce soit dans la cavité du vagin, peut aussi, selon Ettmuller, produire les mêmes effets.
Mais ces prétendus aphrodisiaques n'opèrent pour la plupart qu'entant qu'ils sont stimulants en général, comme tous les acres subtils, pénétrants, sans aucune détermination à porter leurs effets plus particulièrement sur une partie que sur une autre. L'expérience n'a appris à excepter guère que les cantharides, qui paraissent développer leur action dans les voies des urines plus qu'ailleurs ; d'où par communication elles se font sentir dans les organes de la génération, en y excitant une sorte d'érétisme.
De cette disposition corporelle produite par cette cause, ou par toute autre de celles qui viennent d'être exposées, s'ensuivent des sensations qui ne peuvent que faire naître dans l'âme des idées relatives aux plaisirs de l'amour ; comme un certain gonflement des tuniques de l'estomac, par le sang, par le suc gastrique, et l'écoulement de la salive douée de certaines qualités, réveille dans l'âme des idées relatives à l'appétit des aliments (Voyez FAIM) ; idées qui peuvent être si fortes, s'il n'y est fait diversion par quelqu'autre, que les fibres du cerveau, dont un degré déterminé de tension est la cause physique à laquelle il est attaché de produire ces idées, contractent pour ainsi dire l'habitude de cette disposition, restent tendues, et par conséquent susceptibles d'affecter l'âme de la même manière, indépendamment de l'impression transmise des organes de la génération ; en sorte que les causes physiques qui donnent lieu à cette impression, peuvent cesser sans que l'état des fibres correspondantes du cerveau change : et il subsiste ainsi une vraie cause de délire, en tant que l'âme est continuellement occupée d'idées relatives à l'appétit vénérien, sans qu'aucune cause externe y donne lieu, et que la personne ainsi affectée juge certainement mal durant la veille de ce qui est connu de tout le monde, puisqu'elle cherche à satisfaire ses désirs sans décence, sans discrétion, par conséquent d'une manière contraire aux bonnes mœurs et à l'éducation qu'elle a reçue. Or, comme c'est le propre de toutes les passions de devenir plus violentes à proportion qu'elles trouvent plus de résistance, celle de l'appétit vénérien immodéré dans les femmes n'étant pas ordinairement bien facîle à contenter, soit parce qu'elle est quelquefois insatiable, soit parce qu'il n'est pas toujours possible ou permis d'employer les moyens propres à cet effet, s'irrite par ces obstacles, et dégenere en fureur, qui parce qu'elle est censée être causée par les influences de la matrice, est appelée utérine.
Cependant non-seulement ce délire violent peut exister sans que cet organe continue à y avoir aucune part, après avoir concouru à en établir la cause, mais encore sans qu'il ait jamais été précédemment affecté d'aucun vice qui y ait rapport, et même d'aucune disposition propre à produire cet effet. Il suffit que les causes morales aient fortement influé sur le cerveau, pour y établir celle de la fureur utérine ; ainsi que l'idée vive, le désir pressant de différents aliments, ou autres choses singulières, qui affectent les femmes grosses, suffisent pour leur en donner de fortes envies, qui ressemblent souvent à un vrai délire, sans qu'il y ait aucune autre cause particulière dans les organes qui puisse faire naître l'idée de cet appétit, de ces fantaisies : c'est alors une véritable espèce de mélancolie maniaque. Voyez ENVIE, MELANCOLIE, MANIE.
Mais la fureur utérine ne s'établit jamais tout de suite, avec tous les symptômes qui la caractérisent. Les personnes qui en sont affectées, ont toujours commencé à ressentir par degrés les aiguillons de la chair ; quoiqu'elles en soient d'abord fort inquiétées, la pudeur les retient pendant quelque temps ; elles tâchent de ne pas manifester le sentiment honteux qui les occupe fortement ; elles sont alors d'une humeur sombre, taciturne, triste ; et il leur échappe de temps en temps des soupirs, des regards lascifs, surtout lorsqu'il se présente à elles des hommes, ou que l'on tient quelque propos qui a rapport aux plaisirs de l'amour ; elles rougissent, leur visage s'allume ; et si on leur touche le pouls dans ce temps-là, on le trouve plus agité, ainsi qu'il arrive dans la passion érotique. Voyez EROTIQUE. Galien assure qu'il n'a jamais été trompé à employer ce moyen, lorsqu'il a eu à découvrir les maladies causées par les désirs vénériens. Après ces premiers symptômes, lorsque le mal augmente, les personnes affectées paraissent perdre peu-à-peu toute pudeur ; elles deviennent babillardes ; elles ne cachent plus l'inclination qu'elles ont à s'entretenir, à jaser sur les plaisirs de l'amour ; elles s'emportent facilement contre les personnes qui les contrarient, qui tâchent de les contenir ; elles se livrent aussi quelquefois sans sujet à des accès de colere dangereuse ; elles paraissent violemment agitées ; elles font de grands cris mêlés d'éclats de rire, et passent subitement à donner des marques de chagrin, de douleur, à répandre des larmes, jusqu'à paraitre désolées, désespérées ; ce qui dure peu, pour passer à un état opposé.
Enfin ces malheureuses en viennent à ne garder plus aucune mesure, à demander, à rechercher ce qui peut les satisfaire, à témoigner leur désir par les propos, les invitations, les gestes, et à se livrer pour cet effet au premier venu, s'il se trouve quelqu'un qui veuille s'y prêter ; elles ne se contentent pas de peu ; elles ne font souvent qu'irriter leur désir par ce qui semblerait devoir suffire pour les assouvir ; ce qui a lieu surtout dans le cas où la cause n'a pas son siège dans les parties génitales, où elle n'est pas par conséquent de nature à cesser par les effets des actes vénériens, où en un mot elle dépend absolument du dérangement du cerveau, parce qu'il n'est pas susceptible d'être corrigé par le remède ordinaire de l'amour, qui est la jouissance : au contraire ce vice en devient toujours plus considérable, attendu que l'érétisme des fibres nerveuses et l'orgasme doivent nécessairement augmenter de plus en plus par cet effet, et par conséquent l'idée de désir qui est attachée à cet état doit être de plus en plus forte et violente. C'était sans-doute par l'effet d'un délire de cette espèce porté à cet excès, que Messaline était plutôt fatiguée, lassée, que rassasiée des plaisirs grossiers auxquels elle se prostituait sans mesure avec la plus infame brutalité. Ce ne peut être aussi vraisemblablement que par cause de maladie, que Sémiramis, cette reine des Assyriens, après s'être rendue digne des plus grands éloges, tomba dans la plus honteuse et la plus excessive dissolution, jusqu'à se livrer à un grand nombre de ses soldats, qu'elle faisait après cela périr par les moyens les plus cruels. Martial fait mention des énormes débauches d'une Coelia, qui ne pouvaient être aussi, selon toute apparence, que l'effet d'une fureur utérine, puisqu'elle n'était pas une prostituée de profession ; autrement il n'y aurait rien eu de remarquable dans ses excès. Ce poète en parle ainsi, Ep. lib. VII.
Das Cattis, das Germanis, das Coelia Dacis,
Nec Cilicum spernis, &c.
Le peu d'exemples que l'on peut citer de personnes atteintes de cette maladie, prouve qu'elle n'a par conséquent jamais été bien commune ; et elle est devenue toujours plus rare, à mesure que les mœurs sont devenues plus sévères sur le commerce entre les deux sexes, parce qu'il en résulte moins de causes occasionnelles ; mais elle se présente encore quelquefois. Il est peu d'auteurs qui ayant été grands praticiens, n'aient eu quelques observations autoptiques à rapporter à ce sujet, avec différentes circonstances : M. de Buffon, sans être médecin (hist. nat. tom. IV. de la puberté), dit avoir eu occasion d'en voir un exemple dans une jeune fille de douze ans, très-brune, d'un teint vif et fort coloré, d'une petite taille, mais déjà formée avec de la gorge et de l'embonpoint : elle faisait les actions les plus indécentes au seul aspect d'un homme ; rien n'était capable de l'en empêcher, ni la présence de sa mère, ni les remontrances, ni les châtiments : elle ne perdait cependant pas totalement la raison ; et ses accès, qui étaient marqués au point d'en être affreux, cessaient dans le moment qu'elle demeurait seule avec des femmes. Aristote prétend que c'est à cet âge que l'irritation est la plus grande, et qu'il faut garder le plus soigneusement les filles. Cela peut être vrai pour le climat où il vivait : mais il parait que dans les pays froids, le tempérament des femmes ne commence à prendre de l'ardeur que beaucoup plus tard.
On observe en général que les jeunes personnes sont plus sujettes à la fureur utérine, que celles d'un âge avancé. Mais les filles brunes, de bonne santé, d'une forte complexion, qui sont vierges, surtout celles qui sont d'état à ne pouvoir pas cesser de l'être ; les jeunes veuves qui réunissent les trois premières de ces qualités ; les femmes de même qui ont des maris peu vigoureux, ont plus de disposition à cette maladie que les autres personnes du sexe : on peut cependant assurer que le tempérament opposé est infiniment plus commun parmi les femmes, dont la plupart sont naturellement froides, ou tout au-moins fort tranquilles sur le physique de la passion qui tend à l'union des corps entre les deux sexes.
La fureur utérine est susceptible d'une guérison facîle à procurer, si on y apporte remède dès qu'elle commence à se montrer, et surtout avant qu'elle ait dégénéré en une manie continuelle : car lorsqu'elle est parvenue à ce degré, il est arrivé quelquefois que le mariage même ne la calme point. Il y a des exemples de femmes qui sont mortes de cette maladie : cependant dans le cas même où elle est dans toute sa force, on est fondé à en attendre la cessation ; il y a même lieu de la regarder comme prochaine, lorsque les accès sont moins longs, que les intervalles deviennent plus considérables, et que l'on peut parler des plaisirs vénériens, sans que la malade paraisse en être aussi affectée, aussi portée à s'occuper de l'objet de son délire qu'auparavant. On doit être prompt à empêcher les progrès de cette maladie naissante, d'autant plus qu'elle peut non-seulement avoir les suites les plus fâcheuses pour la personne qui en est affectée, mais encore elle établit un préjugé déshonorant à l'égard de la famille à qui elle appartient ; préjugé toujours injuste, s'il n'y a point de reproche à faire aux parents concernant l'éducation et les soins qu'ils ont dû prendre de la conduite de la malade, qui d'ailleurs avec toute la vertu possible, peut être tombée dans le cas de paraitre en avoir secoué entièrement le joug, parce que l'âme ne se commande pas toujours elle-même, parce que les sens lui ravissent quelquefois tout son empire, et qu'elle est réduite alors à n'être que leur esclave.
Les indications à remplir dans le traitement de la fureur utérine, doivent être tirées de la nature bien connue de la cause prochaine qui produit cette maladie, jointe à celle de ses causes éloignées, de ses causes occasionnelles, et du tempérament de la personne affectée.
Si elle est naturellement vive, sensible, voluptueuse, qu'elle puisse légitimement se satisfaire par l'usage des plaisirs de l'amour, c'est communément le plus sur remède qui puisse être employé contre la fureur utérine, selon l'observation des plus fameux praticiens, qui pensent que la maxime générale doit être appliquée dans ce cas : quò natura vergit, eò ducendum ; aussi n'en trouve-t-on aucun qui ne propose cet expédient comme le plus simple, lorsqu'il peut être mis en usage. Voyez les observations à ce sujet, de Schenckius, de Bartholin, d'Horstius ; les œuvres de Sennert, de Rivière, d'Ettmuller, etc.
En effet il en est de cet appétit, lorsqu'il peche plutôt par excès que par dépravation, comme de celui des aliments, lorsqu'il n'est qu'un désir violent des aliments ; la faim s'apaise en mangeant.
Mais si la fureur utérine ne dépend ni du tempérament seul, ni d'aucun vice dans les parties génitales ; si elle n'est autre chose qu'un vrai délire mélancolique, maniaque, provenant du vice du cerveau, sans aucune influence étrangère à ce viscère, on a Ve dans ce cas que les actes vénériens ne procurent aucun soulagement, et qu'ils sont insuffisans, quelque répétés qu'ils puissent être, pour faire cesser la disposition des fibres nerveuses, qui entretiennent ou renouvellent continuellement dans l'âme l'idée d'un besoin qui n'existe réellement point. Il en est dans ce cas comme de la faim, que le manger ne fait pas cesser. Voyez FAIM CANINE. Il faut alors avoir recours aux remèdes physiques et moraux, propres à détruire cette disposition.
On peut encore concevoir des cas où la fureur utérine, bien loin d'être calmée par les moyens qui semblent d'abord les plus propres à satisfaire les désirs déréglés en quoi elle consiste, ne fait qu'être irritée par ces mêmes moyens, en tant qu'ils augmentent et soutiennent l'orgasme dans les parties génitales, dont l'impression ne cesse d'être transmise au cerveau, et d'y rendre l'érétisme toujours plus violent ; en sorte que dans ces différents cas ils seraient plutôt utiles à être employés dans la suite comme préservatifs, que comme curatifs.
Mais si la malade, quoique très-bien dans le cas où le coït pourrait lui être salutaire, n'est pas susceptible d'un pareil conseil, comme le mal est pressant, et qu'il ne faut pas lui laisser jeter de profondes racines, il faut recourir aux moyens convenables que l'art propose, pour faire cesser les effets d'un sentiment aussi importun que révoltant par sa nature. Ainsi lorsqu'il y a lieu d'attribuer la maladie à la pléthore, soit qu'elle soit naturelle à l'approche de l'évacuation menstruelle, soit qu'elle provienne de cette évacuation supprimée, on doit employer la saignée à grande dose et à plusieurs reprises, à proportion de l'intensité de cette cause déterminante, et il faut travailler à rétablir les règles selon l'art. Voyez MENSTRUES.
Si la maladie dépend d'un engorgement des glandes et des vaisseaux salivaires du vagin, avec chaleur, ardeur dans les parties génitales, on peut faire usage avec succès d'injections, d'abord rafraichissantes, tempérantes ; et après qu'elles auront produit leur effet, on continuera à en employer, mais d'une nature différente. On les rendra légèrement acres, apophlegmatisantes. Les bains domestiques, les lavements émolliens, les tisanes émulsionnées, nitreuses, conviennent pour satisfaire à la première de ces deux indications-ci. Les purgatifs minoratifs, les doux hydragogues, les ventouses aux cuisses, les sangsues à l'anus pour procurer un flux hémorrhoïdal, peuvent être placés avec succès pour remplir la seconde. En détournant de proche en proche les humeurs dont sont surchargées les membranes du vagin, on doit observer d'accompagner l'usage de ces différents remèdes d'un régime propre à changer la qualité des humeurs, à en corriger l'acrimonie, l'ardeur dominante, à en refréner la partie bilieuse stimulante : ainsi l'abstinence de la viande, surtout du gibier ; des aliments épicés, salés ; des liqueurs spiritueuses, du vin même, et un grand retranchement sur la quantité ordinaire de la nourriture (sine baccho et cerere friget venus) ; l'attention de faire éviter l'usage de tout ce qui peut favoriser la mollesse, la sensualité, comme les trop bons lits, les coites, qui, comme on dit, échauffent les reins ; en un mot de prescrire un genre de vie austère à tous égards.
Si la maladie doit être attribuée principalement à des causes morales, il faut être extrêmement sévère à les faire cesser, il faut éloigner tout ce qui peut échauffer l'imagination de la malade, lui présenter des idées lascives ; ne la laisser aucunement à portée de voir des hommes ; lui fournir la compagnie de personnes de son sexe, qui ne puissent lui tenir que des propos sages, réservés, qui lui fassent de douces corrections, qui lui rappellent ce qu'elle doit à la religion, à la raison, aux bonnes mœurs, à l'honneur de sa famille : en même temps, on pourra faire usage de tous les remèdes propres à combattre la mélancolie, la manie : les anti-hystériques, les anti-spasmodiques, les anodyns, les narcotiques, sont les palliatifs les plus assurés à employer, en attendant que l'on ait pu détruire entièrement la cause par les moyens convenables.
La plupart des auteurs proposent plusieurs médicaments, comme des spécifiques pour éteindre les ardeurs vénériennes ; tels que le camphre enflammé et plongé dans la boisson ordinaire, ou employé tout autrement, sous quelque forme que ce soit : il est bon à joindre à tous les autres remèdes propres à détruire l'excès de l'appetit vénérien. Horstius, epist. ad Bartholinum, assure n'avoir jamais éprouvé que de très-grands effets du camphre, l'ayant souvent mis en usage pour des filles attaquées de la fureur utérine. Voyez CAMPHRE. On trouve aussi le suc de l'agnus castus, des tendrons de saule, de morelle, de petite joubarbe, très-recommandé pour être donné dans les juleps, contre cette maladie : on fait aussi avec succès des décoctions des feuilles de ces plantes, pour les injections, les fomentations, les bains nécessaires. On vante beaucoup aussi les bons effets du nymphéa, des violettes, de leur syrop : on conseille surtout très-fort l'usage des préparations de plomb, entr'autres du sel de Saturne ; mais seulement pour les personnes qui ne sont pas et qui ne doivent jamais être dans le cas de faire des enfants ; parce que ce métal pris intérieurement rend, dit-on, les femmes stériles. Rivière, dans l'idée où il était qu'il fallait attribuer la fureur utérine à la semence échauffée, faisait prendre, pour l'évacuer, des bols de térébenthine. Quel cas fera d'un pareil remède le médecin qui ne croit pas à l'existence de cette humeur séminale, et qui ne juge de son effet que par l'idée qu'en donne ce vénérable praticien ?
Mais aucun de tous ces médicaments ne convient dans le traitement de la maladie dont il s'agit, qu'entant qu'il peut satisfaire à quelqu'une des différentes indications qui se présentent à remplir, et non point par aucune autre vertu spéciale. Il n'en est aucun qui puisse être employé indistinctement dans tous les cas : c'est au médecin prudent à choisir entr'eux, conformément à l'idée qu'il s'est faite de la nature de la maladie, d'après les conséquences qu'il a judicieusement tirées de la nature de ses causes et de ses symptômes, combinée avec la constitution de la malade. (d)
FUREUR
- Détails
- Écrit par Louis-Jacques Goussier (D)
- Catégorie parente: Logique
- Catégorie : Grammaire & Morale
- Affichages : 2177