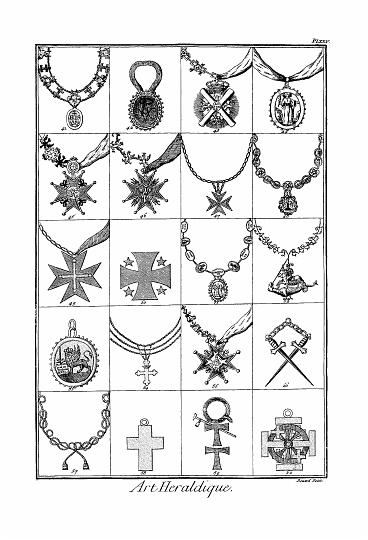VERTU, (Synonyme) la sagesse consiste à se rendre attentif à ses véritables et solides intérêts, à les demêler d'avec ce qui n'en a que l'apparence, à choisir bien, et à se soutenir dans des choix éclairés. La vertu Ve plus loin ; elle a à cœur le bien de la société ; elle lui sacrifie dans le besoin ses propres avantages, elle sent la beauté et le prix de ce sacrifice, et par-là ne balance point de le faire, quand il le faut. (D.J.)
SAGESSE, (Morale) la sagesse consiste à remplir avec exactitude ses devoirs, tant envers la divinité, qu'envers soi - même et les autres hommes. Mais où trouvera-t-elle des motifs pour y être fidèle, si ce n'est dans le sentiment de notre immortalité ? Ainsi l'homme véritablement sage est un homme immortel, un homme qui se survit à lui-même, et qui porte ses espérances au-delà du trépas. Si nous nous renfermons dans le cercle étroit des objets de ce monde, la force que nous aurons pour nous empêcher d'être avares, consistera dans la crainte de faire tort à notre honneur par les bassesses de l'intérêt ; la force que nous aurons pour nous empêcher d'être prodigues, consistera dans la crainte de ruiner nos affaires, lorsque nous aspirons à nous faire estimer des autres par nos libéralités. La crainte des maladies nous fera résister aux tentations de la volupté : l'amour-propre nous rendra modérés et circonspects, et par orgueil nous paraitrons humbles et modestes. Mais ce n'est-là que passer d'un vice à un autre. Pour donner à notre âme la force de s'élever au-dessus d'une faiblesse, sans retomber dans une autre, il faut la faire agir par des motifs bien supérieurs. Les vues du temps pourront lui faire sacrifier une passion à une autre passion ; mais la vue de l'éternité seule enferme des motifs propres à l'élever au-dessus de toutes les faiblesses. On a Ve des orateurs d'une sublime éloquence ne faire aucun effet, parce qu'ils ne savaient point intéresser, comme il faut, la nature immortelle. On en a Ve au contraire d'un talent fort médiocre, toucher tout le monde par des discours sans art, parce qu'ils prenaient les hommes par les motifs de l'éternité. C'est du sentiment de notre immortalité que nous voyons sortir tout ce qui nous console, qui nous élève et qui nous satisfait. Il n'y a que l'homme immortel qui puisse braver la mort : lui seul peut s'élever au-dessus de tous les événements de ce monde, se montrer indépendant des caprices du sort, et plus grand que toutes les dignités du monde. Que cette insensibilité fastueuse dont les Stoïciens paraient leur sage, s'accorde mal avec leurs principes ! Tandis que vous le renfermez dans l'enceinte des choses fragiles et périssables, qu'exigez-vous de lui ? Quel motif lui fournissez-vous pour le rendre supérieur à des choses qui lui procurent du plaisir ? L'homme étant né pour être heureux, et n'étant heureux que par les sentiments délicieux qu'il éprouve, il ne peut renoncer à un plaisir que par un plus grand plaisir. S'il sacrifie son plaisir à une vertu stérile, vertu qui laisse l'âme dans une molle inaction, où son activité n'a rien à saisir, ce n'est chez lui qu'une vaine ostentation d'une grandeur chimérique. Placez le sage vis-à-vis de lui-même, qu'il n'ait que lui pour témoin de ses actions, que le murmure flatteur des louanges ne pénètre pas jusqu'à lui dans son désert, réduisez cet homme tristement vertueux à s'envelopper dans son propre mérite, à vivre, pour ainsi dire, de son propre lui, vous reconnoitrez bientôt que tout ce faste de sagesse n'était qu'un orgueil imposant qui tombe de lui-même, lorsqu'il n'a plus d'admirateur. Avec quel front voulez-vous qu'un tel sage affronte les hasards ? Qui peut le dédommager d'une mort qui lui ôtant tout sentiment, détruit cette sagesse même dont il se fait honneur ? Mais supposez-vous l'homme immortel, il est plus grand que tout ce qui l'environne. Il n'estime dans l'homme que l'homme même. Les injustices des autres hommes le touchent peu. Elles ne peuvent nuire à son immortalité ; sa haine seule pourrait lui nuire. Elle éteint le flambeau. L'homme mortel peut affecter une constance qu'il n'a pas, pour faire croire qu'il est au-dessus de l'adversité. Ce sentiment ne sied pas bien à un homme qui renferme toutes ses ressources dans le temps. Mais il est bien placé dans un homme qui se sent fait pour l'éternité. Sans se contrefaire, pour paraitre magnanime, la nature et la religion l'élèvent assez pour le faire souffrir sans impatience, et le rendre content sans affectation. Un tel homme peut remplir l'idée et le plan de la suprême valeur, lorsque son devoir l'oblige à s'exposer aux dangers de la guerre. Le monde verra dans lui un homme brave par raison ; sa valeur ne devra point toute sa force à la stupidité qui lui ferme les yeux sur le précipice qui s'ouvre sous ses pas, à l'exemple qui l'oblige de suivre les autres dans les plus affreux périls, aux considérations du monde qui ne lui permettent pas de reculer où l'honneur l'appele. L'homme immortel s'expose à la mort, parce qu'il sait bien qu'il ne peut mourir. Il n'y a point de héros dans le monde, puisqu'il n'y en a point qui ne craigne la mort, ou qui ne doive son intrépidité à sa propre faiblesse. Pour être brave, on cesse d'être homme, et pour aller à la mort, on commence à se perdre de vue ; mais l'homme immortel s'expose, parce qu'il se connait. L'héroïsme, dans les principes d'un homme qui renferme toutes ses espérances dans le monde, est une extravagance. Les louanges de la postérité contre lesquelles il échange sa vie, ne sont pas capables de l'en dédommager. Comment donc et par quel prodige des hommes qui ne paraissent avoir connu d'autre vie que la présente, ont-ils pu consentir à cesser d'être, pour être heureux ? Ciceron a cru que le principe de cet héroïsme était toujours une espérance secrète de jouir de sa réputation dans le sein même du tombeau. Mais il y a quelque chose de plus. Il ne serait pas impossible que ces hommes célèbres aient été plus heureux par leur mort, qu'ils ne l'eussent été par leur vie. Admirés de leurs amis et de leurs compatriotes, persuadés qu'ils le seraient de leurs ennemis mêmes et de la postérité, cette épaisse nuée de tant d'admirateurs a pu, pour des imaginations vives, former un spectacle dont le charme, quoique de peu de durée, fut pour eux d'un plus grand poids que leur propre vie. L'amour de nous-mêmes éclairé par la raison, ne consentira jamais à un tel sacrifice : ce n'est qu'à la faveur des accès d'une imagination séduite et enchantée, qu'il lui applaudira.
Il faut, observe Séneque, apprendre chaque jour à se quitter, il faut apprendre à mourir. Ce sentiment qui est si noble et si relevé dans une bouche chrétienne, parait tout à fait ridicule dans celle d'un stoïcien. Il n'avait aucune crainte ni aucune espérance pour l'autre vie. Pourquoi donc s'imposait-il une peine si rigoureuse ? Pourquoi fuyait-il les plaisirs attirants, lui qui devait à la mort rentrer dans le sein de la divinité ? Quel avantage avait le philosophe obscur, toujours rempli de pensées funestes, toujours forcé à se contraindre ; quel avantage avait-il sur le libertin aimable et aimé, satisfait de son bonheur, ingenieux dans la recherche de la volupté ? Le même sort les attendait tous deux. La vie des hommes s'envole trop rapidement, pour être employée à la poursuite d'une vertu farouche et opiniâtre. Nous ne pouvons trop chercher à être heureux ; et le présent est le seul moyen qui nous conduise à la félicité, dumoins à celle dont nous sommes capables ici-bas. Dompter ses passions, se gêner sans-cesse, renoncer à ses plus chères inclinations, corriger ses erreurs, veiller scrupuleusement sur sa conduite, c'est l'emploi d'un homme qui perce au-delà de cette vie, qui sait par la révélation, qu'il survivra à la perte de son corps. Mais les Stoïciens n'avaient pas les mêmes motifs de se flatter ; jamais un avenir obscur ne leur a tenu lieu du présent, et le présent était toute leur richesse, l'objet de tous leurs désirs. Aussi les philosophes grecs, qui parlaient suivant leur cœur, avaient-ils une morale douce, et accommodée aux différents besoins de la société. Le portique seul se distingua par une sévérité déplacée ; trop de confiance en la raison, l'abus de ses forces, un courage mal entendu le perdirent entièrement.
SAGESSE, (Critique sacrée) sapience, ; ce mot qui chez les Grecs et les Latins se prend pour la science de la philosophie, a encore d'autres significations dans l'Ecriture. Il désigne par exemple, 1°. dans le Créateur, ses œuvres divines ; ps. l. 8. 2°. l'habileté dans un art ou dans une science ; Exode xxxix. 3. 3°. la prudence dans la conduite de la vie ; III. Rois IIe 6. 4°. la doctrine, l'expérience ; Job. XIIe 12. 5°. l'assemblage des vertus : à mesure que Jesus-Christ croissait en âge, il donnait de plus en plus des preuves de sa sagesse ; Luc. IIe 52. 6°. la prudence présomptueuse des hommes du monde : je confondrai leur sagesse ; I. Cor. j. 19. 7°. enfin la sagesse éternelle est l'être suprême ; Luc. XIe 49. (D.J.)
SAGESSE, (Mythologie) il ne parait pas que les Grecs aient jamais divinisé la sagesse, qu'ils appelaient , mais ils l'ont du moins personnifiée, et le plus souvent sous la figure de Minerve, déesse de la sagesse : son symbole ordinaire était la chouette, oiseau qui voit dans les ténèbres, et qui marque que la vraie sagesse n'est jamais endormie. Les Lacédémoniens représentaient la sagesse sous la figure d'un jeune homme qui a quatre mains et quatre oreilles, un carquois à son côté, et dans sa main droite une flute ; ces quatre mains semblent désigner que la vraie sagesse est toujours dans l'activité ; les quatre oreilles, qu'elle reçoit volontiers des conseils ; la flute et le carquois, qu'elle doit se trouver par-tout, au milieu des armées comme dans les plaisirs : c'est du moins là ce que pensent nos mythologues moralistes. (D.J.)
SAGESSE livre de la, (Théologie) nom d'un des livres canoniques de l'ancien Testament, que les Grecs appellent sagesse de Salomon, , et qui est cité par quelques anciens sous le nom grec de , comme qui dirait recueil ou tresor de toute vertu, ou instructions pour nous conduire à la vertu. En effet le but principal que se propose l'auteur de cet ouvrage, est d'instruire les rais, les grands, les juges de la terre.
Le texte original de cet ouvrage est le grec, et il n'y a nulle apparence qu'il ait jamais été écrit en hébreu ; on n'y voit point les hébraïsmes et les barbarismes présque inévitables à ceux qui traduisent un livre sur l'hébreu ; l'auteur écrivait assez bien en grec et avait lu Platon et les poètes grecs, dont il emprunte certaines expressions inconnues aux Hébreux, telles que l'ambroisie, le fleuve d'oubli, le royaume de Pluton ou d'Adès, etc. il cite toujours l'Ecriture d'après les septante, lors même qu'il s'éloigne de l'hébreu, et enfin si les auteurs juifs l'ont cité, ce qu'ils en rapportent est pris sur le grec. Toutes ces preuves réunies démontrent que l'original est grec.
La traduction latine que nous en avons, n'est pas de S. Jérôme, c'est l'ancienne vulgate usitée dans l'église dès le commencement, et faite sur le grec longtemps avant S. Jérôme ; elle est exacte et fidèle, mais le latin n'en est pas toujours fort pur. L'auteur de ce livre est entièrement inconnu ; quelques-uns l'attribuent à Salomon, et veulent que ce prince l'ait écrit en hébreu, qu'on le traduisit en grec, et que le premier original s'étant perdu, le grec a depuis passé pour l'original ; mais quelle apparence que les juifs n'eussent pas mis cet ouvrage au nombre de leurs livres canoniques, s'il eut été de Salomon ? D'où vient qu'il n'est point en hébreu, que personne ne l'a jamais Ve en cette langue, que le traducteur n'en dit rien, et que son style ne se ressent point de son original ?
D'autres l'ont attribué à Philon, mais on ne connait point précisément quel est ce Philon : car l'antiquité fait mention de trois auteurs de ce nom ; le premier vivait du temps de Ptolomée Philadelphe ; le second est Philon de Biblos, cité dans Eusebe et dans Josephe ; le troisième est Philon le juif, assez connu : ce ne peut être le premier de l'existence duquel on a de bonnes raisons de douter, ni le second qui était payen, ni le troisième qui n'a jamais été reconnu pour un auteur inspiré.
Grotius pense que ce livre est d'un juif qui l'écrivit, dit-il, en hebreu depuis Esdras et avant le pontificat du grand prêtre Simon. Il ajoute qu'il fut traduit en grec avec assez de liberté, par un auteur chrétien qui y ajouta quelques traits et quelques sentiments tirés du christianisme ; delà vient qu'on y remarque, selon cet auteur, le jugement universel, le bonheur des justes, et le supplice des mécans, d'une manière plus distincte que dans les autres livres des Hébreux ; mais Grotius avance tout cela sans preuves. Grot. praefat. in sapient.
Cornelius-A-Lapide croit que le livre de la sagesse a été écrit en grec par un auteur juif, depuis la captivité de Babylone vers le temps de Ptolomée Philadelphe, roi d'Egypte, et il soupçonne que ce pourrait bien être un des septante interpretes, parce qu'au rapport d'Aristée, ce prince proposa à chacun de ces interpretes une question touchant le bon gouvernement de son état ; ce livre pourrait donc être un recueil de leurs réponses, ou avoir été écrit par un seul d'entr'eux à cette occasion.
Le livre de la sagesse n'a pas toujours été reçu pour canonique dans l'église ; les juifs ne l'ont jamais reconnu ; plusieurs pères et plusieurs églises l'ont rejeté de leur canon. Lyran même, et Cajetan ne le reconnaissent pas comme incontestablement canonique ; mais d'un autre côté, plusieurs pères l'ont connu et cité comme Ecriture sainte. Les auteurs sacrés du nouveau Testament, y font quelquefois allusion ; les conciles de Carthage en 337, de Sardique en 347, de Constantinople, in Trullo, en 692, le XIe de Tolede en 675, celui de Florence en 1438, et enfin celui de Trente, sep. 4. l'ont expressément admis au nombre des livres canoniques.
Les musulmants attribuent le livre de la sagesse à leur philosophe Locman, qui n'était pas, disent-ils, nabi ou prophète, mais seulement hakim, c'est-à-dire sage. Calmet, Diction. de la Bibl. tom. III. pag. 424. et suiv. (H)
Articles populaires Logique
TENTATIVE
(Grammaire) terme qui s'emploie en certaines occasions, comme un adjectif ; ainsi nous disons, une méthode tentative, pour exprimer une méthode encore grossière et imparfaite, et que l'on tâche de perfectionner par des essais et des expériences.Tentative s'emploie aussi comme un substantif, et signifie un essai ou un effort que l'on fait pour mesurer ses forces, pour sonder une affaire, et pour voir si l'on réussira ou non.
Lire la suite...