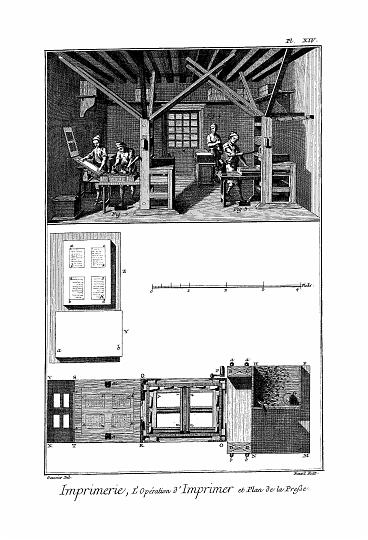v. adj. (Grammaire) le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, ont admis dans leur conjugaison un mode particulier, qui est inconnu aux Hébreux, aux Grecs, et aux Latins : je ferais, j'aurais fait, j'aurais eu fait, je devrais faire.
Ce mode est personnel, parce qu'il reçoit dans chacun de ses temps les inflexions et les terminaisons personnelles et numériques, qui servent à caractériser par la concordance, l'application actuelle du verbe, à tel sujet déterminé : je ferais, tu ferais, il ferait ; nous ferions, vous feriez, ils feraient.
Ce mot est direct ; parce qu'il peut constituer par lui-même la proposition principale, ou l'expression immédiate de la pensée : je lirais volontiers cet ouvrage.
Enfin, c'est un mode mixte, parce qu'il ajoute à l'idée fondamentale du verbe, l'idée accidentelle d'hypothèse et de supposition : il n'énonce pas l'existence d'une manière absolue, ce n'est que dépendamment d'une supposition particulière : je lirais volontiers cet ouvrage, si je l'avais.
Parce que ce mode est direct, quelques-uns de nos grammairiens en ont regardé les temps comme appartenant au mode indicatif. M. Restaut en admet deux à la fin de l'indicatif ; l'un qu'il appelle conditionnel présent, comme je ferais ; et l'autre qu'il nomme conditionnel passé, comme j'aurais fait. Le P. Buffier les rapporte aussi à l'indicatif, et il les appelle temps incertains ; mais il est évident que c'est confondre un mode qui n'exprime l'existence que d'une manière conditionnelle, avec un autre qui l'exprime d'une manière absolue, ainsi que le premier de ces grammairiens le reconnait lui-même par la dénomination de conditionnel : ces deux modes, à la vérité, conviennent en ce qu'ils sont directs, mais ils diffèrent en ce que l'un est pur, et l'autre mixte ; ce qui doit empêcher qu'on ne les confonde : c'est de même parce que l'indicatif et l'impératif sont également directs, que les grammairiens hébreux ont regardé l'impératif comme un simple temps de l'indicatif ; mais c'est parce que l'indicatif est pur, et l'impératif mixte, que les autres grammairiens distinguent ces deux modes. La raison qu'ils ont eu à cet égard, est la même dans le cas présent ; ils doivent donc en tirer la même conséquence : quelque frappante qu'elle sait, je ne sache pourtant aucun grammairien étranger qui l'ait appliquée aux conjugaisons des verbes de sa langue ; et par rapport à la nôtre, il n'y a que M. l'abbé Girard qui l'ait sentie et réduite en pratique, sans même avoir déterminé à suivre ses traces, aucun des grammairiens qui ont écrit depuis l'édition de ses vrais principes ; comme s'ils trouvaient plus honorable d'errer à la suite des anciens que l'on ne fait que copier, que d'adopter une vérité mise au jour par un moderne que l'on craint de reconnaître pour maître.
D'autres grammairiens ont rapporté au mode subjonctif, les temps de celui-ci : l'abbé Régnier appelle l'un premier futur, comme je ferais, et l'autre second futur composé, comme j'aurais fait. La Touche les place de même au subjonctif, qu'il appelle conjonctif ; je ferais, selon lui, en est un second imparfait, ou l'imparfait conditionnel ; j'aurais fait, en est le second plus que parfait, ou le plus que parfait conditionnel. C'est la méthode de la plupart de nos rudimentaires latins, qui traduisent ce qu'ils appellent l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif : facerem, que je fisse, ou je ferais ; fecissem, que j'eusse fait, ou j'aurais fait. C'est une erreur évidente, que j'ai démontrée au mot SUBJONCTIF, n. 1. et c'est confondre un mode direct avec un oblique.
Cette méprise vient, comme tant d'autres, d'une application gauche de la grammaire latine à la langue française ; dans les cas où nous disons je ferais, j'aurais fait, les latinistes ont Ve que communément ils doivent dire facerem, fecissem ; de même que quand ils ont à rendre nos expressions, je fisse, j'eusse fait ; et comme ils n'ont pas osé imaginer que nos langues modernes pussent avoir d'autres modes ou d'autres temps que la latine, ils n'ont pu en conclure autre chose, sinon que nous rendons de deux manières l'imparfait, et le plusque-parfait du subjonctif latin.
Mais examinons cette conséquence. Tout le monde conviendra sans-doute, que je ferais et je fisse, ne sont pas synonymes, puisque je ferais est direct et conditionnel, et que je fisse est oblique et absolu : or il n'est pas possible qu'un seul et unique mot d'une autre langue, réponde à deux significations si différentes entr'elles dans la nôtre, à-moins qu'on ne suppose cette langue absolument barbare et informe. Je sais bien qu'on objectera que les latins se servent des mêmes temps du subjonctif, et pour les phrases que nous regardons comme obliques ou subjonctives, et pour celles que nous regardons comme directes et conditionnelles ; et je conviens moi-même de la vérité du fait ; mais cela ne se fait qu'au moyen d'une ellipse, dont le supplément ramène toujours les temps dont il s'agit, à la signification du subjonctif : illud si scissem, ad id litteras meas accommodassem ; Cic. c'est-à-dire analytiquement, si res fuerat ita ut scissem illud, res ita ut accommodassem ad id meas litteras ; si la chose avait été de manière que je l'eusse su, la chose était de manière que j'y eusse adapté ma lettre. On voit même dans la traduction littérale, que je n'ai employé aucun des temps dont il s'agit ici, parce que le tour analytique m'en a épargné le besoin : les latins ont conservé l'empreinte de cette construction, en gardant le subjonctif scissem, accommodassem ; mais ils ont abrégé par une ellipse, dont le supplément est suffisamment indiqué par ces subjonctifs mêmes, et par le si. Notre usage nous donne ici la même licence, et nous pouvons dire, si je l'eusse su, j'y eusse adapté ma lettre ; mais c'est, comme en latin, une véritable ellipse, puisque j'eusse su, j'eusse adapté sont en effet du mode subjonctif, qui suppose une conjonction, et une proposition principale, dont le verbe doit être à un mode direct ; et ceci prouve que M. Restaut se trompe encore, et n'a pas assez approfondi la différence des mots, quand il rend son prétendu conditionnel passé de l'indicatif par j'aurais, ou j'eusse fait ; c'est confondre le direct et l'oblique.
C'est encore la même chose en latin, mais non pas en français, lorsqu'il s'agit du temps simple, appelé communément imparfait. Quand Ovide dit, si possem, sanior essem ; c'est au-lieu de dire analytiquement, si res erat ita ut possem, res est ita ut essem sanior ; si la chose était de manière que je pusse, la chose est de manière que je fusse plus sage. Dans cette traduction littérale, je ne fais encore usage d'aucun temps conditionnel ; j'en suis dispensé par le tour analytique que les latins n'ont fait qu'abréger comme dans le premier exemple ; mais ce que notre usage a autorisé à l'égard de ce premier exemple, il ne l'autorise pas ici, et nous ne pouvons pas dire elliptiquement, si je pusse, je fusse plus sage : c'est l'interdiction de cette ellipse qui nous a mis dans le cas d'adopter ou l'ennuyeuse circonlocution du tour analytique, ou la formation d'un mode exprès ; le goût de la briéveté a décidé notre choix, et nous disons par le mode suppositif, je serais plus sage, si je pouvais ; la nécessité ayant établi ce temps du mode suppositif, l'analogie lui a accordé tous les autres dont il est susceptible ; et quoique nous puissions rendre la première phrase latine par le subjonctif, au moyen de l'ellipse, nous pouvons le rendre encore par le suppositif, sans aucune ellipse ; si je l'avais su, j'y aurais adapté ma lettre.
Il arrive souvent aux habitants de nos provinces voisines de l'Espagne, de joindre au si un temps du suppositif : c'est une imitation déplacée de la phrase espagnole qui autorise cet usage ; mais la phrase française le rejette, et nous disons, si j'étais, si j'avais été, et non pas, si je serais, si j'aurais été, quoique les Espagnols disent si estuviéra, si uviéra estado.
J'ai mieux aimé donner à ce mode le nom de suppositif, avec M. l'abbé Girard, que celui de conditionnel ; mais la raison de mon choix est fort différente de la sienne ; c'est que la terminaison est semblable à celle des noms des autres modes, et qu'elle annonce la destination de la chose nommée, laquelle est spécifiée par le commencement du mot suppositif, qui sert à la supposition, à l'hypothèse ; comme impératif, qui sert au commandement ; subjonctif, qui sert à la subordination des propositions dépendantes ; etc. Tous les adjectifs français terminés en if et ive, comme les latins en ivus, iva, ivum, ont le même sens, qui est fondé sur l'origine de cette terminaison.
Pour ce qui regarde le détail des temps du suppositif. Voyez TEMS. (B. E. R. M.)
SUPPOSITION, s. f. (Grammaire et Jurisprudence) est lorsque l'on met une chose au-lieu d'une autre, comme une supposition d'un nom pour un autre, ou d'un testament, ou autre acte, ou signature, qui n'est pas véritable.
La supposition de faits est lorsqu'on met en avant des faits inventés.
Supposition de personne est lorsqu'une personne s'annonce pour une autre, dont elle prend le nom pour abuser quelqu'un, ou commettre quelqu'autre fraude. Ce crime est puni selon les circonstances. Voyez Papon, l. XXII. tit. 9.
La supposition de part, ou d'enfant, est lorsqu'un homme ou une femme annoncent pour leur enfant quelqu'un qui ne l'est point. Ce crime est si grave qu'il est quelquefois puni de mort. Voyez au digest. les titres ad leg. com. de fall. de inspicien. ventre et de Ca.... edicto. So.... tom. I. cant. II. ch. lxxxix. Dard... tom. II. l. VII. ch. xxxj. (A)
SUPPOSITION des anciens auteurs, (Littérature) comme il importe encore d'anéantir l'hypothèse bizarre du père Hardouin, qui a tenté d'établir la supposition de la plupart des anciens auteurs, je vais rapporter ici cinq arguments décisifs, par lesquels M. des Vignoles a sappé pour toujours le système imaginaire du jésuite trop audacieux.
Le premier argument qu'il emploie, c'est que dans les anciens historiens, comme Thucydide, Diodore de Sicile, Tite-Live, et autres, que le père Hardouin regarde comme supposés : on trouve plusieurs éclipses de soleil et de lune marquées, qui s'accordent avec les tables astronomiques, et dont les chronologues spécifient le jour dans l'année Julienne proleptique, avec exactitude. Comment concevoir que des moines du xiije. siècle, fabricateurs de tous ces anciens ouvrages, selon le P. Hardouin, aient eu des tables semblables à celles que le roi Alphonse fit faire depuis. M. des Vignoles répond en même temps à une objection tirée de Pline, et il prouve que ce que Pline dit, n'est nullement propre à invalider le témoignage des autres écrivains ?
En second lieu, on demande au P. Hardouin, où des moines français du xiije. siècle, auraient trouvé la suite des archontes athéniens, qui quadre parfaitement avec des inscriptions anciennes qu'ils n'avaient jamais vues, et avec toute l'histoire. Les fastes des consuls romains fournissent un argument de la même force ; d'où ces faussaires ont-ils eu ces fastes, pour les insérer dans leur Tite-Live, dans leur Diodore, et dans leur Denys d'Halicarnasse, en sorte qu'ils s'accordent avec les fastes capitolins déterrés depuis peu ? En quatrième lieu, M. des Vignoles demande d'où ils ont su les noms et la suite des mois athéniens, puisque l'on a disputé jusqu'au siècle passé, de leur suite, et que ce n'est qu'alors qu'il a paru par divers monuments, et par les inscriptions, que Joseph Scaliger l'avait bien marquée ? Il fallait que ces moines du treizième siècle fussent bien habiles, pour savoir ce qui était inconnu aux plus savants hommes du seizième et du dix-septième siècle. On peut tirer un nouvel argument des olympiades, qui se trouvent si bien placées dans les historiens grecs prétendus supposés : on voit du premier coup d'oeil que ces cinq arguments sont sans replique ; mais l'on en sentira encore mieux toute la force, si l'on se donne la peine de lire les vindiciae veterum scriptorum, que M. Lacroze publia en 1708. contre l'étrange paradoxe, ou pour mieux dire la dangereuse hérésie du P. Hardouin ; car c'en est une que de travailler à détruire les monuments antiques grecs et latins, qui font aujourd'hui la gloire de nos études, et le principal ornement de nos bibliothèques. (D.J.)
SUPPOSITION, s. f. ce mot a aujourd'hui deux sens en Musique. 1°. Lorsque plusieurs notes montent ou descendent diatoniquement dans une partie sur une même note d'une autre partie, alors ces notes diatoniques ne sauraient toutes faire harmonie, ni entrer à la fois dans le même accord, il y en a donc qui y sont comptées pour rien, et ce sont ces notes qu'on appelle notes par supposition.
La règle générale est, quand les notes sont égales, que toutes les notes qui sont sur le temps fort doivent porter harmonie, celles qui passent sur le temps faible, sont des notes de supposition qui ne sont mises que par goût pour former des degrés conjoints. Remarquez que par temps fort et temps faible, j'entens moins ici les principaux temps de la mesure, que les parties mêmes de chaque temps. Ainsi s'il y a deux notes égales dans un même temps, c'est la première qui porte harmonie, la seconde est de supposition : si le temps est composé de quatre notes égales, la première et la troisième portent harmonie, la seconde et la quatrième sont par supposition, etc.
Quelquefois on pervertit cet ordre, on passe la première note par supposition, et l'on fait porter la seconde ; mais alors la valeur de cette seconde note est ordinairement augmentée par un point aux dépens de la première.
Tout ceci suppose toujours une marche diatonique par degrés conjoints ; car quand les degrés sont disjoints, il n'y a point de supposition, et toutes les notes doivent entrer dans l'accord.
2°. On appelle accords par supposition, ceux où la basse continue ajoute ou suppose un nouveau son au-dessous même de la basse fondamentale ; ce qui fait que de tels accords excédent toujours l'étendue de l'octave.
Les dissonnances des accords par supposition doivent toujours être préparées par des syncopes, et sauvées en descendant diatoniquement sur des sons d'un accord, sous lequel la même basse supposée puisse tenir comme basse fondamentale, ou du moins comme une consonnance de l'accord. C'est ce qui fait que les accords par supposition bien examinés, peuvent tous passer pour de pures suspensions. Voyez SUSPENSION.
Il y a trois sortes d'accords par supposition, tous sous des accords de la septième ; la première quand le son ajouté est une tierce au-dessous du son fondamental, tel est l'accord de neuvième ; si l'accord de neuvième est formé par la médiante ajoutée au-dessous de l'accord sensible en mode mineur, alors l'accord prend le nom de quinte superflue. La seconde espèce, est quand le son supposé est une quinte au-dessous du son fondamental, comme dans l'accord de quarte ou onzième ; si l'accord est sensible, et qu'on suppose la tonique, cet accord prend le nom de septième superflue. Enfin la troisième espèce d'accord par supposition, est celle où le son supposé est au-dessous d'un accord de septième diminuée ; si c'est une quinte au-dessous, c'est-à-dire que le son supposé soit la médiante, l'accord s'appelle accord de quarte et quinte superflue ; et si c'est une septième au-dessous, c'est-à-dire que le son supposé soit la tonique, l'accord prend le nom de sixte mineure et septième superflue. A l'égard des renversements de ces divers accords, on trouvera au mot ACCORD, tous ceux qui peuvent se tolérer. (S)
Articles populaires Logique
RÉEL
adj. (Grammaire) qui est en effet. Il s'oppose en ce sens, à apparent. Pourquoi tromper les hommes par des démonstrations, quand on ne peut, ni veut les servir réellement ? Voyez l'article REALITE.Lire la suite...