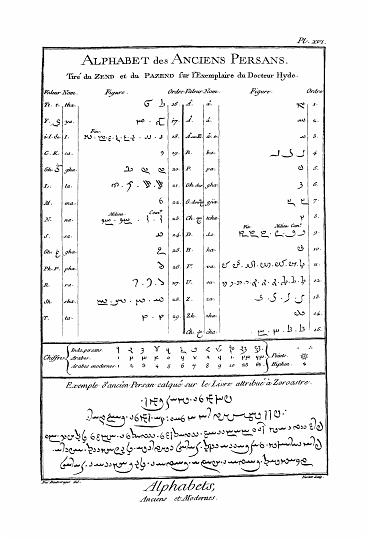(Grammaire) union ou confédération entre des princes ou des particuliers pour attaquer ou pour se défendre mutuellement.
LIGUE, la, (Histoire de France) on nomme ainsi par excellence toutes les confédérations qui se formèrent dans les troubles du royaume contre Henri III. et contre Henri IV. depuis 1576 jusqu'en 1593.
On appela ces factions la sainte union ou la sainte ligue ; les zélés catholiques en furent les instruments, les nouveaux religieux les trompettes, et les lorrains les conducteurs. La mollesse d'Henri III. lui laissa prendre l'accroissement, et la reine mère y donna la main ; le pape et le roi d'Espagne la soutinrent de toute leur autorité ; ce dernier à cause de la liaison des calvinistes de France avec les confédérés des pays-bas ; l'autre par la crainte qu'il eut de ces mêmes huguenots, qui, s'ils devenaient les plus forts, auraient bientôt sappé sa puissance. Abrégeons tous ces faits que j'ai recueillis par la lecture de plus de trente historiens.
Depuis le massacre de la saint Barthélemi, le royaume était tombé dans une affreuse confusion, à laquelle Henri III. mit le comble à son retour de Pologne. La nation fut accablée d'édits bursaux, les campagnes désolées par la soldatesque, les villes par la rapacité des financiers, l'Eglise par la simonie et le scandale.
Cet excès d'opprobre enhardit le duc Henri de Guise à former la ligue projetée par son oncle le cardinal de Lorraine, et à s'élever sur les ruines d'un état si mal-gouverné. Il était devenu le chef de la maison de Lorraine en France, ayant le crédit en main, et vivant dans un temps où tout respirait les factions ; Henri de Guise était fait pour elle. Il avait, dit-on, toutes les qualités de son père avec une ambition plus adroite, plus artificieuse et plus effrénée, telle enfin qu'après avoir causé mille maux au royaume, il tomba dans le précipice.
On lui donne la plus belle figure du monde, une éloquence insinuante, qui dans le particulier triomphait de tous les cœurs ; une libéralité qui allait jusqu'à la profusion, un train magnifique, une politesse infinie, et un air de dignité dans toutes ses actions ; fin et prudent dans les conseils, prompt dans l'exécution, secret ou plutôt dissimulé sous l'apparence de la franchise ; du reste accoutumé à souffrir également le froid et le chaud, la faim et la soif, dormant peu, travaillant sans cesse, et si habîle à manier les affaires, que les plus importantes ne semblaient être pour lui qu'un badinage. La France, dit Balzac, était folle de cet homme-là ; car c'est trop peu de dire amoureuse ; une telle passion allait bien près de l'idolâtrie. Un courtisan de ce règne prétendait que les huguenots étaient de la ligue quand ils regardaient le duc de Guise. C'est de son père et de lui que la maréchale de Retz disait, qu'auprès d'eux tous les autres princes paraissaient peuple.
On vantait aussi la générosité de son cœur ; mais il n'en donna pas un exemple, quand il investit lui-même la maison de l'amiral Coligny, et qu'attendant dans la cour l'exécution de l'assassinat de ce grand homme, qu'il fit commettre par son valet (Besme), il cria qu'on jetât le cadavre par les fenêtres, pour s'en assurer et le voir à ses pieds : tel était le duc de Guise, à qui la soif de régner applanit tous les chemins du crime.
Il commença par proposer la ligue dans Paris, fit courir chez les bourgeois, qu'il avait déjà gagnés par ses largesses, des papiers qui contenaient un projet d'association, pour défendre la religion, le roi et la liberté de l'état, c'est-à-dire pour opprimer à la fois le roi et l'état, par les armes de la religion ; la ligue fut ensuite signée solennellement à Péronne, et dans presque toute la Picardie, par les menées et le credit de d'Humières gouverneur de la province. Il ne fut pas difficîle d'engager la Champagne et la Bourgogne dans cette association, les Guises y étaient absolus. La Tremouille y porta le Poitou, et bientôt après toutes les autres provinces y entrèrent.
Le roi craignant que les états ne nommassent le duc de Guise à la tête du parti qui voulait lui ravir la liberté, crut faire un coup d'état, en signant lui-même la ligue, de peur qu'elle ne l'écrasât. Il devint, de roi, chef de cabale, et de père commun, ennemi de ses propres sujets. Il ignorait que les princes doivent veiller sur les ligues, et n'y jamais entrer. Les rois sont la planéte centrale qui entraîne tous les globes dans son tourbillon : ceux ci ont un mouvement particulier, mais toujours lent et subordonné à la marche uniforme et rapide du premier mobile. En vain, dans la suite, Henri III. voulut arrêter les progrès de cette ligue : il ne sut pas y travailler ni l'éteindre ; elle éclata contre lui, et fut cause de sa perte.
Comme le premier dessein de la ligue était la ruine des calvinistes, on ne manqua pas d'en communiquer avec dom Juan d'Autriche, qui, allant prendre possession des Pays Bas, se rendit déguisé à Paris, pour en concerter avec le duc de Guise : on se conduisit de même avec le légat du pape. En conséquence la guerre se renouvella contre les protestants ; mais le roi s'étant embarqué trop légérement dans ces nouvelles hostilités, fit bien-tôt la paix, et créa l'ordre du S. Esprit, comptant, par le serment auquel s'engageaient les nouveaux chevaliers, d'avoir un moyen sur pour s'opposer aux desseins de la ligue. Cependant dans le même temps, il se rendit odieux et méprisable, par son genre de vie efféminée, par ses confrairies, par ses pénitences, et par ses profusions pour ses favoris, qui l'engagèrent à établir sans nécessité des édits bursaux, et à les faire vérifier par son parlement.
Les peuples voyant que du trône et du sanctuaire de la Justice, il ne sortait plus que des édits d'oppression, perdirent peu à peu le respect et l'affection qu'ils portaient au prince et au parlement. Les chefs de la ligue ne manquèrent pas de s'en prévaloir, et en recueillant ces édits onéreux, d'attiser le mépris et l'aversion du peuple.
Henri III. ne regnait plus : ses mignons disposaient insolemment et souverainement des finances, pendant que la ligue catholique et les confédérés protestants se faisaient la guerre malgré lui dans les provinces ; les maladies contagieuses et la famine se joignaient à tant de fléaux. C'est dans ces moments de calamités, que, pour opposer des favoris au duc de Guise, il dépensa quatre millions aux nôces du duc de Joyeuse. De nouveaux impôts qu'il mit à ce sujet, changèrent les marques d'affection en haine et en indignation publique.
Dans ces conjonctures, le duc d'Anjou son frère, vint dans les Pays-Bas, chercher au milieu d'une désolation non moins funeste, une principauté qu'il perdit par une tirannique imprudence, que sa mort suivit de près.
Cette mort rendant le roi de Navarre le plus proche héritier de la couronne, parce qu'on regardait comme une chose certaine, qu'Henri III. n'aurait point d'enfants, servit de prétexte au duc de Guise, pour se déclarer chef de la ligue, en faisant craindre aux François d'avoir pour roi un prince séparé de l'Eglise. En même temps, le pape fulmina contre le roi de Navarre et le prince de Condé, cette fameuse bulle dans laquelle il les appelle génération bâtarde et détestable de la maison de Bourbon ; il les déclare en conséquence déchus de tout droit et de toute succession. La ligue profitant de cette bulle, força le roi à poursuivre son beau-frère qui voulait le secourir, et à seconder le duc de Guise qui voulait le détrôner.
Ce duc, de son côté, persuada au vieux cardinal de Bourbon, oncle du roi de Navarre, que la couronne le regardait, afin de se donner le temps, à l'abri de ce nom, d'agir pour lui-même. Le vieux cardinal, charmé de se croire l'héritier présomptif de la couronne, vint à aimer le duc de Guise comme son soutien, à haïr le roi de Navarre son neveu, comme son rival, et à lever l'étendart de la ligue contre l'autorité royale, sans ménagement, sans crainte et sans mesure.
Il fit plus ; il prit en 1585, dans un manifeste public, le titre de premier prince du sang, et recommandait aux François de maintenir la couronne dans la branche catholique. La manifeste était appuyé des noms de plusieurs princes, et entr'autres, de ceux du roi d'Espagne et du pape à la tête : Henri III. au lieu d'opposer la force à cette insulte, fit son apologie ; et les ligueurs s'emparèrent de quelques villes du royaume, entr'autres, de Tours et de Verdun.
C'est cette même année 1585, que se fit l'établissement des seize, espèce de ligue particulière pour Paris seulement, composée de gens vendus au duc de Guise, et ennemis jurés de la royauté. Leur audace alla si loin, que le lieutenant du prevôt de l'île de France révéla au roi l'entreprise qu'ils avaient formée de lui ôter la couronne et la liberté. Henri III. se contenta de menaces, qui portèrent les seize à presser le duc de Guise de revenir à Paris. Le roi écrivit deux lettres au duc, pour lui défendre d'y venir.
M. de Voltaire rapporte à ce sujet une anecdote fort curieuse ; il nous apprend qu'Henri III. ordonna qu'on dépêchât ses deux lettres par deux couriers, et que, comme on ne trouva point d'argent dans l'épargne pour cette dépense nécessaire, on mit les lettres à la poste ; de sorte que le duc de Guise se rendit à Paris, ayant pour excuse, qu'il n'avait point reçu d'ordre contraire.
De-là suivit la journée des barricades, trop connue pour en faire le récit ; c'est assez de dire que le duc de Guise, se piquant de générosité, rendit les armes aux gardes du roi qui suivant le conseil de sa mère, ou plutôt de sa frayeur, se sauva en grand désordre et à toute bride à Chartres. Le duc, maître de la capitale, négocia avec Catherine de Médicis un traité de paix qui fut tout à l'avantage de la ligue, et à la honte de la royauté.
A peine le roi l'eut conclu, qu'il s'aperçut, quand il n'en fut plus temps, de l'abîme que la reine mère lui avait creusé, et de l'autorité souveraine des Guises, dont l'audace portée au comble, demandait quelque coup d'éclat. Ayant donc médité son plan, dans un accès de bîle noire à laquelle il était sujet en hiver, il convoqua les états de Blais, et là, il fit assassiner le 23 et le 24 Décembre le duc de Guise, et le cardinal son frère.
Les lais, dit très-bien le poète immortel de l'histoire de la ligue, les lois sont une chose si respectable et si sainte, que si Henri III. en avait seulement conservé l'apparence, et qu'ayant dans ses mains le duc et le cardinal, il eut mis quelque formalité de justice dans leur mort, sa gloire, et peut-être sa vie eussent été sauvées ; mais l'assassinat d'un héros et d'un prêtre le rendirent exécrable aux yeux de tous les catholiques, sans le rendre plus redoutable.
Il commit une seconde faute, en ne courant pas dans l'instant à Paris avec ses troupes. Les ligueurs, ameutés par son absence, et irrités de la mort du duc et du cardinal de Guise, continuèrent leurs excès. La Sorbonne s'enhardit à donner un decret qui déliait les sujets du serment de fidélité qu'ils doivent au roi, et le pape l'excommunia. A tous ces attentats, ce prince n'opposa que de la cire et du parchemin.
Cependant le duc de Mayenne en particulier se voyait chargé à regret de venger la mort de son frère qu'il n'aimait pas, et qu'il avait autrefois appelé en duel. Il sentait d'ailleurs que tôt ou tard le parti des Ligueurs serait accablé ; mais sa position et son honneur emportèrent la balance. Il vint à Paris, et s'y fit déclarer lieutenant général de la couronne de France, par le conseil de l'union : ce conseil de l'union se trouvait alors composé de 70 personnes.
L'exemple de la capitale entraina le reste du royaume ; Henri III. réduit à l'extrémité, prit le parti, par l'avis de M. de Schomberg, d'appeler à son aide le roi de Navarre qu'il avait tant persécuté ; celui-ci, dont l'âme était si belle et si grande, vole à son secours, l'embrasse, et décide qu'il fallait se rendre à force ouverte dans la capitale.
Déja les deux rois s'avançaient vers Paris, avec leurs armées réunies, fortes de plus de trente mille hommes ; déjà le siège de cette ville était ordonné, et sa prise immanquable, quand Henri III. fut assassiné, le premier Aout 1589, par le frère Jacques Clement, dominicain : ce prêtre fanatique fut encouragé à ce parricide par son prieur Bourgoin, et par l'esprit de la ligue.
Quelques Historiens ajoutent, que Madame de Montpensier eut grande part à cette horrible action, moins peut-être par vengeance du sang de son frère, que par un ancien ressentiment que cette dame conservait dans le cœur, de certains discours libres tenus autrefois par le roi sur son compte, et qui découvraient quelques défauts secrets qu'elle avait : outrage, dit Mézerai, bien plus impardonnable à l'égard des femmes, que celui qu'on fait à leur honneur.
Personne n'ignore qu'on mit sur les autels de Paris le portrait du parricide ; qu'on tira le canon à Rome, à la nouvelle du succès de son crime ; enfin, qu'on prononça dans cette capitale du monde catholique l'éloge du moine assassin.
Henri IV (car il faut maintenant l'appeler ainsi avec M. de Voltaire, puisque ce nom si célèbre et si cher est devenu un nom propre) Henri IV. dis-je, changea la face de la ligue. Tout le monde sait comment ce prince, le père et le vainqueur de son peuple, vint à bout de la détruire. Je me contenterai seulement de remarquer, que le cardinal de Bourbon, dit Charles X. oncle d'Henri IV. mourut dans sa prison le 9 Mai 1590 ; que le cardinal Cajetan légat à latère, et Mendoze ambassadeur d'Espagne, s'accordèrent pour faire tomber la couronne à l'infante d'Espagne, tandis que le duc de Lorraine la voulait pour lui-même, et que le duc de Mayenne ne songeait qu'à prolonger son autorité. Sixte V. mourut dégouté de la ligue. Grégoire XIV. publia sans succès, des lettres monitoriales contre Henri IV. en vain le jeune cardinal de Bourbon neveu du dernier mort, tenta de former quelque faction en sa faveur ; en vain le duc de Parme voulut soutenir celle d'Espagne, les armes à la main ; Henri IV. fut partout victorieux ; par-tout il battit les troupes des ligueurs, à Arques, à Ivry, à Fontaine française, comme à Coutras. Enfin, reconnu roi, il soumit par ses bienfaits, le royaume à son obéissance : son abjuration porta le dernier coup à cette ligue monstrueuse, qui fait l'événement le plus étrange de toute l'histoire de France.
Aucuns règnes n'ont fourni tant d'anecdotes, tant de piéces fugitives, tant de mémoires, tant de livres, tant de chansons satyriques, tant d'estampes, en un mot, tant de choses singulières, que les règnes d'Henri III. et d'Henri IV. Et, en admirant le règne de ce dernier monarque, nous ne sommes pas moins avides d'être instruits des faits arrivés sous son prédécesseur, que si nous avions à vivre dans des temps si malheureux. (D.J.)
LIGUE, (Géographie) nom commun aux trois parties qui composent le pays des Grisons ; l'une se nomme la ligue grise ou haute, l'autre la ligue de la Cadée, et la troisième la ligue des dix juridictions, ou des dix droitures. Voyez GRISONS.
La ligue grise, ou la ligue haute, en allemand, graw-bunds, en latin, foedus superius, ou foedus canum, est la plus considérable des trois, et a communiqué son nom à tout le pays. C'est ici que se trouvent les trois sources du Rhin. Cette ligue est partagée en huit grandes communautés, qui contiennent vingt-deux juridictions. Les habitants de la ligue grise parlent, les uns allemand, les autres italien, et d'autres un certain jargon qu'ils appellent roman : ce jargon est un mélange d'italien ou de latin, et de la langue des anciens Lépontiens.
La ligue de la Cadée, ou maison de Dieu, en allemand, gotts hansf-bundt, est partagée en onze grandes communautés, qui se subdivisent en vingt-une juridictions. Dans les affaires générales qui se nomment autrement dietes, cette ligue a vingtquatre voix. Voyez CADEE.
La ligue des dix juridictions, ou dix droitures, tire son nom des dix juridictions qui la forment, sous sept communautés générales : tous les habitants de cette dernière ligue, à un ou deux villages près, parlent allemand. (D.J.)
Articles populaires Logique
PRINCIPAUTÉ
S. f. (Grammaire) souveraineté ; comme dans ces phrases, il aspirait à la principauté ; les principautés d'Orient sont absolues. C'est aussi la terre ou seigneurie qui donne le titre de prince.PRINCIPAUTES, s. f. (Théologie) troisième classe de la hiérarchie des anges.
PRINCIPAUTE CITERIEURE, (Géographie moderne) province d'Italie, au royaume de Naples, bornée au midi et au couchant par la mer, au nord par la principauté ultérieure, et au levant par la Basilicate. Elle a 75 milles de longueur, et 50 de largeur. Elle faisait autrefois partie de la principauté de Capoue, et aujourd'hui elle fait partie de la terre de Labour. Salerne en est la capitale. (D.J.)
Lire la suite...