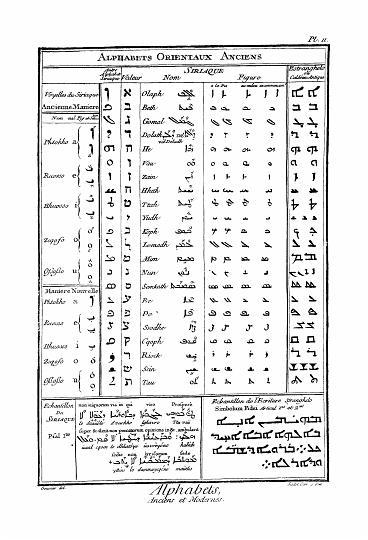subst. masc. (Grammaire) c'est une façon de parler éloignée des usages ordinaires, ou des lois générales du langage, adaptée au génie propre d'une langue particulière. R. , peculiaris, propre, particulier. C'est un terme général dont on peut faire usage à l'égard de toutes les langues ; un idiotisme grec, latin, français, etc. C'est le seul terme que l'on puisse employer dans bien des occasions ; nous ne pouvons dire qu'idiotisme espagnol, portugais, turc, etc. Mais à l'égard de plusieurs langues, nous avons des mots spécifiques subordonnés à celui d'idiotisme, et nous disons anglicisme, arabisme, celticisme, gallicisme, germanisme, hébraïsme, hellénisme, latinisme, &c.
Quand je dis qu'un idiotisme est une façon de parler adaptée au génie propre d'une langue particulière, c'est pour faire comprendre que c'est plutôt un effet marqué du génie caractéristique de cette langue, qu'une locution incommunicable à tout autre idiome, comme on a coutume de le faire entendre. Les richesses d'une langue peuvent passer aisément dans une autre qui a avec elle quelque affinité ; et toutes les langues en ont plus ou moins, selon les différents degrés de liaison qu'il y a ou qu'il y a eu entre les peuples qui les parlent ou qui les ont parlées. Si l'italien, l'espagnol et le français sont entés sur une même langue originelle, ces trois langues auront apparemment chacune à part leurs idiotismes particuliers, parce que ce sont des langues différentes ; mais il est difficîle qu'elles n'aient adopté toutes trois quelques idiotismes de la langue qui sera leur source commune, et il ne serait pas étonnant de trouver dans toutes trois des celticismes. Il ne serait pas plus merveilleux de trouver des idiotismes de l'une des trois dans l'autre, à cause des liaisons de voisinage, d'intérêts politiques, de commerce, de religion, qui subsistent depuis longtemps entre les peuples qui les parlent ; comme on n'est pas surpris de rencontrer des arabismes dans l'espagnol, quand on sait l'histoire de la longue domination des Arabes en Espagne. Personne n'ignore que les meilleurs auteurs de la latinité sont pleins d'hellénismes : et si tous les littérateurs conviennent qu'il est plus facîle de traduire du grec que du latin en français, c'est que le génie de notre langue approche plus de celui de la langue grecque que de celui de la langue latine, et que notre langage est presque un hellénisme continuel.
Mais une preuve remarquable de la communicabilité des langues qui paraissent avoir entr'elles le moins d'affinité, c'est qu'en français même nous hébraïsons. C'est un hébraïsme connu que la répétition d'un adjectif ou d'un adverbe, que l'on veut élever au sens que l'on nomme communément superlatif. Voyez AMEN et SUPERLATIF. Et le superlatif le plus énergique se marquait en hébreu par la triple répétition du mot : de là le triple kirie eleison que nous chantons dans nos églises, pour donner plus de force à notre invocation ; et le triple sanctus pour mieux peindre la profonde adoration des esprits célestes. Or il est vraisemblable que notre très, formé du latin tres, n'a été introduit dans notre langue, que comme le symbole de cette triple répétition, très-saint, ter sanctus, ou sanctus, sanctus, sanctus : et notre usage de lier très au mot positif par un tiret, est fondé sans-doute sur l'intention de faire sentir que cette addition est purement matérielle, qu'elle n'empêche pas l'unité du mot, mais qu'il doit être répété trois fais, ou du-moins qu'il faut y attacher le sens qu'il aurait s'il était répété trois fois ; et en effet les adverbes bien et fort qui expriment par eux-mêmes le sens superlatif dont il s'agit, ne sont jamais liés de même au mot positif auquel on les joint pour le lui communiquer. On rencontre dans le langage populaire des hébraïsmes d'une autre espèce : un homme de Dieu, du vin de Dieu, une moisson de Dieu, pour dire un très-honnête homme, du vin très-bon, une moisson très-abondante ; ou, en rendant par-tout le même sens par le même tour, un homme parfait, du vin parfait, une moisson parfaite : les Hébreux indiquant la perfection par le nom de Dieu, qui est le modèle et la source de toute perfection. C'est cette espèce d'hébraïsme qui se trouve au Psaumes 35. Ve 7. justitia tua sicut montes Dei, pour sicut montes altissimi ; et au Psaumes 64. Ve 10. flumen Dei, pour flumen maximum.
Malgré les hellénismes reconnus dans le latin, on a cru assez légérement que les idiotismes étaient des locutions propres et incommunicables, et en conséquence on a pris et donné des idées fausses ou louches ; et bien des gens craient encore qu'on ne désigne par ce nom général, ou par quelqu'un des noms spécifiques qui y sont analogues, que des locutions vicieuses imitées mal-adroitement de quelqu'autre langue. Voyez GALLICISME. C'est une erreur que je crois suffisamment détruite par les observations que je viens de mettre sous les yeux du lecteur : je passe à une autre qui est encore plus universelle, et qui n'est pas moins contraire à la véritable notion des idiotismes.
On donne communément à entendre que ce sont des manières de parler contraires aux lois de la Grammaire générale. Il y a en effet des idiotismes qui sont dans ce cas ; et comme ils sont par-là même les plus frappans et les plus aisés à distinguer, on a cru aisément que cette opposition aux lois immuables de la Grammaire, faisait la nature commune de tous. Mais il y a encore une autre espèce d'idiotismes qui sont des façons de parler éloignées seulement des usages ordinaires, mais qui ont avec les principes fondamentaux de la Grammaire générale toute la conformité exigible. On peut donner à ceux-ci le nom d'idiotismes réguliers, parce que les règles immuables de la parole y sont suivies, et qu'il n'y a de violé que les institutions arbitraires et usuelles : les autres au contraire prendront la dénomination d'idiotismes irréguliers, parce que les règles immuables de la parole y sont violées. Ces deux espèces sont comprises dans la définition que j'ai donnée d'abord ; et je vais bientôt les rendre sensibles par des exemples ; mais en y appliquant les principes qu'il convient de suivre pour en pénétrer le sens, et pour y découvrir, s'il est possible, les caractères du génie propre de la langue qui les a introduits.
I. Les idiotismes réguliers n'ont besoin d'aucune autre attention, que d'être expliqués littéralement pour être ramenés ensuite au tour de la langue naturelle que l'on parle.
Je trouve par exemple que les Allemands disent, dièse gelehrten männer, comme en latin, hi docti viri, ou en français, ces savants hommes ; et l'adjectif gelehrten s'accorde en toutes manières avec le nom männer, comme l'adjectif latin docti avec le nom viri, ou l'adjectif français savants avec le nom hommes ; ainsi les Allemands observent en cela, et les lois générales et les usages communs. Mais ils disent, dièse männer sind gelehrt ; et pour le rendre littéralement en latin, il faut dire hi viri sunt doctè, et en français, ces hommes sont savamment, ce qui veut dire indubitablement ces hommes sont savants : gelehrt est donc un adverbe, et l'on doit reconnaître ici que les Allemands s'écartent des usages communs, qui donnent la préférence à l'adjectif en pareil cas. On voit donc en quoi consiste le germanisme lorsqu'il s'agit d'exprimer un attribut ; mais quelle peut être la cause de cet idiotisme ? le verbe exprime l'existence d'un sujet sous un attribut. Voyez VERBE. L'attribut n'est qu'une manière particulière d'être ; et c'est aux adverbes à exprimer simplement les manières d'être, et conséquemment les attributs : voilà le génie allemand. Mais comment pourra-t-on concilier ce raisonnement avec l'usage presque universel, d'exprimer l'attribut par un adjectif mis en concordance avec le sujet du verbe ? Je réponds qu'il n'y a peut-être entre la manière commune et la manière allemande d'autre différence que celle qu'il y aurait entre deux tableaux, où l'on aurait saisi deux moments différents d'une même action : le germanisme saisit l'instant qui précède immédiatement l'acte de juger, où l'esprit considère encore l'attribut d'une manière vague et sans application au sujet : la phrase commune présente le sujet tel qu'il parait à l'esprit après le jugement, et lorsqu'il n'y a plus d'abstraction. L'Allemand doit donc exprimer l'attribut avec les apparences de l'indépendance ; et c'est ce qu'il fait par l'adverbe qui n'a aucune terminaison dont la concordance puisse en désigner l'application à quelque sujet déterminé. Les autres langues doivent exprimer l'attribut avec les caractères de l'application ; ce qui est rempli par la concordance de l'adjectif attributif avec le sujet. Mais peut-être faut-il sous-entendre alors le nom avant l'adjectif, et dire que hi viri sunt docti, c'est la même chose que hi viri sunt viri docti ; et que ego sum miser, c'est la même chose que ego sum homo miser : en effet la concordance de l'adjectif avec le nom, et l'identité du sujet exprimé par les deux espèces, ne s'entendent clairement et d'une manière satisfaisante, que dans le cas de l'apposition ; et l'apposition ne peut avoir lieu ici qu'au moyen de l'ellipse. Je tirerais de tout ceci une conclusion surprenante : la phrase allemande est donc un idiotisme régulier, et la phrase commune un idiotisme irrégulier.
Voici un latinisme régulier dont le développement peut encore amener des vues utiles : neminem reperire est id qui velit. Il y a là quatre mots qui n'ont rien d'embarrassant : qui velit id (qui veuille cela) est une proposition incidente déterminative de l'antécédent neminem ; neminem (ne personne) est le complément ou le régime objectif grammatical du verbe reperire ; neminem qui velit id (ne trouver personne qui veuille cela) ; c'est une construction exacte et régulière. Mais que faire du mot est ? il est à la troisième personne du singulier ; quel en est le sujet ? comment pourra-t-on lier à ce mot l'infinitif reperire avec ses dépendances ? Consultons d'autres phrases plus claires dont la solution puisse nous diriger.
On trouve dans Horace (III. Od. 2.) dulce et decorum est pro patriâ mori ; et encore (IV. Od. 12.) dulce est desipere in loco. Or la construction est facîle : mori pro patriâ est dulce et decorum ; desipere in loco est dulce : les infinitifs mori et desipere y sont traités comme des noms, et l'on peut les considérer comme tels : j'en trouve une preuve encore plus forte dans Perse, Sat. 1. scire tuum nihil est ; l'adjectif tuum mis en concordance avec scire, désigne bien que scire est considéré comme nom. Voilà la difficulté levée dans notre première phrase : le verbe reperire est ce que l'on appelle communément le nominatif du verbe est ; ou en termes plus justes, c'en est le sujet grammatical, qui serait au nominatif, s'il était déclinable : reperire neminem qui velit id, en est donc le sujet logique. Ainsi il faut construire, reperire neminem qui velit id, est ; ce qui signifie littéralement, ne trouver personne qui le veuille, est ou existe ; ou en transposant la négation, trouver quelqu'un qui le veuille, n'est pas ou n'existe pas ; ou enfin, en ramenant la même pensée à notre manière de l'énoncer, on ne trouve personne qui le veuille.
C'est la même syntaxe et la même construction par-tout où l'on trouve un infinitif employé comme sujet du verbe sum, lorsque ce verbe a le sens adjectif, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas simplement verbe substantif, mais qu'il renferme encore l'idée de l'existence réelle comme attribut, et conséquemment qu'il est équivalent à existo. Ce n'est que dans ce cas qu'il y a latinisme ; car il n'y a rien de si commun dans la plupart des langues, que de voir l'infinitif sujet du verbe substantif, quand on exprime ensuite un attribut déterminé : ainsi dit-on en latin turpe est mentiri, et en français, mentir est une chose honteuse. Mais nous ne pouvons pas dire voir est pour on voit, voir était pour on voyait, voir sera, pour on verra, comme les Latins disent videre est, videre erat, videre erit. L'infinitif considéré comme nom, sert aussi à expliquer une autre espèce de latinisme qu'il me semble qu'on n'a pas encore entendu comme il faut, et à l'explication duquel les rudiments ont substitué les difficultés ridicules et insolubles du redoutable que retranché. Voyez INFINITIF.
II. Pour ce qui regarde les idiotismes irréguliers, il faut, pour en pénétrer le sens, discerner avec soin l'espèce d'écart qui les détermine, et remonter, s'il est possible, jusqu'à la cause qui a occasionné ou pu occasionner cet écart : c'est même le seul moyen qu'il y ait de reconnaître les caractères précis du génie propre d'une langue, puisque ce génie ne consiste que dans la réunion des vues qu'il s'est proposées, et des moyens qu'il a autorisés.
Pour discerner exactement l'espèce d'écart qui détermine un idiotisme irrégulier, il faut se rappeler ce que l'on a dit au mot GRAMMAIRE, que toutes les règles fondamentales de cette science se réduisent à deux chefs principaux, qui sont la Lexicologie et la Syntaxe. La Lexicologie a pour objet tout ce qui concerne la connaissance des mots considérés en soi et hors de l'élocution : ainsi dans chaque langue, le vocabulaire est comme l'inventaire des sujets de son domaine ; et son principal office est de bien fixer le sens propre de chacun des mots autorisés dans cet idiome. La Syntaxe a pour objet tout ce qui concerne le concours des mots réunis dans l'ensemble de l'élocution ; et ses décisions se rapportent dans toutes les langues à trois points généraux, qui sont la concordance, le régime et la construction.
Si l'usage particulier d'une langue autorise l'altération du sens propre de quelques mots, et la substitution d'un sens étranger, c'est alors une figure de mots que l'on appelle trope. Voyez ce mot.
Si l'usage autorise une locution contraire aux lois générales de la Syntaxe, c'est alors une figure que l'on nomme ordinairement figure de construction, mais que j'aimerais mieux que l'on designât par la dénomination plus générale de figure de Syntaxe, en réservant le nom de figure de construction aux seules locutions qui s'écartent des règles de la construction proprement dite. Voyez FIGURE et CONSTRUCTION. Voilà deux espèces d'écart que l'on peut observer dans les idiotismes irréguliers.
1°. Lorsqu'un trope est tellement dans le génie d'une langue, qu'il ne peut être rendu littéralement dans une autre, ou qu'y étant rendu littéralement il y exprime un tout autre sens, c'est un idiotisme de la langue originale qui l'a adopté ; et cet idiotisme est irrégulier, parce que le sens propre des mots y est abandonné ; ce qui est contraire à la première institution des mots. Ainsi le superstitieux euphémisme, qui dans la langue latine a donné le sens de sacrifier au verbe mactare, quoique ce mot signifie dans son étymologie augmenter davantage (magis auctare) ; cet euphémisme, dis-je, est tellement propre au génie de cette langue, que la traduction littérale que l'on en ferait dans une autre, ne pourrait jamais y faire naître l'idée de sacrifice. Voyez EUPHEMISME.
C'est pareillement un trope qui a introduit dans notre langue ces idiotismes déjà remarqués au mot GALLICISME, dans lesquels on emploie les deux verbes venir et aller, pour exprimer par l'un des prétérits prochains, et par l'autre des futurs prochains (voyez TEMS) ; comme quand on dit, je viens de lire, je venais de lire, pour j'ai ou j'avais lu depuis peu de temps ; je vais lire, j'allais lire, pour je dais, ou je devais lire dans peu de temps. Les deux verbes auxiliaires venir et aller perdent alors leur signification originelle, et ne marquent plus le transport d'un lieu en un autre ; ils ne servent plus qu'à marquer la proximité de l'antériorité ou de la postériorité ; et nos phrases rendues littéralement dans quelqu'autre langue, ou n'y signifieraient rien, ou y signifieraient autre chose que parmi nous. C'est une catachrèse introduite par la nécessité (voyez CATACHRESE), et fondée néanmoins sur quelque analogie entre le sens propre et le sens figuré. Le verbe venir, par exemple, suppose une existence antérieure dans le lieu d'où l'on vient ; et dans le moment qu'on en vient, il n'y a pas longtemps qu'on y était : voilà précisément la raison du choix de ce verbe, pour servir à l'expression des prétérits prochains. Pareillement le verbe aller indique la postériorité d'existence dans le lieu où l'on Ve ; et dans le temps qu'on y va, on est dans l'intention d'y être bientôt : voilà encore la justification de la préférence donnée à ce verbe, pour désigner les futurs prochains. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ces verbes, devenus auxiliaires, perdent réellement leur signification primitive et fondamentale, et qu'ils n'en retiennent que des idées accessoires et éloignées.
2°. Ce que l'on vient de dire des tropes, est également vrai des figures de Syntaxe : telle figure est un idiotisme irrégulier, parce qu'elle ne peut être rendue littéralement dans une autre langue, ou que la version littérale qui en serait faite, y aurait un autre sens. Ainsi l'usage où nous sommes, dans la langue française, d'employer l'adjectif possessif masculin, mon, ton, son, avant un nom féminin qui commence par une voyelle ou par une h muette, est un idiotisme irrégulier de notre langue, un gallicisme ; parce que l'imitation littérale de cette figure dans une autre langue n'y serait qu'un solécisme. Nous disons mon âme, et l'on ne dirait pas meus anima ; ton opinion, et l'on ne peut pas dire tuus opinio : c'est que les Latins avaient pour éviter l'hiatus occasionné par le concours des voyelles, des moyens qui nous sont interdits par la constitution de notre langue, et dont il était plus raisonnable de faire usage ; que de violer une loi aussi essentielle que celle de la concordance que nous transgressons : ils pouvaient dire anima mea, opinio tua ; et nous ne pouvons pas imiter ce tour, et dire âme ma, opinion ta. Notre langue sacrifie donc ici un principe raisonnable aux agréments de l'euphonie (voyez EUPHONIE), conformément à la remarque sensée de Cicéron, Orat. n. 47 : impetratum est à consuetudine ut peccare, suavitatis causâ, liceret.
Voici une ellipse qui est devenue une locution propre à notre langue, un gallicisme, parce que l'usage en a prévalu au point qu'il n'est plus permis de suivre en pareil cas la Syntaxe pleine : il ne laisse pas d'agir, notre langue ne laisse pas de se prêter à tous les genres d'écrire, on ne laisse pas d'abandonner la vertu en la louant, c'est-à-dire il ne laisse pas le soin d'agir, notre langue ne laisse pas la faculté de se prêter à tous les genres d'écrire, on ne laisse pas la faiblesse d'abandonner la vertu en la louant. Nous préférons dans ces phrases le mérite de la briéveté à une locution pleine, qui sans avoir plus de clarté, aurait le désagrément inséparable des longueurs superflues.
S'il est facîle de ramener à un nombre fixe de chefs principaux les écarts qui déterminent les différents idiotismes, il n'en est pas de même de vues particulières qui peuvent y influer : la variété de ces causes est trop grande, l'influence en est trop délicate, la complication en est quelquefois trop embarrassante pour pouvoir établir à ce sujet quelque chose de bien certain. Mais il n'en est pas moins constant qu'elles tiennent toutes, plus ou moins, au génie des diverses langues, qu'elles en sont des émanations, et qu'elles peuvent en devenir des indices. " Il en est des peuples entiers comme d'un homme particulier, dit du Tremblay, traité des langues, chap. 22 ; leur langage est la vive expression de leurs mœurs, de leur génie et de leurs inclinations ; et il ne faudrait que bien examiner ce langage pour pénétrer toutes les pensées de leur âme et tous les mouvements de leur cœur. Chaque langue doit donc nécessairement tenir des perfections et des défauts du peuple qui la parle. Elles auront chacune en particulier, disait-il un peu plus haut, quelque perfection qui ne se trouvera pas dans les autres, parce qu'elles tiennent toutes des mœurs et du génie des peuples qui les parlent : elles auront chacune des termes et des façons de parler qui leur seront propres, et qui seront comme le caractère de ce génie ". On reconnait en effet le flegme oriental dans la répétition de l'adjectif ou de l'adverbe ; amen, amen ; sanctus, sanctus, sanctus : la vivacité française n'a pu s'en accommoder, et très-saint est bien plus à son gré que saint, saint, saint.
Mais si l'on veut démêler dans les idiotismes réguliers ou irréguliers, ce que le génie particulier de la langue peut y avoir contribué, la première chose essentielle qu'il y ait à faire, c'est de s'assurer d'une bonne interprétation littérale. Elle suppose deux choses ; la traduction rigoureuse de chaque mot par sa signification propre, et la réduction de toute la phrase à la plénitude de la construction analytique, qui seule peut remplir les vides de l'ellipse, corriger les rédondances du pléonasme, redresser les écarts de l'inversion, et faire rentrer tout dans le système invariable de la Grammaire générale.
" Je sais bien, dit M. du Marsais, Meth. pour apprendre la langue latine, pag. 14, que cette traduction littérale fait d'abord de la peine à ceux qui n'en connaissent point le motif ; ils ne voient pas que le but que l'on se propose dans cette manière de traduire, n'est que de montrer comment on parlait latin ; ce qui ne peut se faire qu'en expliquant chaque mot latin par le mot français qui lui répond.
Dans les premières années de notre enfance, nous lions certaines idées à certaines impressions ; l'habitude confirme cette liaison. Les esprits animaux prennent une route déterminée pour chaque idée particulière ; de sorte que lorsqu'on veut dans la suite exciter la même idée d'une manière différente, on cause dans le cerveau un mouvement contraire à celui auquel il est accoutumé, et ce mouvement excite ou de la surprise ou de la risée, et quelquefois même de la douleur : c'est pourquoi chaque peuple différent trouve extraordinaire l'habillement ou le langage d'un autre peuple. On rit à Florence de la manière dont un François prononce le latin ou l'italien, et l'on se moque à Paris de la prononciation du Florentin. De même la plupart de ceux qui entendent traduire pater ejus, le père de lui, au lieu de son père, sont d'abord portés à se moquer de la traduction.
Cependant comme la manière la plus courte pour faire entendre la façon de s'habiller des étrangers, c'est de faire voir leurs habits tels qu'ils sont, et non pas d'habiller un étranger à la française ; de même la meilleure méthode pour apprendre les langues étrangères, c'est de s'instruire du tour original, ce qu'on ne peut faire que par la traduction littérale.
Au reste il n'y a pas lieu de craindre que cette façon d'expliquer apprenne à mal parler français.
1°. Plus on a l'esprit juste et net, mieux on écrit et mieux on parle : or il n'y a rien qui soit plus propre à donner aux jeunes gens de la netteté et de la justesse d'esprit, que de les exercer à la traduction littérale, parce qu'elle oblige à la précision, à la propriété des termes, et à une certaine exactitude qui empêche l'esprit de s'égarer à des idées étrangères. "
2°. La traduction littérale fait sentir la différence des deux langues. Plus le tour latin est éloigné du tour français, moins on doit craindre qu'on l'imite dans le discours. Elle fait connaître le génie de la langue latine ; ensuite l'usage, mieux que le maître, apprend le tour de la langue française. Article de M. de Beauzée.