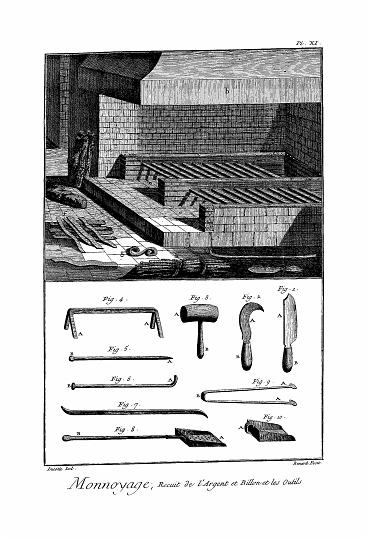S. m. (Jurisprudence) est celui qui représente une personne du chef de laquelle il est héritier. Voyez REPRESENTATION. (A)
REPRESENTANS, (Droit politiq. hist. moderne) Les représentants d'une nation sont des citoyens choisis, qui dans un gouvernement tempéré sont chargés par la société de parler en son nom, de stipuler ses intérêts, d'empêcher qu'on ne l'opprime, de concourir à l'administration.
Dans un état despotique, le chef de la nation est tout, la nation n'est rien ; la volonté d'un seul fait la loi, la société n'est point représentée. Telle est la forme du gouvernement en Asie, dont les habitants soumis depuis un grand nombre de siècles à un esclavage héréditaire, n'ont point imaginé de moyens pour balancer un pouvoir énorme qui sans cesse les écrase. Il n'en fut pas de même en Europe, dont les habitants plus robustes, plus laborieux, plus belliqueux que les Asiatiques, sentirent de tout temps l'utilité et la nécessité qu'une nation fût représentée par quelques citoyens qui parlassent au nom de tous les autres, et qui s'opposassent aux entreprises d'un pouvoir qui devient souvent abusif lorsqu'il ne connait aucun frein. Les citoyens choisis pour être les organes, ou les représentants de la nation, suivant les différents temps, les différentes conventions et les circonstances diverses, jouirent de prérogatives et de droits plus ou moins étendus. Telle est l'origine de ces assemblées connues sous le nom de dietes, d'états-généraux, de parlements, de senats, qui presque dans tous les pays de l'Europe participèrent à l'administration publique, approuvèrent ou rejettèrent les propositions des souverains, et furent admis à concerter avec eux les mesures nécessaires au maintien de l'état.
Dans un état purement démocratique la nation, à proprement parler, n'est point représentée ; le peuple entier se réserve le droit de faire connaître ses volontés dans les assemblées générales, composées de tous les citoyens ; mais dès que le peuple a choisi des magistrats qu'il a rendus dépositaires de son autorité, ces magistrats deviennent ses représentants ; et suivant le plus ou le moins de pouvoir que le peuple s'est réservé, le gouvernement devient ou une aristocratie, ou demeure une démocratie.
Dans une monarchie absolue le souverain ou jouit, du consentement de son peuple, du droit d'être l'unique représentant de sa nation, ou bien, contre son gré, il s'arroge ce droit. Le souverain parle alors au nom de tous ; les lois qu'il fait sont, ou du moins sont censées l'expression des volontés de toute la nation qu'il représente.
Dans les monarchies tempérées, le souverain n'est dépositaire que de la puissance exécutrice, il ne représente sa nation qu'en cette partie, elle choisit d'autres représentants pour les autres branches de l'administration. C'est ainsi qu'en Angleterre la puissance exécutrice réside dans la personne du monarque, tandis que la puissance législative est partagée entre lui et le parlement, c'est-à-dire l'assemblée générale des différents ordres de la nation britannique, composée du clergé, de la noblesse et des communes ; ces dernières sont représentées par un certain nombre de députés choisis par les villes, les bourgs et les provinces de la Grande-Bretagne. Par la constitution de ce pays, le parlement concourt avec le monarque à l'administration publique ; dès que ces deux puissances sont d'accord, la nation entière est reputée avoir parlé, et leurs décisions deviennent des lais.
En Suède, le monarque gouverne conjointement avec un sénat, qui n'est lui-même que le représentant de la diete générale du royaume ; celle-ci est l'assemblée de tous les représentants de la nation suédoise.
La nation germanique, dont l'empereur est le chef, est représentée par la diete de l'Empire, c'est-à-dire par un corps composé de vassaux souverains, ou de princes tant ecclésiastiques que laïques, et de députés des villes libres, qui représentent toute la nation allemande. Voyez DIETE DE L'EMPIRE.
La nation française fut autrefois représentée par l'assemblée des états-généraux du royaume, composée du clergé et de la noblesse, auxquels par la suite des temps on associa le tiers-état, destiné à représenter le peuple. Ces assemblées nationales ont été discontinuées depuis l'année 1628.
Tacite nous montre les anciennes nations de la Germanie, quoique féroces, belliqueuses et barbares, comme jouissant toutes d'un gouvernement libre ou tempéré. Le roi, ou le chef, proposait et persuadait, sans avoir le pouvoir de contraindre la nation à plier sous ses volontés : Ubi rex, vel princeps, audiuntur autoritate suadendi magis quam jubendi potestate. Les grands délibéraient entr'eux des affaires peu importantes ; mais toute la nation était consultée sur les grandes affaires : de minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes. Ce sont ces peuples guerriers ainsi gouvernés, qui, sortis des forêts de la Germanie, conquirent les Gaules, l'Espagne, l'Angleterre, etc. et fondèrent de nouveaux royaumes sur les débris de l'empire romain. Ils portèrent avec eux la forme de leur gouvernement ; il fut par-tout militaire, la nation subjuguée disparut ; réduite en esclavage, elle n'eut point le droit de parler pour elle-même ; elle n'eut pour représentants que les soldats conquérants, qui après l'avoir soumise par les armes, se subrogèrent en sa place.
Si l'on remonte à l'origine de tous nos gouvernements modernes, on les trouvera fondés par des nations belliqueuses et sauvages, qui sorties d'un climat rigoureux, cherchèrent à s'emparer de contrées plus fertiles, formèrent des établissements sous un ciel plus favorable, et pillèrent des nations riches et policées. Les anciens habitants de ces pays subjugués ne furent regardés par ces vainqueurs farouches, que comme un vil bétail que la victoire faisait tomber dans leurs mains. Ainsi les premières institutions de ces brigands heureux, ne furent pour l'ordinaire que des effets de la force accablant la faiblesse ; nous trouvons toujours leurs lois partiales pour les vainqueurs, et funestes aux vaincus. Voilà pourquoi dans toutes les monarchies modernes nous voyons partout les nobles, les grands, c'est-à-dire des guerriers, posséder les terres des anciens habitants, et se mettre en possession du droit exclusif de représenter les nations ; celles-ci avilies, écrasées, opprimées, n'eurent point la liberté de joindre leurs voix à celles de leurs superbes vainqueurs. Telle est sans doute la source de cette prétention de la noblesse, qui s'arrogea longtemps le droit de parler exclusivement à tous les autres au nom des nations ; elle continua toujours à regarder ses concitoyens comme des esclaves vaincus, même un grand nombre de siècles après une conquête à laquelle les successeurs de cette noblesse conquérante n'avait point eu de part. Mais l'intérêt secondé par la force, se fait bientôt des droits ; l'habitude rend les nations complices de leur propre avilissement, et les peuples malgré les changements survenus dans leurs circonstances, continuèrent en beaucoup de pays à être uniquement représentés par une noblesse, qui se prévalut toujours contre eux de la violence primitive, exercée par des conquérants aux droits desquels elle prétendit succéder.
Les Barbares qui démembrèrent l'empire romain en Europe étaient payens ; peu-à-peu ils furent éclairés des lumières de l'Evangile, ils adoptèrent la religion des vaincus. Plongés eux-mêmes dans une ignorance qu'une vie guerrière et agitée contribuait à entretenir, ils eurent besoin d'être guidés et retenus par des citoyens plus raisonnables qu'eux ; ils ne purent refuser leur vénération aux ministres de la religion, qui à des mœurs plus douces joignaient plus de lumières et de science. Les monarques et les nobles jusqu'alors représentants uniques des nations, consentirent donc qu'on appelât aux assemblées nationales les ministres de l'Eglise. Les rais, fatigués sans doute eux-mêmes des entreprises continuelles d'une noblesse trop puissante pour être soumise, sentirent qu'il était de leur intérêt propre de contrebalancer le pouvoir de leurs vassaux indomptés, par celui des interpretes d'une religion respectée par les peuples. D'ailleurs le clergé devenu possesseur de grands biens, fut intéressé à l'administration publique, et dut à ce titre, avoir part aux délibérations.
Sous le gouvernement féodal, la noblesse et le clergé eurent longtemps le droit exclusif de parler au nom de toute la nation, ou d'en être les uniques représentants. Le peuple composé des cultivateurs, des habitants des villes et des campagnes, des manufacturiers, en un mot, de la partie la plus nombreuse, la plus laborieuse, la plus utîle de la société, ne fut point en droit de parler pour lui-même ; il fut forcé de recevoir sans murmurer les lois que quelques grands concertèrent avec le souverain. Ainsi le peuple ne fut point écouté, il ne fut regardé que comme un vil amas de citoyens méprisables, indignes de joindre leurs voix à celles d'un petit nombre de seigneurs orgueilleux et ingrats, qui jouirent de leurs travaux sans s'imaginer leur rien devoir. Opprimer, piller, vexer impunément le peuple, sans que le chef de la nation put y porter remède, telles furent les prérogatives de la noblesse, dans lesquelles elle fit consister la liberté. En effet, le gouvernement féodal ne nous montre que des souverains sans forces, et des peuples écrasés et avilis par une aristocratie, armée également contre le monarque et la nation. Ce ne fut que lorsque les rois eurent longtemps souffert des excès d'une noblesse altière, et des entreprises d'un clergé trop riche et trop indépendant, qu'ils donnèrent quelque influence à la nation dans les assemblées qui décidaient de son sort. Ainsi la voix du peuple fut enfin entendue, les lois prirent de la vigueur, les excès des grands furent reprimés, ils furent forcés d'être justes envers des citoyens jusque-là méprisés ; le corps de la nation fut ainsi opposé à une noblesse mutine et intraitable.
La nécessité des circonstances oblige les idées et les institutions politiques de changer ; les mœurs s'adoucissent, l'iniquitté se nuit à elle-même ; les tyrants des peuples s'aperçoivent à la longue que leurs folies contrarient leurs propres intérêts ; le commerce et les manufactures deviennent des besoins pour les états, et demandent de la tranquillité ; les guerriers sont moins nécessaires ; les disettes et les famines fréquentes ont fait sentir à la fin le besoin d'une bonne culture, que troublaient les démélés sanglans de quelques brigands armés. L'on eut besoin de lois ; l'on respecta ceux qui en furent les interpretes, on les regarda comme les conservateurs de la sûreté publique ; ainsi le magistrat dans un état bien constitué devint un homme considéré, et plus capable de prononcer sur les droits des peuples, que des nobles ignorants et dépourvus d'équité eux-mêmes, qui ne connaissaient d'autres droits que l'épée, ou qui vendaient la justice à leurs vassaux.
Ce n'est que par des degrés lents et imperceptibles que les gouvernements prennent de l'assiette ; fondés d'abord par la force, ils ne peuvent pourtant se maintenir que par des lois équitables qui assurent les propriétés et les droits de chaque citoyen, et qui le mettent à couvert de l'oppression ; les hommes sont forcés à la fin de chercher dans l'équité, des remèdes contre leurs propres fureurs. Si la formation des gouvernements n'eut pas été pour l'ordinaire l'ouvrage de la violence et de la déraison, on eut senti qu'il ne peut y avoir de societé durable si les droits d'un chacun ne sont mis à l'abri de la puissance qui toujours veut abuser ; dans quelques mains que le pouvoir soit placé, il devient funeste s'il n'est contenu dans des bornes ; ni le souverain, ni aucun ordre de l'état ne peuvent exercer une autorité nuisible à la nation, s'il est vrai que tout gouvernement n'ait pour objet que le bien du peuple gouverné. La moindre réflexion eut donc suffi pour montrer qu'un monarque ne peut jouir d'une puissance véritable, s'il ne commande à des sujets heureux et réunis de volontés ; pour les rendre tels, il faut qu'il assure leurs possessions, qu'il les défende contre l'oppression, qu'il ne sacrifie jamais les intérêts de tous à ceux d'un petit nombre, et qu'il porte ses vues sur les besoins de tous les ordres dont son état est composé. Nul homme, quelles que soient ses lumières, n'est capable sans conseils, sans secours, de gouverner une nation entière ; nul ordre dans l'état ne peut avoir la capacité ou la volonté de connaître les besoins des autres ; ainsi le souverain impartial doit écouter les voix de tous ses sujets, il est également intéressé à les entendre et à remédier à leurs maux ; mais pour que les sujets s'expliquent sans tumulte, il convient qu'ils aient des représentants, c'est-à-dire des citoyens plus éclairés que les autres, plus intéressés à la chose, que leurs possessions attachent à la patrie, que leur position mette à portée de sentir les besoins de l'état, les abus qui s'introduisent, et les remèdes qu'il convient d'y porter.
Dans les états despotiques tels que la Turquie, la nation ne peut avoir de représentants ; on n'y voit point de noblesse, le despote n'a que des esclaves également vils à ses yeux ; il n'est point de justice, parce que la volonté du maître est l'unique loi ; le magistrat ne fait qu'exécuter ses ordres ; le commerce est opprimé, l'agriculture abandonnée, l'industrie anéantie, et personne ne songe à travailler, parce que personne n'est sur de jouir du fruit de ses travaux ; la nation entière réduite au silence, tombe dans l'inertie, ou ne s'explique que par des revoltes. Un sultan n'est soutenu que par une soldatesque effrenée, qui ne lui est elle-même soumise qu'autant qu'il lui permet de piller et d'opprimer le reste des sujets ; enfin souvent ses janissaires l'égorgent et disposent de son trône, sans que la nation s'intéresse à sa chute ou désapprouve le changement.
Il est donc de l'intérêt du souverain que sa nation soit représentée ; sa sûreté propre en dépend ; l'affection des peuples est le plus ferme rempart contre les attentats des méchants ; mais comment le souverain peut-il se concilier l'affection de son peuple, s'il n'entre dans ses besoins, s'il ne lui procure les avantages qu'il désire, s'il ne le protège contre les entreprises des puissants, s'il ne cherche à soulager ses maux ? Si la nation n'est point représentée, comment son chef peut-il être instruit de ces miseres de détail que du haut de son trône il ne voit jamais que dans l'éloignement, et que la flatterie cherche toujours à lui cacher ? Comment, sans connaître les ressources et les forces de son pays, le monarque pourrait-il se garantir d'en abuser ? Une nation privée du droit de se faire représenter, est à la merci des imprudents qui l'oppriment ; elle se détache de ses maîtres, elle espère que tout changement rendra son sort plus doux ; elle est souvent exposée à devenir l'instrument des passions de tout factieux qui lui promettra de la secourir. Un peuple qui souffre s'attache par instinct à quiconque a le courage de parler pour elle ; il se choisit tacitement des protecteurs et des représentants, il approuve les réclamations que l'on fait en son nom ; est-il poussé à bout ? il choisit souvent pour interpretes des ambitieux et des fourbes qui le séduisent, en lui persuadant qu'ils prennent en main sa cause, et qui renversent l'état sous prétexte de le défendre. Les Guises en France, les Cromwels en Angleterre, et tant d'autres séditieux, qui sous pretexte du bien public jetèrent leurs nations dans les plus affreuses convulsions, furent des représentants et des protecteurs de ce genre, également dangereux pour les souverains et les nations.
Pour maintenir le concert qui doit toujours subsister entre les souverains et leurs peuples, pour mettre les uns et les autres à couvert des attentats des mauvais citoyens, rien ne serait plus avantageux qu'une constitution qui permettrait à chaque ordre de citoyens de se faire représenter, de parler dans les assemblées qui ont le bien général pour objet. Ces assemblées, pour être utiles et justes, devraient être composées de ceux que leurs possessions rendent citoyens, et que leur état et leurs lumières mettent à portée de connaître les intérêts de la nation et les besoins des peuples ; en un mot c'est la propriété qui fait le citoyen ; tout homme qui possède dans l'état, est intéressé au bien de l'état, et quel que soit le rang que des conventions particulières lui assignent, c'est toujours comme propriétaire, c'est en raison de ses possessions qu'il doit parler, ou qu'il acquiert le droit de se faire représenter.
Dans les nations européennes, le clergé, que les donations des souverains et des peuples ont rendu propriétaire de grands biens, et qui par-là forme un corps de citoyens opulents et puissants, semble dès-lors avoir un droit acquis de parler ou de se faire représenter dans les assemblées nationales ; d'ailleurs la confiance des peuples le met à portée de voir de près ses besoins et de connaître ses vœux.
Le noble, par les possessions qui lient son sort à celui de la patrie, a sans doute le droit de parler ; s'il n'avait que des titres, il ne serait qu'un homme distingué par les conventions ; s'il n'était que guerrier, sa voix serait suspecte, son ambition et son intérêt plongeraient fréquemment la nation dans des guerres inutiles et nuisibles.
Le magistrat est citoyen en vertu de ses possessions ; mais ses fonctions en font un citoyen plus éclairé, à qui l'expérience fait connaître les avantages et les désavantages de la législation, les abus de la jurisprudence, les moyens d'y remédier. C'est la loi qui décide du bonheur des états.
Le commerce est aujourd'hui pour les états une source de force et de richesse ; le négociant s'enrichit en même temps que l'état qui favorise ses entreprises, il partage sans-cesse ses prospérités et ses revers ; il ne peut donc sans injustice être réduit au silence ; il est un citoyen utîle et capable de donner ses avis dans les conseils d'une nation dont il augmente l'aisance et le pouvoir.
Enfin le cultivateur, c'est-à-dire tout citoyen qui possède des terres, dont les travaux contribuent aux besoins de la société, qui fournit à sa subsistance, sur qui tombent les impôts, doit être représenté ; personne n'est plus que lui intéressé au bien public ; la terre est la base physique et politique d'un état, c'est sur le possesseur de la terre que retombent directement ou indirectement tous les avantages et les maux des nations ; c'est en proportion de ses possessions, que la voix du citoyen doit avoir du poids dans les assemblées nationales.
Tels sont les différents ordres dans lesquels les nations modernes se trouvent partagées ; comme tous concourent à leur manière au maintien de la république, tous doivent être écoutés ; la religion, la guerre, la justice, le commerce, l'agriculture, sont faits dans un état bien constitué pour se donner des secours mutuels ; le pouvoir souverain est destiné à tenir la balance entr'eux ; il empêchera qu'aucun ordre ne soit opprimé par un autre, ce qui arriverait infailliblement si un ordre unique avait le droit exclusif de stipuler pour tous.
Il n'est point, dit Edouard I, roi d'Angleterre, de règle plus équitable, que les choses qui intéressent tous, soient approuvées par tous, et que les dangers communs soient repoussés par des efforts communs. Si la constitution d'un état permettait à un ordre de citoyens de parler pour tous les autres, il s'introduirait bientôt une aristocratie sous laquelle les intérêts de la nation et du souverain seraient immolés à ceux de quelques hommes puissants, qui deviendraient immanquablement les tyrants du monarque et du peuple. Telle fut, comme on a vu, l'état de presque toutes les nations européennes sous le gouvernement féodal, c'est-à-dire, durant cette anarchie systématique des nobles, qui lièrent les mains des rois pour exercer impunément la licence sous le nom de liberté ; tel est encore aujourd'hui le gouvernement de la Pologne, où sous des rois trop faibles pour protéger les peuples, ceux-ci sont à la merci d'une noblesse fougueuse, qui ne met des entraves à la puissance souveraine que pour pouvoir impunément tyranniser la nation. Enfin tel sera toujours le sort d'un état dans lequel un ordre d'hommes devenu trop puissant, voudra représenter tous les autres.
Le noble ou le guerrier, le prêtre ou le magistrat, le commerçant, le manufacturier et le cultivateur, sont des hommes également nécessaires ; chacun d'eux sert à sa manière la grande famille dont il est membre ; tous sont enfants de l'état, le souverain doit entrer dans leurs besoins divers ; mais pour les connaître il faut qu'ils puissent se faire entendre, et pour se faire entendre sans tumulte, il faut que chaque classe ait le droit de choisir ses organes ou ses représentants ; pour que ceux-ci expriment le vœu de la nation, il faut que leurs intérêts soient indivisiblement unis aux siens par le lien des possessions. Comment un noble nourri dans les combats, connaitrait-il les intérêts d'une religion dont souvent il n'est que faiblement instruit, d'un commerce qu'il méprise, d'une agriculture qu'il dédaigne, d'une jurisprudence dont il n'a point d'idées ? Comment un magistrat, occupé du soin pénible de rendre la justice au peuple, de sonder les profondeurs de la jurisprudence, de se garantir des embuches de la ruse, et de démêler les pieges de la chicane, pourrait-il décider des affaires relatives à la guerre, utiles au commerce, aux manufactures, à l'agriculture ? Comment un clergé, dont l'attention est absorbée par des études et par des soins qui ont le ciel pour objet, pourrait-il juger de ce qui est le plus convenable à la navigation, à la guerre, à la jurisprudence ?
Un état n'est heureux, et son souverain n'est puissant, que lorsque tous les ordres de l'état se prêtent réciproquement la main : pour opérer un effet si salutaire, les chefs de la societé politique sont intéressés à maintenir entre les différentes classes de citoyens, un juste équilibre, qui empêche chacune d'entr'elles d'empiéter sur les autres. Toute autorité trop grande, mise entre les mains de quelques membres de la societé, s'établit aux dépens de la sûreté et du bien-être de tous ; les passions des hommes les mettent sans-cesse aux prises ; ce conflict ne sert qu'à leur donner de l'activité ; il ne nuit à l'état que lorsque la puissance souveraine oublie de tenir la balance, pour empêcher qu'une force n'entraîne toutes les autres. La voix d'une noblesse remuante, ambitieuse, qui ne respire que la guerre, doit être contrebalancée par celle d'autres citoyens, aux vues desquels la paix est bien plus nécessaire ; si les guerriers décidaient seuls du sort des empires, ils seraient perpétuellement en feu, et la nation succomberait même sous le poids de ses propres succès ; les lois seraient forcées de se taire, les terres demeureraient incultes, les campagnes seraient dépeuplées, en un mot on verrait renaître ces miseres qui pendant tant de siècles ont accompagné la licence des nobles sous le gouvernement féodal. Un commerce prépondérant ferait peut-être trop négliger la guerre ; l'état, pour s'enrichir, ne s'occuperait point assez du soin de sa sûreté, ou peut-être l'avidité le plongerait-il souvent dans des guerres qui frustreraient ses propres vues. Il n'est point dans un état d'objet indifférent et qui ne demande des hommes qui s'en occupent exclusivement ; nul ordre de citoyens n'est capable de stipuler pour tous ; s'il en avait le droit, bientôt il ne stipulerait que pour lui-même ; chaque classe doit être représentée par des hommes qui connaissent son état et ses besoins ; ces besoins ne sont bien connus que de ceux qui les sentent.
Les représentants supposent des constituans de qui leur pouvoir est émané, auxquels ils sont par conséquent subordonnés et dont ils ne sont que les organes. Quels que soient les usages ou les abus que le temps a pu introduire dans les gouvernements libres et tempérés, un représentant ne peut s'arroger le droit de faire parler à ses constituans un langage opposé à leurs intérêts ; les droits des constituans sont les droits de la nation, ils sont imprescriptibles et inaliénables ; pour peu que l'on consulte la raison, elle prouvera que les constituans peuvent en tout temps démentir, désavouer et révoquer les représentants qui les trahissent, qui abusent de leurs pleins pouvoirs contre eux-mêmes, ou qui renoncent pour eux à des droits inhérents à leur essence ; en un mot, les représentants d'un peuple libre ne peuvent point lui imposer un joug qui détruirait sa félicité ; nul homme n'acquiert le droit d'en représenter un autre malgré lui.
L'expérience nous montre que dans les pays qui se flattent de jouir de la plus grande liberté, ceux qui sont chargés de représenter les peuples, ne trahissent que trop souvent leurs intérêts, et livrent leurs constituans à l'avidité de ceux qui veulent les dépouiller. Une nation a raison de se défier de semblables représentants et de limiter leurs pouvoirs ; un ambitieux, un homme avide de richesses, un prodigue, un débauché, ne sont point faits pour représenter leurs concitoyens ; ils les vendront pour des titres, des honneurs, des emplois, et de l'argent, ils se croiront intéressés à leurs maux. Que sera-ce si ce commerce infâme semble s'autoriser par la conduite des constituans qui seront eux-mêmes vénaux ? Que sera-ce si ces constituans choisissent leurs représentants dans le tumulte et dans l'ivresse, ou, si négligeant la vertu, les lumières, les talents, ils ne donnent qu'au plus offrant le droit de stipuler leurs intérêts ? De pareils constituans invitent à les trahir ; ils perdent le droit de s'en plaindre, et leurs représentants leur fermeront la bouche en leur disant : je vous ai acheté bien chérement, et je vous vendrai le plus chérement que je pourrai.
Nul ordre de citoyens ne doit jouir pour toujours du droit de représenter la nation, il faut que de nouvelles élections rappellent aux représentants que c'est d'elle qu'ils tiennent leur pouvoir. Un corps dont les membres jouiraient sans interruption du droit de représenter l'état, en deviendrait bientôt le maître ou le tyran.
REPRÉSENTANT
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Morale
- Catégorie : Jurisprudence
- Affichages : 3472