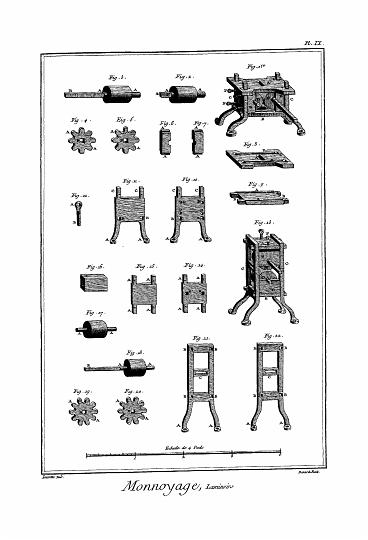(Jurisprudence) on entend par ce terme, les différentes formes dont on usait anciennement pour se justifier de quelque fait dont on était prévenu.
Il y avait deux sortes de purgation, celle qu'on appelait purgation vulgaire et la purgation canonique.
La purgation vulgaire consistait en des épreuves superstitieuses, par l'eau froide, par l'eau bouillante, par le feu, par le fer ardent, par le combat en champ clos, par la croix, l'eucharistie, et par le pain d'orge et le fromage de brebis ; l'ignorance et la crédulité des peuples fit introduire ces preuves, et les juges peu éclairés eux-mêmes les adoptèrent ; elles acquirent tant d'autorité, qu'on les appela jugements de Dieu. Voyez ci-devant COMBAT EN CHAMP CLOS, DUEL et EPREUVE.
La purgation canonique fut ainsi appelée, parce qu'elle était autorisée par les canons. Voyez l'article suivant.
PURGATION CANONIQUE, (Histoire moderne) cérémonie très-usitée depuis le huitième jusqu'au douzième siècle, pour se justifier, par serment, de quelqu'accusation en présence d'un nombre de personnes dignes de foi, qui affirmaient de leur côté, qu'ils croyaient le serment véritable.
On l'appelait purgation canonique, parce qu'elle se faisait suivant le droit canonique, et pour la distinguer de la purgation qui se faisait par le combat, ou par les épreuves de l'eau et du feu. Voyez COMBAT et ÉPREUVE.
" Le serment, dit M. Duclos, dans une dissertation sur ce sujet, se faisait de plusieurs manières. L'accusé, qu'on appelait jurator ou sacramentalis, prenant une poignée d'épis, les jetait en l'air, en attestant le ciel de son innocence. Quelquefois, une lance à la main, il déclarait qu'il était prêt à soutenir, par le fer, ce qu'il affirmait par serment ; mais l'usage le plus ordinaire, et celui qui seul subsista dans la suite, était celui de jurer sur un tombeau, sur des reliques, sur l'autel ou sur les évangiles.
Quand il s'agissait d'une accusation grave, formée par plusieurs témoins, mais dont le nombre était moindre que celui que la loi exigeait, ils ne pouvaient former qu'une présomption plus ou moins grande, suivant le nombre des accusateurs. Ce cas était d'autant plus fréquent, que la loi, pour convaincre un accusé, exigeait beaucoup de témoins. Il en fallait 72 contre un évêque, 40 contre un prêtre, plus ou moins contre un laïque, suivant la qualité de l'accusé, ou la gravité de l'accusation. Lorsque ce nombre n'était pas complet, l'accusé ne pouvait être condamné, mais il était obligé de présenter plusieurs personnes, où le juge les nommait d'office, et en fixait le nombre suivant celui des accusateurs, mais ordinairement à 12. Cum duodecim juret, dit une loi des anciens Bourguignons, cap. VIIIe ces témoins attestaient l'innocence de l'accusé, ou, ce qu'il est plus raisonnable de penser, certifiaient qu'ils le croyaient incapable du crime dont on l'accusait, et par-là formaient en sa faveur une présomption d'innocence, capable de détruire ou de balancer l'accusation intentée contre lui. On trouve dans l'histoire un exemple bien singulier d'un pareil serment.
Gontran, roi de Bourgogne, faisant difficulté de reconnaître Clotaire II. pour fils de Chilperic son frère, Frédégonde, mère de Clotaire, non-seulement jura que son fils était légitime, mais fit jurer la même chose par trois évêques, et trois cent autres témoins : Gontran n'hésita plus à reconnaître Clotaire pour son neveu.
Quelques lois exigeaient que dans une accusation d'adultère, l'accusée fit jurer avec elle des témoins de son sexe. On trouve aussi plusieurs occasions où l'accusateur pouvait présenter une partie des témoins qui devaient jurer avec l'accusé ; de façon cependant que celui-ci put en recuser deux de trois. Il parait d'abord contradictoire, qu'un accusé puisse fournir à son accusateur les témoins de son innocence. Pour résoudre cette difficulté, il suffit d'observer que les témoins qui s'unissaient au serment de l'accusé, juraient simplement qu'ils le croyaient innocent, et fortifiaient leur affirmation de motifs plus ou moins forts, suivant la confiance qu'ils avaient en sa probité. Ainsi l'accusateur exigeait que tels et tels qui étaient à portée de connaître les mœurs et le caractère de l'accusé fussent interrogés ; ou bien l'accusé étant sur de son innocence et de sa réputation, et dans des cas où son accusateur n'avait point de témoins, il le défiait d'en trouver, en se réservant toujours le droit de récusation.
Il est certain que la religion du serment était alors en grande vénération : on avait peine à supposer qu'on osât être parjure ; mais en louant ce sentiment, on ne saurait assez admirer, par quelles ridicules et basses pratiques on croyait pouvoir en éluder l'effet.
Le roi Robert voulant exiger un serment de ses sujets, et craignant aussi de les exposer au châtiment du parjure, les fit jurer sur une châsse sans reliques ; comme si le témoignage de la conscience n'était pas le véritable serment dont le reste n'est que l'appareil.
Quelquefois, malgré le serment, l'accusateur persistait dans son accusation : alors l'accusateur, pour preuve de la vérité, et l'accusé, pour preuve de son innocence, ou tous deux ensemble, demandaient le combat. Voyez COMBAT.
Lorsque dans les affaires douteuses, ajoute le même auteur, on déférait le serment à l'accusé, il n'y avait rien que de raisonnable et d'humain. Dans le risque de condamner un innocent, il était juste d'avoir recours à son affirmation, et de laisser à Dieu la vengeance du parjure. Cet usage subsiste encore parmi nous. Il est vrai que nous l'avons borné à des cas de peu d'importance, parce que notre propre dépravation nous ayant éclairé sur celle des autres, nous a fait connaître que la probité des hommes tient rarement contre de grands intérêts ". Mém. de l'Acad. tom. XVe
On n'appelle plus cette sorte de preuve en justice, purgation canonique, mais simplement preuve par le serment, ou affirmation ; et toute personne en est crue sur son affirmation, s'il n'y a point de titres ou de preuve testimoniale au contraire.
PURGATION
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Morale
- Catégorie : Jurisprudence
- Affichages : 1774