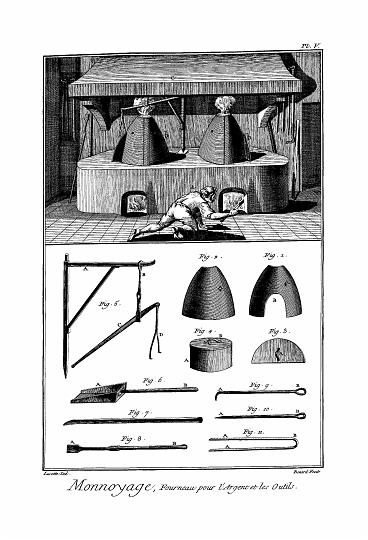S. f. (Droit politique et Morale) Une qualité essentielle des actions humaines est d'être susceptible d'imputation ; c'est-à-dire, que l'agent en peut être regardé avec raison comme le véritable auteur, que l'on peut les mettre sur son compte ; tellement que les effets bons ou mauvais qui en proviennent, lui seront justement attribués, et retomberont sur lui comme en étant la cause.
Il ne faut pas confondre l'imputabilité des actions humaines avec leur imputation actuelle. La première est une qualité de l'action ; la seconde est un acte du législateur, du juge, etc. qui met actuellement sur le compte de quelqu'un une action qui de sa nature peut être imputée.
L'imputation est donc proprement un jugement par lequel on déclare que quelqu'un étant l'auteur ou la cause morale d'une action commandée ou défendue par les lais, les effets bons ou mauvais qui s'ensuivent, doivent actuellement lui être attribués ; qu'en conséquence il en est responsable, et qu'il doit en être loué ou blâmé, récompensé ou puni.
Ce jugement d'imputation, aussi-bien que celui de la conscience, se fait en appliquant la loi à l'action dont il s'agit, en comparant l'une avec l'autre, pour prononcer ensuite sur le mérite du fait, et faire ressentir en conséquence à celui qui en est l'auteur, le bien ou le mal, la peine ou la récompense que la loi y a attaché. Tout cela suppose nécessairement une connaissance exacte de la loi et de son véritable sens, aussi-bien que du fait en question et de ses circonstances. Le défaut de ces circonstances ne pourrait que rendre l'application fausse et le jugement vicieux.
Pour bien établir les principes et les fondements de cette matière, il faut d'abord remarquer que l'on ne doit pas conclure de la seule imputabilité d'une action à son imputation actuelle. Afin qu'une action mérite d'être actuellement imputée, il faut le concours de ces deux conditions, 1°. qu'elle soit de nature à pouvoir l'être, et 2°. que l'agent soit dans quelque obligation de la faire ou de s'en abstenir. Un exemple rendra la chose sensible. De deux jeunes hommes que rien n'oblige d'ailleurs à savoir les Mathématiques, l'un s'applique à cette science, et l'autre ne le fait pas. Quoique l'action de l'un et l'omission de l'autre soient par elles-mêmes de nature à pouvoir être imputées, cependant elles ne le seront dans ce cas-ci, ni en bien, ni en mal. Mais si l'on suppose que ces deux jeunes hommes sont destinés, l'un à être conseiller d'état, l'autre à quelque emploi militaire : en ce cas, leur application ou leur négligence à s'instruire dans la Jurisprudence, ou dans les Mathématiques, leur serait méritoirement imputée ; d'où il parait que l'imputation actuelle demande qu'on soit dans l'obligation de faire quelque chose ou de s'en abstenir.
2°. Quand on impute une action à quelqu'un, on le rend, comme on l'a dit, responsable des suites bonnes ou mauvaises de l'action qu'il a faite. Il suit de-là que pour rendre l'imputation juste, il faut qu'il y ait quelque liaison nécessaire ou accidentelle entre ce que l'on a fait ou omis, et les suites bonnes ou mauvaises de l'action ou de l'omission ; et que d'ailleurs l'agent ait eu connaissance de cette liaison, ou que du moins il ait pu prévoir les effets de son action avec quelque vraisemblance. Sans cela, l'imputation ne saurait avoir lieu, comme on le sentira par quelques exemples. Un armurier vend des armes à un homme fait qui lui parait en son bon sens, de sang froid, et n'avoir aucun mauvais dessein. Cependant cet homme Ve sur le champ attaquer quelqu'un injustement, et il le tue. On ne saurait rien imputer à l'armurier, qui n'a fait que ce qu'il avait droit de faire, et qui d'ailleurs ne pouvait ni ne devait prévoir ce qui est arrivé. Mais si quelqu'un laissait par négligence des pistolets chargés sur la table, dans un lieu exposé à tout le monde ; et qu'un enfant qui ne connait pas le danger, se blesse ou se tue ; le premier est certainement responsable du malheur qui est arrivé ; car c'était une suite claire et prochaine de ce qu'il a fait, et il pouvait et devait le prévoir.
Il faut raisonner de la même manière à l'égard d'une action qui a produit quelque bien : ce bien ne peut nous être attribué, lorsqu'on en a été la cause sans le savoir et sans y penser ; mais aussi il n'est pas nécessaire, pour qu'on nous en sache quelque gré, que nous eussions une certitude entière du succès : il suffit que l'on ait eu lieu de le présumer raisonnablement ; et quand l'effet manquerait absolument, l'intention n'en serait pas moins louable.
L'imputation est simple ou efficace. Quelquefois l'imputation se borne simplement à la louange ou au blâme ; quelquefois elle Ve plus loin. C'est ce qui donne lieu de distinguer deux sortes d'imputation, l'une simple, l'autre efficace. La première est celle qui consiste seulement à approuver ou à désapprouver l'action, en sorte qu'il n'en résulte aucun autre effet par rapport à l'agent. Mais la seconde ne se borne pas au blâme ou à la louange ; elle produit encore quelque effet bon ou mauvais à l'égard de l'agent, c'est-à-dire, quelque bien ou quelque mal réel qui retombe sur lui.
Effets de l'une et de l'autre. L'imputation simple peut être faite indifféremment par chacun, soit qu'il ait ou qu'il n'ait pas un intérêt particulier et personnel à ce que l'action fut faite ou non : il suffit d'y avoir un intérêt général et indirect. Et comme l'on peut dire que tous les membres de la société sont intéressés à ce que les lois naturelles soient bien observées, ils sont tous en droit de louer ou de blâmer les actions d'autrui, selon qu'elles sont conformes ou opposées à ces lais. Ils sont même dans une sorte d'obligation à cet égard ; le respect qu'ils doivent au legislateur et à ses lois l'exige d'eux ; et ils manqueraient à ce qu'ils doivent à la société et aux particuliers, s'ils ne témoignaient pas, du moins par leur approbation ou leur désaveu, l'estime qu'ils font de la probité et de la vertu, et l'aversion qu'ils ont au contraire pour la méchanceté et pour le crime.
Mais à l'égard de l'imputation efficace, il faut, pour la pouvoir faire légitimement, que l'on ait un intérêt particulier et direct à ce que l'action dont il s'agit se fasse ou ne se fasse pas. Or ceux qui ont un tel intérêt, ce sont 1°. ceux à qui il appartient de régler l'action ; 2°. ceux qui en sont l'objet, c'est-à-dire, ceux envers lesquels on agit, et à l'avantage ou au désavantage desquels la chose peut tourner. Ainsi un souverain qui a établit des lais, qui ordonne certaines choses sous la promesse de quelque récompense, et qui en défend d'autres sous la menace de quelque peine, doit sans-doute s'intéresser à l'observation de ses lais, et il est en droit d'imputer à ses sujets leurs actions d'une manière efficace, c'est-à-dire, de les récompenser ou de les punir. Il en est de même de celui qui a reçu quelque injure ou quelque dommage par une action d'autrui.
Remarquons, enfin, qu'il y a quelque différence entre l'imputation des bonnes et des mauvaises actions. Lorsque le législateur a établi une certaine récompense pour une bonne action, il s'oblige par cela même à donner cette récompense, et il accorde le droit de l'exiger à ceux qui s'en sont rendus dignes par leur obéissance ; mais à l'égard des peines décernées pour les actions mauvaises, le législateur peut effectivement les infliger, s'il le veut ; mais il ne s'ensuit pas de-là que le souverain soit obligé de punir à la rigueur : il demeure toujours le maître d'user de son droit ou de faire grâce, et il peut avoir de bonnes raisons de faire l'un ou l'autre.
Application des principes précédents. 1°. Il suit de ce que nous avons dit, que l'on impute avec raison à quelqu'un toute action ou omission, dont il est l'auteur ou la cause, et qu'il pouvait et devait faire ou omettre.
2 °. Les actions de ceux qui n'ont pas l'usage de la raison ne doivent point leur être imputées. Car ces personnes n'étant pas en état de savoir ce qu'elles font, ni de le comparer avec les lais, leurs actions ne sont pas proprement des actions humaines, et n'ont point de moralité. Si l'on gronde ou si l'on bat un enfant, ce n'est point en forme de peine ; ce sont de simples corrections, par lesquelles on se propose principalement d'empêcher qu'il ne contracte de mauvaises habitudes.
3°. A l'égard de ce qui est fait dans l'ivresse, toute ivresse contractée volontairement, n'empêche point l'imputation d'une mauvaise action commise dans cet état.
4°. L'on n'impute à personne les choses qui sont véritablement au-dessus de ses forces, non plus que l'omission d'une chose ordonnée si l'occasion a manqué : car l'imputation d'une omission suppose manifestement ces deux choses, 1°. que l'on ait eu les forces et les moyens nécessaires pour agir ; 2°. que l'on ait pu faire usage de ces moyens sans préjudice de quelqu'autre devoir plus indispensable. Bien entendu que l'on ne se soit pas mis par sa faute dans l'impuissance d'agir : car alors le législateur pourrait aussi légitimement punir ceux qui se sont mis dans une telle impuissance que si étant en état d'agir ils refusaient de le faire. Tel était à Rome le cas de ceux qui se coupaient le pouce, pour se mettre hors d'état de manier les armes, et pour se dispenser d'aller à la guerre.
A l'égard des choses faites par ignorance ou par erreur, on peut dire en général que l'on n'est point responsable de ce que l'on fait par une ignorance invincible, etc. Voyez IGNORANCE.
Quoique le tempérament, les habitudes et les passions aient par eux-mêmes une grande force pour déterminer à certaines actions ; cette force n'est pourtant pas telle qu'elle empêche absolument l'usage de la raison et de la liberté, du moins quant à l'exécution des mauvais desseins qu'ils inspirent. Les dispositions naturelles, les habitudes et les passions ne portent point invinciblement les hommes à violer les lois naturelles, et ces maladies de l'âme ne sont point incurables. Que si au lieu de travailler à corriger ces dispositions vicieuses, on les fortifie par l'habitude, l'on ne devient pas excusable pour cela. Le pouvoir des habitudes est, à la vérité, fort grand ; il semble même qu'elles nous entraînent par une espèce de nécessité à faire certaines choses. Cependant l'expérience montre qu'il n'est point impossible de s'en défaire, si on le veut sérieusement ; et quand même il serait vrai que les habitudes bien formées auraient sur nous plus d'empire que la raison ; comme il dépendait toujours de nous de ne pas les contracter, elles ne diminuent en rien le vice des actions mauvaises, et ne sauraient en empêcher l'imputation. Au contraire, comme l'habitude à faire le bien rend les actions plus louables, l'habitude au vice ne peut qu'augmenter le blâme. En un mot, si les inclinations, les passions et les habitudes pouvaient empêcher l'effet des lais, il ne faudrait plus parler d'aucune direction pour les actions humaines ; car le principal objet des lois en général est de corriger les mauvais penchans, de prévenir les habitudes vicieuses, d'en empêcher les effets, et de déraciner les passions, ou du moins de les contenir dans leurs justes bornes.
Les différents cas que nous avons parcourus jusqu'ici n'ont rien de bien difficile. Il en reste quelques autres un peu plus embarrassants, et qui demandent une discussion un peu plus détaillée.
Premièrement on demande ce qu'il faut penser des actions auxquelles on est forcé ; sont-elles de nature à pouvoir être imputées, et doivent-elles l'être effectivement ?
Je réponds, 1°. qu'une violence physique, et telle qu'il est absolument impossible d'y résister, produit une action involontaire, qui bien-loin de mériter d'être actuellement imputée, n'est pas même imputable de sa nature.
2°. Mais si la contrainte est produite par la crainte de quelque grand mal, il faut dire que l'action à laquelle on se porte en conséquence, ne laisse pas d'être volontaire, et que par conséquent elle est de nature à pouvoir être imputée.
Pour connaître ensuite si elle doit l'être effectivement, il faut voir si celui envers qui on use de contrainte est dans l'obligation rigoureuse de faire une chose ou de s'en abstenir, au hasard de souffrir le mal dont il est menacé. Si cela est, et qu'il se détermine contre son devoir, la contrainte n'est point une raison suffisante pour le mettre à couvert de toute imputation ; car en général, on ne saurait douter qu'un supérieur légitime ne puisse nous mettre dans la nécessité d'obéir à ses ordres, au hasard d'en souffrir, et même au péril de notre vie.
En suivant ces principes, il faut donc distinguer ici entre les actions indifférentes (voyez l'article MORALITE) et celles qui sont moralement nécessaires. Une action indifférente de sa nature, extorquée par la force, ne saurait être imputée à celui qui y a été contraint, puisque n'étant dans aucune obligation à cet égard, l'auteur de la violence n'a aucun droit d'exiger rien de lui. Et la loi naturelle défendant formellement toute violence, ne saurait en même temps l'autoriser, en mettant celui qui la souffre dans la nécessité d'exécuter ce à quoi il n'a consenti que par force. C'est ainsi que toute promesse ou toute convention forcée est nulle par elle-même, et n'a rien d'obligatoire en qualité de promesse ou de convention ; au contraire elle peut et elle doit être imputée comme un crime à celui qui est auteur de la violence. Mais si l'on suppose que celui qui emploie la contrainte ne fait en cela qu'user de son droit et en poursuivre l'exécution, l'action, quoique forcée, ne laisse pas d'être valable, et d'être accompagnée de tous ses effets moraux. C'est ainsi qu'un débiteur fuyant, ou de mauvaise foi, qui ne satisfait son créancier que par la crainte prochaine de l'emprisonnement ou de quelque exécution sur ses biens, ne saurait réclamer contre le payement qu'il a fait, comme y ayant été forcé.
Pour ce qui est des bonnes actions auxquelles on ne se détermine que par force, &, pour ainsi dire, par la crainte des coups ; elles ne sont comptées pour rien, et ne méritent ni louange ni récompense. L'on en voit aisément la raison. L'obéissance que les lois exigent de nous doit être sincère, et il faut s'acquitter de ses devoirs par principe de conscience, volontairement et de bon cœur.
Enfin à l'égard des actions manifestement mauvaises et criminelles, auxquelles on se trouve forcé par la crainte de quelque grand mal, et surtout de la mort ; il faut poser pour règle générale, que les circonstances fâcheuses où l'on se rencontre, peuvent bien diminuer le crime de celui qui succombe à cette épreuve ; mais néanmoins l'action demeure toujours vicieuse en elle-même, et digne de reproche ; en conséquence de quoi elle peut être imputée, et elle l'est effectivement, à moins que l'on n'allegue en sa faveur l'exception de la nécessité. Une personne qui se détermine par la crainte de quelque grand mal, mais pourtant sans aucune violence physique, à exécuter une action visiblement mauvaise, concourt en quelque manière à l'action, et agit volontairement, quoiqu'avec regret. D'ailleurs il n'est point absolument au-dessus de la fermeté de l'esprit humain, de se résoudre à souffrir et même à mourir, plutôt que de manquer à son devoir. Le législateur peut donc imposer l'obligation rigoureuse d'obéir, et il peut avoir de justes raisons de le faire. Les nations civilisées n'ont jamais mis en question si l'on pouvait, par exemple, trahir sa patrie pour conserver sa vie. Plusieurs moralistes payens ont fortement soutenu qu'il ne fallait pas céder à la crainte des douleurs et des tourments, pour faire des choses contraires à la religion et à la justice.
Ambiguae si quando citabere testis
Incertaeque rei ; Phalaris licet imperet, ut sis
Falsus, et admoto dictet perjuria tauro,
Summum crede nefas animam praeferre pudori,
Et propter vitam vivendi perdere causas.
Juvenal, Sat. 8.
Telle est la règle. Il peut arriver pourtant, comme nous l'avons insinué, que la nécessité où l'on se trouve fournisse une exception favorable, qui empêche que l'action ne soit imputée. Les circonstances où l'on se trouve donnent quelquefois lieu de présumer raisonnablement, que le législateur nous dispense lui-même de souffrir le mal dont on nous menace, et que pour cela il permet que l'on s'écarte alors de la disposition de la loi ; et c'est ce qui a lieu toutes les fois que le parti que l'on prend pour se tirer d'affaire, renferme en lui-même un mal moindre que celui dont on était menacé.
Des actions auxquelles plusieurs personnes ont part. Nous ajouterons encore ici quelques réflexions sur les cas où plusieurs personnes concourent à produire la même action. La matière étant importante et de grand usage, mérite d'être traitée avec quelque précision.
1°. Les actions d'autrui ne sauraient nous être imputées, qu'autant que nous y avons concouru, et que nous pouvions et devions les procurer, ou les empêcher, ou du-moins les diriger d'une certaine manière. La chose parle d'elle-même ; car imputer l'action d'autrui à quelqu'un, c'est déclarer que celui-ci en est la cause efficiente, quoiqu'il n'en soit pas la cause unique ; et que par conséquent cette action dépendait en quelque manière de sa volonté dans son principe ou dans son exécution.
2°. Cela posé, on peut dire que chacun est dans une obligation générale de faire ensorte, autant qu'il le peut, que toute autre personne s'acquitte de ses devoirs, et d'empêcher qu'elle ne fasse quelque mauvaise action, et par conséquent de ne pas y contribuer soi-même de propos délibéré, ni directement, ni indirectement.
3°. A plus forte raison on est responsable des actions de ceux sur qui l'on a quelque inspection particulière. C'est sur ce fondement que l'on impute à un père de famille la bonne ou la mauvaise conduite de ses enfants.
4°. Remarquons ensuite que pour être raisonnablement censé avoir concouru à une action d'autrui, il n'est pas nécessaire que l'on fût sur de pouvoir la procurer ou l'empêcher, en faisant ou ne faisant pas certaines choses ; il suffit que l'on eut là-dessus quelque probabilité ou quelque vraisemblance. Et comme d'un côté ce défaut de certitude n'excuse point la négligence ; de l'autre si l'on a fait tout ce que l'on devait, le défaut de succès ne peut point nous être imputé ; le blâme tombe alors tout entier sur l'auteur immédiat de l'action.
5°. Enfin il est bon d'observer encore, que dans la question que nous examinons, il ne s'agit point du degré de vertu ou de malice qui se trouve dans l'action même, et qui la rendant plus excellente ou plus mauvaise, en augmente la louange ou le blâme, la récompense ou la peine. Il s'agit proprement d'estimer le degré d'influence que l'on a sur l'action d'autrui, pour savoir si l'on en peut être regardé comme la cause morale, et si cette cause est plus ou moins efficace, afin de mesurer pour ainsi dire ce degré d'influence, qui décide de la manière dont on peut imputer à quelqu'un une action d'autrui ; il y a plusieurs circonstances et plusieurs distinctions à observer. Par exemple, il est certain qu'en général, la simple approbation a moins d'efficace pour porter quelqu'un à agir, qu'une forte persuasion, qu'une instigation particulière. Cependant la haute opinion que l'on a de quelqu'un, peut faire qu'une simple approbation ait quelquefois autant, et peut-être même plus d'influence sur une action d'autrui que la persuasion la plus pressante, ou l'instigation la plus forte d'une autre personne.
L'on peut ranger sous trois classes les causes morales qui influent sur une action d'autrui. Tantôt cette cause est la principale, en sorte que celui qui exécute, n'est que l'agent subalterne ; tantôt l'agent immédiat est au contraire la cause principale, tandis que l'autre n'est que la cause subalterne ; d'autres fois ce sont des causes collatérales qui influent également sur l'action dont il s'agit.
Celui-là doit être censé la cause principale qui, en faisant ou ne faisant pas certaines choses, influe tellement sur l'action ou l'omission d'autrui, que sans lui cette action n'aurait point été faite, ou cette omission n'aurait pas eu lieu, quoique d'ailleurs l'agent immédiat y ait contribué sciemment. Ainsi David fut la cause principale de la mort d'Urie, quoique Joab y eut contribué connaissant bien l'intention du roi.
Au reste, la raison pour laquelle un supérieur est censé être la cause principale de ce que font ceux qui dépendent de lui, n'est pas proprement la dépendance de ces derniers, c'est l'ordre qu'il leur donne, sans quoi l'on suppose que ceux-ci ne se seraient point portés d'eux-mêmes à l'action dont il s'agit.
Mais celui-là n'est qu'une cause collatérale, qui en faisant ou ne faisant pas certaines choses, concourt suffisamment et autant qu'il dépend de lui, à l'action d'autrui ; en sorte qu'il est censé coopérer avec lui, quoique l'on ne puisse pas présumer absolument que sans son concours, l'action n'ait pas été faite.
Tels sont ceux qui fournissent quelques secours à l'agent immédiat, ceux qui lui donnent retraite et qui le protegent, celui par exemple, qui tandis qu'un autre enfonce une porte, prend garde aux avenues, etc. Un complot entre plusieurs personnes, les rend pour l'ordinaire également coupables. Tous sont censés causes égales et collatérales, etc.
Enfin la cause subalterne est celle qui n'influe que peu sur l'action d'autrui, qui n'y fournit qu'une légère occasion, ou qui ne fait qu'en rendre l'exécution plus facile, de manière que l'agent, déjà tout déterminé à agir, et ayant pour cela tous les secours nécessaires, est seulement encouragé à exécuter sa résolution. Comme quand on lui indique la manière de s'y prendre, le moment favorable, le moyen de s'évader, ou quand on loue son dessein, et qu'on l'excite à le suivre, etc.
Ne pourrait-on pas mettre dans la même classe l'action d'un juge, qui au lieu de s'opposer à un avis qui a tous les suffrages, mais qu'il croit mauvais, s'y rangerait par timidité ou par complaisance ? Le mauvais exemple ne peut aussi être mis qu'au rang des causes subalternes, parce que ceux qui les donnent ne contribuent d'ordinaire que faiblement au mal que l'on fait en les imitant. Cependant il y a quelquefois des exemples si efficaces, à cause du caractère des personnes qui les donnent, et de la disposition de ceux qui les suivent, que si les premiers s'étaient abstenus du mal, les autres n'auraient pas pensé à le commettre ; et par conséquent ceux qui donnent ces mauvais exemples, doivent être considérés tantôt comme causes principales, tantôt comme causes collatérales, tantôt comme causes subalternes.
L'application de ces distinctions et de ces principes se fait d'elle-même : toutes choses d'ailleurs égales, les causes collatérales doivent être traitées également ; mais les causes principales méritent sans doute plus de louange ou de blâme, et un plus haut degré de récompense ou de peine que les causes subalternes. J'ai dit, toutes choses étant d'ailleurs égales ; car il peut arriver par la diversité des circonstances, qui augmentent ou diminuent le mérite ou le démérite d'une action, que la cause subalterne agisse avec un plus grand degré de malice que la cause principale, et qu'ainsi l'imputation soit aggravée à son égard. Supposé par exemple, qu'un homme de sang-froid assassinât quelqu'un à l'instigation d'un autre qui se trouvait animé contre son ennemi ; quoique l'instigateur soit le premier auteur du meurtre, on trouvera son action faite dans un transport de colere, moins indigne que celle du meurtrier, qui l'a servi dans sa passion, étant lui-même tranquille et de sens rassis.
IMPUTATION, (Théologie) est un terme dogmatique fort usité chez les Théologiens, quelquefois dans un bon et quelquefois dans un mauvais sens. Lorsqu'il se prend en mauvaise part, il signifie l'attribution d'un péché qu'un autre a commis.
L'imputation du péché d'Adam a été faite à sa postérité, parce que par sa chute tous ses descendants sont devenus criminels devant Dieu, comme s'ils étaient tombés eux-mêmes, et qu'ils portent la peine de ce premier crime. Voyez PECHE ORIGINEL.
L'imputation, lorsqu'on la prend en bonne part, est l'application d'une justice étrangère. Voyez JUSTIFICATION.
L'imputation des mérites de Jesus-Christ ne signifie autre chose chez les réformés, qu'une justice extrinseque, qui ne nous rend pas véritablement justes, mais qui nous fait seulement paraitre tels, qui cache nos péchés, mais qui ne les efface pas.
Luther, qui le premier a voulu expliquer la justification par cette imputation de la justice de Jesus-Christ, prétendait que ce qui nous justifie et ce qui nous rend agréables aux yeux de Dieu, ne fut rien en nous, mais que nous avons été justifiés, parce que Dieu nous imputait la justice de J. C. comme si elle eut été la nôtre propre, parce qu'en effet nous pouvions nous l'approprier par la foi. A quoi il ajoutait qu'on était justifié dès qu'on croyait l'être avec certitude. Bossuet, hist. des variat. tom. I. liv. I. pag. 10.
C'est pour cela que les Catholiques ne se servent point du terme d'imputation, et disent que la grâce justifiante qui nous applique les mérites de Jesus-Christ, couvre non-seulement nos péchés, mais même les efface ; que cette grâce est intrinseque et inhérente, qu'elle renouvelle entièrement l'intérieur de l'homme, et qu'elle le rend pur, juste et sans tache devant Dieu, et que cette justice inhérente lui est donnée à cause de la justice de Jesus-Christ, c'est-à-dire, par les mérites de sa mort et de sa passion. En un mot, disent-ils, quoique ce soit l'obéissance de Jesus-Christ qui nous a mérité la grâce justifiante, ce n'est pas cependant cette obéissance qui nous rend formellement justes. Et de la même manière, ce n'est pas la desobéissance d'Adam qui nous rend formellement pécheurs, quoique ce soit cette desobéissance qui nous a mérité et attiré le péché et les peines du péché.
Les Protestants disent que le péché du premier homme est imputé à ses descendants, parce qu'ils sont regardés et punis comme coupables à cause du péché d'Adam. Les Catholiques prétendent que ce n'est pas en dire assez, et que non-seulement nous sommes regardés et punis comme coupables, mais que nous le sommes en effet par le péché originel.
Les Protestants disent aussi que la justice de Jesus-Christ nous est imputée, et que notre justification ne se fait que par l'imputation de la justice de Jesus-Christ, parce que ses souffrances nous tiennent lieu de justification, et que Dieu accepte sa mort comme si nous l'avions soufferte. Mais les Catholiques enseignent que la justice de Jesus-Christ est non-seulement imputée, mais actuellement communiquée aux fidèles par l'opération du Saint-Esprit ; en sorte que non-seulement ils sont réputés, mais rendus justes par sa grâce.
IMPUTATION, (Jurisprudence) signifie l'acquittement qui se fait d'une somme dû. par le payement d'une autre somme.
Celui qui est débiteur de plusieurs sommes principales envers la même personne et qui lui fait quelque payement, peut l'imputer sur telle somme que bon lui semble, pourvu que ce soit à l'instant du payement.
Si le débiteur ne fait pas sur le champ l'imputation, le créancier peut la faire aussi sur le champ, pourvu que ce soit in duriorem causam, c'est-à-dire sur la dette la plus onéreuse au débiteur.
Quand le débiteur ni le créancier n'ont point fait l'imputation, elle se fait de droit, aussi in duriorem.
Lorsqu'il est dû un principal portant intérêt, l'imputation des payements se fait suivant la disposition du droit priùs in usuras ; cela se pratique ainsi dans tous les parlements de droit écrit.
Le parlement de Paris distingue si les intérêts sont dû. ex naturâ rei, ou ex officio judicis : au premier cas les payements s'imputent d'abord sur les intérêts ; au second elle se fait d'abord sur le principal, ensuite sur les intérêts. Voyez le recueil de questions de M. Bretonnier, au mot INTERETS. (A)
IMPUTATION
- Détails
- Écrit par Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie parente: Morale
- Catégorie : Droit politique
- Affichages : 1998