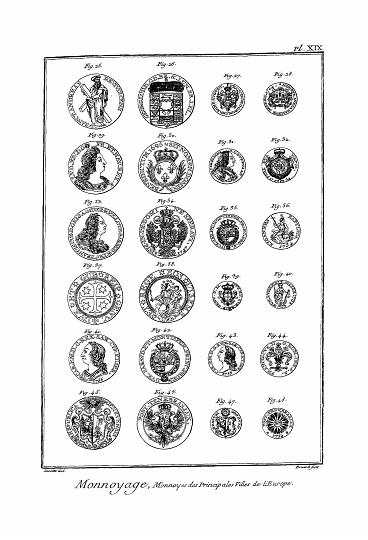(Gouvernement romain) la république romaine avait englouti toutes les autres républiques, et avait anéanti tous les rois qui restaient encore, quand elle s'affaissa sous le poids de sa grandeur et de sa puissance. Les Romains en détruisant tous les peuples, se détruisaient eux-mêmes ; sans cesse dans l'action, l'effort, et la violence, ils s'usèrent comme s'use une arme dont on se sert toujours. Enfin, les discordes civiles, les triumvirats, les proscriptions, contribuèrent à affoiblir Rome, plus encore que toutes ses guerres précédentes.
Les règlements qu'ils firent pour remédier à de tels maux, eurent leur effet pendant que la république, dans la force de son institution, n'eut à réparer que les pertes qu'elle faisait par son courage, par son audace, par sa fermeté, et par son amour pour la gloire. Mais dans la suite, toutes les lois ne purent rétablir ce qu'une république mourante, ce qu'une anarchie générale, ce qu'un gouvernement militaire, ce qu'un empire dur, ce qu'un despotisme superbe, ce qu'une monarchie faible, ce qu'une cour stupide, idiote, et superstitieuse, abattirent successivement. On eut dit qu'ils n'avaient conquis le monde que pour l'affoiblir, et le livrer sans défense aux Barbares : les nations Gothes, Gothiques, Sarrazines, et Tartares, les accablèrent tour-à-tour. Bien-tôt les peuples barbares n'eurent à détruire que des peuples barbares ; ainsi dans le temps des fables, après les inondations et les déluges, il sortit de la terre des hommes armés qui s'exterminèrent les uns les autres. Parcourons, d'après M. de Montesquieu, tous ces événements d'un oeil rapide ; l'âme s'éleve, l'esprit s'étend, en s'accoutumant à considérer les grands objets.
Il était tellement impossible que la république put se relever après la tyrannie de César, qu'il arriva à sa mort ce qu'on n'avait point encore vu, qu'il n'y eut plus de tyrants, et qu'il n'y eut pas de liberté ; car les causes qui l'avaient détruite, subsistaient toujours.
Sextus Pompée tenait la Sicîle et la Sardaigne ; il était maître de la mer, et il avait avec lui une infinité de fugitifs et de proscrits, qui combattaient pour leurs dernières espérances. Octave lui fit deux guerres très-laborieuses ; et après bien des mauvais succès, il le vainquit par l'habileté d'Agrippa. Il gagna les soldats de Lépidus, et le dépouillant de la puissance du triumvirat, il lui envia même la consolation de mener une vie obscure, et le força de se trouver comme homme privé dans les assemblées du peuple. Ensuite la bataille d'Actium se donna, et Cléopatre en fuyant, entraina Antoine avec elle. Tant de capitaines et tant de rais, qu'Antoine avait faits ou agrandis, lui manquèrent ; et comme si la générosité avait été liée à l'esclavage, une simple troupe de gladiateurs lui conserva une fidélité héroïque.
Auguste, c'est le nom que la flatterie donna à Octave, établit l'ordre, c'est-à-dire une servitude durable : car dans un état libre où l'on vient d'usurper la souveraineté, on appelle règle, tout ce qui peut fonder l'autorité sans bornes d'un seul ; et on nomme trouble, dissension, mauvais gouvernement, tout ce qui peut maintenir l'honnête liberté des sujets.
Tous les gens qui avaient eu des projets ambitieux, avaient travaillé à mettre une espèce d'anarchie dans la république. Pompée, Crassus, et César y réussirent à merveille ; ils établirent une impunité de tous les crimes publics ; tout ce qui pouvait arrêter la corruption des mœurs, tout ce qui pouvait faire une bonne police, ils l'abolirent ; et comme les bons législateurs cherchent à rendre leurs concitoyens meilleurs, ceux-ci travaillaient à les rendre pires : ils introduisirent la coutume de corrompre le peuple à prix d'argent ; et quand on était accusé de brigues, on corrompait aussi les juges : ils firent troubler les élections par toutes sortes de violences ; et quand on était mis en justice, on intimidait encore les juges : l'autorité même du peuple était anéantie ; témoin Gabinius, qui après avoir rétabli, malgré le peuple, Ptolomée à main armée, vint froidement demander le triomphe.
Ces derniers hommes de la république cherchaient à dégoûter le peuple de son devoir, et à devenir nécessaires, en rendant extrêmes les inconvénients du gouvernement républicain ; mais lorsqu'Auguste fut une fois le maître, la politique le fit travailler à rétablir l'ordre, pour faire sentir le bonheur du gouvernement d'un seul.
Au lieu que César disait insolemment que la république n'était rien, et que les paroles de lui César, étaient des lois ; Auguste ne parla que de la dignité du sénat, et de son respect pour la république. Il songea donc à établir le gouvernement le plus capable de plaire qui fût possible, sans choquer ses intérêts, et il en fit un aristocratique par rapport au civil, et monarchique par rapport au militaire : gouvernement ambigu, qui n'étant pas soutenu par ses propres forces, ne pouvait subsister que tandis qu'il plairait au monarque, et était entièrement monarchique par conséquent. En un mot, toutes les actions d'Auguste, tous ses règlements tendaient à l'établissement de la monarchie. Sylla se défit de la dictature : mais dans toute la vie de Sylla au milieu de ses violences, on vit un esprit républicain ; tous ses règlements, quoique tyranniquement exécutés, tendaient toujours à une certaine forme de république. Sylla homme emporté, menait violemment les Romains à la liberté : Auguste rusé tyran, les conduisit doucement à la servitude. Pendant que sous Sylla, la république reprenait des forces, tout le monde criait à la tyrannie ; et pendant que sous Auguste la tyrannie se fortifiait, on ne parlait que de liberté.
La coutume des triomphes qui avait tant contribué à la grandeur de Rome, se perdit sous ce prince ; ou plutôt cet honneur devint un privilège de la souveraineté. Dans le temps de la république, celui-là seul avait droit de demander le triomphe sous les auspices duquel la guerre s'était faite ; or elle se faisait toujours sous les auspices du chef, et par conséquent de l'empereur, qui était le chef de toutes les armées.
Sous prétexte de quelques tumultes arrivés dans les élections, Auguste mit dans la ville un gouverneur et une garnison ; il rendit les corps des légions éternels, les plaça sur les frontières, et établit des fonds particuliers pour les payer. Enfin, il ordonna que les vétérants recevraient leur récompense en argent, et non pas en terres.
Dion remarque très-bien, que depuis lors, il fut plus difficîle d'écrire l'histoire : tout devint secret : toutes les dépêches des provinces furent portées dans le cabinet des empereurs ; on ne sut plus que ce que la folie et la hardiesse des tyrants ne voulut point cacher, ou ce que les historiens conjecturèrent.
Comme on voit un fleuve miner lentement et sans bruit les digues qu'on lui oppose, et enfin les renverser dans un moment, et couvrir les campagnes qu'elles conservaient ; ainsi la puissance souveraine, sous Auguste, agit insensiblement, et renversa sous Tibere avec violence.
A peine ce prince fut monté sur le trône, qu'il appliqua la loi de majesté, non pas aux cas pour lesquels elle avait été faite, mais à tout ce qui put servir sa haine, ou ses défiances. Ce n'étaient pas seulement les actions qui tombaient dans le cas de cette loi ; mais des paroles, des signes, et des pensées mêmes : car ce qui se dit dans ces épanchements de cœur que la conversation produit entre deux amis, ne peut être regardé que comme des pensées. Il n'y eut donc plus de liberté dans les festins, de confiance dans les parentés, de fidélité dans les esclaves ; la dissimulation et la tristesse du prince se communiquant par-tout, l'amitié fut regardée comme un écueil, l'ingénuité comme une imprudence, et la vertu comme une affectation qui pouvait rappeler dans l'esprit des peuples le bonheur des temps précédents.
Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle qu'on exerce à l'ombre des lois, et avec les couleurs de la justice ; lorsqu'on va, pour ainsi dire, noyer des malheureux sur la planche même sur laquelle ils s'étaient sauvés. Et comme il n'est jamais arrivé qu'un tyran ait manqué d'instruments de sa tyrannie, Tibere trouva toujours des juges prêts à condamner autant de gens qu'il en put soupçonner.
Du temps de la république, le sénat qui ne jugeait point en corps les affaires des particuliers, connaissait par une délégation du peuple, des crimes qu'on imputait aux alliés. Tibere lui renvoya de même le jugement de tout ce qui s'appelait crime de lése-majesté contre lui. Ce corps tomba dans un état de bassesse qui ne peut s'exprimer ; les sénateurs allaient au-devant de la servitude, sous la faveur de Séjan ; les plus illustres d'entr'eux faisaient le métier de délateurs.
Avant que Rome fût gouvernée par un seul, les richesses des principaux Romains étaient immenses, quelles que fussent les voies qu'ils employaient pour les acquérir : elles furent presque toutes ôtées sous les empereurs ; les sénateurs n'avaient plus ces grands cliens qui les comblaient de biens ; on ne pouvait guère rien prendre dans les provinces que pour César, surtout lorsque ses procurateurs, qui étaient à-peu-près comme sont aujourd'hui nos intendants, y furent établis. Cependant, quoique la source des richesses fût coupée, les dépenses subsistaient toujours ; le train de vie était pris, et on ne pouvait plus le soutenir que par la faveur de l'empereur.
Auguste avait ôté au peuple la puissance de faire des lais, et celle de juger les crimes publics ; mais il lui avait laissé, ou du-moins avait paru lui laisser, celle d'élire les magistrats. Tibere, qui craignait les assemblées d'un peuple si nombreux, lui ôta encore ce privilège, et le donna au sénat, c'est-à-dire à lui-même : or on ne saurait croire combien cette décadence du pouvoir du peuple avilit l'âme des grands. Lorsque le peuple disposait des dignités, les magistrats qui les briguaient, faisaient bien des bassesses ; mais elles étaient jointes à une certaine magnificence qui les cachait, soit qu'ils donnassent des jeux, ou de certains repas au peuple, soit qu'ils lui distribuassent de l'argent ou des grains. Quoique le motif fût bas, le moyen avait quelque chose de noble, parce qu'il convient toujours à un grand homme d'obtenir par des libéralités, la faveur du peuple. Mais, lorsque le peuple n'eut plus rien à donner, et que le prince, au nom du sénat, disposa de tous les emplois, on les demanda, et on les obtint par des voies indignes ; la flatterie, l'infamie, les crimes, furent des arts nécessaires pour y parvenir.
Caligula succéda à Tibere. On disait de lui qu'il n'y avait jamais eu un meilleur esclave, ni un plus méchant maître ; ces deux choses sont assez liées, car la même disposition d'esprit, qui fait qu'on a été vivement frappé de la puissance illimitée de celui qui commande, fait qu'on ne l'est pas moins lorsqu'on vient à commander soi-même.
Ce monstre faisait mourir militairement tous ceux qui lui déplaisaient, ou dont les biens tentaient son avarice ; plusieurs de ses successeurs l'imitèrent : nous ne trouvons rien de semblable dans nos histoires modernes. Attribuons-en la cause à des mœurs plus douces, et à une religion plus réprimante ; de plus on n'a point à dépouiller les familles de ces sénateurs qui avaient ravagé le monde. Nous tirons cet avantage de la médiocrité de nos fortunes, qu'elles sont plus sures ; nous ne valons pas la peine qu'on nous ravisse nos biens.
Le petit peuple de Rome, ce que l'on appelait plebs, ne haïssait pas cependant les plus mauvais empereurs. Depuis qu'il avait perdu l'empire et qu'il n'était plus occupé à la guerre, il était devenu le plus vil de tous les peuples ; il regardait le commerce et les arts comme des choses propres aux seuls esclaves, et les distributions de blé qu'il recevait lui faisaient négliger les terres ; on l'avait accoutumé aux jeux et aux spectacles. Quand il n'eut plus de tribuns à écouter, ni de magistrats à élire, ces choses vaines lui devinrent nécessaires, et son oisiveté lui en augmenta le gout. Or, Caligula, Néron, Commode, Caracalla étaient regrettés du peuple, à cause de leur folie même ; car ils aimaient avec fureur ce que le peuple aimait, et contribuaient de tout leur pouvoir et même de leur personne à ses plaisirs ; ils prodiguaient pour lui toutes les richesses de l'empire ; et quand elles étaient épuisées, le peuple voyant sans peine dépouiller toutes les grandes familles, il jouissait des fruits de la tyrannie, et il en jouissait purement ; car il trouvait sa sûreté dans sa bassesse. De tels gens haïssaient naturellement les gens de bien ; ils savaient qu'ils n'en étaient pas approuvés : indignés de la contradiction ou du silence d'un citoyen austère, enivrés des applaudissements de la populace, ils parvenaient à s'imaginer que leur gouvernement faisait la félicité publique, et qu'il n'y avait que des gens mal intentionnés qui pussent le censurer.
Caligula était un vrai sophiste dans sa cruauté : comme il descendait également d'Antoine et d'Auguste, il disait qu'il punirait les consuls s'ils célébraient le jour de réjouissance établi en mémoire de la victoire d'Actium, et qu'il les punirait s'ils ne le célébraient pas ; et Drusille, à qui il accorda les honneurs divins, étant morte, c'était un crime de la pleurer, parce qu'elle était déesse, et de ne la pas pleurer, parce qu'elle était sa sœur.
C'est ici qu'il faut se donner le spectacle des choses humaines. Qu'on voie dans l'histoire de Rome tant de guerres entreprises, tant de sang répandu, tant de peuples détruits, tant de grandes actions, tant de triomphes, tant de politique, de sagesse, de prudence, de constance, de courage ; ce projet d'envahir tout, si bien formé, si bien soutenu, si bien fini, à quoi aboutit-il, qu'à assouvir le bonheur de cinq ou six monstres ? Quoi ! ce sénat n'avait fait évanouir tant de rois que pour tomber lui - même dans le plus bas esclavage de quelques-uns de ses plus indignes citoyens, et s'exterminer par ses propres arrêts ? On n'élève donc sa puissance que pour la voir mieux renversée ? Les hommes ne travaillent à augmenter leur pouvoir que pour le voir tomber contre eux-mêmes dans de plus heureuses mains.
Caligula ayant été tué, le sénat s'assembla pour établir une forme de gouvernement. Dans le temps qu'il délibérait, quelques soldats entrèrent dans le palais pour piller, ils trouvèrent dans un lieu obscur un homme tremblant de peur ; c'était Claude : ils le saluèrent empereur. Cet empereur acheva de perdre les anciens ordres, en donnant à ses officiers le droit de rendre la justice. Les guerres de Marius et de Sylla ne se faisaient que pour savoir qui aurait ce droit, des sénateurs ou des chevaliers. Une fantaisie d'un imbécile l'ôta aux uns et aux autres ; étrange succès d'une dispute qui avait mis en combustion tout l'univers !
Les soldats avaient été attachés à la famille de César, qui était garante de tous les avantages que leur avait procuré la révolution. Le temps vint que les grandes familles de Rome furent toutes exterminées par celle de César, et que celle de César, dans la personne de Néron, périt elle-même. La puissance civîle qu'on avait sans cesse abattue, se trouva hors d'état de contre-balancer la militaire ; chaque armée voulut nommer un empereur.
Galba, Othon, Vitellius ne firent que passer, Vespasien fut élu, comme eux, par les soldats : il ne songea, dans tout le cours de son règne, qu'à rétablir l'empire, qui avait été successivement occupé par six tyrants également cruels, presque tous furieux, souvent imbéciles, et pour comble de malheur, prodigues jusqu'à la folie.
Tite, qui vint à succéder à Vespasien, fut les délices du peuple. Domitien fit voir un nouveau monstre, plus cruel, ou du-moins plus implacable que ceux qui l'avaient précédé, parce qu'il était plus timide. Ses affranchis les plus chers, &, à ce que quelques-uns ont dit, sa femme même, voyant qu'il était aussi dangereux dans ses amitiés que dans ses haines, et qu'il ne mettait aucunes bornes à ses méfiances, ni à ses accusations, s'en défirent. Avant de faire le coup, ils jetèrent les yeux sur un successeur, et choisirent Nerva, vénérable vieillard.
Nerva adopta Trajan, prince le plus accompli dont l'histoire ait jamais parlé. Adrien, son successeur, abandonna ses conquêtes et borna l'empire à l'Euphrate.
Dans ces temps-là, la secte des stoïciens s'étendait et s'accréditait de plus en plus. Il semblait que la nature humaine eut fait un effort pour produire d'elle-même cette secte admirable, qui était comme ces plantes que la terre fait naître dans des lieux que le ciel n'a jamais vus.
Les Romains lui durent leurs meilleurs empereurs. Rien n'est capable de faire oublier le premier Antonin que Marc-Aurele qu'il adopta. On sent en soi-même un plaisir secret, lorsqu'on parle de cet empereur ; on ne peut lire sa vie sans une espèce d'attendrissement : tel est l'effet qu'elle produit, qu'on a meilleure opinion de soi-même, parce qu'on a meilleure opinion des hommes. La sagesse de Nerva, la gloire de Trajan, la valeur d'Adrien, la vertu des deux Antonins se firent respecter des soldats. Mais lorsque de nouveaux monstres prirent leur place, l'abus du gouvernement militaire parut dans tout son excès ; et les soldats qui avaient vendu l'empire, assassinèrent les empereurs pour en avoir un nouveau prix.
Commode succéda à Marc-Aurele son père. C'était un monstre qui suivait toutes ses passions, et toutes celles de ses ministres et de ses courtisans. Ceux qui en délivrèrent le monde, nommèrent en sa place Pertinax, vénérable vieillard, que les soldats prétoriens massacrèrent d'abord.
Ils mirent l'empire à l'enchère, et Didius Julien l'emportant par ses promesses, souleva tous les Romains ; car quoique l'empire eut été souvent acheté, il n'avait pas encore été marchandé. Pescennius Niger, Sévère et Albin furent salués empereurs, et Julien n'ayant pu payer les sommes immenses qu'il avait promises fut abandonné par ses troupes.
Sévère avait de grandes qualités, mais il avait encore de plus grands défauts ; quoique jaloux de son autorité autant que l'avait été Tibere, il se laissa gouverner par Plautien d'une manière misérable. Enfin il était cruel et barbare ; il employa les exactions d'un long règne, et les proscriptions de ceux qui avaient suivi le parti de ses concurrents, à amasser des trésors immenses. Mais les trésors amassés par des princes n'ont presque jamais que des effets funestes : ils corrompent le successeur qui en est ébloui ; et s'ils ne gâtent pas son cœur, ils gâtent son esprit. Ils forment d'abord de grandes entreprises avec une puissance qui est d'accident, qui ne peut pas durer, qui n'est pas naturelle, et qui est plutôt enflée qu'agrandie. Les proscriptions de cet empereur furent cause que plusieurs soldats de Niger se retirèrent chez les Parthes. Ils leur apprirent ce qui manquait à leur art militaire, à se servir des armes romaines, et même à en fabriquer, ce qui fit que ces peuples qui s'étaient ordinairement contentés de se défendre, furent dans la suite presque toujours agresseurs.
Il est remarquable que dans cette suite de guerres civiles qui s'élevèrent continuellement, ceux qui avaient les légions d'Europe vainquirent presque toujours ceux qui avaient les légions d'Asie ; et l'on trouve dans l'histoire de Sévère qu'il ne put prendre la ville d'Atra en Arabie, parce que les légions d'Europe s'étant mutinées, il fut obligé d'employer celles de Syrie. On sentit cette différence depuis qu'on commença à faire des levées dans les provinces ; et elle fut telle entre les légions qu'elles étaient entre les peuples mêmes qui, par la nature et par l'éducation, sont plus ou moins propres pour la guerre.
Ces levées faites dans les provinces produisirent un autre effet : les empereurs pris ordinairement dans la milice furent presque tous étrangers et quelquefois barbares. Rome ne fut plus la maîtresse du monde, et reçut des lois de tout l'univers. Chaque empereur y porta quelque chose de son pays ou pour les manières, ou pour les mœurs, ou pour la police, ou pour le culte ; et Héliogabale alla jusqu'à vouloir détruire tous les objets de la vénération de Rome, et ôter tous les dieux de leurs temples pour y placer le sien.
On pourrait appeler Caracalla qui vint à succéder à Sévère non pas un tyran, mais le destructeur des hommes. Caligula, Néron et Domitien bornaient leurs cruautés dans la capitale ; celui-ci allait promener sa fureur dans tout l'univers. Ayant commencé son règne par tuer de sa propre main Géta son frère, il employa ses richesses à augmenter la paye des soldats, pour leur faire souffrir son crime ; et pour en diminuer encore l'horreur, il mit son frère au rang des dieux. Ce qu'il y a de singulier, c'est que le même honneur lui fut exactement rendu par Macrin, qui, après l'avoir fait poignarder, voulant apaiser les soldats prétoriens affligés de la mort de ce prince qui les avait comblés de largesses, lui fit bâtir un temple, et y établit des prêtres flamines pour le desservir.
Les profusions de Caracalla envers ses troupes avaient été immenses, et il avait très-bien suivi le conseil que son père lui avait donné en mourant, d'enrichir les gens de guerre, et de ne s'embarrasser pas des autres. Mais cette politique n'était guère bonne que pour un règne ; car le successeur ne pouvant plus faire les mêmes dépenses, était d'abord massacré par l'armée ; de façon qu'on voyait toujours les empereurs sages mis à mort par les soldats, et les méchants par des conspirations ou des arrêts du sénat.
Quand un tyran qui se livrait aux gens de guerre avait laissé les citoyens exposés à leurs violences et à leurs rapines, cela ne pouvait durer qu'un règne ; car les soldats, à force de détruire, allaient jusqu'à s'ôter à eux - mêmes leur solde. Il fallait donc songer à rétablir la discipline militaire ; entreprise qui coutait toujours la vie à celui qui osait la tenter.
Quand Caracalla eut été tué par les embuches de Macrin, les soldats élurent Héliogabale ; et quand ce dernier qui n'étant occupé que de ses sales voluptés, les laissait vivre à leur fantaisie, ne put plus être souffert, ils le massacrèrent. Ils tuèrent de même Alexandre qui voulait rétablir la discipline, et parlait de les punir. Ainsi un tyran qui ne s'assurait point la vie, mais le pouvoir de faire des crimes, périssait avec ce funeste avantage, que celui qui voudrait faire mieux périrait après lui.
Après Alexandre, on élut Maximin qui fut le premier empereur d'une origine barbare. Sa taille gigantesque et la force de son corps l'avaient fait connaître : il fut tué avec son fils par ses soldats. Les deux premiers Gordiens périrent en Afrique ; Maxime, Balbin et le troisième Gordien furent massacrés. Philippe qui avait fait tuer le jeune Gordien, fut tué lui-même avec son fils ; et Dèce qui fut élu en sa place, périt à son tour par la trahison de Gallus.
Ce qu'on appelait l'empire romain dans ce siecle-là, était une espèce de république irrégulière, telle à-peu-près que l'aristocratie d'Alger, où la milice qui a la puissance souveraine fait et défait un magistrat, qu'on appelle le dey.
Dans ces mêmes temps, les Barbares au commencement inconnus aux Romains, ensuite seulement incommodes, leur étaient devenus redoutables. Par l'événement du monde le plus extraordinaire, Rome avait si bien anéanti tous les peuples, que lorsqu'elle fut vaincue elle-même, il sembla que la terre en eut enfanté de nouveaux pour la détruire.
Sous le règne de Gallus, un grand nombre de nations qui se rendirent ensuite plus célèbres, ravagèrent l'Europe ; et les Perses ayant envahi la Syrie, ne quittèrent leurs conquêtes que pour conserver leur butin. Les violences des Romains avaient fait retirer les peuples du midi au nord ; tandis que la force qui les contenait subsista, ils y restèrent ; quand elle fut affoiblie, ils se répandirent de toutes parts. La même chose arriva quelques siècles après. Les conquêtes de Charlemagne et ses tyrannies avaient une seconde fois fait reculer les peuples du midi au nord : si-tôt que cet empire fut affoibli, ils se portèrent une seconde fois du nord au midi. Et si aujourd'hui un prince faisait en Europe les mêmes ravages, les nations repoussées dans le nord, adossées aux limites de l'univers, y tiendraient ferme jusqu'au moment qu'elles inonderaient et conquereraient l'Europe une troisième fais.
L'affreux désordre qui était dans la succession à l'empire étant venu à son comble, on vit paraitre, sur la fin du règne de Valerien et pendant celui de Galien, trente prétendants divers qui s'étant la plupart entre-détruits, ayant eu un règne très-court, furent nommés tyrants. Valerien ayant été pris par les Perses, et Galien son fils négligeant les affaires, les barbares pénétrèrent par-tout ; l'empire se trouvant dans cet état où il fut environ un siècle après en Occident, et il aurait été dès-lors détruit sans un concours heureux de circonstances ; quatre grands hommes, Claude, Aurélien, Tacite et Probus qui, par un grand bonheur, se succédèrent, rétablirent l'empire prêt à périr.
Cependant pour prévenir les trahisons continuelles des soldats, les empereurs s'associèrent des personnes en qui ils avaient confiance ; et Dioclétien, sous la grandeur des affaires, régla qu'il y aurait toujours deux empereurs et deux césars ; mais ce qui contint encore plus les gens de guerre, c'est que les richesses des particuliers et la fortune publique ayant diminué, les empereurs ne purent plus leur faire des dons si considérables, de manière que la récompense fut plus proportionnée au danger de faire une nouvelle élection. D'ailleurs les préfets du prétoire qui faisaient à leur gré massacrer les empereurs pour se mettre en leur place, furent entièrement abaissés par Constantin, qui ne leur laissa que les fonctions civiles, et en fit quatre au lieu de deux.
La vie des empereurs commença donc à être plus assurée ; ils purent mourir dans leur lit, et cela sembla avoir un peu adouci leurs mœurs ; ils ne versèrent plus le sang avec tant de férocité. Mais comme il fallait que ce pouvoir immense débordât quelque part, on vit un autre genre de tyrannie plus sourde. Ce ne furent plus des massacres, mais des jugements iniques, des formes de justice qui semblaient n'éloigner la mort que pour flétrir la vie : la cour fut gouvernée, et gouverna par plus d'artifices, par des arts plus exquis, avec un plus grand silence : enfin au lieu de cette hardiesse à concevoir une mauvaise action, et de cette impétuosité à la commettre, on ne vit plus régner que les vices des âmes faibles et des crimes réfléchis.
Il s'établit encore un nouveau genre de corruption, les premiers empereurs aimaient les plaisirs, ceux-ci la mollesse : ils se montrèrent moins aux gens de guerre, ils furent plus aisifs, plus livrés à leurs domestiques, plus attachés à leurs palais, et plus séparés de l'empire. Le poison de la cour augmenta sa force, à mesure qu'il fut plus séparé ; on ne dit rien, on insinua tout ; les grandes réputations furent toutes attaquées ; et les ministres et les officiers de guerre furent mis sans cesse à la discrétion de cette sorte de gens qui ne peuvent servir l'état, ni souffrir qu'on le serve avec gloire. Le prince ne sçut plus rien que sur le rapport de quelques confidents, qui toujours de concert, souvent même lorsqu'ils semblaient être d'opinion contraire, ne faisaient auprès de lui que l'office d'un seul.
Le séjour de plusieurs empereurs en Asie et leur perpétuelle rivalité avec les rois de Perse firent qu'ils voulurent être adorés comme eux ; et Dioclétien, d'autres disent Galere, l'ordonna par un édit. Ce faste et cette pompe asiatique s'établissant, les yeux s'y accoutumèrent d'abord : et lorsque Julien voulut mettre de la simplicité et de la modestie dans ses manières, on appela oubli de la dignité ce qui n'était que la mémoire des anciennes mœurs.
Quoique depuis Marc-Aurele il y eut eu plusieurs empereurs, il n'y avait eu qu'un empire ; et l'autorité de tous étant reconnue dans la province, c'était une puissance unique exercée par plusieurs. Mais Galere et Constance Chlore n'ayant pu s'accorder, ils partagèrent réellement l'empire, et cet exemple que Constantin suivit sur le plan de Galere produisit une étrange révolution. Ce prince qui n'a fait que des fautes en matière de politique, porta le siege de l'empire en Orient ; cette division qu'on en fit le ruina, parce que toutes les parties de ce grand corps liées depuis longtemps ensemble, s'étaient, pour ainsi dire, ajustées pour y rester et dépendre les unes des autres.
Dès que Constantin eut établi son siege à Constantinople, Rome presque entière y passa, et l'Italie fut privée de ses habitants et de ses richesses. L'or et l'argent devinrent extrêmement rares en Europe ; et comme les empereurs en voulurent toujours tirer les mêmes tributs, ils soulevèrent tout le monde.
Constantin, après avoir affoibli la capitale, frappa un autre coup sur les frontières ; il ôta les légions qui étaient sur le bord des grands fleuves, et les dispersa dans les provinces : ce qui produisit deux maux ; l'un, que la barrière qui contenait tant de nations fut ôtée ; et l'autre, que les soldats vécurent et s'amollirent dans le cirque et dans les théâtres.
Plusieurs autres causes concoururent à la ruine de l'empire. On prenait un corps de barbares pour s'opposer aux inondations d'autres barbares, et ces nouveaux corps de milice étaient toujours prêts à recevoir de l'argent, à piller et à se battre ; on était servi pour le moment ; mais dans la suite, on avait autant de peine à réduire les auxiliaires que les ennemis.
Les nations qui entouraient l'empire en Europe et en Asie, absorbèrent peu-à-peu les richesses des Romains ; et comme ils s'étaient agrandis, parce que l'or et l'argent de tous les rois étaient portés chez eux, ils s'affoiblirent, parce que leur or et leur argent fut porté chez les autres. " Vous voulez des richesses ? disait Julien à son armée qui murmurait ; voilà le pays des Perses, allons-en chercher. Croyez-moi, de tant de trésors que possédait la république romaine, il ne reste plus rien ; et le mal vient de ceux qui ont appris aux princes à acheter la paix des barbares. Nos finances sont épuisées, nos villes sont détruites, nos provinces ruinées. Un empereur qui ne connait d'autres biens que ceux de l'âme, n'a pas honte d'avouer une pauvreté honnête ".
De plus les Romains perdirent toute leur discipline militaire, ils abandonnèrent jusqu'à leurs propres armes. Végece dit que les soldats les trouvant trop pesantes, ils obtinrent de l'empereur Gratien de quitter leur cuirasse, et ensuite leur casque ; de façon qu'exposés aux coups sans défense, ils ne songèrent plus qu'à fuir. Il ajoute qu'ils avaient perdu la coutume de fortifier leur camp ; et que, par cette négligence, leurs armées furent enlevées par la cavalerie des Barbares.
C'était une règle inviolable des premiers Romains, que quiconque avait abandonné son poste ou laissé ses armes dans le combat, était puni de mort ; Julien et Valentinien avaient à cet égard rétabli les anciennes peines. Mais les barbares pris à la solde des Romains, accoutumés à faire la guerre, comme la font aujourd'hui les Tartares, à fuir pour combattre encore, à chercher le pillage plus que l'honneur, étaient incapables d'une pareille discipline.
Telle était celle des premiers Romains, qu'on y avait Ve des généraux condamner leurs enfants à mourir pour avoir, sans leur ordre, gagné la victoire : mais quand ils furent mêlés parmi les Barbares, ils y contractèrent un esprit d'indépendance qui faisait le caractère de ces nations ; et si l'on lit les guerres de Bélisaire contre les Goths, on verra un général presque toujours désobéi par ses officiers.
Dans cette position, Attila parut dans le monde pour soumettre tous les peuples du nord. Ce prince dans sa maison de bois, où nous le représente Priscus, se fit connaître pour un des grands monarques dont l'histoire ait jamais parlé. Il était maître de toutes les nations barbares, et en quelque façon de presque toutes celles qui étaient policées. Il s'étendit depuis le Danube jusqu'au Rhin, détruisit tous les forts et tous les ouvrages qu'on avait faits sur ces fleuves, et rendit les deux empires tributaires. On voyait à sa cour les ambassadeurs des empereurs qui venaient recevoir ses lois, ou implorer sa clémence. Il avait mis sur l'empire d'orient un tribut de deux mille cent livres d'or. Il envoyait à Constantinople ceux qu'il voulait récompenser, afin qu'on les comblât de biens, faisant un trafic continuel de la frayeur des Romains. Il était craint de ses sujets ; et il ne parait pas qu'il en fût haï. Fidélement servi des rois mêmes qui étaient sous sa dépendance, il garda pour lui seul l'ancienne simplicité des mœurs des Huns.
Après sa mort, toutes les nations barbares se redivisèrent ; mais les Romains étaient si faibles, qu'il n'y avait pas de si petit peuple qui ne put leur nuire. Ce ne fut pas une certaine invasion qui perdit l'empire ; ce furent toutes les invasions. Depuis celle qui fut si générale sous Gallus, il sembla rétabli, parce qu'il n'avait point perdu de terrain ; mais il alla de degrés en degrés, de la décadence à sa chute, jusqu'à - ce qu'il s'affaissa tout-à-coup sous Arcadius et Honorius.
En vain on aurait rechassé les Barbares dans leur pays, ils y seraient tout de même rentrés, pour mettre en sûreté leur butin. En vain on les extermina, les villes n'étaient pas moins saccagées, les villages brulés, les familles tuées ou dispersées. Lorsqu'une province avait été ravagée, les barbares qui succédaient, n'y trouvant plus rien, devaient passer à une autre. On ne ravagea au commencement que la Thrace, la Mysie, la Pannonie. Quand ces pays furent dévastés, on ruina la Macédoine, la Thessalie, la Grèce ; de-là il fallut aller aux Noriques. L'empire, c'est-à-dire le pays habité, se rétrécissait toujours, et l'Italie devenait frontière.
L'empire d'occident fut le premier abattu, et Honorius fut obligé de s'enfuir à Ravenne. Théodoric s'empara de l'Italie, qu'Alaric avait déjà ravagée. Rome s'était agrandie, parce qu'elle n'avait eu que des guerres successives, chaque nation, par un bonheur inconcevable, ne l'attaquant que quand l'autre avait été ruinée. Rome fut détruite, parce que toutes les nations l'attaquèrent à la fais, et pénétrèrent partout.
L'empire d'orient (dont on peut voir l'article au mot ORIENT), après avoir essuyé toutes sortes de tempêtes, fut réduit sous ces derniers empereurs, aux fauxbourgs de Constantinople, et finit comme le Rhin, qui n'est plus qu'un ruisseau lorsqu'il se perd dans l'Océan.
Je n'ajoute qu'une seule, mais admirable réflexion, qu'on doit encore à M. de Montesquieu. Ce n'est pas, dit-il, la fortune qui domine le monde ; on peut le demander aux Romains qui eurent une suite continuelle de prospérités, quand ils se gouvernèrent sur un certain plan ; et une suite non interrompue de revers, lorsqu'ils se conduisirent sur un autre. Il y a des causes générales, soit morales, soit physiques, qui agissent dans chaque monarchie, l'élèvent, la maintiennent ou la précipitent ; tous les accidents sont soumis à ces causes ; et si le hasard d'une bataille, c'est-à-dire une cause particulière, a ruiné un état, il y avait une cause générale qui faisait que cet état devait périr par une seule bataille. En un mot, l'allure principale entraîne avec elle tous les accidents particuliers. (D.J.)
ROMAINS. Philosophie des Etrusques et des Romains, (Histoire, Philosophie) nous savons peu de chose des opinions des Etrusques sur le monde, les dieux, l'âme et la nature. Ils ont été les inventeurs de la divination par les augures, ou de cette science frivole qui consiste à connaître la volonté des dieux, ou par le vol des oiseaux, ou par leur chant, ou par l'inspection des entrailles d'une victime. O combien nos lumières sont faibles et trompeuses ! tantôt c'est notre imagination, ce sont les événements, nos passions, notre terreur et notre curiosité qui nous entraînent aux suppositions les plus ridicules ; tantôt c'est une autre sorte d'erreur qui nous joue. Avons-nous découvert à force de raison et d'étude quelque principe vraisemblable ou vrai ? Nous nous égarons dès les premières conséquences que nous en tirons, et nous flottons incertains. Nous ne savons s'il y a vice ou dans le principe, ou dans la conséquence ; et nous ne pouvons nous résoudre, ni à admettre l'un, ni à rejeter l'autre, ni à les recevoir tous deux. Le sophisme consiste dans quelque chose de très-subtil qui nous échappe. Que répondrions-nous à un augure qui nous dirait : écoute philosophe incrédule, et humilie-toi. Ne conviens-tu pas que tout est lié dans la nature ?... J'en conviens... Pourquoi donc oses-tu nier qu'il y ait entre la conformation de ce foie et cet événement, un rapport qui m'éclaire ?... Le rapport y est sans doute, mais comment peut-il t'éclairer ?... comme le mouvement de l'astre de la nuit t'instruit sur l'élévation ou l'abaissement des eaux de la mer ; et combien d'autres circonstances où tu vois qu'un phénomène étant, un autre phénomène est ou sera, sans apercevoir entre ces phénomènes aucune liaison de cause et d'effet ? Quel est le fondement de ta science en pareil cas ? D'où sais-tu que si l'on approche le feu de ce corps, il en sera consumé ?.... De l'expérience.... Eh bien l'expérience est aussi le fondement de mon art. Le hasard te conduisit à une première observation, et moi aussi. J'en fis une seconde, une troisième ; et je conclus de ces observations réiterées, une concomitance constante et peut-être nécessaire entre des effets très-éloignés et très-disparates. Mon esprit n'eut point une autre marche que le tien. Viens donc. Approche-toi de l'autel. Interrogeons ensemble les entrailles des victimes, et si la vérité accompagne toujours leurs réponses, adore mon art et garde le silence... Et voilà, mon philosophe, s'il est un peu sincère, réduit à laisser de côté sa raison, et à prendre le couteau du sacrificateur, ou à abandonner un principe incontestable ; c'est que tout tient dans la nature par un enchainement nécessaire ; ou à réfuter par l'expérience même, la plus absurde de toutes les idées ; c'est qu'il y a une liaison ineffable et secrète, entre le sort de l'empire et l'appétit ou le dégoût des poulets sacrés. S'ils mangent, tout Ve bien ; tout est perdu, s'ils ne mangent pas. Qu'on rende le philosophe si subtil que l'on voudra, si l'augure n'est pas un imbécile, il répondra à tout, et ramenera le philosophe, malgré qu'il en ait, à l'expérience.
Les Etrusques disaient, Jupiter a trois foudres : un foudre qu'il lance au hasard, et qui avertit les hommes qu'il est ; un foudre qu'il n'envoye qu'après en avoir déliberé avec quelques dieux et qui intimide les méchants ; un foudre qu'il ne prend que dans le conseil général des immortels, et qui écrase et qui perd.
Ils pensaient que Dieu avait employé douze mille ans à créer le monde, et partagé sa durée en douze périodes de mille ans chacune. Il créa dans les premiers mille ans, le ciel et la terre, dans les seconds mille ans, le firmament ; dans les troisiemes, la mer et toutes les eaux ; dans les quatriemes, le soleil, la lune et les autres astres qui éclairent le ciel ; dans les cinquiemes, les oiseaux, les insectes, les reptiles, les quadrupedes, et tout ce qui vit dans l'air, dans les eaux et sur la terre. Le monde avait six mille ans, que l'homme n'était pas encore. L'espèce humaine subsistera jusqu'à la fin de la dernière période ; c'est alors que les temps seront consommés.
Les périodes de la création des étrusques correspondent exactement aux jours de la création de Moïse.
Il arriva sous Marius un phénomène étonnant. On entendit dans le ciel le son d'une trompette, aiguë et lugubre ; et les augures Etrusques consultés en inférèrent le passage d'une période du monde à une autre, et quelque changement marqué dans la race des hommes.
Les divinités d'Isis et d'Osiris ont - elles été ignorées ou connues des Etrusques ? c'est une question que nous laissons à discuter aux érudits.
Les premiers Romains ont emprunté sans doute, des Sabins, des Etrusques, et des peuples circonvoisins, le peu d'idées raisonnables qu'ils ont eues ; mais qu'était - ce que la philosophie d'une poignée de brigands, réfugiés entre des collines, d'où ils ne s'échappaient par intervalles, que pour porter le fer, le feu, la terreur et le ravage chez les peuples malheureux qui les entouraient ? Romulus les renferma dans des murs qui furent arrosés du sang de son frère. Numa tourna leurs regards vers le ciel, et il en fit descendre les lois. Il éleva des autels ; il institua des danses, des jours de solennité et des sacrifices. Il connut l'effet des prodiges sur l'esprit des peuples, et il en opéra ; il se retira dans les lieux écartés et déserts ; conféra avec les nymphes ; il eut des révélations ; il alluma le feu sacré ; il en confia le soin à des vestales ; il étudia le cours des astres, et il en tira la mesure des temps. Il tempéra les âmes féroces de ses sujets par des exhortations, des institutions politiques et des cérémonies religieuses. Il éleva sa tête entre les dieux pour tenir les hommes prosternés à ses pieds ; il se donna un caractère auguste, en alliant le rôle de pontife à celui de roi. Il immola les coupables avec le fer sacré dont il égorgeait les victimes. Il écrivit, mais il voulut que ses livres fussent déposés avec son corps dans le tombeau, ce qui fut exécuté. Il y avait cinq cent ans qu'ils y étaient, lorsque dans une longue inondation, la violence des eaux sépara les pierres du tombeau de Numa, et offrit au préteur Petilius les volumes de ce législateur. On les lut ; on ne crut pas devoir en permettre la connaissance à la multitude, et on les brula.
Numa disparait d'entre les Romains ; Tullus Hostilius lui succede. Les brigandages recommencent. Toute idée de police et de religion s'éteint au milieu des armes, et la barbarie renait. Ceux qui commandent n'échappent à l'indocîle férocité des peuples, qu'en la tournant contre les nations voisines ; et les premiers rois cherchent leur sécurité dans la même politique que les derniers consuls. Quelle différence d'une contrée à une autre contrée ? A peine les Athéniens et les Grecs en général ont-ils été arrachés des cavernes et rassemblés en société, qu'on voit fleurir au milieu d'eux les Sciences et les Arts, et les progrès de l'esprit humain s'étendre de tous côtés, comme un grand incendie pendant la nuit, qui embrase et éclaire la nation, et qui attire l'attention des peuples circonvoisins. Les Romains au contraire restent abrutis jusqu'au temps où l'académicien Carnéade, le stoïcien Diogène, et le peripatéticien Critolaus viennent solliciter au sénat la remise de la somme d'argent à laquelle leurs compatriotes avaient été condamnés pour le dégât de la ville d'Orope. Publius Scipion Nasica et Marius Marcellus étaient alors consuls, et Aulus-Albinus exerçait la préture.
Ce fut un événement que l'apparition dans Rome des trois philosophes d'Athènes. On accourut pour les entendre. On distingua dans la foule, Laelius, Furius et Scipion, celui qui fut dans la suite surnommé l'Africain. La lumière allait prendre, lorsque Caton l'ancien, homme superstitieusement attaché à la grossiereté des premiers temps, et en qui les infirmités de la vieillesse augmentaient encore une mauvaise humeur naturelle, pressa la conclusion de l'affaire d'Orope, et fit congédier les ambassadeurs.
On enjoignit peu de temps après au préteur Pomponius, de veiller à ce qu'il n'y eut ni école, ni philosophe dans Rome, et l'on publia contre les rhéteurs ce fameux decret qu'Aulugelle nous a conservé ; il est conçu en ces termes : Sur la dénonciation qui nous a été faite, qu'il y avait parmi nous des hommes qui accréditaient un nouveau genre de discipline ; qu'ils tenaient des écoles où la jeunesse romaine s'assemblait ; qu'ils se donnaient le titre de rhéteurs latins, et que nos enfants perdaient le temps à les entendre : nous avons pensé que nos ancêtres instruisaient eux-mêmes leurs enfants et qu'ils avaient pourvu aux écoles, où ils avaient jugé convenable qu'on les enseignât ; que ces nouveaux établissements étaient contre les mœurs et les usages des premiers temps ; qu'ils étaient mauvais et qu'ils devaient nous déplaire ; en conséquence nous avons conclu à ce qu'il fût déclaré, et à ceux qui tenaient ces écoles nouvelles, et à ceux qui s'y rendent, qu'ils faisaient une chose qui nous déplaisait.
Ceux qui souscrivirent à ce decret étaient bien éloignés de soupçonner qu'un jour les ouvrages de Ciceron, le poème de Lucrèce, les comédies de Plaute et de Térence, les vers d'Horace et de Virgile, les élégies de Tibulle, les madrigaux de Catulle, l'histoire de Salluste, de Tite-Live et de Tacite, les fables de Phèdre, feraient plus d'honneur au nom romain que toutes ses conquêtes, et que la postérité ne pourrait arracher ses yeux remplis d'admiration de dessus les pages sacrées de ses auteurs, tandis qu'elle les détournerait avec horreur de l'inscription de Pompée, après avoir égorgé trois millions d'hommes. Que reste-t-il de toute cette énorme grandeur de Rome ? La mémoire de quelques actions vertueuses, et quelques lignes d'une écriture immortelle pour distraire d'une longue suite d'atrocités.
L'éloquence pouvait tout dans Athènes. Les hommes rustiques et grossiers qui commandaient dans Rome, craignirent que bientôt elle n'y exerçât le même despotisme. Il leur était bien plus facîle de chasser les Philosophes, que de le devenir. Mais la première impression était faite, et ce fut inutilement que l'on renouvella quelquefois le decret de proscription. La jeunesse se porta avec d'autant plus de fureur à l'étude, qu'elle était défendue. Les temps montrèrent que Caton et les pères conscripts qui avaient opiné après lui, avaient manqué doublement de jugement. Ils passèrent ; et les jeunes gens qui s'étaient instruits secrétement, leur succédèrent aux premières fonctions de la république, et furent des protecteurs déclarés de la science. La conquête de la Grèce acheva l'ouvrage. Les Romains devinrent les disciples de ceux dont ils s'étaient rendus les maîtres par la force des armes, et ils rapportèrent sur leurs fronts le laurier de Bellone entrelacé de celui d'Apollon. Alexandre mettait Homère sous son oreiller ; Scipion y mit Xénophon. Ils goutèrent particulièrement l'austérité stoïcienne. Ils connurent successivement l'Epicuréisme, le Platonisme, le Pythagorisme, le Cynisme, l'Aristotélisme, et la Philosophie eut des sectateurs parmi les grands, parmi les citoyens, dans la classe des affranchis et des esclaves.
Lucullus s'attacha à l'académie ancienne. Il recueillit un grand nombre de livres ; il en forma une bibliothèque très-riche, et son palais fut l'asîle de tous les hommes instruits qui passèrent d'Athènes à Rome.
Sylla fit couper les arbres du lycée et des jardins d'académies, pour en construire des machines de guerre ; mais au milieu du tumulte des armes, il veilla à la conservation de la bibliothèque d'Apellicon de Teïos.
Ennius embrassa la doctrine de Pythagore ; elle plut aussi à Nigidius Figulus. Celui-ci s'appliqua à l'étude des Mathématiques et de l'Astronomie. Il écrivit des animaux, des augures, des vents.
Marius Brutus préféra le Platonisme et la doctrine de la première académie, à toutes les autres manières de philosopher qui lui étaient également connues ; mais il vécut en stoïcien.
Ciceron, qui avait été proscrit par les triumvirs avec M. Térentius Varron, le plus savant des Romains, inscrit celui-ci dans la classe des sectateurs de l'ancienne académie. Il dit de lui : tu aetatem patriae, tu descriptiones temporum, tu sacrorum jura, tu sacerdotum, tu domesticam, tu bellicam disciplinam, tu sedem regionum et locorum, tu omnium divinarum humanarumque nomina, genera, officia, causas aperuisti ; plurimumque poetis nostris omninoque latinis et litteris luminis attulisti et verbis, atque ipse varium et elegans omni fère numero poema fecisti ; Philosophiamque multisque locis inchoasti, ad impellendum satis, ad docendum parum.
M. Pison se montra plutôt péripatéticien qu'académicien dans son ouvrage, de finibus bonorum et malorum.
Ciceron fut alternativement péripatéticien, stoïcien, platonicien et sceptique. Il étudia la Philosophie comme un moyen sans lequel il était impossible de se distinguer dans l'art oratoire ; et l'art oratoire, comme un moyen sans lequel il n'y avait point de dignité à obtenir dans la république. Sa vie fut pusillanime, et sa mort héroïque.
Le peuple que son éloquence avait si souvent rassemblé aux rostres, vit au même endroit ses mains exposées à côté de sa tête. L'existence de ces dieux immortels, qu'il atteste avec tant d'emphase et de véhémence dans ses harangues publiques, lui fut très-suspecte dans son cabinet.
Quintus Lucilius Balbus fit honneur à la secte stoïcienne.
Lucain a dit de Caton d'Utique :
Hi mores, haec duri immota Catonis
Secta fuit, servare modum, finemque tenere,
Naturamque sequi, patriamque impendere vitam,
Nec sibi, sed toti genitum se credere mundo ;
Huic epulae, vicisse famem, magnique penates
Summovisse hyemem tecto ; pretiosaque vestis,
Hirtam membra super Romani more quiritis
Induxisse togam, Venerisque huic maximus usus,
Progenies. Urbi pater est, urbique maritus.
Justitiae cultor, rigidi servator honesti,
In commune bonus, nullosque Catonis in actus
Subrepsit, partemque tulit sibi nata voluptas.
Ce caractère où il y a plus d'idées que de poésie, plus de force que de nombre et d'harmonie, est celui du stoïcien parfait. Il mourut entre Apollonide et Démétrius, en disant à ces philosophes : " Ou détruisez les principes que vous m'avez inspirés, ou permettez que je meure ".
Andronicus de Rhodes suivit la philosophie d'Aristote.
Ciceron envoya son fils à Athènes, sous le péripatéticien Cratippus.
Torquatus, Velleius, Atticus, Papirius, Paetus, Verrius, Albutius, Pison, Pansa, Fabius Gallus, et beaucoup d'autres hommes célèbres embrassèrent l'Epicuréisme.
Lucrèce chanta la doctrine d'Epicure. Virgile, Varius, Horace écrivirent et vécurent en épicuriens.
Ovide ne fut attaché à aucun système. Il les connut presque tous, et ne retint d'aucun que ce qui prêtait des charmes à la fiction.
Manilius, Lucain et Perse panchèrent vers le Stoïcisme.
Séneque inscrit le nom de Tite-Live parmi les Philosophes en général.
Tacite fut stoïcien ; Strabon aristotélicien ; Mécène épicurien ; Cneius Julius et Thraseas stoïciens ; Helvidius Priscus prit le même manteau.
Auguste appela auprès de lui les Philosophes.
Tibere n'eut point d'aversion pour eux.
Claude, Néron et Domitien les chassèrent.
Trajan, Hadrien et les Antonins les rapellèrent.
Ils ne furent pas sans considération sous Septime Sévère.
Héliogabale les maltraita ; ils jouirent d'un sort plus supportable sous Alexandre Sévère et sous les Gordiens.
La Philosophie, depuis Auguste jusqu'à Constantin, eut quelques protecteurs ; et l'on peut dire à son honneur que ses ennemis, parmi les princes, furent en même temps ceux de la justice, de la liberté, de la vertu, de la raison et de l'humanité. Et s'il est permis de prononcer d'après l'expérience d'un grand nombre de siècles écoulés, on peut avancer que le souverain qui haïra les sciences, les arts et la Philosophie, sera un imbécile ou un méchant, ou tous les deux.
Terminons cet abrégé historique de la philosophie des Romains, c'est qu'ils n'ont rien inventé dans ce genre ; qu'ils ont passé leur temps à s'instruire de ce que les Grecs avaient découvert, et qu'en Philosophie, les maîtres du monde n'ont été que des écoliers.
ROMAINS, ROI DES, (Histoire moderne, Droit public) c'est le nom qu'on donne en Allemagne à un prince, qui, du vivant de l'empereur, est élu par les électeurs, pour être son vicaire et son lieutenant-général, et pour lui succéder dans la dignité impériale, aussi-tôt après sa mort, sans avoir besoin pour cela d'une nouvelle élection.
L'usage d'élire un roi des Romains a été établi en Allemagne, pour éviter les inconvénients des interrègnes, et pour assurer le bien-être et la tranquillité de l'empire que la concurrence des contendants pouvait altérer. Pour élire un roi des Romains, il faut que tous les électeurs s'assemblent et délibèrent si la chose est avantageuse au bien de l'empire. En vertu de la capitulation impériale, le roi des Romains peut être choisi par les électeurs indépendamment du consentement de l'empereur, lorsqu'il n'a point de bonnes raisons pour s'y opposer. Les Jurisconsultes ne sont point d'accord pour savoir si un roi des Romains a, en cette qualité, une autorité qui lui est propre, ou si son autorité n'est qu'empruntée (delegata). Il parait constant que le roi des Romains n'est que le successeur désigné de l'empereur, et qu'il ne doit être regardé que comme le premier des sujets de l'empire.
Les empereurs qui en ont eu le crédit, ont eu soin de faire élire leur fils ou leur frère roi des Romains, pour assurer dans leur famille la dignité impériale qui n'est point héréditaire, mais qui est élective. Voyez EMPEREUR et CAPITULATION IMPERIALE.
ROMAINS, JEUX, (Antiquité romaine) ou les grands jeux, parce que c'était les plus solennels de tous. Ils avaient été institués par le premier Tarquin. On les célébrait à l'honneur de Jupiter, de Junon et de Minerve. Ils commençaient toujours le 4 Septembre, et ils duraient 4 jours du temps de Ciceron. Leur durée fut augmentée dans la suite, aussi-bien que celle de la plupart des autres jeux publics, quand les empereurs se furent emparés du droit de les faire représenter. Quoique les jeux romains fussent ordinairement des jeux circenses, ludi circenses, selon Plutarque ; cependant on les faisait aussi scéniques ; je n'en veux pour preuve que ce passage de Tite-Live, lib. XXXI. Ludi romani scenici eo anno magnificè, apparatèque facti, ab aedilibus curulibus L. Valerio Flacco et L. Quintio Flaminio biduum instaurati sunt. " Les jeux romains scéniques furent célébrés cette année - là magnifiquement, et avec apparat, par les édiles curules L. Valérius Flaccus, et L. Quintius Flaminius, durant deux jours continuels ". (D.J.)
ROMAIN, adj. (Arithmétique) le chiffre romain n'est autre chose que les lettres majuscules de l'alphabet I, V, X, L, C, D, etc. auxquelles on a donné des valeurs déterminées ; soit qu'on les prenne séparément ; soit qu'on les considère relativement à la place qu'elles occupent avec d'autres lettres. Voyez CARACTERE.
Le chiffre romain est fort en usage dans les inscriptions, sur les cadrants des horloges, etc. Voyez CHIFFRE. (E)
ROMAIN gros, fondeurs en caractères d'Imprimerie, est le onzième des corps sur lesquels on fond les caractères d'imprimerie ; sa proportion est de trois lignes mesure de l'échelle ; il est le corps double de la gaillarde, et le sien est le trimégiste. Voyez PROPORTIONS DES CARACTERES, et l'exemple à l'article CARACTERE.
ROMAIN petit, sixième corps des caractères d'imprimerie ; sa proportion est d'une ligne quatre points mesure de l'échelle ; son corps double est le petit parangon. Voyez PROPORTION DES CARACTERES D'IMPRIMERIE, et l'exemple à l'article CARACTERE.
ROMAIN EMPIRE
- Détails
- Écrit par Jean Baptiste de La Chapelle (E)
- Catégorie parente: Morale
- Catégorie : Gouvernement romain
- Affichages : 1635