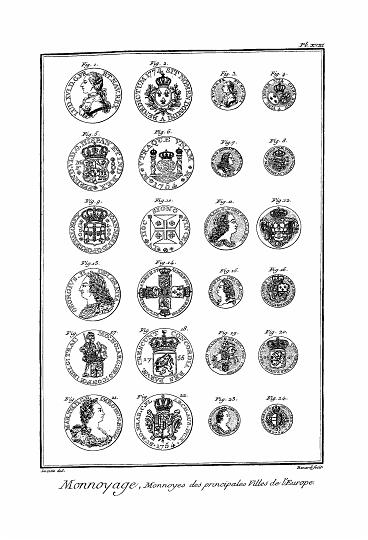S. f. (Histoire ancienne et moderne, Commerce) on entend par ce mot le transport d'un peuple, ou d'une partie d'un peuple, d'un pays à un autre.
Ces migrations ont été fréquentes sur la terre, mais elles ont eu souvent des causes et des effets différents : c'est pour les distinguer que nous les rangerons dans six classes que nous allons caractériser.
I. Environ 350 ans après le déluge, le genre humain ne formait encore qu'une seule famille : à la mort de Noé, ses descendants, déjà trop multipliés pour habiter ensemble, se séparèrent. La postérité de chacun des fils de ce patriarche, Japhet, Sem, et Cham, partagée en différentes tribus, partit des plaines de Sennaar pour chercher de nouvelles habitations, et chaque tribu devint une nation particulière ; ainsi se peuplèrent de proche en proche les diverses contrées de la terre, à mesure que l'une ne pouvait plus nourrir ses habitants.
Telle est la première espèce de colonies : le besoin l'occasionna ; son effet particulier fut la subdivision des tribus ou des nations.
II. Lors même que les hommes furent répandus sur toute la surface de la terre, chaque contrée n'était point assez occupée pour que de nouveaux habitants ne pussent la partager avec les anciens.
A mesure que les terres s'éloignaient du centre commun d'où toutes les nations étaient parties, chaque famille séparée errait au gré de son caprice, sans avoir d'habitation fixe : mais dans les pays où il était resté un plus grand nombre d'hommes, le sentiment naturel qui les porte à s'unir, et la connaissance de leurs besoins réciproques, y avaient formé des sociétés. L'ambition, la violence, la guerre, et même la multiplicité, obligèrent dans la suite des membres de ces sociétés de chercher de nouvelles demeures.
C'est ainsi qu'Inachus, phénicien d'origine, vint fonder en Grèce le royaume d'Argos, dont sa postérité fut depuis dépouillée par Danaus, autre avanturier sorti de l'Egypte. Cadmus n'osant reparaitre devant Agenor son père roi de Tyr, aborda sur les confins de la Phocide, et y jeta les fondements de la ville de Thebes. Cécrops à la tête d'une colonie égyptienne bâtit cette ville, qui depuis sous le nom d'Athènes devint le temple des Arts et des Sciences. L'Afrique vit sans inquiétude s'élever les murs de Carthage, qui la rendit bientôt tributaire. L'Italie reçut les Troie.s échappés à la ruine de leur patrie.
Ces nouveaux habitants apportèrent leurs lois et la connaissance de leurs arts dans les régions où le hasard les conduisit ; mais ils ne formèrent que de petites sociétés, qui presque toutes s'érigèrent en républiques.
La multiplicité des citoyens dans un territoire borné ou peu fertile, alarmait la liberté : la politique y remédia par l'établissement des colonies. La perte même de la liberté, les révolutions, les factions, engageaient quelquefois une partie du peuple à quitter sa patrie pour former une nouvelle société plus conforme à son génie.
Telle est entr'autres l'origine de la plupart des colonies des Grecs en Asie, en Sicile, en Italie, dans les Gaules. Les vues de conquête et d'agrandissement n'entrèrent point dans leur plan : quoiqu'assez ordinairement chaque colonie conservât les lais, la religion, et le langage de la métropole, elle était libre, et ne dépendait de ses fondateurs que par les liens de la reconnaissance, ou par le besoin d'une défense commune : on les a même vues dans quelques occasions, assez rares il est vrai, armées l'une contre l'autre.
Cette seconde espèce de colonies eut divers motifs ; mais l'effet qui la caractérise, ce fut de multiplier les sociétés indépendantes parmi les nations, d'augmenter la communication entr'elles, et de les polir.
III. Dès que la terre eut assez d'habitants pour qu'il leur devint nécessaire d'avoir des propriétés distinctes, cette propriété occasionna les différends entre eux. Ces différends jugés par les lois entre les membres d'une société, ne pouvaient l'être de même entre les sociétés indépendantes ; la force en décida : la faiblesse du vaincu fut le titre d'une seconde usurpation, et le gage du succès ; l'esprit de conquête s'empara des hommes.
Le vainqueur, pour assurer ses frontières, dispersait les vaincus dans les terres de son obéissance, et distribuait les leurs à ses propres sujets ; ou bien il se contentait d'y bâtir et d'y fortifier des villes nouvelles, qu'il peuplait de ses soldats et des citoyens de son état.
Telle est la troisième espèce de colonies, dont presque toutes les histoires anciennes nous fournissent des exemples, surtout celles des grands états. C'est par ces colonies qu'Alexandre contint une multitude de peuples vaincus si rapidement. Les Romains, dès l'enfance de leur république, s'en servirent pour l'accroitre ; et dans le temps de leur vaste domination, ce furent les barrières qui la défendirent longtemps contre les Parthes et les peuples du Nord. Cette espèce de colonie était une suite de la conquête, et elle en fit la sûreté.
IV. Les excursions des Gaulois en Italie, des Goths et des Vandales dans toute l'Europe et en Afrique, des Tartares dans la Chine, forment une quatrième espèce de colonies. Ces peuples chassés de leur pays par d'autres peuples plus puissants, ou par la misere, ou attirés par la connaissance d'un climat plus doux et d'une campagne plus fertile, conquirent pour partager les terres avec les vaincus, et n'y faire qu'une nation avec eux : bien différents en cela des autres conquérants qui semblaient ne chercher que d'autres ennemis, comme les Scythes en Asie ; ou à étendre leurs frontières, comme les fondateurs des quatre grands empires.
L'effet de ces colonies de barbares fut d'effaroucher les Arts, et de répandre l'ignorance dans les contrées où elles s'établirent : en même temps elles y augmentèrent la population, et fondèrent de puissantes monarchies.
V. La cinquième espèce de colonies est de celles qu'a fondées l'esprit de commerce, et qui enrichissent la métropole.
Tyr, Carthage, et Marseille, les seules villes de l'antiquité qui aient fondé leur puissance sur le commerce, sont aussi les seules qui aient suivi ce plan dans quelques-unes de leurs colonies. Utique bâtie par les Tyriens près de 200 ans avant la fuite d'Elissa, plus connue sous le nom de Didon, ne prétendit jamais à aucun empire sur les terres de l'Afrique : elle servait de retraite aux vaisseaux des Tyriens, ainsi que les colonies établies à Malthe et le long des côtes fréquentées par les Phéniciens. Cadix, l'une de leurs plus anciennes et de leurs plus fameuses colonies, ne prétendit jamais qu'au commerce de l'Espagne, sans entreprendre de lui donner des lais. La fondation de Lilybée en Sicîle ne donna aux Tyriens aucune idée de conquête sur cette ile.
Le commerce ne fut point l'objet de l'établissement de Carthage, mais elle chercha à s'agrandir par le commerce. C'est pour l'étendre ou le conserver exclusivement, qu'elle fut guerrière, et qu'on la vit disputer à Rome la Sicile, la Sardaigne, l'Espagne, l'Italie, et même ses remparts. Ses colonies le long des côtes de l'Afrique, sur l'une et l'autre mer jusqu'à Cerné, augmentaient plus ses richesses que la force de son empire.
Marseille, colonie des Phocéens chassés de leur pays et ensuite de l'île de Corse par les Tyriens, ne s'occupa dans un territoire stérîle que de sa pêche, de son commerce, et de son indépendance. Ses colonies en Espagne et sur les côtes méridionales des Gaules, n'avaient point d'autres motifs.
Ces sortes d'établissements étaient doublement nécessaires aux peuples qui s'adonnaient au commerce. Leur navigation dépourvue du secours de la boussole, était timide ; ils n'osaient se hasarder trop loin des côtes, et la longueur nécessaire des voyages exigeait des retraites sures et abondantes pour les navigateurs. La plupart des peuples avec lesquels ils trafiquaient, ou ne se rassemblaient point dans des villes, ou uniquement occupés de leurs besoins, ne mettaient aucune valeur au superflu. Il était indispensable d'établir des entrepôts qui fissent le commerce intérieur, et où les vaisseaux pussent en arrivant faire leurs échanges.
La forme de ces colonies répondait assez à celles des nations commerçantes de l'Europe en Afrique et dans l'Inde, elles y ont des comptoirs et des forteresses, pour la commodité et la sûreté de leur commerce. Ces colonies dérogeraient à leur institution, si elles devenaient conquérantes, à moins que l'état ne se chargeât de leur dépense ; il faut qu'elles soient sous la dépendance d'une compagnie riche et exclusive, en état de former et de suivre des projets politiques. Dans l'Inde on ne regarde comme marchands que les Anglais, parmi les grandes nations de l'Europe qui y commercent ; sans-doute, parce qu'ils y sont les moins puissants en possessions.
IV. La découverte de l'Amérique vers la fin du quinzième siècle, a multiplié les colonies européennes, et nous en présente une sixième espèce.
Toutes celles de ce continent ont eu le commerce et la culture tout-à-la-fais pour objet de leur établissement, ou s'y sont tournées : dès-lors il était nécessaire de conquérir les terres, et d'en chasser les anciens habitants, pour y en transporter de nouveaux.
Ces colonies n'étant établies que pour l'utilité de la métropole, il s'ensuit :
1°. Qu'elles doivent être sous sa dépendance immédiate, et par conséquent sous sa protection.
2°. Que le commerce doit en être exclusif aux fondateurs.
Une pareille colonie remplit mieux son objet, à mesure qu'elle augmente le produit des terres de la métropole, qu'elle fait subsister un plus grand nombre de ses hommes, et qu'elle contribue au gain de son commerce avec les autres nations. Ces trois avantages peuvent ne pas se rencontrer ensemble dans des circonstances particulières ; mais l'un des trois au moins doit compenser les autres dans un certain degré. Si la compensation n'est pas entière, ou si la colonie ne procure aucun des trois avantages, on peut décider qu'elle est ruineuse pour le pays de la domination, et qu'elle l'énerve.
Ainsi le profit du commerce et de la culture de nos colonies est précisément, 1° le plus grand produit que leur consommation occasionne au propriétaire de nos terres, les frais de culture déduits ; 2° ce que reçoivent nos artistes et nos matelots qui travaillent pour elles, et à leur occasion ; 3° tout ce qu'elles suppléent de nos besoins ; 4° tout le superflu qu'elles nous donnent à exporter.
De ce calcul, on peut tirer plusieurs conséquences :
La première est que les colonies ne seraient plus utiles, si elles pouvaient se passer de la métropole : ainsi c'est une loi prise dans la nature de la chose, que l'on doit restraindre les arts et la culture dans une colonie, à tels et tels objets, suivant les convenances du pays de la domination.
La seconde conséquence est que si la colonie entretient un commerce avec les étrangers, ou que si l'on y consomme les marchandises étrangères, le montant de ce commerce et de ces marchandises est un vol fait à la métropole ; vol trop commun, mais punissable par les lais, et par lequel la force réelle et relative d'un état est diminuée de tout ce que gagnent les étrangers.
Ce n'est donc point attenter à la liberté de ce commerce, que de le restraindre dans ce cas : toute police qui le tolere par son indifférence, ou qui laisse à certains ports la facilité de contrevenir au premier principe de l'institution des colonies, est une police destructive du commerce, ou de la richesse d'une nation.
La troisième conséquence est qu'une colonie sera d'autant plus utile, qu'elle sera plus peuplée, et que ses terres seront plus cultivées.
Pour y parvenir surement, il faut que le premier établissement se fasse aux dépens de l'état qui la fonde ; que le partage des successions y soit égal entre les enfants, afin d'y fixer un plus grand nombre d'habitants par la subdivision des fortunes ; que la concurrence du commerce y soit parfaitement établie, parce que l'ambition des négociants fournira aux habitants plus d'avances pour leurs cultures, que ne le feraient des compagnies exclusives, et dès-lors maîtresses tant du prix des marchandises, que du terme des payements. Il faut encore que le sort des habitants soit très-doux, en compensation de leurs travaux et de leur fidélité : c'est pourquoi les nations habiles ne retirent tout au plus de leur colonies, que la dépense des forteresses et des garnisons ; quelquefois même elles se contentent du bénéfice général du commerce.
Les dépenses d'un état avec ses colonies, ne se bornent pas aux premiers faits de leur établissement. Ces sortes d'entreprises exigent de la constance, de l'opiniâtreté même, à moins que l'ambition de la nation n'y supplée par des efforts extraordinaires ; mais la constance a des effets plus surs et des principes plus solides : ainsi jusqu'à ce que la force du commerce ait donné aux colonies une espèce de consistance, elles ont besoin d'encouragement continuel, suivant la nature de leur position et de leur terrain ; si on les néglige, outre la perte des premières avances et du temps, on les expose à devenir la proie des peuples plus ambitieux ou plus actifs.
Ce serait cependant aller contre l'objet même des colonies, que de les établir en dépeuplant le pays de la domination. Les nations intelligentes n'y envoyent que peu-à-peu le superflu de leurs hommes, ou ceux qui y sont à charge à la société : ainsi le point d'une première population est la quantité d'habitants nécessaires pour défendre le canton établi contre les ennemis qui pourraient l'attaquer ; les peuplades suivantes servent à l'agrandissement du commerce ; l'excès de la population serait la quantité d'hommes inutiles qui s'y trouveraient, ou la quantité qui manquerait au pays de la domination. Il peut donc arriver des circonstances où il serait utîle d'empêcher les citoyens de la métropole de sortir à leur gré pour habiter les colonies en général, ou telle colonie en particulier.
Les colonies de l'Amérique ayant établi une nouvelle forme de dépendance et de commerce, il a été nécessaire d'y faire des lois nouvelles. Les législateurs habiles ont eu pour objet principal de favoriser l'établissement et la culture : mais lorsque l'un et l'autre sont parvenus à une certaine perfection, il peut arriver que ces lois deviennent contraires à l'objet de l'institution, qui est le commerce ; dans ce cas elles sont même injustes, puisque c'est le commerce qui par son activité en a donné à toutes les colonies un peu florissantes. Il paraitrait donc convenable de les changer ou de les modifier, à mesure qu'elles s'éloignent de leur esprit. Si la culture a été favorisée plus que le commerce, ç'a été en faveur même du commerce ; dès que les raisons de préférence cessent, l'équilibre doit être rétabli.
Lorsqu'un état a plusieurs colonies qui peuvent communiquer entr'elles, le véritable secret d'augmenter les forces et les richesses de chacune, c'est d'établir entr'elles une correspondance et une navigation suivies. Ce commerce particulier a la force et les avantages du commerce intérieur d'un état, pourvu que les denrées des colonies ne soient jamais de nature à entrer en concurrence avec celles de la métropole. Il en accrait réellement la richesse, puisque l'aisance des colonies lui revient toujours en bénéfice, par les consommations qu'elle occasionne : par cette même raison, le commerce actif qu'elles font avec les colonies étrangères, des denrées pour leur propre consommation, est avantageux, s'il est contenu dans ses bornes légitimes.
Le commerce dans les colonies et avec elles, est assujetti aux maximes générales, qui par-tout le rendent florissant : cependant des circonstances particulières peuvent exiger que l'on y déroge dans l'administration : tout doit changer avec les temps ; et c'est dans le parti que l'on tire de ces changements forcés, que consiste la suprême habileté.
Nous avons Ve qu'en général la liberté doit être restreinte en faveur de la métropole. Un autre principe toujours constant, c'est que tout exclusif, tout ce qui prive le négociant et l'habitant du bénéfice, de la concurrence, les péages, les servitudes, ont des effets plus pernicieux dans une colonie, qu'en aucun autre endroit ; le commerce y est si resserré, que l'impression y en est plus fréquente ; le découragement y est suivi d'un abandon total : quand même ces effets ne seraient pas instantanés, il est certain que le mal n'en serait que plus dangereux.
Ce qui contribue à diminuer la quantité de la denrée ou à la renchérir, diminue nécessairement le bénéfice de la métropole, et fournit aux autres peuples une occasion favorable de gagner la supériorité, ou d'entrer en concurrence.
Nous n'entrerons point ici dans le détail des diverses colonies européennes à l'Amérique, en Afrique, et dans les Indes orientales, afin de ne pas rendre cet article trop long : d'ailleurs la place naturelle de ces matières est au commerce de chaque état. Voyez les mots FRANCE, LONDRES, HOLLANDE, ESPAGNE, PORTUGAL, DANEMARCK.
On peut consulter sur les colonies anciennes la Genèse, chap. Xe Hérodote, Thucydide, Diodore de Sicile, Strabon, Justin, la géographie sacrée de Sam. Bochart, l'histoire du commerce et de la navigation des anciens, la dissertation de M. de Bougainville sur les devoirs réciproques des métropoles et des colonies grecques : à l'égard des nouvelles colonies, M. Melon dans son essai politique sur le commerce, et l'esprit des lais, ont fort bien traité la partie politique : sur le détail, on peut consulter les voyages du P. Labat, celui de don Antonio de Ulloa, de M. Fraizier, et le livre intitulé commerce de la Hollande. Cet article est de M. V. D. F.
Articles populaires Morale
EMBOITER
v. act. (Commerce) mettre ou serrer quelque marchandise dans une boite, pour la garantir de la pluie, etc. Ce terme signifie souvent la même chose qu'encaisser. Voyez ENCAISSER. Dictionnaire de Comm. de Trév. et de Chamb. (G)EMBOITER, (Hydraulique) c'est enchâsser un tuyau dans un autre ; ce qui se pratique en posant des tuyaux de bois ou de grès pour conduire les eaux. (K)
Lire la suite...