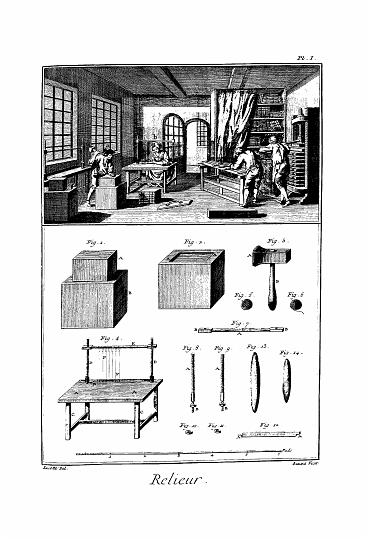ARBRE DE SAINT -, (Histoire naturelle, Botanique) arbre des Indes orientales. Ses feuilles ressemblent à celles du lierre, ses fleurs sont comme des lys violets, dont l'odeur est très-agréable. Cet arbre ne produit aucun fruit.
THOMAS, Saint -, (Géographie moderne) île d'Afrique, dans la mer d'Ethiopie, sous la ligne. Elle a été découverte par les Portugais en 1495. On lui donne environ douze lieues de diamètre ; l'air y est malsain, à cause des chaleurs excessives qu'on y ressent. Le terroir en est cependant fertîle en raisins et en cannes de sucre. Pavoasan est la capitale de cette ile. (D.J.)
THOMAS, Saint -, (Géographie moderne) île de l'Amérique septentrionale, une des Antilles, au levant de Porto-Rico. Elle a six lieues de tour, et appartient aux Danois. Long. 18. 27. (D.J.)
THOMAS, CHRETIENS DE SAINT, (Histoire ecclésiastique) c'est le nom qu'on donne aux chrétiens indiens, établis dans la presqu'île des Indes, au royaume de Cochin, et sur la côte de Malabar et de Coromandel.
On ne doit pas douter que le christianisme n'ait percé de bonne heure dans les Indes, et l'on peut le prouver par Cosmas, témoin oculaire d'une partie de ce qu'il avance dans sa topographie chrétienne. " Il y a, dit-il, dans l'île Taprobane, dans l'Inde intérieure, dans la mer des Indes, une église de chrétiens, avec des clercs et des fidèles ; je ne sai s'il n'y en a point au-delà. De même dans les pays de Malé, où croit le poivre, et dans la Calliane, il y a un évêque qui vient de Perse, où il est ordonné ".
Nous avons dans ces paroles, un témoignage de christianisme, établi aux Indes dans le sixième siècle. Cosmas écrivait environ l'an 547 de Notre-Seigneur, et ces chrétiens se sont conservés jusqu'à notre siècle dans un état qui parait n'avoir été exposé par rapport à la religion, à aucune contradiction violente, hormis celle qu'ils eurent à essuyer de la part des Portugais, vers la fin du seizième siècle.
Le P. Montfaucon a rendu service à l'Eglise et à la république des lettres, par la publication et la traduction de l'ouvrage de Cosmas. Sans parler de plusieurs choses curieuses qui y sont rapportées, on y trouve les plus anciennes connaissances qu'on ait de l'établissement de l'Eglise chrétienne sur la côte de Malabar, et de la dépendance où était leur évêque, à l'égard du catholique ou métropolitain de Perse : dépendance qui a continué jusqu'à-ce que les Portugais, qui s'étaient rendus puissants dans les Indes, mirent tout en œuvre pour amener cette église à la tutele du pape, auquel elle n'avait jamais été soumise.
Les chrétiens de S. Thomas se donnent une antiquité bien plus reculée que celle dont nous venons de parler. Ils prétendent que l'apôtre S. Thomas est le fondateur de leur église, et les Portugais leurs ennemis, n'ont pas peu contribué à appuyer cette tradition. Antoine Gouvea, religieux Augustin, la soutient dans son livre intitulé : Jornada do Arçobispo de Goa, imprimé à Conimbre en 1606.
Il prétend que dans la répartition de toutes les parties du monde qui se fit entre les apôtres, les Indes échurent à S. Thomas, qui après avoir établi le christianisme dans l'Arabie heureuse, et dans l'île Dioscoride, appelée aujourd'hui Socotora, se rendit à Cranganor, où résidait alors le principal roi de la côte de Malabar. Le saint apôtre ayant fondé plusieurs églises à Cranganor, vint sur la côte opposée, connue aujourd'hui sous le nom de Coromandel, et s'étant arrêté à Méliapour, que les Européens appellent S. Thomas, il y convertit le roi et tout le peuple.
Je ne suivrai point sa narration romanesque, qui doit peut-être son origine à ceux-là même, qui ont autrefois supposé divers actes sous le nom des apôtres ; entr'autres les actes de S. Thomas, et l'histoire de ses courses dans les Indes. Ces actes fabuleux subsistent encore dans un manuscrit de la bibliothèque du roi de France. M. Simon dans ses observations sur les versions du nouveau Testament, en a donné un extrait, que le savant Fabricius a inséré dans son premier volume des apocryphes du nouveau Testament. Il parait que c'est de-là, que le prétendu Abdias, babylonien, a puisé tout ce qu'il débite dans la vie de S. Thomas ; et il n'est pas surprenant que les chrétiens de Malabar, gens simples et crédules, aient adopté la fable de cette mission, ainsi que beaucoup d'autres.
Il est néanmoins toujours certain, que la connaissance du christianisme est ancienne sur la côte de Malabar, non-seulement par le témoignage de Cosmas, mais encore, parce qu'on trouve dans les souscriptions du concîle de Nicée, celle d'un prélat qui se donne le titre d'évêque de Perse. De plus, un ancien auteur cité par Suidas, dit que les habitants de l'Inde intérieure (c'est le nom que Cosmas donne à la côte de Malabar), les Ibériens et les Arméniens, furent baptisés sous le règne de Constantin.
Les princes du pays, entr'autres Serant Peroumal, empereur de Malabar, fondateur de la ville de Calecut, l'an de J. C. 825, selon M. Vischer, donna de grands privilèges aux chrétiens de la côte. Ils ne dépendent à proprement parler que de leur évêque, tant pour le temporel, que pour le spirituel.
Le roi de Cranganor honora depuis de ses bonnes grâces un arménien nommé Thomas Cana ou marThomas ; ce mot de mar est syriaque, et signifie la même chose que le dom des Espagnols. Il y a de l'apparence que la conformité de nom l'a quelquefois fait confondre avec l'apôtre S. Thomas. Cet homme qui faisait un gros trafic avait deux maisons, l'une du côté du sud, dans le royaume de Cranganor, et l'autre vers le nord, au voisinage d'Augamale.
Dans la première de ces maisons, il tenait son épouse légitime, et dans la seconde, une concubine convertie à la foi. Il eut des enfants de l'une et de l'autre de ces femmes. En mourant, il laissa à ceux qui lui étaient nés de son épouse légitime, les terres qu'il possédait au midi ; et les bâtards héritèrent de tous ses biens qui étaient du côté du nord. Ces descendants de mar Thomas s'étant multipliés, partagèrent tout le christianisme de ces lieux - là. Ceux qui descendent de la femme légitime, passent pour les plus nobles ; ils sont si fiers de leur origine, qu'ils ne contractent point de mariages avec les autres, ne les admettant pas même à la communion dans leurs églises, et ne se servant point de leurs prêtres.
Quelques temps après la fondation de la ville de Coulan, à laquelle commence l'époque du Malabar, c'est-à-dire après l'an 822 de Notre-Seigneur, deux ecclésiastiques syriens vinrent de Babylone dans les Indes : l'un se nommait mar Sapor, et l'autre mar Peroses. Ils abordèrent à Coulan, où le roi voyant qu'ils étaient respectés des chrétiens, leur accorda entr'autres privilèges, celui de bâtir des églises partout où ils voudraient ; ces privilèges subsistent peut-être encore : les chrétiens indiens les firent voir à Alexis de Menezès, écrits sur des lames de cuivre, en langue et caractères malabares, canarins, bisnagares et tamules, qui sont les langues les plus en usage sur ces côtes.
Une si longue suite de prospérités rendit les chrétiens indiens si puissants, qu'ils secouèrent le joug des princes infidèles, et élurent un roi de leur nation. Le premier qui porta ce nom s'appelait Baliarté, et il se donnait le titre de roi des Chrétiens de S. Thomas. Ils se conservèrent quelque temps dans l'indépendance sous leurs propres rais, jusqu'à-ce qu'un d'eux, qui selon une coutume établie dans les Indes, avait adopté pour fils, le roi de Diamper, mourut sans enfants, et ce roi payen lui succéda dans tous ses droits sur les chrétiens des Indes. Ils passèrent ensuite par une adoption semblable sous la juridiction du roi de Cochin, auquel ils étaient soumis, lorsque les Portugais arrivèrent dans les Indes. Il y en avait cependant un nombre assez considérable qui obéissait aux princes voisins.
L'an 1502, Vasco de Gama, amiral du roi de Portugal, étant arrivé à Cochin avec une flotte, ces chrétiens lui envoyèrent des députés, par lesquels ils lui représentèrent que puisqu'il était vassal d'un roi chrétien, au nom duquel il venait pour conquérir les Indes, ils le priaient de les honorer de sa protection et de celle de son roi ; l'amiral leur donna de bonnes paroles, n'étant pas en état de les assister d'une autre manière.
Ils dépendent du catholique de Perse et du patriarche de Babylone, et de Mosul. Ils appellent leurs prêtres, caçanares, dont les fonctions étaient d'expliquer leurs livres écrits en langue syriaque. Les premiers missionnaires qui travaillèrent à leur instruction, pour les soumettre à l'Eglise romaine, furent des Cordeliers ; mais les jésuites envisageant cette charge comme une affaire fort lucrative, obtinrent un collège du roi de Portugal, outre des pensions, et la protection du bras séculier. Malgré tout cela, les chrétiens malabares suivirent leur culte, et ne permirent jamais qu'on fit mention du pape dans leurs prières. Mais il faut ici donner une idée complete des opinions et des rits ecclésiastiques de ces anciens chrétiens.
La première erreur qu'on leur reproche, est l'attachement qu'ils ont pour la doctrine de Nestorius, joint à leur entêtement à nier, que la bienheureuse Vierge soit véritablement la mère de Dieu.
Ils n'admettaient aucunes images dans leurs églises, sinon dans quelques-unes qui étaient voisines des Portugais, dont ils avaient pris cet usage. Cela n'empêchait pas que de tout temps ils n'eussent des croix, pour lesquelles ils avaient beaucoup de respect.
Ils croyaient que les âmes des bienheureux ne verraient Dieu qu'après le jour du jugement universel, opinion qui leur était commune avec les autres églises orientales ; et qui, quoique traitée d'erreur par Gouvea, est en quelque manière appuyée sur la tradition.
Ils ne connaissaient que trois sacrements, le baptême, l'ordre et l'eucharistie. Dans la forme du baptême, il y avait fort peu d'uniformité entre les diverses églises du diocèse.
Quelques - uns de leurs ecclésiastiques administraient ce sacrement d'une manière invalide, au sentiment de l'archevêque, qui à l'exemple des autres ecclésiastiques de sa nation, rapportait tout à la théologie scolastique. Dans cette persuasion, il rebaptisa tout le peuple d'une des nombreuses églises de l'évêché.
Ils différaient le baptême des enfants, souvent un mois, quelquefois plus longtemps ; il arrivait même qu'ils ne les baptisaient qu'à l'âge de sept, de huit, ou de dix ans, contre la coutume des Portugais qui baptisent ordinairement les leurs le huitième jour après la naissance, en quoi ils semblent suivre le rit de la circoncision des Juifs, comme l'a remarqué l'auteur du Traité de l'inquisition de Goa.
Ils ne connaissaient aucun usage des saintes huiles, ni dans le baptême, ni dans l'administration des autres sacrements : seulement après le baptême des enfants, ils les frottaient par tout le corps d'huîle de cocos, ou de gergelin, qui est une espèce de safran des Indes. Cet usage, quoique sans prières, ni bénédiction, passait chez eux pour quelque chose de sacré.
Ils n'avaient aucune connaissance des sacrements de confirmation et d'extrême-onction ; ils n'admettaient point aussi la confession auriculaire.
Ils étaient fort devots au sacrement de l'eucharistie, et communiaient tous sans exception le Jeudi-Saint. Ils n'y apportaient point d'autre préparation que le jeune.
Leur messe ou liturgie était altérée par diverses additions que Nestorius y avait faites. Avant l'arrivée des Portugais dans les Indes, ils consacraient avec des gâteaux, où ils mettaient de l'huîle et du sel. Ils faisaient cuire ces gâteaux dans l'église même. Cette coutume de paitrir le pain de l'eucharistie avec de l'huîle et du sel, est commune aux nestoriens et aux jacobites de Syrie. Il faut observer ici, qu'ils ne mêlaient dans la pâte l'huîle qu'en très-petite quantité, ce qui ne change point la nature du pain. Dans l'église romaine, on se sert d'un peu de farine délayée dans de l'eau, et séchée ensuite entre deux fers que l'on a soin de frotter de temps-en-temps de cire blanche, de peur que la farine ne s'y attache. C'est donc une colle séchée, mêlée de cire ; ce qui semble plus contraire à l'institution du sacrement, que l'huîle des églises syriennes.
Au lieu de vin ordinaire, ils se servaient comme les Abyssins, d'une liqueur exprimée de raisins secs, qu'ils faisaient infuser dans de l'eau. Au défaut de ces raisins, ils avaient recours au vin de palmier.
Celui qui servait le prêtre à l'autel portait l'étole, soit qu'il fût diacre, ou qu'il ne le fût pas. Il assistait à l'office l'encensoir à la main, chantant en langue syriaque, et récitant lui seul presque autant de paroles que le prêtre qui officiait.
Les ordres sacrés étaient en grande estime chez eux. Il y avait peu de maisons où il n'y eut quelqu'un de promu à quelque degré ecclésiastique. Outre que ces dignités les rendaient respectables, elles ne les excluaient d'aucune fonction séculière. Ils recevaient les ordres sacrés dans un âge peu avancé : ordinairement ils étaient promus à la prêtrise dès l'âge de dix-sept, de dix-huit et de vingt-ans. Les prêtres se mariaient même à des veuves, et rien ne les empêchait de contracter de secondes noces après la mort de leurs femmes. Il arrivait assez souvent que le père, le fils et le petit-fils, étaient prêtres dans la même église.
Les femmes des prêtres, qu'ils appelaient caçaneires, avaient le pas par-tout. Elles portaient, pendue au col, une croix d'or, ou de quelqu'autre métal. Les ecclésiastiques des ordres inférieurs, qui ne paraissent pas avoir été distingués parmi ces chrétiens, s'appelaient chamazès, mot syriaque qui signifie diacre ou ministre.
L'habit ordinaire des ecclésiastiques consistait dans de grands caleçons blancs, par-dessus lesquels ils revétaient une longue chemise. Quand ils y ajoutaient une soutane blanche ou noire, c'était leur habit décent. Leurs couronnes ou tonsures, étaient semblables à celles des moines ou des chanoines réguliers.
Ils ne récitaient l'office divin qu'à l'église, où ils le chantaient à haute voix deux fois le jour ; la première à trois heures du matin, la seconde à cinq heures du soir. Personne ne s'en exemptait. Hors de-là ils n'avaient point de bréviaire à réciter, ni aucuns livres de dévotion particulière qui fussent d'obligation.
Ils étaient simoniaques, dit Gouvea, dans l'administration du baptême et de l'eucharistie : le prix de ces sacrements était réglé. Je ne sai s'il n'y a point d'erreur à taxer de simonie un pareil usage. Ces ecclésiastiques n'avaient point d'autre revenu, et ils pouvaient bien exiger de leurs paraissiens ce qui était nécessaire pour leur subsistance.
Lorsqu'ils se mariaient, ils se contentaient d'appeler le premier caçanare qui se présentait. Souvent ils s'en passaient. Quelquefois ils contractaient leurs mariages avec des cérémonies assez semblables à celles des Gentils.
Ils avaient une affection extraordinaire pour le patriarche nestorien de Babylone, et ne pouvaient souffrir qu'on fit mention dans leurs églises, ni du pape, ni de l'église romaine. Le plus ancien des prêtres d'une église y présidait toujours. Il n'y avait ni curé, ni vicaire.
Tout le peuple assistait le dimanche à la liturgie, quoiqu'il n'y eut aucune obligation de le faire. Mais il y avait des lieux où elle ne se célébrait qu'une fois l'an.
Les prêtres se chargeaient quelquefois d'emplois laïques, jusqu'à être receveurs des droits qu'exigeaient les rois payens.
Ils mangeaient de la chair le samedi ; et leurs jours d'abstinence étaient le mercredi et le vendredi. Leur jeune était fort sévère en carême. Ils ne prenaient de repas qu'une fois le jour après le coucher du soleil, et ils commençaient à jeuner dès le dimanche de la Quinquagésime. Pendant ce temps-là ils ne mangeaient ni poissons, ni œufs, ni laitages, ne buvaient point de vin, et n'approchaient point de leurs femmes. Toutes ces observances leur étaient ordonnées sous peine d'excommunication ; cependant les personnes avancées en âge étaient dispensées de jeuner.
Pendant le carême ils allaient trois fois le jour à l'église, le matin, le soir et à minuit. Plusieurs s'exemptaient de la dernière heure ; mais nul ne manquait aux deux précédentes. Ils jeunaient de même tout l'avent. Outre ces deux jeunes d'obligation, ils en avaient d'autres qui n'étaient que de dévotion, comme celui de l'assomption de la Vierge, depuis le premier d'Aout jusqu'au quinzième ; celui des apôtres qui durait cinquante jours, et commençait immédiatement après la Pentecôte ; et celui de la nativité de Notre - Seigneur, depuis le premier de Septembre jusqu'à Noë.
Toutes les fois qu'ils entraient dans l'église les jours de jeune, ils y trouvaient les prêtres assemblés qui chantaient l'office divin, et leur donnaient la bénédiction. Cette cérémonie s'appelait donner, ou recevoir le casturi. Elle consistait à prendre entre leurs mains celles des caçanares, et à les baiser après les avoir élevées en-haut. C'était un signe de paix, qui n'était accordé qu'à ceux qui étaient dans la communion de l'église : les pénitens et les excommuniés en étaient exclus.
Les femmes accouchées d'un enfant mâle, n'entraient dans l'église que quarante jours après leur délivrance ; pour une fille on doublait le nombre des jours, après lesquels la mère venait dans l'assemblée offrir son enfant à Dieu et à l'Eglise.
Ces chrétiens étaient en général fort peu instruits. Quelques-uns seulement savaient l'oraison dominicale, et la salutation angélique.
Ils craignaient extrêmement l'excommunication, et ils avaient raison de la craindre ; la discipline ecclésiastique était si sévère, que les homicides volontaires, et quelques autres crimes, attiraient une excommunication dont le coupable n'était jamais absous, pas même à l'article de la mort.
Leurs églises étaient sales, peu ornées, et bâties à la manière des pagodes, ou temples des Gentils. Nous avons déjà remarqué qu'ils n'avaient point d'images. Nous ajouterons ici qu'ils n'admettaient point de purgatoire, et qu'ils le traitaient de fable.
On voit par ce détail, que ces anciens chrétiens malabares, sans avoir eu de commerce avec les communions de Rome, de Constantinople, d'Antioche et d'Alexandrie, conservaient plusieurs des dogmes admis par les Protestants, et rejetés, en tout ou en partie, par les églises qu'on vient de nommer. Ils niaient la suprématie du pape, ainsi que la transubstantiation, soutenant que le sacrement de l'Eucharistie n'est que la figure du corps de J. C. Ils excluaient aussi du nombre des sacrements, la confirmation, l'extrême-onction et le mariage. Ce sont là les erreurs que le synode de Diamper proscrivit.
Le savant Geddes a mis au jour une traduction anglaise des actes de ce synode, composés par les jésuites, et M. de la Croze en a donné des extraits dans son Histoire du christianisme des Indes. C'est assez pour nous de remarquer qu'Alexis Menezès, nommé archevêque de Goa, tint ce synode après avoir entrepris, en 1599, de soumettre les chrétiens de S. Thomas à l'obéissance du pape. Il réussit dans ce projet par la protection du roi de Portugal, et par le consentement du roi de Cochin, qui aima mieux abandonner les chrétiens de ses états, que de se brouiller avec les Portugais. Menezès jeta dans le feu la plupart de leurs livres, perte considérable pour les savants curieux des antiquités ecclésiastiques de l'Orient ; mais le prélat de Goa ne s'en mettait guère en peine, uniquement occupé de vues ambitieuses. De retour en Europe, il fut nommé archevêque de Brague, vice-roi de Portugal, et président du conseil d'état à Madrid, où il mourut en 1617.
Cependant la conquête spirituelle de Menezès, ainsi que l'autorité temporelle des Portugais, reçut quelque temps après un terrible échec, et les chrétiens de S. Thomas recouvrèrent leur ancienne liberté. La cause de cette catastrophe fut le gouvernement arbitraire des jésuites, qui par le moyen des prélats tirés de leur compagnie, exerçaient une domination violente sur ces peuples, gens à la vérité simples et peu remuans, mais extrêmement jaloux de leur religion. Il parait par le livre de Vincent-Marie de Ste Catherine de Sienne, que les jésuites traitaient ces chrétiens avec tant de tyrannie, qu'ils résolurent de secouer un joug qu'ils ne pouvaient plus porter ; en sorte qu'ils se firent un évêque de leur archidiacre, au grand déplaisir de la cour de Rome.
Alexandre VII. résolut de remédier promptement au schisme naissant ; et comme il savait que la hauteur des jésuites avait tout gâté, il jeta les yeux sur les Carmes déchaussés, et nomma quatre religieux de cet ordre, pour ramener les chrétiens de S. Thomas à son obéissance : mais leurs soins et leurs travaux n'eurent aucun succès par les ruses du prélat jésuite, qui aliéna les esprits, et fit rompre les conférences.
Enfin la prise de Cochin par les Hollandais, en 1663, rendit aux chrétiens de S. Thomas la liberté dont ils avaient anciennement joui. Mais ces mêmes Hollandais, trop attachés à leur négoce, négligèrent entiérement la protection de ces pauvres gens. Il est honteux qu'ils ne se soient pas plus interessés en leur faveur, que s'ils avaient été des infidèles dignes d'être abandonnés. (D.J.)
THOMAS
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire naturelle
- Catégorie : Botanique