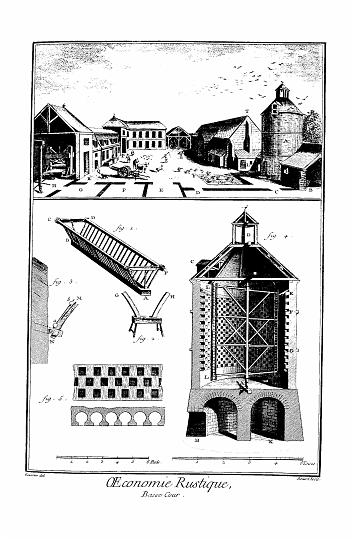S. m. (Médecine, Pathologie) ce mot est pris assez ordinairement, sur tout par les auteurs grecs et latins, comme synonyme à convulsion, et dans ce sens il est employé pour désigner la contraction non-naturelle de quelque partie. Quelques médecins français ont évité de confondre ces deux mots, appelant spasme la disposition des parties à la convulsion, et convulsion le complément de cette disposition, ou ce qui revient au même, un spasme plus fort et plus sensible : il me semble qu'on pourrait en distinguant ces deux états, établir la distinction sur des fondements moins équivoques, et pour cela je remarque que deux sortes de parties peuvent être le sujet ou le siege du spasme, ou de la convulsion : les unes ont un mouvement considérable, mais soumis à l'empire de la volonté ; tels sont les muscles destinés à exécuter les mouvements animaux : les autres ont une action plus cachée, un mouvement moins remarquable, mais indépendant de l'arbitre de la volonté ; de ce nombre sont tous les organes qui servent aux fonctions vitales et naturelles. Le spasme ou la convulsion ne sauraient s'évaluer de la même façon dans l'un et l'autre cas : on juge que les muscles soumis à la volonté sont dans une contraction contre nature, lorsque cette contraction n'est point volontaire, c'est ce que j'appelle proprement convulsion. Cette mesure serait fautive à l'égard des parties qui se contractent naturellement sans la participation de la volonté ; on ne doit donc décider leur contraction non-naturelle que lorsqu'elle sera portée à un trop haut point, que le mouvement tonique sera augmenté de façon à entraîner une lésion sensible dans l'exercice des fonctions. Cette seconde espèce me parait devoir retenir le nom plus approprié de spasme ; la différence que je viens d'établir dans la nomenclature se trouve encore fondée sur la façon ordinaire de s'exprimer ; ainsi on dit : Un homme est tombé dans les convulsions, il avait le bras en convulsion, etc. lorsqu'il s'agit de ces contractions contre nature extérieures involontaires, et l'on dit au contraire : Le spasme des intestins, de la vessie, des extrémités artérielles des différents organes, etc. lorsqu'on veut exprimer l'augmentation de ton de ces parties intérieures. En partant de ces principes, je crois qu'on peut dire qu'une convulsion suppose un spasme violent ; et dans ce cas, il sera vrai que le spasme est une disposition prochaine à la convulsion. Cette assertion est fondée sur ce que tous les symptômes apparents ont pour cause un dérangement intérieur que nous croyons analogue.
Quel est donc ce dérangement intérieur, et quelle en est la cause ? Champ vaste ouvert aux théoriciens, sujet fertîle en discussions, en erreurs et en absurdités. Les partisans de la théorie ordinaire confondant toujours spasme et convulsion, les ont regardés comme des accidents très-graves, qu'ils ont fait dépendre d'un vice plus ou moins considérable dans le cerveau ; les uns ont cru que ce vice consistait dans un engorgement irrégulier des canaux nerveux ; d'autres l'ont attribué à un fluide nerveux, épais et grumelé, qui passait avec peine et inégalement dans les nerfs, et excitait par-là cette irrégularité dans les mouvements. La plupart ont pensé que la cause du mal était dans les vaisseaux sanguins du cerveau, et que leur disposition vicieuse consistait en des espèces de petits anévrismes extrêmement multipliés, qui rendaient la circulation du sang déjà épais et sec, plus difficile, et en troublaient en même temps l'uniformité. Tous enfin ont recours à des causes particulières, presque toutes vagues, chimériques, ou peu prouvées pour l'explication d'un fait plus général qu'on ne le pense communément.
Et c'est précisément de tous les défauts qu'on pourrait, par le plus léger examen, découvrir dans ces théories, celui qui est le plus remarquable, et qu'il est le plus important d'approfondir ; rien n'est plus nuisible aux progrès d'une science, que de trop généraliser certains principes, et d'en trop particulariser d'autres. La circulation du sang, simple phénomène de Physiologie, dont la découverte aurait dû. ce semble, répandre un nouveau jour sur la Médecine théorique, n'a fait qu'éblouir les esprits, obscurcir et embrouiller les matières, parce que tout aussi-tôt on l'a regardée comme un principe général, et qu'on en a fait un agent universel. Erreur dont les conséquences ont toujours été de plus en plus éloignées du sanctuaire de la vérité ou de l'observation ; donnant dans l'écueil opposé, on n'a considéré le spasme que sous l'aspect effrayant d'un symptôme dangereux, tandis qu'avec une idée plus juste de l'économie animale on n'y aurait Ve qu'un principe plus ou moins général, qui, vrai Protée, changeait de forme à chaque instant, et produisait dans différentes parties et dans différentes circonstances des effets très-différents. C'est par la lecture de quelques ouvrages modernes, specimen novi medicinae conspectus, idée de l'homme physique et moral, etc. et des différents écrits de M. de Bordeu, que partant d'une connaissance exacte de l'économie animale, voyez ce mot ; on pourra sentir de quelle importance il est d'analyser plus profondément qu'on ne l'a fait jusqu'ici le spasme, et d'en examiner de beaucoup plus près la nature, le mécanisme, la marche, les espèces et les variations.
A mesure que les sujets sont plus intéressants, on doit chercher davantage à trouver de grands points de vue pour les mieux apercevoir, pour les considérer en grand, et les suivre dans toutes leurs applications ; mais il faut bien prendre garde aux fondements sur lesquels on établit de grands principes. Il est incontestable qu'en Médecine de pareils fondements ne peuvent être assis que sur l'observation ; et comme les différentes théories qui se sont succédées jusqu'à présent n'ont été reçues que sur la foi d'un pareil appui, et qu'il est probable que leurs auteurs étaient persuadés de les avoir ainsi fondés, il en résulte nécessairement qu'il en est de l'observation, comme Montagne le disait de la raison, que c'est un pot à deux anses, une règle de plomb et de cire alongeable, ployable et accommodable, à tous sens et à toutes mesures. Il y a donc une manière de saisir l'observation pour en tirer les lumières qu'elle doit fournir ; il faut donc un point de vue propre à saisir le fonds de l'observation, avant que de pouvoir se flatter d'en tirer assez de parti pour former une théorie également solide et profonde.
Infantum corpus laeditur in quantum convellitur ; c'est un grand et important axiome que le célèbre auteur des ouvrages cités plus haut, établit pour fondement de la théorie des maladies, il découle naturellement des principes justes et féconds qu'il a exposés sur l'économie animale ; il est d'ailleurs appuyé sur des observations multipliées, et surtout sur le genre d'observation le plus lumineux et le moins équivoque ; c'est celui dont on est soi-même l'objet : voilà donc le spasme proposé comme cause générale de maladie, suivons l'auteur dans les différents pas qu'il a faits pour venir à cette conséquence, et examinons sans prévention les preuves sur lesquelles il en étaye la vérité. Jettons d'abord un coup d'oeil sur l'homme sain, et sans remonter aux premiers éléments peu connus dont il est composé, fixons plus particulièrement nos regards sur le tableau animé que présentent le jeu continuel des différentes parties et les fonctions diversifiées qui en résultent.
Qu'est-ce que l'homme ? ou pour éviter toute équivoque, que la méchanceté et la mauvaise foi sont si promptes à faire valoir ; qu'est-ce que la machine humaine ? Elle parait à la première vue, un composé harmonique de différents ressorts qui mus chacun en particulier, concourent tous au mouvement général ; une propriété générale particulièrement restreinte aux composés organiques, connue sous les noms d'irritabilité ou sensibilité, se répand dans tous les ressorts, les anime, les vivifie et excite leurs mouvements ; mais modifiée dans chaque organe, elle en diversifie à l'infini l'action et les mouvements ; par elle les différents ressorts se bandent les uns contre les autres, se résistent, se pressent, agissent et influent mutuellement les uns sur les autres ; cette commixture réciproque entretient les mouvements, nulle action sans réaction. De cet antagonisme continuel d'actions, résulte la vie et la santé ; mais les ressorts perdraient bientôt et leur force, et leur jeu, les mouvements languiraient, la machine se détruirait, si l'Etre suprême qui l'a construite n'avait veillé à sa conservation, en présentant des moyens pour ranimer les ressorts fatigués, et pour ainsi dire débandés, pour rappeler les mouvements et remonter en un mot toute la machine ; c'est-là l'usage des six choses connues dans le langage de l'école sous le nom des six choses non naturelles, et qui sont absolument nécessaires à la vie : l'examen réfléchi des effets qui résultent de l'action de ces causes sur le corps et de quelques phénomènes peu approfondis, l'analogie qu'il doit y avoir nécessairement entre la machine humaine et les autres que la main des hommes a su fabriquer, et plusieurs autres raisons de convenance, ont fait penser qu'il devait y avoir dans le corps un premier et principal ressort, dont le mouvement ou le repos entraîne l'exercice ou l'inaction de tous les autres, voyez ÉCONOMIE ANIMALE ; observation si frappante, qu'il est inconcevable comment elle a pu échapper à l'esprit de comparaison et aux recherches des Mécaniciens modernes. Parmi les différentes parties, celles dont le département est le plus étendu, sont sans contredit, la tête et le ventre, l'influence de leurs fonctions est la plus générale ; ces deux puissances réagissent mutuellement l'une sur l'autre, et par cette contranitence d'action, lorsqu'elle est modérée, se conservent dans une tension nécessaire à l'exercice de leurs fonctions respectives ; mais leurs efforts se réunissent sur le diaphragme, cet organe le premier mu dans l'enfant qui vient de naître, doit être regardé comme le grand mobîle de tous les autres ressorts, comme la roue maîtresse de la machine humaine, comme le point où les dérangements de cette machine viennent se concentrer, où ils commencent et d'où ils se répandent ensuite dans les parties analogues.
Partons de ce point de vue lumineux, pour promener avec plus de fruit nos regards attentifs sur l'innombrable cohorte de maladies qui se présente à nos yeux ; tâchons de pénétrer dans l'intérieur de la machine pour y apercevoir les dérangements les plus cachés : supposons parmi cette multitude de ressorts qui se résistent mutuellement et qui par cette contranitence réciproque, entretiennent leurs mouvements et concourent par-là à l'harmonie générale ; supposons, dis-je, un de ces ressorts altéré, affoibli, par l'abus de ce qui sert à l'entretenir, destitué de la force nécessaire pour réagir efficacement contre le ressort sympathique ; aussi-tôt cette égalité d'action et de réaction qui constitue une espèce de spasme naturel est troublée ; ce dernier ressort augmente la sphère de ses mouvements, les fibres qui le composent sont irritées, tendues, resserrées, et dans un orgasme qui constitue proprement l'état spasmodique contre-nature. Mais remontons à la source du dérangement d'un organe particulier, nous la trouverons dans le diaphragme, qui par le tissu cellulaire, par des bandes aponévrotiques et par les nerfs, communique comme par autant de rayons aux différentes parties ; l'action de cet organe important est entretenue dans l'uniformité qui forme l'état sain par l'effort réciproque et toujours contre-balancé de la tête et de l'épigastre ; si l'une de ces deux puissances vient à agir avec plus ou moins de force, dès-lors l'équilibre est rompu, le diaphragme est affecté, son action cesse d'être uniforme, une ou plusieurs de ses parties sont dérangées, et par une suite de son influence générale sur tous les viscères, le dérangement, l'affection, la maladie plus ou moins considérable se propage et se manifeste dans les organes qui répondent aux parties du diaphragme altérées, par un spasme plus ou moins sensible, plus ou moins facilement réductible à l'état naturel.
Les deux pivots sur lesquels roule le jeu du diaphragme et en conséquence tous les mouvements de la machine, et où prennent naissance les causes ordinaires de maladie, sont comme nous l'avons déjà remarqué, la tête et le bas-ventre ; toute la force du bas-ventre dépend de l'action tonique des intestins et de l'estomac, et de leur effort contre le diaphragme ; les aliments qu'on prend en attirent par le mécanisme de la digestion, l'influx plus considérable de toutes les parties sur la masse intestinale, en augmente le jeu, et remonte pour ainsi dire ce ressort qu'une trop longue abstinence laissait débandé, sans force et sans action ; il agit donc alors plus fortement sur le diaphragme ; le dérangement qui en résulte, très-sensible chez certaines personnes, leur occasionne pendant la digestion une espèce de fièvre ; si la quantité des aliments est trop grande, ou si par quelque vice de digestion ils séjournent trop longtemps dans l'estomac, l'égalité d'action et de réaction de la tête avec cet organe est sensiblement troublée, et ce trouble se peint tout aussi-tôt par l'affection du diaphragme et des parties correspondantes. Les mêmes effets suivront si les humeurs abondent en quantité à l'estomac et aux intestins, si leurs couloirs sont engorgés, si des mauvais sucs s'accumulent dans leur cavité, etc. appliquons le même raisonnement à la tête, et nous verrons l'équilibre disparaitre par l'augmentation des fonctions auxquelles la masse cérébrale est destinée ; ces fonctions sont connues sous le nom générique de passions ou affections de l'âme, elles se réduisent au sentiment intérieur qui s'excite par l'impression de quelque objet sur les sens, et à la durée du sentiment produit par ces impressions ; ce sont ces deux causes dans la rigueur, réductibles à une seule, qui entretiennent le ressort de la tête ; et son augmentation contre nature est une suite de leur trop d'activité ; ainsi les passions modérées ne concourent pas moins au bonheur physique, c'est-à-dire à la santé, qu'au bonheur moral : le corps serait bien moins actif, les sommeils seraient bien plus longs, les sens seraient dans un engourdissement continuel, si nous n'éprouvions pas cette suite constante de sensations, de craintes, de réflexions, d'espérance ; si nous étions moins occupés de notre existence et des moyens de l'entretenir, et si à mesure que le soin de la vie animale nous occupe moins, nous ne cherchions à donner de l'exercice à la tête par l'étude, par l'accomplissement de nouveaux devoirs, par des recherches curieuses, par l'envie de se distinguer dans la société, par l'ambition, l'amour, etc. ce sont-là tout autant de causes qui renouvellent le ressort de la tête, et qui entretiennent son antagonisme modéré avec celui du bas-ventre ; mais si ces causes deviennent plus actives ; si une crainte excessive ou une joie trop vive nous saisit ; si l'esprit ou le sentiment est trop occupé d'un seul objet, il se fatigue et s'incommode, le ressort de la tête augmentant et surpassant celui du bas-ventre, devient cause de maladie. Théorie importante qui nous manquait, qui nous donne un juste coup-d'oeil pour exciter et modérer nos passions d'une manière convenable.
De cette double observation nait une division générale de la pathologie en maladies dû.s au ressort augmenté de la tête, et en celles qui sont produites par l'augmentation du ressort du bas-ventre : cette division Ve paraitre plus importante et plus féconde en se rapprochant du langage ordinaire des médecins ; pour cela qu'on fasse attention que le dérangement du ressort du bas-ventre reconnait pour cause, des mauvaises digestions, des amas d'humeurs viciées, etc. dans l'estomac et les intestins ; et d'un autre côté que le ressort de la tête est altéré par des sensations trop vives, par des passions violentes, par des méditations profondes, des veilles excessives, des études forcées, et l'on s'apercevra que la division précédente se reduit à la distinction connue, mais mal approfondie, des maladies en humorales et nerveuses : double perspective qui se présente dans un lointain très-éclairé au médecin observateur.
Les maladies purement nerveuses dépendantes d'une lésion particulière de sentiment, doivent être appelées plus strictement spasmodiques ; l'état de spasme est l'état premier et dominant, le seul qu'il soit alors nécessaire d'attaquer et de détruire ; mais il arrive souvent qu'à la longue la masse intestinale, dérangée par l'affection constante du diaphragme, donne lieu à de mauvaises digestions, et entraîne bientôt après un vice humoral ; ou au contraire dans des sujets sensibles très-impressionables, qui ont le genre nerveux très-mobile, l'affection humorale étant essentielle et protopathique, occasionne par la même raison des symptômes nerveux ; le genre mixte de maladies qui résulte de cette complication de quelque façon qu'elle ait lieu, est le plus ordinaire ; lorsque la maladie est humorale ou mixte, la cause morbifique irrite, stimule les forces organiques, augmente leurs mouvements, et les dirige à un effort critique, ou, ce qui est le même, excite la fièvre, pendant le premier temps de la fièvre, qu'on appelle temps de crudité ou d'irritation ; l'état spasmodique des organes affectés, et même de toute la machine, est peint manifestement sur le pouls, qui, pendant tout ce temps, est tendu, serré, précipité, convulsif : lorsque par la réussite des efforts fébrils le spasme commence à se dissiper, les symptômes diminuent, le temps de la coction arrive, le pouls est moins tendu, il commence à se développer ; la solution du spasme annonce, détermine, et prépare l'évacuation critique qui terminera la maladie ; à mesure qu'elle a lieu, les accidents disparaissent, la peau est couverte d'une douce moiteur, l'harmonie se rétablit dans la machine, le spasme se dissipe, le pouls devient plus mol, plus égal, plus rapprochant en un mot de l'état naturel : si, au contraire, quelqu'obstacle vient s'opposer à l'accomplissement de la crise, tout aussi-tôt les efforts redoublent, la constriction des vaisseaux augmente, leur spasme devient plus sensible, le pouls reprend un caractère d'irritation ; dans les maladies nerveuses où il ne se fait point de crise, le pouls conserve pendant tout le cours de la maladie son état convulsif, image naturelle de ce qui se passe à l'intérieur.
Nous ne poussons pas plus loin ces détails, renvoyant le lecteur curieux aux ouvrages mêmes dont nous les avons tirés ; les principes plus rapprochés des faits y paraitront plus solidement établis, et plus féconds ; les conséquences mieux enchainées et plus naturellement déduites, les vues plus vastes, les idées plus justes et plus lumineuses ; mais pour juger sainement de la bonté de cette doctrine, il ne faut pas chercher à la plier aux minucieuses recherches anatomiques ; ce n'est point à la taise des théories ordinaires qu'il faut la mesurer ; on tâcherait en vain de la soumettre aux lois peu connues et mal évaluées de la circulation du sang ; mesures fautives et sur la valeur desquelles tous ceux qui les admettent ne sont pas d'accord ; c'est dans l'observation répétée, et surtout dans l'étude de soi-même, qu'il faut chercher des raisons pour la détruire ou la confirmer ; appliquons-lui avec l'auteur ce que Stahl disait avec raison de toutes ces discussions frivoles, qui ne font qu'embrouiller les faits, avec lesquels elles sont si rarement d'accord : mussitant hic subtilitates nudae, eo nil faciunt speculationes anatomicorum à viis et mentibus petitae, sed motus naturae hic considerari debet. Qu'on fasse attention d'ailleurs que ces principes pathologiques, très-conformes aux lois bien fixées de l'économie animale, aux dogmes les plus sacrés, établis par les anciens, et reconnus par les modernes, à la doctrine des crises, aux nouvelles découvertes, enfin à la plus exacte observation, fournissent encore l'explication naturelle de plusieurs phénomènes dont les théoristes modernes avaient inutilement cherché les raisons ; les métastases entr'autres, les douleurs vagues qu'on sent courir en différents endroits du corps, les maladies qui changent à chaque instant de place, et plusieurs autres faits analogues, écueils où se venaient briser la sagacité et l'imagination de ces auteurs, se déduisent si naturellement de ce système, qu'ils en paraissent la confirmation.
Quelle que soit la fécondité des principes que nous venons d'exposer, quelle que soit la multiplicité et la force des preuves qui étaient la doctrine dont ils sont les fondements ; une raison plus victorieuse encore combat en leur faveur ; un avantage infiniment plus précieux aux yeux du praticien éclairé s'y rencontre ; c'est que cette théorie loin de gêner, d'asservir l'observateur, de lui fasciner pour ainsi dire les yeux, et de diriger sa main, ne fait au-contraire que lui servir de point de vue fixe pour discerner plus exactement les faits ; bien éloignée en cela des théories ordinaires qui tyrannisent le praticien, et l'asservissent au joug souvent funeste du raisonnement. Pour faire sentir cette différence et le prix de cet avantage, je propose l'épreuve décisive de la pratique : qu'un malade se présente avec une fièvre assez considérable, difficulté de respirer, point de côté assez vif, crachement de sang, etc. le médecin imbu des théories ordinaires, s'avance avec d'autant plus de courage qu'il a moins de lumière, et au premier aspect de ces symptômes, ce despote absolu dit : " je prouve par mes raisonnements que ces phénomènes sont des signes assurés d'une inflammation de la plèvre ou du poumon ; je tiens pour maxime incontestable que les saignées sont le remède unique et par excellence de toute inflammation ; on ne saurait trop en faire, et le moindre retardement est un grand mal ". En conséquence, il ordonne qu'on fasse coup-sur-coup plusieurs saignées, secours jamais curatif, quelquefois soulageant, et souvent inutîle ou pernicieux ; il fait couler à grands flots le sang de l'infortuné malade, qui atteint d'une affection humorale, meurt bientôt après victime de ce théoriste inconsidéré ; que le même malade tombe entre les mains d'un médecin qui aura adopté la théorie que nous venons d'exposer ; mais prompt à se décider, s'il est conséquent à ses principes, il examinera attentivement, et les symptômes qui paraissent, et les causes qui ont précédé, attribuant tous ces symptômes au pervertissement de l'action du diaphragme, à un spasme plus ou moins étendu, il se rappellera en même temps que ce dérangement intérieur peut être l'effet de deux vices très-différents, ou produit par l'augmentation du ressort de la masse intestinale qu'auront occasionnée la présence et l'accumulation de mauvais sucs dans les premières voies, ou tout à fait indépendant de cette cause ; considerant la maladie sous ce double aspect, il vient à-bout de décider par un examen plus réfléchi des symptômes propres, à quelle cause elle doit être attribuée : c'est-là que s'arrête le théoricien ; le praticien observateur muni de ces connaissances, appelle à son secours les observations antérieures pour classer la maladie, et déterminer par quel genre de remèdes il doit attaquer la cause qui se présente, comment il doit employer ces remèdes, les varier, et dans quel temps il doit les administrer. Suivons-le dans le traitement de cette maladie pour indiquer combien cette théorie s'applique heureusement à la pratique : supposons que cette prétendue fluxion de poitrine soit du nombre de celles qui ne dépendent que du mauvais état de l'estomac et des intestins ; après une ou deux saignées et l'émétique que la violence des accidents peut exiger, il tournera toutes ses vues du côté du bas-ventre, il sollicitera par des purgatifs legers la solution du spasme de ce côté, et préparera par-là une crise prompte et salutaire. Attentif à suivre tous les mouvements de la nature, si le spasme critique parait se diriger vers quelqu'autre couloir ; instruit par divers signes, et surtout par le pouls de cette détermination, il secondera la nature en poussant les humeurs vers les couloirs indiqués ; ainsi, jamais asservi par la théorie à telle ou telle pratique, il n'en sera que plus éclairé pour mieux saisir et suivre l'observation ; d'où il résulte évidemment que quand même les fondements de ce système seraient aussi faibles qu'ils sont solides, il n'en serait pas moins infiniment préférable à tous ceux que nous connaissons. (m)
SPASME
- Détails
- Écrit par Paul-Jacques Malouin (M)
- Catégorie parente: Physique particulière
- Catégorie : Pathologie