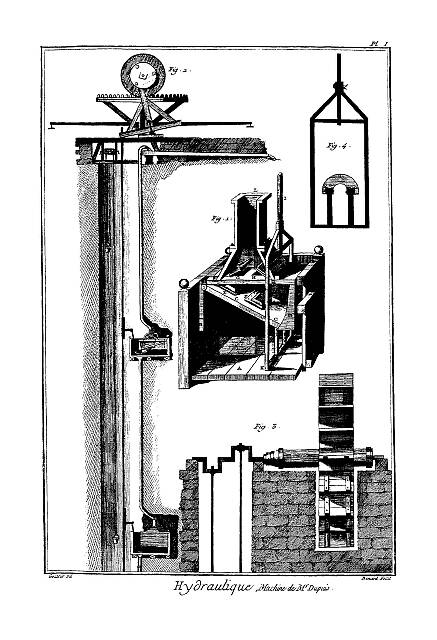S. f. (Métaphysique) la providence est le soin que la divinité prend de ses ouvrages, tant en les conservant, qu'en dirigeant leurs opérations. Les payens, tant poètes que philosophes, si l'on en excepte les Epicuriens, l'ont reconnue, et elle a été admise par toutes les nations du moins policées, et qui vivaient sous le gouvernement des lais. Virgile nous tiendra ici lieu de tous les poètes. Il fait adresser à Jupiter cette invocation par Vénus :
O qui res hominumque, deumque
Aeternis regis imperiis et fulmine terres.
Aeneid. lib. I.
Diodore de Sicîle dit que les Chaldéens soutenaient que l'ordre et la beauté de cet univers étaient dû. à une Providence, et que ce qui arrive dans le ciel et sur la terre, n'arrive point de soi-même, et ne dépend point du hazard, mais se fait par la volonté fixe et déterminée des dieux. Les philosophes barbares admettaient une Providence générale. Ils tombaient d'accord qu'un premier moteur, que Dieu avait présidé à la formation de la terre, mais ils niaient une providence particulière ; ils disaient que les choses ayant une fois reçu le mouvement qui leur convenait, s'étaient dépliées, pour ainsi dire, et se succédaient les unes aux autres à point nommé : c'est une folie de croire, disaient-ils, que chaque chose arrive en détail, parce que Jupiter l'a ainsi ordonné : tout au contraire, ce qui arrive est une dépendance certaine de ce qui est arrivé auparavant. Il y a un ordre inviolable duquel tous les événements ne peuvent manquer de s'ensuivre, et qui ne sert pas moins à la beauté qu'à l'affermissement de l'univers.
Les philosophes grecs, en admettant une providence, étaient partagés entr'eux sur la manière dont elle était administrée. Il y en eut qui n'étendirent la Providence de Dieu que jusqu'au dernier des orbes célestes, le genre humain n'y avait point de part. Il y en eut aussi qui ne lui faisaient gouverner que les affaires générales, la déchargeant du soin des intérêts particuliers, magna dii curant, parva negligunt, disait le stoïcien Balbus, ils ne croyaient pas qu'elle s'abaissât jusqu'à veiller sur les moissons et sur les fruits de la terre. Minora dii negligunt, neque agellos singulorum, nec viticulas persequuntur, nec si uredo aut grando quidpiam nocuit, id Jovi animadvertendum fuit. Nec in regnis quidem reges omnia minima curant.
Il faut ici remarquer que la religion des payens, ce qu'ils disaient de la Providence, leur crainte de la justice divine, leurs espérances des faveurs d'en-haut étaient des choses qui ne coulaient point de leur doctrine touchant la nature des dieux. Je parle même de la doctrine des philosophes sur ce grand point. Cette doctrine approfondie, bien pénétrée, était l'éponge de toute religion. Voici pourquoi : c'est qu'un dieu corporel ne serait pas une substance, mais un amas de plusieurs substances ; car tout corps est composé de parties. Si l'on invoquait ce dieu, il n'entendrait point les prières entant que tout, puisque rien de composé n'existe hors de notre entendement sous la nature de tout. Si Dieu, entant que tout, n'entendait point les prières, du moins les entendait-il quant à ses parties, pas davantage ; car ou chacune de ces parties les entendrait et les pourrait exaucer, ou cela n'appartiendrait qu'à un certain nombre de parties. Au premier cas, il n'y aurait qu'une partie qui fût nécessaire au monde, toutes les autres passeraient sous le rasoir des nominaux, la nature ne souffrant rien d'inutile. Bien plus, cette partie-là contiendrait une infinité d'inutilités, car elle serait divisible à l'infini. On ne parvient jamais à l'unité dans les choses corporelles. Au second cas, on ne pourrait jamais déterminer quel est le nombre des parties exauçantes, ni pourquoi elles ont cette vertu préférablement à leurs compagnes. Dans ces embarras on conclurait par n'invoquer aucun dieu. Je vais plus loin, et je raisonne contre les philosophes anciens. Le dieu que vous admettez n'étant qu'une matière très-subtîle et très-déliée (les anciens n'ont jamais eu d'autre idée de la spiritualité), n'est tout entier nulle part, ni quant à sa substance, ni quant à sa force : donc il n'existe tout entier en aucun lieu quant à sa science : donc il n'y a rien qui par une idée pure et simple connaisse tout-à-la-fais le présent, le passé et l'avenir, les pensées et les actions des hommes, la situation et les qualités de chaque corps, etc. donc la science de votre dieu est partout bornée, et comme le mouvement, quelque infini qu'on le suppose dans l'infinité des espèces est néanmoins fini en chaque partie, et modifié diversement selon les rencontres ; ainsi la science, quelque infinie qu'elle puisse être extensivè par dispersion, est limitée intensivè quant à ses degrés dans chaque partie de l'univers : il n'y a donc point une Providence réunie qui sache tout, et qui règle tout : il serait donc inutîle d'invoquer l'auteur de la nature. Si les anciens philosophes eussent donc raisonné conséquemment, ils auraient nié toute Providence, mais cette idée d'une Providence est si naturelle à l'esprit, et si fortement imprimée dans tous les cœurs, que malgré toutes leurs erreurs sur la nature de Dieu, erreurs qui la détruisaient absolument, ils ont néanmoins toujours reconnu cette Providence. Ils ont réuni en un seul point toute la force et toute la science de Dieu, quoique dans leurs principes elle dû. être à part et désunie dans toute la nature. Ils ne sont redevables de leur orthodoxie sur cet article qu'au défaut d'exactitude qui les a empêchés de raisonner conséquemment. Ce sont deux questions qui dans le vrai se supposent l'une et l'autre. Si Dieu gouverne le monde, il a présidé à sa formation, et s'il y a présidé, il le gouverne. Mais tous les anciens philosophes n'y regardaient pas de si près : ils avouaient que la matière ne devait qu'à elle-même son existence. Il était tout simple d'en conclure que les dieux n'agissaient point sur la matière, et qu'ils n'en pouvaient disposer à leur fantaisie. Mais ce qui nous parait si simple et si naturel, n'entrait point dans leur esprit ; ils trouvaient le secret d'unir les choses les plus incompatibles et les plus discordantes. M. Bayle a très-bien prouvé que les Epicuriens qui niaient la Providence, dogmatisaient plus conséquemment que ceux qui la reconnaissaient. En effet, ce principe une fois posé que la matière n'a point été créée, il est moins absurde de soutenir, comme faisaient les Epicuriens, que Dieu n'était pas l'auteur du monde, et qu'il ne se mêlait pas de le conduire, que de dire qu'il l'avait formé, qu'il le conservait, et qu'il en était le directeur. Ce qu'ils disaient était vrai ; mais ils ne laissaient pas de parler inconséquemment. C'était une vérité, pour ainsi dire intruse, qui n'entrait point naturellement dans leur système ; ils se trouvaient dans le bon chemin, parce qu'ils s'étaient égarés de la route qu'ils avaient prise au commencement. Voici ce qu'on pouvait leur dire : si la matière est éternelle, pourquoi son mouvement ne le serait-il pas ? Et s'il l'est, elle n'a donc pas besoin d'être conduite. L'éternité de la matière entraîne avec elle l'éternité du mouvement. Dès que la matière existe, je la conçais nécessairement susceptible d'un nombre infini de configurations. Peut-on s'imaginer qu'elle puisse être figurable sans mouvement ? D'ailleurs qu'est-ce que le mouvement introduit dans la matière ? Du moins quel est-il selon vos idées ? Ce n'est qu'un changement de situation qui ne peut convenir qu'à la matière, c'est un de ses principaux attributs éternels. Et puis, pourrait dire un épicurien, de quel droit Dieu a-t-il ôté à la matière l'état où elle avait subsisté éternellement ? Quel est son titre ? D'où lui vient sa commission pour faire cette réforme ? Qu'aurait-on pu lui répondre ? Eut-on fondé ce titre sur la force supérieure dont Dieu se trouvait doué ; Mais en ce cas-là ne l'eut-on pas fait agir selon la loi du plus fort, et à la manière de ces conquérants usurpateurs, dont la conduite est manifestement opposée au droit ? Eut-on dit, que Dieu étant plus parfait que la matière, il était juste qu'il la soumit à son empire ? Mais cela même n'est pas conforme aux idées de la religion. Un philosophe qu'on aurait pressé de la sorte, se serait contenté de dire que Dieu n'exerce son pouvoir sur la matière que par un principe de bonté. Dieu, dirait-il, connaissait parfaitement ces deux choses : l'une, qu'il ne faisait rien contre le gré de la matière, en la soumettant à son empire ; car, comme elle ne sentait rien, elle n'était point capable de se fâcher de la perte de son indépendance : l'autre, qu'elle était dans un état de confusion et d'imperfection, un amas informe de matériaux, dont on pouvait faire un excellent édifice, et dont quelques-uns pouvaient être convertis en des corps vivants et en des substances pensantes. Il voulut donc communiquer à la nature un état plus parfait et plus beau que celui où elle était. 1°. Un épicurien aurait demandé s'il y avait un état plus convenable à une chose que celui où elle a toujours été, et où sa propre nature et la nécessité de son existence l'ont mise éternellement. Une telle condition n'est-elle pas la plus naturelle qui puisse s'imaginer ? Ce que la nature des choses, ce que la nécessité à laquelle tout ce qui existe de soi-même doit son existence réglée et déterminée, peut-il avoir besoin de reforme ? 2°. Un agent sage n'entreprend point de mettre en œuvre un grand amas de matériaux, sans avoir examiné ses qualités, et sans avoir reconnu qu'ils sont susceptibles de la forme qu'il voudrait leur donner ; or Dieu pouvait-il les connaître, s'il ne leur avait pas donné l'être ? Dieu ne peut tirer ses connaissances que de lui-même : rien ne peut agir sur lui, ni l'éclaircir : si Dieu ne voyant donc point en lui-même, et par la connaissance de ses volontés, l'existence de la matière, elle devait lui être éternellement inconnue : il ne pouvait donc pas l'arranger avec ordre, ni en former son ouvrage. On peut donc conclure de tous ces raisonnements que l'impiété d'Epicure roulait naturellement et philosophiquement de l'erreur commune aux payens sur l'existence éternelle de la matière. Ses avantages auraient été bien plus grands, s'il avait eu à faire au vulgaire, qui croyait bonnement que les dieux mâles et femelles, issus les uns des autres, gouvernaient le monde. On peut lire sur cela l'article d'Epicure dans le dictionnaire de Bayle.
Il y avait encore une autre raison qui aurait dû empêcher les anciens philosophes, supposé qu'ils eussent raisonné conséquemment, d'admettre une Providence du moins particulière : c'est le sentiment où ils étaient presque tous, qu'il n'y avait point de peines ni de récompenses dans une autre vie, quoiqu'ils enseignassent au peuple ce dogme à cause de son utilité. L'ancienne philosophie grecque était raffinée, subtilisée, spéculative à l'excès ; elle se décidait moins par des principes de Morale, que par des principes de Métaphysique ; et quelque absurdes qu'en fussent les conséquences, elles n'étaient pas capables de vaincre l'impression que ces principes faisaient sur leurs esprits, ni de les tirer de l'erreur dont ils étaient prévenus ; or ces principes métaphysiques qui donnent, dans leur façon de raisonner, nécessairement l'exclusion au dogme des peines et des récompenses d'une autre vie, étaient 1°. que Dieu ne pouvait se fâcher, ni faire du mal à qui que ce soit : 2°. que nos âmes étaient autant de parcelles de l'âme du monde qui était dieu, à laquelle elles devaient se réunir, après que les liens du corps où elles étaient comme enchainées, auraient été brisés. Voyez l'article AME. Un moderne rempli des idées philosophiques de ces derniers siècles, sera peut-être surpris de ce que cette conséquence a fort embarrassé toute l'antiquité, lorsqu'il lui parait et qu'il est réellement si facîle de résoudre la difficulté, en distinguant les passions humaines des attributs divins de justice et de bonté, sur lesquels est établi d'une manière invincible le dogme des peines et des récompenses futures. Mais les anciens étaient fort éloignés d'avoir des idées si précises et si distinctes de la nature divine ; ils ne savaient pas distinguer la colere de la justice, ni la partialité de la bonté. Ce n'est cependant pas qu'il n'y ait eu parmi les ennemis de la religion quelques modernes coupables de la même erreur. Milord Rochester croyait un Etre suprême ; il ne pouvait pas s'imaginer que le monde fût l'ouvrage du hasard, et le cours régulier de la nature lui paraissait démontrer le pouvoir éternel de son auteur ; mais il ne croyait pas que Dieu eut aucune de ces affections d'amour et de haine qui causent en nous tant de trouble ; et par conséquent il ne concevait pas qu'il y eut des récompenses et des peines futures.
Mais comment concilier, direz-vous, la Providence avec l'exclusion du dogme des peines et des récompenses d'une autre vie ? Pour répondre à votre question, il sera bon de considérer quelle était l'espèce de Providence que croyaient les philosophes théistes. Les Péripatéticiens et les Stoïciens avaient à-peu-près les mêmes sentiments sur ce sujet. On accuse communément Aristote d'avoir cru que la Providence ne s'étendait point au dessous de la lune ; mais c'est une calomnie inventée par Chalcidias. Ce qu'Aristote a prétendu, c'est que la Providence particulière ne s'étendait point aux individus. Comme il était fataliste dans ses opinions sur les choses naturelles, et qu'il croyait en même temps le libre arbitre de l'homme, il pensait que si la Providence s'étendait jusqu'aux individus, ou que les actions de l'homme seraient nécessaires, ou qu'étant contingentes, leurs effets déconcerteraient les desseins de la Providence. Ne voyant donc aucun moyen de concilier le libre arbitre avec la Providence divine, il coupa le nœud de la difficulté, en niant que la Providence s'étendit jusqu'aux individus. Zénon soutenait que la Providence prenait soin du genre humain, de la même manière qu'elle préside au globe céleste, mais plus uniforme dans ses opinions qu'Aristote, il niait le libre arbitre de l'homme ; et c'est en quoi il différait de ce philosophe. Au reste l'un comme l'autre, en admettant la providence générale, rejetait toute providence particulière. Voilà d'abord un genre de providence, qui est non-seulement très-compatible avec l'opinion de ne point croire les peines et les récompenses de l'autre vie, mais qui même détruit la créance de ce dogme.
Le cas des Pythagoriciens et des Platoniciens est à la vérité tout à fait différent ; car ces deux sectes croyaient une providence particulière qui s'étendait à chaque individu ; une providence qui suivant les notions de l'ancienne philosophie, ne pouvait avoir lieu sans les passions d'amour ou de haine : c'est-là le point de la difficulté. Ces sectes excluaient de la Divinité toute idée de passion, et particulièrement l'idée de colere ; en conséquence, elles rejetaient la créance du dogme des peines et des récompenses d'une autre vie ; cependant elles croyaient en même temps une providence administrée par le secours des passions. Pour éclaircir cette opposition apparente, il faut avoir recours à un principe dominant du paganisme, c'est-à-dire, de l'influence des divinités locales et nécessaires. Pythagore et Platon enseignaient que les différentes régions de la terre avaient été confiées par le maître suprême de l'univers au gouvernement de certains dieux inférieurs et subalternes. C'était longtemps avant ces philosophes l'opinion populaire de tout le monde payen. Elle venait originairement des Egyptiens, sur l'autorité desquels Pythagore et Platon l'adoptèrent. Tous les écrits de leurs disciples sont remplis de la doctrine des démons et des génies, et d'une manière si marquée, que cette opinion devint le dogme caractérisé de leur théologie. Or l'on supposait que ces génies étaient susceptibles de passions, et que c'était par leur moyen que la providence particulière avait lieu. On doit même observer ici que la raison qui, suivant Chalcidias, faisait rejeter aux Péripatéticiens la créance d'une providence, c'est qu'ils ne croyaient point à l'administration des divinités inférieures ; ce qui montre que ces deux opinions étaient étroitement liées l'une à l'autre.
Il parait évidemment par ce que nous venons de dire, que le principe, que Dieu est incapable de colere, principe qui dans l'idée des payens renversait le dogme des peines et des récompenses d'une autre vie, n'attaquait point la providence particulière des dieux, et que la bienveillance que quelques philosophes attribuaient à la Divinité suprême, n'était point une passion semblable en aucune manière à la colere qu'ils lui refusaient, mais une simple bienveillance, qui dans l'arrangement et le gouvernement de l'univers, dirigeait la totalité vers le mieux, sans intervenir dans chaque système particulier. Cette bienveillance ne provenait pas de la volonté, mais émanait de l'essence même de l'Etre suprême. Presque tous les philosophes ont donc reconnu une providence, sinon particulière, du-moins générale. Démocrite et Leucippe passent pour avoir été les premiers adversaires de la Providence ; mais ce fut Epicure qui entreprit d'établir leurs opinions. Tous les Epicuriens pensaient de même que leur maître ; Lucrèce cependant, le poète Lucrèce, dans le livre même où il combat la Providence, l'établit d'une manière fort énergique, en admettant une force cachée qui influe sur les grands événements.
Usque adeò res humanas vis abdita quaedam
Obterit, et pulchros fasces, saevasque secures
Proculcare ac ludibrio sibi habere videtur.
Au fond, Epicure n'admettait des dieux que par politique, et son système était un véritable athéisme. Cicéron le dit d'après Possidonius, dans son livre de la nature des dieux : Epicurus re tollit, et actione relinquit deos. Nous résoudrons plus bas les difficultés qu'il faisait contre le dogme de la Providence.
Tous les peuples policés reconnaissaient une Providence ; cela est sur des Grecs. On pourrait en rapporter une infinité de preuves ; je me contenterai de celle que me fournit Plutarque dans la vie de Timoléon, de la traduction d'Amiot : " Mais arrivé que fut Dionisius en la ville de Corinthe, il n'y eut homme en toute la Grèce, qui n'eut envie d'y aller pour le voir et parler à lui, et y allaient les uns très-aises de son malheur, comme s'ils eussent foulé aux pieds celui que la fortune avait abattu, tant ils le haïssaient âprement. Les autres amollis en leur cœur de voir une si grande mutation, le regardaient avec un je ne sais quoi de compassion, considérant la grande puissance qu'ont les causes occultes et divines sur l'imbécillité des hommes, et sur les choses qui passent tous les jours devant nos yeux ". Il est vrai, pour le dire en passant, que l'orthodoxie de Plutarque n'est pas soutenue, et qu'il parle quelquefois le langage des Epicuriens. Tite-Live s'exprime ainsi sur le malheur arrivé à Appius Claudius : et dum pro se quisque deos tandem esse, et non negligère humana fremunt, et superbiae crudelitatique paenas et si feras, non lèves tamen venire paenas. Les Indiens, les Celtes, les Egyptiens, les Ethiopiens, les Chaldéens, en un mot, presque tous les peuples qui croyaient qu'il y avait un Dieu, croyaient en même temps qu'il avait soin des choses humaines : tant est forte et naturelle la conviction d'une Providence, dès-là qu'on admet un être suprême. L'évidence de ce dogme ne saurait être obscurcie par les difficultés qu'on y oppose en foule ; les seules lumières de la raison suffisent pour nous faire comprendre, que le Créateur de ce chef-d'œuvre qu'on ne peut assez admirer, n'a pu l'abandonner au hasard. Comment s'imaginer que le meilleur des pères néglige le soin de ses enfants ? Pourquoi les aurait-il formés, s'ils lui étaient indifférents ? Quel est l'ouvrier qui abandonne le soin de son ouvrage ? Dieu peut-il avoir créé des sujets en état de connaître leur Créateur et de suivre des lais, sans leur en avoir donné ? Les lois ne supposent-elles pas la punition des coupables ? Comment punir, sans connaître ce qui se passe ? Tout ce qui est dans Dieu, tout ce qui est dans l'homme, tout ce qui est dans le monde, nous conduit à une Providence. Dès qu'on supprime cette vérité, la religion s'anéantit ; l'idée de Dieu s'efface, et on est tenté de croire, que n'y ayant plus qu'un pas à faire pour tomber dans l'athéïsme, ceux qui nient la Providence peuvent être placés au rang des athées. Mais, pour rendre ceci plus frappant et plus sensible, faisons un parallèle entre le Dieu de la religion, et le dieu de l'irréligion ; entre le Dieu de la providence, et le dieu d'Epicure ; entre le Dieu des Chrétiens, et le dieu de certains déïstes. Dans le système de l'irréligion, je vois un dieu dédaigneux et superbe, qui néglige, qui oublie l'homme après l'avoir fait, qui le dégage de toute dépendance, de peur de s'abaisser jusqu'à veiller sur lui ; qui l'abandonne par mépris à tous les égarements de son orgueil, et à tous les excès de la passion, sans y prendre le moindre intérêt ; un dieu qui voit d'un oeil égal et le vice triomphant, et la vertu violée, qui ne demande d'être aimé ni même d'être connu de sa créature, quoiqu'il ait mis en elle une intelligence capable de le connaître, et un cœur capable de l'aimer. Dans le système de la Providence, je vois au contraire un Dieu sage, dont l'immuable volonté est un immuable attachement à l'ordre, un Dieu bon, dont l'amour paternel se plait à cultiver dans le cœur de sa créature, les semences de vertu qu'il y a mises ; un Dieu juste qui récompense sans mesure, qui corrige sans hauteur, qui punit avec règle et proportionne les châtiments aux fautes ; un Dieu qui veut être connu, qui couronne en nous ses propres dons, l'hommage qu'il nous fait rendre à ses perfections infinies, et l'amour qu'il nous inspire pour elles. C'est au déiste situé entre ces deux tableaux, à se déterminer pour celui qui lui parait plus conforme à sa raison.
Si nous pouvions méconnaître la Providence dans le spectacle de ce vaste univers, nous la retrouverions en nous. Sans chercher des raisons qui nous fuient, ouvrons l'oreille à la voix intérieure qui cherche à nous instruire. Nous sommes l'abrégé de l'univers, et en même temps nous sommes l'image du Créateur. Si nous ne pouvons contempler ce grand original, contentons-nous de le contempler dans son image. Nous ne pouvons jamais mieux le trouver que dans les portraits où il a voulu se peindre lui-même. Si je me replie sur moi-même, je sens en moi un principe qui pense, qui juge, qui veut ; je trouve de plus que je suis un corps organisé, capable d'une infinité de mouvements variés, dont les uns ne dépendent point du tout de moi, les autres en dépendent en partie, et les autres me sont entièrement soumis. Ceux qui ne dépendent point de moi, sont par exemple, la circulation du sang et celle des humeurs, d'où procede la nutrition et la formation des esprits animaux. Ce mouvement ne peut être interrompu par un acte de ma volonté, et je ne puis subsister, si quelque cause étrangère en interrompt le cours. J'en trouve d'autres chez moi aussi indépendants de ma volonté que la circulation du sang ; mais que je puis suspendre pour un moment, sans bouleverser toute la machine. Tel est entr'autres celui de la respiration, que je puis arrêter quand il me plait, mais non pas pour longtemps, par un simple acte de ma volonté, sans le secours de quelques moyens antérieurs. Enfin, il y a en moi certains fluides errants dans tous les divers canaux, dont mon corps est rempli, mais dont je puis déterminer le cours par un acte de ma volonté. Sans cet acte, ces fluides que j'appellerai les esprits animaux, coulent par leur activité naturelle indifféremment dans tous les vides et dans tous les canaux qu'ils rencontrent ouverts, sans affecter un lieu particulier plutôt qu'un autre, semblables à des serviteurs qui se promenent négligemment en attendant l'ordre de leur maître ; mais selon mes désirs ils se transportent dans les canaux particuliers, à proportion du besoin plus ou moins grand, dont je suis le juge. Je vois dans ce que je viens de trouver chez moi, une image naïve de tout cet univers. Nous y distinguons des mouvements réglés et invariables, d'où dépendent tous les autres, et qui sont à l'univers comme la circulation du sang dans le corps humain, mouvement que Dieu n'arrête jamais, non plus que l'homme n'arrête celui de son sang ; avec cette différence, que c'est en nous un effet de notre impuissance, et en Dieu celui de son immutabilité. Nous comparerons donc les mouvements généraux de nos corps qui ne dépendent point de nous, aux lois générales et immuables que Dieu a établies dans la matière. Mais comme nous trouvons en nous de certains mouvements, quoiqu'indépendants de nous, dont nous pouvons pourtant suspendre le cours pour quelques moments, comme celui de la respiration ; aussi conçais-je dans cet univers des mouvements très-réglés, qui procedent des mouvements généraux, que Dieu peut suspendre quelque temps, sans porter préjudice à ce bel ordre, mais dont il changerait l'économie, si cette suspension durait trop longtemps. Tel est celui du soleil et de la lune, que Dieu arrêta pour donner le temps à Josué de remporter une entière victoire sur les ennemis de son peuple. Enfin, je trouve dans la nature aussi-bien que chez moi une quantité immense de fluides de plusieurs espèces, répandus dans tous les pores et les interstices des corps, ayant du mouvement en eux-mêmes, mais un mouvement qui n'est pas entièrement déterminé de tel ou tel côté par les lois générales, qui sont en partie comme vagues et indéterminées. Ce sont ces fluides qui sont à la nature ce que sont les esprits animaux au corps humain, esprits nécessaires à tous les mouvements principaux et indépendants de nous, mais soumis outre cela à exécuter nos ordres par ces principes que je viens de poser.
Il est maintenant aisé de comprendre comment Dieu a pu établir des lois fixes et inviolables du mouvement, et gouverner pourtant le monde par sa Providence. Quoi ! j'aurai le pouvoir de remuer un bras ou de ne pas le remuer, de me transporter dans un certain lieu ou de ne pas le faire, d'aider un ami ou de ne le pas aider ; et Dieu qui a disposé toutes choses avec une sagesse et une puissance infinies, et de qui je tiens ce pouvoir, se sera lui-même privé d'agir par des volontés particulières ? Je puis aider mes enfants, les punir, les corriger, leur procurer du plaisir, ou les priver de certaines choses selon ma prudence ; je puis par ma prévoyance prévenir les maux et les accidents qui peuvent leur arriver, en ôtant de dessous leurs pas ce qui pourrait occasionner leur chute. Ce que je puis faire pour mes enfants je le puis aussi pour mes amis. Je sai qu'un ami se dispose à faire une action qui peut lui procurer de fâcheuses affaires, je cours sur les lieux, je le préviens, et je l'empêche par mes sollicitations d'exécuter ce qu'il avait désir de faire. Pendant ma promenade je vois devant moi un aveugle qui Ve se précipiter dans un fossé, croyant suivre le chemin. Je précipite mes pas, je prends cet aveugle par le bras, et je l'arrête sur le penchant de sa chute ; n'est-ce pas là une providence en moi ? Par combien d'autres réflexions pourrai-je la prouver ? Or ce que je sens en moi irai-je le refuser à la divinité ? Notre providence n'est qu'une image imparfaite de la sienne. Il est le père de tous les hommes, ainsi que leur créateur ; il punit, il châtie, il prévait les maux, il les fait quelquefois sentir à ses enfants. Il se dispose au châtiment, mais notre repentir calme sa colere, et éteint entre ses mains la foudre qu'il était prêt à lancer. Sa Providence ne s'est pas bornée à établir des lois de mouvement, selon lesquelles tout se meut, tout se combine, tout se varie, tout se perpétue. Ce ne serait là qu'une Providence générale. S'il n'avait créé que de la matière, ces lois générales auraient suffi pour entretenir l'univers éternellement dans le même ordre, tant sa profonde sagesse l'a rendu harmonieux ; mais outre la matière, il a créé des êtres intelligens et libres, auxquels il a donné un certain degré de pouvoir sur les corps : ce sont ces êtres libres qui engagent la Divinité à une providence particulière ; c'est celle-ci qui fait une des parties les plus intéressantes de la religion : examinons si les principes que nous avons posés en détruisent l'idée.
Si je conçais l'univers comme une machine, dont les ressorts sont engagés si dépendamment les uns des autres, qu'on ne peut retarder les uns sans retarder les autres, et sans bouleverser tout l'univers : alors je concevrai d'autre providence que celle de l'ordre établi dans la création du monde, que j'appelle Providence générale. Mais j'ai bien une autre idée de la nature. Les hommes dans leurs ouvrages même les plus liés, ne laissent pas de les faire tels, qu'ils peuvent sans renverser l'ordre de leur machine, y changer bien des choses. Un horloger, par exemple, a beau engager les roues d'une montre, il est pourtant le maître d'avancer ou de reculer l'aiguille comme il lui plait. Il peut faire sonner un réveil plus tôt ou plus tard, sans altérer les ressorts et sans déranger les roues ; ainsi vous voyez qu'il est le maître de son ouvrage, particulièrement sur ce qui regarde sa destination. Un réveil est fait pour indiquer les heures, et pour réveiller les gens dans un certain temps. C'est justement ce dont est maître celui qui a fait la montre. Voilà justement l'idée de la Providence générale et particulière. Ces ressorts, ces roues, ces balanciers, tout cela en mouvement font la Providence générale, qui ne change jamais et qui est inébranlable : ces dispositions du réveil et du cadran, dont les déterminations sont à la disposition de l'ouvrier, sans altérer ni ressort ni rouages, sont l'emblème de la Providence particulière. Je me représente cet univers comme un grand fluide, à qui Dieu a imprimé le mouvement qui s'y conserve toujours. Ce fluide entraîne les planètes par un courant très-reglé et par un mouvement si uniforme, que les Astronomes peuvent aisément prédire les conjonctions et les oppositions. Voilà la Providence générale. Mais dans chaque planète les parties de ces premiers éléments n'ont point de mouvement réglé. Elles ont à la vérité un mouvement perpétuel, mais indéterminé, se portant où les passages sont les plus libres, semblables à ces rivières qui suivent constamment leur lit, mais dont une partie des eaux se répand à droite et à gauche, au-travers des pores de la terre, suivant le plus ou le moins de facilité du terroir qu'elles pénètrent. C'est cette matière du premier élément que Dieu détermine par des volontés particulières, suivant les vues de sa sagesse et de sa bonté. Ainsi sans rien changer dans les lois primitives établies par la Divinité, il peut régler tous les événements sublunaires occasionnellement, selon les démarches des êtres libres qu'il a mis sur la terre ou dans les autres planètes, s'il y en a d'habitées. Voilà ce qui concerne la Providence par rapport à la nature, voyons celle qui regarde les esprits.
En formant cet univers, Dieu avait créé des objets de sa puissance et de sa sagesse. Il voulut en créer qui fussent l'objet de sa bonté, et qui fussent en même temps les témoins de sa puissance et de sa sagesse. Cette pente générale et universelle des hommes à la félicité, parait une preuve incontestable que Dieu les a faits pour être heureux. L'Ecriture fortifie ce sentiment au-lieu de le détruire, en nous disant que Dieu est charité ; qu'est-ce à dire ? C'est que la bonté de Dieu est l'attribut à qui les hommes doivent leur existence, et qui par conséquent est le premier à qui ils doivent rendre hommage.
L'amour d'un sexe l'un pour l'autre, l'amour des pères pour leurs enfants, cette pitié dont nous sommes naturellement susceptibles, sont trois moyens puissants par lesquels la sagesse infinie sait tout conduire à ses fins. 1°. Dieu n'a point commis le soin de la société uniquement à la raison des hommes. En vain aurait-il fait la distinction des deux sexes ; en vain de cette distinction s'en devrait-il suivre la propagation du genre humain ; en vain la religion naturelle nous avertirait-elle que nous devons travailler au bonheur de notre prochain, tout aurait été inutile, le penchant de l'homme au bonheur l'aurait toujours éloigné des vues de la Providence. Quelqu'un se serait-il marié s'il n'y avait eu que la raison seule qui l'y eut déterminé ? Le mariage le plus heureux entraîne toujours après lui plus de soucis et d'inquiétudes que de plaisir ; les femmes surtout y sont plus intéressées que les hommes. Suivez avec exactitude toutes les suites d'une grossesse, les douleurs de l'enfantement, etc. et jugez s'il y a une femme au monde qui voulut en courir les risques, si elle n'agissait qu'en vue de suivre sa raison ? Quoique les hommes courent moins de hasard, et qu'ils soient exposés à moins de maux, il en reste encore assez pour les éloigner du mariage, s'ils n'y étaient poussés que par leur devoir. Aussi Dieu les a-t-il engagés non-seulement par le plaisir, mais par une impulsion secrète, encore plus forte que le plaisir. 2°. Si nous examinons cette tendresse des pères et des mères pour leurs enfants, nous n'y trouverons pas moins les soins attentifs de la Providence. Qu'est-ce qui nous engage à avoir plus d'amour pour nos enfants que pour ceux de nos voisins, quand même les nôtres auraient moins de beauté et moins de mérite ? la raison n'exige-t-elle pas de nous que nous proportionnions notre amour au mérite ? Mais il ne s'agit pas d'agir ici par raison. Le père partage avec sa tendre épouse les inquiétudes que leur cause leur amour pour leurs enfants. Tout leur temps est employé, soit à leur éducation, soit à travailler pour leur laisser du bien après leur mort. Il leur en faudrait peu pour eux seuls, mais ils ne trouvent jamais qu'ils en laissent assez à leurs enfants. Ils se privent souvent des plaisirs qu'il faudrait acheter aux dépens du bonheur de leur famille. En bonne foi, les hommes s'aimant comme ils s'aiment, prendraient-ils tous ces soins pour leurs enfants, s'ils n'y étaient engagés par une forte tendresse ? et auraient-ils cette tendresse si elle ne leur était imprimée par une cause supérieure ? Examinons-les sous un autre point de vue. Ils ont une haine mortelle pour tout ce qui s'oppose à leur bonheur. L'homme est né paresseux, il fuit la peine, et surtout une peine qu'il ne choisit pas lui-même. Voilà pourtant des enfants qui lui en imposent de telles, qu'il les regarderait comme un joug insupportable si c'étaient d'autres que ses enfants. L'homme aime sa liberté, et haït quiconque la lui ravit. Cependant ses enfants lui donnent une occupation onéreuse, et gênent entièrement sa liberté, et il ne les aime pas moins pour cela ; bien plus, si quelqu'enfant est plus accablé de maladies que les autres, il sera toujours le plus aimé quoiqu'il donne le plus de peine, toute la tendresse semble se ramasser en lui seul. Admirons en cela la sagesse infinie de la Providence, qui ayant donné aux hommes un penchant invincible pour le bonheur, a pourtant su malgré ce penchant les conduire à ses fins. 3°. La Providence, toujours attentive à nos besoins, a imprimé dans l'homme le sentiment de la pitié, qui nous fait sentir une vive douleur à la vue du malheur d'autrui, et qui nous engage à le soulager pour nous soulager nous-mêmes. Il y a, je le sais, de l'amour-propre dans le secours que nous donnons aux misérables et aux affligés, mais Dieu enchaine cet amour-propre par cette vive sensibilité dont nous ne sommes pas les maîtres ; elle est involontaire, et ne pouvant nous en défaire, nous trouvons plus d'expédient d'en faire cesser la cause en soulageant les misérables. Il faut avouer que les Stoïciens étaient de pauvres philosophes, de prétendre que la pitié était une passion blâmable, elle qui fait l'honneur de l'humanité. Je ne puis comprendre qu'on ait été si longtemps entêté de la morale de ces gens-là ; mais ils sont anciens, ainsi fussent-ils mille fois plus ridicules, ils feront toujours l'admiration des pedants. La pitié est une passion bien respectable, elle est l'apanage des cœurs bien faits, elle est une des plus fortes preuves que le monde est conduit par une sagesse infinie, qui sait conduire tout à ses fins, même parmi les êtres libres, sans gêner leur liberté. Plus je fais réflexion sur ces trois lois de la Providence générale, plus je suis surpris de voir tant d'athées dans le siècle où nous sommes. Si nous n'avions d'autres preuves de la Divinité que celles qui sont métaphysiques, je ne serais pas surpris que ceux qui n'ont pas le génie tourné de ce côté-là, n'y fussent pas sensibles. Mais ce que je viens de dire est proportionné à toutes sortes de génies, et en même temps si satisfaisant, que je doute que tout homme qui voudra y faire attention, ne reconnaisse une Providence. Qui reconnait une Providence reconnait un Dieu : on a fait souvent ce raisonnement, il y a un Dieu, donc il y a une Providence. Par-là on était obligé de prouver l'existence d'une Divinité par d'autres voies que par la Providence : c'est ce qui engageait les Philosophes à aller chercher des raisons métaphysiques, peu sensibles et souvent fausses, au-lieu que cet argument-ci est certain, il y a une Providence, donc il y a un Dieu : voici quelques-unes des difficultés qu'on peut faire contre la Providence.
Il y a dans le monde plusieurs désordres, bien des choses inutiles et même nuisibles. Les Epicuriens pressaient cette objection, et elle est repétée plus d'une fois dans le poème de Lucrèce :
Nequaquam nobis divinitùs esse creatam
Naturam mundi quae tantae est praedita culpâ.
les rochers inaccessibles, les déserts affreux, les monstres, les poisons, les grêles, les tempêtes, etc. étaient autant d'arguments qu'on joignait aux précédents.
Je réponds 1°. que Dieu a établi dans l'univers des lois générales, suivant lesquelles toutes choses particulières, sans exception, ont leur usage propre ; et quoiqu'elles nous paraissent fâcheuses et incommodes, les règles générales n'en sont pas moins sages et salutaires. Il ne conviendrait point à Dieu de déroger par des exceptions perpétuelles. 2°. On regarde bien des choses comme des désordres, parce qu'on en ignore la raison et les usages ; et dès qu'on vient à les découvrir, on voit un ordre merveilleux. Par exemple, ceux qui adoptaient le système astronomique de Ptolémée, trouvaient dans la structure des cieux, et dans l'arrangement des corps célestes, des espèces d'irrégularités et des contradictions même qui les révoltaient. De-là cette raillerie ou plutôt ce blasphème d'Alphonse roi de Castille et grand mathématicien, qui disait que si la divinité l'avait appelé à son conseil, il lui aurait donné de bons avis. Mais depuis que l'ancien système a fait place à un autre beaucoup plus simple, et plus commode, les embarras ont disparu, et le monde s'est montré sous une forme à laquelle on défierait Alphonse lui-même de trouver à redire. Avant qu'on eut découvert en Anatomie la circulation du sang et d'autres vérités importantes, le véritable usage de plusieurs parties du corps humain était ignoré, au-lieu qu'à présent il s'explique d'une manière sensible. 3°. Quant aux choses inutiles, il ne faut pas être si prompt à les qualifier. Ainsi la pluie tombe dans la mer ; mais peut-être en tempere-t-elle la salure, qui sans cela deviendrait plus nuisible aux poissons, et les navigations en tirent souvent des rafraichissements bien essentiels. 4°. Enfin on trouve des utilités très-considérables dans les choses qui paraissent difformes ou même dangereuses. Les monstres, par exemple, font d'autant mieux sentir la bonté des êtres parfaits. L'expérience a su tirer des poisons mêmes d'excellents remèdes. Ajoutons que les bornes de notre esprit ne permettent pas de prononcer décisivement sur ce qui est beau ou laid, utîle ou inutîle dans un plan immense. Le hasard, dites-vous, cause aveugle, influe sur une quantité de choses, et les soustrait par conséquent à l'empire de la divinité. Mais qu'est-ce que le hasard ? Le hasard n'est rien ; c'est une fiction, une chimère qui n'a ni possibilité, ni existence. On attribue au hasard des effets dont on ne connait pas les causes ; mais Dieu connaissant de la manière la plus distincte toutes les causes et tous les effets, tant existants que possibles, rien ne saurait être hasard par rapport à Dieu. Mais à l'égard de Dieu, continuez-vous, n'y a-t-il pas bien des choses casuelles, comme le nombre des feuilles d'un arbre, celui des grains de sable de tel ou tel rivage ? Je réponds que le nombre des feuilles n'est pas moins déterminé que celui des arbres et des plus grands corps de l'univers. Il n'en coute pas plus à Dieu de se représenter les moindres parties du monde que les plus considérables ; et le principe de la raison suffisante n'est pas moins essentiel pour régler leur nombre, leur place, et toutes les autres circonstances qui les concernent, que pour assigner au soleil son orbite, et à la mer son lit. Si le hasard avait lieu dans les moindres choses, il pourrait l'avoir dans les plus grandes. Du moins on avouera que ce qui dépend de la liberté des hommes et des autres êtres intelligens, ne saurait être assujetti à la Providence. Je réponds qu'il serait bien étrange que le plus beau et le plus excellent ordre des choses créées, celui des intelligences, fût soustrait au gouvernement de Dieu, ayant reçu l'existence de lui comme tout le reste, et faisant la plus noble partie de ses ouvrages. Au contraire, il est à présumer que Dieu y fait une attention toute particulière. D'ailleurs, si l'usage de la liberté détruisait le gouvernement divin, il ne resterait presque rien des choses sublunaires qui fût sous la dépendance de Dieu, presque tout ce qui se passe sur la terre étant l'ouvrage de l'homme et de sa liberté. Mais Dieu en dirigeant les événements n'en détruit, ni même n'en change la nature et le principe. Il agit à l'égard des êtres libres d'une façon, s'il est permis de parler ainsi, respectueuse pour leur liberté. S'il y a quelque difficulté à concilier cette action de Dieu avec la liberté de l'homme, les bornes de notre esprit doivent en amortir l'impression. Comment Dieu, dit l'adversaire de la Providence, peut-il embrasser la connaissance et le soin de tant de choses à la fois ? Parler ainsi, c'est oublier la grandeur, l'infinité de Dieu. Y a-t-il quelque répugnance à admettre dans un être infini une connaissance sans bornes et une action universelle ? Nous-mêmes, dont l'entendement est renfermé dans de si étroites bornes, ne sommes nous pas témoins tous les jours de l'artifice merveilleux qui rassemble une foule d'objets sur notre rétine, et qui en transmet les idées à l'âme ? N'éprouvons-nous pas plusieurs sensations à la fois ? Ne mettons-nous pas en dépôt dans notre mémoire une quantité innombrable d'idées et de mots, qui se trouvent au besoin dans un ordre et avec une netteté merveilleuse ? Et comme il y a diverses nuances de gradations entre les hommes, et qu'un idiot de paysan a beaucoup moins d'idées qu'un philosophe du premier ordre, ne peut-on pas concevoir en Dieu toutes les idées possibles au plus haut degré de distinction ? N'est-il pas indigne de Dieu d'entrer dans de pareils détails ? Parler ainsi, c'est se faire une fausse idée de la majesté de Dieu. Comme il n'y a ni grand, ni petit pour lui, il n'y a rien non plus de bas et de méprisable à ses yeux. Il est au contraire parfaitement convenable à la qualité d'Etre suprême de diriger l'univers de telle sorte que les plus petites choses parviennent à sa connaissance, et ne s'exécutent point sans sa volonté. La majesté de Dieu consiste dans l'exercice de ses perfections, et cet exercice ne saurait avoir lieu sans sa providence. Les afflictions des gens de bien sont du-moins incompatibles avec le gouvernement d'un Dieu sage et juste ? Les méchants d'un autre côté prospèrent et demeurent impunis. Nous voici parvenus aux difficultés les plus importantes qui ont exercé dans tous les âges les Payens, les Juifs et les Chrétiens. Les Payens, surtout, toutes les fois qu'il arrivait quelque chose de contraire à leurs vœux, et que leur vertu ne recevait pas la récompense à laquelle ils s'attendaient ; les Payens, dis-je, formaient aussitôt des soupçons injurieux contre Dieu et contre sa providence, et ils s'exprimaient d'une manière impie. Les ouvrages des poètes tragiques en sont pleins. Il se présente plusieurs solutions que je ne ferai qu'indiquer. 1°. Tous ceux qui paraissent gens de bien ne le sont pas ; plusieurs n'ont que l'apparence de la piété, et leurs actions ne passent point jusqu'à leurs cœurs. 2°. Les plus pieux ne sont pas exemts de tache. 3°. Ce que les hommes regardent comme des maux ne mérite pas toujours ce nom ; ce n'est pas toujours être malheureux que de vivre dans l'obscurité, ces situations sont souvent plus compatibles avec le bonheur que l'élévation et les richesses. 4°. Le contentement de l'esprit, le plus grand de tous les biens, suffit pour dédommager les justes affligés de leurs traverses. 5°. L'issue en est avantageuse, les calamités servent à éprouver, et sont totalement à la gloire de ceux qui les endurent, en adorant la main qui les frappe. 6°. Enfin la vie future levera pleinement le scandale apparent, en dispensant des distributions supérieures aux maux présents. On trouve de très-judicieuses réflexions sur ce sujet dans les auteurs payens. Séneque a consacré un traité exprès : Quare viris bonis mala accidant, cum sit Providentia ? Les méchants d'un autre côté prospèrent et demeurent impunis, autre embarras pour les Payens. De-là ce mot impie de Jason dans Séneque, quand Médée s'envole après avoir égorgé ses fils : testare nullos esse, quia veheris, deos. Mais personne n'a traité ce sujet avec plus de force que Claudien dans son poème contre Rufin. Le morceau est trop beau pour ne pas le transcrire.
Saepe mihi dubiam traxit sententia mentem,
Curarent superi terras, an nullus inesset
Rector, et incerto fluèrent mortalia casu.
Nam cum dispositi quaesissem foedera mundi,
Praescriptosque mari fines, annique meatus,
Et lucis noctisque vices, tunc omnia rebar
Consilio firmata Dei, qui lege moveri
Sidera, qui fruges diverso tempore nasci,
Qui variam Phaeben alieno jusserit igne
Compleri, solemque suo, porrexerit undis
Littore, tellurem medio libraverit axe.
Sed cum res hominum tantâ caligine volvi
Respicerem, laetosque diu florere nocentes,
Vexarique pios, rursus labefacta cadebat
Religio, causaeque viam non sponte sequebar
Alterius, vacuo quae currere sidera motu
Affirmat, magnumque novas per inane figuras
Fortunâ non arte regi, quae numina sensu
Ambiguo, vel nulla putat, vel nescia veri.
Abstulit hunc tandem Rufini poena tumultum
Absolvitque deos, &c.
Plusieurs méchants paraissent heureux sans l'être ; ils sont le jouet des passions, et la proie des remords sans cesse renaissants. 2°. Les biens dont les méchants jouissent se convertissent pour eux ordinairement en poison. 3°. Les lois humaines font déjà payer à plusieurs coupables la peine de leurs crimes. 4°. Dieu peut supporter les pécheurs, et les combler même de bienfaits, soit pour les ramener à lui, soit pour récompenser quelques vertus humaines : il est de sa grandeur, et si j'ose ainsi parler, de sa générosité de ne se pas venger immédiatement après l'offense. 5°. Le temps des destinées éternelles arrivera, et ceux qui échappent à-présent à la vengeance divine, et qui jouissent en paix du ciel irrité, seront obligés de boire à longs traits le calice que Dieu leur a préparé dans sa fureur. Voyez l'article du MANICHEISME.
PROVIDENCE, (Mythologie) Les Romains honoraient la Providence comme une déesse particulière, à laquelle ils érigeaient des statues. On la représentait ordinairement sous la figure d'une femme appuyée sur une colonne, tenant de la main gauche une corne d'abondance renversée ; et de la droite, un bâton, avec lequel elle montre un globe, pour nous apprendre que la Providence divine étend ses soins sur tout l'univers. Elle est assez souvent accompagnée de l'aigle ou de la foudre de Jupiter, parce que c'est à Jupiter, principalement comme au souverain des dieux, que les Payens attribuaient la Providence qui gouverne toutes choses.
PROVIDENCE
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Science
- Catégorie : Métaphysique
- Affichages : 2485