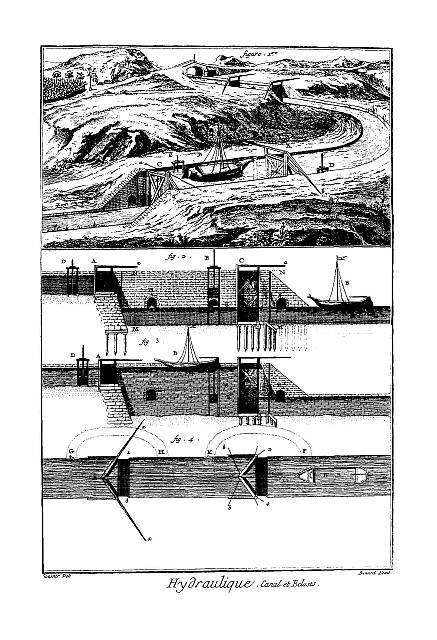S. m. (Métaphysique) le polythéisme est une opinion qui suppose la pluralité des dieux. Il est étonnant dans quels excès l'idolâtrie a précipité ses sectateurs. Lisez-en la description dans le discours de M. de Meaux sur l'Histoire universelle. " Tout était dieu, dit ce grand prélat, excepté Dieu lui-même, et le monde que Dieu avait fait pour manifester sa puissance, semblait être devenu un temple d'idoles. Le genre humain s'égara jusqu'à adorer ses vices et ses passions ; et il ne faut pas s'en étonner, il n'y avait point de puissance plus inévitable ni plus tyrannique que la leur. L'homme accoutumé à croire divin tout ce qui était puissant, comme il se sentait entrainé au vice par une force invincible, crut aisément que cette force était hors de lui, il s'en fit bien-tôt un dieu. C'est par-là que l'amour impudique eut tant d'autels, et que des impuretés qui font horreur, commencèrent à être mêlées dans les sacrifices. La cruauté y entra en même temps. L'homme coupable qui était troublé par le sentiment de son crime, et regardait la divinité comme ennemie, crut ne pouvoir l'apaiser par les victimes ordinaires. Il fallut verser le sang humain avec celui des bêtes. Une aveugle fureur poussait les pères à immoler leurs enfants, et à les bruler à leurs dieux au lieu d'encens. Ces sacrifices étaient communs dès le temps de Moïse, et ne faisaient qu'une partie de ces horribles iniquittés des Amorrhéens dont Dieu commit la vengeance aux Israélites. Mais ils n'étaient pas particuliers à ces peuples. On sait que dans tous les peuples du monde, sans en excepter aucun, les hommes ont sacrifié leurs semblables ; et il n'y a point eu d'endroits sur la terre où l'on n'en ait servi à ces tristes et affreuses divinités, dont la haine implacable pour le genre humain exigeait de telles victimes. Au milieu de tant d'ignorances l'homme vint à adorer jusqu'à l'œuvre de ses mains. Il crut pouvoir renfermer l'esprit divin dans ses statues ; et il oublia si profondément que Dieu l'avait fait, qu'il crut à son tour pouvoir faire un dieu. Qui le pourrait croire, si l'expérience ne nous faisait voir qu'une erreur si stupide et si brutale n'était pas seulement la plus universelle, mais encore la plus enracinée et la plus incorrigible parmi les hommes ? Ainsi il faut reconnaître, à la confusion du genre humain, que la première des vérités, celle que le monde prêche, celle dont l'impression est la plus puissante, était la plus éloignée de la vue des hommes. "
Les Athées prétendent que le culte religieux rendu à des hommes après leur mort, est la première source de l'idolâtrie, et ils en concluent que la religion est originairement une institution politique, parce que les premiers hommes qui furent déifiés, étaient ou des législateurs, ou des magistrats, ou d'autres bienfaiteurs publics. C'est ainsi que parmi les anciens, Evhémerus, surnommé l'athée, composa un traité pour prouver que les premiers dieux des Grecs étaient des hommes. Cicéron qui pénétra son dessein, observe fort judicieusement que ce sentiment tend à renverser toute religion. Parmi les modernes, l'anglais Toland a écrit une brochure dans le même dessein, intitulée, de l'origine de l'idolâtrie, et des motifs du paganisme. La conduite uniforme de ces deux écrivains est singulière. Evhémerus prétendait que son dessein était seulement d'exposer la fausseté de la religion populaire de la Grèce, et Toland a prétendu de même que son dessein n'était que d'écrire contre l'idolâtrie payenne, tandis que le but réel de l'un et de l'autre était de détruire la religion en général.
On doit avouer que cette opinion sur la première origine de l'idolâtrie a une apparence plausible, mais cette apparence n'est fondée que sur un sophisme qui confond l'origine de l'idolâtrie avec celle de tout culte religieux en général. Or il est non-seulement possible, mais même il est extrêmement probable que le culte de ce qu'on croyait la première et la grande cause de toutes choses, à été antérieur a celui des idoles, le culte idolâtre n'ayant aucune des circonstances qui accompagnent une institution originaire et primitive, ayant au contraire toutes celles qui accompagnent une institution dépravée et corrompue. Cela est non-seulement possible et probable, mais l'histoire payenne prouve de plus que le culte rendu aux hommes déifiés après leur mort, n'est point la première source de l'idolâtrie.
Un auteur dont l'autorité tient une des premières places dans le monde savant, aussi différent de Toland par le cœur que par l'esprit, je veux dire le grand Newton, dans sa chronologie grecque, parait être du même sentiment que lui sur l'origine de l'idolâtrie. " Eacus, dit-il, fils d'Egina, et de deux générations plus ancien que la guerre de Troie, est regardé par quelques-uns comme le premier qui ait bâti un temple dans la Grèce. Vers le même temps les oracles d'Egypte y furent introduits, ainsi que la coutume de faire des figures pour représenter les dieux, les jambes liées ensemble, de la même manière que les momies égyptiennes. Car l'idolâtrie naquit dans la Chaldée et dans l'Egypte, et se répandit de-là, etc. Les pays qu'arrosent le Tygre et le Nil, étant extrêmement fertiles, furent les premiers habités par le genre humain, et par conséquent ils commencèrent les premiers à adorer leurs rois et leurs reines après leur mort ". On voit par ce passage que cet illustre savant a supposé que le culte rendu aux hommes déifiés, était le premier genre d'idolâtrie, et il ne fait qu'en insinuer la raison ; savoir que le culte rendu aux hommes après leur mort, a introduit le culte des statues. Car les Egyptiens adorèrent d'abord leurs grands hommes décédés en leurs propres personnes ; c'est-à-dire leur momies ; et après qu'elles eurent été perdues, consumées ou détruites, ils les adorèrent sous des figures qui les représentaient, et dont les jambes, à l'imitation des momies, étaient liées ensemble. Il parait que M. Newton s'est lui-même donné le change en supposant que le culte des statues était inséparablement uni à l'idolâtrie en général ; ce qui est contraire à ce que rapporte Hérodote, que les Perses qui adoraient les corps célestes, n'avaient point de statues de leurs dieux, et à ce que Denys d'Halicarnasse nous apprend, que les Romains, dont les dieux étaient des hommes déifiés après leur mort, les adorèrent pendant plusieurs siècles sans statues.
Mais ce qui est remarquable, c'est que dès l'entrée de la question, les esprits forts renversent eux-mêmes ce qu'ils prétendent établir. Leur grand principe est que la crainte a d'abord fait des dieux, primus in orbe deos fecit timor ; et cependant si on veut les croire, ces premiers dieux furent des hommes déifiés après leur mort, à cause de leurs bienfaits envers leur patrie et le genre humain. Sans m'arrêter à cette contradiction, il est certain que ce grand principe de crainte est en toute manière incompatible avec leur système. Car les siècles où la crainte régnait le plus, et était la passion dominante du genre humain, furent ceux qui précédèrent l'établissement des sociétés civiles, lorsque la main de chaque homme était tournée contre son frère. Si la crainte était donc le principe de la religion, il s'ensuivrait incontestablement que la religion existait avant l'établissement des sociétés.
Comme l'espérance et la crainte, l'amour et la haine sont les grands ressorts des pensées et des actions des hommes, je ne crois pas que ce soit aucune de ses passions en particulier, mais je crois que toutes ensemble ont contribué à faire naître l'idée des êtres supérieurs dans l'esprit des premiers mortels, dont la raison brute n'avait point acquis la connaissance du vrai Dieu, et dont les mœurs dépravées en avaient effacé la tradition.
Ces premiers hommes encore dans l'état de nature, où ils trouvaient toute leur subsistance dans les productions de la terre, ont dû naturellement observer ce qui avançait ou retardait ces productions ; en sorte que le soleil qui anime le système du monde dû. bientôt être regardé comme la divinité éminemment bienfaisante. Le tonnerre, les éclairs, les orages, les tempêtes furent regardés comme des marques de sa colere ; et chaque orbe céleste en particulier fut envisagé sous la même face, à proportion de son utilité et de sa magnificence ; c'est ce qui parait de plus naturel sur l'origine de l'idolâtrie, et les réflexions suivantes le vont mettre entièrement dans son jour.
On trouve des vestiges de l'adoration des astres chez toutes les nations. Moyse Maimonide prétend qu'elle a précedé le déluge, et il en fixe la naissance vers le temps d'Enoch ; c'est aussi le sentiment de la plupart des rabbins, qui assurent que ce fut-là un des crimes que Dieu châtia par les eaux du déluge. Je ne détaillerai point ici leurs raisons, qui sont combattues par les SS. Peres et par les meilleurs interpretes de l'ancien testament, et je tomberai d'accord avec ces derniers, que l'idolâtrie n'a commencé qu'après le déluge ; mais en même temps je dois avouer qu'elle fit des progrès si rapides et si contagieux, que les origines de tous les grands peuples qui tirèrent leur naissance ou des enfants ou des petits enfants de Noé, en furent infectés. Les Juifs, hors quelques intervalles d'égarement, se conservèrent dans la créance de l'unité de Dieu, sous la main duquel ils étaient si particulièrement. Ils ne méconnurent point le grand ouvrier, pour admirer les beautés innombrables de l'ouvrage. Il faut cependant convenir, que si le peuple hébreu n'a point adoré les astres, il les a du moins regardé comme des êtres intelligens qui se connaissent eux-mêmes, qui obéissent aux ordres de Dieu, qui avancent ou retardent leurs courses, ainsi qu'il le leur prescrit. Origène Ve encore plus loin, et il soupçonne que les astres ont la liberté de pécher et de se repentir de leurs fautes. Sans doute que lui, qui allégorisait toutes choses, prenait à la lettre ce passage de Job : les cieux et les astres ne sont pas purs devant Dieu. Que d'erreurs grossières sont nées de l'ignorance de l'Astronomie ! combien les découvertes modernes nous ont dévoilé de vérités capitales, de points importants !
Les peuples les plus anciens du nord et du sud, les Suèves, les Arabes, les Africains, qui ont vécu longtemps sans être civilisés, adoraient tous les corps célestes. M. Sale, auteur anglais, entièrement versé dans l'histoire des Arabes, rapporte qu'après de longues observations et expériences sur les changements qui surviennent dans l'air, ces peuples attribuèrent enfin aux étoiles une puissance divine. Les Chinois, les Péruviens et les Méxicains paraissent aussi avoir d'abord adoré les corps célestes ; actuellement même les Chinois lettrés, qui forment une secte particulière, semblent se faire une divinité d'une certaine vertu répandue dans l'univers, et surtout dans le ciel matériel.
En un mot, toute l'antiquité est unanime sur ce point, et elle nous apprend que le premier culte religieux rendu à des créatures, a eu pour objet les corps célestes ; c'était une vérité si évidente et si universellement reconnue, que Critius fameux athée, a été obligé de l'admettre. Il ne peut y avoir que la force de la vérité qui lui ait arraché cet aveu, puisque cela même détruit entièrement son système sur l'origine de la religion ; voici le passage.
" Il y eu un temps où l'homme vivait en sauvage, sans lois, sans gouvernement, ministre et instrument de la violence, où la vertu n'avait point de récompense, ni le vice de châtiment. Les lois civiles furent inventées pour refréner le mal ; alors la justice présida à la conduite du genre humain. La force devint l'esclave du droit, et un châtiment inexorable poursuivit le coupable ; ne pouvant plus désormais violer ouvertement la justice, les hommes conspirèrent secrètement pour trouver le moyen de nuire aux autres. Quelque politique rusé, habîle dans la connaissance du cœur humain, imagina de combattre ce complot par un autre, en inventant quelque nouveau principe, capable de tenir dans la crainte les mécans, lorsque même ils diraient, penseraient ou feraient du mal en secret ; c'est ce qu'il exécuta en proposant aux peuples la créance d'un Dieu immortel, être d'une connaissance sans bornes, d'une nature supérieure et éminente. Il leur dit que ce Dieu pouvait entendre et voir tout ce que les mortels faisaient et disaient ici bas, et que la première idée du crime le plus caché ne pouvait point se dérober à la connaissance d'un être, dont la connaissance était l'essence même de sa nature ; c'est ainsi que notre politique en inculquant ces notions, devint l'auteur d'une doctrine merveilleusement séduisante, tandis qu'il cachait la vérité sous le voîle brodé de la fiction ; mais pour ajouter la terreur au respect, il leur dit que les dieux habitaient les lieux consacrés à tous les fantômes et à ces horreurs paniques, que les hommes ont été si ingénieux à imaginer pour s'épouvanter eux-mêmes, ajoutant des miseres imaginaires à une vie déjà surchargée de maux. Ces lieux où la lumière foudroyante des météores enflammés, accompagnée des éclats horribles du tonnerre, traverse la voute étoilée des cieux, l'ouvrage admirable de ce vieux et sage architecte, le temps où les cohortes associées des sphères lumineuses, remplissent leurs révolutions régulières et bienfaisantes, et d'où des pluies rafraichissantes descendent pour recréer la terre altérée ; telle fut l'habitation qu'il assigna à ses dieux, place propre à l'exercice de leurs fonctions ; telles furent les terreurs dont il se servit pour prévenir les maux, étouffer les désordres dans leur naissance, faire jouer le ressort de ses lois, et introduire la religion si nécessaire aux magistrats. Tel est à mon avis, l'artifice dont on s'est servi pour faire croire à des hommes mortels, qu'il y avait des êtres immortels. "
Ce serait abuser de la patience du lecteur, que d'accumuler des citations ; mais comme l'Egypte et la Grèce, de tous les pays, sont ceux où la politique et l'économie civîle prirent les racines les plus profondes et s'étendirent de-là presque par-tout, effacèrent la mémoire de l'ancienne idolâtrie, par l'idolâtrie plus récente de déifier les hommes après leur mort, et que plusieurs auteurs modernes en ont conclu, que ce dernier genre d'idolâtrie avait été le premier de tous ; je rapporterai ici seulement deux témoignages de l'antiquité, pour prouver que l'adoration des corps célestes a été le premier genre d'idolâtrie dans ces deux pays, aussi-bien que dans tous les autres. " Il me parait, dit Platon dans son Cratylus, que les premiers hommes qui ont habité la Grèce, n'avaient point d'autres dieux que ceux que plusieurs barbares adorent encore actuellement ; savoir, le soleil, la lune, la terre, les étoiles, les cieux ". Par ces nations barbares, Platon entend également, celles qui étaient civilisées et celles qui ne l'étaient pas ; savoir, les Perses et les sauvages d'Afrique, qui au rapport d'Hérodote, adoraient également les astres, dont la lumière bienfaisante renouvelle toute la nature.
Le second témoignage que j'ai à rapporter, regarde les Egyptiens, et il est tiré du premier livre de Diodore de Sicile. " Les premiers hommes, dit-il, en parlant de cette nation, levant les yeux vers le ciel, frappés de crainte et d'étonnement à la vue du spectacle de l'univers, supposèrent que le soleil et la lune en étaient les principaux dieux et qu'ils étaient éternels ". La raison que cet historien rapporte rend sa proposition générale, l'étend à toutes les nations, et fait voir qu'il croyait que ce genre d'idolâtrie avait été le premier en tout autre lieu aussi bien qu'en Egypte.
En général, les anciens croyaient que tout ce qui se meut de lui-même et d'une manière réglée, participe bien surement à la divinité, et que le principe intérieur par lequel il se meut, est non-seulement incréé, mais encore exempt de toute altération. Cela supposé, on voit que dans la pensée où étaient les anciens, que les astres se mouvaient d'eux-mêmes, ils devaient nécessairement les regarder comme des dieux, comme les auteurs et les conservateurs de l'univers.
Au reste, c'étaient le soleil et la lune, qui par leur éclat et leur lumière se rendaient dignes des principaux hommages, dont le peuple superstitieux honorait les astres. Le soleil se nommait le roi, le maître et le souverain ; et la lune la reine, la princesse du ciel. Tous les autres globes lumineux passaient ou pour leurs sujets, ou pour leurs conseillers, ou pour leurs gardes, ou pour leur armée. L'Ecriture-sainte parait elle-même s'accommoder à ce langage, en faisant mention de la milice du ciel, à qui le peuple offrait ses hommages.
Théodoret, en voulant piquer les payens sur le culte qu'ils rendaient encore de son temps aux astres, fait une réflexion bien sensée. Le souverain arbitre de la nature, dit-il, a doué ses ouvrages de toutes les perfections dont ils étaient susceptibles ; mais comme il a craint que l'homme faible et timide n'en fût ébloui, il a entremêlé ces mêmes ouvrages de quelques défauts et de quelques imperfections, afin que d'un côté ce qu'il y a de grand et de merveilleux dans l'univers s'attirât notre admiration, et que de l'autre, ce qui s'y trouve d'incommode et de différence, nous ôtât la pensée de lui rendre aucun culte divin. Ainsi de quelque éclat, de quelque lumière dont brillent le soleil et la lune, il ne faut qu'un simple nuage pour effacer l'un en plein midi, et pour obscurcir l'autre pendant les plus belles nuits de l'été. Ainsi la terre est une source inépuisable de trésors, elle ne ressent aucune vieillesse, elle renouvelle ses libéralités en faveur des hommes laborieux ; mais de peur qu'on ne fût tenté de l'adorer et de lui offrir des respects, Dieu en a fait un théâtre des plus grandes agitations, le séjour des maladies cruelles et des guerres sanglantes. Parmi les animaux utiles se trouvent les serpens venimeux, et parmi les plantes salutaires se cueillent des herbes qui empoisonnent.
On invoquait plus particulièrement le soleil sur les hauts lieux ou toits des maisons, à la lumière et en plein jour : on invoquait de la même manière la lune dans les bocages et les vallées, à l'ombre et pendant la nuit ; et c'est à ce culte secret qu'on doit rapporter l'origine de tant d'actions indécentes, de tant de coutumes folles, de tant d'histoires impures, dont il est étonnant que des hommes, d'ailleurs sensés et raisonnables, aient pu faire une matière de religion. Mais de quoi ne sont pas capables ceux qui viennent à s'oublier eux-mêmes, et qui font céder la lumière de l'esprit aux rapides égarements du cœur ? A cette adoration des astres tenait celle du feu, en tant qu'il est le plus noble des éléments, et une vive image du soleil. On ne voyait même autrefois aucun sacrifice ni aucune cérémonie religieuse, où il n'entrât du feu. Celui qui servait à parer les autels, et à consumer les victimes qu'on immolait aux dieux, était traité avec beaucoup d'égard et de distinction. On feignait qu'il avait été apporté du ciel, et même sur l'autel du premier temple que Zoroastre avait fait bâtir dans la ville de Zix en Médie. On n'y jetait rien de gras ni d'impur ; on n'osait même le regarder fixément : tanta gentium in rebus frivolis, s'écrie Pline, plerumque religio est. Pour en imposer davantage, les prêtres payens toujours fourbes et imposteurs, entretenaient ce feu secrètement, et faisaient accroire au peuple, qu'il était inaltérable et se nourrissait de lui-même. Le lieu du monde où l'on revérait davantage le feu, était la Perse. Il y avait des enclos fermés de murailles et sans tait, où l'on en faisait assidument, et où le peuple soumis venait à certaines heures pour prier. Les personnes qualifiées se ruinaient à y jeter des essences précieuses et des fleurs odoriférantes. Les enclos qui subsistent encore peuvent être regardés comme les plus anciens monuments de la superstition.
Ce qui embarrasse les Savants sur l'origine de l'idolâtrie, c'est qu'on n'a pas fait assez d'attention aux degrés par lesquels l'idolâtrie des hommes déifiés après leur mort, a supplanté l'ancienne et primitive idolâtrie des corps célestes. Le premier pas vers l'apothéose a été de donner aux héros et aux bienfaiteurs publics le nom de l'être qui était le plus estimé et le plus révéré. C'est ainsi qu'un roi fut appelé le soleil, à cause de sa munificence, et une reine la lune, à cause de sa beauté. Ce même genre d'adulation subsiste encore parmi les nations orientales, quoique dans un degré subordonné ; ces titres étant aujourd'hui plutôt un compliment civil, qu'un compliment religieux. A mesure qu'un genre d'adulation fit des progrès, on retourna la phrase, et alors la planète fut appelée du nom du héros, afin sans doute d'accoutumer plus facilement à ce nouveau genre d'adoration, ce peuple déjà accoutumé à celle des planètes. Diodore de Sicîle après avoir dit que le soleil et la lune furent les premiers dieux d'Egypte, ajoute qu'on appela le soleil du nom d'Osiris, et la lune du nom d'Isis.
Par cette manière d'introduire un nouveau genre d'idolâtrie, l'ancienne et la nouvelle furent confondues ensemble. On peut juger de l'excès de cette confusion par la savante collection de Vossius, sur la théologie des payens, où l'on voit de combien d'obscurités on a embrouillé ce point de l'antiquité, en se proposant de l'expliquer, dans la supposition qu'un de ces deux genres d'idolâtrie, n'était qu'une idée symbolique de l'autre.
M. l'abbé Pluche, dans son histoire du ciel, a inventé un nouveau système sur l'origine de l'idolâtrie. Il prétend que ce n'est point l'admiration du soleil qui a fait adorer le soleil à la place de son auteur. Jamais, dit-il, ce spectacle de l'univers n'a corrompu les hommes : jamais il ne les a détournés de la pensée d'un être moteur de tout, et de la reconnaissance qu'ils doivent à une providence toujours féconde en nouvelles libéralités ; il les y rappele, loin de les en détourner. L'écriture symbolique des Egyptiens, si on l'en croit, par l'abus que la cupidité en a fait, est la source du mal. Toutes les nations s'y sont empoisonnées, en recevant les caractères de cette écriture sans en recevoir le sens. Une autre conséquence de ce système, tout aussi naturelle, c'est que les anciens dieux n'ont point été des hommes réels ; la seule méprise des figures hiéroglyphiques a donné naissance aux dieux, aux déesses, aux métamorphoses, aux augures, et aux oracles. C'est-là ce qu'il appelle rapporter toutes les branches de l'idolâtrie à une seule et même racine ; mais ce système est démenti par les mystères si célèbres parmi les payens ; on y enseignait avec soin que les dieux étaient des hommes déïfiés après leur mort. M. l'abbé Pluche tâche de prouver son sentiment par l'autorité de Cicéron, et Cicéron dit positivement dans ses tusculanes, que les cieux sont remplis du genre humain. Il dit encore dans son traité de la nature des dieux, que les dieux étaient des hommes puissants et illustres, qui avaient été déïfiés après leur mort. Il rapporte qu'Evhémerus enseigne où ils sont enterrés, sans parler, ajoute-t-il, de ce qui s'enseigne dans les mystères d'Eleusis et de Samothrace. Cependant malgré des preuves si décisives, M. l'abbé Pluche, en parlant des mystères, prétend que ce ne sont point des dieux qu'il faut chercher sous ces enveloppes, qu'elles sont plutôt destinées à nous apprendre l'état des choses qui nous intéressent ; et ces choses qui nous intéressent ne sont, selon lui, que le sens des figures qu'on y représentait, réduit aux règlements du labourage encore informe, aux avantages de la paix, et à la justice qui donne droit d'espérer une meilleure vie.
Mais pour renverser de fond en comble tout le système de M. l'abbé Pluche, je vais rapporter un témoignage décisif, tiré de deux des plus grands pères de l'église, et qui prouve que l'hiérophante dans les mystères même d'Egypte, où M. l'abbé Pluche a placé le lieu de la scène, enseignait que les dieux nationaux étaient des hommes qui avaient été déïfiés après leur mort. Le trait dont il s'agit est du temps d'Alexandre, lorsque l'Egypte n'avait point encore succé l'esprit subtil et spéculatif de la philosophie des Grecs. Ce conquérant écrit à sa mère que le suprême hiérophante des mystères égyptiens lui avait découvert en secret les instructions mystérieuses que l'on y donnait, concernant la nature des dieux nationaux. Saint Augustin et saint Cyprien nous ont conservé ce fait curieux de l'histoire ancienne : voici ce qu'en dit le premier dans le huitième livre de la Cité de Dieu. " Ces choses sont de la même espèce que celles qu'Alexandre écrivit à sa mère, comme lui ayant été révélées par un certain Léon, le suprême hiérophante des mystères d'Egypte ; savoir que Picus, non-seulement Faunus, Enée, Romulus, et même Hercule, Esculape, Bacchus, fils de Sémelé, Castor et Pollux, et les autres de même rang, étaient des hommes que l'on avait déïfiés après leur mort ; mais encore que les dieux de la première classe, auxquels Cicéron parait faire allusion dans ses tusculanes, comme Jupiter, Junon, Saturne, Neptune, Vulcain, Vesta, et plusieurs autres, que Varron voudrait par des allégories transformer dans les éléments où les parties du monde, avaient été de même que les autres, des hommes mortels. Léon rempli de crainte, sachant qu'en révélant ces choses, il révélait les secrets des mystères, supplia Alexandre, qu'après les avoir communiquées à sa mère, il lui ordonnât de bruler sa lettre ". Saint Cyprien dit que la crainte du pouvoir d'Alexandre extorqua de l'hiérophante le secret des hommes dieux.
Ces différents témoignages confirment de plus en plus que les mystères avaient été destinés à découvrir la fausseté des divinités populaires, afin de soutenir la religion des hommes de bon sens, et de les exciter au service de leur patrie. Dans cette ancienne institution imaginée par les hommes les plus sages et les plus habiles, en enseignant que les dieux étaient des hommes déïfiés à cause de leurs bienfaits envers la société : rien n'était plus propre que l'histoire de ces bienfaits à exciter le zéle à l'héroïsme. D'un autre côté, la découverte du véritable état de ces héros sur la terre, qui avaient participés à toutes les faiblesses de la nature humaine, prévenait le mal qu'aurait pu produire l'histoire de leurs vices et de leurs dérèglements ; histoire propre à faire accroire aux hommes qu'ils étaient autorisés par l'exemple des dieux à donner dans les mêmes excès. Si l'on suppose avec M. Pluche, que tous les dieux provenaient d'un alphabet égyptien, quel motif peut-on supposer dans les peuples, qui les ait entrainés vers l'idolâtrie ? Ils s'y seraient précipités, pour ainsi dire, de gaieté de cœur, sans y avoir été déterminés, sans aucune de ces passions vives et véhémentes qui agissent également sur le cœur et sur l'esprit, qui accompagnent toujours les grandes révolutions, et qui régnant avec une force universelle dans le cœur de tous les hommes, peuvent seules être envisagées comme la cause d'une pratique universelle. Mais que l'on suppose au contraire ce que toute l'antiquité nous apprend, que les peuples ont adoré leurs ancêtres et leurs premiers rais, à cause des bienfaits qu'ils en avaient reçu, on ne peut alors concevoir un motif plus puissant ni plus capable de les avoir conduits à l'idolâtrie ; et de la sorte l'histoire du genre humain se concilie avec la connaissance de la nature humaine, et celle de l'effet des passions.
Ce n'est point une simple conjecture que de croire qu'une reconnaissance superstitieuse fit regarder comme des dieux les inventeurs des choses utiles à la société. Eusebe juge compétent, s'il y en eut jamais, des sentiments de l'antiquité, atteste ce fait, comme un fait notoire et certain. Ce savant évêque dit que ceux qui dans les premiers âges du monde excellèrent par leur sagesse, leur force, ou leur valeur, ou qui avaient le plus contribué au bien commun des hommes, ou inventé, ou perfectionné les Arts, furent déïfiés durant leur vie même, ou immédiatement après leur mort. C'est ce qu'Eusebe avait lui-même puisé dans une des histoires des plus anciennes et des plus respectables, l'histoire phénicienne et sanchoniate, qui donne un détail fort exact de l'origine du culte des héros ; et qui nous apprend expressément que leur déïfication se fit immédiatement après leur mort, temps où le souvenir de leurs bienfaits était encore récent dans la mémoire des hommes, et où les mouvements d'une reconnaissance vive et profonde absorbant, pour ainsi dire, toutes les facultés de leur âme, enflammaient les cœurs et les esprits de cet amour et de cette admiration, que M. Pope a si parfaitement dépeint dans son essai sur l'homme.
Un mortel généreux, par ses soins, sa valeur,
Du public qu'il aimait, faisait-il le bonheur ?
Admirait-on en lui les qualités aimables
Qui rendent aux enfants les pères respectables ?
Il commandait sur tous, il leur donnait la loi,
Et le père du peuple en devenait le roi.
Jusqu'à ce temps fatal, seul reconnu pour maître,
Tout patriarche était le monarque, le prêtre,
Le père de l'état qui se formait sous lui.
Ses peuples après Dieu n'avaient point d'autre appui.
Ses yeux étaient leur loi, sa bouche leur oracle,
Jamais ses volontés ne trouvèrent d'obstacle ;
De leur bonheur commun il devint l'instrument,
Du sillon étonné tira leur aliment.
Il leur porta les Arts, leur apprit à réduire
Le feu, l'air, et les eaux aux lois de leur empire,
Fit tomber à leurs pieds les habitants des airs,
Et tira les poissons de l'abyme des mers.
Lorsqu' enfin abattu sous le poids des années
Il s'éteint et finit ses longues destinées,
Cet homme comme un dieu si longtemps honoré,
Comme un faible mortel par les siens est pleuré.
Jaloux d'en conserver les traits et la figure,
Leur zèle industrieux inventa la peinture.
Leurs neveux attentifs à ces hommes fameux
Qui par le droit du sang avaient régné sur eux,
Trouvent-ils dans leur suite un grand, un premier père,
Leur aveugle respect l'adore et le révère.
Ces premiers sentiments antérieurs à l'idolâtrie, en furent la première cause par les passions d'amour et d'admiration qu'ils excitèrent dans un peuple encore simple et ignorant. On ne doit pas être étonné qu'un peuple de ce caractère ait été porté à regarder comme des espèces de dieux, ceux qui avaient enseigné aux hommes à s'assujettir les éléments. Ils devinrent le sujet de leurs hymnes, de leurs panégyriques, et de leurs hommages ; et l'on peut observer que parmi toutes les nations, les hommes dont la mémoire fut consacrée par un culte religieux, sont les seuls de ces temps anciens et ignorants, dont le nom n'ait point été enseveli dans l'oubli.
On a Ve dans ces temps postérieurs, lorsque les circonstances étaient semblables, des hommes parvenir aux honneurs divins avec autant de facilité et de succès, que les anciens héros, qu'Osiris, Jupiter, ou Bélus ; car la nature en général est uniforme dans ses démarches. On s'est à la vérité moqué des apothéoses d'Alexandre et de César ; mais c'est que les nations au milieu desquelles ils vivaient, étaient trop éclairées. Il n'en fut pas de même d'un Odin, qui vivait vers le temps de César, et qui fut mis par le peuple du nord au-dessus de tous les autres dieux. C'est que ces peuples étaient encore barbares et sauvages, et qu'une pareille farce ne peut être jouée avec applaudissement, que le lieu de la scène ne soit parmi un peuple grossier et ignorant.
Tacite rapporte que c'était une coutume générale parmi les nations du nord, que de déifier leurs grands hommes, non à la manière des Romains leurs contemporains, uniquement par flatterie et par persuasion intime, mais sérieusement et de bonne foi. Un trait qui se trouve dans Ezéchiel, confirme que l'apothéose se faisait souvent du vivant même des rais. Ton cœur s'en glorifie, dit Dieu en s'adressant au roi de Tyr par la bouche de son prophète, tu as dit, je suis un dieu, je suis assis sur le trône de Dieu au milieu de la mer, cependant tu n'es qu'un homme et non un dieu.... Diras-tu encore que tu es un dieu ?.... Mais tu trouveras que tu es un homme et non un dieu. Ce passage indique, ce me semble, que les sujets du roi de Tyr rendaient à ce prince un culte idolâtre, même durant sa vie, et il est assez vraisemblable qu'il devint dans la suite un des Neptunes grecs.
Sous prétexte d'expliquer l'antiquité, M. Pluche la renverse et la détruit entièrement. Sa chimère est que toutes les coutumes civiles et religieuses de l'antiquité sont provenues de l'agriculture, et que les dieux et les déesses mêmes proviennent de cette moisson fertile. Mais s'il y a deux faits dans l'antiquité, que le scepticisme même avait honte, dans ses moments de sincérité et de bon sens, de révoquer en doute, c'est que ce culte idolâtre des corps célestes, a eu pour premier fondement l'influence sensible et visible qu'ils ont sur les corps sublunaires, et que les dieux tutélaires des passions payennes étaient des hommes déifiés après leur mort, et à qui leurs bienfaits envers le genre humain ou envers leurs concitoyens avaient procuré les honneurs divins ; qui croirait que ces deux faits puissent être niés par une personne qui prétend à la connaissance de l'antiquité, et qui se propose de l'expliquer ? Mais ni les hommes, ni les dieux ne peuvent tenir contre un système. M. Pluche nous assure que tout cela est illusion ; que l'antiquité n'a eu aucune connaissance de cette matière ; que les corps célestes n'ont point été adorés à cause de leur influence ; qu'Osiris, Isis, Jupiter, Pluton, Neptune, Mercure, que même les héros demi-dieux, comme Hercule et Minos, n'ont jamais existé ; que ces prétendus dieux n'étaient que les lettres d'un ancien alphabet, de simples figures qui servaient à donner des instructions au laboureur égyptien. Ses hiéroglyphes sont presqu'entièrement confinés à la seule agriculture et à l'usage des calendriers ; ce qui suppose ou qu'ils n'ont point été destinés dans leur origine à représenter les pensées des hommes, sur quelques sujets qu'elles pussent rouler, ou que les soins de ces fameux personnages de l'antiquité, qui ont établi, affermi et gouverné les sociétés, étaient absorbés par l'agriculture, ou qu'ils n'étaient occupés d'aucune autre idée. L'agriculture, en un mot, est la base principale et fondamentale à ce système de l'antiquité ; tout le reste n'y est inséré que pour l'ornement de la scène. Ce système, que l'on peut regarder comme le débordement d'une imagination féconde, est lui-même comme l'ancienne, dont les débordements du Nil couvraient les terres les plus fertiles de l'Egypte ; et qui, échauffée et mise en fermentation par les rayons puissants du soleil, produisait des hommes et des monstres. Les dieux de M. l'abbé Pluche paraissent sortir des sillons, comme l'on dit qu'il est autrefois arrivé au dieu Tagès.
Mais comment prouve-t-il la justesse du principe sur lequel il fonde son système, et la vérité des conséquences qu'il en déduit ? Il les prouve alternativement l'un par l'autre, le principe par la conséquence, et la conséquence par le principe. Toutes les fois qu'il veut prouver qu'un hiéroglyphe que l'on prenait pour la figure réelle d'un dieu, n'est qu'un symbole de l'agriculture, il suppose que ce ne peut être la figure réelle d'un dieu, parce que les dieux n'ont point existé ; il en conclut que c'est un symbole ; il lui plait que ce soit un symbole de l'agriculture ; et lorsqu'il veut prouver que les dieux n'ont point existé, alors il suppose que l'hiéroglyphe que l'on prenait pour la figure réelle d'un dieu, n'était qu'un symbole de l'agriculture.
En général on peut dire contre le système de M. Pluche, qu'il est absurde de supposer que les Egyptiens n'aient fait usage des hiéroglyphes que pour les choses qui concernent le labourage. Il est fort naturel de croire, que l'esprit n'ayant pas encore inventé des signes qui servissent à représenter les sons et non les choses, les législateurs et les magistrats auront été obligés de puiser dans cette source, c'est-à-dire, de recourir aux hiéroglyphes pour s'exprimer aux yeux du peuple sur les matières relatives au culte religieux, au gouvernement de la société, à l'histoire des héros, aux arts et aux sciences. Le genre d'expression était extrêmement imparfaite, et le sujet des méprises infinies, toutes les fois qu'au défaut des images réelles on était obligé d'employer des images symboliques. Souvent on substituait le symbole à l'idée ; et c'est ainsi qu'après s'être servi de la figure des animaux et des végétatifs, pour exprimer les attributs des dieux et des héros, on a substitué à ces dieux et à ces héros les animaux et les végétatifs même. On a cru que ces dieux les animaient, qu'ils s'étaient cachés sous leur figure, et on les a adorés. Ce progrès est sensible dans l'exemple d'Osiris et d'Apis.
De ce qui n'était que l'origine d'une seule branche de l'idolâtrie, M. Pluche en a voulu faire l'origine de toute l'idolâtrie. Des images empruntées de la diversité des objets visibles qui sont sur la terre et dans les cieux, ne pouvant manquer d'avoir quelque rapport avec les productions de l'agriculture, qui sont en même temps les effets de la fécondité de la terre et de l'influence des astres. De ce rapport M. Pluche a conclu qu'il fallait expliquer les hiéroglyphes relativement à l'agriculture ; et ce qui s'y trouvait sur les dieux, sur le gouvernement et sur l'histoire, est devenu dans son esprit un instrument ou une instruction pour le labourage. Il a employé les monuments même de l'antiquité pour la détruire, comme le père Hardouin s'est servi de médailles pour renverser l'histoire. Ses conjectures ont pris la place des faits, l'imagination a dégradé la vérité ; et j'oserais dire qu'il ne serait pas difficile, en conséquence des mêmes principes, de prouver que les dieux d'Egypte, au lieu de provenir de l'agriculture proviennent des jeux de cette nation ; de leurs fêtes, de leurs combats, de leur manière de chasser, de pêcher, et même si l'on voulait de leur cuisine, et les langues orientales ne manqueraient pas de fournir des étimologies pour soutenir ces différents sentiments.
L'idolâtrie ayant déifié les hommes, il était tout naturel qu'elle communiquât à ses dieux les défauts des hommes. C'est aussi ce qui arriva. Les dieux du paganisme furent donc hommes en toutes manières, à cela près qu'ils étaient plus puissants que des hommes. Les hommes jouissaient du plaisir secret de voir retracée dans de si respectables modèles l'image de leurs propres passions, et d'avoir pour fauteurs et pour complices de leurs débauches, les dieux mêmes qu'ils adoraient. Sous le nom de fausses divinités, c'étaient en effet leurs propres pensées, leurs plaisirs et leurs fantaisies qu'ils adoraient. Ils adoraient Vénus, parce qu'ils se laissaient dominer par l'amour sensuel, et qu'ils en aimaient la puissance. Ils érigeaient des autels à Bacchus le plus enjoué de tous les dieux, parce qu'ils s'abandonnaient et qu'ils sacrifiaient, pour ainsi dire, à la joie des sens plus douce et plus enivrante que le vin. La manie de déifier alla si loin, qu'on déifia même les villes, et Rome fut considérée comme une déesse.
Le polythéisme considéré en lui-même, est également contraire à la raison et aux phénomènes de l'univers. Quand on a une fois admis l'existence d'une nature infiniment parfaite, il est facîle de comprendre qu'elle est l'unique, et qu'aucun être ne peut l'égaler. Si notre raison peut s'élever jusqu'à ce principe, il existe une telle nature, elle fera aisément et sans nul secours cet autre pas, qui est plus facîle sans comparaison que le premier, donc il n'y a qu'un seul dieu. S'il pouvait y avoir trois ou quatre de ces natures, il pourrait y en avoir non-seulement dix millions, mais aussi une infinité, car on ne saurait trouver aucune raison d'un certain nombre plutôt que d'un autre. Comme donc le nombre binaire enfermerait une superfluité qui choque notre raison, l'ordre demande que l'on se réduise à l'unité. Si chacune de ces matières était souverainement parfaite, elle n'aurait besoin que d'elle-même pour jouir d'une félicité infinie ; la société des autres ne lui servirait donc de rien, et ainsi notre raison ne pourrait souffrir aucune pluralité. C'est un de ses axiomes, que la nature ne fait rien en vain, et que c'est en vain que l'on emploie plusieurs causes pour un effet qu'un plus petit nombre de causes peut produire aussi commodément : la maxime qui a été appelée la raison des nominaux, parce qu'elle leur a servi à retrancher des écoles de philosophie une infinité d'excrescences et d'entités superflues ; la maxime, dis-je, qu'il ne faut point multiplier les êtres sans nécessité, est un principe qu'aucune secte de philosophie n'a rejeté ; or elle ruine sans ressource le polythéisme.
Le polythéisme n'est pas moins contraire aux phenomenes qu'à la raison, puisqu'on ne voit aucun désordre dans le monde, ni aucune confusion dans ses parties qui puissent faire soupçonner qu'il y a plusieurs divinités indépendantes auxquelles il soit soumis. Or cependant c'est ce qui arriverait, si le polythéisme avait lieu. M. Bayle prouve parfaitement bien que la religion payenne était un principe d'anarchie. En effet, ces dieux qu'elle répandait partout, et dont elle remplissait le ciel et la terre, la mer et l'air, étant sujets aux mêmes passions que l'homme, la guerre était immanquable entr'eux. Ils étaient et plus puissants et plus habiles que les hommes : tant pis pour le monde. L'ambition ne cause jamais autant de ravages que lorsqu'elle est secondée d'un grand pouvoir et d'un grand esprit.
Le désordre commença bientôt dans la famille divine. Titan le fils ainé du premier des dieux fut privé de la succession par les intrigues de ses sœurs, qui ayant gagné leur mère, firent en sorte qu'il cédât son droit à Saturne son frère puiné, de sorte qu'une cabale de femmes troubla la loi naturelle dès la première génération. Saturne dévorait ses enfants mâles pour tenir parole à Titan, mais son épouse le trompa, et fit nourrir en secret trois de ses fils. Titan ayant découvert ce manège, résolut de tirer raison de cette injure, et fit la guerre à Saturne et le vainquit, et l'enferma dans une noire prison lui et sa femme. Jupiter fils de Saturne, soutint la guerre, et remit en liberté son père et sa mère ; et alors Titan et ses fils, chargés de fers, furent enfermés dans le tartare, qui était la même prison où Saturne et son épouse avaient été enchainés. Saturne redevable de sa liberté à son fils, n'en fut pas reconnaissant. Un oracle lui avait prédit que Jupiter le détronerait ; il tâcha de prévenir cette prédiction. Mais Jupiter s'étant aperçu de l'entreprise, le renversa du trône, le chargea de chaînes, et le précipita dans le tartare. Il le châtia même, comme Saturne en avait usé envers son père. Le sang qui coula de la plaie que Saturne reçut en cette occasion, tomba sur la terre, et produisit des géans, qui s'efforcèrent de déposer Jupiter. Le combat fut rude et douteux pendant assez longtemps. Enfin la victoire se déclara pour Jupiter.
Ce sont les principales guerres divines dont les Payens aient fait mention. Ils se sont autant éloignés du vraisemblable, en ne continuant point l'histoire de cette suite de rébellions, qui ont dû être fréquentes, qu'ils s'y étaient conformés en la conduisant jusqu'à la gigantomachie. Rien ne choque plus la vraisemblance, que de voir qu'ils ont supposé que les autres dieux ne conspiraient pas souvent contre Jupiter, et que par des ligues et des contre-ligues ils ne tâchaient pas de s'agrandir, ou de s'exposer aux usurpateurs. La suite naturelle et inévitable du caractère qu'on leur donne, était qu'ils se querelassent plus souvent, et qu'ils entreprissent plus fréquemment de s'emparer des états les uns des autres, que les hommes ne se querellent et ne forment de pareilles entreprises. Cela Ve loin, comme vous voyez. Junon seule, telle qu'on la représente, devait tailler plus de besogne à Jupiter son mari, qu'il n'en eut su expédier. Elle était jalouse, fière, vindicative excessivement, et se voyait tous les jours trahie par son mari. Quels tumultes ne devait-elle pas exciter ? Quels complots ne devait-elle pas former contre un époux si infidèle ? Il se tira d'une guerre qu'elle lui avait suscitée, et d'une seconde conspiration où elle entra. Quels désordres ne causa-t-elle pas dans le monde pour se venger de ses rivales, et pour perdre tous ceux qui lui déplaisaient ? Il n'y a rien de plus vraisemblable dans l'Enéide, que le personnage qu'elle y joue ; personnage si pernicieux, qu'elle fait sortir des enfers une furie, pour inspirer la rage martiale à des peuples qui ne songeaient qu'à la paix. Souvenez-vous qu'il y avait encore d'autres déesses. Il n'eut fallu que celle-là pour mettre le trouble parmi les dieux. Cela rendait inévitables les fonctions et les intrigues, les complots et les querelles. Un bel esprit (le chevalier Temple) les a bien décrites, en disant que ce sont des guerres d'anarchie, dont les mauvais fruits murissent tôt ou tard, et bouleversent quelquefois les sociétés les plus florissantes. L'histoire est toute remplie de ces sortes de choses. Voici donc comme je raisonne. Malgré toutes les précautions qu'on a prises dans les états, malgré les différentes formes de gouvernement qu'on y a successivement introduites, on n'a jamais pu ôter les semences de l'anarchie, ni empêcher qu'elle ne levât la tête de temps en temps. Les séditions, les guerres civiles, les révolutions sont fréquentes dans tous les états, quoique plus ou moins dans les uns que dans les autres. Pourquoi cela ? C'est que les hommes sont sujets à des mauvaises passions. Ils sont envieux les uns des autres. L'avarice, l'ambition, la volupté, la vengeance les possédent. Ceux qui doivent commander, s'en acquittent mal. Ceux qui doivent obéir, s'en acquittent encore quelquefois plus mal. Vous donnez des bornes à l'autorité royale ; c'est le moyen d'inspirer l'envie de parvenir à la puissance despotique. En un mot, les uns abusent de l'autorité, et les autres de la liberté. Or puisque les dieux étaient sujets aux mêmes passions que l'homme, il fallait donc nécessairement qu'il y eut des guerres entr'eux, et des guerres d'autant plus funestes, qu'ils surpassaient l'homme en esprit et en puissance ; des guerres qui ébranlassent jusqu'au centre de la mer et de la terre, l'air et les cieux, des guerres enfin qui missent l'anarchie, le trouble et la confusion dans tous les corps de l'univers. Or puisque cette anarchie n'est point venue, c'est une marque qu'il n'y a point eu de guerre entre les dieux ; et c'est en même temps une preuve qu'ils n'existaient point, car s'ils eussent existé, ils n'eussent point pu être d'accord. Je ne voudrais point d'autre raison que celle-là pour me convaincre de la fausseté de la religion payenne.
Le polythéisme étant si absurde en lui-même, et si contraire en même temps aux phénomènes, vous me demanderez peut-être ce qu'en pensaient les plus sages d'entre les Payens. C'est à quoi je vais satisfaire. Il y avait autrefois trois classes de dieux, rangés avec beaucoup d'adresse : les poétiques, les politiques, et les philosophiques. C'est la division qu'en fait le grand pontife Scevola, qui se trouvant à la tête de tous les ministres de la superstition, ne devait point s'y méprendre. Les dieux poétiques semblaient abandonnés au vulgaire qui se repait de fictions. Les politiques servaient dans les occurrences délicates, où il fallait relever les courages abattus, les manier avec dextérité, leur donner une nouvelle force. Les philosophiques enfin n'offraient rien que de noble, de pur, de convenable au petit nombre d'honnêtes gens qui parmi les payens, savaient penser. Ces derniers ne reconnaissaient qu'un seul Dieu qui gouvernait l'univers par le ministère des génies ou des démons, à qui ils donnaient le nom de divinités subalternes. M. Bayle prétend qu'aucun philosophe payen n'a eu connaissance de l'unité de Dieu ; car tous ceux, dit-il, qui semblent reconnaître cette vérité, ont réduit à la seule divinité du soleil tous les autres dieux du paganisme, ou n'ont point admis d'autre dieu que l'univers même, que la nature, que l'âme du monde. Or on comprend aisément, pour peu qu'on y fasse attention, que l'unité ne peut convenir ni au soleil ni au monde, ni à l'âme du monde. Cela est visible à l'égard du soleil et du monde ; car ils sont composés de plusieurs portions de matière réellement distinctes les unes des autres ; et il ne serait pas moins absurde de soutenir qu'un vaisseau n'est qu'un seul être, ou qu'un éléphant n'est qu'une seule entité, que de l'affirmer du monde, soit qu'on le considère comme une simple machine, soit qu'on le considère comme un animal. Toute machine, tout animal est essentiellement un composé de diverses pièces. L'ame du monde est aussi composée de parties différentes. Ce qui anime un arbre n'est point la même chose que ce qui anime un chien. Personne n'a mieux décrit que Virgile le dogme de l'âme du monde, laquelle il prenait pour Dieu.
Esse apibus partem divinae mentis et haustus
Aethereos dixere : Deum namque ire per omnes
Terrasque, tractusque maris, coelumque profundum,
Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum,
Quemque sibi tenues nascentem arcessere vitam.
Virg. Georg. lib. IV. Ve 220.
On voit par-là clairement la divinité divisée en autant de parties qu'il y a de bêtes et d'hommes. Cet esprit, cet entendement répandu, selon Virgile, par toute la masse de la matière, peut-il être composé de moins de parties que la matière ? ne faut-il pas qu'il soit dans l'air par des portions de sa substance numériquement distinctes des portions par lesquelles il est dans l'eau réellement ; donc les philosophes qui semblent avoir enseigné l'unité de Dieu ont été plus polythéistes que le peuple. Ils ne savaient ce qu'ils disaient, s'ils croyaient dire que l'unité appartient à Dieu. Elle ne peut lui convenir selon leur dogme, que de la manière qu'elle convient à l'Océan, à une nation, à une ville, à un palais, à une armée. Le dieu qu'ils reconnaissaient être un amas d'une infinité de parties, si elles étaient homogènes, chacune était un dieu, ou aucune ne l'était. Or si aucune ne l'avait été, le tout n'aurait pas pu être dieu. Il fallait donc qu'ils admissent au pied de la lettre une infinité de dieux, ou pour le moins un plus grand nombre qu'il n'y en avait dans le poème d'Hésiode, ni dans aucune autre lithurgie. Si elles étaient hétérogènes, on tombait dans la même conséquence, car il fallait que chacune participât à la nature divine et à l'essence de l'âme du monde. Elle n'y pouvait participer sans être un dieu, puisque l'essence des choses n'est point susceptible du plus ou du moins. On l'a toute entière, ou l'on n'en a rien du tout. Voilà donc autant de dieux que de parties dans l'univers. Que si la nature de Dieu n'avait point été communiquée à quelques-unes des parties, d'où serait venu qu'elle aurait été communiquée à quelques autres ? et quel composé bizarre et monstrueux ne serait-ce pas qu'une âme composée de parties non vivantes et non animées, et de parties vivantes et animées ? Il serait encore plus monstrueux de dire qu'aucune portion de dieu n'était un dieu, et que néanmoins toutes ensemble elles composaient un dieu ; car en ce cas-là, l'être divin eut été le résultat d'un assemblage de plusieurs pièces non divines, il eut été fait de rien, tout comme si l'étendue était composée de points mathématiques.
Qu'on se tourne de quelque côté qu'on voudra ; on ne peut trouver jamais dans les systèmes des anciens philosophes, l'unité de Dieu ; ce sera toujours une unité collective. Affectez de dire sans nommer jamais l'armée, que tels ou tels bataillons ont fait ceci, ou sans jamais articuler ni régiments, ni bataillons, que l'armée a fait cela, vous marquerez également une multitude d'acteurs. S'il n'y a qu'un seul Dieu, selon eux, c'est de la même manière qu'il n'y a qu'un peuple romain, ou que, selon Aristote, il n'y a qu'une matière première. Voyez dans saint Augustin les embarras où la doctrine de Varron se trouve réduite. Il croyait que Dieu n'était autre chose que l'âme du monde. On lui fait voir que c'est une division de Dieu en plusieurs choses, et la réduction de plusieurs choses en un seul Dieu. Lactance aussi a très-bien montré le ridicule du sentiment des Stoïques, qui était à-peu-près le même que celui de Varron. Spinoza est dans le même labyrinthe. Il soutient qu'il n'admet qu'une substance, et il la nomme Dieu. Il semble donc n'admettre qu'un Dieu ; mais dans le fond il en admet une infinité sans le savoir. Jamais on ne comprendra que l'unité de substance, à quoi il réduit l'univers, soit autre chose que l'unité collective, ou que l'unité formelle des Logiciens, qui ne subsiste qu'idéalement dans notre esprit. S'il se trouve donc dans les philosophes payens quelques passages qui semblent autoriser d'une manière plus orthodoxe l'unité de Dieu, ce ne sont la plupart du temps qu'un galimathias pompeux ; faites-en bien l'analyse, il en sortira toujours une multitude de dieux. On n'est parfaitement unitaire qu'autant qu'on reconnait une intelligence parfaitement simple, totalement distinguée de la matière et de la forme du monde, productrice de toutes choses, et véritablement spirituelle. Si l'on affirme cela, l'on croit qu'il n'y a qu'un Dieu ; mais si on ne l'affirme pas, on a beau siffler tous les dieux du paganisme, et témoigner de l'horreur pour la multitude des dieux, on en admettra réellement une infinité. Or c'est là précisément le cas de tous les anciens philosophes que nous avons prouvé ailleurs n'avoir aucune teinture de la véritable spiritualité.
Si M. Bayle s'était contenté de dire qu'en raisonnant conséquemment, on ne se persuaderait jamais que l'unité de Dieu fût compatible avec la nature de Dieu, telle que l'admettaient les anciens philosophes, je me rangerais à son avis. Il me semble que ce qu'ils disaient de l'unité de Dieu, ne coulait point de leur doctrine touchant la nature de cet Etre. Je parle même de la doctrine des premiers pères de l'Eglise, qui mettaient dans Dieu une espèce de matérialisme. Cette doctrine bien pénétrée, et conduite exactement de conséquence en conséquence, était l'éponge de toute religion. Les raisonnements de M. Bayle, que j'ai apportés en objection, en sont une preuve bien évidente. Mais comme les opinions, inconséquemment et très-impertinemment tirées d'une hypothèse, n'entrent pas moins facilement dans les esprits, que si elles émanaient nécessairement d'un bon principe ; il faut convenir que les philosophes payens ont véritablement reconnu l'unité de Dieu, quoiqu'elle ne coulât pas de leur doctrine sur la nature d'un Etre suprême. Il n'y a point eu de philosophes payens qui aient plus insisté sur les dogmes de la Providence que les Stoïques. Ils croyaient pourtant que Dieu était corporel. Ils joignaient donc ensemble la nature corporelle à une intelligence répandue par-tout. Or l'unité proprement dite, n'est pas plus difficîle à concilier avec une telle nature, que la Providence, ou plutôt elles sont toutes deux également incapables de lui être assorties. Combien de philosophes modernes, qui sur les traces de M. Locke, s'imaginent que leur âme est matérielle ! en sont-ils pour cela moins persuadés de sa véritable unité ? L'idée de l'unité de Dieu est si naturelle et si conforme à la droite raison, qu'ils l'ont entée sur leur système, quelque discordant qu'il fût avec cette idée. Ils se sont rapprochés de l'orthodoxie par ces inconséquences, car il est sur que s'ils avaient bien suivi leur pointe, je veux dire qu'ils se fussent attachés régulièrement aux résultats de leur principe, ils auraient parlé de Dieu moins noblement qu'ils n'ont fait. Tous les systèmes des anciens philosophes sur la nature de Dieu, conduisaient à l'irréligion ; et si tous les philosophes ne sont point tombés dans cet abîme, ils en ont été redevables, encore un coup, au défaut d'exactitude dans le raisonnement. Ils sont sortis de leur route, attirés ailleurs par les idées que la nature avait imprimée dans leur esprit, et que l'étude de la morale nourrissait et fortifiait.
Un des plus grands esprits de l'ancienne Rome, s'avisa d'examiner les opinions des philosophes sur la nature divine. Il disputa pour et contre avec beaucoup d'attention. Qu'en arriva-t-il ? c'est qu'au bout du compte, il se trouva athée, ou peu s'en fallut, ou qu'au moins il n'évita ce grand changement que parce qu'il eut plus de déférence pour l'autorité de ses ancêtres que pour ses lumières philosophiques.
Mais une chose qu'on ne peut pardonner aux anciens philosophes qui reconnaissaient un seul Dieu, c'est que satisfaits de ne point tomber dans l'erreur, ils regardaient comme une de leurs obligations d'y entretenir les autres. Le sage, avoue l'orateur philosophe, doit maintenir tout l'extérieur de la religion qu'il trouve établi, et conserver inviolablement les cérémonies brillantes, sacrées, auxquelles les ancêtres ont donné cours. Pour lui qu'il considère la beauté de l'univers, qu'il examine l'arrangement des corps célestes, il verra que sans rien changer aux choses anciennes, il doit adorer en secret l'Etre suprême. En cela consistait toute la religion des Payens, gens d'esprit. Ils reconnaissaient un Dieu qu'ils regardaient comme remplissant le monde de sa grandeur, de son immensité. Ils retenaient avec cela les principaux usages du pays où ils vivaient, craignaient surtout d'en troubler la paix par un zèle furieux, ou par trop d'attachement à leurs opinions particulières. C'est sur quoi appuie Séneque d'une manière très-sensée. Quand nous plions, dit-il, devant cette foule de divinités qu'une vieille superstition a entassée les unes sur les autres, nous donnons ces hommages à la coutume, et non pas à la religion. Nous voulons par-là contenir le peuple, et non point nous avilir honteusement.
Suivant quelques philosophes, tout le polythéisme poétique, tout ce qu'il y a eu de divinités parmi les Grecs, tout ce qui entre dans le détail de leurs généalogies, de leurs familles, de leurs domaines, de leurs amours, de leurs aventures, n'est autre chose que la physique mise sur un certain ton et agréablement tournée. Ainsi Jupiter n'est plus que la matière éthérée, et Junon la masse liquide de notre athmosphère. Apollon est le soleil, et Diane est la lune. Pour abreger, tous les dieux ne sont que les éléments et les corps physiques ; la nature se trouve partagée entre eux, ou plutôt ils ne sont tous que les différentes parties de divers effets de la nature.
Il faut convenir que cette première institution des dieux, est un fait d'histoire assez constant, du-moins pris en général. On sait que dans l'origine du paganisme, la physique qui n'avait pas encore formé de science, laissait les écrivains dans une si grande sécheresse sur le fond des choses, que pour la corriger, ils empruntèrent le secours des allusions et des fables, genre d'écrire que favorisait le penchant, et en quelque sorte l'enfance des lecteurs, comme il parait dans Cicéron. Mais ce fait même, la défense du paganisme dans le temps que le Christianisme s'élevait sur ses ruines et ses débris, était la plus forte démonstration contre lui. 1°. Si les dieux n'étaient que des portions de l'univers, il demeurait évident que l'univers prenait la place de son auteur, et que l'homme aveugle décernait à la créature, l'adoration qui n'est dû. qu'au Créateur. 2°. Quand même les dieux n'auraient été dans l'origine que les éléments personnifiés, cette théologie symbolique ne devenait-elle pas une occasion de scandale et d'erreur impie ? Quelle que fût l'origine physique du mot Jupiter, n'était-il pas dans la signification d'usage, le nom propre d'un Dieu, père des autres dieux ? Lorsque le peuple lisait dans ses poètes que Jupiter frappait Junon son épouse et sa sœur, concevait-il qu'il ne s'agissait là que du choc des éléments ? Recourait-il aux allusions pour l'intelligence des autres fables, où il voyait un sens clair, qui dès le premier aspect, fixait sa croyance ? Où était le poète qui eut appris à distinguer ces images allégoriques d'avec la simplicité de la lettre ? Où étaient même les poètes qui n'eussent pas représenté le même Dieu sous des emblèmes tous différents, et quelquefois opposés ? Il était donc impossible que le vulgaire ignorant saisit au milieu de ces variations un point fixé d'allégorie qui le déterminât, et dès lors il ne lui restait qu'un système scandaleux où la raison trompée n'offrait à la morale que des exemples trompeurs.
Quelque parti que prit l'Idolatrie, soit qu'elle regardât ses dieux comme des éléments qu'elle avait personnifiés, soit qu'elle les regardât comme des hommes qu'elle avait déifiés après leur mort, pour les bienfaits dont ils avaient comblé les humains, toujours est-il vrai de dire que son fonds était une ignorance brutale, et une entière dépravation du sens humain. Ajoutez à cela que les Poètes épuisèrent en sa faveur tout ce qu'ils avaient d'esprit, de délicatesse et de grâces, et qu'ils s'étudièrent à employer les couleurs les plus vives pour fonder des vices et des crimes qui seraient tombés dans le décri, sans la parure qu'ils leur prêtaient, pour en couvrir la difformité, l'absurdité et l'infamie.
On sait que le plus sage des philosophes condamnait sans réserve ces fictions profanes, si manifestement injurieuses à la divinité. " Nous ne devons, disait-il, admettre dans notre république, ni les chaînes de Junon formées par son propre fils ; ni la chute de Vulcain, précipité du haut des cieux pour avoir pris la défense de sa mère contre Jupiter qui levait la main sur elle ; ni les autres combats des dieux, soit que ces idées servent de voiles à d'autres, soit que le poète les donne pour ce qu'il semble qu'elles sont. La jeunesse qui ne peut démêler ces vues différentes, se remplit par-là d'opinions insensées qui ne s'effacent qu'avec peine de son esprit. Il faut au contraire lui montrer toujours Dieu comme juste et véritable dans ses œuvres, autant que dans ses paroles. Et en effet, il est constant dans ses promesses, il ne séduit ni par de vaines images, ni par de faux discours, ni par des signes trompeurs, ni durant le jour, ni durant la nuit ".
La raison même au milieu des plus épaisses ténèbres, ne pouvait se dérober à ces rayons de vérité, tant il est impossible à l'homme d'anéantir l'idée de l'Etre unique, saint et parfait qui l'a tiré du néant.
Mais si ces fables dont on repaissait le peuple étaient, de l'aveu même de Platon, si injurieuses à la divinité, et en même temps si funestes à la pureté des mœurs, pourquoi ne travaillait-il pas à le détromper, en lui inspirant une idée saine de la divinité ? Pourquoi, de concert avec les autres philosophes, fomentait-il encore son erreur ? Le voici, c'est qu'il s'imaginait que le polythéisme était si fort enraciné, qu'il était impossible de le détruire sans mettre toute la société en combustion. " Il est très-difficile, dit-il, de connaître le père, le souverain arbitre de cet univers ; mais si vous avez le bonheur de le connaître, gardez-vous bien d'en parler au peuple ". Les Philosophes, aussi bien que les Législateurs, étaient dans ce principe, que la vérité était peu propre à être communiquée aux hommes. On croyait sans aucune répugnance qu'il fallait les tromper, ou du moins leur exposer les choses adroitement voilées. De-là vient, dit Strabon, que l'usage des fables s'est si fort étendu, qu'on a feint et imaginé, par une espèce de devoir politique, le tonnerre de Jupiter, l'égide de Pallas, le trident de Neptune, les flambeaux et les serpens des Furies vengeresses ; et ce sont toutes ces traditions ajoutées les unes aux autres, qui ont formé l'ancienne théologie, dans la vue d'intimider ceux qui se conduisent par la crainte plutôt que par la raison, trop faible, hélas ! sur l'esprit des hommes corrompus. Séneque dit que le Jupiter du peuple est celui qui est armé de la foudre, et dont la statue se voit au milieu du Capitole ; mais que le véritable Jupiter, celui des Philosophes, est un Etre invisible, l'âme et l'esprit universel, le maître et le conservateur de toutes choses, la cause des causes, dont la nature emprunte sa force, et pour ainsi dire sa vie. Varron le plus savant des Romains, dans un fragment de son traité sur les religions, cité par S. Augustin, dit qu'il y a de certaines vérités qu'il n'est pas à-propos de faire connaître trop généralement pour le bien de l'état ; et d'autres choses qu'il est utîle de faire accroire au peuple quoiqu'elles soient fausses, et que c'est par cette raison que les Grecs cachent leurs mystères en général. Quelque système qu'on embrasse, il faut que le peuple soit séduit ; et il veut lui-même être séduit. Orphée en parlant de Dieu disait, je ne le vois point, car il y a un nuage autour de lui qui me le dérobe.
Une autre raison qui portait les législateurs à ne point déprévenir l'esprit des peuples des erreurs dont ils étaient imbus, c'est qu'ils avaient eux-mêmes contribué à l'établissement ou à la propagation du polythéisme, en protestant des inspirations, et se servant des opinions religieuses quoique fausses, et dont les peuples étaient prévenus, pour leur inspirer une plus grande vénération pour les lois. Le polythéisme fut entièrement corrompu par les Poètes, qui inventèrent ou publièrent des histoires scandaleuses des dieux et des héros ; histoires dont la prudence des législateurs aurait voulu dérober la connaissance au peuple, ce qui plus que toute autre chose, contribuait à rendre le polythéisme dangereux pour l'état, comme il est aisé de s'en convaincre par le passage de Platon que j'ai cité ci-dessus. Trouvant donc les peuples livrés à une religion qui était faite pour le plaisir, à une religion dont les divertissements, les fêtes, les spectacles, et enfin la licence même faisait une partie du culte, les trouvant, disje, enchantés par une telle religion, ils se virent forcés de se prêter à des préjugés trop tenans et trop invétérés. Ils crurent qu'il n'était pas dans leur pouvoir de la détruire, pour y en substituer une meilleure. Tout ce qu'ils purent faire, ce fut d'établir avec plus de fermeté le corps de la religion ; et c'est à cet usage qu'ils employèrent un grand nombre de pompeuses cérémonies. Dans la suite des temps, le génie de la religion suivit celui du gouvernement civil ; et ainsi elle s'épura d'elle-même comme à Rome, ou elle se corrompit de plus en plus comme dans la Syrie. Si les législateurs eussent institué une religion nouvelle, ainsi qu'ils instituèrent de nouvelles lois, on aurait trouvé dans quelques-unes de ces religions des institutions moins éloignées de la pureté de la religion naturelle. L'imperfection de ces religions est une preuve qu'ils les trouvèrent déjà établies, et qu'ils n'en furent pas les inventeurs.
On peut dire que ni les Philosophes, ni les Législateurs n'ont reconnu cette vérité essentielle, que le vrai et l'utîle sont inséparables. Par-là les uns et les autres ont très-souvent manqué leur but. Les premiers négligeant l'utilité, sont tombés dans les opinions les plus absurdes sur la nature de Dieu, et sur celle de l'âme ; et les derniers n'étant pas assez scrupuleux sur la vérité, ont beaucoup contribué à la propagation du Polythéisme, qui tend naturellement à la destruction de la société. Ce fut même la nécessité de remédier à ce mal qui leur fit établir les mystères sacrés avec tant de succès ; et on peut dire qu'ils étaient fort propres à produire cet effet. Dans le Paganisme l'exemple des dieux vicieux et corrompus avait une forte influence sur les mœurs : Ils ont fait cela, disait-on, et moi chétif mortel je ne le ferais pas ? Ego homuncio hoc non facerem ? Térence, Eunuq. acte III. scène Ve Euripide met le même argument dans la bouche de plusieurs de ses personnages en différents endroits de ses tragédies.
Voilà ce que l'on alléguait pour sa justification, lorsqu'on voulait s'abandonner à ses passions déréglées, et ouvrir un champ libre à ses vastes désirs. Or dans les mystères on affoiblissait ce puissant aiguillon, et c'est ce que l'on faisait en coupant la racine du mal. On découvrait à ceux des initiés qu'on en jugeait capables, l'erreur où était le commun des hommes : on leur apprenait que Jupiter, Mercure, Vénus, Mars, et toutes les divinités licencieuses, n'étaient que des hommes comme les autres, qui durant leur vie avaient été sujets aux mêmes passions et aux mêmes vices que le reste des mortels ; qu'ayant été à divers égards les bienfaiteurs du genre humain, la postérité les avait déifiés par reconnaissance, et avait indiscrétement canonisé leurs vices avec leurs vertus. Au reste on ne doit pas croire que la doctrine enseignée dans les mystères, d'une cause suprême, auteur de toutes choses, détruisit les divinités tutélaires, ou pour mieux dire les patrons locaux. Ils étaient simplement considérés comme des êtres du second ordre, inférieurs à Dieu ; mais supérieurs à l'homme, et placés par le premier être pour présider aux différentes parties de l'univers. Ce que la doctrine des grands mystères détruisait, c'était le polythéisme vulgaire, ou l'adoration des hommes déifiés après leur mort.
L'unité de Dieu était donc établie dans les grands mystères sur les ruines du polythéisme ; car dans les petits on ne démasquait pas encore les erreurs du polythéisme : seulement on y inculquait fortement le dogme de la Providence, et ceci n'est pas une simple conjecture. Les mystagogues d'Egypte enseignaient dans leurs cérémonies secrètes le dogme de l'unité de Dieu, comme M. Ladworth savant anglais, l'a évidemment prouvé. Or les Grecs et les Asiatiques empruntèrent leurs mystères des Egyptiens, d'où l'on peut conclure très-probablement qu'ils enseignaient le même dogme. Pythagore reconnaissait que c'était dans les mystères d'Orphée qui se célébraient en Thrace, qu'il avait appris l'unité de la cause première universelle. Cicéron garde aussi peu de mesure. " Si j'entreprenais d'approfondir l'antiquité, et d'examiner les relations des historiens grecs, on trouverait que les dieux de la première classe ont habité la terre avant que d'habiter les cieux. Informez-vous seulement de qui sont ces sépulchres que l'on montre dans la Grèce ; ressouvenez-vous, car vous êtes initié, de ce que l'on enseigne dans les mystères ? Vous concevrez alors toute l'étendue que l'on pourrait donner à cette discussion ". On pourrait, s'il était nécessaire, citer une nuée de témoins pour confirmer de plus en plus cette vérité.
S'il restait encore quelques nuages, ils seraient bientôt dissipés par ce qui est dit de l'unité de Dieu dans l'hymne chantée par l'hiérophante, qui paraissait sous la figure du créateur. Après avoir ouvert les mystères, et chanté la théologie des idoles, il renversait alors lui-même tout ce qu'il avait dit, et introduisait la vérité en débutant ainsi. " Je vais déclarer un secret aux initiés, que l'on ferme l'entrée de ces lieux aux profanes. O toi, Musée, descendu de la brillante Sélene, sois attentif à mes accens : je t'annoncerai des vérités importantes. Ne souffre pas que des préjugés ni des affections antérieures, t'enlèvent le bonheur que tu souhaites de puiser dans la connaissance des vérités mystérieuses. Considère la nature divine, contemple-la sans cesse, règle ton esprit et ton cœur, et marchant dans une voie sure, admire le maître unique de l'univers. Il en est un, il existe par lui-même. C'est à lui seul que tous les autres êtres doivent leur existence. Il opère en tout et par-tout ; invisible aux yeux des mortels, il voit lui-même toutes choses ".
Avant de finir cet article, il est à-propos de prévenir une objection que fait M. Bayle au sujet du polythéisme, qu'il prétend pour le moins être aussi pernicieux à la société que l'athéisme. Il se fonde sur ce que cette religion si peu liée dans toutes ses parties, n'exigeait point les bonnes mœurs. Et de quel front, disait-il, les aurait-elle exigées ? Tout était plein des crimes, des iniquittés diverses qu'on reprochait à l'assemblée des dieux. Leur exemple accoutumait au mal, leur culte même applanissait le chemin qui y conduit. Qu'on remonte à la source du paganisme, ou verra qu'il ne promettait aux hommes que des biens physiques, comme des cérémonies d'éclat, des sacrifices, des décorations propres à faire respecter les temples et les autels, des jeux, des spectacles pour les passions si difficiles à corriger, ou plutôt à retenir dans de justes bornes (car les passions ne se corrigent jamais entierement). Il leur laissait une libre étendue, sans les contraindre en aucune manière, sans aller jamais jusqu'au cœur. En un mot, la religion payenne était une espèce de banque, où en échange des offrandes temporelles, les dieux rendaient des plaisirs, des satisfactions voluptueuses.
Pour répondre à cette objection, il faut remarquer que dans le paganisme il y avait deux sortes de religion, la religion des particuliers, et la religion de la société. La religion des particuliers était inférieure à celle de l'état, et en était différente. A chacune de ces religions présidait une Providence particulière. Celle de la religion des particuliers ne punissait pas toujours le vice, ni ne récompensait pas toujours la vertu en ce bas monde, idée qui entrainait nécessairement après elle celle du dogme des peines et des récompenses d'une autre vie. La Providence, sous la direction de laquelle était la société, était au contraire égale ou uniforme dans sa conduite, dispensant les biens et les maux temporels, selon la manière dont la société se comportait envers les dieux. De-la vient que la religion faisait partie du gouvernement civil. On ne délibérait sur rien, ni l'on n'exécutait rien sans consulter l'oracle. Les prodiges, les présages étaient aussi communs que les édits des magistrats ; car on les regardait comme dispensés par la Providence pour le bien public ; c'étaient ou des déclarations de la faveur des dieux, ou des dénonciations des châtiments qu'ils étaient sur le point d'infliger. Tout cela ne regardait point les particuliers considérés comme tels. S'il s'agissait d'accepter un augure, ou d'en détourner le présage, de rendre grâce aux dieux, ou d'apaiser leur colere, la méthode que l'on suivait constamment, était ou de rétablir quelque ancienne cérémonie, ou d'en instituer de nouvelles ; mais la réformation des mœurs ne faisait jamais partie de la propitiation de l'état. La singularité et l'évidence de ce fait ont frappé si fortement M. Bayle, que s'imaginant que cette partie publique de la religion des payens en faisait le tout, il en a conclu avec un peu trop de précipitation, que la religion payenne n'instruisait point à la vertu, mais seulement au culte externe des dieux ; et de-là il a tiré un argument pour soutenir son paradoxe favori en faveur de l'athéisme. La vaste et profonde connaissance qu'il avait de l'antiquité ne l'a point, en cette occasion, garanti de l'erreur ; et l'on doit avouer qu'il y a été en partie entrainé par plusieurs passages des pères de l'Eglise dans leurs déclamations contre les vices du paganisme. Quoiqu'il soit évident que cette partie publique de la religion payenne n'eut aucun rapport à la pratique de la vertu, et à la pureté des mœurs ; on ne saurait prétendre la même chose de l'autre partie de la religion, dont chaque individu était le sujet. Le dogme des peines et des récompenses d'une autre vie en était le fondement ; dogme inséparable du mérite des œuvres qui consiste dans le vice et la vertu. Je ne nierai cependant pas que la nature de la partie publique de la religion n'ait souvent donné lieu à des erreurs dans la pratique de la religion privée, concernant l'efficacité des actes extérieurs en des cas particuliers. Mais les mystères sacrés auxquels bien des personnes se faisaient initier, corrigeaient les maux que le polythéisme n'avait pas la force de réprimer.
POLYTHÉISME
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Science
- Catégorie : Métaphysique
- Affichages : 3057