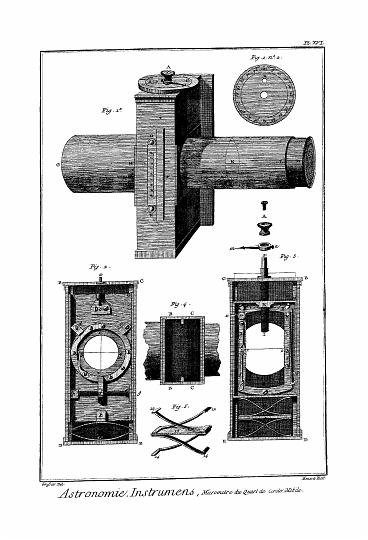S. m. pl. (Métaphysique) On appelle athées, ceux qui nient l'existence d'un Dieu auteur du monde. On peut les diviser en trois classes : les uns nient qu'il y ait un Dieu : les autres affectent de passer pour incrédules ou sceptiques sur cet article : les autres enfin, peu différents des premiers, nient les principaux attributs de la nature divine, et supposent que Dieu est un être sans intelligence, qui agit purement par nécessité ; c'est-à-dire un être qui, à parler proprement, n'agit point du tout, mais qui est toujours passif. L'erreur des athées vient nécessairement de quelqu'une de ces trois sources.
Elle vient 1°. de l'ignorance et de la stupidité. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais rien examiné avec attention, qui n'ont jamais fait un bon usage de leurs lumières naturelles, non pas même pour acquérir la connaissance des vérités les plus claires et les plus faciles à trouver : elles passent leur vie dans une oisiveté d'esprit qui les abaisse et les avilit à la condition des bêtes. Quelques personnes croient qu'il y a eu des peuples assez grossiers et assez sauvages, pour n'avoir aucune teinture de religion. Strabon rapporte qu'il y avait des nations en Espagne et en Afrique qui vivaient sans dieux, et chez lesquels on ne découvrait aucune trace de religion. Si cela était, il en faudrait conclure qu'ils avaient toujours été athées ; car il ne parait nullement possible qu'un peuple entier passe de la religion à l'athéisme. La religion est une chose qui étant une fois établie dans un pays, y doit durer éternellement : on s'y attache par des motifs d'intérêt, par l'espérance d'une félicité temporelle, ou d'une félicité éternelle. On attend des dieux la fertilité de la terre, le bon succès des entreprises : on craint qu'ils n'envoyent la stérilité, la peste, les tempêtes, et plusieurs autres calamités ; et par conséquent on observe les cultes publics de religion, tant par crainte que par espérance. L'on est fort soigneux de commencer par cet endroit-là l'éducation des enfants ; on leur recommande la religion comme une chose de la dernière importance, et comme la source du bonheur et du malheur, selon qu'on sera diligent ou négligent à rendre aux dieux les honneurs qui leur appartiennent : de tels sentiments qu'on suce avec le lait, ne s'effacent point de l'esprit d'une nation ; ils peuvent se modifier en plusieurs manières ; je veux dire que l'on peut changer de cérémonies ou de dogmes, soit par vénération pour un nouveau docteur, soit par les menaces d'un conquérant : mais ils ne sauraient disparaitre tout à fait ; d'ailleurs les personnes qui veulent contraindre les peuples en matière de religion, ne le font jamais pour les porter à l'athéisme : tout se réduit à substituer aux formulaires de culte et de créance qui leur déplaisent, d'autres formulaires. L'observation que nous venons de faire a paru si vraie à quelques auteurs, qu'ils n'ont pas hésité de regarder l'idée d'un Dieu comme une idée innée et naturelle à l'homme : et de-là ils concluent qu'il n'y a eu jamais aucune nation, quelque féroce et quelque sauvage qu'on la suppose, qui n'ait reconnu un Dieu. Ainsi, selon eux, Strabon ne mérite aucune créance ; et les relations de quelques voyageurs modernes, qui rapportent qu'il y a dans le nouveau monde des nations qui n'ont aucune teinture de religion, doivent être tenues pour suspectes, et même pour fausses. En effet, les voyageurs touchent en passant une côte, ils y trouvent des peuples inconnus : s'ils leur voient faire quelques cérémonies, ils leur donnent une interprétation arbitraire ; et si au contraire ils ne voient aucune cérémonie, ils concluent qu'ils n'ont point de religion. Mais comment peut-on savoir les sentiments de gens dont on ne voit pas la pratique, et dont on n'entend point la langue ? Si l'on en croit les voyageurs, les peuples de la Floride ne reconnaissaient point de Dieu, et vivaient sans religion ; cependant un auteur anglais qui a vécu dix ans parmi eux, assure qu'il n'y a que la religion révélée qui ait effacé la beauté de leurs principes ; que les Socrates et les Platons rougiraient de se voir surpasser par des peuples d'ailleurs si ignorants. Il est vrai qu'ils n'ont ni idoles, ni temples, ni aucun culte extérieur ; mais ils sont vivement persuadés d'une vie à venir, d'un bonheur futur pour récompenser la vertu, et de souffrances éternelles pour punir le crime. Que savons-nous, ajoute-t-il, si les Hottentots et tels autres peuples qu'on nous représente comme athées, sont tels qu'ils nous paraissent ? S'il n'est pas certain que ces derniers reconnaissent un Dieu, du moins est-il sur par leur conduite qu'ils reconnaissent une équité, et qu'ils en sont pénétrés. La description du cap de Bonne-Espérance par M Kolbe, prouve bien que les Hottentots les plus barbares n'agissent pas sans raison, et qu'ils savent le droit des gens et de la nature. Ainsi pour juger s'il y a eu des nations sauvages, sans aucune teinture de divinité et de religion, attendons à en être mieux informés que par les relations de quelques voyageurs.
La seconde source d'athéisme, c'est la débauche et la corruption des mœurs. On trouve des gens qui, à force de vices et de dérèglements, ont presqu'éteint leurs lumières naturelles et corrompu leur raison : au lieu de s'appliquer à la recherche de la vérité d'une manière impartiale, et de s'informer avec soin des règles ou des devoirs que la nature prescrit, ils s'accoutument à enfanter des objections contre la religion, à leur prêter plus de force qu'elles n'en ont, et à les soutenir opiniatrément. Ils ne sont pas persuadés qu'il n'y a point de Dieu, mais ils vivent comme s'ils l'étaient, et tâchent d'effacer de leur esprit toutes les notions qui tendent à leur prouver une divinité. L'existence d'un Dieu les incommode dans la jouissance de leurs plaisirs criminels ; c'est pourquoi ils voudraient croire qu'il n'y a point de Dieu, et ils s'efforcent d'y parvenir. En effet il peut arriver quelquefois qu'ils réussissent à s'étourdir et à endormir leur conscience ; mais elle se réveille de temps en temps, et ils ne peuvent arracher entièrement le trait qui les déchire.
Il y a divers degrés d'athéisme pratique, et il faut être extrêmement circonspect sur ce sujet. Tout homme qui commet des crimes contraires à l'idée d'un Dieu, et qui persévère même quelque temps, ne saurait être déclaré aussi-tôt athée de pratique. David, par exemple, en joignant le meurtre à l'adultère, sembla oublier Dieu ; mais on ne saurait pour cela le ranger au nombre des athées de pratique, ce caractère ne convient qu'à ceux qui vivent dans l'habitude du crime, et dont toute la conduite ne parait tendre qu'à nier l'existence de Dieu.
L'athéisme du cœur a conduit le plus souvent à celui de l'esprit. A force de désirer qu'une chose soit vraie, on vient enfin à se persuader qu'elle est telle ; l'esprit devient la dupe du cœur, les vérités les plus évidentes ont toujours un côté obscur et ténébreux par où l'on peut les attaquer. Il suffit qu'une vérité nous incommode et qu'elle contrarie nos passions ; l'esprit agissant alors de concert avec le cœur, découvrira bientôt des endroits faibles auxquels il s'attache : on s'accoutume insensiblement à regarder comme faux ce qui avant la dépravation du cœur brillait à l'esprit de la plus vive lumière : il ne faut pas moins que la violence des passions pour étouffer une notion aussi évidente que celle de la divinité. Le monde, la cour et les armées fourmillent de ces sortes d'athées. Quand ils auraient renversé Dieu de dessus son trône, ils ne se donneraient pas plus de licence et de hardiesse. Les uns ne cherchant qu'à se distinguer par les excès de leurs débauches, y mettent le comble en se moquant de la religion ; ils veulent faire parler d'eux, et leur vanité ne serait pas satisfaite s'ils ne jouissaient hautement et sans bornes de la réputation d'impies : cette réputation dangereuse est le but de leurs souhaits, et ils feraient mécontens de leurs expressions, si elles n'étaient extraordinairement odieuses. Les railleries, les profanations et les blasphèmes de cette sorte d'impies, ne sont point une marque qu'en effet ils croient qu'il n'y a point de divinité ; ils ne parlent de la sorte que pour faire dire qu'ils enchérissent sur les débauches ordinaires : leur athéisme n'est rien moins que raisonné, il n'est pas même la cause de leurs débauches, il en est plutôt le fruit et l'effet, et pour ainsi dire le plus haut degré. Les autres, tels que les grands, qui sont le plus soupçonnés d'athéisme, trop paresseux pour décider en leur esprit que Dieu n'est pas, se reposent mollement dans le sein des délices. " Leur indolence, dit la Bruyere, Ve jusqu'à les rendre froids et indifférents sur cet article si capital, comme sur la nature de leur âme et sur les conséquences d'une vraie religion ; ils ne nient ces choses ni ne les accordent, ils n'y pensent point ". Cette espèce d'athéisme est la plus commune, et elle est aussi connue parmi les Turcs que parmi les Chrétiens. M. Ricaut, secrétaire de M. le comte de Winchelsey, ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, rapporte que les athées ont formé une secte nombreuse en Turquie, qui est composée pour la plupart de cadis et de personnes savantes dans les livres arabes, et de Chrétiens renégats, qui pour éviter les remords qu'ils sentent de leur apostasie, s'efforcent de se persuader qu'il n'y a rien à craindre ni à espérer après la mort. Il ajoute que cette doctrine contagieuse s'est insinuée jusque dans le sérail, et qu'elle a infecté l'appartement des femmes et des eunuques ; qu'elle s'est aussi introduite chez les bachas ; et qu'après les avoir empoisonnés, elle a répandu son venin sur toute la cour ; que le sultan Amurat favorisait fort cette opinion dans sa cour et dans son armée.
Il y a enfin des athées de spéculation et de raisonne ment, qui se fondant sur des principes de Philosophie, soutiennent que les arguments contre l'existence et les attributs de Dieu, leur paraissent plus forts et plus concluans que ceux qu'on emploie pour établir ces grandes vérités. Ces sortes d'athées s'appellent des athées théoriques. Parmi les anciens on compte Protagoras, Démocrite, Diagoras, Théodore, Nicanor, Hippon, Evhemère, Epicure et ses sectateurs, Lucrèce, Pline le jeune, etc. et parmi les modernes, Averroès, Calderinus, Politien, Pomponace, Pierre Bembus, Cardan, Caesalpin, Taurellus, Crémonin, Bérigord, Viviani, Thomas Hobbe, Benait Spinosa, etc. Je ne pense pas qu'on doive leur associer ces hommes qui n'ont ni principes ni système, qui n'ont point examiné la question, et qui ne savent qu'imparfaitement le peu de difficulté qu'ils débitent. Ils se font une sotte gloire de passer pour esprits forts ; ils en affectent le style pour se distinguer de la foule, tout prêts à prendre le parti de la religion, si tout le monde se déclarait impie et libertin : la singularité leur plait.
Ici se présente naturellement la célèbre question, savoir si les lettrés de la Chine sont véritablement athées. Les sentiments sur cela sont fort partagés. Le P. le Comte, Jésuite, a avancé que le peuple de la Chine a conservé près de 2000 ans la connaissance du véritable Dieu ; qu'ils n'ont été accusés publiquement d'athéisme par les autres peuples, que parce qu'ils n'avaient ni temples ni sacrifices ; qu'ils étaient les moins crédules et les moins superstitieux de tous les habitants de l'Asie. Le P. le Gobien, aussi Jésuite, avoue que la Chine n'est devenue idolatre que cinq ou six ans avant la naissance de J. C. D'autres prétendent que l'athéisme a regné dans la Chine jusqu'à Confucius, et que ce grand Philosophe même en fut infecté. Quoi qu'il en soit de ces temps si reculés, sur lesquels nous n'osons rien décider, le zèle de l'apostolat d'un côté, et de l'autre l'avidité insatiable des négociants européens, nous ont procuré la connaissance de la religion de ce peuple subtil, savant et ingénieux. Il y a trois principales sectes dans l'empire de la Chine. La première fondée par Li-laokium, adore un Dieu souverain, mais corporel, et ayant sous sa dépendance beaucoup de divinités subalternes, sur lesquelles il exerce un empire absolu. La seconde, infectée de pratiques folles et absurdes, met toute sa confiance en une idole nommée Fo ou Foè. Ce Fo ou Foè mourut à l'âge de 79 ans ; et pour mettre le comble à son impiété, après avoir établi l'idolatrie durant sa vie, il tâcha d'inspirer l'athéisme à sa mort. Pour lors il déclara à ses disciples qu'il n'avait parlé dans tous ses discours que par énigme, et que l'on s'abusait si l'on cherchait hors du néant le premier principe des choses. C'est de ce néant, dit-il, que tout est sorti, et c'est dans le néant que tout doit retomber : voilà l'abîme où aboutissent nos espérances. Cela donna naissance parmi les Bonzes à une secte particulière d'athées, fondée sur ces dernières paroles de leur maître. Les autres, qui eurent de la peine à se défaire de leurs préjugés, s'en tinrent aux premières erreurs. D'autres enfin tâchèrent de les accorder ensemble, en faisant un corps de doctrine où ils enseignèrent une double loi, qu'ils nommèrent la loi extérieure et la loi intérieure. La troisième enfin plus répandue que les deux autres, et même la seule autorisée par les lois de l'état, tient lieu de politique, de religion, et surtout de philosophie. Cette dernière secte que professent tous les nobles et tous les savants, ne reconnait d'autre divinité que la matière, ou plutôt la nature ; et sous ce nom, source de beaucoup d'erreurs et d'équivoques, elle entend je ne sai quelle âme invisible du monde, je ne sai quelle force ou vertu surnaturelle qui produit, qui arrange, qui conserve les parties de l'univers. C'est, disent-ils, un principe très-pur, très-parfait, qui n'a ni commencement ni fin ; c'est la source de toutes choses, l'essence de chaque être, et ce qui en fait la véritable différence. Ils se servent de ces magnifiques expressions, pour ne pas abandonner en apparence l'ancienne doctrine ; mais au fond ils s'en font une nouvelle. Quand on l'examine de près, ce n'est plus ce souverain maître du ciel, juste, toutpuissant, le premier des esprits, et l'arbitre de toutes les créatures : on ne voit chez eux qu'un athéisme raffiné, et un éloignement de tout culte religieux. Ce qui le prouve, c'est que cette nature à laquelle ils donnent des attributs si magnifiques, qu'il semble qu'ils l'affranchissent des imperfections de la matière, en la séparant de tout ce qui est sensible et corporel ; est néanmoins aveugle dans ses actions les plus réglées, qui n'ont d'autre fin que celle que nous leur donnons, et qui par conséquent ne sont utiles qu'autant que nous savons en faire un bon usage. Quand on leur objecte que le bel ordre qui règne dans l'univers n'a pu être l'effet du hasard, que tout ce qui existe doit avoir été créé par une première cause, qui est Dieu : donc, répliquent-ils d'abord, Dieu est l'auteur du mal moral et du mal physique. On a beau leur dire que Dieu étant infiniment bon, ne peut être l'auteur du mal : donc, ajoutent-ils, Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qui existe. Et puis, continuent-ils d'un air triomphant, doit-on croire qu'un être plein de bonté ait créé le monde, et que le pouvant remplir de toutes sortes de perfections, il ait précisément fait le contraire ? Quoiqu'ils regardent toutes choses comme l'effet de la nécessité, ils enseignent cependant que le monde a eu un commencement, et qu'il aura une fin. Pour ce qui est de l'homme, ils conviennent tous qu'il a été formé par le concours de la matière terrestre et de la matière subtile, à-peu-près comme les plantes naissent dans les îles nouvellement formées, où le laboureur n'a point semé, et où la terre seule est devenue féconde par sa nature. Au reste notre âme, disent-ils, qui en est la portion la plus épurée, finit avec le corps, quand ses parties sont dérangées, et renait aussi avec lui, quand le hasard remet ces mêmes parties dans leur premier état.
Ceux qui voudraient absolument purger d'athéisme les Chinois, disent qu'il ne faut pas faire un trop grand fond sur le témoignage des missionnaires ; et que la seule difficulté d'apprendre leur langue et de lire leurs livres, est une grande raison de suspendre son jugement. D'ailleurs en accusant les Jésuites, sans doute à tort, de souffrir les superstitions des Chinois. on a sans y penser détruit l'accusation de leur athéisme, puisque l'on ne rend pas un culte à un être qu'on ne regarde pas comme Dieu. On dit qu'ils ne reconnaissent que le ciel matériel pour l'être suprême : mais ils pourraient reconnaître le ciel matériel (si tant est qu'ils aient un mot dans leur langue qui réponde au mot de matériel), et croire néanmoins qu'il y a quelqu'intelligence qui l'habite, puisqu'ils lui demandent de la pluie et du beau temps, la fertilité de la terre, etc. Il se peut faire aisément qu'ils confondent l'intelligence avec la matière, et qu'ils n'aient que des idées confuses de ces deux êtres, sans nier qu'il y ait une intelligence qui préside dans le ciel. Epicure et ses disciples ont cru que tout était corporel, puisqu'ils ont dit qu'il n'y avait rien qui ne fût composé d'atomes ; et néanmoins ils ne niaient pas que les âmes des hommes ne fussent des êtres intelligens. On sait aussi qu'avant Descartes on ne distinguait pas trop bien dans les écoles l'esprit et le corps ; et l'on ne peut pas dire néanmoins que dans les écoles on niât que l'âme humaine fût une nature intelligente. Qui sait si les Chinois n'ont pas quelqu'opinion semblable du ciel ? ainsi leur athéisme n'est rien moins que décidé.
Vous demanderez peut-être comment plusieurs philosophes anciens et modernes ont pu tomber dans l'athéisme : le voici. Pour commencer par les philosophes payens, ce qui les jeta dans cette énorme erreur, ce furent apparemment les fausses idées de la divinité qui régnaient alors ; idées qu'ils surent détruire, sans savoir édifier sur leur ruine celle du vrai Dieu. Et quant aux modernes, ils ont été trompés par des sophismes captieux, qu'ils avaient l'esprit d'imaginer sans avoir assez de sagacité ou de justesse pour en découvrir le faible. Il ne saurait assurément y avoir d'athée convaincu de son système, car il faudrait qu'il eut pour cela une démonstration de la non-existence de Dieu, ce qui est impossible ; mais la conviction et la persuasion sont deux choses différentes. Il n'y a que la dernière qui convienne à l'athée. Il se persuade ce qui n'est point : mais rien n'empêché qu'il ne le croye aussi fermement en vertu de ses sophismes, que le théiste croit l'existence de Dieu en vertu des démonstrations qu'il en a. Il ne faut pour cela que convertir en objections les preuves de l'existence de Dieu, et les objections en preuves. Il n'est pas indifférent de commencer par un bout plutôt que par l'autre, la discussion de ce qu'on regarde comme un problème : car si vous commencez par l'affirmative, vous la rendrez plus facilement victorieuse ; au lieu que si vous commencez par la négative, vous rendrez toujours douteux le succès de l'affirmative. Les mêmes raisonnements font plus ou moins d'impression selon qu'ils sont proposés ou comme des preuves, ou comme des objections. Si donc un philosophe débutait d'abord par la thèse, il n'y a point de Dieu, et qu'il rangeât en forme de preuves ce que les orthodoxes ne font venir sur les rangs que comme de simples difficultés, il s'exposerait à l'égarement ; il se trouverait satisfait de ses preuves, et n'en voudrait point démordre, quoiqu'il ne sut comment se débarrasser des objections ; car, dirait-il, si j'affirmais le contraire, je me verrais obligé de me sauver dans l'asîle de l'incompréhensibilité. Il choisit donc malheureusement les incompréhensibilités, qui ne devaient venir qu'après.
Jettez les yeux sur les principales controverses des Catholiques et des Protestants, vous verrez que ce qui passe dans l'esprit des uns pour une preuve démonstrative de fausseté, ne passe dans l'esprit des autres que pour un sophisme, ou tout au plus pour une objection spécieuse, qui fait voir qu'il y a quelques nuages même autour des vérités révélées. Les uns et les autres portent le même jugement des objections des Sociniens : mais ceux-ci les ayant toujours considérées comme leurs preuves, les prennent pour des raisons convaincantes : d'où ils concluent que les objections de leurs adversaires peuvent bien être difficiles à résoudre, mais qu'elles ne sont pas solides. En général, dès qu'on ne regarde une chose que comme l'endroit difficîle d'une thèse qu'on a adoptée, on en fait très-peu de cas : on étouffe tous les doutes qui pourraient s'élever, et on ne se permet pas d'y faire attention ; ou si on les examine, c'est en ne les considérant que comme de simples difficultés ; et c'est par-là qu'on leur ôte la force de faire impression sur l'esprit. Il n'est donc point surprenant qu'il y ait eu et qu'il y ait encore des athées de théorie, c'est-à-dire, des athées qui par la voie du raisonnement soient parvenus à se persuader qu'il n'y a point de Dieu. Ce qui le prouve encore, c'est qu'il s'est trouvé des athées que le cœur n'avait pas séduits, et qui n'avaient aucun intérêt à s'affranchir d'un joug qui les incommodait. Qu'un professeur d'athéisme, par exemple, étale fastueusement toutes les preuves par lesquelles il prétend appuyer son système impie, elles saisiront ceux qui auront l'imprudence de l'écouter, et les disposeront à ne point se rebuter des objections qui suivent. Les premières impressions seront comme une digue qu'ils opposeront aux objections ; et pour peu qu'ils aient de penchant au libertinage, ne craignez pas qu'ils se laissent entraîner à la force de ces objections.
Quoique l'expérience nous force à croire que plusieurs philosophes anciens et modernes ont vécu et sont morts dans la profession d'athéisme, il ne faut pourtant pas s'imaginer qu'ils soient en si grand nombre que le supposent certaines personnes, ou trop zélées pour la religion, ou mal intentionnées contre elle. Le père Mersenne voulait qu'il n'y eut pas moins que 50 mille athées dans Paris ; il est visible que cela est outré à l'excès. On attache souvent cette note injurieuse à des personnes qui ne la méritent point. On n'ignore pas qu'il y a certains esprits qui se piquent de raisonnement, et qui ont beaucoup de force dans la dispute. Ils abusent de leur talent, et se plaisent à s'en servir pour embarrasser un homme qui leur parait convaincu de l'existence de Dieu. Ils lui font des objections sur la religion ; ils attaquent ses réponses et ne veulent pas avoir le dernier ; ils crient et s'échauffent, c'est leur coutume. Leur adversaire sort mal satisfait, et les prend pour des athées, quelques-uns des assistants prennent le même scandale, et portent le même jugement ; ce sont souvent des jugements téméraires. Ceux qui aiment la dispute et qui s'y sentent très-forts, soutiennent en mille rencontres le contraire de ce qu'ils croient bien fermement. Il suffira quelquefois, pour rendre quelqu'un suspect d'athéisme, qu'il ait disputé avec chaleur sur l'insuffisance d'une preuve de l'existence de Dieu ; il court risque, quelque orthodoxe qu'il sait, de se voir bien-tôt décrié comme un athée ; car, dira-t-on, il ne s'échaufferait pas tant s'il ne l'était : quel intérêt sans cela pourrait-il prendre dans cette dispute ? La belle demande ! n'y est-il pas intéressé pour l'honneur de son discernement ? Voudrait-on qu'il laissât croire qu'il prend une mauvaise preuve pour un argument démonstratif ?
Le parallèle de l'athéisme et du paganisme se présente ici fort naturellement. On se partage beaucoup sur ce problème, si l'irreligion est pire que la superstition : on convient que ce sont les deux extrémités vicieuses au milieu desquelles la vérité est située : mais il y a des personnes qui pensent avec Plutarque, que la superstition est un plus grand mal que l'athéisme : il y en a d'autres qui n'osent décider, et plusieurs enfin qui déclarent que l'athéisme est pire que la superstition. Juste Lipse prend ce dernier parti : mais en même temps il avoue que la superstition est plus ordinaire que l'irreligion ; qu'elle s'insinue sous le masque de la piété ; et que n'étant qu'une image de la religion, elle séduit de telle sorte l'esprit de l'homme qu'elle le rend son jouet. Personne n'ignore combien ce sujet a occupé Bayle, et comment il s'est tourné de tous côtés, et a employé toutes les subtilités du raisonnement pour soutenir ce qu'il avait une fois avancé. Il s'est appliqué à pénétrer jusque dans les replis les plus cachés de la nature humaine : aussi remarquable par la force et la clarté du raisonnement, que par l'enjouement, la vivacité et la délicatesse de l'esprit, il ne s'est égaré que par l'envie demesurée des paradoxes. Quoique familiarisé avec la plus saine philosophie, son esprit toujours actif et extrêmement vigoureux n'a pu se renfermer dans la carrière ordinaire ; il en a franchi les bornes. Il s'est plu à jeter des doutes sur les choses qui sont les plus généralement reçues, et à trouver des raisons de probabilité pour celles qui sont les plus généralement rejetées. Les paradoxes, entre les mains d'un auteur de ce caractère, produisent toujours quelque chose d'utîle et de curieux ; et on en a la preuve dans la question présente : car l'on trouve dans les pensées diverses de M. Bayle, un grand nombre d'excellentes observations sur la nature et le génie de l'ancien polithéisme. Comme il ne s'est proposé d'autre méthode que d'écrire selon que les choses se présenteraient à sa pensée, ses arguments se trouvent confusément épars dans son ouvrage. Il est nécessaire de les analyser et de les rapprocher. On les exposera dans un ordre où ils viendront à l'appui les uns des autres ; et loin de les affoiblir, on tâchera de leur prêter toute la force dont ils peuvent être susceptibles.
Dans ses pensées diverses, M. Bayle posa sa thèse de cette manière générale, que l'athéisme n'est pas un plus grand mal que l'idolatrie. C'est l'argument d'un de ses articles. Dans l'article même il dit que l'idolatrie est pour le moins aussi abominable que l'athéisme. C'est ainsi qu'il s'explique d'abord : mais les contradictions qu'il essuya lui firent proposer sa thèse avec les restrictions suivantes. " L'idolatrie des anciens payens n'est pas un mal plus affreux que l'ignorance de Dieu dans laquelle on tomberait, ou par stupidité, ou par défaut d'attention, sans une malice préméditée, fondée sur le dessein de ne sentir nuls remords, en s'adonnant à toutes sortes de crimes ". Enfin dans sa continuation des pensées diverses, il changea encore la question. Il supposa deux anciens philosophes, qui s'étant mis en tête d'examiner l'ancienne religion de leur pays, eussent observé dans cet examen les lois les plus rigoureuses de la recherche de la vérité. " Ni l'un ni l'autre de ces deux examinateurs ne se proposent de se procurer un système favorable à leurs intérêts ; ils mettent à part leurs passions, les commodités de la vie, toute la morale ; en un mot ils ne cherchent qu'à éclairer leur esprit. L'un deux ayant comparé autant qu'il a pu et sans aucun préjugé les preuves et les objections, les réponses, les répliques, conclut que la nature divine n'est autre chose que la vertu qui meut tous les corps par des lois nécessaires et immuables ; qu'elle n'a pas plus d'égard à l'homme qu'aux autres parties de l'univers ; qu'elle n'entend point nos prières ; que nous ne pouvons lui faire ni plaisir ni chagrin ", c'est-à-dire, en un mot que le premier philosophe deviendrait athée. Le second philosophe, après le même examen, tombe dans les erreurs les plus grossières du paganisme. M. Bayle soutient que le péché du premier ne serait pas plus énorme que le péché du dernier, et que même ce dernier aurait l'esprit plus faux que le premier. On voit par ces échantillons combien M. Bayle s'est plu à embarrasser cette question : divers savants l'ont réfuté, et surtout M. Bernard, dans différents endroits de ses nouvelles de la république des lettres, et M. Warburton, dans ses dissertations sur l'union de la religion, de la morale et de la politique. C'est une chose tout à fait indifférente à la vraie Religion, de savoir lequel de l'athéisme ou de l'idolatrie est un plus grand mal. Les intérêts du Christianisme sont tellement séparés de ceux de l'idolatrie payenne, qu'il n'a rien à perdre ni à gagner, soit qu'elle passe pour moins mauvaise ou pour plus mauvaise que l'irreligion. Mais quand on examine le parallèle de l'athéisme et du polythéisme par rapport à la société, ce n'est plus un problème indifférent. Il parait que le but de M. Bayle était de prouver que l'athéisme ne tend pas à la destruction de la société ; et c'est-là le point qu'il importe de bien développer : mais avant de toucher à cette partie de son système, examinons la première ; et pour le faire avec ordre, n'oublions pas la distinction qu'on fait des athées de théorie et des athées de pratique. Cette distinction une fois établie, on peut dire que l'athéisme pratique renferme un degré de malice, qui ne se trouve pas dans le polithéisme : on en peut donner plusieurs raisons.
La première est qu'un payen qui ôtait à Dieu la sainteté et la justice, lui laissait non-seulement l'existence, mais aussi la connaissance et la puissance ; au lieu qu'un athée pratique lui ôte tout. Les payens pouvaient être regardés comme des calomniateurs qui flétrissaient la gloire de Dieu ; les athées pratiques l'outragent et l'assassinent à la fais. Ils ressemblent à ces peuples qui maudissaient le soleil, dont la chaleur les incommodait, et qui l'eussent détruit, si cela eut été possible. Ils étouffent, autant qu'il est en eux, la persuasion de l'existence de Dieu ; et ils ne se portent à cet excès de malice, qu'afin de se délivrer des remords de leur conscience.
La seconde est que la malice est le caractère de l'athéisme pratique, mais que l'idolatrie payenne était un péché d'ignorance ; d'où l'on conclut que Dieu est plus offensé par les athées pratiques que par les payens, et que leurs crimes de lese-majesté divine sont plus injurieux au vrai Dieu que ceux des payens. En effet ils attaquent malicieusement la notion de Dieu qu'ils trouvent dans leur cœur et dans leur esprit ; ils s'efforcent de l'étouffer ; ils agissent en cela contre leur conscience, et seulement par le motif de se délivrer d'un joug qui les empêche de s'abandonner à toutes sortes de crimes. Ils font donc directement la guerre à Dieu ; et ainsi l'injure qu'ils font au souverain être est plus offensante que l'injure qu'il recevrait des adorateurs des idoles. Du moins ceux-ci étaient bien intentionnés pour la divinité en général, ils la cherchaient dans le dessein de la servir et de l'adorer ; et croyant l'avoir trouvée dans des objets qui n'étaient pas Dieu, ils l'honoraient selon leurs faux préjugés, autant qu'il leur était possible. Il faut déplorer leur ignorance ; mais en même temps il faut reconnaître que la plupart n'ont point su qu'ils erraient. Il est vrai que leur conscience était erronée : mais du moins ils s'y conformaient, parce qu'ils la croyaient bonne.
Pour l'athéisme spéculatif, il est moins injurieux à Dieu, et par conséquent un moindre mal que le polythéisme. Je pourrais alléguer grand nombre de passages d'auteurs, tant anciens que modernes, qui reconnaissent tous unanimement qu'il y a plus d'extravagance, plus de brutalité, plus de fureur, plus d'aveuglement dans l'opinion d'un homme qui admet tous les dieux des Grecs et des Romains, que dans l'opinion de celui qui n'en admet point du tout. " Quoi, dit Plutarque, (Traité de la Superst.) celui qui ne croit point qu'il y ait des dieux, est impie ; et celui qui croit qu'ils sont tels que les superstitieux se les figurent, ne le sera pas ? Pour moi, j'aimerais mieux que tous les hommes du monde dissent que Plutarque n'a jamais été, que s'ils disaient, Plutarque est un homme inconstant, leger, colere, qui se venge des moindres offenses ". M. Bossuet ayant donné le précis de la théologie que Wiclef a débitée dans son trialogue, ajoute ceci : " Voilà un extrait fidèle de ses blasphèmes : ils se réduisent en deux chefs ; à faire un dieu dominé par la nécessité ; et ce qui en est une suite, un dieu auteur et approbateur de tous les crimes, c'est-à-dire un dieu que les athées auraient raison de nier : de sorte que la religion d'un si grand réformateur est pire que l'athéisme ". Un des beaux endroits de M. de la Bruyere est celui-ci : " Si ma religion était fausse, je l'avoue, voilà le piège le mieux dressé qu'il soit possible d'imaginer : il était inévitable de ne pas donner tout au-travers, et de n'y être pas pris. Quelle majesté ! quel éclat des mystères ! quelle suite et quel enchainement de toute la doctrine ! quelle raison éminente ! quelle candeur ! quelle innocence de mœurs ! quelle force invincible et accablante de témoignages rendus successivement et pendant trois siècles entiers par des millions de personnes les plus sages, les plus modérées qui fussent alors sur la terre ! Dieu même pouvait-il jamais mieux rencontrer pour me séduire ? par où échapper, où aller, où me jeter, je ne dis pas pour trouver rien de meilleur, mais quelque chose qui en approche ? S'il faut périr, c'est par-là que je veux périr ; il m'est plus doux de nier Dieu, que de l'accorder avec une tromperie si spécieuse et si entière ". Voyez la continuation des pensées diverses de M. Bayle.
La comparaison de Richeome nous fera mieux sentir que tous les raisonnements du monde, que c'est un sentiment moins outrageant pour la divinité, de ne la point croire du tout, que de croire ce qu'elle n'est pas, et ce qu'elle ne doit pas être. Voilà deux portiers à l'entrée d'une maison : on leur demande, peut-on parler à votre maître ? Il n'y est pas, répond l'un : il y est, répond l'autre, mais fort occupé à faire de la fausse monnaie, de faux contrats, des poignards, et des poisons, pour perdre ceux qui ont exécuté ses desseins : l'athée ressemble au premier de ces portiers, le payen à l'autre. Il est donc visible que le payen offense plus grievement la divinité que ne fait l'athée. On ne peut comprendre que des gens qui auraient été attentifs à cette comparaison, eussent balancé à dire que la superstition payenne valait moins que l'irreligion.
S'il est vrai, 1°. que l'on offense beaucoup plus celui que l'on nomme fripon, scélérat, infame, que celui auquel on ne songe pas, ou de qui on ne dit ni bien, ni mal : 2°. qu'il n'y a point d'honnête femme, qui n'aimât mieux qu'on la fit passer pour morte, que pour prostituée : 3°. qu'il n'y a point de mari jaloux qui n'aime mieux que sa femme fasse vœu de continence, ou en général qu'elle ne veuille plus entendre parler de commerce avec un homme, que si elle se prostituait à tout venant : 4°. qu'un roi chassé de son trône s'estime plus offensé, lorsque ses sujets rébelles sont ensuite très-fidèles à un autre roi, que s'ils n'en mettaient aucun à sa place : 5°. qu'un roi qui a une forte guerre sur les bras, est plus irrité contre ceux qui embrassent avec chaleur le parti de ses ennemis, que contre ceux qui se tiennent neutres. Si, dis-je, ces cinq propositions sont vraies, il faut de toute nécessité, que l'offense que les Payens faisaient à Dieu, soit plus atroce que celle que lui font les athées spéculatifs, s'il y en a : ils ne songent point à Dieu ; ils n'en disent ni bien ni mal ; et s'ils nient son existence, c'est qu'ils la regardent non pas comme une chose réelle, mais comme une fiction de l'entendement humain. C'est un grand crime, je l'avoue : mais s'ils attribuaient à Dieu tous les crimes les plus infames, comme les Payens les attribuaient à leur Jupiter et à leur Vénus ; si après l'avoir chassé de son trône, ils lui substituaient une infinité de faux dieux, leur offense ne serait-elle pas beaucoup plus grande ? Ou toutes les idées que nous avons des divers degrés de péchés sont fausses, ou ce sentiment est véritable. La perfection qui est la plus chère à Dieu, est la sainteté ; par conséquent le crime qui l'offense le plus, est de le faire méchant : ne point croire son existence, ne lui point rendre de culte, c'est le dégrader ; mais de rendre le culte qui lui est dû à une infinité d'autres êtres, c'est tout-à-la-fais le dégrader et se déclarer pour le démon dans la guerre qu'il fait à Dieu. L'Ecriture nous apprend que c'est au diable que se terminait l'honneur rendu aux idoles, dii gentium daemonia. Si au jugement des personnes les plus raisonnables et les plus justes, un attentat à l'honneur est une injure plus atroce qu'un attentat à la vie ; si tout ce qu'il y a d'honnêtes gens conviennent qu'un meurtrier fait moins de tort qu'un calomniateur qui flétrit la réputation, ou qu'un juge corrompu qui déclare infame un innocent ; en un mot, si tous les hommes qui ont du sentiment, regardent comme une action très-criminelle de préférer la vie à l'honneur, l'infamie à la mort : que devons-nous penser de Dieu, qui verse lui-même dans les âmes ces sentiments nobles et généreux ? Ne devons-nous pas croire que la sainteté, la probité, la justice, sont ses attributs les plus essentiels, et dont il est le plus jaloux : donc la calomnie des Payens, qui le chargeant de toutes sortes de crimes détruit ses perfections les plus précieuses, lui est une offense plus injurieuse que l'impiété des athées, qui lui ôte la connaissance et la direction des événements.
C'est un grand défaut d'esprit de n'avoir pas reconnu dans les ouvrages de la nature un Dieu souverainement parfait ; mais c'est un plus grand défaut d'esprit encore, de croire qu'une nature sujette aux passions les plus injustes et les plus sales, soit un Dieu, et mérite nos adorations : le premier défaut est celui des athées, et le second celui des Payens.
C'est une injure sans doute bien grande d'effacer de nos cœurs l'image de la Divinité qui s'y trouve naturellement empreinte : mais cette injure devient beaucoup plus atroce, lorsqu'on défigure cette image, et qu'on l'expose au mépris de tout le monde. Les athées ont effacé l'image de Dieu, et les Payens l'ont rendue méconnaissable ; jugez de quel côté l'offense a été plus grande.
Le grand crime des athées parmi les Payens, est de n'avoir pas mis le véritable Dieu sur le trône, après en avoir si justement et si raisonnablement précipité tous les faux dieux : mais ce crime, quelque criant qu'il puisse être, est-il une injure aussi sanglante pour le vrai Dieu que celle qu'il a reçue des Idolatres, qui, après l'avoir déthroné, ont mis sur son trône les plus infames divinités qu'il fût possible d'imaginer ? Si la reine Elisabeth chassée de ses états, avait appris que ses sujets révoltés lui eussent fait succéder la plus infame prostituée qu'ils eussent pu déterrer dans Londres, elle eut été plus indignée de leur conduite, que s'ils eussent pris une autre forme de gouvernement, ou que pour le moins ils eussent donné la couronne à une illustre princesse. Non-seulement la personne de la reine Elisabeth eut été tout de nouveau insultée par le choix qu'on aurait fait d'une infame courtisanne, mais aussi le caractère royal eut été déshonoré, profané : voilà l'image de la conduite des Payens à l'égard de Dieu. Ils se sont révoltés contre lui ; et après l'avoir chassé du ciel, ils ont substitué à sa place une infinité de dieux chargés de crimes, et ils leur ont donné pour chef un Jupiter, fils d'un usurpateur, et usurpateur lui-même. N'était-ce pas flétrir et déshonorer le caractère divin, exposer au dernier mépris la nature et la majesté divine ?
A toutes ces raisons, M. Bayle en ajoute une autre, qui est que rien n'éloigne davantage les hommes de se convertir à la vraie religion, que l'idolatrie : en effet, parlez à un Cartésien ou à un Péripatéticien, d'une proposition qui ne s'accorde pas avec les principes dont il est préoccupé, vous trouvez qu'il songe bien moins à pénétrer ce que vous lui dites, qu'à imaginer des raisons pour le combattre : parlez-en à un homme qui ne soit d'aucune secte, vous le trouvez docile, et prêt à se rendre sans chicaner. La raison en est, qu'il est bien plus mal-aisé d'introduire quelque habitude dans une âme qui a déjà contracté l'habitude contraire, que dans une âme qui est encore toute nue. Qui ne sait, par exemple, qu'il est plus difficîle de rendre libéral un homme qui a été avare toute sa vie, qu'un enfant qui n'est encore ni avare ni libéral ? De même, il est beaucoup plus aisé de plier d'un certain sens un corps qui n'a jamais été plié, qu'un autre qui a été plié d'un sens contraire. Il est donc très-raisonnable de penser que les apôtres eussent converti plus de gens à J. C. s'ils l'eussent prêché à des peuples sans religion, qu'ils n'en ont converti, annonçant l'Evangîle à des nations engagées par un zèle aveugle et entêté aux cultes superstitieux du Paganisme. On m'avouera, que si Julien l'apostat eut été athée, du caractère dont il était d'ailleurs, il eut laissé en paix les Chrétiens ; au lieu qu'il leur faisait des injures continuelles, infatué qu'il était des superstitions du Paganisme, et tellement infatué, qu'un historien de sa religion n'a pu s'empêcher d'en faire une espèce de raillerie ; disant que s'il fût retourné victorieux de son expédition contre les Perses, il eut dépeuplé la terre de bœufs à force de sacrifices. Tant il est vrai, qu'un homme entêté d'une fausse religion, résiste plus aux lumières de la véritable, qu'un homme qui ne tient à rien de semblable. Toutes ces raisons, dira-t-on à M. Bayle, ne sont tout au plus concluantes que pour un athée négatif, c'est-à-dire pour un homme qui n'a jamais pensé à Dieu, qui n'a pris aucun parti sur cela. L'ame de cet homme est comme uu tableau nud, tout prêt à recevoir telles couleurs qu'on voudra lui appliquer : mais peut-on dire la même chose d'un athée positif, c'est-à-dire d'un homme qui, après avoir examiné les preuves sur lesquelles on établit l'existence de Dieu, finit par conclure qu'il n'y en a aucune qui soit solide, et capable de faire impression sur un esprit vraiment philosophique ? Un tel homme est assurément plus éloigné de la vraie religion, qu'un homme qui admet une divinité, quoiqu'il n'en ait pas les idées les plus saines. Celle-ci se conserve le tronc sur lequel on pourra enter la foi véritable : mais celui-là a mis la hache à la racine de l'arbre, et s'est ôté toute espérance de se relever. Mais en accordant que le payen peut être guéri plus facilement que l'athée, je n'ai garde de conclure qu'il soit moins coupable que ce dernier. Ne sait-on pas que les maladies les plus honteuses, les plus sales, les plus infames, sont celles dont la guérison est la plus facîle ?
Nous voici enfin parvenus à la seconde partie du parallèle de l'athéisme et du polithéisme. M. Bayle Ve plus loin ; il tâche encore de prouver que l'athéisme ne tend pas à la destruction de la société. Pour nous, quoique nous soyons persuadés que les crimes de lese-majesté divine sont plus énormes dans le système de la superstition, que dans celui de l'irreligion, nous croyons cependant que ce dernier est plus pernicieux au genre humain, que le premier. Voici sur quoi nous nous fondons.
On a généralement pensé qu'une des preuves que l'athéisme est pernicieux à la société, consistait en ce qu'il exclut la connaissance du bien et du mal moral, cette connaissance étant postérieure à celle de Dieu. C'est pourquoi le premier argument dont M. Bayle fait usage pour justifier l'athéisme, c'est que les athées peuvent conserver les idées, par lesquelles on découvre la différence du bien et du mal moral ; parce qu'ils comprennent, aussi-bien que les déistes ou théistes, les premiers principes de la Morale et de la Métaphysique ; et que les Epicuriens qui niaient la Providence, et les Stratoniciens qui niaient l'existence de Dieu, ont eu ces idées.
Pour connaître ce qu'il peut y avoir de vrai ou de faux dans ces arguments, il faut remonter jusqu'aux premiers principes de la Morale ; matière en elle-même claire et facîle à comprendre, mais que les disputes et les subtilités ont jetée dans une extrême confusion. Tout l'édifice de la Morale-pratique est fondé sur ces trois principes réunis, savoir le sentiment moral, la différence spécifique des actions humaines, et la volonté de Dieu. J'appelle sentiment moral cette approbation du bien, cette horreur pour le mal, dont l'instinct ou la nature nous prévient antérieurement à toutes réflexions sur leur caractère et sur leurs conséquences. C'est-là la première ouverture, le premier principe qui nous conduit à la connaissance parfaite de la Morale, et il est commun aux athées aussi-bien qu'aux théistes. L'instinct ayant conduit l'homme jusque-là, la faculté de raisonner qui lui est naturelle, le fait réfléchir sur les fondements de cette approbation et de cette horreur. Il découvre que ni l'une ni l'autre ne sont arbitraires, mais qu'elles sont fondées sur la différence qu'il y a essentiellement dans les actions des hommes. Tout cela n'imposant point encore une obligation assez forte pour pratiquer le bien et pour éviter le mal, il faut nécessairement ajouter la volonté supérieure d'un législateur, qui non-seulement nous ordonne ce que nous sentons et reconnaissons pour bon, mais qui propose en même temps des récompenses pour ceux qui s'y conforment, et des châtiments pour ceux qui lui désobéissent. C'est le dernier principe des préceptes de Morale ; c'est ce qui leur donne le vrai caractère de devoir : c'est donc sur ces trois principes que porte tout l'édifice de la Morale. Chacun d'eux est soutenu par un motif propre et particulier. Lorsqu'on se conforme au sentiment moral, on éprouve une sensation agréable : lorsqu'on agit conformément à la différence essentielle des choses, on concourt à l'ordre et à l'harmonie de l'univers ; et lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu, on s'assure des récompenses, et l'on évite des peines.
De tout cela, il résulte évidemment ces deux conséquences : 1°. qu'un athée ne saurait avoir une connaissance exacte et complete de la moralité des actions humaines proprement nommée : 2°. que le sentiment moral et la connaissance des différences essentielles qui spécifient les actions humaines, deux principes dont on connait qu'un athée est capable, ne concluent néanmoins rien en faveur de l'argument de M. Bayle ; parce que ces deux choses, même unies, ne suffisent pas pour porter l'athée à la pratique de la vertu, comme il est nécessaire pour le bien de la société, ce qui est le point dont il s'agit.
Voyons d'abord comment M. Bayle a prétendu prouver la moralité des actions humaines, suivant les principes d'un stratonicien. Il le fait raisonner de la manière suivante : " La beauté, la symétrie, la régularité, l'ordre que l'on voit dans l'univers, sont l'ouvrage d'une nature qui n'a point de connaissance ; et encore que cette nature n'ait point suivi des idées, elle a néanmoins produit une infinité d'espèces, dont chacune a ses attributs essentiels. Ce n'est point en conséquence de nos opinions que le feu et l'eau diffèrent d'espèce, et qu'il y a une pareille différence entre l'amour et la haine, et entre l'affirmation et la négation. Cette différence spécifique est fondée dans la nature même des choses : mais comment la connaissons-nous ? N'est-ce pas en comparant les propriétés essentielles de l'un de ces êtres avec les propriétés essentielles de l'autre ? Or nous connaissons par la même voie, qu'il y a une différence spécifique entre le mensonge et la vérité, entre l'ingratitude et la gratitude, etc. Nous devons donc être assurés que le vice et la vertu diffèrent spécifiquement par leur nature, et indépendamment de nos opinions ". M. Bayle en conclut, que les Stratoniciens ont pu connaître que le vice et la vertu étaient deux espèces de qualité, qui étaient naturellement séparées l'une de l'autre. On le lui accorde. " Voyons, continue-t-il, comment ils ont pu savoir qu'elles étaient outre cela séparées moralement. Ils attribuaient à la même nécessité de la nature, l'établissement des rapports que l'on voit entre les choses, et celui des règles par lesquelles nous distinguons ces rapports. Il y a des règles de raisonnement, indépendantes de la volonté de l'homme ; ce n'est point à cause qu'il a plu aux hommes d'établir les règles du syllogisme, qu'elles sont justes et véritables ; elles le sont en elles-mêmes, et toute entreprise de l'esprit humain contre leur essence et leurs attributs serait vaine et ridicule ". On accorde tout cela à M. Bayle. Il ajoute : " S'il y a des règles certaines et immuables pour les opérations de l'entendement, il y en a aussi pour les actes de la volonté ". Voilà ce qu'on lui nie, et ce qu'il tâche de prouver de cette manière. " Les règles de ces actes-là ne sont pas toutes arbitraires ; il y en a qui émanent de la nécessité de la nature, et qui imposent une obligation indispensable.... La plus générale de ces règles-ci, c'est qu'il faut que l'homme veuille ce qui est conforme à la droite raison. Il n'y a pas de vérité plus évidente que de dire qu'il est digne de la créature raisonnable de se conformer à la raison, et qu'il est indigne de la créature raisonnable de ne se pas conformer à la raison ".
Le passage de M. Bayle fournit une distinction à laquelle on doit faire beaucoup d'attention, pour se former des idées nettes de morale. Cet auteur a distingué avec soin la différence par laquelle les qualités des choses ou des actions sont naturellement séparées les unes des autres, et celle par laquelle ces qualités sont moralement séparées ; d'où il nait deux sortes de différences, l'une naturelle, l'autre morale. De la différence naturelle et spécifique des choses il suit qu'il est raisonnable de s'y conformer ou de s'en abstenir ; et de la différence morale il suit qu'on est obligé de s'y conformer ou de s'en abstenir. De ces deux différences l'une est spéculative ; elle fait voir le rapport ou défaut de rapport qui se trouve entre les choses ; l'autre est pratique. Outre le rapport des choses, elle établit une obligation dans l'agent ; en sorte que différence morale et obligation de s'y conformer, sont deux idées inséparables : car c'est-là uniquement ce que peuvent signifier les termes de différence naturelle et de différence morale ; autrement ils ne signifieraient que la même chose, ou ne signifieraient rien du tout.
Or si l'on prouve que de ces deux différences l'une n'est pas nécessairement une suite de l'autre, l'argument de M. Bayle tombe de lui-même : c'est ce qu'il est aisé de faire voir. L'idée d'obligation suppose nécessairement un être qui oblige, et qui doit être différent de celui qui est obligé. Supposer que celui qui oblige et celui qui est obligé sont une seule et même personne, c'est supposer qu'un homme peut faire un contrat avec lui-même ; ce qui est la chose du monde la plus absurde en matière d'obligation : car c'est une maxime incontestable, que celui qui acquiert un droit sur quelque chose par l'obligation dans laquelle un autre entre avec lui, peut céder ce droit. Si donc celui qui oblige et celui qui est obligé sont la même personne, toute obligation devient nulle par cela même ; ou, pour parler plus exactement, il n'y a jamais eu d'obligation. C'est-là néanmoins l'absurdité où tombe l'athée stratonicien, lorsqu'il parle de différence morale, ou autrement d'obligations ; car quel être peut lui imposer des obligations ? dira-t-il que c'est la droite raison ? Mais c'est-là précisément l'absurdité dont nous venons de parler ; car la raison n'est qu'un attribut de la personne obligée, et ne saurait par conséquent être le principe de l'obligation : son office est d'examiner et de juger des obligations qui lui sont imposées par quelqu'autre principe. Dira-t-on que par la raison on n'entend pas la raison de chaque homme en particulier, mais la raison en général ? Mais cette raison générale n'est qu'une notion arbitraire, qui n'a point d'existence réelle ; et comment ce qui n'existe pas peut-il obliger ce qui existe ? c'est ce qu'on ne comprend pas.
Tel est le caractère de toute obligation en général, elle suppose une loi qui commande et qui défende ; mais une loi ne peut être imposée que par un être intelligent et supérieur, qui ait le pouvoir d'exiger qu'on s'y conforme. Un être aveugle et sans intelligence n'est ni ne saurait être législateur ; et ce qui procede nécessairement d'un pareil être, ne saurait être considéré sous l'idée de loi proprement nommée. Il est vrai que dans le langage ordinaire on parle de loi de raison et de loi de nécessité ; mais ce ne sont que des expressions figurées. Par la première on entend la règle que le législateur de la nature nous a donnée pour juger de sa volonté ; et la seconde signifie seulement que la nécessité a en quelque manière une des propriétés de la loi, celle de forcer ou de contraindre. Mais on ne conçoit pas que quelque chose puisse obliger un être dépendant et doué de volonté, si ce n'est une loi prise dans le sens philosophique. Ce qui a trompé M. Bayle, c'est qu'ayant aperçu que la différence essentielle des choses est un objet propre pour l'entendement, il en a conclu avec précipitation que cette différence devait également être le motif de la détermination de la volonté ; mais il y a cette disparité, que l'entendement est nécessité dans ses perceptions, et que la volonté n'est point nécessitée dans ses déterminations. Les différences essentielles des choses n'étant donc pas l'objet de la volonté, il faut que loi d'un supérieur intervienne pour former l'obligation du choix ou la moralité des actions.
Hobbes, quoiqu'accusé d'athéisme, semble avoir pénétré plus avant dans cette matière que le stratonicien de Bayle. Il parait qu'il a senti que l'idée de morale renfermait nécessairement celle d'obligation, l'idée d'obligation celle de loi, et l'idée de loi celle de législateur ; c'est pourquoi après avoir en quelque sorte banni le législateur de l'univers, il a jugé à propos, afin que la moralité des actions ne restât pas sans fondement, de faire intervenir son grand monstre, qu'il appelle le léviathan, et d'en faire le créateur et le soutien du bien et du mal moral. C'est donc en vain qu'on prétendrait qu'il y aurait un bien moral à agir conformément à la relation des choses, parce que par-là on contribuerait au bonheur de ceux de son espèce. Cette raison ne peut établir qu'un bien ou un mal naturel, et non pas un bien ou un mal moral. Dans ce système, la vertu serait au même niveau que les productions de la terre et que la bénignité des saisons, le vice serait au même rang que la peste et les tempêtes, puisque ces différentes choses ont le caractère commun de contribuer au bonheur ou au malheur des hommes. La moralité ne saurait résulter simplement de la nature d'une action ni de celle de son effet ; car qu'une chose soit raisonnable ou ne le soit pas, il s'ensuit seulement qu'il est convenable ou absurde de la faire ou de ne la point faire ; et si le bien ou le mal qui résulte d'une action, rendait cette action morale, les brutes dont les actions produisent ces deux effets, auraient le caractère d'agens moraux.
Ce qui vient d'être exposé fait voir que l'athée ne saurait parvenir à la connaissance de la moralité des actions proprement nommées. Mais quand on accorderait à un athée le sentiment moral et la connaissance de la différence essentielle qu'il y a dans les qualités des actions humaines, cependant ce sentiment et cette connaissance ne feraient rien en faveur de l'argument de M. Bayle, parce que ces deux choses unies ne suffisent point pour porter la multitude à pratiquer la vertu, ainsi qu'il est nécessaire pour le maintien de la société. Pour discuter cette question à fond, il faut examiner jusqu'à quel point le sentiment moral seul peut influer sur la conduite des hommes pour les porter à la vertu : en second lieu, quelle nouvelle force il acquiert lorsqu'il agit conjointement avec la connaissance de la différence essentielle des choses ; distinction d'autant plus nécessaire à observer, qu'encore que nous ayons reconnu qu'un athée peut parvenir à cette connaissance, il est néanmoins un genre d'athées qui en sont entièrement incapables, et sur lesquels il n'y a par conséquent que le sentiment moral seul qui puisse agir : ce sont les athées épicuriens, qui prétendent que tout en ce monde n'est que l'effet du hasard.
En posant que le sentiment moral est dans l'homme un instinct, le nom de la chose ne doit pas nous tromper, et nous faire imaginer que les impressions de l'instinct moral sont aussi fortes que celles de l'instinct animal dans les brutes : le cas est différent. Dans la brute l'instinct étant le seul principe d'action, a une force invincible ; mais dans l'homme ce n'est, à proprement parler, qu'un pressentiment officieux, dont l'utilité est de concilier la raison avec les passions, qui toutes à leur tour déterminent la volonté. Il doit donc être d'autant plus faible, qu'il partage avec plusieurs autres principes le pouvoir de nous faire agir : la chose même ne pouvait être autrement, sans détruire la liberté du choix. Le sentiment moral est si délicat, et tellement entrelacé dans la constitution de la nature humaine ; il est d'ailleurs si aisément et si fréquemment effacé, que quelques personnes n'en pouvant point découvrir les traces dans quelques-unes des actions les plus communes, en ont nié l'existence. Il demeure presque sans force et sans vertu, à moins que toutes les passions ne soient bien tempérées, et en quelque manière en équilibre. De-là on doit conclure que ce principe seul est trop faible pour avoir une grande influence sur la pratique.
Lorsque le sentiment moral est joint à la connaissance de la différence essentielle des choses, il est certain qu'il acquiert beaucoup de force ; car d'un côté cette connaissance sert à distinguer le sentiment moral d'avec les passions déréglées et vicieuses ; et d'un autre côté le sentiment moral empêche qu'en raisonnant sur la différence essentielle des choses, l'entendement ne s'égare et ne substitue des chimères à des réalités. Mais la question est de savoir si ces deux principes, indépendamment de la volonté et du commandement d'un supérieur, et par conséquent de l'attente des récompenses et des peines, auront assez d'influence sur le plus grand nombre des hommes, pour les déterminer à la pratique de la vertu. Tous ceux qui ont étudié avec quelqu'attention, et qui ont tant-sait-peu approfondi la nature de l'homme, ont tous trouvé qu'il ne suffit pas de reconnaître que la vertu est le souverain bien, pour être porté à la pratiquer : il faut qu'on s'en fasse une application personnelle, et qu'on la considère comme un bien faisant partie de notre propre bonheur. Le plaisir de satisfaire une passion qui nous tyrannise avec force et avec vivacité, et qui a l'amour-propre dans ses intérêts, est communément ce que nous regardons comme le plus capable de contribuer à notre satisfaction et à notre bonheur. Les passions étant très-souvent opposées à la vertu et incompatibles avec elle, il faut pour contre-balancer leur effet, mettre un nouveau poids dans la balance de la vertu ; et ce poids ne peut être que les récompenses ou les peines que la religion propose.
L'intérêt personnel, qui est le principal ressort de toutes les actions des hommes, en excitant en eux des motifs de crainte et d'espérance, a produit tous les désordres qui ont obligé d'avoir recours à la société. Le même intérêt personnel a suggéré les mêmes motifs pour remédier à ces désordres, autant que la nature de la société pouvait le permettre. Une passion aussi universelle que celle de l'intérêt personnel, ne pouvant être combattue que par l'opposition de quelqu'autre passion aussi forte et aussi active, le seul expédient dont on ait pu se servir, a été de la tourner contre elle-même, en l'employant pour une fin contraire. La société, incapable de remédier par sa propre force aux désordres qu'elle devait corriger, a été obligée d'appeler la religion à son secours, et & n'a pu déployer sa force qu'en conséquence des mêmes principes de crainte et d'espérance. Mais comme des trois principes qui servent de base à la morale, ce dernier, qui est fondé sur la volonté de Dieu, et qui manque à un athée, est le seul qui présente ces puissants motifs ; il s'ensuit évidemment que la religion, à qui seule on en est redevable, est absolument nécessaire pour le maintien de la société ; ou, ce qui revient au même, que le sentiment moral et la connaissance de la différence essentielle des choses, réunis ensemble, ne sauraient avoir assez d'influence sur la plupart des hommes, pour les déterminer à la pratique de la vertu.
M. Bayle a très-bien compris que l'espérance et la crainte sont les plus puissants ressorts de la conduite des hommes. Quoiqu'après avoir distingué la différence naturelle des choses et leur différence morale, il les avait ensuite confondues pour en tirer un motif qui put obliger les hommes à la pratique de la veru ; il a apparemment senti l'inefficacité de ce motif, puisqu'il en a appelé un autre à son secours, en supposant que le désir de la gloire et la crainte de l'infamie suffiraient pour régler la conduite des athées ; et c'est-là le second argument dont il se sert pour défendre son paradoxe. " Un homme, dit-il, destitué de foi, peut être fort sensible à l'honneur du monde, fort avide de louange et d'encens. S'il se trouve dans un pays où l'ingratitude et la fourberie exposent les hommes au mépris, et où la générosité et la vertu seront admirées, ne doutez point qu'il ne fasse profession d'être homme d'honneur, et qu'il ne soit capable de restituer un dépôt, quand même on ne pourrait l'y contraindre par les voies de la justice. La crainte de passer dans le monde pour un traitre et pour un coquin, l'emportera sur l'amour de l'argent ; et comme il y a des personnes qui s'exposent à mille peines et à mille périls pour se venger d'une offense qui leur a été faite devant très-peu de témoins, et qu'ils pardonneraient de bon cœur, s'ils ne craignaient d'encourir quelque infamie dans leur voisinage ; je crois de même que malgré les oppositions de son avarice, un homme qui n'a point de religion est capable de restituer un dépôt qu'on ne pourrait le convaincre de retenir injustement, lorsqu'il voit que sa bonne foi lui attirera les éloges de toute une ville, et qu'on pourrait un jour lui faire des reproches de son infidélité, ou le soupçonner à tout le moins d'une chose qui l'empêcherait de passer pour un honnête homme dans l'esprit des autres : car c'est à l'estime intérieure des autres que nous aspirons surtout. Les gestes et les paroles qui marquent cette estime, ne nous plaisent qu'autant que nous nous imaginons que ce sont des signes de ce qui se passe dans l'esprit. Une machine qui viendrait nous faire la révérence et qui formerait des paroles flatteuses, ne serait guère propre à nous donner bonne opinion de nous-mêmes, parce que nous saurions que ce ne seraient pas des signes de la bonne opinion qu'un autre aurait de notre mérite ; c'est pourquoi celui dont je parle pourrait sacrifier son avarice à sa vanité, s'il croyait seulement qu'on le soupçonnerait d'avoir violé les lois sacrées du dépôt : et s'il se croyait à l'abri de tout soupçon, encore pourrait-il bien se résoudre à lâcher sa prise, par la crainte de tomber dans l'inconvénient qui est arrivé à quelques-uns, de publier eux-mêmes leurs crimes pendant qu'ils dormaient, ou pendant les transports d'une fièvre chaude. Lucrèce se sert de ce motif pour porter à la vertu des hommes sans religion ".
On conviendra avec M. Bayle, que le désir de l'honneur et la crainte de l'infamie sont deux puissants motifs pour engager les hommes à se conformer aux maximes adoptées par ceux avec qui ils conversent, et que les maximes reçues parmi les nations civilisées (non toutes les maximes, mais la plupart), s'accordent avec les règles invariables du juste, nonobstant tout ce que Sextus Empiricus et Montagne ont pu dire de contraire, appuyés de quelques exemples dont ils ont voulu tirer une conséquence trop générale. La vertu contribuant évidemment au bien du genre humain, et le vice y mettant obstacle, il n'est point surprenant qu'on ait cherché à encourager par l'estime de la réputation, ce que chacun en particulier trouvait tendre à son avantage ; et que l'on ait tâché de décourager par le mépris et l'infamie, ce qui pouvait produire un effet opposé. Mais comme il est certain qu'on peut acquérir la réputation d'honnête homme, presqu'aussi surement et beaucoup plus aisément et plus promptement, par une hypocrisie bien concertée et bien soutenue, que par une pratique sincère de la vertu ; un athée qui n'est retenu par aucun principe de conscience, choisira sans doute la première voie, qui ne l'empêchera pas de satisfaire en secret toutes ses passions. Content de paraitre vertueux, il agira en scélérat lorsqu'il ne craindra pas d'être découvert, et ne consultera que ses inclinations vicieuses, son avarice, sa cupidité, la passion criminelle dont il se trouvera le plus violemment dominé. Il est évident que ce sera là en général le plan de toute personne qui n'aura d'autre motif pour se conduire en honnête homme, que le désir d'une réputation populaire. En effet, dès-là que j'ai banni de mon cœur tout sentiment de religion, je n'ai point de motif qui m'engage à sacrifier à la vertu mes penchants favoris, mes passions les plus impérieuses, toute ma fortune, ma réputation même. Une vertu détachée de la religion n'est guère propre à me dédommager des plaisirs véritables et des avantages réels auxquels je renonce pour elle. Les athées diront-ils qu'ils aiment la vertu pour elle-même, parce qu'elle a une beauté essentielle, qui la rend digne de l'amour de tous ceux qui ont assez de lumières pour la reconnaître ? Il est assez étonnant, pour le dire en passant, que les personnes qui outrent le plus la piété ou l'irreligion, s'accordent néanmoins dans leurs prétentions touchant l'amour pur de la vertu : mais que veut dire dans la bouche d'un athée, que la vertu a une beauté essentielle ? n'est-ce pas là une expression vide de sens ? Comment prouveront-ils que la vertu est belle, et que supposé qu'elle ait une beauté essentielle, il faut l'aimer, lors même qu'elle nous est inutile, et qu'elle n'influe pas sur notre félicité ? Si la vertu est belle essentiellement, elle ne l'est que parce qu'elle entretient l'ordre et le bonheur dans la société humaine ; la vertu ne doit paraitre belle, par conséquent, qu'à ceux qui par un principe de religion se croient indispensablement obligés d'aimer les autres hommes, et non pas à des gens qui ne sauraient raisonnablement admettre aucune loi naturelle, sinon l'amour le plus grossier. Le seul égard auquel la vertu peut avoir une beauté essentielle pour un incrédule, c'est lorsqu'elle est possédée et exercée par les autres hommes, et que par-là elle sert pour ainsi dire d'asîle aux vices du libertin : ainsi, pour s'exprimer intelligiblement, les incrédules devraient soutenir qu'à tout prendre, la vertu est pour chaque individu humain, plus utîle que le vice, et plus propre à nous conduire vers le néant d'une manière commode et agréable. Mais c'est ce qu'ils ne prouveront jamais. De la manière dont les hommes sont faits, il leur en coute beaucoup plus pour suivre scrupuleusement la vertu, que pour se laisser aller au cours impétueux de leurs penchans. La vertu dans ce monde est obligée de lutter sans cesse contre mille obstacles qui à chaque pas l'arrêtent ; elle est traversée par un tempérament indocile, et par des passions fougueuses ; mille objets séducteurs détournent son attention ; tantôt victorieuse et tantôt vaincue, elle ne trouve et dans ses défaites et dans ses victoires, que des sources de nouvelles guerres, dont elle ne prévait pas la fin. Une telle situation n'est pas seulement triste et mortifiante ; il me semble même qu'elle doit être insupportable, à moins qu'elle ne soit soutenue par des motifs de la dernière force ; en un mot, par des motifs aussi puissants que ceux qu'on tire de la religion.
Par conséquent, quand même un athée ne douterait pas qu'une vertu qui jouit tranquillement du fruit de ses combats, ne soit plus aimable et plus utîle que le vice, il serait presqu'impossible qu'il y put jamais parvenir. Plaçons un tel homme dans l'âge où d'ordinaire le cœur prend son parti, et commence à former son caractère ; donnons-lui, comme à un autre homme, un tempérament, des passions, un certain degré de lumière. Il délibère avec lui-même s'il s'abandonnera au vice, ou s'il s'attachera à la vertu. Dans cette situation il me semble qu'il doit raisonner à peu près de cette manière. " Je n'ai qu'une idée confuse que la vertu tranquillement possédée, pourrait bien être préférable aux agréments du vice : mais je sens que le vice est aimable, utile, fécond en sensations délicieuses ; je vois pourtant que dans plusieurs occasions il expose à de fâcheux inconvénients : mais la vertu me parait sujette en mille rencontres à des inconvénients du moins aussi terribles. D'un autre côté je comprents parfaitement bien que la route de la vertu est escarpée, et qu'on n'y avance qu'en se gênant, qu'en se contraignant ; il me faudra des années entières, avant que de voir le chemin s'applanir sous mes pas, et avant que je puisse jouir des effets d'un si rude travail. Ma première jeunesse, cet âge où l'on goute toutes sortes de plaisirs avec le plus de vivacité et de ravissement, ne sera employé qu'à des efforts aussi rudes que continuels. Quel est donc le grand motif qui doit me porter à tant de peine et à de si cruels embarras ? seront-ce les délices qui sortent du fond de la vertu ? mais je n'ai de ces délices qu'une très-foible idée. D'ailleurs je n'ai qu'une espèce d'existence d'emprunt. Si je pouvais me promettre de jouir pendant un grand nombre de siècles de la félicité attachée à la vertu, j'aurais raison de ramasser toutes les forces de mon âme, pour m'assurer un bonheur si digne de mes recherches : mais je ne suis sur de mon être que durant un seul instant ; peut-être que le premier pas que je ferai dans le chemin de la vertu, me précipitera dans le tombeau. Quoi qu'il en sait, le néant m'attend dans un petit nombre d'années ; la mort me saisira peut-être, lorsque je commencerai à goûter les charmes de la vertu. Cependant toute ma vie se sera écoulée dans le travail et dans le desagrément : ne serait-il pas ridicule que pour une félicité peut-être chimérique, et qui, si elle est réelle, n'existera peut-être jamais pour moi, je renonçasse à des plaisirs présents, vers lesquels mes passions m'entraînent, et qui sont de si facîle accès, que je dois employer toutes les forces de ma raison pour m'en éloigner ? Non : le moment où j'existe est le seul dont la possession me soit assurée ; il est raisonnable que j'y saisisse tous les agréments que je puis y rassembler ".
Il me semble qu'il serait difficîle de trouver dans ce raisonnement d'un jeune esprit fort, un défaut de prudence, ou un manque de justesse d'esprit. Le vice conduit avec un peu de prudence, l'emporte infiniment sur une vertu exacte qui n'est point soutenue de la consolante idée d'un être suprême. Un athée sage économe du vice, peut jouir de tous les avantages qu'il est possible de puiser dans la vertu considérée en elle-même ; et en même temps il peut éviter tous les inconveniens attachés au vice imprudent et à la rigide vertu. Epicurien circonspect, il ne refusera rien à ses désirs. Aime-t-il la bonne chère ? il contentera cette passion autant que sa fortune et sa santé le lui permettront ; et il se fera une étude de se conserver toujours en état de goûter les mêmes plaisirs, avec le même ménagement. La gaieté que le vin répand dans l'âme a-t-elle de grands charmes pour lui ? il essayera les forces de son tempérament, et il observera jusqu'à quel degré il peut soutenir les délicieuses vapeurs d'un commencement d'ivresse. En un mot il se formera un système de tempérance voluptueuse, qui puisse étendre sur tous les jours de sa vie, des plaisirs non interrompus. Son penchant favori le porte-t-il aux délices de l'amour ? il emploiera toutes sortes de voies pour surprendre la simplicité et pour séduire l'innocence. Quelle raison aura-t-il surtout de respecter le sacré lien du mariage ? Se fera-t-il un scrupule de dérober à un mari le cœur de son épouse, dont un contrat autorisé par les lois l'a mis seul en possession ? Nullement : son intérêt veut qu'il se règle plutôt sur les lois de ses désirs, et que profitant des agréments du mariage, il en laisse le fardeau au malheureux époux.
Il est aisé de voir par ce que je viens de dire, qu'une conduite prudente, mais facile, suffit pour se procurer sans risque mille plaisirs, en manquant à propos de candeur, de justice, d'équité, de générosité, d'humanité, de reconnaissance, et de tout ce qu'on respecte sous l'idée de vertu. Qu'avec tout cet enchainement de commodités et de plaisirs, dont le vice artificieusement conduit est une source intarissable, on mette en parallèle tous les avantages qu'on peut se promettre d'une vertu qui se trouve bornée aux espérances de la vie présente ; il est évident que le vice aura sur elle de grands avantages, et qu'il influera beaucoup plus qu'elle sur le bonheur de chaque homme en particulier. En effet, quoique la prudente jouissance des plaisirs des sens puisse s'allier jusqu'à un certain degré avec la vertu même, combien de sources de ces plaisirs n'est-elle pas obligée de fermer ? Combien d'occasions de les goûter ne se contraint-elle pas de négliger et d'écarter de son chemin ? Si elle se trouve dans la prospérité et dans l'abondance, j'avoue qu'elle y est assez à son aise. Il est certain pourtant que dans les mêmes circonstances, le vice habilement mis en œuvre a encore des libertés infiniment plus grandes : mais l'appui des biens de la fortune manque-t-il à la vertu ? rien n'est plus destitué de ressources que cette triste sagesse. Il est vrai que si la masse générale des hommes était beaucoup plus éclairée et dévouée à la sagesse, une conduite régulière et vertueuse serait un moyen de parvenir à une vie douce et commode : mais il n'en est pas ainsi des hommes ; le vice et l'ignorance l'emportent, dans la société humaine, sur les lumières et sur la sagesse. C'est-là ce qui ferme le chemin de la fortune aux gens de bien, et qui l'élargit pour une espèce de sages vicieux. Un athée se sent un amour bizarre pour la vertu, il s'aime pourtant : la bassesse, la pauvreté, le mépris, lui paraissent des maux véritables ; le crédit, l'autorité, les richesses, s'offrent à ses désirs comme des biens dignes de ses recherches. Supposons qu'en achetant pour une somme modique la protection d'un grand seigneur, un homme puisse obtenir malgré les lois une charge propre à lui donner un rang dans le monde, à le faire vivre dans l'opulence, à établir et à soutenir sa famille. Mais peut-il se résoudre à employer un si coupable moyen de s'assurer un destin brillant et commode ? Non : il est forcé de négliger un avantage si considérable, qui sera saisi avec avidité par un homme qui détache la religion de la vertu ; ou par un autre qui agissant par principes, secoue en même temps le joug de la religion.
Je ne donnerai point ici un détail étendu de semblables situations, dans lesquelles la vertu est obligée de rejeter des biens très-réels, que le vice adroitement ménagé s'approprierait sans peine et sans danger : mais qu'il me soit permis de demander à un athée vertueux, par quel motif il se résoud à des sacrifices si tristes. Qu'est-ce que la nature de sa vertu lui peut fournir, qui suffise pour le dédommager de tant de pertes considérables ? Est-ce la certitude qu'il fait son devoir ? Mais je crois avoir démontré, que son devoir ne consiste qu'à bien ménager ses véritables intérêts pendant une vie de peu de durée. Il sert donc une maîtresse bien pauvre et bien ingrate, qui ne paye ses services les plus pénibles, d'aucun véritable avantage, et qui pour prix du dévouement le plus parfait, lui arrache les plus flatteuses occasions d'étendre sur toute sa vie les plus doux plaisirs et les plus vifs agréments.
Si l'athée vertueux ne trouve pas dans la nature de la vertu l'équivalent de tout ce qu'il sacrifie à ce qu'il considère comme son devoir, du moins il le trouvera, direz-vous, dans l'ombre de la vertu, dans la réputation qui lui est si légitimement dû.. Quoiqu'à plusieurs égards la réputation soit un bien réel, et que l'amour qu'on a pour elle, soit raisonnable ; j'avouerai cependant que c'est un bien faible avantage, quand c'est l'unique récompense qu'on attend d'une stérîle vertu. Otez les plaisirs que la vanité tire de la réputation, tout l'avantage qu'un athée en peut espérer, n'aboutit qu'à l'amitié, qu'aux caresses, et qu'aux services de ceux qui ont formé de son mérite des idées avantageuses. Mais qu'il ne s'y trompe point : ces douceurs de la vie ne trouvent pas une source abondante dans la réputation qu'on s'attire par la pratique d'une exacte vertu. Dans le monde fait comme il est, la réputation la plus brillante, la plus étendue, et la plus utile, s'accorde moins à la vraie sagesse, qu'aux richesses et qu'aux dignités, qu'aux grands talents, qu'à la supériorité d'esprit, qu'à la profonde érudition. Que dis-je ? un homme de bien se procure-t-il une estime aussi vaste et aussi avantageuse, qu'un homme poli, complaisant, badin, qu'un fin railleur, qu'un aimable étourdi, qu'un agréable débauché ? Quelle utîle réputation, par exemple, la plus parfaite vertu s'attire-t-elle, lorsqu'elle a pour compagne la pauvreté et la bassesse ? Quand par une espèce de miracle, elle perce les ténèbres épaisses qui l'accablent, sa lumière frappe-t-elle les yeux de la multitude ? Echauffe-t-elle les cœurs des hommes, et les attire-t-elle vers un mérite si digne d'admiration ? Nullement. Ce pauvre est un homme de bien ; on se contente de lui rendre cette justice en très-peu de mots, et on le laisse jouir tranquillement des avantages faibles et peu enviés qu'il peut tirer de son faible et stérîle mérite. Il est vrai que ceux qui ont quelque vertu, préserveront un tel homme de l'affreuse indigence ; ils le soutiendront par de modiques bienfaits : mais lui donneront-ils des marques éclatantes de leur estime ? se lieront-ils avec lui par les nœuds d'une amitié que la vertu peut rendre féconde en plaisirs purs et solides ? Ce sont-là des phénomènes qui ne frappent guère nos yeux. Virtus laudatur et alget. On accorde à la vertu quelques louanges vagues ; et presque toujours on la laisse croupir dans la misere. Si dans les tristes circonstances où elle se trouve, elle cherche du secours dans son propre sein ; il faut que par des nœuds indissolubles elle se lie à la religion, qui seule peut lui ouvrir une source inépuisable de satisfactions vives et pures.
Je vais plus loin. Je veux bien supposer les hommes assez sages pour accorder l'estime la plus utîle à ce qui s'offre à leur esprit sous l'idée de la vertu. Mais cette idée est-elle juste et claire chez la plupart des hommes ? Le contraire n'est que trop certain. Le grand nombre dont les suffrages décident d'une représentation, ne voit les objets qu'à-travers ses passions et ses préjugés. Mille fois le vice usurpe chez lui les droits de la vertu ; mille fois la vertu la plus pure s'offrant à son esprit sous le faux jour de la prévention, prend une forme desagréable et triste.
La véritable vertu est resserrée dans des bornes extrêmement étroites. Rien de plus déterminé et de plus fixé qu'elle par les règles que la raison lui prescrit. A droite et à gauche de sa route ainsi limitée, se découvre le vice. Par-là elle est forcée de négliger mille moyens de briller et de plaire, et de s'exposer à paraitre souvent odieuse et méprisable. Elle met au nombre de ses devoirs la douceur, la politesse, la complaisance ; mais ces moyens assurés de gagner les cœurs des hommes, sont subordonnés à la justice ; ils deviennent vicieux dès qu'ils s'échappent de l'empire de cette vertu souveraine, qui seule est en droit de mettre à nos actions et à nos sentiments le sceau de l'honnête.
Il n'en est pas ainsi d'une fausse vertu : faite exprès pour la parade et pour servir le vice ingénieux, qui trouve son intérêt à se cacher sous ce voîle imposteur, elle peut s'arroger une liberté infiniment plus étendue, aucune règle inaltérable ne la gêne. Elle est la maîtresse de varier ses maximes et sa conduite selon ses intérêts, et de tendre toujours sans la moindre contrainte vers les récompenses que la gloire lui montre. Il ne s'agit pas pour elle de mériter la réputation, mais de la gagner de quelque manière que ce sait. Rien ne l'empêche de se prêter aux faiblesses de l'esprit humain. Tout lui est bon, pourvu qu'elle aille à ses fins. Est-il nécessaire pour y parvenir, de respecter les erreurs populaires, de plier sa raison aux opinions favorites de la mode, de changer avec elle de parti, de se prêter aux circonstances et aux préventions publiques ? ces efforts ne lui coutent rien, elle veut être admirée ; et pourvu qu'elle réussisse, tous les moyens lui sont égaux.
Mais combien ces vérités deviennent-elles plus sensibles, lorsqu'on fait attention que les richesses et les dignités procurent plus universellement l'estime populaire, que la vertu même ! Il n'y a point d'infamie qu'elles n'effacent et qu'elles ne couvrent. Leur éclat tentera toujours fortement un homme que l'on suppose sans autre principe que celui de la vanité, en lui présentant l'appât flatteur de pouvoir s'enrichir aisément par ses injustices secrètes ; appât si attrayant, qu'en lui donnant les moyens de gagner l'estime extérieure du public, il lui procure en même temps la facilité de satisfaire ses autres passions, et légitime pour ainsi dire les manœuvres secrètes, dont la découverte incertaine ne peut jamais produire qu'un effet passager, promptement oublié, et toujours réparé par l'éclat des richesses. Car qui ne sait que le commun des hommes (& c'est ce dont il est uniquement question dans cette controverse) se laisse tyranniser par l'opinion ou l'estime populaire ? et qui ignore que l'estime populaire est inséparablement attachée aux richesses et au pouvoir ? Il est vrai qu'une classe peu nombreuse de personnes que leurs vertus et leurs lumières tirent de la foule, oseront lui marquer tout le mépris dont il est digne ; mais il suit noblement ses principes, l'idée qu'elles auront de son caractère ne troublera ni son repos ni ses plaisirs : ce sont de petits génies, indignes de son attention. D'ailleurs le mépris de ce petit nombre de sages et de vertueux peuvent-ils balancer les respects et les soumissions dont il sera environné, les marques extérieures d'une estime véritable que la multitude lui prodiguera ? Il arrivera même qu'un usage un peu généreux qu'il fera de ses trésors mal acquis, les lui fera adjuger par le vulgaire, et surtout par ceux avec qui il partagera le revenu de ses fourberies.
Après bien des détours, M. Bayle est comme forcé de convenir que l'athéisme tend par sa nature à la destruction de la société ; mais à chaque pas qu'il cede, il se fait un nouveau retranchement. Il prétend donc qu'encore que les principes de l'athéisme puissent tendre au bouleversement de la société, ils ne la ruineraient cependant pas, parce que les hommes n'agissent pas conséquemment à leurs principes, et ne règlent pas leur vie sur leurs opinions. Il avoue que la chose est étrange ; mais il soutient qu'elle n'en est pas moins vraie, et il en appelle pour le fait aux observations du genre humain. " Si cela n'était pas, dit-il, comment serait-il possible que les Chrétiens, qui connaissent si clairement par une révélation soutenue de tant de miracles, qu'il faut renoncer au vice pour être éternellement heureux et pour n'être pas éternellement malheureux ; qui ont tant d'excellents prédicateurs, tant de directeurs de conscience, tant de livres de dévotion ; comment serait-il possible parmi tout cela que les Chrétiens vécussent, comme ils font, dans les plus énormes dérèglements du vice " ? Dans un autre endroit, en parlant de ce contraste, voici ce qu'il dit : " Cicéron l'a remarqué à l'égard de plusieurs Epicuriens qui étaient bons amis, honnêtes gens, et d'une conduite accommodée, non pas aux désirs de la volupté, mais aux règles de la raison ". Ils vivent mieux, dit-il, qu'ils ne parlent ; au lieu que les autres parlent mieux qu'ils ne vivent. On a fait une semblable remarque sur la conduite des Stoïciens : leurs principes étaient que toutes choses arrivent par une fatalité si inévitable, que Dieu lui-même ne peut ni n'a jamais pu l'éviter. " Naturellement cela devait les conduire à ne s'exciter à rien, à n'user jamais ni d'exhortations, ni de menaces, ni de censures, ni de promesses ; cependant il n'y a jamais eu de philosophes qui se soient servis de tout cela plus qu'eux, et toute leur conduite faisait voir qu'ils se croyaient entièrement les maîtres de leur destinée ". De ces différents exemples M. Bayle conclut que la religion n'est point aussi utîle pour réprimer le vice qu'on le prétend, et que l'athéisme ne cause point le mal que l'on s'imagine, par l'encouragement qu'il donne à la pratique du vice, puisque de part et d'autre on agit d'une manière contraire aux principes que l'on fait profession de croire. Il serait infini, ajoute-t-il, de parcourir toutes les bizarreries de l'homme ; c'est un monstre plus monstrueux que les centaures et la chimère de la fable.
A entendre M. Bayle, l'on serait tenté de supposer avec lui quelqu'obscurité mystérieuse dans une conduite si extraordinaire, et de croire qu'il y aurait dans l'homme quelque principe bizarre qui le disposerait, sans savoir comment, à agir contre ses opinions, quelles qu'elles fussent. C'est ce qu'il doit nécessairement supposer, ou ce qu'il dit ne prouve rien de ce qu'il veut prouver. Mais si ce principe, quel qu'il sait, loin de porter l'homme à agir constamment d'une manière contraire à sa créance, le pousse quelquefois avec violence à agir conformément à ses opinions ; ce principe ne favorise en rien l'argument de M. Bayle. Si, même après y avoir pensé, l'on trouve que ce principe si mystérieux et si bizarre n'est autre chose que les passions irrégulières et les désirs dépravés de l'homme, alors bien loin de favoriser l'argument de M. Bayle, il est directement opposé à ce qu'il soutient : or c'est-là le cas, et heureusement M. Bayle ne saurait s'empêcher d'en faire l'aveu ; car quoiqu'il affecte communément de donner à la perversité de la conduite des hommes en ce point, un air d'incompréhensibilité, pour cacher le sophisme de son argument, cependant lorsqu'il n'est plus sur ses gardes il avoue et déclare naturellement les raisons d'une conduite si extraordinaire. " L'idée générale, dit-il, veut qu'un homme qui croit un Dieu, un paradis et un enfer, fasse tout ce qu'il connait être agréable à Dieu, et ne fasse rien de ce qu'il sait lui être desagréable. Mais la vie de cet homme nous montre qu'il fait tout le contraire. Voulez-vous savoir la cause de cette incongruité ? la voici. C'est que l'homme ne se détermine pas à une certaine action plutôt qu'à une autre, par les connaissances générales qu'il a de ce qu'il doit faire, mais par le jugement particulier qu'il porte de chaque chose, lorsqu'il est sur le point d'agir. Or ce jugement particulier peut bien être conforme aux idées générales que l'on a de ce qu'on doit faire, mais le plus souvent il ne l'est pas. Il s'accommode presque toujours à la passion dominante du cœur, à la pente du tempérament, à la force des habitudes contractées, et au goût ou à la sensibilité qu'on a pour de certains objets. " Si c'est-là le cas, comme ce l'est en effet, on doit nécessairement tirer de ce principe une conséquence directement contraire à celle qu'en tire M. Bayle ; que si les hommes n'agissent pas conformément à leurs opinions, et que l'irrégularité des passions et des désirs soit la cause de cette perversité, il s'ensuivra à la vérité qu'un théiste religieux agira souvent contre ses principes, mais qu'un athée agira conformément aux siens, parce qu'un athée et un théiste satisfont leurs passions vicieuses, le premier en suivant ses principes, et le second en agissant d'une manière qui y est opposée. Ce n'est donc que par accident que les hommes agissent contre leurs principes, seulement lorsque leurs principes se trouvent en opposition avec leurs passions. On voit par-là toute la faiblesse de l'argument de M. Bayle, lorsqu'il est dépouillé de la pompe de l'éloquence et de l'obscurité qu'y jettent l'abondance de ses discours, le faux éclat de ses raisonnements captieux, et la malignité de ses réflexions.
Il est encore d'autres cas que ceux des principes combattus par les passions, où l'homme agit contre ses opinions ; et c'est lorsque ses opinions choquent les sentiments communs du genre humain, comme le fatalisme des Stoïciens, et la prédestination de quelques sectes chrétiennes : mais l'on ne peut tirer de ces exemples aucun argument pour soutenir et justifier la doctrine de M. Bayle. Ce subtil controversiste en fait néanmoins usage, en insinuant qu'un athée qui nie l'existence de Dieu, agira aussi peu conformément à son principe, que le fataliste qui nie la liberté, et qui agit toujours comme s'il la croyait. Le cas est différent. Que l'on applique aux fatalistes la raison que M. Bayle assigne lui-même pour la contrariété qu'on observe entre les opinions et les actions des hommes, on reconnaitra qu'un fataliste qui croit en Dieu, ne saurait se servir de ses principes pour autoriser ses passions ; car quoiqu'en niant la liberté il en doive naturellement résulter que les actions n'ont aucun mérite, néanmoins le fataliste reconnaissant un Dieu qui récompense et qui punit les hommes, comme s'il y avait du mérite dans les actions, il agit aussi comme s'il y en avait réellement. Otez au fataliste la créance d'un Dieu, rien alors ne l'empêchera d'agir conformément à son opinion ; en sorte que bien loin de conclure de son exemple que la conduite d'un athée démentira ses opinions, il est au contraire évident que l'athéisme joint au fatalisme, réalisera dans la pratique les spéculations que l'idée seule du fatalisme n'a jamais pu faire passer jusque dans la conduite de ceux qui en ont soutenu le dogme.
Si l'argument de M. Bayle est vrai en quelque point, ce n'est qu'autant que son athée s'écarterait des notions superficielles et légères que cet auteur lui donne sur la nature de la vertu et des devoirs moraux. En ce point l'on convient que l'athée est encore plus porté que le théiste à agir contre ses opinions. Le théiste ne s'écarte de la vertu, qui, suivant ses principes, est le plus grand de tous les biens, que parce que ses passions l'empêchent, dans le moment de l'action, de considérer ce bien comme partie necessaire de son bonheur. Le conflit perpétuel qu'il y a entre sa raison et ses passions, produit celui qui se trouve entre sa conduite et ses principes. Ce conflit n'a point lieu chez l'athée ; ses principes le conduisent à conclure que les plaisirs sensuels sont le plus grand de tous les biens ; et ses passions, de concert avec des principes qu'elles chérissent, ne peuvent manquer de lui faire regarder ce bien comme partie nécessaire de son bonheur : motif dont la vérité ou l'illusion détermine nos actions. Si quelque chose est capable de s'opposer ce désordre, et de nous faire regarder la vertu comme partie nécessaire de notre bonheur, sera-ce l'idée innée de sa beauté ? sera-ce la contemplation encore plus abstraite de sa différence essentielle d'avec le vice ? réflexions qui sont les seules dont un athée puisse faire usage : ou ne sera-ce pas plutôt l'opinion que la pratique de la vertu, telle que la religion l'enseigne, est accompagnée d'une récompense infinie, et que celle du vice est accompagnée d'un châtiment également infini ? On peut observer ici que M. Bayle tombe en contradiction avec lui-même : là il voudrait faire accroire que le sentiment moral et la différence essentielle des choses suffisent pour rendre les hommes vertueux ; et ici il prétend que ces deux motifs réunis, et soutenus de celui d'une providence qui récompense et qui punit, ne sont presque d'aucune efficacité.
Mais, dira M. Bayle, l'on ne doit pas s'imaginer qu'un athée, précisément parce qu'il est athée, et qu'il nie la providence, tournera en ridicule ce que les autres appellent vertu et honnêteté ; qu'il fera de faux serments pour la moindre chose ; qu'il se plongera dans toutes sortes de désordres ; que s'il se trouve dans un poste qui le mette au-dessus des lois humaines, aussi-bien qu'il s'est déjà mis au-dessus des remords de sa conscience, il n'y a point de crime qu'on ne doive attendre de lui ; qu'étant inaccessible à toutes les considérations qui retiennent un théiste, il deviendra nécessairement le plus grand et le plus incorrigible scélérat de l'univers. Si cela était vrai, il ne le serait que quand on regarde les choses dans leur idée, et qu'on fait des abstractions métaphysiques. Mais un tel raisonnement ne se trouve jamais conforme à l'expérience. L'athée n'agit pas autrement que le théiste, malgré la diversité de ses principes. Oubliant donc dans l'usage de la vie et dans le train de leur conduite, les conséquences de leur hypothèse, ils vont tous deux aux objets de leur inclination ; ils suivent leur gout, et ils se conforment aux idées qui peuvent flatter l'amour-propre : ils étudient, s'ils aiment la science ; ils préfèrent le sincérité à la fourberie, s'ils sentent plus de plaisir après avoir fait un acte de bonne-foi qu'après avoir dit un mensonge ; ils pratiquent la vertu, s'ils sont sensibles à la réputation d'honnête homme : mais si leur tempérament les pousse tous deux vers la débauche, et s'ils aiment mieux la volupté que l'approbation du public, ils s'abandonneront tous deux à leur penchant, le théiste comme l'athée. Si vous en doutez, jetez les yeux sur les nations qui ont différentes religions, et sur celles qui n'en ont pas, vous trouverez par-tout les mêmes passions : l'ambition, l'avarice, l'envie, le désir de se venger, l'impudicité et tous les crimes qui peuvent satisfaire les passions, sont de tous les pays et de tous les siècles. Le Juif et le Mahométan, le Turc et le More, le Chrétien et l'Infidèle, l'Indien et le Tartare, l'habitant de terre-ferme et l'habitant des iles, le noble et le roturier ; toutes ces sortes de gens qui sur la vertu ne conviennent, pour ainsi dire, que dans la notion générale du mot, sont si semblables à l'égard de leurs passions, que l'on dirait qu'ils se copient les uns les autres. D'où vient tout cela, sinon que le principe pratique des actions de l'homme n'est autre chose que le tempérament, l'inclination naturelle pour le plaisir, le goût que l'on contracte pour certains objets, le désir de plaire à quelqu'un, une habitude qu'on s'est formée dans le commerce de ses amis, ou quelqu'autre disposition qui résulte du fond de la nature en quelque pays que l'on naisse, et de quelques connaissances que l'on nous remplisse l'esprit ? Les maximes que l'on a dans l'esprit laissent les sentiments du cœur dans une parfaite indépendance : la seule cause qui donne la forme à la différente conduite des hommes, sont les différents degrés d'un tempérament heureux ou malheureux, qui nait avec nous, et qui est l'effet physique de la constitution de nos corps. Conformément à cette vérité d'expérience, il peut se faire qu'un athée vienne au monde avec une inclination naturelle pour la justice et pour l'équité, tandis qu'un théiste entrera dans la société humaine accompagné de la dureté, de la malice et de la fourberie. D'ailleurs, presque tous les hommes naissent avec plus ou moins de respect pour les vertus qui lient la société : n'importe d'où puisse venir cette utîle disposition du cœur humain ; elle lui est essentielle : un certain degré d'amour pour les autres hommes nous est naturel, tout comme l'amour souverain que nous avons chacun pour nous-mêmes : de-là vient que quand même un athée, pour se conformer à ses principes, tenterait de pousser la scélératesse jusqu'aux derniers excès, il trouverait dans le fond de sa nature quelques semences de vertu, et les cris d'une conscience qui l'effrayerait, qui l'arrêterait, et qui ferait échouer ses pernicieux desseins.
Pour répondre à cette objection qui tire un air éblouissant de la manière dont M. Bayle l'a proposée en divers endroits de ses ouvrages, j'avouerai d'abord que le tempérament de l'homme est pour lui une féconde source de motifs, et qu'il a une influence très-étendue sur toute sa conduite. Mais ce tempérament forme-t-il seul notre caractère ? détermine-t-il tous les actes de notre volonté ? sommes-nous absolument inflexibles à tous les motifs qui nous viennent de dehors ? nos opinions vraies ou fausses, sont-elles incapables de rien gagner sur nos penchants naturels ? Rien au monde n'est plus évidemment faux ; et pour le soutenir il faut n'avoir jamais démêlé les ressorts de sa propre conduite. Nous sentons tous les jours que la réflexion sur un intérêt considérable nous fait agir directement contre les motifs qui sortent du fond de notre nature. Une sage éducation ne fait pas toujours tout l'effet qu'on pourrait s'en promettre : mais il est rare qu'elle soit absolument infructueuse. Supposons dans deux hommes le même degré d'un certain tempérament et de génie : il est sur que le même caractère éclatera dans toute leur conduite ? L'un n'aura eu d'autre guide que son naturel ; son esprit assoupi dans l'inaction, n'aura jamais opposé la moindre réflexion à la violence de ses penchants ; toutes les habitudes vicieuses dérivées de son tempérament, auront le loisir de se former ; elles auront asservi sa raison pour jamais. L'autre, au contraire, aura appris dès l'âge le plus tendre à cultiver son bon sens naturel ; on lui aura rendu familiers des principes de vertu et d'honneur ; on aura fortifié dans son âme la sensibilité pour le prochain, de laquelle les semences y ont été placées par la nature ; on l'aura formé à l'habitude de réfléchir sur lui-même, et de résister à ses penchants impérieux : ces deux personnes seront-elles nécessairement les mêmes ? Cette idée peut-elle entrer dans l'esprit d'un homme judicieux ? Il est vrai qu'un trop grand nombre d'hommes ne démentent que trop souvent dans leur conduite le sentiment légitime de leurs principes, pour s'asservir à la tyrannie de leurs passions : mais ces mêmes hommes n'ont pas dans toutes les occasions une conduite également inconséquente ; leur tempérament n'est pas toujours excité avec la même violence. Si un tel degré de passion détourne leur attention de la lumière de leurs principes, cette passion moins animée, moins fougueuse, peut céder à la force de la réflexion, quand elle offre un intérêt plus grand que celui qui nous est promis par nos penchans. Notre tempérament a sa force, et nos principes ont la leur ; selon que ces forces sont plus ou moins grandes de côté et d'autre, notre conduite varie. Un homme qui n'a point de principes opposés à ses penchans, ou qui n'en a que de très-foibles, tel que l'athée, suivra toujours indubitablement ce que lui dicte son naturel ; et un homme dont le tempérament est combattu par les lumières fausses ou véritables de son esprit, doit être souvent en état de prendre le parti de ses idées contre les intérêts de ses penchans. Les récompenses et les peines d'une autre vie sont un contrepoids salutaire, sans lequel bien des gens auraient été entrainés dans l'habitude du vice par un tempérament qui se serait fortifié tous les jours. Souvent la religion fait plier sous elle le naturel le plus impérieux, et conduit peu à peu son heureux prosélyte à l'habitude de la vertu.
Les législateurs étaient si persuadés de l'influence de la religion sur les bonnes mœurs, qu'ils ont tous mis à la tête des lois qu'ils ont faites, les dogmes de la providence et d'un état futur. M. Bayle, le coryphée des incrédules, en convient en termes exprès. " Toutes les religions du monde, dit-il, tant la vraie que les fausses, roulent sur ce grand pivot ; qu'il y a un juge invisible qui punit et qui récompense après cette vie les actions de l'homme, tant intérieures qu'extérieures : c'est de-là qu'on suppose que découle la principale utilité de la religion ". M. Bayle croit que l'utilité de ce dogme est si grande, que dans l'hypothèse où la religion eut été une invention politique, c'eut été, selon lui, le principal motif qui eut animé ceux qui l'auraient inventée.
Les poètes grecs les plus anciens, Musée, Orphée, Homère, Hesiode, etc. qui ont donné des systèmes de théologie et de religion conformes aux idées et aux opinions populaires de leur temps, ont tous établi le dogme des peines et des récompenses futures comme un article fondamental. Tous leurs successeurs ont suivi le même plan ; tous ont rendu témoignage à ce dogme important : on en peut voir la preuve dans les ouvrages d'Eschyle, de Sophocle, d'Euripide et d'Aristophane, dont la profession était de peindre les mœurs de toutes les nations policées, grecques ou barbares ; et cette preuve se trouve perpétuée dans les écrits de tous les historiens et de tous les philosophes.
Plutarque, remarquable par l'étendue de ses connaissances, a sur ce sujet un passage digne d'être rapporté. " Jettez les yeux, dit-il dans son traité contre l'épicurien Colotès, " sur toute la face de la terre ; vous y pourrez trouver des villes sans fortification, sans lettres, sans magistrats réguliers, sans habitations distinctes, sans professions fixes, sans propriété, sans l'usage des monnaies, et dans l'ignorance universelle des beaux arts : mais vous ne trouverez nulle part une ville sans la connaissance d'un dieu ou d'une religion, sans l'usage des vœux, des serments, des oracles, sans sacrifices pour se procurer des biens, ou sans rits déprécatoires pour détourner les maux ". Dans sa consolation à Apollonius, il déclare que l'opinion que les hommes vertueux seront récompensés après leur mort, est si ancienne, qu'il n'a jamais pu en découvrir ni l'auteur, ni l'origine. Ciceron et Seneque avaient déclaré la même chose avant lui. Sextus Empiricus voulant détruire la démonstration de l'existence de Dieu, fondée sur le consentement universel de tous les hommes, observe que ce genre d'argument prouverait trop, parce qu'il prouverait également la vérité de l'enfer fabuleux des poètes.
Quelque diversité qu'il y eut dans les opinions des Philosophes, quels que fussent les principes de politique que suivit un historien, quelque système qu'un philosophe eut adopté ; la nécessité de ce dogme général, je veux dire des peines et des récompenses d'une autre vie, était un principe fixe et constant, qu'on ne s'avisait point de révoquer en doute. Le partisan du pouvoir arbitraire regardait cette opinion comme le lien le plus fort d'une obéissance aveugle ; le défenseur de la liberté civîle l'envisageait comme une source féconde de vertus et un encouragement à l'amour de la patrie ; et quoique son utilité eut dû être une preuve invincible de la divinité de son origine, le philosophe athée en concluait au contraire qu'elle était une invention de la politique ; comme si le vrai et l'utîle n'avaient pas nécessairement un point de réunion, et que le vrai ne produisit pas l'utile, comme l'utîle produit le vrai. Quand je dis l'utile, j'entends l'utilité générale et j'exclus l'utilité particulière toutes les fois qu'elle se trouve en opposition avec l'utilité générale. C'est pour n'avoir pas fait cette distinction juste et nécessaire, que les sages de l'antiquité payenne, philosophes, ou législateurs, sont tombés dans l'erreur de mettre en opposition l'utîle et le vrai : et il en résulte que le philosophe négligeant l'utîle pour ne chercher que le vrai, a souvent manqué le vrai ; et que le législateur au contraire négligeant le vrai pour n'aller qu'à l'utile, a souvent manqué l'utile.
Mais pour revenir à l'utilité du dogme des peines et des récompenses d'une autre vie, et pour faire voir combien l'antiquité a été unanime sur ce point, je vais transcrire quelques passages qui confirment ce que j'avance. Le premier est de Timée le Locrien, un des plus anciens disciples de Pythagore, homme d'état, et qui suivant l'opinion de Platon, était consommé dans les connaissances de la Philosophie. Timée après avoir fait voir de quel usage est la science de la Morale pour conduire au bonheur un esprit naturellement bien disposé, en lui faisant connaître quelle est la mesure du juste et de l'injuste, ajoute que la société fut inventée pour retenir dans l'ordre des esprits moins raisonnables, par la crainte des lois et de la religion. " C'est à l'égard de ceux-ci, dit-il, qu'il faut faire usage de la crainte des châtiments, soit ceux qu'infligent les lois civiles, ou ceux que fulminent les terreurs de la religion du haut du ciel et du fond des enfers ; châtiments sans fin, réservés aux ombres des malheureux ; tourments dont la tradition a perpétué l'idée, afin de purifier l'esprit de tout vice ".
Polybe nous fournira le second passage. Ce sage historien extrêmement versé dans la connaissance du genre humain, et dans celle de la nature des sociétés civiles ; qui fut chargé de l'auguste emploi de composer des lois pour la Grèce, après qu'elle eut été réduite sous la puissance des Romains, s'exprime ainsi en parlant de Rome. " L'excellence supérieure de cette république éclate particulièrement dans les idées qui y règnent sur la providence des dieux. La superstition, qui en d'autres endroits ne produit que des abus et des désordres, y soutient au contraire et y anime toutes les branches du gouvernement, et rien ne peut surmonter la force avec laquelle elle agit sur les particulières et sur le public. Il me semble que ce puissant motif a été expressément imaginé pour le bien des états. S'il fallait à la vérité former le plan d'une société civîle qui fût entièrement composée d'hommes sages, ce genre d'institution ne serait peut-être pas nécessaire : mais puisqu'en tous lieux la multitude est volage, capricieuse, sujette à des passions irrégulières, et à des ressentiments violents et déraisonnables ; il n'y a pas d'autre moyen de la retenir dans l'ordre, que la terreur des châtiments futurs, et l'appareil pompeux qui accompagne cette sorte de fiction. C'est pourquoi les anciens me paraissent avoir agi avec beaucoup de jugement et de pénétration dans le choix des idées qu'ils ont inspirées au peuple concernant les dieux et un état futur ; et le siècle présent montre beaucoup d'indiscrétion et un grand manque de sens, lorsqu'il tâche d'effacer ces idées, qu'il encourage le peuple à les mépriser, et qu'il lui ôte le frein de la crainte. Qu'en résulte-t-il ? En Grèce, par exemple, pour ne parler que d'une seule nation, rien n'est capable d'engager ceux qui ont le maniement des deniers publics, à être fidèles à leurs engagements. Parmi les Romains au contraire, la seule religion rend la foi du serment un garant sur de l'honneur et de la probité de ceux à qui l'on confie les sommes les plus considérables, soit dans l'administration publique des affaires, soit dans les ambassades étrangères ; et tandis qu'il est rare en d'autres pays de trouver un homme intègre et désintéressé qui puisse s'abstenir de piller le public, chez les Romains rien n'est plus rare que de trouver quelqu'un coupable de ce crime ". Ce passage mérite l'attention la plus sérieuse. Polybe était grec ; et comme homme de bien, il aimait tendrement sa patrie, dont l'ancienne gloire et la vertu étaient alors sur leur déclin, dans le temps que la prospérité de la république romaine était à son comble. Pénétré du triste état de son pays, et observant les effets de l'influence de la religion sur l'esprit des Romains, il profite de cette occasion pour donner une leçon à ses compatriotes, et les instruire de ce qu'il regardait comme la cause principale de la ruine dont ils étaient menacés. Un certain libertinage d'esprit avait infecté les premiers hommes de l'état, et leur faisait penser et débiter, que les craintes qu'inspire la religion ne sont que des visions et des superstitions ; ils croyaient sans doute faire paraitre par-là plus de pénétration que leurs ancêtres, et se tirer du niveau du commun du peuple. Polybe les avertit qu'ils ne doivent pas chercher la cause de la décadence de la Grèce dans la mutabilité inévitable des choses humaines, mais qu'ils doivent l'attribuer à la corruption des mœurs introduite par le libertinage de l'esprit. Ce fut cette corruption qui affoiblit et qui énerva la Grèce, et qui l'avait, pour ainsi dire conquise ; en sorte que les Romains n'eurent qu'à en prendre possession.
Mais si Polybe eut vécu dans le siècle suivant, il aurait pu adresser la même leçon aux Romains. L'esprit de libertinage, funeste avant-coureur de la chute des états, fit parmi eux de grands progrès en peu de temps. La religion y dégénéra au point que César osa déclarer en plein sénat, avec une licence dont toute l'antiquité ne fournit point d'exemple, que l'opinion des peines et des récompenses d'une autre vie était une notion sans fondement. C'était-là un terrible pronostic de la ruine prochaine de la république.
L'esprit d'irreligion fait tous les jours des progrès ; il avance à pas de géant et gagne insensiblement tous les états et toutes les conditions. Les philosophes modernes, les esprits forts me permettront-ils de leur demander quel est le fruit qu'ils prétendent retirer de leur conduite ? Un d'eux, le célèbre comte de Shaftsbury, aussi fameux par son irreligion que par sa réputation de citoyen zélé, et dont l'idée était de substituer dans le gouvernement du monde la bienveillance à la créance d'un état futur, s'exprime ainsi dans son style extraordinaire. " La conscience même, j'entens, dit-il, celle qui est l'effet d'une discipline religieuse, ne sera sans la bienveillance qu'une misérable figure : elle pourra peut-être faire des prodiges parmi le vulgaire. Le diable et l'enfer peuvent faire effet sur des esprits de cet ordre, lorsque la prison et la potence ne peuvent rien : mais le caractère de ceux qui sont polis et bienveillans, est fort différent ; ils sont si éloignés de cette simplicité puérile, qu'au lieu de régler leur conduite dans la société par l'idée des peines et des récompenses futures, ils font voir évidemment par tout le cours de leur vie, qu'ils ne regardent ces notions pieuses que comme des contes propres à amuser les enfants et le vulgaire ". Je ne demanderai point où était la religion de ce citoyen zélé lorsqu'il parlait de la sorte, mais où étaient sa prudence et sa politique ; car s'il est vrai, comme il le dit, que le diable et l'enfer ont tant d'effet, lors même que la prison et la potence sont inefficaces, pourquoi donc cet homme qui aimait sa patrie, voulait-il ôter un frein si nécessaire pour retenir la multitude, et en restraindre les excès ? si ce n'était pas son dessein, pourquoi donc tourner la religion en ridicule ? Si son intention était de rendre tous les Anglais polis et bienveillans, il pouvait aussi-bien se proposer de les faire tous mylords.
Strabon dit qu'il est impossible de gouverner le commun du peuple par les principes de la Philosophie ; qu'on ne peut faire d'impression sur lui que par le moyen de la superstition, dont les fictions et les prodiges sont la base et le soutien ; que c'est pour cela que les législateurs ont fait usage de ce qu'enseigne la fable sur le tonnerre de Jupiter, l'égide de Minerve, le trident de Neptune, le thyrse de Bacchus, les serpens et les torches des Furies, et de tout le reste des fictions de l'ancienne théologie, comme d'un épouvantail propre à frapper de terreur les imaginations puériles de la multitude.
Pline le naturaliste reconnait qu'il est nécessaire pour le soutien de la société, que les hommes croient que les dieux interviennent dans les affaires du genre humain ; et que les châtiments dont ils punissent les coupables, quoique lents à cause de la diversité des soins qu'exige le gouvernement d'un si vaste univers, sont néanmoins certains, et qu'on ne peut s'y soustraire.
Pour ne point trop multiplier les citations, je finirai par rapporter le préambule des lois du philosophe Romain : comme il fait profession d'imiter Platon, qu'il en adopte les sentiments et souvent les expressions, nous connaitrons par-là ce que pensait ce philosophe sur l'influence de la religion par rapport à la société. " Les peuples avant tout doivent être fermement persuadés de la puissance et du gouvernement des dieux, qu'ils sont les souverains et les maîtres de l'univers, que tout est dirigé par leur pouvoir, leur volonté et leur providence, et que le genre humain leur a des obligations infinies. Ils doivent être persuadés que les dieux connaissent l'intérieur de chacun, ce qu'il fait, ce qu'il pense, avec quels sentiments, avec quelle piété il remplit les actes de religion, et qu'ils distinguent l'homme de bien d'avec le méchant. Si l'esprit est bien imbu de ces idées, il ne s'écartera jamais du vrai ni de l'utile. L'on ne saurait nier le bien qui résulte de ces opinions, si l'on fait réflexion à la stabilité que les serments mettent dans les affaires de la vie, et aux effets salutaires qui résultent de la nature sacrée des traités et des alliances. Combien de personnes ont été détournées du crime par la crainte des châtiments divins ! et combien pure et saine doit être la vertu qui règne dans une société, où les dieux immortels interviennent eux-mêmes comme juges et témoins " ! Voilà le préambule de la loi ; car c'est ainsi que Platon l'appele. Ensuite viennent les lois dont la première est conçue en ces termes : " Que ceux qui s'approchent des dieux soient purs et chastes ; qu'ils soient remplis de piété et exempts de l'ostentation des richesses. Quiconque fait autrement, Dieu lui-même s'en fera vengeance. Qu'un saint culte soit rendu aux dieux, à ceux qui ont été regardés comme habitants du ciel, et aux héros que leur mérite y a placés, comme Hercule, Bacchus, Esculape, Castor, Pollux, et Romulus. Que des temples soient édifiés en l'honneur des qualités qui ont élevé des mortels à ce degré de gloire, en l'honneur de la raison, de la vertu, de la piété et de la bonne foi ". A tous ces différents traits on reconnait le génie de l'antiquité, et particulièrement celui des législateurs, dont le soin était d'inspirer au peuple les sentiments de religion pour le bien de l'état même. L'établissement des mystères en est un autre exemple remarquable. Ce sujet important et curieux est amplement développé dans les dissertations sur l'union de la religion, de la morale, et de la politique, tirés par M. Silhouette d'un ouvrage de M. Warburton.
Enfin M. Bayle abandonne le raisonnement, qui est son fort : sa dernière ressource est d'avoir recours à l'expérience ; et c'est par-là qu'il prétend soutenir sa thèse, en faisant voir qu'il y a eu des athées qui ont vécu moralement bien, et que même il y a eu des peuples entiers qui se sont maintenus sans croire l'existence de Dieu. Suivant lui, la vie de plusieurs athées de l'antiquité prouve pleinement que leur principe n'entraîne pas nécessairement la corruption des mœurs ; il en allegue pour exemple Diagoras, Théodore, Evhemère, Nicanor et Hippon, philosophes, dont la vertu a paru si admirable à S. Clément d'Alexandrie, qu'il a voulu en décorer la religion et en faire autant de théistes, quoique l'antiquité les reconnaisse pour des athées décidés. Il descend ensuite à Epicure et à ses sectateurs, dont la conduite, de l'aveu de leurs ennemis, était irreprochable. Il cite Atticus, Cassius, et Pline le naturaliste. Enfin il finit cet illustre catalogue par l'éloge de la vertu de Vanini et de Spinosa. Ce n'est pas tout ; il cite des nations entières d'athées, que des voyageurs modernes ont découvertes dans le continent et dans les îles d'Afrique et de l'Amérique, et qui pour les mœurs l'emportent sur la plupart des idolâtres qui les environnent. Il est vrai que ces athées sont des sauvages, sans lais, sans magistrats, sans police civîle : mais de ces circonstances il en tire des raisons d'autant plus fortes en faveur de son sentiment ; car s'ils vivent paisiblement hors de la société civile, à plus forte raison le feraient-ils dans une société, où des lois générales empêcheraient les particuliers de commettre des injustices.
L'exemple des Philosophes qui, quoique athées, ont vécu moralement bien, ne prouve rien par rapport à l'influence que l'athéisme pent avoir sur les mœurs des hommes en général ; et c'est-là néanmoins le point dont il est question. En examinant les motifs différents qui engageaient ces philosophes à être vertueux, l'on verra que ces motif qui étaient particuliers à leur caractère, à leurs circonstances, à leur dessein, ne peuvent agir sur la totalité d'un peuple qui serait infecté de leurs principes. Les uns étaient portés à la vertu par le sentiment moral et la différence essentielle des choses, capables de faire un certain effet sur un petit nombre d'hommes studieux, contemplatifs, et qui joignent à un heureux naturel, un esprit délicat et subtil : mais ces motifs sont trop faibles pour déterminer le commun des hommes. Les autres agissaient par passion pour la gloire et la réputation : mais quoique tous les hommes ressentent cette passion dans un même degré de force, ils ne l'ont pas tous dans un même degré de délicatesse : la plupart s'embarrassent peu de la puiser dans des sources pures : plus sensibles aux marques extérieures de respect et de déférence qui l'accompagnent, qu'au plaisir intérieur de la mériter, ils marcheront par la voie la plus aisée et qui gênera le moins leurs autres passions, et cette voie n'est point celle de la vertu. Le nombre de ceux sur qui ces motifs sont capables d'agir est donc très-petit, comme Pomponace lui-même, qui était athée, en fait l'aveu. " Il y a, dit-il, quelques personnes d'un naturel si heureux, que la seule dignité de la vertu suffit pour les engager à la pratiquer, et la seule difformité du vice suffit pour le leur faire éviter. Que ces dispositions sont heureuses, mais qu'elles sont rares ! Il y a d'autres personnes dont l'esprit est moins héroïque, qui ne sont point insensibles à la dignité de la vertu ni à la bassesse du vice ; mais que ce motif seul, sans le secours des louanges et des honneurs, du mépris et de l'infamie, ne pourrait point entretenir dans la pratique de la vertu et dans l'éloignement du vice. Ceux-ci forment une seconde classe ; d'autres ne sont retenus dans l'ordre que par l'espérance de quelque bien réel ou par la crainte de quelque punition corporelle. Le législateur pour les engager à la pratique de la vertu, leur a présenté l'appât des richesses, des dignités, ou de quelqu'autre chose semblable ; et d'un autre côté il leur a montré des punitions, soit en leur personne, en leur bien, ou en leur honneur, pour les détourner du vice. Quelques autres d'un caractère plus féroce, plus vicieux, plus intraitable, ne peuvent être retenus par aucuns de ces motifs. A l'égard de ces derniers, le législateur a inventé le dogme d'une autre vie, où la vertu doit recevoir des récompenses éternelles, et où le vice doit subir des châtiments qui n'auront point de fin ; deux motifs dont le dernier a beaucoup plus de force sur l'esprit des hommes, que le premier. Plus instruit par l'expérience de la nature des maux que de celle des biens, on est plutôt déterminé par la crainte que par l'espérance. Le législateur prudent et attentif au bien public, ayant observé d'une part le penchant de l'homme vers le mal, et de l'autre côté, combien l'idée d'une autre vie peut être utîle à tous les hommes, de quelque condition qu'ils soient, a établi le dogme de l'immortalité de l'âme, moins occupé du vrai que de l'utile, et de ce qui pouvait conduire les hommes à la pratique de la vertu : et l'on ne doit pas le blâmer de cette politique ; car de même qu'un médecin trompe un malade afin de lui rendre la santé, de même l'homme d'état inventa des apologues ou des fictions utiles pour servir à la correction des mœurs. Si tous les hommes à la vérité étaient de la première classe, quoiqu'ils crussent leur âme mortelle, ils rempliraient tous leurs devoirs : mais comme il n'y en a presque pas de ce caractère, il a été nécessaire d'avoir recours à quelqu'autre expédient ".
Les autres motifs étaient bornés à leur secte ; c'était l'envie d'en soutenir l'honneur et le crédit, et de tâcher de l'annoblir par ce faux lustre. Il est étonnant jusqu'à quel point ils étaient préoccupés et possédés de ce désir. L'histoire de la conversation de Pompée et de Possidonius le stoïque, qui est rapportée dans les Tusculanes de Cicéron, en est un exemple bien remarquable : ô douleur, disait ce philosophe malade et souffrant ! tes efforts sont vains ; tu peux être incommode, jamais je n'avouerai que tu sois un mal. Si la crainte de se rendre ridicule en désavouant ses principes, peut engager des hommes à se faire une si grande violence, la crainte de se rendre généralement odieux n'a pas été un motif moins puissant pour les engager à la pratique de la vertu. Cardan lui-même reconnait que l'athéisme tend malheureusement à rendre ceux qui en sont les partisans, l'objet de l'exécration publique. De plus le soin de leur propre conservation les y engageait ; le magistrat avait beaucoup d'indulgence pour les spéculations philosophiques : mais l'athéisme étant en général regardé comme tendant à renverser la société, souvent il déployait toute sa vigueur contre ceux qui voulaient l'établir ; en sorte qu'ils n'avaient d'autre moyen de désarmer sa vengeance, que de persuader par une vie exemplaire, que ce principe n'avait point en lui-même une influence si funeste. Mais ces motifs étant particuliers aux sectes des philosophes, qu'ont ils de commun avec le reste des hommes ?
A l'égard des nations de sauvages athées, qui vivent dans l'état de la nature sans société civile, avec plus de vertu que les idolatres qui les environnent ; sans vouloir révoquer ce fait en doute, il suffira d'observer la nature d'une telle société, pour démasquer le sophisme de cet argument.
Il est certain que dans l'état de la société, les hommes sont constamment portés à enfraindre les lais. Pour y remédier, la société est constamment occupée à soutenir et à augmenter la force et la vigueur de ses ordonnances. Si l'on cherche la cause de cette perversité, on trouvera qu'il n'y en a point d'autre que le nombre et la violence des désirs qui naissent de nos besoins réels et imaginaires. Nos besoins réels sont nécessairement et invariablement les mêmes, extrêmement bornés en nombre, extrêmement aisés à satisfaire. Nos besoins imaginaires sont infinis, sans mesure, sans règle, augmentant exactement dans la même proportion qu'augmentent les différents arts. Or ces différents arts doivent leur origine à la société civîle : plus la police y est parfaite, plus ces arts sont cultivés et perfectionnés, plus on a de nouveaux besoins et d'ardents désirs ; et la violence de ces désirs qui ont pour objet de satisfaire des besoins imaginaires, est beaucoup plus forte que celle des désirs fondés sur les besoins réels, non-seulement parce que les premiers sont en plus grand nombre, ce qui fournit aux passions un exercice continuel ; non-seulement parce qu'ils sont plus déraisonnables, ce qui en rend la satisfaction plus difficile, et que n'étant point naturels, ils sont sans mesure : mais principalement parce qu'une coutume vicieuse a attaché à la satisfaction de ses besoins, une espèce d'honneur et de réputation, qui n'est point attachée à la satisfaction des besoins réels. C'est en conséquence de ces principes que nous disons que toutes les précautions dont la prévoyance humaine est capable, ne sont point suffisantes par elles-mêmes pour maintenir l'état de la société, et qu'il a été nécessaire d'avoir recours à quelqu'autre moyen. Mais dans l'état de nature où l'on ignore les arts ordinaires, les besoins des hommes réels sont en petit nombre, et il est aisé de les satisfaire : la nourriture et l'habillement sont tout ce qui est nécessaire au soutien de la vie ; et la Providence a abondamment pourvu à ces besoins ; en sorte qu'il ne doit y avoir guère de dispute, puisqu'il se trouve presque toujours une abondance plus que suffisante pour satisfaire tout le monde.
Par-là on peut voir clairement comment il est possible que cette canaille d'athées, s'il est permis de se servir de cette expression, vive paisiblement dans l'état de nature ; et pourquoi la force des lois humaines ne pourrait pas retenir dans l'ordre et le devoir une société civîle d'athées. Le sophisme de M. Bayle se découvre de lui-même. Il n'a pas soutenu ni n'aurait voulu soutenir que ces athées, qui vivent paisiblement dans leur état présent, sans le frein des lois humaines, vivraient de même sans le secours des lais, après qu'il auraient appris les différents arts, qui sont en usage parmi les nations civilisées ; il ne nierait pas sans doute que dans la société civile, qui est cultivée par les arts, le frein des lois est absolument nécessaire. Or voici les questions qu'il est naturel de lui faire. Si un peuple peut vivre paisiblement hors de la société civîle sans le frein des lais, mais ne saurait sans ce frein vivre paisiblement dans l'état de société : quelle raison avez-vous de prétendre que, quoiqu'il puisse vivre paisiblement hors de la société sans le frein de la religion, ce frein ne devienne pas nécessaire dans l'état de société ? La réponse à cette question entraîne nécessairement l'examen de la force du frein qu'il faut imposer à l'homme qui vit en société : or nous avons prouvé qu'outre le frein des lois humaines, il fallait encore celui de la religion.
On peut observer qu'il règne un artifice uniforme dans tous les sophismes dont M. Bayle fait usage pour soutenir son paradoxe. Sa thèse était de prouver que l'athéisme n'est pas pernicieux à la société ; et pour le prouver, il cite des exemples. Mais quels exemples ? De sophistes, ou de sauvages, d'un petit nombre d'hommes spéculatifs fort au-dessous de ceux qui dans un état forment le corps des citoyens, ou d'une troupe de barbares et de sauvages infiniment au-dessous d'eux, dont les besoins bornés ne réveillent point les passions ; des exemples, en un mot, dont on ne peut rien conclure, par rapport au commun des hommes, et à ceux d'entr'eux qui vivent en société. Voyez les dissertations de l'union de la religion, de la morale et de la politique de M. Warbuton, d'où sont extraits la plupart des raisonnements qu'on fait contre ce paradoxe de M. Bayle. Lisez l'article du POLYTHEISME, où l'on examine quelques difficultés de cet auteur. (X)
ATHÉES
- Détails
- Écrit par Claude Yvon (X)
- Catégorie parente: Science
- Catégorie : Métaphysique
- Affichages : 3990