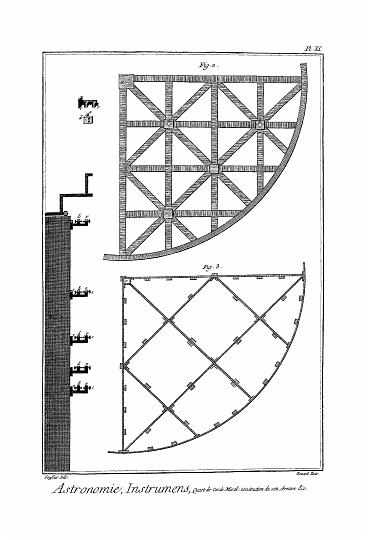S. m. (Métaphysique) la notion métaphysique de l'ordre consiste dans le rapport ou la ressemblance qu'il y a, soit dans l'arrangement de plusieurs choses coexistentes, soit dans la suite de plusieurs choses successives. Comment prouverait-on, par exemple, qu'Euclide a mis de l'ordre dans les éléments de Géométrie ? Il suffit de montrer qu'il a toujours fait précéder ce dont l'intelligence est nécessaire, pour comprendre ce qui suit. Cette règle constante ayant déterminé la place de chaque définition et de chaque proposition, il en résulte une ressemblance entre la manière dont ces définitions et ces propositions coexistent, et se succedent l'une à l'autre.
Tout ordre détermine donc la place de chacune des choses qu'il comprend, et la manière dont cette place est déterminée, comprend la raison pourquoi telle place est assignée à chaque chose. Que l'ordre d'une bibliothéque soit chronologique, c'est-à-dire, que les livres se suivent conformément à la date de leur édition, aussi-tôt chacun a sa place marquée, et la raison de la place de l'un, contient celle de la place de l'autre.
Cette raison énoncée par une proposition s'appelle règle. Quand la raison suffisante d'un certain ordre est simple, la règle est unique ; quand elle peut se résoudre en d'autres, il en résulte pluralité de règles à observer. Si je me contente de ranger mes livres suivant leurs formes, cette règle unique dispose de la place de tous les volumes. Mais si je veux avoir égard aux formes, aux reliures, aux matières, à l'ordre des temps, voilà plusieurs règles qui concourent à déterminer la place de chaque livre. Dans ce dernier cas l'observation des règles les plus importantes doit précèder celle des moins considérables. Les règles qui doivent être observées ensemble, ne sauraient être en contradiction, parce qu'il ne saurait y avoir deux raisons suffisantes opposées d'une même détermination, qui soient de la même force. Il peut bien y avoir des contrariétés de règles, ou collisions qui produisent les exceptions ; mais dans ce cas, on sent toujours qu'une règle est plus étendue et plus forte que l'autre. Les règles ne doivent pas non plus se déterminer réciproquement ; car alors c'est un embarras superflu. Une règle qui est déjà supposée par une autre, reparait inutilement à part.
L'ordre qui est lié à l'essence des choses, et dont le changement détruirait cette essence, est un ordre nécessaire : celui dont les règles peuvent varier sans détriment essentiel, est contingent. L'ordre des côtés d'un triangle, ou de toute autre figure est un ordre nécessaire. Il n'en est pas de même de celui des livres d'un cabinet, des meubles d'un appartement. L'ordre qui y règne est contingent ; et plusieurs bibliothéques, appartements, jardins peuvent être rangés différemment, et se trouver dans un bon ordre.
Il y a défaut dans l'ordre, toutes les fois qu'une chose n'est pas à la place que les règles lui destinent. Mais si certaines choses sont susceptibles d'être rangées de diverses manières, ce qui est défaut dans un ordre, ne saurait être censé tel dans un autre ordre.
L'opposé de l'ordre, c'est la confusion, dans laquelle il n'y a ni ressemblance entre l'arrangement, les simultanés, et l'enchainure des successifs, ni règles qui déterminent les places.
Pour connaître un ordre, il faut être au fait des règles qui déterminent les places. Combien de gens se mêlent de juger du gouvernement d'un état, des opérations d'une compagnie, ou de telle autre manœuvre, et qui en jugent en aveugles, parce qu'ils ne connaissent point le plan secret, et les vues qui déterminent la place de chaque démarche, et la soumettent à un ordre caché, sans la connaissance duquel, telle circonstance, détachée de tout le système, peut paraitre extraordinaire, et même ridicule. Combien voit-on de gens dont l'audacieuse critique censure le plan physique ou moral de l'univers, et qui prétendent y trouver des désordres. Pour faire sentir ces désordres, qu'ils commencent par étaler la notion de l'ordre qui doit régner dans l'univers, et qu'ils démontrent que celle qu'ils ont conçue est la seule admissible. Et comment pourraient-ils le faire, ne connaissant qu'un petit coin de l'univers, dont ils ne voient même que l'écorce ? Celui-là seul qui est derrière le rideau, et qui connait les moindres ressorts de la vaste machine du monde, l'Etre suprême qui l'a formé, et qui le soutient, peut seul juger de l'ordre qui y règne.
Quand il reste des déterminations arbitraires qui laissent certaines choses sans place fixe, il y a un mélange d'ordre et de confusion, et l'un ou l'autre domine à proportion du nombre des places déterminées ou à déterminer.
Les choses qui n'ont aucune différence intrinséque peuvent changer de place entr'elles, sans que l'ordre soit altéré, au-lieu que celles qui différent intrinséquement ne sauraient être substituées l'une à l'autre. Quand on dérange une chambre, dans laquelle il n'y a, par exemple, qu'une douzaine de chaises pareilles, il n'est pas nécessaire que chaque chaise retourne précisément à la place où elle était. Mais si les meubles de cet appartement sont inégaux, qu'il y ait sopha, lit, ou telle autre pièce disproportionnée à d'autres, on ne saurait mettre le lit où était une chaise, etc.
C'est l'ordre qui distingue la veille du sommeil ; c'est que dans celui-ci tout se fait sans raison suffisante. Personne n'ignore les bizarres assemblages qui se forment dans nos songes. Nous changeons de lieu dans un instant. Une personne parait, disparait et reparait. Nous nous entretenons avec des morts, avec des inconnus, sans qu'il y ait aucune raison de toutes ces révolutions. En un mot, les contradictoires y ont lieu. Aussi la fin d'un songe n'a souvent aucun rapport avec le commencement ; et il en résulte que la succession de nos idées en songe, n'ayant point de ressemblance, la notion de l'ordre ne s'y trouve pas ; mais pendant la veille, chaque chose a sa raison suffisante ; la suite des idées et des mouvements se développe et s'exécute conformément aux lois de l'ordre établi dans l'univers, et la confusion ne s'y trouve jamais au point d'admettre la coexistence des choses contradictoires.
ORDRE, en Géométrie, se dit en parlant des lignes courbes, distinguées par le différent degré de leur équation. Les lignes droites, dont l'équation ne monte qu'au premier degré, composent le premier ordre ; les sections coniques, le second ordre, parce que leur équation monte au second degré, et ainsi des autres.
M. Newton a fait un ouvrage intitulé, énumération des lignes du troisième ordre. Voyez COURBE.
On se sert quelquefois du mot de degré au lieu de celui d'ordre : ainsi on dit une courbe ou une ligne du troisième degré, pour une ligne du troisième ordre. Voyez DEGRE, COURBE et GENRE.
Ordre s'emploie aussi en parlant des infinis et des infiniment petits ; ainsi on dit infini du second ordre, pour dire une quantité infinie par rapport à une autre qui est déjà infinie elle-même : infiniment petit du second ordre, pour dire une quantité infiniment petite par rapport à une autre qui est déjà infiniment petite elle-même, et ainsi de suite : sur quoi voyez INFINI et DIFFERENCIEL. On dit de même équation différencielle du premier, du second, etc. ordre, pour dire une équation où les différencielles sont du premier, du second ordre, etc. Voyez ÉQUATION. (O)
ORDRE, (Jurisprudence canon.) est le sixième des sacrements de l'Eglise catholique, qui donne un caractère particulier aux ecclésiastiques lorsqu'ils se consacrent au service de Dieu.
La tonsure cléricale n'est point un ordre, c'est seulement une préparation pour parvenir à se faire promouvoir aux ordres.
L'ordre a été institué par J. C. lorsqu'il dit à ses disciples : Sicut misit me pater, et ego mitto vos.... Insufflavit et dixit eis, accipite Spiritum Sanctum, etc. Joann. xx. Ve 21.
Mais comme J. C. et l'Eglise n'ont point donné à tous les clercs un pouvoir égal, il y a dans le clergé différents degrés que l'on nomme ordres ; et ces degrés sont ce qui compose la hiérarchie ecclésiastique.
Suivant l'usage de l'église latine, on distingue deux sortes d'ordres ; savoir les ordres mineurs ou moindres, et les ordres sacrés ou majeurs.
Les ordres mineurs ou moindres sont au nombre de quatre ; savoir l'office de portier, celui de lecteur, celui d'exorciste et celui d'acolythe.
Les ordres majeurs ou sacrés sont le soudiaconat, le diaconat et la prêtrise : l'épiscopat est encore un degré au-dessus de la prêtrise.
Les évêques reçoivent la plénitude du sacerdoce avec le caractère épiscopal, voyez CONSECRATION et EVEQUE. Ils sont aussi les seuls qui puissent donner à l'Eglise des ministres par le sacrement de l'ordre.
L'imposition des mains de l'évêque est la matière du sacrement de l'ordre ; la prière qui répond à l'imposition des mains en est la forme.
L'ordre imprime sur ceux qui le reçoivent un caractère indélébile, qui les rend ministres de J. C. et de son Eglise d'une manière irrévocable.
L'ordination d'un prêtre se fait par l'évêque, en mettant les deux mains sur la tête de l'ordinant, et en récitant sur lui des prières. Les prêtres qui sont présents lui imposent aussi les mains ; l'évêque lui met les ornements du sacerdoce ; il lui consacre les mains par dedans avec l'huîle des cathécumenes ; et après lui avoir fait toucher le calice plein de vin, et la patene avec le pain, il lui donne le pouvoir d'offrir le saint sacrifice. Le nouveau prêtre célèbre avec l'évêque ; après la communion l'évêque lui impose une seconde fois les mains, et lui donne le pouvoir de remettre les péchés.
Tous les prêtres reçoivent dans l'ordination le même pouvoir ; cependant ils n'en ont pas toujours l'exercice : ainsi un prêtre qui n'a point de bénéfice à charge d'ames, ne peut confesser et absoudre hors le cas de nécessité, sinon en vertu d'un pouvoir spécial de l'évêque.
Pour l'ordination d'un diacre, l'évêque met seulement la main sur la tête de l'ordinant, en disant recevez le Saint-Esprit ; ensuite il lui donne les ornements de son ordre, et le livre des Evangiles.
Il n'y a point d'imposition des mains pour le soudiaconat ; l'évêque donne seulement à l'ordinant le calice vide avec la patene, le revêt des ornements de son ordre, et lui donne le livre des épitres.
Ceux qui ont reçu les ordres sacrés ne peuvent plus se marier ; on accorde quelquefois des dispenses à ceux qui n'ont que le soudiaconat, mais ces exemples sont rares.
Les ordres mineurs se conférent sans imposition des mains, et seulement par la tradition de ce qui doit servir aux fonctions de l'ordinant ; ainsi l'évêque donne au portier les clés, au lecteur le livre de l'église, à l'exorciste le livre des exorcismes, à l'acolythe il fait toucher le chandelier, le cierge et les burettes.
Ceux qui ont reçu les ordres mineurs peuvent quitter l'état de cléricature et se marier sans dispense.
Le concîle de Trente exhorte les évêques à rétablir les fonctions des ordres mineurs, et à ne les faire remplir que par des clercs qui aient reçu l'ordre auquel elles sont attachées ; mais ce règlement n'a point eu d'exécution. Les fonctions des quatre ordres mineurs sont le plus souvent remplies par de simples clercs, ou même par des laïques revêtus d'habits ecclésiastiques ; de sorte qu'on ne regarde plus les ordres mineurs que comme une cérémonie nécessaire pour parvenir aux ordres supérieurs.
Il faut néanmoins excepter la fonction des exorcismes, laquelle par un usage établi depuis longtemps dans l'Eglise, est réservée aux prêtres, lesquels ne peuvent même exorciser les possédés du démon, sans un pouvoir spécial de l'évêque, parce qu'il est rare présentement qu'il y ait des possédés, et qu'il y a souvent de l'imposture de la part de ceux qui paraissent l'être.
L'ordination ne se réitère point, si ce n'est quand on doute si celui qui a conféré les ordres à un clerc, était véritablement évêque, ou bien s'il avait ordonné prêtre quelqu'un qui n'aurait point été baptisé ; dans ce dernier cas, on commence par donner le baptême, et ensuite tous les ordres inférieurs au sacerdoce.
Si l'évêque avait omis l'imposition des mains à l'imposition d'un prêtre ou d'un diacre, on ne réitère pas pour cela toute l'ordination ; mais il faut que celui qui a été ordonné suspende les fonctions de son ordre jusqu'à ce que la cérémonie omise ait été suppléée aux premiers quatre-temps. Mais si l'évêque avait omis de prononcer lui-même les prières qu'il doit dire, il faudrait réiterer l'ordination.
Celui qui a reçu les ordres d'un évêque excommunié, ne peut en faire les fonctions jusqu'à ce qu'il en ait obtenu la dispense.
Un évêque qui s'est démis de son évêché, sans renoncer à la dignité épiscopale, peut donner les ordres quand il en est prié par un autre évêque.
Il n'est pas permis à un évêque de donner les ordres hors de son diocese, même à ses diocésains, si ce n'est par la permission de l'ordinaire du lieu : celui qui ordonne autrement est suspens pour un an de la collation des ordres ; et celui qui a été ainsi ordonné, suspens de ses fonctions jusqu'à ce que l'évêque l'ait relevé de la suspense.
Suivant le droit canonique, l'évêque ordinaire d'un clerc pour l'ordination, est celui du diocese où il est né, ou dans le diocese duquel il a son domicîle ou un bénéfice.
Le concîle de Trente permet aussi à un évêque d'ordonner un clerc qui a demeuré 3 ans avec lui, pourvu qu'il lui confère aussitôt un bénéfice.
Mais les évêques de France, dans les assemblées du clergé de 1635 et 1665, sont convenus de n'ordonner sans démissoire, que les clercs originaires de leur diocese : ce qui s'observe assez exactement, quoiqu'il n'y ait pas de loi qui ait révoqué l'ancien usage.
Les religieux doivent être ordonnés par l'évêque du diocese où est leur monastère ; ce qui ne peut se faire néanmoins sans le consentement de leur supérieur régulier.
En l'absence de l'évêque, son vicaire général, et pendant la vacance de l'évêché, le chapitre de la cathédrale, peuvent donner des démissoires pour les ordres. Voyez DEMISSOIRE.
Le pape est en possession d'ordonner les clercs de quelque diocese que ce sait, sans le consentement de leur évêque.
Les ordres mineurs se peuvent donner tous les dimanches et fêtes ; mais les ordres majeurs ne se donnent qu'aux quatre-temps, le samedi saint, ou le samedi d'avant le dimanche de la Passion : les ordres majeurs ne peuvent être conférés en d'autres temps, si ce n'est par dispense du pape, ce qu'on appelle une dispense extra tempora.
Ceux qui ont reçu les ordres sacrés hors les temps prescrits par l'Eglise, sont suspens des fonctions de leur ordre jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une dispense du pape. L'évêque qui a ordonné hors les temps prescrits, est punissable pour cette contravention.
On observait autrefois des interstices entre chaque ordre mineur ; présentement dans la plupart des dioceses, l'évêque les donne tous quatre en un même jour, et même souvent en donnant la tonsure.
Pour ce qui est des ordres sacrés, il n'est pas permis d'en conférer deux en un même jour, ni en deux jours consécutifs ; l'évêque qui aurait ainsi ordonné un clerc, demeurerait suspens du droit de conférer les ordres, et le clerc suspens de ses fonctions, jusqu'à ce qu'ils aient été relevés de la suspense.
Ces règles ne furent pas observées par Photius, lequel dans le ix. siècle fut mis à la place du patriarche Ignace ; les évêques le firent passer en six jours par tous les degrés du sacerdoce. Le premier jour, on le fit moine, parce qu'alors l'état monachal faisait en Orient un degré de la hiérarchie ecclésiastique ; le second jour, on le fit lecteur ; le troisième, soudiacre, puis diacre, prêtre, et enfin patriarche.
On en usa de même pour Humbert, dauphin de Viennais, auquel Clément VI. donna tous les ordres sacrés en un même jour.
Pour être promu aux ordres il faut avoir les qualités nécessaires, telles que la vertu, la piété, la conduite régulière, la vocation ; il faut aussi n'être point irrégulier. Voyez IRREGULARITE.
Le concîle de Trente veut aussi que l'on ne donne les ordres mineurs qu'à ceux qui entendent le latin, et dont les progrès font espérer qu'ils se rendront dignes des ordres supérieurs.
Quant à l'âge nécessaire, en France les évêques ne donnent les ordres mineurs qu'à ceux qui ont 18 ou 19 ans ; l'âge fixé pour le soudiaconat est de 22 ans commencés, pour le diaconat 23, et pour la prêtrise 24 ans commencés ; le pape accorde quelquefois des dispenses d'âge. Celui qui serait ordonné avant l'âge nécessaire sans dispense, serait suspens des fonctions de son ordre jusqu'à ce qu'il eut l'âge légitime.
Avant d'admettre un clerc aux ordres, on lui fait subir un examen sur les choses qu'il doit savoir, selon son âge et le degré auquel il aspire.
On observe aussi en France d'obliger les clercs de demeurer quelque temps au séminaire avant de se présenter à l'ordination.
Il est d'usage de publier au prône de la paraisse, le nom de celui qui se présente pour les ordres sacrés, et l'on ordonne à ceux qui y sauraient quelque empêchement de le venir déclarer.
Autrefois on n'ordonnait aucun clerc sans lui donner un titre ; présentement pour les ordres sacrés il faut que l'ordinant ait un bénéfice ou un titre clérical. Voyez TITRE CLERICAL.
L'évêque donne à celui qui est ordonné des lettres d'ordres ou ordination, signées de lui ; et l'on tient registre de ces lettres.
Il y a des bénéfices qui requièrent dans le titulaire un certain ordre, comme de diaconat ou de prêtrise ; l'ordre peut être requis à lege ou à fundatione, voyez BENEFICE. Voyez la collection des conciles, les mémoires du clergé, les lois ecclésiastiques d 'Hericourt. (A)
ORDRE, (Jurisprudence) qu'on appelle état en Normandie, est un jugement qui fixe le rang dans lequel les créanciers opposans au decret, doivent être payés sur le prix des biens saisis réellement, et sur les deniers provenans des baux judiciaires.
En quelques endroits, comme en Lorraine, au parlement de Bordeaux et en Angoumais, l'ordre se fait avant l'adjudication par decret, afin de ne vendre des biens qu'autant qu'il en faut pour payer les créanciers. A Paris, et presque partout ailleurs, l'ordre ne se fait qu'après l'adjudication.
En Normandie on fait d'abord un état du prix des baux judiciaires, pour voir pareillement s'il y a de quoi payer les créanciers sans vendre le fonds ; ailleurs on ne fait qu'un seul ordre.
En quelques endroits on ne fait l'ordre que quand le prix est consigné ; en d'autres on le commence aussitôt après l'adjudication.
Quand le decret est délivré, le procureur du poursuivant lève au greffe un extrait du nom des opposans, et celui de leur procureur ; il prend ensuite avec eux l'appointement sur l'ordre, qui est un appointement en droit à écrire et produire : il doit bien prendre garde de n'omettre aucun des créanciers opposans ; car s'il en omettait un qui put être utilement colloqué, il serait responsable de sa créance.
Huitaine après la signification de l'appointement, le poursuivant fournit ses causes et moyens d'opposition, et fait sa production.
Le procureur plus ancien des opposans, lequel en cette matière est regardé comme leur syndic, contredit toutes les productions ; ce qui n'empêche pas que chaque opposant n'ait aussi la liberté de contredire en son particulier.
L'instance d'ordre étant instruite, on juge ; et par le jugement on fait l'ordre, ce que l'on appelle sentence d'ordre, ou arrêt d'ordre, si c'est en cour souveraine.
On colloque dans l'ordre, en premier les créanciers privilegiés, chacun suivant le rang de leur privilège ; en second lieu les créanciers simples hypothécaires, chacun suivant le rang de leur hypothéque ; en troisième lieu les créanciers chirographaires.
Les créanciers colloqués utilement dans l'ordre, vont toucher leur paiement aux saisies réelles, ou aux consignations, suivant que leur paiement est assigné sur l'un ou sur l'autre.
Au châtelet on nomme un commissaire pour faire l'ordre.
Il y a encore divers usages sur cette matière dans différents tribunaux. Voyez le traité de la vente des immeubles par decret par M. d 'Hericourt, les questions de Bretonnier, au mot DECRET.
Bénéfice d'ordre ou de discussion, est une exception accordée à la caution pour ne pouvoir être poursuivie avant que le principal obligé ait été discuté. Voyez CAUTION, DISCUSSION, FIDEJUSSEUR. (A)
ORDRE RELIGIEUX, (Histoire ecclésiastique) congrégation, société de religieux, vivants sous un chef, d'une même manière, et sous un même habit.
On peut réduire les ordres religieux à cinq classes : Moines, Chanoines, Chevaliers, Mendiants, et Clercs réguliers. On sait que l'ordre de S. Basîle est le plus célèbre de l'Orient, et l'ordre de S. Benait un des plus anciens de l'Occident. L'ordre de S. Augustin se divise en chanoines réguliers et en hermites de S. Augustin. Quant aux quatre ordres des religieux mendiants, qui ont été tant multipliés, ils ne parurent que dans le XIIIe siècle.
Laissons au P. Helliot tous les détails qui concernent les ordres religieux, et traçons seulement en général leur origine et leurs progrès, non pas néanmoins avec des protestants prévenus, mais avec M. l'abbé Fleury, dont l'impartialité égale les lumières.
La naissance du monachisme est de la fin du iij siècle. Saint-Paul qui vivait en CCL, Saint-Antoine et Saint-Pacôme, sont les premiers religieux chrétiens d'Egypte, et on les reconnait pour les plus parfaits de tous ceux qui leur succédèrent. Cassien qui nous a donné une description exacte de leur manière de vie, nous apprend qu'elle renfermait quatre principaux articles : la solitude, le travail, le jeune et la prière. Leur solitude ne consistait pas seulement à se séparer des autres hommes, mais à s'éloigner des lieux fréquentés, et habiter des déserts. Or, ces déserts n'étaient pas, comme plusieurs s'imaginent, de vastes forêts, ou d'autres terres abandonnées, que l'on put défricher et cultiver : c'étaient des lieux non-seulement inhabités, mais inhabitables : des plaines immenses de sables arides, des montagnes stériles, des rochers, et des pierres. Ils s'arrêtaient aux endroits où ils trouvaient de l'eau, et y bâtissaient leurs cellules de roseaux ou d'autres matières légères ; et pour y arriver, il fallait souvent faire plusieurs journées de chemin dans le désert. Là, personne ne leur disputait le terrain ; il ne fallait demander à personne la permission de s'y établir.
Le travail des mains était regardé comme essentiel à la vie monastique. La vocation générale de tout le genre humain est de passer ses jours à quelques fonctions sérieuses et pénibles. Les plus grands saints de l'ancien testament ont été pâtres, et laboureurs. Le travail de ces premiers religieux tendait, d'une part, à éviter l'oisiveté et l'ennui qui en est inséparable ; et d'autre part, à gagner de quoi subsister sans être à charge à personne. Ils prenaient à la lettre ce précepte de Saint Paul : " Si quelqu'un ne veut point travailler, qu'il ne mange pas non plus ". Ils ne cherchaient ni glose ni commentaire à ce précepte ; mais ils s'occupaient à des travaux compatibles à leur état : comme de faire des nattes, des corbeilles, de la corde, du papier, ou de la toile. Quelques-uns ne dédaignaient pas de tourner la meule. Ceux qui avaient quelques pièces de terre, les cultivaient eux-mêmes : mais ils aimaient mieux les métiers que les biens en fonds, qui demandent trop de soins, et attirent des procès.
Ces religieux jeunaient presque toute l'année, ou du moins se contentaient d'une nourriture très-frugale. Ils réglèrent la quantité de leur pain à 12 onces par jour, qu'ils distribuaient en deux repas ; l'un à none, l'autre au soir. Ils ne portaient ni cilice ni chaîne ou carcan de fer ; car pour les disciplines et flagellations, elles n'avaient pas encore été imaginées. Leurs austérités consistaient dans la persévérance en une vie uniforme et laborieuse ; ce qui est plus convenable à la nature, que l'alternative des rudes pénitences avec le relâchement.
Leur prière était réglée avec la même sagesse. Ils priaient en commun deux fois en 24 heures ; le soir et la nuit. Une partie étant debout, chantait un pseaume au milieu de l'assemblée ; et les autres écoutaient dans le silence, sans se fatiguer la poitrine ni le reste du corps. Leurs dévotions étaient de même gout, si on ose le dire, que les ouvrages des anciens Egyptiens, grandes, simples et solides. Tels étaient ces premiers moines si fort estimés par S. Basîle et S. Jean-Chrysostome.
La vie monastique, en s'étendant par toute la chrétienté, commença à dégénerer de cette première perfection. La règle de S. Benait nous apprend qu'il fut obligé d'accorder aux religieux un peu de vin, et deux mets outre le pain, sans les obliger à jeuner toute l'année. Cependant, voyez combien la ferveur s'est ralentie, depuis qu'on a regardé cette règle comme d'une sévérité impraticable ! Voyez, dis-je, combien ceux qui y ont apporté tant de mitigations, étaient éloignés de l'esprit de leur réelle vocation ; tant il est vrai que la nature corrompue ne cherche qu'à autoriser le relâchement !
On vit bientôt après des communautés de clercs mener une vie approchante de celle des religieux de ce temps-là : on les nomma chanoines ; et vers le milieu du VIIe siècle, Chrodegang, évêque de Metz, leur donna une règle : ainsi voilà deux sortes de religieux dans le VIIe siècle ; les uns clercs ; les autres laïcs ; on sait quelles en ont été les suites.
Au commencement du ix. siècle, les religieux de S. Benait se trouvèrent très-éloignés de l'observance de la règle de leur institut. Vivants indépendants les uns des autres, ils reçurent de nouveaux usages qui n'étaient point écrits, comme la couleur, la figure de l'habit, la qualité de la nourriture, etc. et ces divers usages furent des sources d'orgueil et de relâchement.
Dans le Xe siècle, en 910, Guillaume, duc d'Aquittaine, fonda l'ordre de Clugny, qui sous la conduite de l'abbé Bernon, prit la règle de S. Benait. Cet ordre de Clugny se rendit célèbre par la doctrine et les vertus de ses premiers abbés ; mais au bout de deux cent ans, il tomba dans une grande obscurité, et l'on n'y vit plus d'homme distingué depuis Pierre le vénérable.
Les deux principales causes de cette chute furent les richesses, et la multiplication des prières vocales. Le mérite singulier des premiers abbés de Clugny leur procura des dons immenses, qu'ils eussent mieux fait de refuser, s'ils avaient sérieusement réfléchi sur les suites de leur opulence. Les moines de Clugny ne tardèrent pas de faire la meilleure chère possible en maigre, et de s'habiller des étoffes du plus grand prix. Les abbés marchèrent à grand train ; les églises furent bâties magnifiquement, et richement ornées, et les lieux réguliers à proportion.
L'autre cause du relâchement fut la multiplication de la psalmodie et des prières vocales. Ils ajoutèrent entr'autres choses, à la règle de S. Benait l'office des morts, dont ils étaient les auteurs. Cette longue psalmodie leur ôtait le temps du travail des mains ; et Pierre le vénérable fut trompé par les préjugés de son siècle, en regardant le travail corporel comme une occupation servile. L'antiquité n'en jugeait pas ainsi ; et sans parler des Israélites, on sait que les Grecs et les Romains s'en faisaient honneur.
Deux cent ans après la fondation de Clugny, saint Bernard fonda l'ordre religieux de Cisteaux ; mais il faut avouer que son zèle ne fut pas assez réglé par la discrétion. Il introduisit dans l'observance de Cisteaux une nouveauté, qui dans la suite, contribua beaucoup au relâchement ; je veux dire, la distinction des moines du chœur et des frères lais. Jusqu'au XIe siècle, les moines se rendaient eux-mêmes toutes sortes de services, et s'occupaient tous des mêmes travaux.
Saint Jean-Gualbert institua le premier des freres-lais dans son monastère de Valombreuse, fondé vers l'an 1040. On occupa ces freres-lais des travaux corporels, du ménage de la campagne, et des affaires du dehors. Pour prière, on leur prescrivit un certain nombre de pater ; et afin qu'ils s'en pussent acquitter, ils avaient des grains enfilés, d'où sont venus les chapelets. Ces frères étaient vêtus moins bien que les moines, et portaient la barbe longue, comme les autres laïcs. Les Chartreux, les moines de Grandmont, et ceux de Cisteaux ayant établi des freres-lais, tous les ordres religieux venus depuis, ont suivi leur exemple : il a même passé aux religieuses ; car on distingue chez elles, les filles du chœur, et les sœurs converses.
Cette distinction entre les religieux a fait beaucoup de mal. Les moines du chœur, voyant les freres-lais au-dessous d'eux, les ont regardés comme des hommes grossiers, et se sont regardés eux-mêmes comme des seigneurs ; c'est en effet ce que signifie le titre de dom, abrégé de dominus, qui en Italie et en Espagne, est encore un titre de noblesse que la règle de saint Benait donnait à l'abbé seul dans le Xe siècle.
D'un autre côté, les freres-convers, qu'on tenait fort bas et fort soumis, ont voulu souvent dominer, comme étant plus nécessaires pour le temporel que le spirituel supposé ; car il faut vivre avant que de prier et d'étudier.
Depuis ce temps, les moines abandonnèrent plus que jamais le travail des mains, et quelques-uns d'eux crurent que l'étude était la seule occupation qui put leur convenir ; mais ils ne se bornèrent pas à l'étude de l'Ecriture sainte, ils embrassèrent toutes sortes d'études ; celle des canons et du droit civil, qui ne devaient pas être de leur ressort, et celle de la Médecine, encore moins. Rigord, moine de S. Denys était physicien, c'est-à-dire médecin du roi Louis-le-Gros, dont il a écrit la vie. Si ces moines commencèrent ces sortes d'études par charité, ils les continuèrent par intérêt, pour gagner de l'argent, comme auraient fait des séculiers. Le concîle de Rheims tenu par le pape Innocent III. en 1131, nous l'apprend, c'est, dit ce concile, au canon VI, l'avarice, qui les engage à se faire avocats, et à plaider des causes justes et injustes sans distinction. C'est l'avarice qui les engage à mépriser le soin des âmes, pour entreprendre la guérison des corps, et arrêter leurs yeux sur des objets dont la pudeur défend même de parler.
Le concîle de Latran tenu en 1215, voulant remédier à l'extrême relâchement des communautés religieuses de l'un et de l'autre sexe, ordonna la tenue des chapitres généraux tous les trois ans : mais ce remède a eu peu d'effet ; parce que d'ailleurs les chapitres généraux ont de grands inconvéniens. La dissipation inséparable des voyages est plus grande ; et plus ces chapitres sont grands, plus grande est la dépense, qui oblige à faire des impositions sur les monastères, source de plaintes et de murmures. Enfin, quel a été le fruit de ces chapitres ? de nouveaux règlements et des députations de visiteurs pour les faire exécuter ; c'est-à-dire, une multiplication odieuse de voyages et de dépenses, comme l'a fait voir l'expérience de quatre siècles.
Le même concîle de Latran défendit de nouvelles religions, c'est-à-dire de nouveaux ordres ou congrégations. Cette défense était très sage, très-avantageuse à l'état, et conforme à l'esprit de la pure antiquité. Les divers ordres religieux sont autant de petites églises jalouses l'une de l'autre dans l'Eglise universelle. Il est moralement impossible qu'un ordre estime autant un autre institut que le sien, et que l'amour propre ne pousse pas chaque religieux à préférer singulièrement l'institut qu'il a choisi, à souhaiter à sa communauté plus de richesses et de réputation qu'à toute autre, et à se dédommager ainsi de ce que la nature souffre à ne rien posséder en propre. Les moines aiment tant leur ordre, parce que leur règle les prive des choses, sur lesquelles les passions ordinaires s'appuient. Reste donc cette passion pour la règle même qui les afflige. De-là tant d'activité, de procès et de disputes si vives entre les ordres religieux sur la préséance et les honneurs.
Le concîle de Latran avait donc très-sagement défendu d'instituer de nouvelles religions ; mais son decret a été si mal observé, ainsi que celui du concîle de Lyon, tenu soixante ans après pour en réitérer la défense, que depuis ces deux conciles, il s'est plus établi de nouveaux ordres, que dans tous les siècles précédents.
Si les inventeurs des nouveaux ordres qu'on nomme religieux mendiants, n'étaient pas canonisés pour la plupart, on pourrait les soupçonner de s'être laissé séduire à l'amour propre, et d'avoir voulu se distinguer par leur raffinement au-dessus des autres. Mais sans préjudice de leur sainteté, on peut librement attaquer leurs lumières ; et le pape Innocent III. avait raison de faire difficulté d'approuver le nouvel institut de saint Français. En effet, il eut été plus utîle à l'Eglise que les papes et les évêques se fussent appliqués sérieusement à réformer le clergé séculier, et le rétablir sur le pied des trois premiers siècles, sans appeler au secours ces troupes étrangères ; en sorte qu'il n'y eut que deux genres de personnes consacrées à Dieu, des clercs destinés à l'instruction et la conduite des fidèles, et un petit nombre de moines séparés du monde, et appliqués uniquement à prier et travailler en silence.
Mais comme au XIIIe siècle, l'on était touché des désordres que l'on avait devant les yeux, l'avarice du clergé, son luxe, sa vie molle et voluptueuse qui avait gagné les monastères rentés, l'on crut devoir admettre des hommes qui renonçaient à la possession des biens temporels en particulier, et en commun. Ainsi l'on gouta beaucoup l'institut des frères Mineurs, et autres nouveaux moines, qui choisirent la mendicité jusques-là rejetée par les plus saints religieux. Le vénérable Guigues traite d'odieuse la nécessité de quêter ; et le concîle de Paris tenu en 1212, veut que l'on donne de quoi subsister aux religieux qui voyagent, pour ne les pas réduire à mendier à la honte de leur ordre. Saint François lui-même avait ordonné le travail à ses disciples, ne leur permettant de mendier qu'à la dernière extrémité ; et dans son testament, il leur fait une défense expresse de demander au pape aucun privilège, et de donner aucune explication à sa règle. Cependant peu de temps après sa mort, les frères Mineurs assemblés au chapitre de 1230, obtinrent du pape Grégoire IX. une bulle qui déclare qu'ils ne sont point obligés à l'observation de son testament, et qui explique la règle en plusieurs articles. Ainsi le travail des mains si recommandé dans l'Ecriture, et si bien pratiqué par les premiers moines, est devenu odieux, et la mendicité odieuse auparavant, est devenue honorable.
J'avoue que les frères Prêcheurs et les frères Mineurs, négligeant dans l'enfance de leurs ordres, les bénéfices et les dignités ecclésiastiques, se rendirent célèbres par leurs études dans les universités naissantes de Paris et de Boulogne ; et sans examiner quel était au fond ce genre d'étude qu'ils cultivèrent, il suffit qu'ils y réussissaient mieux que les autres. Leur vertu, la modestie, l'amour de la pauvreté, et le zèle de la propagation de la foi, contribuèrent en même temps à les faire respecter de tout le monde. De-là vient qu'ils furent si-tôt favorisés par les papes, qui leur accordèrent tant de privilèges, et chéris par les princes et par les rais. Saint Louis disait, que s'il pouvait se partager en deux, il donnerait aux frères Prêcheurs la moitié de sa personne, et l'autre aux frères Mineurs.
Mais sans discuter ici la matière de la pauvreté évangelique, que les frères Mendiants ont fort mal connue, tenons-nous-en à l'expérience. Trente ans après la mort de saint Français, on remarquait déjà un relâchement extrême dans les ordres de sa fondation. J'en citerai seulement pour preuve, le témoignage de saint Bonaventure, qui ne peut être suspect. C'est dans la lettre qu'il écrivit en 1257, étant général de l'ordre, à tous les provinciaux et les custodes. Cette lettre est dans ses opuscules, tome II. page 352. Il se plaint de la multitude des affaires pour lesquelles ils requéraient de l'argent, de l'oisiveté de divers frères, de leur vie vagabonde, de leurs importunités à demander, des grands bâtiments qu'ils élevaient ; enfin, de leur avidité des sépultures et des testaments. Je ne dirai qu'un mot sur chacun de ces articles.
Les frères Mendiants, sous prétexte de charité, se mêlaient de toutes sortes d'affaires publiques et particulières. Ils entraient dans le secret des familles, et se chargeaient de l'exécution des testaments ; ils prenaient des députations pour négocier la paix entre les villes et les princes. Les papes surtout leur donnaient volontiers des commissions, comme à des gens sans conséquence, qui voyageaient à peu de frais, et qui leur étaient entièrement dévoués : ils les employaient même quelquefois à des levées de deniers.
Mais une chose plus singulière que toute autre, c'est le tribunal de l'inquisition dont ils se chargèrent. On sait que dans ce tribunal, contraire à toute bonne police, et qui trouva par-tout un soulevement général, il y a capture de criminels, prison, torture, condamnations, confiscations, peines infamantes, et si souvent corporelles par le ministère du bras séculier. Il est sans doute bien étrange de voir des religieux, faisant profession de l'humilité la plus profonde, et de la pauvreté la plus exacte, transformés tout d'un coup en juges criminels, ayant des appariteurs et des familiers armés, c'est-à-dire, des gardes et des trésors à leur disposition, se rendant ainsi terribles à toute la terre.
Je glisse sur le mépris du travail des mains, qui attire l'oisiveté chez les Mendiants comme chez les autres religieux. De-là la vie vagabonde de plusieurs, et que saint Bonaventure reproche à ces frères, lesquels, dit-il, sont à charge à leurs hôtes, et scandalisent au lieu d'édifier. Leur importunité à demander, ajoute le même saint, fait craindre la rencontre de nos frères comme celle des voleurs. En effet, cette importunité est une espèce de violence, à laquelle peu de gens savent résister, surtout à l'égard de ceux dont l'habit et la profession ont attiré du respect ; et d'ailleurs, c'est une suite naturelle de la mendicité ; car enfin il faut vivre. D'abord, la faim et les autres besoins pressants font vaincre la pudeur d'une éducation honnête ; et quand une fois on a franchi cette barrière, on se fait un mérite et un honneur d'avoir plus d'industrie qu'un autre à attirer les aumônes.
La grandeur et la curiosité des bâtiments incommodent nos amis qui fournissent à la dépense, et nous exposent aux mauvais jugements des hommes. Ces frères, dit Pierre des Vignes, qui dans la naissance de leur religion, semblaient fouler aux pieds la gloire du monde, reprennent le faste qu'ils ont méprisé ; n'ayant rien, ils possèdent tout, et sont plus riches que les riches mêmes. Quant à leur avidité des sépultures et des testaments, Matthieu Paris l'a peinte en ces mots : " Ils sont soigneux d'assister à la mort des grands au préjudice des pasteurs ordinaires : ils sont avides de gain, et extorquent des testaments secrets ; ils ne recommandent que leur ordre, et le préfèrent à tous les autres ".
Le relâchement fit encore dans la suite de plus grands progrès chez les frères Mineurs, par le malheureux schisme qui divisa tout l'ordre, entre les frères spirituels, et ceux de l'observance commune. Le pape Célestin, dont le zèle était plus grand que la prudence, autorisa cette division, en établissant la congrégation des pauvres hermites, sous la conduite du frère Libérat.
Les anciens religieux étant tombés dans le mépris depuis l'introduction des Mendiants, ce mépris les excita à tâcher de relever chez eux les études ; mais comme on n'imaginait pas alors qu'on put bien étudier ailleurs que dans les universités, on y envoyait les moines ; ce qui fut une nouvelle source de dépravation par la dissipation des voyages, la fréquentation inévitable des étudiants séculiers, peu réglés dans leurs mœurs pour la plupart, la vanité du doctorat, et des autres grades, et les distinctions qu'ils donnent dans les monastères. D'ailleurs, ils recevaient en argent leur nourriture et leur vestiaire ; ils sortaient sans permission, mangeaient en ville chez les séculiers, et s'y cachaient. Ils avaient leur pécule en propre, couchaient dans des chambres particulières, empruntaient de l'argent en leur nom, et se rendaient caution pour d'autres.
Il serait trop long d'examiner les sources du relâchement, de la dégradation, et de la multiplication des religieux. Nous dirons seulement qu'une des causes les plus générales du relâchement qui règne chez eux, est la légèreté de l'esprit humain, et la rareté d'hommes fermes, qui persévèrent longtemps dans une même résolution. On a tâché de fixer l'inquiétude naturelle par le moyen des vœux ; mais ces vœux mêmes sont téméraires, et mal imaginés. Les récréations introduites dans les derniers temps, seraient peut-être convenables, si elles consistaient dans le mouvement du corps, la promenade, ou un travail modéré.
Les austérités corporelles si usitées dans les derniers siècles, ont fait plus de mal que de bien : ce ne sont pas des signes de vertu ; on peut sans humilité et sans charité marcher nud pied, porter la haire, ou se donner la discipline. L'amour propre qui empoisonne tout, persuade à un esprit faible qu'il est un saint, dès qu'il pratique ces dévotions extérieures ; et pour se dédommager de ce qu'il souffre par-là, il s'imagine aisément pouvoir faire une espèce de compensation, comme cet italien qui disait : Que veux-tu, mon frère ? un peu de bien, un peu de mal, le bon Dieu nous fera miséricorde.
Mais les exemptions ne sont pas une des moindres causes du relâchement des religieux ; et les inconvénients en sont sensibles : le pouvoir du pape à cet égard, n'est fondé que sur les fausses décrétales, que le pontife de Rome peut tout. Les exemptions sont une occasion de mépriser les évêques et le clergé qui leur est soumis. C'est une source de division dans l'Eglise, en formant une hiérarchie particulière.
L'humilité est entièrement tombée par les distinctions entre les frères. Un général d'ordre se regarde comme un prélat et un seigneur ; et quelques-uns en prennent le titre et l'équipage. Un provincial s'imagine presque commander à tout le peuple de sa province ; et en certains ordres, après son temps fini, il garde le titre d'exprovincial.
Depuis que le travail des mains a été méprisé, les religieux rentés se sont abandonnés la plupart à la paresse dans les pays chauds, et à la crapule dans les pays froids. Tant de relâchements a nui à tous les Chrétiens catholiques, qui ont cru pouvoir se permettre quelque chose de plus que les moines. L'affoiblissement de la Théologie morale est venu de la même source. Les casuistes qui étaient presque tous religieux, et religieux mendiants, gens peu sévères envers ceux dont ils tirent leur subsistance, ont excusé la plupart des péchés, ou en ont facilité les absolutions. Cette facilité est nécessaire dans les pays d'inquisition, où le pécheur d'habitude, qui ne veut pas se corriger, n'ose toutefois manquer au devoir paschal, de peur d'être dénoncé, excommunié, au bout de l'an déclaré suspect d'hérésie, et comme tel poursuivi en justice : aussi est-ce dans ces pays, qu'ont vécu les casuistes les plus relâchés.
Les nouvelles dévotions introduites par divers religieux, ont concouru au même effet, de diminuer l'horreur du péché, et de faire négliger la correction des mœurs. On peut porter gayement un scapulaire, dire tous les jours le chapelet, ou quelque oraison, sans pardonner à son ennemi, restituer le bien mal acquis, ou quitter sa concubine. Des pratiques qui n'engagent point à être meilleur, sont aisément reçues. De-là vient encore la dévotion simplement extérieure qu'on donne au saint Sacrement. On aime bien mieux s'agenouiller devant lui, ou le suivre en procession, que se disposer à communier dignement.
Nous supprimons les détails de cette jalousie éclatante qui règne entre divers ordres religieux : la division entre les Dominicains et les Franciscains ; la haine entre les moines noirs et les moines blancs ; chaque ordre se rallie sous un étendart opposé. Tous enfin ont l'esprit du corps qui animant leurs sociétés particulières, ne procure aucun bien à la société générale.
Concluons donc avec saint Benait, qu'il n'est peut-être pas nécessaire qu'il y ait des ordres religieux dans l'Eglise ; ou du-moins, que ceux qui ont pris le parti de s'y dévouer, bien-loin de se relâcher, doivent tendre nécessairement à une plus grande perfection. Le bienheureux Guigues chartreux, déclare en conséquence, que l'institut religieux qui admet le moins de sujets, est le meilleur ; et que celui qui en admet le plus, est le moins estimable.
Si cette réflexion est juste, que devons-nous penser de leur multiplicité ? Je ne dirai rien de leur opulence, sinon qu'elle commença très-promptement, et qu'elle était déjà prodigieuse dans les VIIIe et ix. siècles : ils ont toujours acquis depuis, et ils acquièrent encore. Quant au nombre incroyable de sujets qu'ils possèdent, c'est assez d'observer que la France en nourrit plus de cent mille dans des monastères ou couvens ; l'Italie n'en a pas moins ; et les cloitres en Espagne tiennent lieu d'une mortalité qui détruit insensiblement la nation. Ces familles éternelles où il ne nait personne, dit l'auteur de l'esprit des Lais, et qui subsistent perpétuellement aux dépens du public, ont des maisons toujours ouvertes, comme autant de gouffres, où s'ensevelissent les races futures. (D.J.)
ORDRE D'UN ETAT, (Droit Polit.) on appelle ordres dans un état, différentes classes et assemblées des hommes, avec leurs différents pouvoirs et privilèges. Il n'est pas possible de détruire et de changer essentiellement les ordres d'un état, tandis que l'esprit et le caractère du peuple demeurent dans la pureté et la vigueur de son origine ; mais ils seraient essentiellement altérés, si l'esprit et le caractère du peuple était perdus ; cette altération des ordres entraînerait plus certainement la perte de la liberté, que s'ils étaient anéantis. (D.J.)
ORDRE BLANC ; on appelle ordres blancs dans l'église romaine les ordres religieux, dont les membres sont vêtus de blanc, tels que les chanoines réguliers de S. Augustin, autrement Génovefains, les Prémontrés, les Trinitaires ; et par opposition on appelle ordres noirs ceux qui sont tous vêtus de noir, tels que les Bénédictins, les Augustins, etc. Voyez ORDRE.
ORDRES MILITAIRES, (Histoire moderne) les ordres militaires sont certains corps de chevaliers, institués par des rois ou des princes, pour donner des marques d'honneur et faire des distinctions dans leur noblesse.
Il y a eu en France quatre ou cinq ordres de chevalerie purement militaires.
Charles Martel institua l'ordre de la genette, qui ne dura point.
S. Louis fonda en 1269 l'ordre du navire et du croissant, qui fut aussi de courte durée.
En 1350 le roi Jean institua l'ordre de l'étoile, en faveur des plus grands seigneurs ; la devise était monstrant regibus astra viam, par allusion à l'étoîle des mages : cet ordre dont le siège était à Saint-Ouen près Paris, s'avilit dans la suite par le trop grand nombre de chevaliers, et fut abandonné aux chevaliers du guet.
En 1389 Charles VI. fonda l'ordre de la ceinture de l'espérance, dont on ne sait aucun détail.
En 1469 Louis XI. institua l'ordre de S. Michel, parce que celui de l'étoîle était tombé en discrédit. Il fixa le nombre des chevaliers à trente-six, et ce fut au traité de Noyon, que Charles-Quint et François I. se donnèrent mutuellement l'un l'ordre de la taison, l'autre celui de S. Michel ; mais François II. en 1559 ayant créé à la fois dix-huit chevaliers de S. Michel, cette promotion commença à avilir cet ordre. Les marques d'honneur, dit M. de Sainte-Palaye, sont la monnaie de l'état ; il est aussi dangereux de la hausser à l'excès que de la baisser.
Enfin, l'an 1693 est la date de l'institution de l'ordre de S. Louis.
Loin d'entrer dans les détails sur ces divers ordres, je me borne à deux réflexions.
1°. Les ordres militaires de chevalerie, comme ceux du temple, ceux de malthe, l'ordre teutonique et tant d'autres, sont une imitation de l'ancienne chevalerie qui joignait les cérémonies religieuses aux fonctions de la guerre. Mais cette espèce de chevalerie fut absolument différente de l'ancienne. Elle produisit en effet les ordres monastiques et militaires fondés par les papes, possédant des bénéfices, astreints aux trois vœux des moines. De ces ordres singuliers, les uns ont été grands conquérants, les autres ont été abolis pour leurs débauches ou leur puissance ; d'autres ont subsisté avec éclat.
2°. Les souverains ont dans leur main un moyen admirable de payer les services considérables que les sujets ont rendus à l'état, en honneurs, en dignités, et en rubans, plutôt qu'en argent ou autres semblables récompenses. " C'a été, dit Montagne, une belle invention, et reçue en la plupart des polices du monde, d'établir certaines marques vaines et sans prix, pour en honorer et récompenser la vertu ; comme sont les couronnes de laurier, de chêne, de myrte, la forme de certain vêtement, le privilège d'aller en coche par ville, ou de nuit avec flambeau, quelque assiette particulière aux assemblées publiques, la prérogative d'aucuns surnoms et titres, certaines marques aux armoiries, et choses semblables, de quoi l'usage a été diversement reçu, selon l'opinion des nations, et dure encore. Nous avons pour notre part et plusieurs de nos voisins, les ordres de chevalerie qui ne sont établis qu'à cette fin. Il est beau de reconnaître la valeur des hommes, et de les contenter par des payements qui ne chargent aucunement le public, et qui ne coutent rien au prince, et ce qui a été toujours connu par expérience ancienne, et que nous avons autrefois aussi pu voir entre nous, que les gens de qualités avaient plus de jalousies de telles récompenses, que de celles où il y avait du gain et du profit, cela n'est pas sans raison et sans apparence. Si au prix qui doit être simplement d'honneur, on y mêle d'autres commodités et de la richesse, ce mélange au lieu d'augmenter l'estimation, il la ravale, et en retranche.... La vertu embrasse et aspire plus volontiers à une récompense purement sienne, plutôt glorieuse qu'utîle ; car à la vérité les autres dons n'ont pas leur usage si digne, d'autant qu'on les emploie à toutes sortes d'occasions. Par des richesses on satisfait le service d'un valet, la diligence d'un courier ; le danser, le voltiger, le parler, et les plus vils offices qu'on reçoive : voire et le vice s'en paye, la flatterie, le maquerélage, la trahison ; ce n'est pas merveille, si la vertu reçoit et désire moins volontiers cette sorte de monnaie commune, que celle qui lui est propre et particulière, toute noble et généreuse. " (D.J.)
ORDRE MILITAIRE ; c'est en France l'ordre de S. Louis que Louis XIV. établit en 1693, pour récompenser les officiers de ses troupes, et leur donner une marque de distinction particulière sur les autres états. Ceux qui sont revêtus de cet ordre sont appelés chevaliers de S. Louis : ils portent à la boutonnière de leur habit et sur l'estomac une croix d'or, sur laquelle il y a l'image de S. Louis, elle y est attachée avec un ruban couleur de feu.
Il y a dans l'ordre de S. Louis huit grands-croix et vingt-quatre commandeurs. Les grands-croix portent leur croix attachée à un ruban large de couleur de feu qu'ils mettent en écharpe ; et outre cela, ils portent une croix en broderie d'or sur leur habit et sur leur manteau. Pour les commandeurs, ils portent aussi leur croix en écharpe, mais ils n'en ont point de brodée sur leurs habits. Le roi est le grand maître de cet ordre, M. le Dauphin en est revêtu, et tous les héritiers présomptifs de la couronne doivent la porter.
Il y a des commandeurs qui ont 4000 l. de pension et d'autres 3000 liv. il y a aussi un nombre de simples chevaliers qui ont des pensions, mais elles sont moins considérables. (Q)
ORDRE DE CALATRAVA, (Histoire des ordres) je n'ajoute qu'un mot ; cet ordre n'est plus aujourd'hui ni religieux ni militaire, puisqu'on peut s'y marier une fais, et qu'il ne consiste que dans la jouissance de plusieurs commanderies en Espagne. Voyez CALATRAVA, ORDRE DE. (D.J.)
ORDRE DU CHARBON ou DE S. ANDRE, (Histoire moderne) est un ordre militaire d'écosse, institué, à ce que disent quelques-uns, par Hungus ou Hungo, roi des Pictes, après la victoire qu'il remporta sur Athelstan. Voyez CHEVALIER.
La légende porte, que pendant la bataille, une croix de S. André, patron d'écosse, apparut à Hungus qui en conçut un bon augure, décora son étendart de la figure de cette croix ; et après le gain de la bataille, institua un ordre de chevaliers, dont le collier est d'or entrelacé de fleurs de chardons et de branches de ruè.
Au bas du collier pend une médaille sur laquelle on voit l'image de S. André, ayant sa croix sur la poitrine avec cette devise, nemo me impunè lacesset, personne ne me défie impunément.
D'autres racontent différemment l'origine de cet ordre, et nous assurent qu'il fut institué après la conclusion d'une paix entre Charles VII, roi de France, d'une part, et le roi d'écosse de l'autre.
L'abbé Justiniani remonte plus haut, et prétend qu'il fut institué par Achaius I, roi d'écosse en 809, lequel après avoir conclu une alliance avec Charlemagne, prit pour sa devise le chardon avec ces mots, nemo me impunè lacesset, laquelle devise est effectivement celle de l'ordre : il ajoute que le roi Jacques IV. renouvella cet ordre, et le mit sous la protection de S. André.
L'ordre n'est composé que de douze chevaliers, et du roi qui en est le chef et le souverain ; ils portent un ruban verd au bas duquel pend un chardon d'or couronné dans un cercle d'or, avec l'inscription de la devise. (H)
ORDRE DE L'ÉLEPHANT, est un des ordres militaires des rois de Danemarck ; on l'appelle ainsi, parce que ses armes sont un éléphant. Il y a bien des sentiments sur l'origine de l'institution de cet ordre. Mennenius et Hocpingius l'attribuent à Christien IV. qui fut élu roi en 1584 ; Selden et Imhoff à Frederic II. élu en 1542 ; Gregorio Leti à Frederic I. qui regna vers 1530 ; Bernard Rebolledus à Jean I. qui commença à régner en 1478 ; Bechman et Janus Bicherodius soutiennent que Canut VI. en est le premier instituteur, et que c'est aux croisades qu'il en faut rapporter l'origine. Il est certain qu'en 1494. l'ordre de l'éléphant subsistait. Cet ordre s'appela d'abord l'ordre de sainte Marie, et celui de l'éléphant sous Christien I. ce qui donna occasion à son institution, fut une action courageuse de quelques-uns des Danois qui tuèrent un éléphant dans une guerre que Canut soutint contre les Sarrasins. Cet ordre a toujours été sous la protection de la sainte Vierge, et s'appelle encore à présent l'ordre de sainte Marie. Au dessous de l'éléphant pend une image de la sainte Vierge, environnée de rayons. Plusieurs princes augmentèrent cet ordre. Frederic II. créa beaucoup de chevaliers à la cérémonie de son couronnement. Christien V. en fit autant, et l'orna beaucoup : les chevaliers portent un collier d'où pend un éléphant d'or, émaillé de blanc, le dos chargé d'un château d'argent, maçonné de sable. L'éléphant est porté sur une terrasse de sinople, émaillée de fleurs. Les rois de Danemark ne font point de chevaliers de l'éléphant que le jour de leur couronnement.
ORDRE DU S. ESPRIT, est un ordre de chevalerie institué par Henri III. en 1579, il devait être composé de cent chevaliers seulement. Pour y être admis, il fallait faire preuve de trois races de noblesse. Le grand maître et les commandeurs sont revétus les jours de cérémonies, de longs manteaux, faits à la façon de ceux qui se portent le jour de S. Michel. Ils sont de velours noir, garnis tout-autour d'une broderie d'or et d'argent qui représente des fleurs de lis, et forme des nœuds d'or entre trois divers chiffres d'argent, et au-dessus de ces chiffres, de ces nœuds et de ces fleurs de lis, il y a des flammes d'or semées de part en part. Ce grand manteau est garni d'un mantelet de toîle d'argent verte, couverte d'une broderie semblable à celle du grand manteau, excepté qu'au lieu de chiffres, il y a des colombes d'argent. Ces manteaux et mantelets sont doublés de satin jaune orangé, ils se portent retroussés du côté gauche, et l'ouverture est du côté droit. Le grand maître et les commandeurs portent des chausses et des pourpoints blancs, façonnés à leur discrétion ; ils ont un bonnet noir surmonté d'une plume blanche, et mettent à découvert sur leurs manteaux le grand collier de l'ordre qui leur a été donné lors de leur réception.
Le chancelier est vétu de même que le commandeur, excepté qu'il n'a pas le grand collier, mais seulement la croix cousue sur le devant de son manteau, et celle d'or pendante au col. Le prevôt, le grand trésorier et le greffier ont aussi des manteaux de velours noir et le mantelet de toîle d'argent verte, qui ne sont brodés que de quelques flammes d'or. Ils portent aussi la croix de l'ordre cousue et celle d'or pendante au col ; le héraut et huissiers ont des manteaux de satin et le mantelet de velours verd, bordé de flammes comme ceux des autres officiers. Le héraut porte la croix de l'ordre avec son émail pendue au col, et l'huissier une croix de l'ordre, mais plus petite que celle des autres officiers.
Les prélats, commandeurs et officiers portent la croix cousue sur le côté gauche de leurs manteaux, robes et autres habillements de dessus. Le grand maître, qui est le roi, la porte aux habillements de dessous, au milieu de l'estomac quand bon lui semble, et en ceux de dessus au côté gauche de même grandeur que les commandeurs. Elle est faite en forme de croix de malthe en broderie d'argent, au milieu il y a une colombe figurée, et aux angles des rais et des fleurs de lis brodées en argent. C'est un des statuts irrévocables de l'ordre, de porter toujours la croix aux habits ordinaires avec celle d'or au col pendante à un ruban de soie, de couleur bleu céleste, et l'habit aux jours destinés. Les cardinaux, prélats, commandeurs et officiers portent aussi une croix de l'ordre pendante au col et au même ruban. La croix est de la forme de celle de malthe, toute d'or, émaillée de blanc par les bords, et le milieu sans émail : dans les angles il y a une fleur de lis ; mais sur le milieu ceux qui sont chevaliers de l'ordre de S. Michel, en portent la marque d'un côté, et de l'autre une colombe. Les cardinaux et les prélats qui ne sont point de cet ordre portent une colombe des deux côtés.
Le collier de l'ordre du S. Esprit est d'or fait à fleurs de lis avec trois différents chiffres entrelacés de nœuds de la façon de la broderie du manteau. Il est toujours du poids de deux cent écus ou environ, sans être enrichi de pierreries ni d'autres choses. Les commandeurs ne le peuvent vendre, engager ni aliéner, pour quelque nécessité ou cause que ce sait, parce qu'il appartient à l'ordre et lui revient après la mort de celui qui le portait. Avant que de recevoir l'ordre du S. Esprit, les commandeurs reçoivent celui de S. Michel ; c'est pourquoi leurs armes sont entourées de deux colliers. En 1664. le roi fixa le nombre des chevaliers à cent. Les officiers sont le chancelier et garde des sceaux, le prévot et grand maître des cérémonies, le grand trésorier, le greffier, les intendants, le généalogiste de l'ordre, le roi d'armes, les hérauts et les huissiers. Les chevaliers portent le cordon bleu de droite à gauche, et les pairs ecclésiastiques en forme de collier pendant sur l'estomac.
ORDRE DE LA TABLE RONDE, (Histoire de la Chevalerie) ordre de chevalerie célèbre dans les ouvrages des écrivains de romans, qui en attribuent l'institution au roi Arthur. Quoiqu'on ait bâti divers récits fabuleux sur ce fondement, il ne s'ensuit point que l'institution de cet ordre doive entièrement passer pour chimérique ; il n'est pas contre la vraisemblance, qu'Arthur ait institué un ordre de chevalerie dans la Grande-Bretagne, puisque dans le même siècle, Théodoric, roi des Ostrogoths, en avait institué un en Italie. Arthur a été sans doute un grand capitaine ; c'est dommage que ses actions aient servi de base à une infinité de fables qu'on a publiées sur son sujet, au lieu que sa vie méritait d'être écrite par des historiens sensés. (D.J.)
ORDRE TEUTONIQUE, (Histoire moderne) est un ordre militaire et religieux de chevaliers. Il fut institué vers la fin du XIIe siècle, et nommé teutonique, à cause que la plupart de ses chevaliers sont allemands ou teutons. Voyez CHEVALIER et ORDRE.
Voici l'origine de cet ordre. Pendant que les Chrétiens, sous Guy de Lusignan, faisaient le siege d'Acre, ville de la Syrie, sur les frontières de la Terre-sainte, auquel siege se trouvaient Philippe-Auguste roi de France, Richard roi d'Angleterre, et quelques seigneurs allemands de Bremen et de Lubec, on fut touché de compassion pour les malades et blessés qui manquaient du nécessaire, et on établit une espèce d'hôpital sous une tente faite d'un voîle de navire, où l'on exerça la charité envers les pauvres soldats.
C'est ce qui fit naître l'idée d'instituer un troisième ordre militaire, à l'imitation des templiers et des hospitaliers. Voyez TEMPLIER et HOSPITALIER.
Ce dessein fut approuvé par le patriarche de Jérusalem, par les évêques et archevêques des places voisines, par le roi de Jérusalem, par les maîtres du temple et de l'hôpital, et par les seigneurs et prélats allemands qui se trouvaient pour lors dans la Terre-sainte.
Ce fut du consentement commun de tous ces personnages, que Frédéric duc de Souabe, envoya des ambassadeurs à son frère Henri roi des Romains, pour qu'il sollicitât le pape de confirmer cet ordre nouveau. Celestin III. qui gouvernait l'Eglise, accorda ce qu'on lui demandait, par une bulle du 23 Février 1191 ou 1192 ; et le nouvel ordre fut appelé l'ordre des chevaliers teutoniques de l'hospice de sainte-Marie de Jérusalem.
Le pape leur accorda les mêmes privilèges qu'aux templiers et aux hospitaliers de S. Jean, excepté qu'il les soumit aux patriarches et autres prélats, et qu'il les chargea de payer la dixme de ce qu'ils possédaient.
Le premier maître de l'ordre, Henri de Walpot, élu pendant le siege d'Acre, acheta, depuis la prise de cette ville, un jardin où il bâtit une église et un hôpital, qui fut la première maison de l'ordre teutonique, suivant la relation de Pierre de Duisbourg, prêtre du même ordre. Jacques de Vitry s'éloigne un peu de ce fait historique, en disant que l'ordre teutonique fut établi à Jérusalem, avant le siege de la ville d'Acre.
Hartknoch, dans ses notes sur Duisbourg, concilie ces deux opinions, en prétendant que l'ordre teutonique fut institué d'abord à Jérusalem par un particulier, allemand de nation ; que cet ordre fut confirmé par le pape, par l'empereur et par les princes pendant le siege d'Acre ; et qu'après la prise de cette ville, cet ordre militaire devint considérable et se fit connaître par tout le monde.
S'il est vrai que cet ordre fut institué d'abord par un particulier, auquel se joignirent ceux de Bremen et de Lubec, qui étaient alors dans la ville de Jérusalem, on ne peut savoir au juste l'année de son origine.
L'ordre ne fit pas de grands progrès sous les trois premiers grands-maîtres, mais il devint extrêmement puissant sous le quatrième, nommé Hermand de Saltz, au point que Conrad, duc de Mazovie et de Cujavie, lui envoya des ambassadeurs pour lui demander son amitié et du secours, et pour lui offrir et à son ordre, les provinces de Culm et de Livonie, avec tous les pays qu'ils pourraient recouvrer sur les Prussiens idolâtres qui désolaient ses états par des incursions continuelles, et auxquels il opposa ces nouveaux chevaliers, parce que ceux de l'ordre de Christ ou de Dobrin, qu'il avait institués dans la même vue, étaient trop faibles pour exécuter ses desseins.
De Saltz accepta la donation, et Gregoire IX. la confirma. Innocent publia une croisade pour aider les chevaliers teutons à réduire les Prussiens. Avec ce secours l'ordre subjugua, dans l'espace d'un an, les provinces de Warmie, de Natangie et de Barthie, dont les habitants renoncèrent au culte des idoles ; et dans le cours de 50 ans, ils conquirent toute la Prusse, la Livonie, la Samogitie, la Poméranie, etc.
En 1204 le duc Albert institua l'ordre des chevaliers porte-glaives, qui fut uni ensuite à l'ordre teutonique, et cette union fut approuvée par le pape Grégoire IX. Voyez PORTE-GLAIVES.
Waldemar III. roi de Danemarck, vendit à l'ordre la province d'Estein, les villes de Nerva et de Wessamberg, avec quelques autres provinces.
Quelque temps après, une nouvelle union mit de grandes divisions dans l'ordre : cette union se fit avec les évêques et les chanoines de Prusse et de Livonie, lesquels en conséquence prirent l'habit de l'ordre, et partagèrent la souveraineté avec les chevaliers dans leurs diocèses.
L'ordre se voyant maître de toute la Prusse, il fit bâtir les villes d'Elbing, Marienbourg, Thorn, Dantzic, Konigsberg, et quelques autres. L'empereur Frédéric II. permit à l'ordre de joindre à ses armes l'aigle impérial, et en 1250 S. Louis lui permit d'écarteler de la fleur-de-lis.
Après que la ville d'Acre eut été reprise par les Infidèles, le grand-maître de l'ordre teutonique en transfera son siege à Marienbourg. A mesure que l'ordre croissait en puissance, les chevaliers voulaient croitre en titres et dignités ; de sorte qu'à la fin, au lieu de se contenter, comme auparavant, du nom de frères, ils voulurent qu'on les traitât de seigneurs ; et quoique le grand-maître Conrad Zolnera de Rotestein se fût opposé à cette innovation, son successeur Conrad Wallerod, non-content de favoriser l'orgueil des chevaliers, se fit rendre à lui-même des honneurs qui ne sont dû. qu'aux princes du premier ordre.
Les rois de Pologne profitèrent des divisions qui s'étaient mises dans l'ordre : les Prussiens se revoltèrent ; et après des guerres continuelles entre les chevaliers et les Polonais, les premiers cédèrent au roi Casimir la Prusse supérieure, et conservèrent l'inférieure, à condition de lui en faire hommage.
Enfin, dans le temps de la réformation, Albert, marquis de Brandebourg, grand-maître de l'ordre, se rendit luthérien, renonça à la dignité de grand-maître, détruisit les commanderies, et chassa les chevaliers de la Prusse.
La plupart des chevaliers suivirent son exemple, et embrassèrent la réformation : les autres transferèrent le siege du grand-maître à Margentheim ou Mariendal en Franconie, où le chef-lieu de l'ordre est encore aujourd'hui.
Ils y élurent pour leur grand-maître Walter de Cromberg, intentèrent un procès contre Albert, que l'empereur mit au ban de l'empire : cependant l'ordre ne put jamais recouvrer ses domaines ; et aujourd'hui les chevaliers ne sont tout-au-plus que l'ombre de ce qu'ils étaient autrefois, n'ayant que trois ou quatre commanderies, qui suffisent à-peine pour faire subsister le grand-maître et ses chevaliers.
Pendant que l'ordre teutonique était dans sa splendeur, ses officiers étaient le grand-maître, qui faisait son séjour à Mariendal, et qui avait sous lui le grand-commandeur, le grand-maréchal, résidant à Konigsberg, le grand-hospitalier, résidant à Elbing, le drapier, chargé de fournir les habits, le trésorier vivant à la cour du grand-maître, et plusieurs autres commandeurs, comme ceux de Thorn, de Culm, de Brandebourg, de Konigsberg, d'Elbing, etc.
L'ordre avait aussi des commandeurs particuliers dans les châteaux et dans les forteresses, des avocats, des pourvoyeurs, des intendants, des moulins, des provisions, etc.
Waisselms, dans ses annales, dit que l'ordre avait 28 commandeurs de villes, 46 de châteaux, 81 hospitaliers, 35 maîtres de couvens, 40 maîtres-d'hôtels, 37 pourvoyeurs, 93 maîtres de moulins, 700 frères ou chevaliers pour aller à l'armée, 162 frères de chœur ou prêtres, 6200 serviteurs ou domestiques, etc.
Les armes de l'ordre teutonique sont une croix partie de sable chargée d'une croix potencée au champ d'argent. Saint Louis, roi de France, avait permis d'y joindre quatre fleur-de-lis d'or ; et anciennement elles faisaient partie de leur blason, mais peu-à-peu ils ont négligé et enfin abandonné cette marque d'honneur.
ORDRE DE LA TOISON D'OR, (Histoire moderne) order of the golden fleece, est un ordre militaire institué par Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne en 1429. Voyez ORDRE.
Il a pris son nom de la représentation de la taison d'or, que les chevaliers portent au bas d'un collier, composé de fusils et de pierres à feu. Le roi d'Espagne est le chef et grand-maître de l'ordre de la taison, en qualité de duc de Bourgogne. Le nombre des chevaliers est fixé à trente et un. On dit qu'il fut institué à l'occasion d'un gain immense que le duc de Bourgogne fit sur les laines. Les Chimistes prétendent que ce fut pour un mystère de chimie, à l'imitation de cette fameuse taison d'or des anciens, qui, selon les initiés dans cet art, n'était autre chose que le secret de l'élixir écrit sur la peau d'un mouton.
Olivier de la Marche dit qu'il remit en mémoire à Philippe I. archiduc d'Autriche, père de l'empereur Charles V. que Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, son aïeul, avait institué l'ordre de la taison d'or, dans la vue de celle de Jason, et que Jean Germain, évêque de Châlons sur Saône, et chancelier de l'ordre, étant venu sur ces entrefaites, le fit changer de sentiment, et déclara au jeune prince que cet ordre avait été institué en mémoire de la taison de Gédéon. Mais Guillaume, évêque de Tournai, qui était aussi chancelier de l'ordre, prétend que le duc de Bourgogne eut pour objet la taison d'or de Jason, et celle de Jacob ; c'est-à-dire, ces brebis tachetées de diverses couleurs que ce patriarche eut pour sa part, suivant l'accord qu'il avait fait avec son beau-pere Laban ; ce qui a donné lieu à ce prélat de faire un gros ouvrage en deux parties. Dans la première, sous le symbole de la taison de Jason, il parle de la vertu de magnanimité dont un chevalier doit faire profession ; et sous le symbole de la taison de Jacob, de la vertu de justice.
Paradin a suivi ce sentiment, en disant que le duc voulut insinuer que la conquête fabuleuse que l'on dit que Jason fit de la taison d'or, n'était autre chose que la conquête de la vertu, qu'on ne peut acquérir sans vaincre les monstres horribles, qui sont les vices et les affections désordonnées.
Dans la première institution, les chevaliers portaient un manteau d'écarlate fourré d'hermine. Maintenant leur habit de cérémonie est une robe de toîle d'argent, un manteau de velours cramoisi rouge, et un chaperon de velours violet. La devise est, pretium non vîle laborum, qui semble faire allusion aux travaux que Jason et ses compagnons surmontèrent pour enlever la taison, et dont elle fut le prix.
ORDRE DE BATAILLE, c'est la disposition ou l'arrangement des troupes de l'armée pour combattre. Voyez ARMEE.
On a donné (article ARMEE) l'ordre ordinaire sur lequel les troupes sont mises en bataille, c'est-à-dire, sur deux lignes avec des réserves, la cavalerie également distribuée aux ailes, et l'infanterie au centre. Dans cet ordre les bataillons et les escadrons forment des lignes tant pleines que vides ; les troupes de la seconde ligne sont placées derrière ou en face des intervalles de celles de la première.
Comme ces intervalles, lorsqu'ils sont égaux au front des bataillons et des escadrons, augmentent considérablement le front de l'armée, M. le maréchal de Puysegur prétend qu'il faut les réduire à dix taises pour les bataillons, et à six pour les escadrons. Voyez INTERVALLE. Dans cet état, toutes les parties de l'armée étant plus réunies, il en résulte plus de force pour l'ordre de bataille. Mais on peut encore le rendre plus formidable en combattant en ligne pleine. Voyez ARMEE et LIGNE PLEINE. Ce dernier ordre a cependant un inconvénient, c'est que si la ligne pleine est rompue, il est presque impossible de rétablir le désordre : mais en formant derrière une seconde ligne, comme une espèce de réserve partagée en plusieurs grandes parties propres à soutenir la première dans les endroits où elle peut être forcée, on a de cette manière, l'avantage d'attaquer l'ennemi dans un ordre plus fort, et celui de pouvoir remédier, comme dans l'ordre en lignes tant pleines que vides, aux accidents qui peuvent arriver à la première ligne.
L'usage ordinaire de mettre la cavalerie aux ailes, et l'infanterie au centre, n'est pas généralement approuvé, parce qu'alors chaque armée, ou chaque espèce de troupe est abandonnée à sa propre force ; c'est-à-dire que la cavalerie ne soutient point l'infanterie, et celle-ci la cavalerie. Voyez INFANTERIE.
Montecuculli, le chevalier Folard, M. de Santa-Cruz, M. de Puysegur et plusieurs autres militaires habiles, auxquels cet inconvénient n'a point échappé, ont proposé différentes manières d'y remédier. Suivant le célèbre commentateur de Polybe, il faut mêler dans l'ordre de bataille la cavalerie et l'infanterie, de manière que ces différentes troupes occupent alternativement des parties de chaque ligne ; que la cavalerie de la seconde soit derrière l'infanterie de la première, et cette même troupe de la seconde ligne derrière la cavalerie qui est en première ligne. Par cet arrangement les deux différentes espèces de troupes de l'armée se soutiennent réciproquement. Ce mélange devient d'autant plus important, que la cavalerie de l'ennemi est en plus grand nombre et meilleure que celle qu'on peut lui opposer. Voyez sur ce sujet les éléments de Tactique, où l'on est entré dans un grand détail sur la manière de faire le mélange de la cavalerie et de l'infanterie dans l'ordre de bataille.
Il est difficîle de fixer des règles générales et constantes pour l'arrangement des troupes dans l'ordre de bataille. Cet ordre, comme le dit Onosander, doit être relatif à l'espèce d'armes, de troupes et des lieux qu'occupe l'ennemi. L'habileté du général consiste à régler ses dispositions selon les circonstances dans lesquelles il trouve l'armée opposée. Le coup d'oeil doit lui faire prendre dans le moment le parti le plus avantageux, suivant la situation de l'ennemi. Si l'on s'aperçoit qu'il ait mis ses principales forces au centre, ou aux ailes, on doit s'arranger pour lui opposer plus de résistance dans ces endroits, et faire en sorte que chaque espèce de troupe soit opposée à celles de même nature de l'armée qu'on veut combattre.
Il est aisé de s'apercevoir par le simple exposé de ces principes, que les ordres de bataille doivent varier d'une infinité de manières. Mais malgré leur nombre et leur diversité, il y a certaines règles qui servent de base à ces différents ordres, et dont on ne peut s'écarter sans inconvénient : voici en quoi elles consistent.
1°. Il faut toujours que les ailes de l'armée soient à l'abri des entreprises de l'ennemi. Une aîle détruite expose le reste à l'être également ; car il est très-difficîle de se soutenir contre une attaque de front et de flanc.
Pour éviter cet inconvenient, la méthode ordinaire est d'appuyer les ailes à quelque fortification naturelle qui les garantisse d'être tournées ou enveloppées ; comme par exemple, à un marais reconnu pour impratiquable, à une rivière qu'on ne peut passer à gué, à un bois bien garni d'infanterie, à un village bien fortifié, à des hauteurs dont le sommet est occupé par de bonnes troupes, de l'artillerie, etc.
Il est évident que les ailes de l'armée dans cette disposition, ne peuvent guère éprouver de danger de l'ennemi ; mais comme cette espèce de fortification est permanente, et que l'armée peut être obligée d'avancer ou de reculer, il arrive que si elle change de terrain, elle perd la protection de ses ailes. Pour éviter cet inconvenient M. le chevalier de Folard propose de les couvrir par des colonnes d'infanterie ; ces colonnes pouvant suivre tous les mouvements de l'armée, elles forment une espèce de fortification ambulante dont les ailes sont par-tout également protégées. Cette façon de les couvrir est beaucoup plus avantageuse que celle qu'on suit ordinairement, qui ne devrait avoir lieu que lorsqu'on est attaqué par l'ennemi dans un bon poste qu'on ne pourrait abandonner sans s'affoiblir. " La situation naturelle, dit Montecuculli, peut, à la vérité, assurer les flancs ; mais cette situation n'étant pas mobile, et n'étant pas possible de la trainer après soi, elle n'est avantageuse qu'à celui qui veut attendre le choc de l'ennemi, et non à celui qui marche à sa rencontre, ou qui Ve le chercher dans son poste ".
2°. Il faut éviter d'être débordé par l'armée ennemie, où, ce qui est la même chose, lui opposer un front égal, en observant néanmoins de ne pas trop dégarnir la seconde ligne, et de se conserver des réserves pour soutenir les parties qui peuvent en avoir besoin.
Lorsqu'il n'est pas possible de former un front égal à celui de l'ennemi, il faut encore plus d'attention pour couvrir les ailes : outre les colonnes de M. le chevalier de Folard, qui sont excellentes dans ce cas, on peut y ajouter des chevaux de frise, des chariots, ou quelqu'autre espèce de retranchement que l'ennemi ne puisse ni forcer ni tourner.
3°. Chaque troupe doit être placée sur le terrain qui convient à sa manière de combattre. Ainsi l'infanterie doit occuper les lieux fourrés ou embarrassés, et la cavalerie ceux qui sont libres et ouverts.
4°. Lorsqu'il y a des villages à portée de la ligne que l'ennemi ne peut pas éviter, on doit les fortifier, les bien garnir d'infanterie et de dragons pour rompre les premiers efforts de l'ennemi ; mais ces villages doivent être assez près de la ligne pour en être soutenus, et pour que les troupes puissent la rejoindre, si elles sont obligées de les abandonner.
Si les villages sont trop éloignés pour la communication des troupes avec le reste de l'armée, et que l'ennemi, en s'y établissant, puisse y trouver quelque avantage pour fortifier son armée, on doit les raser de bonne heure ; ne point se contenter d'y mettre le feu, qui ne fait que détruire les portes et les toits des maisons, mais renverser les murailles qui peuvent servir de couvert et de retranchement aux troupes ennemies.
5°. Observer que toutes les parties de l'armée aient des communications sures et faciles pour se soutenir réciproquement, et que les réserves puissent se porter par-tout où leur secours pourra être nécessaire : on doit aussi avoir attention de les placer de manière que les troupes ne puissent point se renverser sur elles, et les mettre en désordre, et qu'il n'y ait point de bagage entre les lignes ni derrière, qui incommode l'armée dans ses mouvements.
6°. Profiter de toutes les circonstances particulières du champ de bataille, pour que l'armée ne présente aucune partie faible à l'ennemi : un général doit considérer le terrain qu'occupe son armée, comme une place qu'on veut mettre en état de défense de tous côtés ; l'artillerie doit être placée dans les lieux les plus favorables pour causer la plus grande perte qu'il est possible à l'ennemi.
7°. Comme, malgré la bonne disposition des troupes, il arrive dans les batailles des événements imprévus qui décident souvent du succès, on doit prendre de bonne heure toutes les précautions convenables pour qu'aucune troupe ne soit abandonnée à elle-même, et se ménager des ressources pour soutenir le combat ; en sorte que, s'il faut céder, on ne le fasse au-moins qu'après avoir fait usage de toutes ses forces. C'est pourquoi on ne saurait trop insister sur la nécessité des réserves. Si le centre, ou l'une des ailes a plié, la seconde ligne ou les réserves, peuvent rétablir l'affaire ; mais il faut pour cet effet des troupes fermes, valeureuses, bien exercées dans les manœuvres militaires, et conduites par des officiers habiles et expérimentés. Alors on peut rétablir le premier désordre, et même faire perdre à l'ennemi l'espérance de la victoire qu'un premier succès aurait pu lui donner. Voyez GUERRE. Il est important que le champ de bataille soit bien connu, afin de juger des lieux propres à chaque espèce de troupe, selon les différents endroits où l'on peut les employer.
8°. Pour soutenir plus surement l'armée et la rendre encore plus respectable à l'ennemi, les redoutes en-avant, fortifiées d'un fossé et placées judicieusement, sont d'un excellent usage. Elles doivent être garnies d'un nombre suffisant d'artillerie et de soldats, pour n'être point emportées par une première attaque. Si quelque partie de l'armée se trouve enfoncée, les troupes des redoutes doivent prendre l'ennemi en flanc et de revers, et lui causer une grande perte ; elles ne peuvent guère manquer de le gêner dans ses mouvements, de les rendre plus lents, et de donner le temps aux corps qui ont plié de se rallier pour le repousser. M. le maréchal de Saxe faisait grand cas des redoutes dans ces circonstances. M. le marquis de Santa-Cruz, qui a écrit avant cet illustre général, en parle également d'une manière très-avantageuse dans ses réflexions militaires.
Il est difficîle de ne pas penser sur ce sujet comme ces célèbres auteurs. Car les redoutes ont cet avantage d'assurer la position de l'armée, de manière qu'elle a différents points d'appui ou de réunion, capables d'arrêter les premiers efforts de l'ennemi, et de protéger par leur feu l'armée qui les soutient.
9°. S'il y a quelque partie de l'armée qu'on veuille éviter de faire combattre, on doit la couvrir d'une rivière, d'un marais, ou, au défaut de cette fortification naturelle, de chevaux de frise, puits, retranchements, etc. de manière que l'ennemi ne puisse pas en approcher. Ainsi supposant qu'on se propose d'attaquer par la droite, et que, pour la fortifier, on soit obligé de dégarnir sa gauche, on la couvre de manière que l'ennemi ne puisse point en approcher, et l'on fait alors à la droite les plus grands efforts avec l'élite de ses troupes.
Il est évident que de cette manière un général peut s'arranger pour ne combattre qu'avec telle partie de son armée qu'il juge à-propos.
Il y a des situations où le général peut juger que toutes les parties de la ligne de l'ennemi ne seront pas également en état de combattre. Dans ce cas, son attention doit être de dégarnir les endroits les moins exposés pour fortifier ceux qui le sont plus. Mais ce mouvement doit être caché autant qu'il est possible à l'ennemi ; car, s'il s'aperçoit de cette manœuvre, il en use de même, et tout devient alors égal de part et d'autre.
On peut voir dans M. de Feuquière qu'un général voyant l'ennemi dégarnir sa droite pour fortifier sa gauche, ne put être engagé à en user de même pour fortifier sa droite, qu'il garda toujours la même disposition : d'où il arriva que les troupes de cette droite se trouvant attaquées par la gauche opposée, très-supérieure en nombre, ne put, malgré l'extrême valeur des corps les plus distingués qui y étaient placés, se soutenir contre le grand nombre qu'ils avaient à combattre.
10°. Une attention encore très-importante dans la disposition des troupes en bataille, c'est de conserver toujours derrière la seconde ligne et les réserves, un espace de terrain assez étendu pour que les troupes ne soient point gênées dans leurs manœuvres ; que si, par exemple, la première ligne est forcée de plier, elle trouve derrière la seconde assez de place pour se rallier et se reformer. Sans cette attention, la déroute de la première ligne ne peut guère manquer d'occasionner celle de toute l'armée.
Telles sont en général les principales observations qui peuvent servir de base à la disposition des troupes dans l'ordre de bataille : la nature du terrain doit décider de leur arrangement particulier. C'est pourquoi on ne peut trop s'appliquer à le connaître parfaitement, pour en tirer tous les avantages qu'il peut procurer.
Les anciens comptaient sept dispositions générales des armées pour combattre ; elles sont rapportées par Vegece, liv. III. ch. xx.
La première, est celle du carré long, que nous avons donné à l'article ARMEE. Voyez ce mot. Ceux qui sont habiles dans la science des armes, dit Vegece, ne la jugent point, cette disposition, la meilleure, parce que dans l'étendue que l'armée occupe il ne se rencontre pas toujours un terrain égal qui lui permette de marcher également ; ayant ainsi des parties plus avancées les unes que les autres, et formant une espèce de ligne courbe, il arrive souvent qu'elle est rompue ou percée. D'ailleurs cet ordre a l'inconvenient, si l'ennemi est supérieur, d'exposer l'armée à être prise en flanc et battue à l'une ou l'autre des ailes, ce qui entraîne la défaite du centre ou du corps de bataille. Vegece prétend qu'il ne faut se servir de l'ordre dont il s'agit ici, que lorsque par la bonté et la supériorité des troupes, on est en état de tourner l'ennemi par ses deux ailes et de l'enfermer de tous côtés : il est d'autant plus désavantageux que les troupes en ligne ont de plus grands intervalles entr'elles. L'armée, pour peu qu'elle soit considérable, présente alors un front d'une longueur excessive ; toutes ses différentes parties sont trop éloignées les unes des autres pour se soutenir mutuellement. La seconde ligne qui est dans un ordre aussi faible, répare rarement le désordre de la première ; et comme le succès du combat dépend presque toujours par cette raison de celui de la première ligne, il parait que pour fortifier cet ordre autant qu'il est possible, il faut, comme on l'a déjà dit, combattre en ligne pleine et fortifier cette ligne par des réserves de cavalerie et d'infanterie.
La seconde disposition générale est l'ordre oblique ou de biais. Dans cet ordre on engage le combat avec l'aîle droite, pendant que l'autre se refuse à l'ennemi. Cette disposition peut servir à faire remporter la victoire à un petit nombre de bonnes troupes, qui sont obligées d'en combattre de plus nombreuses.
Pour cet effet, les deux armées étant en présence et marchant pour se charger, on tient sa gauche (si l'on veut faire combattre sa droite) hors de la portée des coups de l'ennemi, et l'on tombe sur la gauche de l'armée opposée avec tout ce qu'on a de plus braves troupes, dont on a eu soin de fortifier sa droite.
On tâche de faire plier la gauche de l'ennemi, de la pousser, et même de l'attaquer par-derrière.
Lorsqu'on peut y mettre du désordre et la faire reculer, on parvient aisément avec le reste des troupes qui soutiennent l'aîle qui a engagé le combat, à remporter la victoire, et cela sans que le reste de l'armée ait été exposé.
Si l'ennemi se sert le premier de cette disposition, on fait passer promptement à la gauche la cavalerie et l'infanterie qui est en réserve derrière l'armée, et l'on se met ainsi en état de lui résister.
Cet ordre de bataille est regardé par tous les auteurs militaires comme un des meilleurs moyens de s'assurer de la victoire. C'est, dit M. le chevalier de Folard, tout ce qu'il y a de plus à craindre et de plus rusé dans la Tactique.
On peut voir dans l'art de la guerre de M. le maréchal de Puysegur, le cas qu'il faisait de cet ordre. Comme la charge des troupes doit se faire de front et non pas obliquement, cet illustre auteur observe que la partie avancée de la ligne oblique, destinée à charger l'ennemi, doit prendre une position parallèle au front qu'elle veut attaquer, dans le moment qu'elle se trouve à portée de tomber sur lui. Les autres parties de la ligne doivent alors se mettre en colomne pour soutenir celle qui a commencé l'attaque, et avoir attention de se tenir toujours hors de la portée du fusil de la ligne ennemie.
Ce même auteur donne dans son livre une disposition pour l'attaque du poste de M. de Mercy à Nordlingen. Montécuculli propose aussi le même ordre dans ses principes sur l'art militaire : " Si l'on veut, dit cet habîle général, avec son aîle droite, battre la gauche de l'ennemi, ou au contraire, on mettra sur cette aîle le plus grand nombre et les meilleures de ses troupes, et on marchera à grands pas de ce côté-là, les troupes de la première et de la seconde ligne avançant également, au lieu que l'autre aîle marchera lentement, ou ne branlera point du tout ; parce que tandis que l'ennemi sera en suspens, ou avant qu'il s'aperçoive du stratagème, ou qu'il ait songé à y remédier, il verra son côté faible attaqué par le fort de l'ennemi, tandis que sa partie la plus forte demeure oisive, et est au désespoir de ne rien faire ". S'il se rencontre de ce côté-là quelque village, Montécuculli conseille d'y mettre le feu, pour empêcher l'ennemi d'attaquer cette aile, et lui ôter la connaissance de ce qui se passe.
M. le marquis de Santa-Cruz qui admet dans le cinquième volume de ses réflexions militaires, cette même disposition de combattre, lorsque l'on a des troupes qui ne sont pas également bonnes, observe trois choses qu'il est bon de rapporter ici en peu de mots.
La première, c'est qu'il faut commencer de loin à incliner insensiblement la marche de l'aîle où l'on a mis ses meilleures troupes.
La seconde, qu'il faut toujours mettre les troupes sur lesquelles on compte le plus vis-à-vis les faibles de l'ennemi.
Et la troisième, " qu'il faut choisir le terrain le plus avantageux pour l'aîle qui doit attaquer, et couvrir l'autre, si la chose est possible, par un ravin, un canal, un bois, ou une montagne, afin que ces obstacles détournent les ennemis de vouloir vous attaquer par ce côté-là. Lorsque ces avantages ne se rencontrent pas, on peut couvrir cette aîle par des chevaux de frise, des tranchées ou retranchements de charettes, beaucoup d'artillerie ".
La troisième disposition ne diffère de la précédente, qu'en ce qu'on engage le combat par la gauche, au lieu de le faire par la droite.
La quatrième disposition consiste à engager le combat par les deux ailes, en tenant le centre éloigné de l'ennemi.
Pour réussir dans cette disposition sans craindre pour l'infanterie, qui se trouve pour ainsi dire abandonnée de la cavalerie : voici ce qu'il faut faire selon M. le maréchal de Puysegur, qui entre à ce sujet dans un détail un peu plus circonstancié que Vegece.
" Quand les armées sont à cinq ou six cent pas au plus l'une de l'autre, il faut que celle qui est supérieure en cavalerie fasse doubler le pas à ses ailes pour aller attaquer celles de l'ennemi, et qu'en marchant, son aîle droite se jette un peu sur sa gauche, pour déborder par les flancs celles qu'elles vont attaquer, en se tenant un peu obliques pour ne pas trop approcher les escadrons qui joignent l'infanterie, afin de les obliger parlà de se déplacer s'ils veulent vous venir attaquer. Alors s'ils le font, il s'ensuivra qu'ils ne seront plus protégés de l'infanterie. Dans ce cas il est constant que tout l'avantage est pour l'armée dont les ailes iront attaquer ; et comme ces charges de cavalerie sont bien-tôt décidées avant que les lignes de l'infanterie en soient venues aux mains, le combat aux ailes sera fini ".
M. de Puysegur ajoute qu'il y a plusieurs exemples de batailles dans lesquelles les ailes de cavalerie se sont ainsi chargées avant l'infanterie : mais il croit que cela est arrivé plutôt par hasard que par dessein, et il en donne une raison bien naturelle, c'est que la cavalerie allant plus vite que l'infanterie, si ceux qui la conduisent ne la contiennent pas dans sa marche, elle est plutôt aux mains que l'infanterie.
Comme il est assez ordinaire, lorsque la cavalerie a ainsi battu celle de l'ennemi, qu'elle s'emporte toute à la poursuivre, et qu'elle compte le combat fini pour elle, M. de Puysegur observe, " que ceux qui sont habiles et qui ont des troupes dressées n'en laissent aller qu'une partie pour empêcher l'ennemi de se rallier, et qu'avec le surplus ils vont aider leur infanterie à battre celle de l'ennemi en la prenant par les flancs et par derrière ".
La cinquième disposition ne diffère guère de la quatrième, on couvre seulement le centre par des troupes légères qui empêchent l'ennemi d'en approcher. Cette précaution le met plus en sûreté, et quel que soit l'évenement de l'attaque qui se fait par les ailes, il n'est pas absolument abandonné à lui-même.
Observons à cette occasion que les anciens faisaient de leurs troupes légères un usage différent de celui que nous faisons des nôtres. Elles consistaient particulièrement en archers et en frondeurs : ces troupes couvraient, dans l'ordre de bataille, celles qui étaient destinées à combattre de pied ferme, elles servaient à commencer le combat. Après qu'elles avaient lancé leurs traits sur l'ennemi, elles se retiraient par les intervalles des troupes en bataille, pour aller se placer derrière et agir suivant les différentes occasions : ainsi le centre dans la disposition dont il s'agit étant couvert de ces gens de trait, trouvait une protection qui le mettait à couvert d'une attaque brusque.
La sixième disposition est presque semblable à la seconde et à la troisième. Dans cet ordre on choque pour ainsi dire l'armée ennemie perpendiculairement avec une aîle fortifiée des meilleures troupes, et on tâche de la percer et de la mettre en désordre. Suivant Vegece et M. le maréchal de Puysegur, cette disposition est la plus avantageuse pour ceux qui étant inférieurs en nombre et en qualité de troupes, sont obligés de combattre.
Pour former cet ordre, l'armée étant en bataille, et s'approchant de l'ennemi, il faut joindre votre aîle droite à celle de la gauche de l'armée opposée, et combattre cette dernière aîle avec vos meilleures troupes, dont vous devez avoir garni votre droite. Pendant ce combat on doit tenir le reste de la ligne à-peu-près perpendiculaire au front de l'armée ennemie : si par ce moyen on peut la prendre en flanc et par derrière, il est difficîle qu'elle puisse éviter d'être battue ; car votre position presque perpendiculaire au front de cette armée, l'empêche d'être secourue par son aîle droite et par le centre. Cet ordre est assez souvent celui qu'il convient de prendre, selon Vegece et M. le maréchal de Puysegur, quand il s'agit de combattre dans une armée.
M. le chevalier de Folard prétend que ce fut sur cet ordre qu'Epaminondas combattit à Leuctres et à Mantinée ; mais au-lieu qu'à Leuctres il était tombé sur l'une des ailes de l'armée ennemie, à Mantinée il dirigea son attaque sur le centre, assuré, dit Xénophon, qu'avec ses meilleures troupes il enfoncerait l'ennemi, et qu'après avoir fait jour à la bataille, c'est-à-dire au centre, il donnerait l'épouvante au reste.
On peut voir dans le traité de la Colonne de M. le chevalier de Folard, la description et les plans qu'il donne de ces deux batailles.
Enfin la septième et dernière disposition générale de Vegece, ne consiste guère qu'à se conformer au terrain pour mettre l'armée en état de se soutenir contre l'ennemi en profitant de tout ce qui peut assurer sa position, soit par des fortifications naturelles ou artificielles.
Il est évident que les sept dispositions précédentes peuvent être réduites à cinq, comme nous l'avons déjà observé dans les éléments de Tactique ; car la seconde, la troisième et la sixième peuvent être regardées comme la même disposition ou le même ordre. A l'égard de l'usage qu'on peut faire de ces différents ordres, il dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve obligé de combattre. Les anciens ne s'attachaient point à les observer scrupuleusement. La science de la guerre leur en fournissait de particuliers suivant les occasions ; ils savaient suppléer au nombre par la bonté de l'ordre de bataille, et déconcerter l'ennemi par des manœuvres inattendues, en changeant leur ordre de bataille au moment du combat. Ces manœuvres dont l'exécution était prompte et facile, parce que les généraux prenaient eux-mêmes le soin d'exercer et de discipliner leurs troupes, les faisaient souvent triompher du plus fort ; mais il n'y a que la science et le génie militaire qui puissent produire ces ressources : jamais la simple pratique de la guerre ne fera imaginer ces chefs-d'œuvres de conduite qu'on admire dans Scipion et Annibal, dans plusieurs autres généraux de l'antiquité, et dans quelques modernes, tels que les Condé, les Turenne, les Luxembourg, les Créqui, etc. La pratique, comme on l'a déjà dit ailleurs, ne peut donner ni le génie ni la science de la guerre ; le premier est à la vérité un don de la nature que l'art ne donne point, mais l'autre est le fruit d'une étude longue, sérieuse et réfléchie. Cette étude fournit des idées qu'il serait fort difficîle de se procurer soi-même ; par son secours on se fait un amas de préceptes et d'exemples qu'on peut appliquer ensuite selon les occasions ; c'est pourquoi nous pensons qu'on peut tirer un très-grand avantage des ordres de bataille qu'on trouve dans les historiens et dans les auteurs militaires, et cela soit qu'ils aient été exécutés ou qu'ils soient de pure imagination, comme le sont la plupart de ceux que M. le chevalier de Folard a insérés dans son commentaire sur Polybe. Ce n'est pas dans la vue d'imiter absolument ces dispositions qu'on doit les étudier, mais pour en saisir l'esprit, et pour examiner la manière dont ils répondent au but que leurs auteurs se proposaient.
On n'entrera point ici dans un plus grand détail sur ce qui concerne les ordres de bataille : cette matière pour être traitée avec toute l'étendue dont elle est susceptible, exigerait une espèce de volume. On s'est renfermé dans les observations les plus générales et les plus essentielles. On renvoie ceux qui voudront des détails plus circonstanciés et plus étendus, à Vegece, au commentaire sur Polybe du chevalier de Folard, aux Mémoires militaires de M. Guischard, qu'il faut absolument mettre à la suite du précédent ouvrage, qui le rectifie dans beaucoup d'endroits, et qui donne des idées plus exactes de la Tactique des anciens. A ces ouvrages on fera très-bien de joindre l'Art de la guerre de M. le maréchal de Puysegur, les Mémoires de Montecuculli, les Réflexions militaires de M. le marquis de Santacrux, les Mémoires de M. le marquis de Feuquières, les Rêveries ou Mémoires sur la guerre de M. le maréchal de Saxe, etc. A l'égard de l'ordre particulier de chaque espèce de troupe pour combattre, voyez EVOLUTION ; voyez aussi PHALANGE et LEGION.
ORDRE, dans l'Art militaire, se dit du mot que l'on donne tous les jours aux troupes, voyez MOT. Ainsi aller à l'ordre, c'est aller recevoir ou prendre le mot : c'est aussi aller recevoir du général ou du commandant les ordres qu'il a à donner pour tout ce qu'il juge à propos de faire exécuter concernant le service.
A l'armée le lieutenant général de jour prend l'ordre du général ; il le donne au maréchal de camp de jour, qui le distribue au major général de l'infanterie, au maréchal des logis de la cavalerie, au major général des dragons, au général des vivres, au capitaine des guides, et au prévôt de l'armée.
Les majors de brigade de l'infanterie reçoivent l'ordre du major général, et ceux de cavalerie et de dragons du maréchal des logis de la cavalerie et du major général des dragons. Dans les places le commandant donne l'ordre et le mot au major de la place, qui le donne ensuite aux majors et aides-majors des régiments. Voyez MOT. (Q)
ORDRE DE MARCHE, DE BATAILLE, etc. (Marine) Voyez ÉVOLUTIONS NAVALES.
ORDRE, en terme de Commerce, de billets et de lettres de change, est un endossement ou écrit succinct que l'on met au dos d'un billet ou d'une lettre de change, pour en faire le transport et le rendre payable à un autre.
Quand on dit qu'une lettre ou billet de change est payable à un tel ou à son ordre, c'est-à-dire que cette personne peut, si bon lui semble, recevoir le contenu en cette lettre, ou en faire le transport à un autre en passant son ordre en faveur de cet autre. Voyez ENDOSSEMENT.
Ordre, parmi les négociants, signifie aussi le pouvoir et commission qu'un marchand donne à son correspondant ou commissionnaire de lui faire telles et telles emplettes, à tel ou tel prix, ou sous telle autre condition qu'il lui prescrit ; un commissionnaire ou correspondant qui fait quelque chose sans ordre, ou qui Ve au-delà de l'ordre que lui a donné son commettant, est sujet à désaveu. Voyez COMMISSIONNAIRE et CORRESPONDANT.
Ordre se dit encore de la bonne règle qu'un marchand tient dans le maniement de ses affaires, écritures etc. les livres d'un marchand qui ne sont pas tenus en bon ordre, ne peuvent faire foi en justice. Diction. de commerce.
ORDRE, s. m. (Architecture) c'est un arrangement régulier de parties saillantes, dont la colomne est la principale pour composer un bel ensemble. Un ordre parfait a trois parties principales, qui sont le piédestal, la colomne et l'entablement. Cependant, suivant que les circonstances le demandent, on fait des colomnes sans piédestal, et on y substitue une plinthe ; cela n'empêche pas qu'on ne dise qu'un bâtiment est construit selon un tel ou tel ordre, quoiqu'il n'y ait point de colomnes, pourvu que sa hauteur et ses membres soient proportionnés aux règles de cet ordre. L. C. Sturm prétend qu'il n'y a eu d'abord que deux ordres, dont le roi Salomon a fait usage du plus beau pour son temple et de l'autre pour son palais, et que les Corinthiens se sont ensuite appropriés le premier et les Doriens le second ; qu'après cela on en a inventé un qui tient le milieu entre ces deux ordres, et qu'on appelle l'ionien ; que les peuples Toscans en Italie ont contrefait l'ordre dorique, quoique d'une manière plus simple et plus massive, et que c'est de-là que s'est formé l'ordre toscan.
Ces quatre ordres, le toscan, le dorique, l'ionique et le corinthien, sont les seuls que les Grecs aient connu ; aussi Vitruve ne parle point de cinquième ordre. Les Romains ont enfin composé un nouvel ordre de l'ionique et du corinthien, qu'on appelle communément le romain ou le composite. Louis XIV. avait promis une récompense considérable à celui qui inventerait un sixième ordre. Cette promesse mit toutes les imaginations en feu ; mais quoiqu'on se soit donné beaucoup de peine, on n'a rien découvert qui mérite l'approbation des connaisseurs ; car ou l'on a avancé des absurdités qu'on ne saurait admettre dans l'architecture, ou l'on n'a rien présenté qui ne fût déjà compris dans les quatre ordres décrits par Vitruve, et qui n'appartint à l'ordre composé, dont les Romains ont donné le premier exemple. Cela devait être, selon Vilalpande, puisqu'on avait voulu trouver un ordre plus beau que le corinthien qui, selon lui, vient de Dieu immédiatement. Prenant sa pieuse conjecture pour une vérité, Sturm, dans la recherche qu'il a faite d'un nouvel ordre, en a trouvé un inférieur au romain et au corinthien, mais plus beau que l'ionique. Voyez ORDRE ALLEMAND.
Parmi les architectes italiens, Vignole, Palladio et Scamozzi se sont particulièrement distingués à faciliter l'usage des ordres. Vignole surtout a rendu cet usage beaucoup plus facîle qu'il n'était avant lui par une règle générale, qui sert à déterminer toutes les parties des colomnes. Cette règle est telle, le piédestal est toujours le tiers, et l'entablement le quart de toute la colomne. Ainsi en divisant l'endroit où l'on veut mettre la colomne en dix-neuf parties égales, on en donne quatre au piédestal, douze à la colomne, et trois à l'entablement. Si l'on ne veut point de piédestal, on divise cet endroit en cinq parties, dont on donne une à l'entablement et quatre à la colomne. C'est à cause de cette division facîle que la plupart des ouvriers suivent les règles de cet architecte : mais sur quoi sont-elles fondées ?
Palladio est de tous les Architectes celui qui a su le mieux joindre les membres des ordres ; et Scamozzi est singulièrement estimé par la proportion qu'il leur a donnée. Nicolas Goldman dans son traité de stylométris, et dans ses institutions d'Architecture, a tâché de remplir ces trois objets. M. Perrault a donné un très-bel ouvrage sur les ordres, intitulé : Ordonnance des cinq espèces de colomnes. Roland Fréard de Chambray, Charles-Philippes Dieussard, François Blondel et Seyler ont publié des éclaircissements sur les cinq ordres. L'ouvrage de ce dernier auteur peu connu est intitulé : Parallelismus architectorum celebriorum : mais il faut décrire par gradation du simple au composé les ordres que nous avons considérés jusqu'ici sous un point de vue général.
Ordre toscan. C'est le premier, le plus simple et le plus solide de tous les ordres, la hauteur de sa colomne est de sept diamètres pris par le bas. Cette solidité ne comporte ni sculpture, ni autre ornement ; aussi son chapiteau et sa base ont peu de moulures, et son piédestal qui est fort simple, n'a qu'un module de hauteur. On n'emploie cet ordre qu'aux bâtiments qui demandent beaucoup de solidité, comme sont les portes des forteresses, des ponts, des arsenaux, des maisons de force, etc. On garnit souvent ses colomnes de bossages ou de pierres entrecoupées, qui sont ou piquées également par-tout, ou trouées comme des pierres rongées, ou du bois vermiculaire, qu'on appelle rustique vermiculé ; mais cet usage n'est pas approuvé par tous les Architectes.
L'ordre, dont nous venons de parler, est de l'invention des Latins, on le nomme toscan, parce qu'il a pris son origine dans la Toscane.
Ordre dorique. Cet ordre est plus ancien que l'ordre toscan, quoiqu'on le place le second, parce qu'il est plus délicat, et en quelque façon plus composé que celui-ci. Vitruve rapporte dans son architecture, liv. IV. chap. IIIe que Dorus, roi d'Achaïe, s'en est servi le premier pour un temple qu'il éleva à Argos en l'honneur de Junon ; mais on n'y avait observé qu'une mesure arbitraire. Les Athéniens ayant voulu employer cet ordre dans un temple qu'ils consacrèrent à Apollon, crurent que le rapport de la hauteur d'un homme à la longueur de son pied était la proportion la plus convenable. Or la longueur du pied d'un homme étant la sixième partie de sa hauteur, on donna à la colomne de cet ordre six de ses diamètres. Le P. Vilalpande le trouve trop beau pour en faire honneur aux hommes ; il croit qu'il vient immédiatement de Dieu. Il en donne les raisons dans son commentaire sur le prophête ézéchiel, tome III. Mais sans nous arrêter à ces puérilités, fixons le caractère de l'ordre dorique.
La hauteur de la colomne est de huit diamètres ; elle n'a aucun ornement ni dans son chapiteau, ni dans sa base, et la frise est ornée de triglyphes et de métopes.
Les Architectes ont toujours trouvé de grandes difficultés sur la division exacte qu'on doit observer dans cet ordre, parce que l'axe de la colomne doit l'être en même temps du triglyphe qui est au-dessus, et que les entreglyphes ou métopes doivent toujours former un carré exact. Ces circonstances leur ont paru souvent impossibles dans tous les entre-colonnements, et surtout dans les colomnes accouplées. Le même inconvénient a lieu dans les édifices carrés. Aussi les plus célèbres ont été réduits ou à faire des fautes aux bâtiments dans lesquels ils ont employé cet ordre, ou à omettre tout à fait les triglyphes dans la frise ; deux extrémités fâcheuses, qu'il n'appartient qu'à des habiles gens de concilier.
Les anciens ont consacré cet ordre à l'héroïsme. En conséquence ils en ont fait hommage à leurs divinités mâles, telles que Jupiter, Apollon, Hercule, etc. et ils en ont décoré leurs temples. C'est pourquoi on l'emploie fort convenablement aux monuments, aux bâtiments héroïques, aux portes des villes, aux arsenaux, etc.
Ordre ionique. Cet ordre tire son nom de l'Ionie, province d'Asie. C'est le second des Grecs, qui l'ont inventé pour orner un temple consacré à Diane. Il n'est ni si mâle que le dorique, ni si solide que le toscan : sa colomne a neuf diamètres de hauteur, son chapiteau est orné de volutes, et sa corniche de denticules.
Dans son origine, cet ordre n'avait que huit diamètres de la colomne, parce qu'ils avaient voulu le proportionner selon le corps d'une femme, comme ils avaient proportionné l'ordre toscan suivant le corps d'un homme. Poussant plus loin l'imitation, ils copièrent les boucles de leurs cheveux : ce qui donna lieu aux volutes, et enfin ils cannelèrent la colomne pour imiter les plis de leurs vêtements. Voyez l'architecture de Vitruve, liv. IV. chap. j.
Ordre corinthien. C'est, selon les époques de l'invention des ordres, le second ordre, &, selon la proportion la plus délicate, le dernier des quatre. Il fut inventé à Corinthe par Callimaque, sculpteur athénien. Voyez ACANTHE et CHAPITEAU. Son chapiteau est orné de deux rangs de feuilles, et de huit volutes qui en soutiennent le tailloir ; sa colomne a dix diamètres de hauteur, et sa corniche est ornée de modillons. Vilalpande, toujours pieux dans ses origines, soutient que les Grecs ont pris cet ordre au temple de Jérusalem, et que par conséquent Dieu l'avait révélé au roi Salomon.
Ordre composite. Cet ordre est ainsi nommé, parce que son chapiteau est composé de deux rangs de feuilles du corinthien, et des volutes de l'ionique ; on l'appelle italique ou romain, parce qu'il a été inventé par les Romains. Ce fut dans le temps qu'Auguste donna la paix à toute la terre : sa colomne a dix diamètres de hauteur, et sa corniche est ornée de denticules ou modillons simples.
Ordre Allemand. C'est un ordre de l'invention de L. C. Sturm, qui l'appela d'abord ainsi ; mais ayant fait attention qu'il ne lui convenait point de disposer du nom d'une nation, il lui donna un nom plus modeste, celui d'ordre nouveau : son chapiteau a un seul rang de feuilles, et seize volutes ; ce qui est une nouveauté fort naturelle, car ou les autres chapiteaux sont sans feuilles, ou ils en ont deux rangs ; mais cette simplicité produit-elle un effet agréable ? C'est-ce dont les Architectes jugeront par la lecture des chapitres Xe et XIe de la manière d'inventer toutes sortes de bâtiments de parade du même Sturm, inventeur de l'ordre allemand, où il donne les desseins des parties inférieures et supérieures.
Ordre attique, petit ordre de pilastres de la plus courte proportion, qui a une corniche architravée pour entablement comme l'ordre, par exemple, du château de Versailles au-dessus de l'ionique du côté du jardin.
Telles sont les proportions de l'ordre attique : sa hauteur, en y comprenant son piédestal et sa corniche, a ordinairement la moitié de la hauteur de l'ordre sur lequel il est élevé, soit qu'il y ait des piédestaux ou non. Cette hauteur se divise ainsi : le piédestal a le quart de toute la hauteur : les trois autres quarts se divisent en quatorze parties, qui font autant de modules. On prend deux de ces parties, dont l'une est pour la base y compris le listeau, l'autre pour le chapiteau ; et on donne un module 2/3 à la hauteur de la corniche, de sorte qu'il reste dix modules 1/3 pour la hauteur du fût du pilastre, y compris l'astragale du chapiteau. M. Jacques-Français Blondel a publié sur ces proportions une dissertation dans l'architecture française, t. I. p. 83, qui mérite d'être lue.
L'ordre attique était connu des anciens, mais il était différent de celui que nous venons de définir. Pline, dans son Histoire naturelle, liv. XXXVI. dit que les colomnes de cet ordre étaient carrées. M. Perrault, d'après la description de Pline, et sur quelques desseins que M. Demonceaux lui avait communiqués, et que celui-ci avait fait d'après plusieurs chapiteaux trouvés dans des ruines ; M. Perrault, dis-je, donne, dans sa traduction de l'architecture de Vitruve, page 133, le dessein de cet ordre qui est tel : le chapiteau a un collier ou gorgerin, avec un rang de feuilles, un rondeau, un ove, une plate-bande, une gueule renversée, et un listeau. Le fût est carré, et par-tout d'une égale épaisseur. Le bas de la colomne consiste dans une plinthe, un thore, un listeau, une cymaise dorique, et un rondeau.
Ordre caryatique. C'est un ordre qui a des figures de femmes à la place de colomnes. Voyez CARYATIDES. Il y a un ordre de cette espèce au gros pavillon du Louvre, dont les caryatides sont de M. Jacques Sarrazin, sculpteur du roi.
Ordre composé. C'est un ordre arbitraire et de pur caprice, qui n'a aucun rapport avec les cinq ordres d'architecture. Tel est l'ordre du dedans dans l'église de S. Nicolas du Chardonnet à Paris : les chapiteaux des huit colomnes dans la chapelle de Gadagne, dans l'église des Jacobins à Lyon, sont d'ordre composé, et ils sont tous différents les uns des autres. On voit encore à Rome des ordres composés dans les ouvrages d'Architecture du Cavalier Baromini.
Ordre français, ordre dont le chapiteau est composé d'attributs relatifs à la nation française, comme des têtes de cocqs, de fleurs de lys, de pièces des ordres militaires, etc. et qui a les proportions corinthiennes. Il y a un ordre français dans la grande galerie de Versailles ; il est du dessein de M. le Brun, premier peintre du roi.
Ordre gothique. C'est un ordre si éloigné des proportions et des ornements antiques, que ses colomnes sont ou trop massives en manière de piliers, ou aussi menues que des perches avec des chapiteaux sans mesures, taillés de feuilles d'acanthe épineuse, de choux, de chardons, etc.
Ordre persique. C'est un ordre dorique qui a des figures d'esclaves persans au lieu de colomnes, pour porter l'entablement. On voit dans le parallèle de l'Architecture antique avec la moderne de M. de Chambray, un de ces esclaves qui porte un entablement dorique, et qui est copié d'après l'une des deux statues antiques des rois des Parthes, lesquelles sont aux côtés de la porte du salon du palais Farnese à Rome. Telle est l'origine de l'ordre persique : Pausanias, roi des Lacédémoniens, ayant défait les Perses, les vainqueurs élevèrent des trophées des armes de leurs ennemis, qu'ils représentèrent ensuite chargés des entablements de leurs maisons. Voyez l'Architecture de Vitruve, liv. I. chap. j.
Ordre rustique, ordre qui est avec des refends ou bossages. Tels sont les ordres du palais de Luxembourg à Paris.
Je n'ajoute qu'un mot à ce détail de Daviler sur les ordres d'Architecture.
Les curieux voyageurs qui nous ont donné le bel ouvrage des ruines de Palmyre en 1753, remarquent que dans la diversité des ruines qu'ils ont vues en parcourant l'Orient, ils ont eu occasion d'observer que chacun des trois ordres grecs a eu son période à la mode. Les plus anciens édifices ont été doriques ; à cet ordre a succédé l'ionique, qui semble avoir été l'ordre favori, non-seulement en Ionie, mais par toute l'Asie mineure, le pays de la bonne Architecture dans le temps de la plus grande perfection de cet art. Ensuite le corinthien est venu en vogue, et la plupart des édifices de cet ordre qui se trouvent en Grèce semblent postérieurs à l'établissement des Romains dans ce pays-là : enfin a paru l'ordre composé accompagné de toutes les bizarreries, et alors on sacrifia entièrement les proportions à la parure et à la multiplicité mal entendue des ornements. (D.J.)
ORDRE, ce mot, en Vénerie, signifie l'espèce ou les qualités des chiens : on dit un bel ordre de chiens.
ORDRE, la tour d '(Géographie) on appelait ainsi le phare que les Romains avaient élevé à Boulogne-sur-mer, pour servir de guide aux vaisseaux. M. de Valais l'appele, je ne sai pourquoi, turris ordinis ; car ni le mot français ordre, ni le latin ordo, ne sont l'origine d'une pareille dénomination. Ce phare est nommé odraus pharus dans la vie de saint Folcuin, évêque de Terouanne ; c'est donc d'Odraus que parait venir le mot d'ordre, qu'on donne à cette tour ; mais on ignore également et la signification, et l'étymologie de ce mot odraus. (D.J.)
ORDRE
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Science
- Catégorie : Métaphysique
- Affichages : 2806