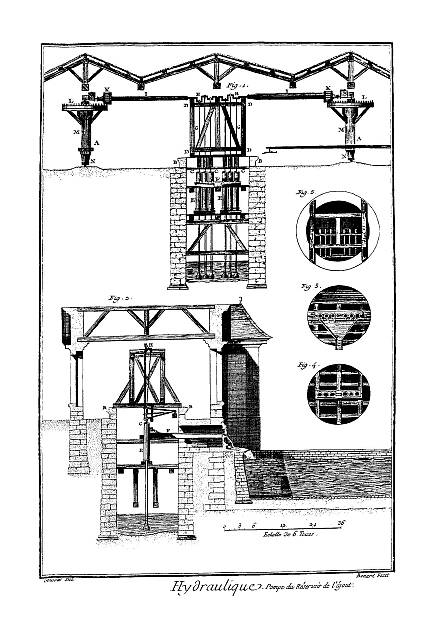S. m. (Métaphysique) puissance de l'âme, qui juge de la convenance, ou de la disconvenance des idées.
Il ne faut pas confondre le jugement avec l'accord successif des connaissances que procurent les sens, indépendamment des facultés intellectuelles ; car le jugement n'a aucune part dans ce qui est aperçu et discerné par le seul effet des sensations. Lorsque nous buvons séparément du vin et de l'eau, les impressions différentes que ces deux liqueurs font sur notre langue, suffisent pour que nous les distinguions l'une de l'autre. Il en est de même des sensations que nous recevons par la vue, par l'ouie, par l'odorat ; le jugement n'y entre pour rien.
Nous ne jugeons pas, lorsque nous apercevons que la neige est blanche, parce que la blancheur de la neige se distingue par la simple vue de la neige. Les hommes et les bêtes acquièrent également cette connaissance par le seul discernement, sans aucune attention, sans aucun examen, sans aucune recherche. Le jugement n'a pas plus lieu dans les cas où l'on est déterminé par sensation à agir, ou à ne pas agir. Si nous sommes, par exemple, placés trop près du feu, la chaleur qui nous incommode nous porte, ainsi que les bêtes, à nous éloigner, sans la moindre délibération de l'esprit.
Le jugement est donc une opération de l'âme raisonnable ; c'est un acte de recherche, par lequel après avoir taché de s'assurer de la vérité, elle se rend à son évidence. Pour y parvenir, elle combine, elle compare ce qu'elle veut connaître avec précision. Elle pese les motifs qui peuvent la décider à agir, ou à ne pas agir. Elle fixe ses desseins ; elle choisit les moyens qu'elle doit préférer pour les exécuter.
On estime les choses sur lesquelles il s'agit d'établir son jugement, en appréciant leur degré de perfection ou d'imperfection, l'état des qualités, la valeur des actions, des causes, des effets, l'étendue et l'exactitude des rapports. On les compte par les règles du calcul ; on les mesure en les comparant à des valeurs, à des quantités, ou à des qualités connues et déterminées.
Cependant comme la faculté intellectuelle que nous appelons jugement, a été donnée à l'homme, non-seulement pour la spéculation, mais aussi pour la conduite de sa vie, il serait dans un triste état, s'il devait toujours se décider d'après l'évidence, et la certitude d'une parfaite connaissance ; car cette évidence étant resserrée dans des bornes fort étroites, l'homme se trouverait souvent indéterminé dans la plupart des actions de sa vie. Quiconque ne voudra manger qu'après avoir Ve démonstrativement qu'un tel mets le nourrira sans lui causer d'incommodité ; et quiconque ne voudra agir, qu'après avoir Ve certainement que ce qu'il doit entreprendre sera suivi d'un heureux succès, n'aura presque autre chose à faire, qu'à se tenir en repos ou à périr d'inanition.
S'il y a des choses exposées à nos yeux dans une entière évidence, il y en a un beaucoup plus grand nombre, sur lesquelles nous n'avons qu'une lumière obscure, et si je puis ainsi m'exprimer, un crépuscule de probabilité. Voilà pourquoi l'usage et l'excellence du jugement se bornent ordinairement à pouvoir observer la force ou le poids des probabilités ; ensuite à en faire une juste estimation ; enfin, après les avoir pour ainsi dire toutes sommées exactement, à se déterminer pour le côté qui emporte la balance.
Les personnes qui ont le plus d'esprit et le plus de mémoire, n'ont pas toujours le jugement le plus solide et le plus profond : j'entends par esprit, l'art de joindre promptement les idées, de les varier, d'en faire des tableaux qui divertissent et frappent l'imagination. L'esprit en ce sens est satisfait de l'agrément de la peinture, sans s'embarrasser des règles sevères du raisonnement. Le jugement au contraire, travaille à approfondir les choses, à distinguer soigneusement une idée d'avec une autre, et à éviter qu'une infinité ne lui donne le change.
Il est vrai que souvent le jugement n'émane pas de si bons principes ; les hommes incapables du degré d'attention qui est requis dans une longue suite de gradations, ou de différer quelque temps à se déterminer, jettent les yeux dessus à vue de pays, et supposent, après un leger coup d'oeil, que les choses conviennent ou disconviennent entr'elles.
Ce serait la matière d'un grand ouvrage, que d'examiner combien l'imperfection dans la faculté de distinguer les idées, dépend d'une trop grande précipitation naturelle à certains tempéraments, de l'ignorance, du manque de pénétration, d'exercice, et d'attention du côté de l'entendement, de la grossiereté, des vices, ou du défaut d'organes, etc. Mais il suffit de remarquer ici, que c'est à se représenter nettement les idées, et à pouvoir les distinguer exactement les unes des autres, lorsqu'il règne entre elles quelque différence, que consiste en grande partie la justesse du jugement. Si l'esprit unit ou sépare les idées, selon qu'elles le sont dans la réalité, c'est un jugement droit. Heureux ceux qui réussissent à le former ! Plus heureux encore ceux que la nature a gratifiés de cette rare prérogative ! (D.J.)
JUGEMENT, (Jurisprudence) est ce qui est ordonné par un juge sur une contestation portée devant lui.
Ce terme se prend aussi quelquefois pour justice en général, comme quand on dit ester en jugement, stare in judicio, poursuivre quelqu'un en jugement.
On entend aussi quelquefois par-là l'audience tenante, comme quand on dit une requête faite en jugement, c'est-à-dire judiciairement ou en présence du juge.
Tout jugement doit être précédé d'une demande ; et lorsqu'il intervient sur les demandes et défenses des parties, il est contradictoire ; s'il est rendu seulement sur la demande, sans que l'autre partie ait défendu ou se présente, alors il est par défaut ; et si c'est une affaire appointée, ce défaut s'appelle un jugement par forclusion ; en matière criminelle, c'est un jugement de contumace.
Il y a des jugements préparatoires, d'autres provisionnels, d'autres interlocutoires, d'autres définitifs.
Les uns sont rendus à la charge de l'appel ; d'autres sont en dernier ressort, tels que les jugements prevôtaux et les jugements présidiaux au premier chef de l'édit ; enfin, il y a des jugements souverains, tels que les arrêts des cours souveraines.
On appelle jugement arbitral, celui qui est rendu par des arbitres.
Premier jugement, est celui qui est rendu par le premier juge, c'est-à-dire devant lequel l'affaire a été portée en première instance.
Jugement de mort, est celui qui condamne un accusé à mort.
Quand il y a plusieurs juges qui assistent au jugement, il doit être formé à la pluralité des voix ; en cas d'égalité, il y a partage ; et si c'est en matière criminelle, il faut deux voix de plus pour départager ; quand il n'y en a qu'une, le jugement passe à l'avis le plus doux.
Dans les causes d'audience, c'est celui qui préside qui prononce le jugement ; le greffier doit l'écrire à mesure qu'il le prononce.
Dans les affaires appointées, c'est le rapporteur qui dresse le dispositif.
On distingue deux parties dans un jugement d'audience, les qualités et le dispositif.
Les jugements sur procès par écrit, outre ces qualités, ont encore le Ve avant le dispositif.
On peut acquiescer à un jugement et l'exécuter, ou en interjeter appel.
Voyez dans le corps de droit civil et canonique les titres de judiciis, de sententiis, de re judicatâ, de exceptione rei judicatae, et l'ordonnance de 1667, tit. de l'exécution des jugements, et aux mots APPEL, DISPOSITIF, QUALITES, VU. (A)
JUGEMENT DE LA CROIX était une de ces épreuves que l'on faisait anciennement dans l'espérance de découvrir la vérité. Ce jugement consistait à donner gain de cause à celui des deux parties qui tenait le plus longtemps ses bras élevés en croix. Voyez M. le président Hénault à l'année 848. (A)
JUGEMENT DE DIEU ; on appelait ainsi autrefois les épreuves qui se faisaient par l'eau bouillante, et autres semblables, dont l'usage a duré jusqu'à Charlemagne.
On donnait aussi le même nom à l'épreuve qui se faisait par le duel, dont l'usage ne fut aboli que par Henri II.
Le nom de jugement de Dieu que l'on donnait à ces différentes sortes d'épreuves, vient de ce que l'on était alors persuadé que le bon ou mauvais succès que l'on avait dans ces sortes d'épreuves, était un jugement de Dieu, qui se déclarait toujours pour l'innocent.
Voyez DUEL, ÉPREUVE et PURGATION VULGAIRE. (A)
JUGEMENS PARTICULIERS DES ROMAINS, (Histoire de la Jurisprudence rom.) Les jugements chez les Romains, étaient ou publics ou particuliers. Ces derniers se rendaient quelquefois devant un tribunal au barreau, quelquefois dans les basiliques, et quelquefois sur le lieu même où le peuple était assemblé de plano.
Par jugement particulier on entend la discussion, l'examen et la décision des contestations qui naissaient au sujet des affaires des particuliers. Voici l'ordre suivant lequel on y procédait.
De l'ajournement. Si le différend ne pouvait pas se terminer à l'amiable (car c'était la première voie que l'on tentait ordinairement), le demandeur assignait sa partie à comparaitre en justice le jour d'audience, c'est-à-dire qu'il le sommait de venir avec lui devant le préteur. Si le défendeur refusait de le suivre, les lois des douze tables permettaient au demandeur de le saisir et de le trainer par force devant le juge ; mais il fallait auparavant prendre à témoin de son refus quelqu'un de ceux qui se trouvaient présents ; ce qui se faisait en lui touchant le bout de l'oreille. Dans la suite il fut ordonné, par un édit du préteur, que si l'ajourné ne voulait pas se présenter sur le champ en justice, il donnerait caution de se représenter un autre jour ; s'il ne donnait pas caution, ou s'il n'en donnait pas une suffisante, on le menait, après avoir pris des témoins, devant le tribunal du préteur, si c'était un jour d'audience, sinon on le conduisait en prison, pour l'y retenir jusqu'au plus prochain jour d'audience, et le mettre ainsi dans la nécessité de comparaitre.
Lorsque quelqu'un demeurait caché dans sa maison, il n'était pas à la vérité permis de l'en tirer, parce que tout citoyen doit trouver dans sa maison un azîle contre la violence ; mais il était assigné en vertu d'un ordre du préteur, qu'on affichait à sa porte en présence de témoins. Si le défaillant n'obéissait pas à la troisième de ces assignations, qui se donnaient à dix jours l'une de l'autre, il était ordonné par sentence du magistrat, que ses biens seraient possédés par ses créanciers, affichés et vendus à l'encan. Si le défendeur comparaissait, le demandeur exposait sa prétention, c'est-à-dire qu'il déclarait de quelle action il prétendait se servir, et pour quelle cause il voulait poursuivre ; car il arrivait souvent que plusieurs actions concouraient pour la même cause. Par exemple, pour cause de larcin, quelqu'un pouvait agir par revendication, ou par condition furtive, ou bien en condamnation de la peine du double, si le voleur n'avait pas été pris sur le fait, ou du quadruple s'il avait été pris sur le fait.
Deux actions étaient pareillement ouvertes à celui qui avait empêché d'entrer dans sa maison, l'action en réparation d'injure, et celle pour violence faite, et ainsi dans les autres matières. Ensuite le demandeur demandait l'action ou le jugement au préteur ; c'est-à-dire qu'il le priait de lui permettre de poursuivre sa partie, et le défendeur de son côté demandait un avocat.
Après ces préliminaires, le demandeur exigeait, par une formule prescrite, que le défendeur s'engageât, sous caution, à se représenter en justice un certain jour, qui pour l'ordinaire était le surlendemain : c'est ce qu'on appelait de la part du demandeur, reum vadari, et de la part du défendeur, vadimonium promittère. S'il ne comparaissait pas, on disait qu'il avait fait défaut ; ce qui s'exprimait par vadimonium deserere. Trais jours après, si les parties n'avaient point transigé, le préteur les faisait appeler, et si l'une des deux ne comparaissait pas, elle était condamnée, à moins qu'elle n'eut des raisons bien légitimes pour excuser son défaut de comparoir.
De l'action. Quand les deux parties se trouvaient à l'audience, le demandeur proposait son action, conçue selon la formule qui lui convenait ; car les conclusions de chaque action étaient renfermées dans des formules tellement propres à chacune, qu'il n'était pas permis de s'en écarter d'une syllabe. On prétend que C. N. Fulvius, qui de greffier devint édîle l'an de Rome 449, fut l'auteur de ces formules ; mais l'empereur Constantin les abrogea toutes, et il fit bien.
La formule de l'action étant réglée, le demandeur priait le préteur de lui donner un tribunal ou un juge ; s'il lui donnait un juge, c'était ou un juge proprement dit, ou un arbitre ; s'il lui donnait un tribunal, c'était celui des commissaires, qu'on appelait recuperatores, ou celui des centumvirs.
Le juge qui était donné de l'ordonnance du préteur connaissait de toutes sortes de matières, pourvu que l'objet fût peu important, mais il ne lui était pas permis, comme je l'ai déjà dit, de s'écarter tant soit peu de la formule de l'action.
L'arbitre connaissait des causes de bonne foi et arbitraires. Quelquefois dans les arbitrages on consignait une somme d'argent, qu'on appelait compromissum, compromis ; c'était un accord fait entre les parties de s'en tenir à la décision de l'arbitre, sous peine de perdre l'argent déposé.
Les commissaires recuperatores connaissaient des causes dans lesquelles il s'agissait du recouvrement et de la restitution des deniers et effets des particuliers : on ne donnait ces juges que dans les contestations de faits, comme en matière d'injure, etc.
Des juges nommés centumvirs. Je m'étendrai un peu davantage sur ce qui regarde les centumvirs. Ils étaient tirés de toutes les tribus, trois de chacune, de sorte qu'ils étaient au nombre de cent cinq ; ce qui n'empêchait pas qu'on ne leur donnât le nom de centumvirs. Ces juges rendaient la justice dans les causes les plus importantes, lorsqu'il s'agissait de questions de droit et non de fait, surtout dans la pétition d'hérédité, dans la plainte de testaments inofficieux, et dans d'autres matières semblables. Les jugements des centumvirs avaient une certaine forme qui leur était propre.
Outre cela, ces juges étaient assis sur des tribunaux, au lieu que les autres n'étaient assis que sur des bancs. Il n'y avait point d'appel de leurs jugements, parce que c'était comme le conseil de tout le peuple. On a lieu de croire que ces magistrats furent créés l'an de Rome 519 ou environ, lorsque le peuple fut partagé pour la première fois en 135 tribus : cela parait par la loi 12, 55, 29. ff. de l'origine du droit. Après le règne d'Auguste, le corps des centumvirs devint plus nombreux, et pour l'ordinaire il montait à cent quatre-vingt : ils étaient distribués en quatre chambres ou tribunaux.
C'étaient les décemvirs qui, par l'ordre du préteur, assemblaient ces magistrats pour rendre la justice. Les décemvirs, quoiqu'au nombre des magistrats subalternes, étaient du conseil du préteur, et avaient une sorte de prééminence sur les centumvirs. Il y en avait cinq qui étaient sénateurs, et cinq chevaliers. Le préteur de la ville présidait au jugement des centumvirs, et tenait, pour ainsi dire, la balance entre les quatre tribunaux.
On se contentait quelquefois de porter les causes légères à deux de ces tribunaux, en sorte qu'on pouvait instruire deux affaires en même-temps. Les centumvirs s'assemblaient dans les basiliques, qui étaient de magnifiques édifices, où était déposée une pique pour marque de juridiction : de-là vient qu'on disait un jugement de la pique, hastae judicium, pour désigner un jugement des centumvirs. C'était les décemvirs qui recueillaient les voix, et cet acte de juridiction s'exprimait par ces mots, hastam cogère, de même que ceux qui présidaient à d'autres tribunaux étaient dits, judicium cogère.
De la forme du jugement. Le juge, comme l'arbitre, devait être approuvé par le défendeur, et on disait alors que le juge convenait. Il fallait aussi que les deux parties, tant le demandeur que le défendeur, souscrivissent le jugement des centumvirs, afin qu'il parut qu'ils y avaient consenti. On donnait pour juge un homme qu'aucun empêchement, soit du côté des lais, soit du côté de la nature, soit du côté des mœurs, n'excluait de cette fonction, et on le donnait dans le même temps qu'il était démandé ; ensuite on présentait les cautions de payer les jugements, et de ratifier celle qui serait ordonnée.
Celle du défendeur était présentée la première, ou par son procureur, en cas qu'il fût absent, ou par lui-même quand il était présent, ou hors le jugement, en confirmant ce qui avait été fait par son procureur. Cette caution se donnait sous trois clauses ; savoir, de payer le juge, de défendre à la demande, et de n'employer ni dol ni fraude ; mais lorsque l'ajourné était obligé de se défendre en personne, il n'était point astraint à donner cette caution, on exigeait seulement qu'il s'engageât d'attendre la décision, ou sous sa caution juratoire, ou sur sa simple parole, ou enfin qu'il donnât caution selon sa qualité.
Le procureur du demandeur devait donner caution que ce qu'il ferait serait ratifié. Lorsqu'on doutait de son pouvoir à quelque égard, ou bien lorsqu'il était du nombre de ceux qu'on n'obligeait point de représenter leurs pouvoirs, tels qu'étaient les parents et alliés du demandeur, on prenait cette précaution pour empêcher que les jugements ne devinssent illusoires, et que celui au nom duquel on avait agi ne fût obligé d'essuyer un nouveau procès pour la même chose. Outre cela, si la prétention du demandeur était mal fondée, l'argent déposé pour caution était un appât qui engageait le défendeur à se présenter pour y répondre. Cet argent déposé s'appelait sacramentum.
Suivait la contestation en cause, qui n'était que l'exposition du différend faite par les deux parties devant le juge en présence de témoins, testato. Ce n'était que de la contestation en cause que le jugement était censé commencer ; d'où vient qu'avant le jugement commencé, et avant la cause contestée, étaient deux expressions équivalentes. Après la contestation, chaque plaideur assignait sa partie adverse à trois jours, ou au surlendemain : c'est pourquoi cette assignation était appelée comperendinatio, ou condictio. Ce jour-là il y avait un jugement rendu, à moins qu'une maladie sérieuse, morbus sonticus, n'eut empêché le juge ou l'un des plaideurs, de se trouver à l'audience ; dans ce cas on prorogeait le délai, dies diffendebatur.
Si une des parties manquait de comparaitre sans alléguer l'excuse de maladie, le préteur donnait contre le défaillant un édit péremptoire, qui était précédé de deux autres édits. Si les deux parties comparaissaient, le juge jurait d'abord qu'il jugerait suivant la loi, et ensuite les deux plaideurs prêtaient, par son ordre, le serment de calomnie, c'est-à-dire, que chacun affirmait que ce n'était point dans la vue de frustrer ou de vexer son adversaire qu'il plaidait : calomniari pris dans ce sens, signifiait chicaner. Dans certaines causes, le demandeur évaluait par serment la chose qui faisait la matière de la contestation, c'est-à-dire qu'il affirmait avec serment que la chose contestée valait tant ; c'est ce qu'on appelait in litem jurare ; cela avait lieu dans les causes de bonne foi, lorsqu'on répétait la même chose, ou qu'il était intervenu dol ou contumace de la part du défendeur.
Quand le juge était seul, il s'associait pour conseil un ou deux de ses amis, qui étaient instruits dans la science des lois ; alors on plaidait la cause ; ce qui se faisait en peu de mots, et c'est ce qu'on appelait causes sommaires, causae conjectio, ou par des discours plus longs ou composés avec plus d'art ; telles sont les oraisons ou plaidoyers de Cicéron pour Quintius et pour Roscius le comédien. On donnait le nom de moratores à ces avocats déclamateurs, qui n'étaient bons qu'à retarder la décision des causes, qui causam morabantur. Enfin, on présidait à l'audition des témoins, et l'on produisait les registres et les autres pièces qui pouvaient servir à instruire le procès.
De la fin du jugement. L'après-midi, après le coucher du soleil, on prononçait le jugement, à moins que le juge n'eut pas bien compris la cause ; car dans ce cas il jurait qu'il n'était pas suffisamment instruit, sibi non liquere ; et par cet interlocutoire il était dispensé de juger : c'est pourquoi dans la suite les juges, pour ne pas hazarder mal-à-propos un jugement, demandèrent quelquefois la décision de l'empereur, ou bien ils ordonnaient une plus ample information. Cependant cette plus ample information n'était gueres usitée que dans les jugements publics. Ordinairement les juges prononçaient qu'une chose leur paraissait être ou n'être pas ainsi : c'était la formule dont ils se servaient, quoiqu'ils eussent une pleine connaissance de la chose dont ils jugeaient ; quand ils ne suivaient pas cette manière de prononcer, ils condamnaient une des parties et déchargeaient l'autre.
Pour les arbitres, ils commençaient par déclarer leur avis ; si le défendeur ne s'y soumettait pas, ils le condamnaient, et lorsqu'il était prouvé qu'il y avait dol de sa part, cette condamnation se faisait conformément à l'estimation du procès ; au lieu que le juge faisait quelquefois réduire cette estimation, en ordonnant la prisée.
Dans les arbitrages, il pouvait avoir égard à ce que la foi exigeait. Cependant les arbitres étaient aussi soumis à l'autorité du préteur, et c'était lui qui prononçait et faisait exécuter leur jugement aussi-bien que celui des autres juges. Aussi-tôt qu'un juge avait prononcé, soit bien ou mal, il cessait d'être juge dans cette affaire.
Après le jugement rendu, on accordait quelquefois au condamné, pour des causes légitimes, la restitution en entier : c'était une action pour faire mettre la chose ou la cause au même état où elle était auparavant. On obtenait cette action, ou en exposant qu'on s'était trompé soi-même, ou en alléguant que la partie adverse avait usé de fraude ; par-là on n'attaquait point proprement le jugement rendu, au lieu que l'appel d'une sentence est une preuve qu'on se plaint de son injustice.
Si le défendeur, dans les premiers trente jours depuis sa condamnation, n'exécutait pas le jugement, on n'en interjetait point appel, mais le préteur le livrait à son créancier pour lui appartenir en propriété comme son esclave, nexus creditori addicebatur, et celui-ci pouvait le retenir prisonnier jusqu'à ce qu'il se fût acquitté, ou en argent, ou par son travail. Le demandeur de son côté était exposé au jugement de calomnie. On entendait par calomniateurs, ceux qui pour de l'argent suscitent un procès sans sujet. Dans les actions de partage, le défendeur était obligé de faire le serment de calomnie comme le demandeur.
Enfin, si le juge, sciemment et par mauvaise foi avait rendu un jugement injuste, il devenait garant du procès, litem faciebat suam, c'est-à-dire qu'il était contraint d'en payer la juste estimation. Quelquefois même on informait de ce crime suivant la loi établie contre la concussion. Si le juge était convaincu d'avoir reçu de l'argent des plaideurs, il était condamné à mort suivant la loi des douze tables. C'en est assez pour ce qui regarde les jugements particuliers. Nous parlerons dans un autre article des jugements publics, dont la connaissance est encore plus intéressante. (D.J.)
JUGEMENS PUBLICS DES ROMAINS, (Histoire de la Jurisp. rom.) Les jugements publics de Rome étaient ceux qui avaient lieu pour raison de crimes ; ils sont ainsi appelés, parce que dans ces jugements l'action était ouverte à tout le monde. On peut donc les définir des jugements que les juges, donnés par un commissaire qui les présidait, rendaient pour la vengeance des crimes, conformément aux lois établies contre chaque espèce de crime.
Ces jugements étaient ordinaires ou extraordinaires ; les premiers étaient exercés par des préteurs, et les seconds par des commissaires appelés parricidii et duumviri ; c'étaient des juges extraordinairement établis par le peuple. Les uns et les autres rendaient leurs jugements publics, tantôt au barreau, tantôt au champ de Mars, et quelquefois même au capitole.
Dans les premiers temps, tous les jugements publics étaient extraordinaires ; mais environ l'an de Rome 605, on établit des commissions perpétuelles, questiones perpetuae ; c'est-à-dire qu'on attribua à certains préteurs la connaissance de certains crimes, de sorte qu'il n'était plus besoin de nouvelles lois à ce sujet. Cependant depuis ce temps-là il y eut beaucoup de commissions exercées, ou par le peuple lui-même dans les assemblées, ou par des commissaires créés extraordinairement ; et cela à cause de l'atrocité ou de la nouveauté du crime, dont la vengeance était poursuivie, comme, par exemple, dans l'affaire de Milon, qui était accusé d'avoir tué Clodius, et dans celle de Clodius lui-même, accusé d'avoir violé les saints mystères. C'est ainsi que l'an de Rome 640, L. Cassius Longinus informa extraordinairement de l'inceste des vestales. Les premières commissions perpétuelles furent celles qu'on établit pour la concussion, pour le péculat, pour la brigue, et pour le crime de lèze-majesté.
Le jugement de concussion est celui par lequel les alliés des provinces répétaient l'argent que les magistrats préposés pour les gouverner, leur ont enlevé contre les lais. C'est pourquoi Cicéron dans ses plaidoyers contre Verrès, donne à la loi qui concernait les concussions, le nom de loi sociale. En vertu de la loi julia on pouvait poursuivre par la même action ceux à qui cet argent avait passé, et les obliger à le restituer, quoiqu'il paraisse que la peine de l'exil avait aussi été établie contre les concussionnaires.
Le jugement de péculat est celui dans lequel on accusait quelqu'un d'avoir volé les deniers publics ou sacrés. Le jugement pour le crime d'argent retenu a beaucoup d'affinité avec le péculat : son objet était de faire restituer les deniers publics restés entre les mains de quelqu'un. Celui qui, par des voies illégitimes, tâchait de gagner les suffrages du peuple, pour parvenir aux honneurs, était coupable de brigue ; c'est pourquoi le jugement qui avait ce crime pour objet, cessa d'être en usage à Rome, lorsque l'élection des magistrats eut été remise au soin du prince, et qu'elle ne dépendit plus du peuple.
Le crime de lèze-majesté embrassait tout crime commis contre le peuple romain et contre sa sûreté, comme emmener une armée d'une province, déclarer la guerre de son chef, aspirer à la souveraine autorité sans l'ordre du peuple ou du sénat, soulever les légions, etc. Mais sous le spécieux prétexte de ce crime, les empereurs dans la suite firent périr un si grand nombre d'innocens, que Pline, dans son panégyrique de Trajan, dit fort élégamment que le crime de lèze-majesté était sous Domitien le crime unique et particulier de ceux qui n'en avaient commis aucun. Or la majesté, pour le dire ici en passant, dans le sens qu'on prend aujourd'hui ce terme, ou plutôt qu'on devrait le prendre, n'est autre chose que la dignité et le respect qui résulte de l'autorité et des charges. Sous les empereurs, ce crime était qualifié d'impiété, etc.
A ces commissions, le dictateur Sylla ajouta dans la suite celles contre les assassins, les empoisonneurs et les faussaires. On peut voir dans le titre des pandectes sur cette loi, qui sont ceux qui passaient pour coupables des deux premiers crimes. Celui-là commet le crime de faux, qui fait un testament faux, ou autre acte faux, de quelque nature qu'il sait, ou bien qui fabrique de la fausse monnaie ; et comme ce crime se commettait plus fréquemment dans les testaments et dans la fabrication de la monnaie, bientôt après Cicéron contre Verrès, liv. I. chap. xlij, appelle loi testamentaire et pécuniaire, celle qui avait été faite pour la poursuite et la punition de ce crime.
On établit encore d'autres commissions, comme celles qui furent établies en vertu de la loi pompeia touchant les parricides, dont le supplice consistait, en ce qu'après avoir été fouettés jusqu'au sang, ils étaient précipités dans la mer, cousus dans un sac avec un singe, un chien, un serpent et un coq ; si la mer était trop éloignée, ils étaient, par une constitution de l'empereur Adrien, exposés aux bêtes, ou brulés vifs. On établit des commissions en vertu de la loi julia, touchant la violence publique et la violence particulière. La violence publique était celle qui donnait principalement atteinte au bien ou au droit public, et la violence particulière était celle qui donnait atteinte au bien ou au droit particulier. Il y eut encore d'autres commissions de même nature, comme contre les adultères, les par jures : etc.
Voici l'ordre qu'on suivait dans les jugements publics. Celui qui voulait se porter accusateur contre quelqu'un, le citait en justice de la manière que nous avons dit en parlant des jugements particuliers. Souvent de jeunes gens de la première condition, qui cherchaient à s'illustrer en accusant des personnes distinguées dans l'état, ou qui, comme parle Cicéron, voulaient rendre leur jeunesse recommandable, ne rougissaient point de faire ce personnage. Ensuite l'accusateur demandait au préteur la permission de dénoncer celui qu'il avait envie d'accuser : ce qu'il faut par conséquent distinguer de l'accusation même ; mais cette permission n'était accordée ni aux femmes, ni aux pupilles, si ce n'est en certaines causes, comme lorsqu'il s'agissait de poursuivre la vengeance de la mort de leur père, de leur mère, et de leurs enfants, de leurs patrons et patrones, de leurs fils ou filles, petits-fils ou petites-filles. On refusait aussi cette permission aux soldats et aux personnes infâmes ; enfin il n'était pas permis, selon la loi Memmia, d'accuser les magistrats, ou ceux qui étaient absens pour le service de la république.
S'il se présentait plusieurs accusateurs, il intervenait un jugement qui décidait auquel la dénonciation serait déférée, ce qu'on appelait divination : on peut voir Asconius sur la cause et l'origine de ce nom ; et les autres pouvaient souscrire à l'accusation, s'ils le jugeait à propos. Ensuite au jour marqué, la dénonciation se faisait devant le préteur dans une certaine formule. Par exemple : " je dis que vous avez dépouillé les Siciliens, et je répète contre vous cent mille sesterces, en vertu de la loi " ; mais il fallait auparavant, que l'accusateur prêtât le serment de calomnie, c'est-à-dire, qu'il affirmât que ce n'était point dans la vue de noircir l'accusé par une calomnie, qu'il allait le dénoncer. Si l'accusé ne répondait point, ou s'il avouait le fait, on estimait le dommage dans les causes de concussion ou de péculat ; et dans les autres, on demandait que le coupable fût puni : mais s'il niait le fait, on demandait que son nom fût reçu parmi les accusés, c'est-à-dire, qu'il fût inscrit sur les registres au nombre des accusés. Or on laissait la dénonciation entre les mains du préteur, sur un libelle signé de l'accusateur, qui contenait en détail toutes les circonstances de l'accusation. Alors le préteur fixait un jour, auquel l'accusateur et l'accusé devaient se présenter ; ce jour était quelquefois le dixième, et quelquefois le trentième. Souvent dans la concussion ce delai était plus long, parce qu'on ne pouvait faire venir des provinces les preuves qu'après beaucoup de recherches. Les choses étant dans cet état, l'accusé avec ses amis et ses proches, prenait un habit de deuil, et tâchait de se procurer des partisans.
Le jour fixé étant arrivé, on faisait appeler par un huissier les accusateurs, l'accusé, et ses défenseurs : l'accusé qui ne se présentait pas était condamné ; ou si l'accusateur était défaillant, le nom de l'accusé était rayé des registres. Si les deux parties comparaissaient, on tirait au sort le nombre de juges que la loi prescrivait. Ils étaient pris parmi ceux qui avaient été choisis pour rendre la justice cette année-là, fonction qui se trouvait dévolue, tantôt aux sénateurs, tantôt aux chevaliers, auxquels furent joints par une loi du préteur Aurelius Cotta, les tribuns du trésor, qui furent supprimés par Jules-César ; mais Auguste les ayant rétablis, il en ajouta deux cent autres pour juger des causes qui n'avaient pour objet que des sommes modiques.
Les parties pouvaient recuser ceux d'entre ces juges qu'ils ne croyaient pas leur être favorables, et le préteur ou le président de la commission, en tirait d'autres au sort pour les remplacer ; mais dans les procès de concussion, suivant la loi Servilia, l'accusateur, de quatre cent cinquante juges, en présentait cent, desquels l'accusé en pouvait seulement recuser cinquante. Les juges nommés, à moins qu'il ne se recusassent eux-mêmes pour des causes légitimes, juraient qu'ils jugeraient suivant les lais. Alors on instruisait le procès par voie d'accusation et de défense.
L'accusation était surtout fondée sur des témoignages qui sont des preuves où l'artifice n'a point de part. On en distingue de trois sortes ; 1°, les tortures, qui sont des témoignages que l'on tirait des esclaves par la rigueur des tourments, moyens qu'il n'était jamais permis d'employer contre les maîtres, sinon dans une accusation d'inceste ou de conjuration. 2°. Les témoins qui devaient être des hommes libres, et d'une réputation entière. Ils étaient ou volontaires ou forcés ; l'accusateur pouvait accuser ceux-ci en témoignage, en vertu de la loi ; les uns et les autres faisaient leur déposition après avoir prêté serment, d'où vient qu'on les appelait juratores. Mais il y avait d'autres juratores, pour le dire en passant, chargés d'interroger ceux qui entraient dans un port sur leur nom, leur patrie, et les marchandises qu'ils apportaient. Plaute en fait mention in trinummo, act. 4. sc. 2. Ve 30. Je reviens à mon sujet.
La troisième espèce de preuve sur laquelle on appuyait l'accusation, était les registres, et sous ce nom sont compris tous les genres d'écritures, qui peuvent servir à établir une cause. Tels sont, par exemple, les livres de recette et de payement, les inventaires de meubles qu'on doit vendre à l'encan, les registres des Banquiers. Ces titres produits, l'accusateur établissait son accusation par un discours, dans lequel il se proposait de justifier la réalité des crimes dont il s'agissait, et d'en montrer l'atrocité. Les avocats de l'accusé, opposaient à l'accusateur une défense propre à exciter la commisération ; c'est pourquoi, outre les témoignages en faveur de l'accusé, ils mettaient en usage des raisonnements tirés de sa conduite passée, et allaient même jusqu'aux conjectures et aux soupçons. Dans la péroraison surtout, ils employaient tous leurs efforts pour adoucir, pour toucher et fléchir l'esprit des juges.
Outre les avocats, l'accusé présentait des personnes de considération qui s'offraient de parler en sa faveur ; et c'est ce qui arrivait principalement lorsque quelqu'un était accusé de concussion. On lui accordait presque toujours dix apologistes, comme si ce nombre eut été réglé par les lois ; de plus, on faisait encore paraitre des personnes propres à exciter la compassion, comme les enfants de l'accusé, qui étaient en bas-âge, sa femme et autres semblables.
Ensuite les juges rendaient leur jugement, à moins que la loi n'ordonnât une remise, comme dans le jugement de concussion. La remise comperendinatio différait de la plus ample information, ab ampliatione, surtout en ce que celle-ci était pour un jour certain au gré du préteur, et celle-là toujours pour le sur-lendemain, et en ce que dans la remise, l'accusé parlait le premier, au lieu que le contraire arrivait dans le plus amplement informé.
Le jugement se rendait de cette sorte. Le préteur distribuait aux juges des tablettes ou bulletins, et leur ordonnait de conférer entr'eux pour donner leur avis. Ces tablettes étaient de trois sortes, l'une d'absolution, sur laquelle était écrite la lettre A, absolvo ; l'autre de condamnation, sur laquelle était écrite la lettre C, condemno, et la troisième de plus ample information, sur laquelle étaient écrites les lettres N et L, non liquet, qui signifiaient qu'il n'était pas clair ; et ce plus amplement informé se prononçait d'ordinaire lorsque les juges étaient incertains s'ils devaient absoudre ou condamner.
Les juges jetaient ces tablettes dans une urne, et lorsqu'on les en avait retirées, le préteur à qui elles avaient fait connaître quel devait être le jugement, le prononçait après avoir quitté sa prétexte. Il était conçu suivant une formule prescrite, savoir que quelqu'un paraissait avoir fait quelque chose, et qu'il paraissait avoir eu raison de la faire, etc. et cela apparemment, parce qu'ils voulaient montrer une espèce de doute.
Lorsque les voix étaient égales, l'accusé était renvoyé absous. Souvent la formule de condamnation renfermait la punition ; par exemple, il parait avoir fait violence, et pour cela je lui interdis le feu et l'eau. Mais quoique la punition ne fût pas exprimée, la loi ne laissait pas d'exercer toute son autorité contre le coupable, à peu près de même qu'aujourd'hui en Angleterre les juges particuliers qu'on appelle jurès, prononcent que l'accusé est coupable ou innocent, et le juge a soin de faire exécuter la loi. L'estimation du procès, estimatio litis, c'est-à-dire la condamnation aux dommages suivait la condamnation de l'accusé, dans les jugements de concussion et de péculat ; et dans les autres, la punition selon la nature du délit.
Si l'accusé était absous, il avait deux actions à exercer contre l'accusateur : celle de calomnie, s'il était constant que par une coupable imposture, il eut imputé à quelqu'un un crime supposé ; la punition consistait à imprimer avec un fer sur le front du calomniateur la lettre K ; car autrefois le mot de calomnie commençait par cette lettre ; de-là vient que les Latins disent integrae frontis hominem, un homme dont le front est entier, pour dire un homme de probité. La seconde action était celle de prévarication, s'il était prouvé qu'il y eut eu, de la part de l'accusateur, collusion avec l'accusé, ou qu'il eut supprimé de véritables crimes.
Outre le préteur, il y avait encore pour présider à ces sortes de jugements, un autre magistrat qu'on appelait judex quaestionis. Sigonius, dont le célèbre Nood adopte le sentiment, pense que cette magistrature fut créée après l'édilité, et que le devoir de cette charge consistait à faire les fonctions du préteur en son absence, à instruire l'action donnée, à tirer les juges au sort, à ouir les témoins, à examiner les registres, à faire appliquer à la torture, et à accomplir les autres choses que le préteur ne pouvait pas faire par lui-même, tant à cause de la bienséance, qu'à cause de la multitude de ses occupations.
Quoiqu'il y eut des commissions perpétuelles établies, cependant certaines accusations se poursuivaient devant le peuple dans les assemblées, et l'accusation de rébellion, perduellionis, se poursuivait toujours dans les assemblées par centuries. Or, on appelait perduellis, celui en qui on découvrait des attentats contre la république. Les anciens donnaient le nom de perduelles aux ennemis.
Ainsi on réputait coupable de ce crime celui qui avait fait quelque chose directement contraire aux lois qui favorisent le droit des citoyens et la liberté du peuple ; par exemple, celui qui avait donné atteinte à la loi Porcia, statuée l'an de Rome 556, par P. Porcius Laeca, tribun du peuple, ou à la loi Sempronia. La première de ces lois défendait de battre ou de tuer un citoyen Romain ; la seconde défendait de décider de la vie d'un citoyen Romain sans l'ordre du peuple ; car le peuple avait un droit légitime de se réserver cette connaissance, et c'était un crime de lèze-majesté des plus atroces que d'y donner atteinte.
Les jugements se rendaient dans les assemblées du peuple par tribus. Lorsque le magistrat ou le souverain pontife accusait quelqu'un d'un crime qui n'emportait pas peine capitale, mais où il s'agissait seulement d'une condamnation d'amende, ou lorsque la condamnation capitale ayant été remise à un jour certain, l'accusé, avant que ce jour fut arrivé, prenait de lui-même le parti de s'exiler ; alors ces assemblées suffisaient pour confirmer son exil, comme il parait par Tite-Live, lib. II. cap. xxxv. lib. XXVI. cap. IIIe
Voici quelle était la forme des jugements du peuple. Le magistrat qui avait envie d'accuser quelqu'un, convoquait l'assemblée du peuple par un héraut public ; et de la tribune, il assignait un jour à l'accusé pour entendre son accusation. Dans les accusations qui allaient à la peine de mort, le magistrat lui demandait une caution, vades, laquelle était personnellement obligée de se représenter, ce qui fut pratiqué pour la première fois à l'égard de Quintius, l'an de Rome 291. Dans les accusations qui ne s'étendaient qu'à l'amende, il lui demandait des cautions pécuniaires, praedes.
Le jour marqué étant arrivé, s'il n'y avait point d'opposition de la part d'un magistrat égal ou supérieur, on faisait appeler l'accusé, de la tribune, par un héraut ; s'il ne comparaissait pas, et qu'on n'alléguât point d'excuse en sa faveur, il était condamné à l'amende. S'il se présentait, l'accusateur établissait son accusation par témoins et par raisonnements, et la terminait après trois jours d'intervalle. Dans toutes les accusations, l'accusateur concluait à telle peine ou amende qu'il jugeait à propos ; et sa requisition s'appelait inquisitio. Ensuite l'accusateur publiait par trois jours de marché consécutifs son accusation rédigée par écrit, qui contenait le crime imputé, et la punition demandée ; le troisième jour de marché, il finissait sa quatrième accusation, et alors on donnait à l'accusé la liberté de se défendre.
Après cela le magistrat qui s'était porté accusateur, indiquait un jour pour l'assemblée ; ou si c'était un tribun du peuple qui accusât quelqu'un de rebellion, il demandait jour pour l'assemblée à un magistrat supérieur ; dans ces circonstances, l'accusé en habit de deuil, avec ses amis, sollicitait le peuple par des prières et des supplications redoublées ; et le jugement se rendait en donnant les suffrages, à moins qu'il n'intervint quelqu'opposition, ou que le jugement n'eut été remis, à cause des auspices, pour cause de maladie, d'exil, ou par la nécessité de rendre à quelqu'un les derniers devoirs ; ou bien à moins que l'accusateur n'eut prorogé lui-même le délai en recevant l'excuse ; ou que s'étant laissé fléchir, il ne se fût entièrement désisté de l'accusation ; enfin on suivait l'absolution de l'accusé, ou sa punition s'il avait été condamné ; mais les différents genres de peines qui étaient portées par la condamnation dans les jugements publics et particuliers, demandent un article à part ; ainsi voyez PEINES. (Jurisprudence Rom.)
Nous avons tiré le détail qu'on vient de lire du Traité de M. Nieuport, et lui-même a formé son bel extrait sur le savant ouvrage de Sigonius, de judiciis, et sur celui de Siccana, de judicio centum virali. (D.J.)
JUGEMENT DE ZELE, (Histoire des Juifs) c'est ainsi que les docteurs juifs nomment le droit par lequel chacun pouvait tuer sur le champ celui qui chez les anciens Hébreux renonçait au culte de Dieu, à sa loi, ou qui voulait porter ses compatriotes à l'idolâtrie. Grotius cite, pour prouver ce droit, le chapitre ix. du Deutéronome ; mais ce savant homme s'est trompé dans l'application, car la loi du Deutéronome suppose une condamnation en justice, et elle veut seulement que chacun se porte pour accusateur du crime dont il s'agit.
Si Phinées exerça le jugement de zèle, comme il parait par les Nombres ; ch. xxv. Ve 7. il faut remarquer que le gouvernement du peuple d'Israèl n'était pas alors bien formé.
L'exemple des éphores qu'on cite encore pour justifier que même depuis les établissements des tribunaux civils, les simples particuliers ont conservé, dans les pays policés, quelque reste du droit de punir que chacun avait dans l'indépendance de l'état de nature ; cet exemple, dis-je, ne le démontre pas, parce que quand les éphores faisaient mourir quelqu'un sans autre forme de procès, ils étaient censés le faire par autorité publique, supposé que cette prérogative fût renfermée dans l'étendue des droits dont Lacédémone les avait revêtus, expressément ou tacitement. Mais, pour abréger, il vaut mieux renvoyer le lecteur à la dissertation de M. Buddeus, de jure zelatorum in gente hebraeâ. (D.J.)
JUGEMENT UNIVERSEL, (Peinture) ce mot désigne en peinture la représentation du jugement dernier prédit dans l'Evangile. Plusieurs artistes s'y sont exercés dès le renouvellement de l'art en Italie, Lucas Signorelli à Orviette, Lucas de Leyde en Hollande, Jean Cousin à Vincennes, le Pontorme à Florence, et Michel-Ange à Rome. On a déjà parlé, au mot ÉCOLE FLORENTINE du tableau du jugement de Michel-Ange, dans lequel il étale tant de licences et de beautés :
Larvarum omnigenas species, et ludicra miris
Induxit portenta modis ; stygiasque sorores,
Infernumque senem, conto simulacra cientem,
Et vada cerulaeis sulcantem livida remis.
Cependant le premier qui ait hasardé de représenter ce sujet, est André Orgagna né à Florence en 1329 : doué d'une imagination vive et d'une grande fécondité pour l'expression, il osa peindre dans la cathédrale de Pise le jugement universel, aussi fortement que singulièrement. D'un côté, son tableau représentait les grands de la terre plongés dans le trouble des plaisirs du siècle ; d'un autre côté, regnait une solitude, où S. Magloire fait voir à trois rais, qui sont à la chasse avec leurs maîtresses, les cadavres de trois autres princes ; ce que l'artiste exprima si bien, que l'étonnement des rois qui allaient chassant, était marqué sur leur visage ; il y en avait un qui, en s'écartant, se bouchait le nez pour ne pas sentir la puanteur de ces corps à demi-pourris. Au milieu du tableau, Orgagna peignit la mort avec sa faulx, qui jonchait la terre de gens de tout âge et de tout rang, de l'un et de l'autre sexe, qu'elle étendait impitoyablement à ses pieds. Au haut du tableau, paraissait Jesus-Christ au milieu de ses douze apôtres, assis sur des nuages tout en feu : mais l'artiste avait principalement affecté de représenter, d'une manière ressemblante, ses intimes amis dans la gloire du paradis, et pareillement ses ennemis dans les flammes de l'enfer. Il a été trop bien imité sur ce point par des gens qui ne sont pas peintres. (D.J.)
JUGEMENT et JUGE, (Médecine) ce mot signifie la même chose que crise, dont il est la traduction littérale : mais le dernier qui est grec, et qui a été adopté par les auteurs latins et français, est presque le seul qui soit en usage, tandis que l'adjectif jugé, dérivé du mot français jugement, est au contraire d'un usage très-commun ; ainsi l'on dit d'une maladie, qu'elle est terminée par une crise, ou qu'elle est jugée au septième ou au onzième jour, etc. Voyez CRISE. (b)
JUGEMENT
- Détails
- Écrit par Louis de Cahusac (B)
- Catégorie parente: Science
- Catégorie : Métaphysique
- Affichages : 2376