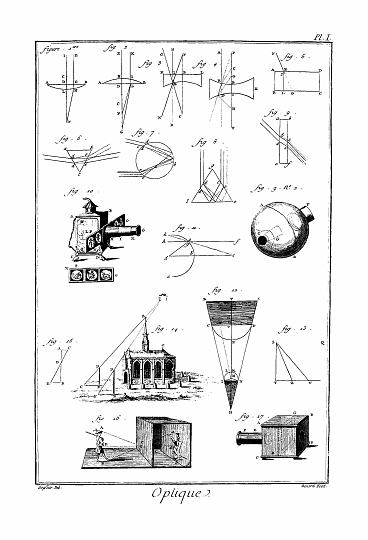sub. fém. (Arts mécaniques).
De la Maçonnerie en général. Sous le nom de Maçonnerie, l'on entend non-seulement l'usage et la manière d'employer la pierre de différente qualité, mais encore celle de se servir de libaye, de moilon, de plâtre, de chaux, de sable, de glaise, de roc, etc. ainsi que celle d'excaver les terres pour la fouille des fondations (a) des bâtiments, pour la construction des terrasses, des taluds, et de tout autre ouvrage de cette espèce.
Ce mot vient de maçon ; et celui-ci, selon Isidore, du latin machio, un machiniste, à cause des machines qu'il emploie pour la construction des édifices et de l'intelligence qu'il lui faut pour s'en servir ; et selon M. Ducange, de maceria, muraille, qui est l'ouvrage propre du maçon.
Origine de la Maçonnerie. La Maçonnerie tient aujourd'hui le premier rang entre les arts mécaniques qui servent à la construction des édifices. Le bois avait d'abord paru plus commode pour bâtir, avant que l'on eut connu l'usage de tous les autres matériaux servant aujourd'hui à la construction.
Anciennement les hommes habitaient les bois et les cavernes, comme les bêtes sauvages, Mais, au rapport de Vitruve, un vent impétueux ayant un jour par hasard poussé et agité vivement des arbres fort près les uns des autres, ils s'entrechoquèrent avec une si grande violence, que le feu s'y mit. La flamme étonna d'abord ces habitants : mais s'étant approchés peu-à-peu, et s'étant aperçu que la température de ce feu leur pouvait devenir commode, ils l'entretinrent avec d'autres bois, en firent connaître la commodité à leurs voisins, et y trouvèrent par la suite de l'utilité.
Ces hommes s'étant ainsi assemblés, poussaient de leurs bouches des sons, dont ils formèrent par la suite des paroles de différentes espèces, qu'ils appliquèrent chacune à chaque chose, et commencèrent à parler ensemble, et à faire société. Les uns se firent des huttes (b) avec des feuillages, ou des loges qu'ils creusèrent dans les montagnes. Les autres imitaient les hirondelles, en faisant des lieux couverts de branches d'arbres, et de terre grasse. Chacun se glorifiant de ses inventions, perfectionnait la manière de faire des cabanes, par les remarques qu'il faisait sur celles de ses voisins, et bâtissait toujours de plus en plus commodément.
Ils plantèrent ensuite des fourches entrelacées de branches d'arbre, qu'ils remplissaient et enduisaient de terre grasse pour faire les murailles.
Ils en bâtirent d'autres avec des morceaux de terre grasse desséchés, élevés les uns sur les autres, sur lesquels ils portaient des pièces de bois en travers qu'ils couvraient de feuilles d'arbres, pour s'y mettre à l'abri du soleil et de la pluie ; mais ces couvertures n'étant pas suffisantes pour se défendre contre les mauvais temps de l'hiver, ils imaginèrent des espèces de combles inclinées qu'ils enduisirent de terre grasse pour faire écouler les eaux.
(a) On distingue ce mot d'avec fondement, en ce que le premier est l'excavation ou la fouille faite dans la terre pour recevoir un massif capable de supporter l'édifice que l'on veut construire, et le second est le massif même : cependant on confond quelquefois ces deux mots dans la pratique ; mais ce que l'on en dit les fait bientôt distinguer.
(b) Espèce de baraque ou cabane.
Nous avons encore en Espagne, en Portugal, en Aquittaine et même en France, des maisons couvertes de chaume ou de bardeau. (c)
Au royaume de Pont dans la Colchide, on étend de part et d'autre sur le terrain des arbres ; sur chacune de leurs extrémités on y en place d'autres, de manière qu'ils enferment un espace carré de toute leur longueur. Sur ces arbres placés horizontalement, on y en élève d'autres perpendiculairement pour former des murailles que l'on garnit d'échalas et de terre grasse : on lie ensuite les extrémités de ces murailles par des pièces de bois qui vont d'angle en angle, et qui se croisent au milieu pour en retenir les quatre extrémités ; et pour former la couverture de ces espèces de cabanes, on attache aux quatre coins, par une extrémité, quatre pièces de bois qui vont se joindre ensemble par l'autre vers le milieu, et qui sont assez longues pour former un tait en croupe, imitant une pyramide à quatre faces, que l'on enduit aussi de terre grasse.
Il y a chez ces peuples de deux espèces de toits en croupe ; celui-ci, que Vitruve appelle testudinatum, parce que l'eau s'écoule des quatre côtés à-la-fais ; l'autre, qu'il appelle displuviatum, est lorsque le faitage allant d'un pignon (d) à l'autre, l'eau s'écoule des deux côtés.
Les Phrygiens, qui occupent des campagnes où il n'y a point de bois, creusent des fossés circulaires ou petits tertres naturellement élevés qu'ils font les plus grands qu'ils peuvent, auprès desquels ils font un chemin pour y arriver. Autour de ces creux ils élèvent des perches qu'ils lient par en haut en forme de pointe ou de cône, qu'ils couvrent de chaume, et sur cela ils amassent de la terre et du gason pour rendre leurs demeures chaudes en hiver et fraiches en été.
En d'autres lieux on couvre les cabanes avec des herbes prises dans les étangs.
A Marseille les maisons sont couvertes de terre grasse paitrie avec de la paille. On fait voir encore maintenant à Athènes, comme une chose curieuse par son antiquité, les toits de l'aréopage faits de terre grasse, et dans le temple du capitole, la cabane de Romulus couverte de chaume.
Au Pérou, les maisons sont encore aujourd'hui de roseaux et de cannes entrelacées, semblables aux premières habitations des Egyptiens et des peuples de la Palestine. Celles des Grecs dans leur origine n'étaient non plus construites que d'argille qu'ils n'avaient pas l'art de durcir par le secours du feu. En Irlande, les maisons ne sont construites qu'avec des menues pierres ou du roc mis dans de la terre détrempée, et de la mousse. Les Abyssins logent dans des cabanes faites de torchis. (e)
Au Monomotapa les maisons sont toutes construites de bois. On voit encore maintenant des peuples se construire, faute de matériaux et d'une certaine intelligence, des cabanes avec des peaux et des os de quadrupedes et de monstres marins.
Cependant on peut conjecturer que l'ambition de perfectionner ces cabanes et d'autres bâtiments élevés par la suite, leur fit trouver les moyens d'allier avec quelques autres fossiles l'argîle et la terre grasse, que
(c) C'est un petit ais de mairain en forme de tuîle ou de latte, de dix ou douze pouces de long, sur six à sept de large, dont on se sert encore à-présent pour couvrir des hangards, appentis, moulins, etc.
(d) Pignon est, à la face d'un mur élevé d'à-plomb, le triangle formé par la base et les deux côtés obliques d'un tait dont les eaux s'écoulent de part et d'autre.
(e) Torchis, espèce de mortier fait de terre grasse détrempée, mêlée de foin et de paille coupée et bien corroyée, dont on se sert à-présent faute de meilleure liaison : il est ainsi appelé à cause des bâtons en forme de torche, au bout desquels on le tortille pour l'employer.
leur offraient d'abord les surfaces des terrains où ils établissaient leurs demeures, qui peu-à-peu leur donnèrent l'idée de chercher plus avant dans le sein de la terre non-seulement la pierre, mais encore les différentes substances qui dans la suite les pussent mettre à portée de préférer la solidité de la maçonnerie à l'emploi des végétaux, dont ils ne tardèrent pas à connaître le peu de durée. Mais malgré cette conjecture, on considère les Egyptiens comme les premiers peuples qui aient fait usage de la maçonnerie ; ce qui nous parait d'autant plus vraisemblable, que quelques-uns de leurs édifices sont encore sur pied : témoins ces pyramides célèbres, les murs de Babylone construits de brique et de bitume ; le temple de Salomon, le phare de Ptolomée, les palais de Cléopatre et de César, et tant d'autres monuments dont il est fait mention dans l'Histoire.
Aux édifices des Egyptiens, des Assyriens et des Hébreux, succédèrent dans ce genre les ouvrages des Grecs, qui ne se contentèrent pas seulement de la pierre qu'ils avaient chez eux en abondance, mais qui firent usage des marbres des provinces d'Egypte, qu'ils employèrent avec profusion dans la construction de leurs bâtiments ; bâtiments qui par la solidité immuable seraient encore sur pied, sans l'irruption des barbares et des siècles d'ignorance qui sont survenus. Ces peuples, par leurs découvertes, excitèrent les autres nations à les imiter. Ils firent naître aux Romains, possédés de l'ambition de devenir les maîtres du monde, l'envie de les surpasser par l'incroyable solidité qu'ils donnèrent à leurs édifices ; en joignant aux découvertes des Egyptiens et des Grecs l'art de la main-d'œuvre, et l'excellente qualité des matières que leurs climats leur procuraient : en sorte que l'on voit aujourd'hui avec étonnement plusieurs vestiges intéressants de l'ancienne Rome.
A ces superbes monuments succédèrent les ouvrages des Goths ; monuments dont la legereté surprenante nous retrace moins les belles proportions de l'Architecture, qu'une élégance et une pratique inconnue jusqu'alors, et qui nous assurent par leurs aspects que leurs constructeurs s'étaient moins attachés à la solidité qu'au goût de l'Architecture et à la convenance de leurs édifices.
Sous le règne de François I. l'on chercha la solidité de ces édifices dans ceux qu'il fit construire ; et ce fut alors que l'Architecture sortit du chaos où elle avait été plongée depuis plusieurs siècles. Mais ce fut principalement sous celui de Louis XIV. que l'on joignit l'art de bâtir au bon goût de l'Architecture, et où l'on rassembla la qualité des matières, la beauté des formes, la convenance des bâtiments, les découvertes sur l'art du trait, la beauté de l'appareil, et tous les arts libéraux et mécaniques.
De la maçonnerie en particulier. Il y a de deux sortes de maçonnerie, l'ancienne, employée autrefois par les Egyptiens, les Grecs et les Romains, et la moderne, employée de nos jours.
Vitruve nous apprend que la maçonnerie ancienne se divisait en deux classes ; l'une qu'on appelait ancienne qui se faisait en liaison, et dont les joints étaient horizontaux et verticaux ; la seconde, qu'on appelait maillée, était celle dont les joints étaient inclinés selon l'angle de 45 degrés, mais cette dernière était très-défectueuse, comme nous le verrons ci-après.
Il y avait anciennement trois genres de maçonnerie ; le premier de pierres taillées et polies, le second de pierres brutes, et le troisième de ces deux espèces de pierres.
La maçonnerie de pierres taillées et polies était de deux espèces ; savoir la maillée, fig. première, appelée par Vitruve reticulatum, dont les joints des pierres étaient inclinés selon l'angle de 45 degrés, et dont les angles étaient faits de maçonnerie en liaison, pour retenir la poussée de ces pierres inclinées, qui ne laissait pas d'être fort considérable ; mais cette espèce de maçonnerie était beaucoup moins solide ; parce que le poids de ces pierres qui portaient sur leurs angles les faisait éclater ou égrainer, ou dumoins ouvrir par leurs joints, ce qui détruisait le mur. Mais les anciens n'avaient d'autres raisons d'employer cette manière que parce qu'elle leur paraissait plus agréable à la vue. La manière de bâtir en échiquier selon les anciens, que rapporte Palladio dans son I. liv. (Voyez la fig. 9.), était moins défectueuse, parce que ces pierres, dont les joints étaient inclinés, étaient non-seulement retenues par les angles du mur, faits de maçonnerie de brique en liaison, mais encore par des traverses de pareille maçonnerie, tant dans l'intérieur du mur qu'à l'extérieur.
La seconde espèce était celle en liaison (fig. 2. et 3.), appelée insertum, et dont les joints étaient horizontaux et verticaux : c'était la plus solide, parce que ses joints verticaux se croisaient, en sorte qu'un ou deux joints se trouvaient au milieu d'une pierre, ce qui s'appelait et s'appelle encore maintenant maçonnerie en liaison. Cette dernière se subdivise en deux, dont l'une était appelée simplement insertum, fig. 2, qui avait toutes les pierres égales par leurs parements ; l'autre, fig. 3, était la structure des Grecs, dans laquelle se trouve l'une et l'autre ; mais les parements des pierres étaient inégaux : en sorte que deux joints perpendiculaires se rencontraient au milieu d'une pierre.
Le second genre était celui de pierre brute, fig. 4. 5. et 6 ; il y en avait de deux espèces, dont l'une était appelée, comme la dernière, la structure des Grecs (fig. 4. et 5.), mais qui différait en ce que les pierres n'en étaient point taillées, à cause de leur dureté, que les liaisons n'étaient pas régulières, et qu'elles n'avaient point de grandeur réglée. Cette espèce se subdivisait encore en deux, l'une que l'on appelait isodomum (fig. 4.), parce que les assises étaient d'égale hauteur ; l'autre pseudisodomum (fig. 5.), parce que les assises étaient d'inégale hauteur. L'autre espèce, faite de pierres brutes, était appelée amplecton (fig. 6.), dans laquelle les assises n'étaient point déterminées par l'épaisseur des pierres ; mais la hauteur de chaque assise était faite de plusieurs si le cas y échéait, et l'espace d'un parement (f) à l'autre était rempli de pierres jetées à l'aventure, sur lesquelles on versait du mortier que l'on enduisait uniment ; et quand cette assise était achevée ; on en recommençait une autre par dessus : c'est ce que les Limousins appelaient des arrases, et que Vitruve nomme erecta coria.
Le troisième genre appelé revinctum (fig. 7.) étaient composé de pierres taillées posées en liaison et cramponées ; en sorte que chaque joint vertical se trouvait au milieu d'une pierre, tant dessus que dessous, entre lesquelles on mettait des cailloux et d'autres pierres jetées à l'aventure mêlées de mortier.
Table des manières anciennes de bâtir, présentées sous un même aspect.
Il y avait encore deux manières anciennes de bâtir ; la première était de poser les pierres les unes sur les autres sans aucune liaison ; mais alors il fallait que leurs surfaces fussent bien unies et bien planes. La seconde était de poser ces mêmes pierres les unes sur les autres, et de placer entre chacune d'elles une lame de plomb d'environ une ligne d'épaisseur.
Ces deux manières étaient fort solides, à cause du poids de la charge d'un grand nombre de ces pierres, qui leur donnait assez de force pour se soutenir ; mais les pierres étaient sujettes par ce même poids à s'éclater et à se rompre dans leurs angles, quoiqu'il y ait, selon Vitruve, des bâtiments fort anciens où de très-grandes pierres avaient été posées horizontalement, sans mortier ni plomb, et dont les joints n'étaient point éclatés, mais étaient demeurés presque invisibles par la jonction des pierres, qui avaient été taillées si juste et se touchaient en un si grand nombre de parties, qu'elles s'étaient conservées entières ; ce qui peut très-bien arriver, lorsque les pierres sont démaigries, c'est-à-dire plus creuses au milieu que vers les bords, tel que le fait voir la figure 8, parce que lorsque le mortier se seche, les pierres se rapprochent, et ne portent ensuite que sur l'extrémité du joint ; et ce joint n'étant pas assez fort pour le fardeau, ne manque pas de s'éclater. Mais les mâçons qui ont travaillé au louvre ont imaginé de fendre les joints des pierres avec la scie, à mesure que le mortier se séchait, et de remplir lorsque le mortier avait fait son effet. On doit remarquer que par là un mur de cette espèce a d'autant moins de solidité que l'espace est grand depuis le démaigrissement jusqu'au parement de devant, parce que ce mortier mis après coup n'étant compté pour rien, ce même espace est un moins dans l'épaisseur du mur, mais le charge d'autant plus.
Palladio rapporte dans son premier livre, qu'il y avait anciennement six manières de faire les murailles ; la première en échiquier, la seconde de terre cuite ou de brique, la troisième de ciment fait de cailloux de rivière ou de montagne, la quatrième de pierres incertaines ou rustiques, la cinquième de pierres de taille, et la sixième de remplage.
Nous avons expliqué ci-dessus la manière de bâtir en échiquier rapportée par Palladio, fig. 9.
La deuxième manière était de bâtir en liaison, avec des carreaux de brique ou de terre cuite grands ou petits. La plus grande partie des édifices de Rome connue, la rotonde, les thermes de Dioclétien et beaucoup d'autres édifices, sont bâtis de cette manière.
La troisième manière (fig. 10.) était de faire les
(f) Parement d'une pierre est sa partie extérieure ; elle peut en avoir plusieurs selon qu'elle est placée dans l'angle saillant ou rentrant d'un bâtiment.
deux faces du mur de carreaux du pierre ou de briques en liaison ; le milieu, de ciment ou de cailloux de rivière paitris avec du mortier ; et de placer de trois pieds en trois pieds de hauteur, trois rangs de brique en liaison ; c'est-à-dire le premier rang Ve sur le petit côté, le second Ve sur le grand côté, et le troisième Ve aussi sur le petit côté. Les murailles de la ville de Turin sont bâties de cette manière ; mais les garnis sont faits de gros cailloux de rivière cassés par le milieu, mêlés de mortier, dont la face unie est placée du côté du mur de face. Les murs des arenes à Vérone sont aussi construits de cette manière avec un garni de ciment, ainsi que ceux de plusieurs autres bâtiments antiques.
La quatrième manière était celle appelée incertaine ou rustique (fig. 11.) Les angles de ces murailles étaient faits de carreaux de pierre de taille en liaison ; le milieu de pierres de toutes sortes de forme, ajustées chacune dans leur place. Aussi se fallait-il servir pour cet effet d'un instrument (fig. 70.) appelé sauterelle ; ce qui donnait beaucoup de sujétion, sans procurer pour cela plus d'avantage. Il y a à Preneste des murailles, ainsi que les pavés des grands chemins faits de cette manière.
La cinquième manière (fig. 12.), était en pierres de taille ; et c'est ce que Vitruve appelle la structure des Grecs. Voyez la fig. 3. Le temple d'Auguste a été bâti ainsi ; on le voit encore par ce qui en reste.
La sixième manière était les murs de remplage (fig. 13.) ; on construisait pour cet effet des espèces de caisses de la hauteur qu'on voulait les lits, avec des madriers retenus par des arcs-boutants, qu'on remplissait de mortier, de ciment, et de toutes sortes de pierres de différentes formes et grandeurs. On bâtissait ainsi de lit en lit : il y a encore à Sirmion, sur le lac de Garda, des murs bâtis de cette manière.
Il y avait encore une autre manière ancienne de faire les murailles (fig. 14.), qui était de faire deux murs de quatre pieds d'épaisseur, de six pieds distants l'un de l'autre, liés ensemble par des murs distants aussi de six pieds, qui les traversaient, pour former des espèces de coffres de six pieds en carré, que l'on remplissait ensuite de terre et de pierre.
Les anciens pavaient les grands chemins en pierre de taille, ou en ciment mêlé de sable et de terre glaise.
Le milieu des rues des anciennes villes se pavait en grais et les côtés avec une pierre plus épaisse et moins large, que les carreaux. Cette manière de paver leur paraissait plus commode pour marcher.
La dernière manière de bâtir, et celle dont on bâtit de nos jours, se divise en cinq espèces.
La première (fig. 15.) se construit de carreaux (g) et boutisse (h) de pierres dures ou tendres bien posées en recouvrement les unes sur les autres. Cette manière est appelée communément maçonnerie en liaison, où la différente épaisseur des murs détermine les différentes liaisons à raison de la grandeur des pierres que l'on veut employer : la fig. 2 est de cette espèce.
Il faut observer, pour que cette construction soit bonne, d'éviter toute espèce de garni et remplissage, et pour faire une meilleure liaison, de piquer les parements intérieurs au marteau ; afin que par ce moyen les agens que l'on met entre deux pierres puissent les consolider. Il faut aussi bien équarrir les pierres, et n'y souffrir aucun tendre ni bouzin (i), parce que l'un et l'autre émousserait les parties de la chaux et du mortier.
La seconde est celle de brique, appelée en latin lateritium, espèce de pierre rougeâtre faite de terre grasse, qui après avoir été moulée d'environ huit pouces de longueur sur quatre de largeur et deux d'épaisseur, est mise à sécher pendant quelque temps au soleil et ensuite cuite au four. Cette construction se fait en liaison, comme la précédente. Il se trouve à Athènes un mur qui regarde le mont Hymette, les murailles du temple de Jupiter, et les chapelles du temple d'Hercule faites de brique, quoique les architraves et les colonnes soient de pierre. Dans la ville d'Arezzo en Italie, on voit un ancien mur aussi en brique très-bien bâti, ainsi que la maison des rois attaliques à Sparte ; on a levé de dessus un mur de brique anciennement bâti, des peintures pour les encadrer. On voit encore la maison de Crésus aussi bâtie en brique, ainsi que le palais du roi Mausole en la ville d'Halicarnasse, dont les murailles de brique sont encore toutes entières.
On peut remarquer ici que ce ne fut pas par économie que ce roi et d'autres après lui, presque aussi riches, ont préféré la brique, puisque la pierre et le marbre étaient chez eux très-communs.
Si l'on défendit autrefois à Rome de faire des murs en brique, ce ne fut que lorsque les habitants se trouvant en grand nombre, on eut besoin de ménager le terrain et de multiplier les surfaces ; ce qu'on ne pouvait faire avec des murs de brique, qui avaient besoin d'une grande épaisseur pour être solides : c'est pourquoi on substitua à la brique la pierre et le marbre ; et par-là on put non-seulement diminuer l'épaisseur des murs et procurer plus de surface, mais encore élever plusieurs étages les uns sur les autres ; ce qui fit alors que l'on fixa l'épaisseur des murs à dix-huit pouces.
Les tuiles qui ont été longtemps sur les toits, et qui y ont éprouvé toute la rigueur des saisons, sont, dit Vitruve, très-propres à la maçonnerie.
La troisième est de moilon, en latin caementitium ; ce n'est autre chose que des éclats de la pierre, dont il faut retrancher le bouzin et toutes les inégalités, qu'on réduit à une même hauteur, bien équarris, et posés exactement de niveau en liaison, comme ci-dessus. Le parement extérieur de ces moilons peut être piqué (l) ou rustiqué (m), lorsqu'ils sont apparents et destinés à la construction des souterrains, des murs de cloture, des caves, mitoyens, etc.
La quatrième est celle de limousinage, que Vitruve appelle amplecton, (fig. 6.) ; elle se fait aussi de moilons posés sur leurs lits et en liaison, mais sans être dressés ni équarris, étant destinés pour les murs que l'on enduit de mortier ou de plâtre.
Il est cependant beaucoup mieux de dégrossir ces moilons pour les rendre plus gissants et en ôter toute espèce de tendre, qui, comme nous l'avons dit précédemment, absorberait ou amortirait la qualité de la chaux qui compose le mortier. D'ailleurs si on ne les équarrissait pas au-moins avec la hachette (fig. 106), les interstices de différentes grandeurs produiraient une inégalité dans l'emploi du mortier, et un tassement inégal dans la construction du mur.
La cinquième se fait de blocage, en latin structura ruderaria, c'est-à-dire de menues pierres qui s'emploient avec du mortier dans les fondations, et avec
(g) Carreau, pierre qui ne traverse point l'épaisseur du mur, et qui n'a qu'un ou deux parements au plus.
(h) Boutisse, pierre qui traverse l'épaisseur du mur, et qui fait parement des deux côtés. On l'appelle encore pamieresse, pierre parpeigne, de parpein, ou faisant parpein.
(i) Bouzin, est la partie extérieure de la pierre abreuvée de l'humidité de la carrière, et qui n'a pas eu le temps de sécher, après en être sortie.
(l) Piqué, c'est-à-dire dont les parements sont piqués avec la pointe du marteau.
(m) Rustiqué, c'est-à-dire dont les parements, après avoir été équarris et hachés, sont grossièrement piqués avec la pointe du marteau.
du plâtre dans les ouvrages hors de terre. C'est-là, selon Vitruve, une très-bonne manière de bâtir, parce que, selon lui, plus il y a de mortier, plus les pierres en sont abreuvées, et plus les murs sont solides quand ils sont secs. Mais il faut remarquer aussi que plus il y a de mortier, plus le bâtiment est sujet à tasser à mesure qu'il se seche ; trop heureux s'il tasse également, ce qui est douteux. Cependant on ne laisse pas que de bâtir souvent de cette manière en Italie, où la pozzolane est d'un grand secours pour cette construction.
Des murs en général. La qualité du terrain, les différents pays où l'on se trouve, les matériaux que l'on a, et d'autres circonstances que l'on ne saurait prévoir, doivent décider de la manière que l'on doit bâtir : celle où l'on emploie la pierre est sans doute la meilleure ; mais comme il y a des endroits où elle est fort chère, d'autres où elle est très-rare, et d'autres encore où il ne s'en trouve point du tout, on est obligé alors d'employer ce que l'on trouve, en observant cependant de pratiquer dans l'épaisseur des murs, sous les retombées des voutes, sous les poutres, dans les angles des bâtiments et dans les endroits qui ont besoin de solidité, des chaînes de pierre ou de grais si on en peut avoir, ou d'avoir recours à d'autres moyens pour donner aux murs une fermeté suffisante.
Il faut observer plusieurs choses en bâtissant : premièrement, que les premières assises au rez-de-chaussée soient en pierre dure, même jusqu'à une certaine hauteur, si l'édifice est très-élevé : secondement, que celles qui sont sur un même rang d'assises soient de même qualité, afin que le poids supérieur, chargeant également dans toute la surface, trouve aussi une résistance égale sur la partie supérieure : troisiemement, que toutes les pierres, moilons, briques et autres matériaux, soient bien unis ensemble et posés bien de niveau. Quatriemement, lorsqu'on emploie le plâtre, de laisser une distance entre les arrachements A, fig. 16. et 17, et les chaînes des pierres B, afin de procurer à la maçonnerie le moyen de faire son effet, le plâtre étant sujet à se renfler et à pousser les premiers jours qu'il est employé ; et lors du ravalement général, on remplit ces interstices. Cinquiemement enfin, lorsque l'on craint que les murs ayant beaucoup de charge, soit par leur très-grande hauteur, soit par la multiplicité des planchers, des voutes etc. qu'ils portent, ne deviennent trop faibles et n'en affaissent la partie inférieure, de faire ce qu'on a fait au Louvre, qui est de pratiquer dans leur épaisseur (fig. 16. et 17.) des arcades ou décharges C, appuyées sur des chaînes de pierres ou jambes sous poutres B, qui en soutiennent la pesanteur. Les anciens, au lieu d'arcades, se servaient de longues pièces de bois d'olivier (fig. 17.) qu'ils posaient sur toute la longueur des murs, ce bois ayant seul la vertu de s'unir avec le mortier ou le plâtre sans se pourrir.
Des murs de faces et de refend. Lorsque l'on construit des murs de face, il est beaucoup mieux de faire en sorte que toutes les assises soient d'une égale hauteur, ce qui s'appelle bâtir à assise égale ; que les joints des parements soient le plus serrés qu'il est possible. C'est à quoi les anciens apportaient beaucoup d'attention ; car, comme nous l'avons vu, ils appareillaient leurs pierres et les posaient les unes sur les autres sans mortier, avec une si grande justesse, que les joints devenaient presqu'imperceptibles, et que leur propre poids suffisait seul pour les rendre fermes. Quelques-uns craient qu'ils laissaient sur tous les parements de leurs pierres environ un pouce de plus, qu'ils retondaient lors du ravalement total, ce qui parait destitué de toute vraisemblance, par la description des anciens ouvrages dont l'Histoire fait mention. D'ailleurs l'appareil étant une partie très essentielle dans la construction, il est dangereux de laisser des joints trop larges, non-seulement parce qu'ils sont désagréables à la vue, mais encore parce qu'ils contribuent beaucoup au défaut de solidité, soit parce qu'en liant des pierres tendres ensemble, il se fait d'autant plus de cellules dans leurs pores, que le mortier dont on se sert est d'une nature plus dure ; soit parce que le bâtiment est sujet à tasser davantage, et par conséquent à s'ébranler ; soit encore parce qu'en employant du plâtre, qui est d'une consistance beaucoup plus molle et pour cette raison plus tôt pulvérisée par le poids de l'édifice, les arêtes des pierres s'éclatent à mesure qu'elles viennent à se toucher. C'est pour cela que dans les bâtiments de peu d'importance, où il s'agit d'aller vite, on les calle avec des lattes D, fig. 18, entre lesquelles on fait couler du mortier, et on les jointoie, ainsi qu'on peut le remarquer dans presque tous les édifices modernes. Dans ceux qui méritent quelqu'attention, on se sert au contraire de lames de plomb E, fig. 19, ainsi qu'on l'a pratiqué au péristîle du Louvre, aux châteaux de Clagny, de Maisons et autres.
Quoique l'épaisseur des murs de face doive différer selon leur hauteur, cependant on leur donne communément deux pieds d'épaisseur, sur dix taises de hauteur, ayant soin de leur donner six lignes par taise de talut ou de retraite en dehors A, fig. 20, et de les faire à plomb par le dedans B. Si on observe aussi des retraites en dedans B, fig. 21, il faut faire en sorte que l'axe C D du mur se trouve dans le milieu des fondements.
La hauteur des murs n'est pas la seule raison qui doit déterminer leur épaisseur ; les différents poids qu'ils ont à porter doivent y entrer pour beaucoup, tels que celui des planchers, des combles, la poussée des arcades, des portes et des croisées ; les scellements des poutres, des solives, sablières, corbeaux, etc. raison pour laquelle on doit donner des épaisseurs différentes aux murs de même espèce.
Les angles d'un bâtiment doivent être non-seulement élevés en pierre dure, comme nous l'avons vu, mais aussi doivent avoir une plus grande épaisseur, à cause de la poussée des voutes, des planchers, des croupes et des combles ; irrégularité qui se corrige aisément à l'extérieur par des avant-corps qui font partie de l'ordonnance du bâtiment, et dans l'intérieur par des revétissements de lambris.
L'épaisseur des murs de refend doit aussi différer selon la longueur et la grosseur des pièces de bois qu'ils doivent porter, surtout lorsqu'ils séparent des grandes pièces d'appartement, lorsqu'ils servent de cage à des escaliers, où les voutes et le mouvement continuel des rampes exigent une épaisseur relative à leurs poussées, ou enfin lorsqu'ils contiennent dans leur épaisseur plusieurs tuyaux de cheminées qui montent de fond, seulement séparés par des languettes de trois ou quatre pouces d'épaisseur.
Tous ces murs se paient à la taise superficielle, selon leur épaisseur.
Les murs en pierre dure se paient depuis 3 liv. jusqu'à 4 liv. le pouce d'épaisseur. Lorsqu'il n'y a qu'un parement, il se paye depuis 12 liv. jusqu'à 16 livres ; lorsqu'il y en a deux, le premier se paye depuis 12 jusqu'à 16 livres, et le second depuis 10 livres jusqu'à 12 livres.
Les murs en pierre tendre se paient depuis 2 liv. 10 sols jusqu'à 3 liv. 10 sols le pouce d'épaisseur. Lorsqu'il n'y a qu'un parement, il se paye depuis 3 liv. 10 sols jusqu'à 4 liv. 10 sols. Lorsqu'il y en a deux, le premier se paye depuis 3 liv. 10 sols jusqu'à 4 liv. 10 sols ; et le second depuis 3 liv. jusqu'à 3 liv. 10 sols.
Les murs en moilon blanc se paient depuis 18 fols jusqu'à 22 sols le pouce ; et chaque parement, qui est un enduit de plâtre ou de chaux, se paye depuis 1 liv. 10 sols jusqu'à 1. liv. 16 sols.
Tous ces prix diffèrent selon le lieu où l'on bâtit, selon les qualités des matériaux que l'on emploie, et selon les bonnes ou mauvaises façons des ouvrages ; c'est pourquoi on fait toujours des devis et marchés avant que de mettre la main à l'œuvre.
Des murs de terrasse. Les murs de terrasse diffèrent des précédents en ce que non-seulement ils n'ont qu'un parement, mais encore parce qu'ils sont faits pour retenir les terres contre lesquelles ils sont appuyés. On en fait de deux manières : les uns (fig. 22.) ont beaucoup d'épaisseur, et coutent beaucoup ; les autres (fig. 23.) fortifiées par des éperons ou contreforts E, coutent beaucoup moins. Vitruve dit que ces murs doivent être d'autant plus solides que les terres poussent davantage dans l'hiver que dans d'autres temps ; parce qu'alors elles sont humectées des pluies, des neiges et autres intempéries de cette saison : c'est pourquoi il ne se contente pas seulement de placer d'un côté des contreforts A (fig. 24. et 25), mais il en met encore d'autres en-dedans, disposés diagonalement en forme de scie B (fig. 24.) ou en portion de cercle C (fig. 25.), étant par-là moins sujets à la poussée des terres.
Il faut observer de les élever perpendiculairement du côté des terres, et inclinés de l'autre. Si cependant on jugeait à-propos de les faire perpendiculaires à l'extérieur, il faudrait alors leur donner plus d'épaisseur, et placer en-dedans les contreforts que l'on aurait dû mettre en-dehors.
Quelques-uns donnent à leur sommet la sixième partie de leur hauteur, et de talut la septième partie : d'autres ne donnent à ce talut que la huitième partie. Vitruve dit que l'épaisseur de ces murs doit être relative à la poussée des terres, et que les contreforts que l'on y ajoute sont faits pour le fortifier et l'empêcher de se détruire ; il donne à ces contreforts, pour épaisseur, pour saillie, et pour intervalle de l'un à l'autre, l'épaisseur du mur, c'est-à-dire qu'ils doivent être carrés par leur sommet, et la distance de l'un à l'autre aussi carrée ; leur empatement, ajoute-t-il, doit avoir la hauteur du mur.
Lorsque l'on veut construire un mur de terrasse, on commence d'abord par l'élever jusqu'au rez-de-chaussée, en lui donnant une épaisseur et un talut convenables à la poussée des terres qu'il doit soutenir : pendant ce temps-là, on fait plusieurs tas des terres qui doivent servir à remplir le fossé, selon leurs qualités : ensuite on en fait apporter près du mur et à quelques pieds de largeur, environ un pied d'épaisseur, en commençant par celles qui ont le plus de poussée, réservant pour le haut celles qui en ont moins. Précaution qu'il faut nécessairement prendre, et sans laquelle il arriverait que d'un côté le mur ne se trouverait pas assez fort pour retenir la poussée des terres, tandis que de l'autre il se trouverait plus fort qu'il ne serait nécessaire. Ces terres ainsi apportées, on en fait un lit de même qualité que l'on pose bien de niveau, et que l'on incline du côté du terrain pour les empêcher de s'ébouler, et que l'on affermit ensuite en les battant, et les arrosant à mesure : car si on remettait à les battre après la construction du mur, non-seulement elles en seraient moins fermes, parce qu'on ne pourrait battre que la superficie, mais encore il serait à craindre qu'on n'ébranlât la solidité du mur. Ce lit fait, on en recommence un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on soit arrivé au rez-de-chaussée.
De la pierre en général. De tous les matériaux compris sous le nom de maçonnerie, la pierre tient aujourd'hui le premier rang ; c'est pourquoi nous expliquerons ses différentes espèces, ses qualités, ses défauts, ses façons et ses usages ; après avoir dit un mot des carrières dont on la tire, et cité les auteurs qui ont écrit de l'art de les réunir ensemble, pour parvenir à une construction solide, soit en enseignant les développements de leur coupe, de leurs joints et de leurs lits relativement à la pratique, soit en démontrant géométriquement la rencontre des lignes, la nature des courbes, les sections des solides, et les connaissances qui demandent une étude particulière.
On distingue deux choses également intéressantes dans la coupe des pierres, l'ouvrage et le raisonnement, dit Vitruve ; l'un convient à l'artisan, et l'autre à l'artiste. Nous pouvons regarder Philibert Delorme, en 1567, comme le premier auteur qui ait traité méthodiquement de cet art. En 1642, Mathurin Jousse y ajouta quelques découvertes, qu'il intitula, le secret de l'Architecture. Un an après, le P.Deraut fit paraitre un ouvrage encore plus profond sur cet art, mais plus relatif aux besoins de l'ouvrier. La même année, Abraham Bosse mit au jour le système de Desargue. En 1728, M. de la Rue renouvella le traité du P.Deraut, le commenta, et y fit plusieurs augmentations curieuses ; en sorte que l'on peut regarder son ouvrage comme le résultat de tous ceux qui l'avaient précédé sur l'art du trait. Enfin, en 1737, M. Fraizier, ingénieur en chef des fortifications de Sa Majesté, en a démontré la théorie d'une manière capable d'illustrer cette partie de l'Architecture, et la mémoire de ce savant.
Il faut savoir qu'avant que la géométrie et la mécanique fussent devenues la base de l'art du trait pour la coupe des pierres, on ne pouvait s'assurer précisément de l'équilibre et de l'effort de la poussée des voutes, non plus que de la résistance des pieds droits, des murs, des contreforts, etc. de manière que l'on rencontrait lors de l'exécution des difficultés que l'on n'avait pu prévoir, et qu'on ne pouvait résoudre qu'en démolissant ou retondant en place les parties défectueuses jusqu'à ce que l'oeil fût moins mécontent ; d'où il résultait que ces ouvrages coutaient souvent beaucoup, et duraient peu, sans satisfaire les hommes intelligens. C'est donc à la théorie qu'on est maintenant redevable de la légéreté qu'on donne aux voutes de différentes espèces, ainsi qu'aux voussures, aux trompes, etc. et de ce qu'on est parvenu insensiblement à abandonner la manière de bâtir des derniers siècles, trop difficîle par l'immensité des poids qu'il fallait transporter et d'un travail beaucoup plus lent. C'est même ce qui a donné lieu à ne plus employer la méthode des anciens, qui était de faire des colonnes et des architraves d'un seul morceau, et de préférer l'assemblage de plusieurs pierres bien plus faciles à mettre en œuvre. C'est par le secours de cette théorie que l'on est parvenu à soutenir des plates-bandes, et à donner à l'architecture ce caractère de vraisemblance et de légéreté inconnue à nos prédécesseurs. Il est vrai que les architectes gothiques ont poussé très-loin la témérité dans la coupe des pierres, n'ayant, pour ainsi dire, d'autre but dans leurs ouvrages que de s'attirer de l'admiration. Malgré nos découvertes, nous sommes devenus plus modérés ; et bien-loin de vouloir imiter leur trop grande hardiesse, nous ne nous servons de la facilité de l'art du trait que pour des cas indispensables relatifs à l'économie, ou à la sujétion qu'exige certain genre de construction : les préceptes n'enseignant pas une singularité présomptueuse, et la vraisemblance devant toujours être préférée, surtout dans les arts qui ne tendent qu'à la solidité.
On distingue ordinairement de deux espèces de pierres : l'une dure, et l'autre tendre. La première est, sans contredit, la meilleure : il arrive quelquefois que cette dernière résiste mieux à la gelée que l'autre ; mais cela n'est pas ordinaire, parce que les parties de la pierre dure ayant leurs pores plus condensés que celles de la tendre, doivent résister davantage aux injures des temps, ainsi qu'aux courants des eaux dans les édifices aquatiques. Cependant, pour bien connaître la nature de la pierre, il faut examiner pourquoi ces deux espèces sont sujettes à la gelée, qui les fend et les détruit.
Dans l'assemblage des parties qui composent la pierre, il s'y trouve des pores imperceptibles remplis d'eau et d'humidité, qui, venant à s'enfler pendant la gelée, fait effort dans ses pores, pour occuper un plus grand espace que celui où elle est resserrée ; et la pierre ne pouvant résister à cet effort, se fend et tombe par éclat. Ainsi plus la pierre est composée de parties argilleuses et grasses, plus elle doit participer d'humidité, et par conséquent être sujette à la gelée. Quelques-uns craient que la pierre ne se détruit pas seulement à la gelée, mais qu'elle se mouline (n) encore à la lune : ce qui peut arriver à de certaines espèces de pierres, dont les rayons de la lune peuvent dissoudre les parties les moins compactes. Mais il s'ensuivrait de-là que ses rayons seraient humides, et que venant à s'introduire dans les pores de la pierre, ils seraient cause de la séparation de ses parties qui tombant insensiblement en parcelles, la ferait paraitre moulinée.
Des carrières et des pierres qu'on en tire. On appelle communément carrière des lieux creusés sous terre A (fig. 26.), où la pierre prend naissance. C'est de-là qu'on tire celle dont on se sert pour bâtir, et cela par des ouvertures B en forme de puits, comme on en voit aux environs de Paris, ou de plain-pié, comme à S. Leu, Trocy, Maillet, et ailleurs ; ce qui s'appelle encore carrière découverte.
La pierre se trouve ordinairement dans la carrière disposée par banc, dont l'épaisseur change selon les lieux et la nature de la pierre. Les ouvriers qui la tirent, se nomment carriers.
Il faut avoir pour principe dans les bâtiments, de poser les pierres sur leurs lits, c'est-à-dire dans la même situation qu'elles se sont trouvé placées dans la carrière, parce que, selon cette situation, elles sont capables de résister à de plus grands fardeaux ; au lieu que posées sur un autre sens, elles sont très-sujettes à s'éclater, et n'ont pas à beaucoup près tant de force. Les bons ouvriers connaissent du premier coup-d'oeil le lit d'une pierre ; mais si l'on n'y prend garde, ils ne s'assujettissent pas toujours à la poser comme il faut.
La pierre dure supportant mieux que toute autre un poids considérable, ainsi que les mauvais temps, l'humidité, la gelée, etc. il faut prendre la précaution de les placer de préférence dans les endroits exposés à l'air, réservant celles que l'on aura reconnu moins bonnes pour les fondations et autres lieux à couvert. C'est de la première que l'on emploie le plus communément dans les grands édifices, surtout jusqu'à une certaine hauteur. La meilleure est la plus pleine, serrée, la moins coquilleuse, la moins remplie de moye (o), veine (p) ou molière (q), d'un grain fin et uni, et lorsque les éclats sont sonores et se coupent net.
La pierre dure et tendre se tire des carrières par gros quartiers que l'on débite sur l'attelier, suivant le besoin que l'on en a. Les plus petits morceaux servent de libage ou de moilon, à l'usage des murs de fondation, de refends, mitoyens, etc. on les unit les unes aux autres par le secours du mortier, fait de ciment ou de sable broyé avec de la chaux, ou bien encore avec du plâtre, selon le lieu où l'on bâtit. Il faut avoir grand soin d'en ôter tout le bouzin, qui n'étant pas encore bien consolidé avec le reste de la pierre, est sujet à se dissoudre par la pluie ou l'humidité, de manière que les pierres dures ou tendres, dont on n'a pas pris soin d'ôter cette partie défectueuse, tombent au bout de quelque temps en poussière, et leurs arêtes s'égrainent par le poids de l'édifice. D'ailleurs ce bouzin beaucoup moins compacte que le reste de la pierre, et s'abreuvant facilement des esprits de la chaux, en exige une très-grande quantité, et par conséquent beaucoup de temps pour la sécher : de plus l'humidité du mortier le dissout, et la liaison ne ressemble plus alors qu'à de la pierre tendre réduite en poussière, posée sur du mortier, ce qui ne peut faire qu'une très-mauvaise construction.
Mais comme chaque pays a ses carrières et ses différentes espèces de pierres, auxquelles on s'assujettit pour la construction des bâtiments, et que le premier soin de celui qui veut bâtir est, avant même que de projeter, de visiter exactement toutes celles des environs du lieu où il doit bâtir, d'examiner soigneusement ses bonnes et mauvaises qualités, soit en consultant les gens du pays, soit en en exposant une certaine quantité pendant quelque temps à la gelée et sur une terre humide, soit en les éprouvant encore par d'autres manières ; nous n'entreprendrons pas de faire un dénombrement exact et général de toutes les carrières dont on tire la pierre. Nous nous contenterons seulement de dire quelque chose de celles qui se trouvent en Italie, pour avoir occasion de rapporter le sentiment de Vitruve sur la qualité des pierres qu'on en tire, avant que de parler de celles dont on se sert à Paris et dans les environs.
Les carrières dont parle Vitruve, et qui sont aux environs de Rome, sont celles de Pallienne, de Fidenne, d'Albe, et autres, dont les pierres sont rouges et très-tendres. On s'en sert cependant à Rome en prenant la précaution de les tirer de la carrière en été, et de les exposer à l'air deux ans avant que de les employer, afin que, dit aussi Palladio, celles qui ont résisté aux mauvais temps sans se gâter, puissent servir aux ouvrages hors de terre, et les autres dans les fondations. Les carrières de Rora, d'Amiterne, et de Tivoli fournissent des pierres moyennement dures. Celles de Tivoli résistent fort bien à la charge et aux rigueurs des saisons, mais non au feu qui les fait éclater, pour le peu qu'il les approche ; parce qu'étant naturellement composées d'eau et de terre, ces deux éléments ne sauraient lutter contre l'air et le feu qui s'insinuent aisément dans ses porosités. Il s'en trouve plusieurs d'où l'on tire des pierres aussi dures que le caillou. D'autres encore dans la terre de Labour, d'où l'on en tire que l'on appelle tuf rouge et noir. Dans l'Ombrie, le Pisantin, et proche de Venise, on tire aussi un tuf blanc qui se coupe à la scie comme le bois. Il y a chez les Tarquiniens des carrières appelées avitiennes, dont les pierres sont rouges comme celles d'Albe, et s'amassent près du lac de Balsenne et dans le gouvernement Statonique : elles résistent très-bien à la gelée et au feu, parce qu'elles sont composées de très-peu d'air, de fer, et d'humidité,
(n) Une pierre est moulinée, lorsqu'elle s'écrase sous le pouce, et qu'elle se réduit en poussière.
(o) Moye est une partie tendre qui se trouve au milieu de la pierre, et qui suit son lit de carrière.
(p) Veine, défaut d'une pierre à l'endroit où la partie tendre se joint à la partie dure.
(q) Moliere, partie de la pierre remplie de trous ; ce qui est un défaut de propreté dans les parements extérieurs.
mais de beaucoup de terrestre ; ce qui les rend plus fermes, telles qu'il s'en voit à ce qui reste des anciens ouvrages près de la ville de Ferente où il se trouve encore de grandes figures, de petits bas-reliefs, et des ornements délicats, de roses, de feuilles d'acanthe, etc. faits de cette pierre, qui sont encore entiers malgré leur vieillesse. Les Fondeurs des environs la trouvent très-propre à faire des moules ; cependant on en emploie fort peu à Rome à cause de leur éloignement.
Des différentes pierres dures. De toutes les pierres dures, la plus belle et la plus fine est celle de liais, qui porte ordinairement depuis sept jusqu'à dix pouces de hauteur de banc (r).
Il y en a de quatre sortes. La première qu'on appelle liais franc, la seconde liais ferault, la troisième liais rose, et la quatrième franc liais de S. Leu.
La première qui se tire de quelques carrières derrière les Chartreux fauxbourg S. Jacques à Paris, s'emploie ordinairement aux revêtissements du dedans des pièces où l'on veut éviter la dépense du marbre, recevant facilement la taille de toutes sortes de membres d'architecture et de sculpture : considération pour laquelle on en fait communément des chambranles de cheminées, pavés d'anti-chambres et de salles à manger, ballustres, entrelas, appuis, tablettes, rampes, échiffres d'escaliers, etc. La seconde qui se tire des mêmes carrières, est beaucoup plus dure, et s'emploie par préférence pour des corniches, bazes, chapiteaux de colonnes, et autres ouvrages qui se font avec soin dans les façades extérieures des bâtiments de quelqu'importance. La troisième qui se tire des carrières proche S. Cloud, est plus blanche et plus pleine que les autres, et reçoit un très-beau poli. La quatrième se tire le long des côtes de la montagne près S. Leu.
La seconde pierre dure et la plus en usage dans toutes les espèces de bâtiments, est celle d'Arcueil, qui porte depuis douze jusqu'à quinze pouces de hauteur de banc, et qui se tirait autrefois des carrières d'Arcueil près Paris ; elle était très-recherchée alors, à cause des qualités qu'elle avait d'être presqu'aussi ferme dans ses joints que dans son cœur, de résister au fardeau, de s'entretenir dans l'eau, ne point craindre les injures des temps : aussi la préférait-on dans les fondements des édifices, et pour les premières assises. Mais maintenant les bancs de cette pierre ne se suivant plus comme autrefois, les Carriers se sont jetés du côté de Bagneux près d'Arcueil, et du côté de Montrouge, où ils trouvent des masses moins profondes dont les bancs se continuent plus loin. La pierre qu'on en tire est celle dont on se sert à-présent, à laquelle on donne le nom d'Arcueil. Elle se divise en haut et bas appareil : le premier porte depuis dix-huit pouces jusqu'à deux pieds et demi de hauteur de banc ; et le second depuis un pied jusqu'à dix-huit pouces. Celui-ci sert à faire des marches, seuils, appuis, tablettes, cimaises de corniches, etc. Elle a les mêmes qualités que celle d'Arcueil, mais plus remplie de moye, plus sujette à la gelée, et moins capable de résister au fardeau.
La pierre de cliquart qui se tire des mêmes carrières, est un bas appareil de six à sept pouces de hauteur de banc, plus blanche que la dernière, ressemblante au liais, et servant aussi aux mêmes usages. Elle se divise en deux espèces, l'une plus dure que l'autre : cette pierre un peu grasse est sujette à la gelée : c'est pourquoi on a soin de la tirer de la carrière, et de l'employer en été.
La pierre de bellehache se tire d'une carrière près d'Arcueil, nommée la carrière royale, et porte depuis dix-huit jusqu'à dix-neuf pouces de hauteur de banc. Elle est beaucoup moins parfaite que le liais ferault, mais de toutes les pierres la plus dure, à cause d'une grande quantité de cailloux dont elle est composée : aussi s'en sert-on fort rarement.
La pierre de souchet se tire des carrières du fauxbourg S. Jacques, et porte depuis douze pouces jusqu'à vingt un pouces de hauteur de banc. Cette pierre qui ressemble à celle d'Arcueil, est grise, trouée et poreuse. Elle n'est bonne ni dans l'eau ni sous le fardeau : aussi ne s'en sert-on que dans les bâtiments de peu d'importance. Il se tire encore une pierre de souchet des carrières du fauxbourg S. Germain, et de Vaugirard, qui porte depuis dixhuit jusqu'à vingt pouces de hauteur de banc. Elle est grise, dure, poreuse, grasse, pleine de fils, sujette à la gelée, et se moulinant à la lune. On s'en sert dans les fondements des grands édifices et aux premières assises, voussoirs, soupiraux de caves, jambages de portes, et croisées des maisons de peu d'importance.
La pierre de bonbave se tire des mêmes carrières, et se prend au-dessus de cette dernière. Elle porte depuis quinze jusqu'à vingt-quatre pouces de hauteur de banc, fort blanche, pleine et très-fine : mais elle se mouline à la lune, résiste peu au fardeau, et ne saurait subsister dans les dehors ni à l'humidité : on s'en sert pour cela dans l'intérieur des bâtiments, pour des appuis, rampes, échiffres d'escaliers, etc. on l'a quelquefois employée à découvert où elle n'a pas gelé, mais cela est fort douteux. On en tire des colonnes de deux pieds de diamètre ; la meilleure est la plus blanche, dont le lit est coquilleux, et a quelques molières.
Il se trouve encore au fauxbourg S. Jacques un bas appareil depuis six jusqu'à neuf pouces de hauteur de banc, qui n'est pas si beau que l'arcueil, mais qui sert à faire des petites marches, des appuis, des tablettes. etc.
Après la pierre d'Arcueil, celle de S. Cloud est la meilleure de toutes. Elle porte de hauteur de banc depuis dix-huit pouces jusqu'à deux pieds, et se tire des carrières de S. Cloud près Paris. Elle est un peu coquilleuse, ayant quelques molières ; mais elle est blanche, bonne dans l'eau, résiste au fardeau, et se délite facilement. Elle sert aux façades des bâtiments, et se pose sur celle d'Arcueil. On en tire des colonnes d'une pièce, de deux pieds de diamètre ; on en fait aussi des bassins et des auges.
La pierre de Meudon se tire des carrières de ce nom, et porte depuis quatorze jusqu'à dix-huit pouces de hauteur de banc. Il y en a de deux espèces. La première qu'on appelle pierre de Meudon, a les mêmes qualités que celles d'Arcueil, mais pleine de trous, et incapable de résister aux mauvais temps. On s'en sert pour des premières assises, des marches, tablettes, etc. Il s'en trouve des morceaux d'une grandeur extraordinaire. Les deux cimaises des corniches rampantes du fronton du Louvre sont de cette pierre, chacune d'un seul morceau. La seconde qu'on appelle rustique de Meudon, est plus dure, rougeâtre et coquilleuse, et n'est propre qu'aux libages et garnis des fondations de piles de ponts, quais et angles de bâtiments.
La pierre de S. Nom, qui porte depuis dix-huit jusqu'à vingt-deux pouces de hauteur de banc, se tire au bout du parc de Versailles, et est presque de même qualité que celle d'Arcueil, mais grise et coquilleuse : on s'en sert pour les premières assises.
La pierre de la chaussée, qui se tire des carrières près Bougival, à côté de S. Germain en Laye, et qui porte depuis quinze jusqu'à vingt pouces de hauteur de banc, approche beaucoup de celle de
(r) La hauteur d'un banc est l'épaisseur de la pierre dans la carrière ; il y en a plusieurs dans chacune.
liais, et en a le même grain. Mais il est nécessaire de moyer cette pierre de quatre pouces d'épaisseur par-dessus, à cause de l'inégalité de sa dureté : ce qui la réduit à quinze ou seize pouces, nette et taillée.
La pierre de montesson se tire des carrières proche Nanterre, et porte neuf à dix pouces de hauteur de banc. Cette pierre est fort blanche, et d'un très-beau grain. On en fait des vases, balustres, entrelas, et autres ouvrages des plus délicats.
La pierre de Fécamp se tire des carrières de la vallée de ce nom, et porte depuis quinze jusqu'à dix-huit pouces de hauteur de banc. Cette pierre qui est très-dure, se fend et se feuillette à la gelée, lorsqu'elle n'a pas encore jeté toute son eau de carrière. C'est pourquoi on ne l'emploie que depuis le mois de Mars jusqu'au mois de Septembre, après avoir longtemps séché sur la carrière : celle que l'on tirait autrefois était beaucoup meilleure.
La pierre dure de saint-Leu se tire sur les côtes de la montagne d'Arcueil.
La pierre de lambourde, ou seulement la lambourde, se tire près d'Arcueil, et porte depuis dixhuit pouces jusqu'à cinq pieds de hauteur de banc. Cette pierre se délite (s), parce qu'on ne l'emploie pas de cette hauteur. La meilleure est la plus blanche, et celle qui résiste au fardeau autant que le Saint-Leu.
On tire encore des carrières du fauxbourg saint Jacques et de celles de Bagneux, de la lambourde depuis dix-huit pouces jusqu'à deux pieds de hauteur de banc. Il y en a de deux espèces : l'une est graveleuse et se mouline à la lune ; l'autre est verte, se feuillette, et ne peut résister à la gelée.
La pierre de Saint-Maur qui se tire des carrières du village de ce nom, est fort dure, résiste très-bien au fardeau et aux injures des temps. Mais le banc de cette pierre est fort inégal, et les quartiers ne sont pas si grands que ceux d'Arcueil : cependant on en a tiré autrefois beaucoup, et le château en est bâti.
La pierre de Vitry qui se tire des carrières de ce nom, est de même espèce.
La pierre de Passy dont on tirait autrefois beaucoup des carrières de ce nom, est fort inégale en qualité et en hauteur de banc. Ces pierres sont beaucoup plus propres à faire du moilon et des libages que de la pierre de taille.
La pierre que l'on tire des carrières du fauxbourg Saint Marceau, n'est pas si bonne que celle des carrières de Vaugirard.
Toutes les pierres dont nous venons de parler se vendent au pié-cube, depuis 10 sols jusqu'à 50, quelquefois 3 livres ; et augmentent ou diminuent de prix, selon la quantité des édifices que l'on bâtit.
La pierre de Senlis se tire des carrières de S. Nicolas, près Senlis, à dix lieues de Paris, et porte depuis douze jusqu'à seize pouces de hauteur de banc ; cette pierre est aussi appelée liais. Elle est très-blanche, dure et pleine, très-propre aux plus beaux ouvrages d'Architecture et de Sculpture. Elle arrive à Paris par la rivière d'Oise, qui se décharge dans la Seine.
La pierre de Vernon à douze lieues de Paris, en Normandie, qui porte depuis deux pieds jusqu'à trois pieds de hauteur de banc, est aussi dure et aussi blanche que celle de S. Cloud. Elle est un peu difficîle à tailler, à cause des cailloux dont elle est composée ; on en fait cependant plusieurs usages, mais principalement pour des figures.
La pierre de Tonnerre à trente lieues de Paris, en Champagne, qui porte depuis seize jusqu'à dix-huit pouces de hauteur de banc, est plus tendre, plus blanche, et aussi pleine que le liais ; on ne s'en sert à cause de sa cherté, que pour des vases, termes, figures, colonnes, retables d'autels, tombeaux et autres ouvrages de cette espèce. Toute la fontaine de Grenelle, ainsi que les ornements, les statues du chœur de S. Sulpice, et beaucoup d'autres ouvrages de cette nature, sont faits de cette pierre.
La pierre de meulière ainsi appelée, parce qu'elle est de même espèce à peu près, que celles dont on fait des meules de moulins, est une pierre grise, fort dure et poreuse, à laquelle le mortier s'attache beaucoup mieux qu'à toutes autres pierres pleines, étant composée d'un grand nombre de cavités. C'est de toutes les maçonneries la meilleure que l'on puisse jamais faire, surtout lorsque le mortier est bon, et qu'on lui donne le temps nécessaire pour sécher, à cause de la grande quantité qui entre dans les pores de cette pierre : raison pour laquelle les murs qui en sont faits sont sujets à tasser beaucoup plus que d'autres. On s'en sert aux environs de Paris, comme à Versailles, et ailleurs.
La pierre fusilière est une pierre dure et seche, qui tient de la nature du caillou : une partie du pont Notre-Dame en est bâti. Il y en a d'autre qui est grise ; d'autre encore plus petite que l'on nomme pierre à fusil, elle est noire, et sert à paver les terrasses et les bassins de fontaines ; on s'en sert en Normandie pour la construction des bâtiments.
Le grais est une espèce de pierre ou roche qui se trouve en beaucoup d'endroits, et qui n'ayant point de lit, se débite sur tous sens et par carreaux, de telle grandeur et grosseur que l'ouvrage le demande. Mais les plus ordinaires sont de deux pieds de long, sur un pied de hauteur et d'épaisseur. Il y en a de deux espèces ; l'une tendre, et l'autre dure. La première sert à la construction des bâtiments, et surtout des ouvrages rustiques, comme cascades, grottes, fontaines, réservoirs, aqueducs, etc. tel qu'il s'en voit à Vaux-le-vicomte et ailleurs. Le plus beau et le meilleur est le plus blanc, sans fil, d'une dureté et d'une couleur égale. Quoiqu'il soit d'un grand poids, et que les membres d'architecture et de sculpture s'y taillent difficilement, malgré les ouvrages que l'on en voit, qui sont faits avec beaucoup d'adresse ; cependant la nécessité contraint quelquefois de s'en servir pour la construction des grands édifices, comme à Fontainebleau, et fort loin aux environs ; ses parements doivent être piqués, ne pouvant être lissés proprement, qu'avec beaucoup de temps.
Le grais dans son principe, étant composé de grains de sable unis ensemble et attachés successivement les uns aux autres, pour se former par la suite des temps un bloc ; il est évident que sa constitution aride exige, lors de la construction, un mortier composé de chaux et de ciment, et non de sable ; parce qu'alors les différentes parties anguleuses du ciment, s'insinuant dans le grais avec une forte adhérence, unissent si bien par le secours de la chaux, toutes les parties de ce fossile, qu'ils ne font pour ainsi dire qu'un tout : ce qui rend cette construction indissoluble, et très-capable de résister aux injures des temps. Le pont de Ponts-sur-Yonne en est une preuve ; les arches ont soixante-douze pieds de largeur, l'arc est surbaissé, et les voussoirs de plus de quatre pieds de long chacun, ont été enduits de chaux et de ciment, et non de sable : il faut cependant avoir soin de former des cavités en zigzag dans les lits de cette pierre, afin que le ciment puisse y entrer en plus grande quantité, et n'être pas sujet à se sécher trop promptement par
(s) Déliter une pierre, c'est la moyer ou la fendre par sa moye, ou par des parties tendres qui suivent le lit de la pierre.
la nature du grais, qui s'abreuve volontiers des esprits de la chaux ; parce que le ciment se trouvant alors dépourvu de cet agent, n'aurait pas seul le pouvoir de s'accrocher et de s'incorporer dans le grais, qui a besoin de tous ces secours, pour faire une liaison solide.
Une des causes principales de la dureté du grais, vient de ce qu'il se trouve presque toujours à découvert, et qu'alors l'air le durcit extrêmement ; ce qui doit nous instruire qu'en général, toutes les pierres qui se trouvent dans la terre sans beaucoup creuser, sont plus propres aux bâtiments que celles que l'on tire du fond des carrières ; c'est à quoi les anciens apportaient beaucoup d'attention : car pour rendre leurs édifices d'une plus longue durée, ils ne se servaient que du premier banc des carrières, précautions que nous ne pouvons prendre en France, la plupart de nos carrières étant presque usées dans leur superficie.
Il est bon d'observer que la taille du grais est fort dangereuse aux ouvriers novices, par la subtilité de là vapeur qui en sort, et qu'un ouvrier instruit évite, en travaillant en plein air et à contrevent. Cette vapeur est si subtile, qu'elle traverse les pores du verre ; expérience faite, à ce qu'on dit, avec une bouteille remplie d'eau, et bien bouchée, placée près de l'ouvrage d'un tailleur de grais, dont le fond s'est trouvé quelques jours après, couvert d'une poussière très-fine.
Il faut encore prendre garde lorsque l'on pose des dalles, seuils, canivaux et autres ouvrages en grais de cette espèce, de les bien caler et garnir par-dessous pour les empêcher de se gauchir ; car on ne pourrait y remédier qu'en les retaillant.
Il y a plusieurs raisons qui empêchent d'employer le grais à Paris ; la première est, que la pierre étant assez abondante, on le relegue pour en faire du pavé. Le seconde est, que sa liaison avec le mortier n'est pas si bonne, et ne dure pas si longtemps que celle de la pierre, beaucoup moins encore avec le plâtre. La troisième est, que cette espèce de pierre couterait trop, tant pour la matière, que pour la main-d'œuvre.
La seconde espèce de grais qui est la plus dure, ne sert qu'à faire du pavé, et pour cet effet se taille de trois différentes grandeurs. La première, de huit à neuf pouces cubes, sert à paver les rues, places publiques, grands chemins, etc. et se pose à sec sur du sable de rivière. La seconde, de six à sept pouces cubes, sert à paver les cours, basses-cours, perrons, trotoirs, etc. et se pose aussi à sec sur du sable de rivière, comme le premier, ou avec du mortier de chaux et de ciment. La troisième, de quatre à cinq pouces cubes, sert à paver les écuries, cuisines, lavoirs, communs, etc. et se pose avec du mortier de chaux et ciment.
La pierre de Caèn, qui se tire des carrières de ce nom, en Normandie, et qui tient de l'ardoise, est fort noire, dure, et reçoit très-bien le poli ; on en fait des compartiments de pavé dans les vestibules, salles à manger, salons, etc.
Toutes ces espèces de pavés se paient à la taise superficielle.
Il se trouve dans la province d'Anjou, aux environs de la ville d'Angers, beaucoup de carrières très-abondantes en pierre noire et assez dure, dont on fait maintenant de l'ardoise pour les couvertures des bâtiments. Les anciens ne connaissant pas l'usage qu'on en pouvait faire, s'en servaient dans la construction des bâtiments, tel qu'il s'en voit encore dans la plupart de ceux de cette ville, qui sont faits de cette pierre. On s'en sert quelquefois dans les compartiments de pavé, en place de celle de Caèn.
Des différentes pierres tendres. Les pierres tendres ont l'avantage de se tailler plus facilement que les autres, et de se durcir à l'air. Lorsqu'elles ne sont pas bien choisies, cette dureté ne se trouve qu'aux parements extérieurs qui se forment en croute, et l'intérieur se mouline : la nature de ces pierres doit faire éviter de les employer dans des lieux humides ; c'est pourquoi on s'en sert dans les étages supérieurs, autant pour diminuer le poids des pierres plus dures et plus serrées, que pour les décharger d'un fardeau considérable qu'elles sont incapables de soutenir, comme on vient de faire au second ordre du portail de S. Sulpice, et au troisième de l'intérieur du Louvre.
La pierre de Saint-Leu qui se tire des carrières, près Saint-Leu-sur-Oise, et qui porte depuis deux, jusqu'à quatre pieds de hauteur de banc, se divise en plusieurs espèces. La première qu'on appele, pierre de Saint-Leu, et qui se tire d'une carrière de ce nom, est tendre, douce, et d'une blancheur tirant un peu sur le jaune. La seconde qu'on appelle de Maillet, qui se tire d'une carrière appelée ainsi, est plus ferme, plus pleine et plus blanche, et ne se délite point : elle est très-propre aux ornements de sculpture et à la décoration des façades. La troisième qu'on appelle de Trocy, est de même espèce que cette dernière ; mais de toutes les pierres, celle dont le lit est le plus difficîle à trouver ; on ne le découvre que par des petits trous. La quatrième s'appelle pierre de Vergelée : il y en a de trois sortes. La première qui se tire d'un des bancs des carrières de Saint-Leu, est fort dure, rustique, et remplie de petits trous. Elle résiste très-bien au fardeau, et est fort propre aux bâtiments aquatiques ; on s'en sert pour faire des voutes de ponts, de caves, d'écuries et autres lieux humides. La seconde sorte de vergelée qui est beaucoup meilleure, se tire des carrières de Villiers, près Saint-Leu. La troisième qui se prend à Carriere-sous-le-bois, est plus tendre, plus grise et plus remplie de veines que le Saint-Leu, et ne saurait résister au fardeau.
La pierre de tuf, du latin tophus, pierre rustique, tendre et trouée, est une pierre pleine de trous, à-peu-près semblable à celle de meulière, mais beaucoup plus tendre. On s'en sert en quelques endroits en France et en Italie, pour la construction des bâtiments.
La pierre de craye est une pierre très-blanche et fort tendre, qui porte depuis huit pouces jusqu'à quinze pouces de hauteur de banc, avec laquelle on bâtit en Champagne, et dans une partie de la Flandres. On s'en sert encore pour tracer au cordeau, et pour dessiner.
Il se trouve encore à Belleville, Montmartre, et dans plusieurs autres endroits, aux environs de Paris, des carrières qui fournissent des pierres que l'on nomme pierres à plâtre, et qui ne sont pas bonnes à autre chose. On en emploie quelquefois hors de Paris, pour la construction des murs de clôture, baraques, cabanes, et autres ouvrages de cette espèce. Mais il est défendu sous de sévères peines aux entrepreneurs, et même aux particuliers, d'en employer à Paris, cette pierre étant d'une très-mauvaise qualité, se moulinant et se pourrissant à l'humidité.
De la pierre selon ses qualités. Les qualités de la pierre dure ou tendre, sont d'être vive, fière, franche, pleine, trouée, poreuse, choqueuse, gelisse, verte ou de couleur.
On appelle pierre vive celle qui se durcit autant dans la carrière que dehors, comme les marbres de liais, etc.
Pierre fière, celle qui est difficîle à tailler, à cause de sa grande sécheresse, et qui résiste au ciseau, comme la belle hache, le lais ferault, et la plupart des pierres dures.
Pierre franche, celle qui est la plus parfaite que l'on puisse tirer de la carrière, et qui ne tient ni de la dureté du ciel de la carrière, ni de la qualité de celles qui sont dans le fond.
Pierre pleine, toute pierre dure qui n'a ni cailloux, ni coquillages, ni trous, ni moye, ni molières, comme sont les plus beaux liais, la pierre de tonnerre, etc.
Pierre entière, celle qui n'est ni cassée ni fêlée, dans laquelle il ne se trouve ni fil, ni veine courante ou traversante ; on la connait facilement par le son qu'elle rend en la frappant avec le marteau.
Pierre trouée, poreuse, ou choqueuse, celle qui étant taillée ou remplie de trous dans ses parements, tel que le rustic de Meudon, le tuf, la meulière, etc.
Pierre gelisse ou verte, celle qui est nouvellement tirée de la carrière, et qui ne s'est pas encore dépouillée de son humidité naturelle.
Pierre de couleur, celle qui tirant sur quelques couleurs, cause une variété quelquefois agréable dans les bâtiments.
De la pierre selon ses défauts. Il n'y a point de pierre qui n'ait des défauts capables de la faire rebuter, soit par rapport à elle-même, soit par la négligence ou mal-façon des ouvriers qui la mettent en œuvre, c'est pourquoi il faut éviter d'employer celles que l'on appelle ainsi.
Des défauts de la pierre par rapport à elle-même. Pierre de ciel, celle que l'on tire du premier banc des carrières ; elle est le plus souvent défectueuse ou composée de parties très-tendres et très-dures indifféremment, selon le lieu de la carrière où elle s'est trouvée.
Pierre coquilleuse ou coquillière, celle dont les parements taillés sont remplis de trous ou de coquillages, comme la pierre S. Nom, à Versailles.
Pierre de soupré, celle du fond de la carrière de S. Leu, qui est trouée, poreuse, et dont on ne peut se servir à cause de ses mauvaises qualités.
Pierre de souchet, en quelques endroits, celle du fond de la carrière, qui n'étant pas formée plus que le bouzin, est de nulle valeur.
Pierre humide, celle qui n'ayant pas encore eu le temps de sécher, est sujette à se feuilleter ou à se geler.
Pierre grasse, celle qui étant humide, est par conséquent sujette à la gelée, comme la pierre de cliquart.
Pierre feuilletée, celle qui étant exposée à la gelée, se délite par feuillet, et tombe par écaille, comme la lambourde.
Pierre délitée, celle qui après s'être fendue par un fil de son lit, ne peut être taillée sans déchet, et ne peut servir après cela que pour des arrases.
Pierre moulinée, celle qui est graveleuse, et s'égraine à l'humidité, comme la lambourde qui a particulièrement ce défaut.
Pierre félée, celle qui se trouve cassée par une veine ou un fil qui court ou qui traverse.
Pierre moyée, celle dont le lit n'étant pas également dur, dont on ôte la moye et le tendre, qui diminue son épaisseur, ce qui arrive souvent à la pierre de la chaussée.
Des défauts de la pierre, par rapport à la main-d'œuvre. On appelle pierre gauche, celle qui au sortir de la main de l'ouvrier, n'a pas ses parements opposés parallèles, lorsqu'ils doivent l'être suivant l'épure (t), ou dont les surfaces ne se bornoyent point, et qu'on ne saurait retailler sans déchet.
Pierre coupée, celle qui ayant été mal taillée, et par conséquent gâtée, ne peut servir pour l'endroit où elle avait été destinée.
Pierre en délit, ou délit en joint, celle qui dans un cours d'assises, n'est pas posée sur son lit de la même manière qu'elle a été trouvée dans la carrière, mais au contraire sur un de ses parements. On distingue pierre en délit de délit en joint, en ce que l'un est lorsque la pierre étant posée, le parement de lit fait parement de face, et l'autre lorsque ce même parement de lit fait parement de joint.
De la pierre selon ses façons. On entend par façons la première forme que reçoit la pierre, lorsqu'elle sort de la carrière pour arriver au chantier, ainsi que celle qu'on lui donne par le secours de l'appareil, selon la place qu'elle doit occuper dans le bâtiment ; c'est pourquoi on appele.
Pierre au binard, celle qui est en un si gros volume, et d'un si grand poids, qu'elle ne peut être transportée sur l'attelier, par les charrais ordinaires, et qu'on est obligé pour cet effet de transporter sur un binard, espèce de chariot tiré par plusieurs chevaux attelés deux à deux, ainsi qu'on l'a pratiqué au Louvre, pour des pierres de S. Leu, qui pesaient depuis douze jusqu'à vingt-deux et vingt-trois milliers ; dont on a fait une partie des frontons.
Pierre d'échantillon, celle qui est assujettie à une mesure envoyée par l'appareilleur aux carrières, et à laquelle le carrier est obligé de se conformer avant que de la livrer à l'entrepreneur ; au lieu que toutes les autres sans aucune mesure constatée, se livrent à la voie, et ont un prix courant.
Pierre en debord, celle que les carrières envaient à l'attelier, sans être commandée.
Pierre velue, celle qui est brute, telle qu'on l'a amenée de sa carrière au chantier, et à laquelle on n'a point encore travaillé.
Pierre bien faite, celle où il se trouve fort peu de déchet en l'équarissant.
Pierre ébouzinée, celle dont on a ôté tout le tendre et le bouzin.
Pierre tranchée, celle où l'on a fait une tranchée avec le marteau, fig. 89. dans toute sa hauteur, à dessein d'en couper.
Pierre débitée, celle qui est sciée. La pierre dure et la pierre tendre ne se débitent point de la même manière. L'une se débite à la scie sans dent, fig. 143. avec de l'eau et du grais comme le liais, la pierre d'Arcueil, etc. et l'autre à la scie à dent, fig. 145. comme le S. Leu, le tuf, la craie, etc.
Pierre de haut et bas appareil, celle qui porte plus ou moins de hauteur de banc, après avoir été atteinte jusqu'au vif.
Pierre en chantier, celle qui se trouve callée par le tailleur de pierre, et disposée pour être taillée.
Pierre esmillée, celle qui est équarrie et taillée grossièrement avec la pointe du marteau, pour être employée dans les fondations, gros murs, etc. ainsi qu'on l'a pratiqué aux cinq premières assises des fondements de la nouvelle église de Sainte Génevieve, et à ceux des bâtiments de la place de Louis XV.
Pierre hachée, celle dont les parements sont dressés avec la hache A du marteau bretelé fig. 93. pour être ensuite layée ou rustiquée.
Pierre layée, celle dont les parements sont travaillés au marteau bretelé, fig. 91.
Pierre rustiquée, celle qui ayant été équarrie et hachée, est piquée grossièrement avec la pointe du marteau, fig. 89.
Pierre piquée, celle dont les parements sont piqués avec la pointe du marteau, fig. 91.
Pierre ragrée au fer, ou riflée, celle qui a été passée au riflard, fig. 114 et 115.
(t) Une épure est un dessein ou développement géométrique des lignes droites et courbes des voutes.
Pierre traversée, celle qui après avoir été bretelée, les trants des bretelures se croisent.
Pierre polie, celle qui étant dure ; a reçu le poli au grais, en sorte qu'il ne parait plus aucunes marques de l'outil avec lequel on l'a travaillée.
Pierre taillée, celle qui ayant été coupée, est taillée de nouveau avec déchet : on appelle encore de ce nom celle qui provenant d'une démolition, a été taillée une seconde fais, pour être derechef mise en œuvre.
Pierre faite, celle qui est entièrement taillée, et prête à être enlevée, pour être mise en place par le poseur.
Pierre nette, celle qui est équarrie et atteinte jusqu'au vif.
Pierre retournée, celle dont les parements opposés sont d'équerre et parallèles entr'eux.
Pierre louvée, celle qui a un trou méplat pour recevoir la louve, fig. 163.
Pierre d'encoignure, celle qui ayant deux parements d'équerre l'un à l'autre se trouve placée dans l'angle de quelques avants ou arrières corps.
Pierre parpeigne, de parpein, ou faisant parpein, celle qui traverse l'épaisseur du mur, et fait parement des deux côtés ; on l'appelle encore pamieresse.
Pierre fusible, celle qui change de nature, et devient transparente par le moyen du feu.
Pierre statuaire, celle qui étant d'échantillon, est propre et destinée pour faire une statue.
Pierre fichée, celle dont l'intérieur du joint est rempli de mortier clair ou de coulis.
Pierres jointoyées, celles dont l'extérieur des joints est bouché, et ragréé de mortier serré, ou de plâtre.
Pierres feintes, celles qui pour faire l'ornement d'un mur de face, ou de terrasse, sont séparées et comparties en manière de bossage en liaison, soit en relief ou seulement marquées sur le mur par les enduits ou crepis.
Pierres à bossages, ou de refend, celles qui étant posées, représentent la hauteur égale des assises, dont les joints sont refendus de différentes manières.
Pierres artificielles, toutes espèces de briques, tuiles, carreaux, etc. pétries et moulées, cuites ou crues.
De la pierre selon ses usages. On appelle première pierre, celle qui avant que d'élever un mur de fondation d'un édifice, est destinée à renfermer dans une cavité d'une certaine profondeur, quelques médailles d'or ou d'argent, frappées relativement à la destination du monument, et une table de bronze, sur laquelle sont gravées les armes de celui par les ordres duquel on construit l'édifice. Cette cérémonie qui se fait avec plus ou moins de magnificence, selon la dignité de la personne, ne s'observe cependant que dans les édifices royaux et publics, et non dans les bâtiments particuliers. Cet usage existait du temps des Grecs, et c'est par ce moyen qu'on a pu apprendre les époques de l'édification de leurs monuments, qui sans cette précaution serait tombée dans l'oubli, par la destruction de leurs bâtiments, dans les différentes révolutions qui sont survenues.
Dernière pierre, celle qui se place sur l'une des faces d'un édifice, et sur laquelle on grave des inscriptions, qui apprennent à la postérité le motif de son édification, ainsi qu'on l'a pratiqué aux piédestaux des places Royales, des Victoires, de Vendôme à Paris, et aux fontaines publiques, portes S. Martin, saint Denis, saint Antoine, etc.
Pierre percée, celle qui est faite en dale (u), et qui se pose sur le pavé d'une cour, remise ou écurie, ou qui s'encastre dans un châssis aussi de pierre, soit pour donner de l'air ou du jour à une cave, ou sur un puisard pour donner passage aux eaux pluviales d'une ou de plusieurs cours.
Pierre à châssis, celle qui a une couverture circulaire, carrée, ou rectangulaire, de quelque grandeur que ce sait, avec feuillure ou sans feuillure, pour recevoir une grille de fer maillée ou non maillée, percée ou non percée, et servir de fermeture à un regard, fosse d'aisance, etc.
Pierre à évier, du latin emissarium, celle qui est creuse, et que l'on place à rez-de-chaussée, ou à hauteur d'appui, dans un lavoir ou une cuisine, pour faire écouler les eaux dans les dehors. On appelle encore de ce nom une espèce de canal long et était, qui sert d'égoût dans une cour ou allée de maison.
Pierre à laver, celle qui forme une espèce d'auge plate, et qui sert dans une cuisine pour laver la vaisselle.
Pierre perdue, celle que l'on jette dans quelques fleuves, rivières, lacs, ou dans la mer, pour sonder, et que l'on met pour cela dans des caissons, lorsque la profondeur ou la qualité du terrain ne permet pas d'y enfoncer des pieux ; on appelle aussi de ce nom celles qui sont jetées à baies de mortier dans la maçonnerie de blocage.
Pierres incertaines, ou irrégulières, celles que l'on emploie au sortir de la carrière, et dont les angles et les pans sont inégaux : les anciens s'en servaient pour paver ; les ouvriers la nomment de pratique, parce qu'ils la font servir sans y travailler.
Pierres jectices, celles qui se peuvent poser à la main dans toute sorte de construction, et pour le transport desquelles on n'est pas obligé de se servir de machines.
Pierres d'attente, celles que l'on a laissé en bossage, pour y recevoir des ornements, ou inscriptions taillées, ou gravées en place. On appelle encore de ce nom celles qui lors de la construction ont été laissées en harpes (x), ou arrachement (y), pour attendre celle du mur voisin.
Pierres de rapport, celles qui étant de différentes couleurs, servent pour les compartiments de pavés mosaïques (z), et autres ouvrages de cette espèce.
Pierres précieuses, toutes pierres rares, comme l'agate, le lapis, l'aventurine, et autres, dont on enrichit les ouvrages en marbre et en marqueterie, tels qu'on en voit dans l'église des carmelites de la ville de Lyon, où le tabernacle est composé de marbre et de pierres précieuses, et dont les ornements sont de bronze.
Pierre spéculaire, celle qui chez les anciens était transparente comme le talc, qui se débitait par feuillet, et qui leur servait de vitres ; la meilleure, selon Pline, venait d'Espagne : Martial en fait mention dans ses épigrammes, livre II.
Pierres milliaires ; celles qui en forme de socle, ou de borne, chez les Romains, étaient placées sur les grands chemins, et espacées de mille en mille, pour marquer la distance des villes de l'empire, et se comptaient depuis la milliaire dorée de Rome, tel que nous l'ont appris les historiens par les mots de primus, secundus, tertius, etc. ab urbe lapis ; cet usage existe encore maintenant dans toute la Chine.
Pierres noires, celles dont se servent les ouvriers dans le bâtiment pour tracer sur la pierre : la plus tendre sert pour dessiner sur le papier. On appele
(u) Dale est une pierre platte et très-mince.
(x) Harpes, pierres qu'on a laissées à l'épaisseur d'un mur alternativement en saillie, pour faire liaison avec un mur voisin qu'on doit élever par la suite.
(y) Arrachements sont des pierres ou moilons aussi en saillie, qui attendent l'édification du mur voisin.
(z) Mosaïque, ouvrage composé de verres de toutes sortes de couleurs, taillés et ajustés carrément sur un fond de stuc, qui imitent très-bien les diverses couleurs de la peinture, et avec lesquels on exécute différents sujets.
encore pierre blanche ou craye, celle qui est employée aux mêmes usages : la meilleure vient de Champagne.
Pierre d'appui, ou seulement appui, celle qui étant placée dans le tableau inférieur d'une croisée, sert à s'appuyer.
Auge, du latin lavatrina, une pierre placée dans des basses-cours, pour servir d'abreuvoir aux animaux domestiques.
Seuil, du latin limen, celle qui est posée au rez-de-chaussée, dont la longueur traverse la porte, et qui formant une espèce de feuillure, sert de battement à la traverse inférieure du châssis de la porte de menuiserie.
Borne, celle qui a ordinairement la forme d'un cône de deux ou trois pieds de hauteur, tronqué dans son sommet, et qui se place dans l'angle d'un pavillon, d'un avant-corps, ou dans celui d'un piédrait de porte cochère, ou de remise, ou le long d'un mur, pour en éloigner les voitures, et empêcher que les moyeux ne les écorchent et ne les fassent éclater.
Banc, celle qui est placée dans des cours, basses-cours, ou à la principale partie des grands hôtels, pour servir de siege aux domestiques, ou dans un jardin, à ceux qui s'y promenent.
Des libages. Les libages sont de gros moilons ou quartiers de pierre rustique et malfaite, de quatre, cinq, six et quelquefois sept à la voie, qui ne peuvent être fournis à la taise par le carrier, et que l'on ne peut équarrir que grossièrement, à cause de leur dureté, provenant le plus souvent du ciel des carrières, ou d'un banc trop mince. La qualité des libages est proportionnée à celle de la pierre des différentes carrières d'où on les tire : on ne s'en sert que pour les garnis, fondations, et autres ouvrages de cette espèce. On emploie encore en libage les pierres de taille qui ont été coupées, ainsi que celles qui proviennent des démolitions, et qui ne peuvent plus servir.
On appelle quartier de pierre, lorsqu'il n'y en a qu'un à la voie.
Carreaux de pierre, lorsqu'il y en a deux ou trois.
Libage, lorsqu'il y en a quatre, cinq, six, et quelquefois sept à la voie.
Du moilon. Le moilon, du latin mollis, que Vitruve appelle caementum, n'étant autre chose que l'éclat de la pierre, en est par conséquent la partie la plus tendre ; il provient aussi quelquefois d'un banc trop mince. Sa qualité principale est d'être bien équarri et bien gisant, parce qu'alors il a plus de lit, et consomme moins de mortier ou de plâtre.
Le meilleur est celui que l'on tire des carrières d'Arcueil. La qualité des autres est proportionnée à la pierre des carrières dont on le tire, ainsi que celui du faubourg saint Jacques, du faubourg saint Marceau, de Vaugirard et autres.
On l'emploie de quatre manières différentes ; la première qu'on appelle en moilon de plat, est de le poser horizontalement sur son lit, et en liaison dans la construction des murs mitoyens, de refend et autres de cette espèce élevés d'à-plomb. La seconde qu'on appelle en moilon d'appareil, et dont le parement est apparent, exige qu'il soit bien équarri, à vives arêtes, comme la pierre, piqué proprement, de hauteur, et de largeur égale, et bien posé de niveau, et en liaison dans la construction des murs de face, de terrasse, etc. La troisième qu'on appelle en moilon de coupe, est de le poser sur son champ (&) dans la construction des voutes. La quatrième qu'on appelle en moilon piqué, est après l'avoir équarri et ébouriné, de le piquer sur son parement avec la pointe du marteau, fig. 91, pour la construction des voutes des caves, murs de basses-cours, de clôture, de puits, etc.
Du moilon selon ses façons. On appelle moilon blanc, chez les ouvriers, un platras, et non un moilon ; ce qui est un défaut dans la construction.
Moilon esmillé, celui qui est grossièrement équarri et ébouziné avec la hachette, fig. 106, à l'usage des murs de parcs de jardin, et autres de peu d'importance.
Moilon bourru ou de blocage, celui qui est trop mal-fait et trop dur pour être équarri, et que l'on emploie dans les fondations, ou dans l'intérieur des murs, tel qu'il est sorti de la carrière.
Le moilon de roche, dit de meulière, est de cette dernière espèce.
Toutes ces espèces de moilons se livrent à l'entrepreneur à la voie ou à la taise, et dans ce dernier cas l'entrepreneur se charge du taisé.
Du marbre en général. le marbre, du latin marmor, dérivé du grec , reluire, à cause du poli qu'il reçoit, est une espèce de pierre de roche extrêmement dure, qui porte le nom des différentes provinces où sont les carrières dont on le tire. Il s'en trouve de plusieurs couleurs ; les uns sont blancs ou noirs, d'autres sont variés ou mêlés de taches, veines, mouches, ondes et nuages, différemment colorés ; les uns et les autres sont opaques, le blanc seul est transparent, lorsqu'il est débité par tranches minces. Aussi M. Félibien rapporte-t-il que les anciens s'en servaient au lieu de verres pour les croisées des bains, étuves et autres lieux qu'on voulait garantir du froid ; et qu'à Florence, il y avait une église très-bien éclairée, dont les croisées en étaient garnies.
Le marbre se divise en deux espèces ; l'une qu'on appelle antique, et l'autre moderne : par marbre antique, l'on comprend ceux dont les carrières sont épuisées, perdues ou inaccessibles, et que nous ne connaissons que par les ouvrages des anciens : par marbres modernes, l'on comprend ceux dont on se sert actuellement dans les bâtiments, et dont les carrières sont encore existantes. On ne l'emploie le plus communément, à cause de sa cherté, que pour revêtissement ou incrustation, étant rare que l'on en fasse usage en bloc, à l'exception des vases, figures, colonnes et autres ouvrages de cette espèce. Il se trouve d'assez beaux exemples de l'emploi de cette matière dans la décoration intérieure et extérieure des châteaux de Versailles, Trianon, Marly, Sceaux, etc. ainsi que dans les différents bosquets de leurs jardins.
Quoique la diversité des marbres soit infinie, on les réduit cependant à deux espèces ; l'une que l'on nomme veiné, et l'autre breche ; celui-ci n'étant autre chose qu'un amas de petits cailloux de différente couleur fortement unis ensemble, de manière que lorsqu'il se casse, il s'en forme autant de breches qui lui ont fait donner ce nom.
Des marbres antiques. Le marbre antique, dont les carrières étaient dans la Grèce, et dont on voit encore de si belles statues en Italie, est absolument inconnu aujourd'hui ; à son défaut on se sert de celui de Carrare.
Le lapis est estimé le plus beau de tous les marbres antiques ; sa couleur est d'un bleu foncé, moucheté d'un autre bleu plus clair, tirant sur le céleste, et entremêlé de quelques veines d'or. On ne s'en sert, à cause de sa rareté que par incrustation, tel qu'on en voit quelques pièces de rapport à plusieurs tables dans les appartements de Trianon et de Marly.
Le porphyre, du grec , pourpre, passe pour le plus dur de tous les marbres antiques, &, après le lapis, pour un des plus beaux ; il se tiroit
(&) Le champ d'une pierre platte, est la surface la plus mince et la plus petite.
autrefois de la Numidie en Afrique, raison pour laquelle les anciens l'appelaient lapis Numidicus ; il s'en trouve de rouge, de verd et de gris. Le porphyre rouge est fort dur ; sa couleur est d'un rouge foncé, couleur de lie de vin, semé de petites taches blanches, et reçoit très-bien le poli. Les plus grands morceaux que l'on en voie à présent, sont le tombeau de Bacchus dans l'église de sainte Constance, près celle de Sainte Agnès hors les murs de Rome ; celui de Patricius et de sa femme dans l'église de sainte Marie majeure ; celui qui est sous le porche de la Rotonde, et dans l'intérieur une partie du pavé ; une frise corinthienne, plusieurs tables dans les compartiments du lambris ; huit colonnes aux petits autels, ainsi que plusieurs autres colonnes, tombeaux et vases que l'on conserve à Rome. Les plus grands morceaux que l'on voie en France, sont la cuve du roi Dagobert, dans l'église de saint Denis en France, et quelques bustes, tables ou vases dans les magasins du Roi. Le plus beau est celui dont le rouge est le plus vif, et les taches les plus blanches et les plus petites. Le porphyre verd, qui est beaucoup plus rare, a la même dureté que le précédent. et est entremêlé de petites taches vertes et de petits points gris. On en voit encore quelques tables, et quelques vases. Le porphyre gris est tacheté de noir et est beaucoup plus tendre.
Le serpentin, appelé par les anciens ophites, du grec , serpent, à cause de sa couleur qui imite celle de la peau d'un serpent, se tirait anciennement des carrières d'Egypte. Ce marbre tient beaucoup de la dureté du porphyre ; sa couleur est d'un verd brun, mêlé de quelques taches carrées et rondes, ainsi que de quelques veines jaunes, et d'un verd pâle couleur de ciboule. Sa rareté fait qu'on ne l'emploie que par incrustation. Les plus grands morceaux que l'on en voit, sont deux colonnes dans l'église de S. Laurent, in lucina, à Rome, et quelques tables dans les compartiments de pavés, ou de lambris de plusieurs édifices antiques, tel que dans l'intérieur du panthéon, quelques petites colonnes corinthiennes au tabernacle de l'église des Carmélites, de la ville de Lyon, et quelques tables dans les appartements et dans les magasins du roi.
L'albâtre, du grec , est un marbre blanc et transparent, ou varié de plusieurs couleurs, qui se tire des Alpes et des Pyrénées ; il est fort tendre au sortir de la carrière, et se durcit beaucoup à l'air. Il y en a de plusieurs espèces, le blanc, le varié, le moutahuto, le violet et le roquebrue. L'albâtre blanc sert à faire des vases, figures et autres ornements de moyenne grandeur. Le varié se divise en trois espèces ; la première se nomme oriental ; la seconde le fleuri, et la troisième l'agatato. L'oriental se divise encore en deux, dont l'une, en forme d'agate, est mêlée de veines roses, jaunes, bleues, et de blanc pâle ; on voit dans la galerie de Versailles plusieurs vases de ce marbre, de moyenne grandeur. L'autre est ondé et mêlé de veines grises et rousses par longues bandes. Il se trouve dans le bosquet de l'étoîle à Versailles, une colonne ionique de cette espèce de marbre, qui porte un buste d'Alexandre. L'albâtre fleuri est de deux espèces ; l'une est tachetée de toutes sortes de couleurs, comme des fleurs d'où il tire son nom ; l'autre, veiné en forme d'agate, est glacé et transparent ; il se trouve encore dans ce genre d'albâtre qu'on appelle en Italie à pecores, parce que ses taches ressemblent en quelque sorte à des moutons que l'on peint dans les paysages. L'albâtre agatato est de même que l'albâtre oriental ; mais dont les couleurs sont plus pâles. L'albâtre de moutahuto est fort tendre ; mais cependant plus dur que les agathes d'Allemagne, auxquelles il ressemble. Sa couleur est d'un fond brun, mêlée de veine grise qui semble imiter des figures de cartes géographiques ; il s'en trouve une table de cette espèce dans le salon qui précède la galerie de Trianon. L'albâtre violet est ondé et transparent. L'albâtre de Roquebrue, qui se tire du pays de ce nom en Languedoc, est beaucoup plus dur que les précédents ; sa couleur est d'un gris foncé et d'un rouge brun par grandes taches ; il y a de toutes ces espèces de marbres dans les appartements du roi, soit en tables, figures, vases, etc.
Le granit, ainsi appelé, parce qu'il est marqué de petites taches formées de plusieurs grains de sables condensés, est très-dur et reçoit mal le poli ; il est évident qu'il n'y a point de marbre dont les anciens aient tiré de si grands morceaux, et en si grande quantité ; puisque la plupart des édifices de Rome, jusqu'aux maisons des particuliers, en étaient décorés. Ce marbre était sans doute très-commun, par la quantité des troncs de colonnes qui servent encore aujourd'hui de bornes dans tous les quartiers de la ville. Il en est de plusieurs espèces ; celui d'Egypte, d'Italie et de Dauphiné ; le verd et le violet. Le granit d'Egypte, connu sous le nom de Thebaïcum marmor, et qui se tirait de la Thébaïde, est d'un fond blanc sale, mêlé de petites taches grises et verdâtres, et presque aussi dur que le porphyre. De ce marbre sont les colonnes de sainte Sophie à Constantinople, qui passent 40 pieds de hauteur. Le granit d'Italie qui, selon M. Félibien, se tirait des carrières de l'île d'Elbe, a des petites taches un peu verdâtres, et est moins dur que celui d'Egypte. De ce marbre sont les seize colonnes corinthiennes du porche du Panthéon ; ainsi que plusieurs cuves de bains servant aujourd'hui à Rome de bassins de fontaines. Le granit de Dauphiné qui se tire des côtes du Rhône, près de l'embouchure de l'Isere, est très-ancien, comme il parait par plusieurs colonnes qui sont en Provence. Le granit verd est une espèce de serpentin ou verd antique, mêlé de petites taches blanches et vertes ; on voit à Rome plusieurs colonnes de cette espèce de marbre. Le granit violet qui se tire des carrières d'Egypte, est mêlé de blanc, et de violet par petites taches. De ce marbre sont la plupart des obélisques antiques de Rome, tels que ceux de saint Pierre du Vatican, de saint Jean de Latran, de la porte du Peuple, et autres.
Le marbre de jaspe, du grec , verd, est de couleur verdâtre, mêlé de petites taches rouges. Il y a encore un jaspe antique noir et blanc par petites taches, mais qui est très-rare.
Le marbre de Paros se tirait autrefois d'une île de l'Archipel, nommée ainsi, et qu'on appelle aujourd'hui Peris ou Parissa. Varron lui avait donné le nom de marbre lychnites, du grec , une lampe, parce qu'on le taillait dans les carrières à la lumière des lampes. Sa couleur est d'un blanc un peu jaune et transparent, plus tendre que celui dont nous nous servons maintenant, approchant de l'albâtre, mais pas si blanc ; la plupart des statues antiques sont de ce marbre.
Le marbre verd antique, dont les carrières sont perdues, est très-rare. Sa couleur est mêlée d'un verd de gazon, et d'un verd noir par taches d'inégales formes et grandeur ; il n'en reste que quelques chambranles dans le vieux château de Meudon.
Le marbre blanc et noir, dont les carrières sont perdues, est mêlé par plaques de blanc très-pur, et de noir très-noir. De ce marbre sont deux petites colonnes corinthiennes dans la chapelle de S. Roch aux Mathurins, deux autres composites dans celle de Rostaing aux Feuillans rue S. Honoré, une belle table au tombeau de Louis de la Trémouille aux Célestins, ainsi que les pieds d'estaux et le parement d'autel de la chapelle de S. Benait dans l'église de S. Denys en France, qui en sont incrustés.
Le marbre de petit antique est de cette dernière espèce, c'est-à-dire blanc et noir, mais plus brouillé ; et par petites veines, ressemblant au marbre de Barbançon. On en voit deux petites colonnes ïoniques dans le petit appartement des bains à Versailles.
Le marbre de brocatelle se tirait autrefois près d'Andrinople en Grèce : sa couleur est mêlée de petites nuances grises, rouges, pâles, jaunes, et isabelles : les dix petites colonnes corinthiennes du tabernacle des Mathurins, ainsi que les huit composites de celui de sainte Génevieve, sont de ce marbre. On en voit encore quelques chambranles de cheminées dans les appartements de Trianon, et quelques tables de moyenne grandeur dans les magasins du roi.
Le marbre africain est tacheté de rouge brun, mêlé de quelques veines de blanc sale, et de couleur de chair, avec quelques filets d'un verd foncé. Il se trouve quatre consoles de ce marbre en manière de cartouche, au tombeau du marquis de Gesvres dans l'église des pères Célestins à Paris. Scamozzi parle d'un autre marbre africain très-dur, recevant un très-beau poli, d'un fond blanc, mêlé de couleur de chair, et quelquefois couleur de sang, avec des veines brunes et noires fort déliées, et ondées.
Le marbre noir antique était de deux espèces ; l'un qui se nommait marmor luculleum, et qui se tirait de Grèce, était fort tendre. C'est de ce marbre que Marcus Scaurus fit tailler des colonnes de trente-huit pieds de hauteur, dont il orna son palais ; l'autre appelé par les Grecs , pierre de touche, et par les Italiens, pietra di paragone, pierre de comparaison, que Vitruve nomme index ; parce qu'il sert à éprouver les métaux, se tirait de l'Ethiopie, et était plus estimé que le premier : ce marbre était d'un noir gris tirant sur le fer. Vespasien en sit faire la figure du Nil, accompagnée de celle des petits enfants, qui signifiaient les crues et recrues de ce fleuve, et qui de son temps fut posée dans le temple de la paix. De ce marbre sont encore à Rome deux sphynx au bas du Capitole ; dans le vestibule de l'orangerie de Versailles une figure de reine d'Egypte ; dans l'église des pères Jacobins rue S. Jaques à Paris, quelques anciens tombeaux, ainsi que quelques vases dans les Jardins de Meudon.
Le marbre de cipolin, de l'italien cipolino, que Scamozzi croit être celui que les anciens appelaient augustum ou tiberium marmor, parce qu'il fut découvert en Egypte du temps d'Auguste et Tibere, est formé de grandes ondes ou de nuances de blanc, et de verd pâle couleur d'eau de mer ou de ciboule, d'où il tire son nom. On ne l'employait anciennement que pour des colonnes ou pilastres. Celles que le roi fit apporter de Lebeda autrefois Leptis, près de Tripoli, sur les côtes de Barbarie, ainsi que les dix corinthiennes du temple d'Antonin et de Faustine, semblent être de ce marbre. On en voit encore plusieurs pilastres dans la chapelle de l'hôtel de Conti, près le collège Mazarin, du dessein de François Mansard.
Le marbre jaune est de deux espèces ; l'une appelée jaune de sienne, est d'un jaune isabelle, sans veine, et est très-rare : aussi ne l'emploie-t-on que par incrustation dans les compartiments. On voit de ce marbre dans le salon des bains de la reine au Louvre, des scabellons de bustes, qui sans doute sont très-précieux. L'autre appelé dorée, plus jaune que le précédent, est celui à qui Pausanias a donné le nom de marmor croceum, à cause de sa couleur de safran : il se tirait près de la Macédoine ; les bains publics de cette ville en étaient construits. Il se trouve encore à Rome dans la chapelle du mont de piété, quatre niches incrustées de ce marbre.
Le marbre de bigionero, dont les carrières sont perdues, est très-rare. Il y en a quelques morceaux dans les magazins du roi.
Le marbre de lumachello, appelé ainsi, parce que sa couleur est mêlée de taches blanches, noires et grises, formées en coquilles de limaçon, d'où il tire son nom, est très-rare, les carrières en étant perdues : on en voit cependant quelques tables dans les appartements du roi.
Le marbre de picciniseo, dont les carrières sont aussi perdues, est veiné blanc, et d'une couleur approchante de l'isabelle : les quatorze colonnes corinthiennes des chapelles de l'église de la Rotonde à Rome, sont de ce marbre.
Le marbre de breche antique, dont les carrières sont perdues, est mêlé par taches rondes de différente grandeur, de blanc, de noir, de rouge de bleu et de gris. Les deux corps d'architecture qui portent l'entablement où sont nichées les deux colonnes de la sépulture de Jacques de Rouvré, grand-prieur de France, dans l'église de S. Jean de Latran à Paris, sont de ce marbre.
Le marbre de breche antique d'Italie, dont les carrières sont encore perdues, est blanc, noir, et gris : le parement d'autel de la chapelle de S. Denys à Montmartre, est de ce marbre.
Des marbres modernes. Le marbre blanc qui se tire maintenant de Carrare, vers les côtes de Gènes, est dur et fort blanc, et très-propre aux ouvrages de sculpture. On en tire des blocs de telle grandeur que l'on veut ; il s'y rencontre quelquefois des crystallins durs. La plupart des figures modernes du petit parc de Versailles sont de ce marbre.
Le marbre de Carrare, que l'on nomme marbre vierge, est blanc, et se tire des Pyrénées du côté de Bayonne. Il a le grain moins fin que le dernier, reluit comme une espèce de sel, et ressemble au marbre blanc antique, dont toutes les statues de la Grèce ont été faites ; mais il est plus tendre, pas si beau, sujet à jaunir et à se tacher : on s'en sert pour des ouvrages de sculpture.
Le marbre noir moderne est pur et sans tache, comme l'antique ; mais beaucoup plus dur.
Le marbre de Dinant, qui se tire près de la ville de ce nom dans le pays de Liège, est fort commun et d'un noir très-pur et très-beau : on s'en sert pour les tombeaux et sépultures. Il y a quatre colonnes corinthiennes au maître autel de l'église de S.Martin-des-Champs, du dessein de François Mansard ; six colonnes de même ordre au grand autel de S. Louis des pères Jésuites, rue S. Antoine, quatre autres de même ordre dans l'église des pères Carmes déchaussés ; et quatre autres composites à l'autel de sainte Thérese de la même église, sont de ce marbre. Les plus belles colonnes qui en sont faites, sont les six corinthiennes du maître autel des Minimes de la Place royale à Paris.
Le marbre de Namur est aussi fort commun, et aussi noir que celui de Dinant, mais pas si parfait, tirant un peu sur le bleuâtre, et étant traversé de quelques filets gris : on en fait un grand commerce de carreau en Hollande.
Le marbre de Thée qui se tire du pays de Liege du côté de Namur, est d'un noir pur, tendre, et facîle à tailler ; recevant un plus beau poli que celui de Namur et de Dinant. Il est par conséquent très-propre aux ouvrages de sculpture. On en voit quelques chapiteaux corinthiens dans les églises de Flandres, et plusieurs têtes et bustes à Paris.
Le marbre blanc veiné qui vient de Carrare, est d'un bleu foncé sur un fond blanc, mêlé de taches grises et de grandes veines. Ce marbre est sujet à jaunir et à se tacher. On en fait des piédestaux, entablements, et autres ouvrages d'Architecture ; de ce marbre est la plus grande partie du tombeau de M. le Chancelier le Tellier, dans l'église de S. Gervais à Paris.
Le marbre de Margorre qui se tire du Milanez, est fort dur et assez commun. Sa couleur est d'un fond bleu, mêlé de quelques veines brunes, couleur de fer ; une partie du dôme de Milan en a été bâti.
Le marbre noir et blanc qui se tire de l'abbaye Leff près de Dinant, a le fond d'un noir très-pur avec quelques veines fort blanches. De ce marbre sont les quatre colonnes corinthiennes du maître-autel de l'Eglise des Carmélites du faubourg S. Jacques.
Le marbre de Barbançon qui se tire du pays de Hainaut, est un marbre noir veiné de blanc qui est assez commun. Les six colonnes torses composites du baldaquin du Val-de-Grace, l'architrave de corniche corinthienne de l'autel de la chapelle de Créqui aux Capucines, sont de ce marbre. Le plus beau est celui dont le noir est le plus noir, et dont les veines sont les plus blanches et déliées.
Le marbre de Givet se tire près de Charlemont, sur les frontières de Luxembourg. Sa couleur est d'un noir veiné de blanc, mais moins brouillé que le Barbançon. Les marches du baldaquin du Val-de-Grace sont de ce marbre.
Le marbre de Portor se tire du pied des Alpes, aux environs de Carrare. Il en est de deux sortes ; l'un qui a le fond très-noir mêlé de quelques taches et veines jaunes dorées, est le plus beau ; l'autre dont les veines sont blanchâtres est moins estimé. On voit de ce marbre deux colonnes ioniques au tombeau de Jacques de Valais duc d'Angoulême, dans l'église des Minimes de la Place royale ; deux autres de même ordre dans la chapelle de Rostaing de l'église des Feuillans rue S. Honoré ; plusieurs autres dans l'appartement des bains à Versailles, et plusieurs tables, chambranles de cheminées, foyers, etc. au même château, à Marly et à Trianon.
Le marbre de S. Maximin est une espèce de portor, dont le noir et le jaune sont très-vifs : on en voit quelques échantillons dans les magasins du roi.
Le marbre de serpentin moderne vient d'Allemagne, et sert plutôt pour des vases et autres ornements de cette espèce, que pour des ouvrages d'Architecture.
Le marbre verd moderne est de deux espèces ; l'une que l'on nomme improprement verd d'Egypte, se tire près de Carrare sur les côtes de Gènes. Sa couleur est d'un verd foncé, mêlé de quelques taches de blanc et de gris-de-lin. Les deux cuves rectangulaires des fontaines de la Gloire, et de la Victoire dans le bosquet de l'arc de triomphe à Versailles, la cheminée du cabinet des bijoux, et celle du cabinet de monseigneur le dauphin à S. Germain en Laye, sont de ce marbre ; l'autre qu'on nomme verd de mer, se tire des environs. Sa couleur est d'un verd plus clair, mêlé de veines blanches. On en voit quatre colonnes ioniques dans l'église des Carmélites du faubourg saint Jacques à Paris.
Le marbre jaspé est celui qui approche du jaspe antique ; le plus beau est celui qui en approche le plus.
Le marbre de Lumachello moderne vient d'Italie, et est presque semblable à l'antique ; mais les taches n'en sont pas si bien marquées.
Le marbre de Breme qui vient d'Italie, est d'un fond jaune mêlé de taches blanches.
Le marbre occhio di pavone, oeil de paon, vient aussi d'Italie, et est mêlé de taches blanches, bleuâtres, et rouges, ressemblantes en quelque sorte aux espèces d'yeux qui sont au bout des plumes de la queue des paons ; ce qui lui a fait donner ce nom.
Le marbre porta sancta ou serena, de la porte sainte ou seraine, est un marbre mêlé de grandes taches et de veines grises, jaunes et rougeâtres : on en voit quelques échantillons dans les magasins du roi.
Le marbre fior di persica, ou fleur de pêcher, qui vient d'Italie, est mêlé de taches blanches, rouges et un peu jaunes : on voit de ce marbre dans les magasins du roi.
Le marbre di Vescovo, ou de l'évêque, qui vient aussi d'Italie, est mêlé de veines verdâtres, traversées de bandes blanches, allongées, arrondies et transparentes.
Le marbre de brocatelle, appelé brocatelle d'Espagne, et qui se tire d'une carrière antique de Tortose en Andalousie, est très-rare. Sa couleur est mêlée de petites nuances de couleurs jaune, rouge, grise, pâle et isabelle. Les quatre colonnes du maître-autel des Mathurins à Paris sont de ce marbre ; ainsi que quelques chambranles de cheminées à Trianon, et quelques petits blocs dans les magasins du roi.
Le marbre de Boulogne est une espèce de brocatelle qui vient de Picardie, mais dont les taches sont plus grandes, et mêlées de quelques filets rouges. Le jubé de l'église métropolitaine de Paris en est construit.
Le marbre de Champagne qui tient de la brocatelle, est mêlé de bleu par taches rondes comme des yeux de perdrix ; il s'en trouve encore d'autres mêlés par nuances de blanc et de jaune pâle.
Le marbre de Sainte Baume se tire du pays de ce nom en Provence. Sa couleur est d'un fond blanc et rouge, mêlé de jaune approchant de la brocatelle. Ce marbre est fort rare, et a valu jusqu'à 60 livres le pied cube. Il s'en voit deux colonnes corinthiennes à une chapelle à côté du maître-autel de l'église du Calvaire au Marais.
Le marbre de Tray qui se tire près Sainte Baume en Provence, ressemble assez au précédent. Sa couleur est un fond jaunâtre, tacheté d'un peu de rouge, de blanc et de gris mêlé. Les pilastres ioniques du salon du château de Seaux, quelques chambranles de cheminées au même château, quelques autres à Trianon, sont de ce marbre.
Le marbre de Languedoc est de deux espèces ; l'une qui se tire près de la ville de Cosne en Languedoc, est très-commun. Sa couleur est d'un fond rouge, de vermillon sale, entremêlé de grandes veines et taches blanches. On l'emploie pour la décoration des principales cours, vestibules, péristiles, etc. Les retraites de la nef de S. Sulpice, l'autel de Notre-Dame de Savonne dans l'église des Augustins déchaussés à Paris, ainsi que les quatorze colonnes ioniques de la cour du château de Trianon, sont de ce marbre ; l'autre qui vient de Narbonne, et qui est de couleur blanche, grise et bleuâtre, est beaucoup plus estimé.
Le marbre de Roquebrue qui se tire à sept lieues de Narbonne, est à-peu-près semblable à celui du Languedoc, et ne différe qu'en ce que ses taches blanches sont toutes en forme de pommes rondes : il s'en trouve plusieurs blocs dans les magasins du roi.
Le marbre de Caen en Normandie, est presque semblable à celui de Languedoc, mais plus brouillé, et moins vif en couleur. Il se trouve de ce marbre à Valery en Bourgogne, au tombeau de Henri de Bourbon prince de Condé.
Le marbre de griotte, ainsi appelé, parce que sa couleur approche beaucoup des griottes ou cerises, se tire près de Cosne en Languedoc, et est d'un rouge foncé, mêlé de blanc sale ; le chambranle de la cheminée du grand appartement du roi à Trianon, est de ce marbre.
Le marbre de bleu turquin vient des côtes de Gènes. Sa couleur est mêlée de blanc sale, sujette à jaunir et à se tacher. De ce marbre sont l'embassement du piédestal de la statue équestre de Henri IV. sur le pont-neuf, et les huit colonnes respectivement opposées dans la colonnade de Versailles.
Le marbre Serancolin se tire d'un endroit appelé le Val d'or, ou la vallée d'or, près Serancolin et des Pyrénées en Gascogne. Sa couleur est d'un rouge couleur de sang, mêlé de gris, de jaune, et de quelques endroits transparents comme l'agate ; le plus beau est très-rare, la carrière en étant épuisée. Il se trouve dans le palais des tuileries quelques chambranles de cheminées de ce marbre. Les corniches et bases des piédestaux de la galerie de Versailles, le pied du tombeau de M. le Brun dans l'église de S. Nicolas du Chardonnet, sont aussi de ce marbre : on en voit dans les magasins du roi des blocs de douze pieds, sur dix-huit pouces de grosseur.
Le marbre de Balvacaire se tire au bas de Saint-Bertrand, près Comminges en Gascogne. Sa couleur est d'un fond verdâtre, mêlée de quelques taches rouges, et fort peu de blanches : il s'en trouve dans les magasins du roi.
Le marbre de campan se tire des carrières près Tarbes en Gascogne, et se nomme de la couleur qui y domine le plus : il y en a de blanc, de rouge, de verd et d'isabelle, mêlé par taches et par veines. Celui que l'on nomme verd de campan est d'un verd très-vif, mêlé seulement de blanc, et est fort commun. On en fait des chambranles, tables, foyers, etc. Les plus grands morceaux que l'on en ait, sont les huit colonnes ioniques du château de Trianon.
Le marbre de siguan qui est d'un verd brun mêlé de taches rouges, qui sont quelquefois de couleur de chair mêlée de gris, et de quelques filets verts dans un même morceau ; il ressemble assez au moindre campan verd. Le piédestal extraordinaire de la colonne funéraire d'Anne de Montmorency, Connétable de France, aux Célestins ; les piédestaux, socles et appuis de l'autel des Minimes de la Place royale, et les quatre pilastres corinthiens de la chapelle de la Vierge dans l'église des Carmes déchaussés à Paris, sont de ce marbre.
Le marbre de Savoie qui se tire du pays de ce nom, est d'un fond rouge, mêlé de plusieurs autres couleurs, qui semblent être mastiquées. De ce marbre sont les deux colonnes ioniques de la porte de l'hôtel de ville de Lyon.
Le marbre de gauchenet qui se tire près de Dinant, est d'un fond rouge brun, tacheté et mêlé de quelques veines blanches. On voit de ce marbre quatre colonnes au tombeau du cardinal de Birague, dans l'église de la Couture sainte Catherine ; quatre aux autels de saint Ignace et de saint François Xavier, dans l'église de Saint Louis des pères Jésuites, rue saint Antoine ; six au maître-autel de l'église de saint Eustache ; quatre à celui de l'église des Cordeliers, et quatre au maître-autel de l'église des Filles-Dieu, rue saint Denis, toutes d'ordre corinthien.
Le marbre de Leff, abbaye près de Dinant, est d'un rouge pâle, avec de grandes plaques et quelques veines blanches. Le chapiteau du sanctuaire derrière le baldaquin du Val-de-grace à Paris, est de ce marbre.
Le marbre de rance qui se tire du pays de Hainaut, et qui est très-commun, est aussi de différente beauté. Sa couleur est d'un fond rouge sale, mêlé de taches, et de veines bleues et blanches. Les plus grands morceaux que l'on en ait à Paris, sont les six colonnes corinthiennes du maître-autel de l'église de la Sorbonne. On en voit à la chapelle de la Vierge de la même église, quatre autres de même ordre et de moyenne grandeur ; et huit plus petites aux quatre autres petits autels. Les huit colonnes ioniques de la clôture de saint Martin des champs, les huit composites aux autels de sainte Marguerite, et de saint Casimir dans l'église de saint Germain des Prés, sont de ce marbre. Les plus beaux morceaux que l'on en voit, sont les quatre colonnes et les quatre pilastres français de la galerie de Versailles, les vingt-quatre doriques du balcon du milieu du château ; ainsi que les deux colonnes corinthiennes de la chapelle de Créqui aux Capucines.
Le marbre de Bazalto a le fond d'un brun clair et sans tache, avec quelques filets gris seulement, mais si déliés, qu'ils ressemblent à des cheveux qui commencent à grisonner : on en voit quelques tables dans les appartements du Roi.
Le marbre d'Auvergne, qui se tire de cette province, est d'un fond couleur de rose, mêlé de violet, de jaune et de verd ; il se trouve dans la pièce entre la salle des ambassadeurs et le salon de la grande galerie à Versailles, un chambranle de cheminée de ce marbre.
Le marbre de Bourbon, qui se tire du pays de ce nom, est d'un gris bleuâtre et d'un rouge sale, mêlé de veines de jaune sale. On en fait communément des compartiments de pavé de salons, vestibules, péristiles, etc. Le chambranle de la cheminée de la salle du bal à Versailles, et la moitié du pavé au premier étage de la galerie du nord, de plein-pié à la chapelle, sont de ce marbre.
Le marbre de Hon, qui vient de Liege, est de couleur grisâtre et blanche, mêlé d'un rouge couleur de sang. Les piédestaux, architraves et corniches du maître autel de l'église de S. Lambert à Liege, sont de ce marbre.
Le marbre de Sicîle est de deux espèces ; l'un que l'on nomme ancien, et l'autre moderne. Le premier est d'un rouge brun, blanc et isabelle, et par taches carrées et longues, semblables à du taffetas rayé ; ses couleurs sont très-vives. Les vingt-quatre petites colonnes corinthiennes du tabernacle des PP. de l'Oratoire rue saint Honoré, ainsi que quelques morceaux de dix à douze pieds de long dans les magasins du Roi, sont de ce marbre. Le second, qui ressemble à l'ancien, est une espèce de breche de Vérone ; voyez ci-après. On en voit quelques chambranles et attiques de cheminée dans le château de Meudon.
Le marbre de Suisse est d'un fond bleu d'ardoise, mêlé par nuance de blanc pâle.
Des marbres de breches modernes. La breche blanche est mêlée de brun, de gris, de violet, et de grandes taches blanches.
La breche noire ou petite breche est d'un fond gris, brun, mêlé de taches noires et quelques petits points blancs. Le socle et le fond de l'autel de Notre-Dame de Savonne, dans l'église des PP. Augustins déchaussés à Paris, sont de ce marbre.
La breche dorée est mêlée de taches jaunes et blanches. Il s'en trouve des morceaux dans les magasins du Roi.
La breche coraline ou serancoline a quelques taches de couleur de corail. Le chambranle de la principale pièce du grand appartement de l'hôtel de Saint-Pouange à Paris, est de ce marbre.
La breche violette ou d'Italie moderne a le fond brun, rougeâtre, avec de longues veines ou taches violettes mêlées de blanc. Ce marbre est très-beau pour les appartements d'été ; mais si on le néglige et qu'on n'ait pas soin de l'entretenir, il passe, se jaunit, et est sujet à se tacher par la graisse, la cire, la peinture, l'huile, etc.
La breche isabelle est mêlée de taches blanches, violettes et pâles, avec de grandes plaques de couleur isabelle. Les quatre colonnes doriques isolées dans le vestibule de l'appartement des bains à Versailles, sont de ce marbre.
La breche des Pyrénées est d'un fond brun, mêlé de gris et de plusieurs autres couleurs. De ce marbre sont deux belles colonnes corinthiennes au fond du maître autel de Saint Nicolas des Champs à Paris.
La breche grosse ou grosse breche, ainsi appelée parce qu'elle a toutes les couleurs des autres breches, est mêlée de taches rouges, grises, jaunes, bleues, blanches et noires. Des quatre colonnes qui portent la châsse de Sainte Génevieve dans l'église de ce nom à Paris, les deux de devant sont de ce marbre.
La breche de Vérone est entremêlée de bleu, de rouge pâle et cramoisi. Il s'en trouve un chambranle de cheminée dans la dernière pièce de Trianon, sous le bois du côté des sources.
La breche sauveterre est mêlée de taches noires, grises et jaunes. Le tombeau de la mère de M. Lebrun premier peintre du Roi, qui est dans sa chapelle à Saint Nicolas du chardonnet, est de ce marbre.
La breche saraveche a le fond brun et violet, mêlé de grandes taches blanches et isabelles. Les huit colonnes corinthiennes du maître autel des grands Augustins, sont de ce marbre.
La breche saraveche petite, ou petite breche saraveche n'est appelée ainsi que parce que les taches en sont plus petites.
La breche sette bazi ou de sept bases, a le fond brun, mêlé de petites taches rondes de bleu sale. Il s'en trouve dans les magasins du Roi.
Il se trouve encore à Paris plusieurs autres marbres, comme celui d'Antin, de Laval, de Cerfontaine de Bergoopzom, de Montbart, de Malplaquet, de Merlemont, de Saint-Remy et le royal, ainsi que quelques breches, comme celle de Florence, de Florières, d'Alet, etc.
Les marbres antiques s'emploient par corvée, et se paient à proportion de leur rareté ; les marbres modernes se paient depuis douze livres jusqu'à cent livres le pied cube, façon à part, à proportion de leur beauté et de leur rareté.
Des défauts du marbre. Le marbre, ainsi que la pierre, a des défauts qui peuvent le faire rebuter : ainsi on appele.
Marbre fier celui qui, à cause de sa trop grande dureté, est difficîle à travailler, et sujet à s'éclater comme tous les marbres durs.
Marbre pouf, celui qui est de la nature du grais, et qui étant travaillé ne peut retenir ses arêtes vives, tel est le marbre blanc des Grecs, celui des Pyrénées et plusieurs autres.
Marbre terrasseux, celui qui porte avec lui des parties tendres appelées terrasses, qu'on est souvent obligé de remplir de mastic, tel que le marbre du Languedoc, celui de Hon, et la plupart des breches.
Marbre filardeux, celui qui a des fils qui le traversent, comme celui de Sainte-Baume, le serancolin, le rance, et presque tous les marbres de couleur.
Marbre camelotté, celui qui étant de même couleur après avoir été poli, parait tabisé, comme le marbre de Namur et quelques autres.
Du marbre selon ses façons. On appelle marbre brut celui qui étant sorti de la carrière en bloc d'échantillon ou par quartier, n'a pas encore été travaillé.
Marbre dégrossi, celui qui est débité dans le chantier à la scie, ou seulement équarri au marteau, selon la disposition d'un vase, d'une figure, d'un profil, ou autre ouvrage de cette espèce.
Marbre ébauché, celui qui ayant déjà reçu quelques membres de sculpture ou d'architecture, est travaillé à la double pointe (fig. 89.) pour l'un, et approché avec le ciseau pour l'autre.
Marbre piqué, celui qui est travaillé avec la pointe du marteau (fig. 91.) pour détacher les avant-corps des arriere-corps dans l'extérieur des ouvrages rustiques.
Marbre matte, celui qui est frotté avec de la prêle (a) ou de la peau de chien de mer (b), pour détacher des membres d'architecture ou de sculpture de dessus un fond poli.
Marbre poli, celui qui ayant été frotté avec le grais et le rabot (c) et ensuite repassé avec la pierre de ponce, est poli à force de bras avec un tampon de linge, et de la potée d'émeril pour les marbres de couleur, et de la potée d'étain pour les marbres blancs, celle d'émeril les roussissant. Il est mieux de se servir, ainsi qu'on le pratique en Italie, d'un morceau de plomb au lieu de linge, pour donner au marbre un plus beau poli et de plus longue durée ; mais il en coute beaucoup plus de temps et de peine. Le marbre sale, terne ou taché, se repolit de la même manière. Les taches d'huile, particulièrement sur le blanc, ne peuvent s'effacer, parce qu'elles pénétrent.
Marbre fini, celui qui ayant reçu toutes les opérations de la main-d'œuvre, est prêt à être posé en place.
Marbre artificiel, celui qui est fait d'une composition de gypse en manière de stuc, dans laquelle on met diverses couleurs pour imiter le marbre. Cette composition est d'une consistance assez dure et reçoit le poli, mais sujette à s'écailler. On fait encore d'autres marbres artificiels avec des teintures corrosives sur du marbre blanc, qui imitent les différentes couleurs des autres marbres, en pénétrant de plus de quatre lignes dans l'épaisseur du marbre : ce qui fait que l'on peut peindre dessus des figures et des ornements de toute espèce : en sorte que si l'on pouvait débiter ce marbre par feuilles très-minces, on en aurait autant de tableaux de même façon. Cette invention est de M. le comte de Cailus.
Marbre feint, peinture qui imite la diversité des couleurs, veines et accidents des marbres, à laquelle on donne une apparence de poli sur le bois ou sur la pierre, par le vernis que l'on pose dessus.
De la brique en général. La brique est une espèce de pierre artificielle, dont l'usage est très-nécessaire dans la construction des bâtiments. Non-seulement on s'en sert avantageusement au lieu de pierre, de moilon ou de plâtre, mais encore il est de certains genres de construction qui exigent de l'employer préférablement à tous les autres matériaux, comme pour des voutes legeres, qui exigent des murs d'une moindre épaisseur pour en retenir la poussée ; pour des languettes (d) de cheminées, des contre-cœurs, des foyers, etc. nous avons Ve ci-devant que cette pierre était rougeâtre et qu'elle se jetait en moule ; nous allons voir maintenant de quelle manière elle se fabrique, connaissance d'autant plus nécessaire, que dans de certains pays il ne s'y trouve souvent point de carrières à pierre ni à plâtre, et que par-là on est forcé de faire usage de brique, de chaux et de sable.
De la terre propre à faire de la brique. La terre la plus propre à faire de la brique est communément appelée terre glaise ; la meilleure doit être de couleur grise ou blanchâtre, grasse, sans graviers ni cailloux, étant plus facîle à corroyer. Ce soin était fort recommandé par Vitruve, en parlant de celles dont les anciens se servaient pour les cloisons, murs, planchers, etc. qui étaient mêlées de foin et de paille hachée, et point cuites, mais seulement séchées au soleil pendant quatre ou cinq ans, parce
(a) Prêle, espèce de plante aquatique très-rude.
(e) Chien de mer, sorte de poisson de mer dont la peau d'une certaine rudesse est très-bonne pour cet usage.
(b) Rabot, est un morceau de bois dur avec lequel on frotte le marbre.
(d) Espèce de cloison qui sépare plusieurs tuyaux de cheminée dans une souche.
que, disait-il, elles se fendent et se détrempent lorsqu'elles sont mouillées à la pluie.
La terre qui est rougeâtre est beaucoup moins estimée pour cet usage, les briques qui en sont faites étant plus sujettes à se feuilleter et à se réduire en poudre à la gelée.
Vitruve prétend qu'il y a trois sortes de terre propres à faire de la brique ; la première, qui est aussi blanche que de la craie ; la seconde, qui est rouge ; et la troisième, qu'il appelle sablon mâle. Au rapport de Perrault, les interpretes de Vitruve n'ont jamais pu décider quel était ce sablon mâle dont il parle, et que Pline prétend avoir été employé de son temps pour faire de la brique. Philander pense que c'est une terre solide et sablonneuse ; Barbaro dit que c'est un sable de rivière gras que l'on trouve en pelotons, comme l'encens mâle : et Baldus rapporte qu'il a été appelé mâle, parce qu'il était moins aride que l'autre sable. Au reste, sans prendre garde scrupuleusement à la couleur, on reconnaitra qu'une terre est propre à faire de bonnes briques, si après une petite pluie on s'aperçoit qu'en marchant dessus elle s'attache aux pieds et s'y amasse en grande quantité, sans pouvoir la détacher facilement, ou si en la paitrissant dans les mains on ne peut la diviser sans peine.
De la manière de faire la brique. Après avoir choisi un espace de terre convenable, et l'ayant reconnu également bonne par-tout, il faut l'amasser par monceaux et l'exposer à la gelée à plusieurs reprises, ensuite la corroyer avec la houe (fig. 118.) ou le rabot (fig. 117.), et la laisser reposer alternativement jusqu'à quatre ou cinq fais. L'hiver est d'autant plus propre pour cette préparation, que la gelée contribue beaucoup à la bien corroyer.
On y mêle quelquefois de la bourre et du poil de bœuf pour la mieux lier, ainsi que du sablon pour la rendre plus dure et plus capable de resister au fardeau lorsqu'elle est cuite. Cette pâte faite, on la jette par motte dans des moules faits de cadres de bois de la même dimension qu'on veut donner à la brique ; et lorsqu'elle est à demi seche, on lui donne avec le couteau la forme que l'on juge à-propos.
Le temps le plus propre à la faire sécher, selon Vitruve, est le printemps et l'automne, ne pouvant sécher en hiver, et la grande chaleur de l'été la séchant trop promptement à l'extérieur, ce qui la fait fendre, tandis que l'intérieur reste humide. Il est aussi nécessaire, selon lui, en parlant des briques crues, de les laisser sécher pendant deux ans, parce qu'étant employées nouvellement faites, elles se resserrent et se séparent à mesure qu'elles se sechent : d'ailleurs l'enduit qui les retient ne pouvant plus se soutenir, se détache et tombe ; et la muraille s'affaissant de part et d'autre inégalement, fait périr l'édifice.
Le même auteur rapporte encore que de son temps dans la ville d'Utique il n'était pas permis de se servir de brique pour bâtir qu'elle n'eut été visitée par le magistrat, et qu'on eut été sur qu'elle avait séché pendant cinq ans. On se sert encore maintenant de briques crues, mais ce n'est que pour les fours à chaux (fig. 29.), à tuîle ou à brique (fig. 27.)
La meilleure brique est celle qui est d'un rouge pâle tirant sur le jaune, d'un grain serré et compacte, et qui lorsqu'on la frappe rend un son clair et net. Il arrive quelquefois que les briques faites de même terre et préparées de même, sont plus ou moins rouges les unes que les autres, lorsqu'elles sont cuites, et par conséquent de différente qualité : ce qui vient des endroits où elles ont été placées dans le four, et où le feu a eu plus ou moins de force pour les cuire. Mais la preuve la plus certaine pour connaître la meilleure, surtout pour des édifices de quelque importance, est de l'exposer à l'humidité et à la gelée pendant l'hiver, parce que celles qui y auront résisté sans se feuilleter, et auxquelles il ne sera arrivé aucun inconvénient considérable, pourront être mises en œuvre en toute sûreté.
Autrefois on se servait à Rome de trois sortes de briques ; la première qu'on appelait didodoron, qui avait deux palmes en carré ; la seconde, tetradoron, qui en avait quatre ; et la troisième, pentadoron, qui en avait cinq : ces deux dernières manières ont été longtemps employées par les Grecs. On faisait encore à Rome des demi-briques et des quarts de briques, pour placer dans les angles des murs et les achever. La brique que l'on faisait autrefois, au rapport de Vitruve, à Calente en Espagne, à Marseille en France, et à Pitence en Asie, nageait sur l'eau comme la pierre-ponce, parce que la terre dont on la faisait était très-spongieuse, et que ses pores externes étaient tellement serrés lorsqu'elle était seche, que l'eau n'y pouvait entrer, et par conséquent la faisait surnager. La grandeur des briques dont on se sert à Paris et aux environs, est ordinairement de huit pouces de longueur, sur quatre de largeur et deux d'épaisseur, et se vend depuis 30 jusqu'à 40 livres le millier.
Il faut éviter de les faire d'une grandeur et d'une épaisseur trop considérable, à moins qu'on ne leur donne pour sécher un temps proportionné à leur grosseur ; parce que sans cela la chaleur du feu s'y communique inégalement, et le cœur étant moins atteint que la superficie, elles se gersent et se fendent en cuisant.
La tuîle pour les couvertures des bâtiments, le carreau pour le sol des appartements, les tuyaux de grais pour la conduite des eaux, les boisseaux pour les chausses d'aisance, et généralement toutes les autres poteries de cette espèce, se font avec la même terre, se préparent et se cuisent exactement de la même manière. Ainsi ce que nous avons dit de la brique, peut nous instruire pour tout ce que l'on peut faire en pareille terre.
Du plâtre en général. Le plâtre du grec propre à être formé, est d'une propriété très-importante dans le bâtiment. Sa cuisson fait sa vertu principale. C'est sans doute par le feu qu'il acquiert la qualité qu'il a, non-seulement de s'attacher lui-même, mais encore d'attacher ensemble les corps solides. Comme la plus essentielle est la promptitude de son action, et qu'il se suffit à lui-même pour faire un corps solide, lorsqu'il a reçu toutes les préparations dont il a besoin, il n'y a point de matière dont on puisse se servir avec plus d'utilité dans la construction.
De la pierre propre à faire le plâtre. La pierre propre à faire du plâtre se trouve dans le sein de la terre, comme les autres pierres. On n'en trouve des carrières qu'aux environs de Paris, comme à Montmartre, Belleville, Meudon, et quelques autres endroits. Il y en a de deux espèces : l'une dure, et l'autre tendre. La première est blanche et remplie de petits grains luisans : la seconde est grisâtre, et sert, comme nous l'avons dit ci-devant, à la construction des bicoques et murs de clôtures dans les campagnes. L'une et l'autre se calcinent au feu, se blanchissent et se réduisent en poudre après la cuisson. Mais les ouvriers préfèrent la dernière, étant moins dure à cuire.
De la manière de faire cuire le plâtre. La manière de faire cuire le plâtre consiste à donner un degré de chaleur capable de dessecher peu-à-peu l'humidité qu'il renferme, de faire évaporer les parties qui le lient, et de disposer aussi le feu de manière que la chaleur agisse toujours également sur lui. Il faut encore arranger dans le four les pierres qui doivent être calcinées, en sorte qu'elles soient toutes également embrasées par le feu, et prendre garde que le plâtre ne soit trop cuit ; car alors il devient aride et sans liaison, et perd la qualité que les ouvriers appellent l'amour du plâtre ; la même chose peut arriver encore à celui qui aurait conservé trop d'humidité, pour s'être trouvé pendant la cuisson à une des extrémités du four.
Le plâtre bien cuit se connait lorsqu'en le maniant on sent une espèce d'onctuosité ou graisse, qui s'attache aux doigts ; ce qui fait qu'en l'employant il prend promptement, se durcit de même, et fait une bonne liaison ; ce qui n'arrive point lorsqu'il a été mal cuit.
Il doit être employé le plus tôt qu'il est possible, en sortant du four, si cela se peut : car étant cuit, il devient une espèce de chaux, dont les esprits ne peuvent jamais être trop-tôt fixés : du-moins si on ne peut l'employer sur le champ, faut-il le tenir à couvert dans les lieux secs et à l'abri du soleil ; car l'humidité en diminue la force, l'air dissipe ses esprits et l'évente, et le soleil l'échauffe et le fait fermenter : ressemblant en quelque sorte, suivant M. Belidor, à une liqueur exquise qui n'a de saveur qu'autant qu'on a eu soin d'empêcher ses esprits de s'évaporer. Cependant lorsque dans un pays où il est cher, on est obligé de le conserver, il faut alors avoir soin de le serrer dans des tonneaux bien fermés de toute part, le placer dans un lieu bien sec, et le garder le moins de temps qu'il est possible.
Si l'on avait quelque ouvrage de conséquence à faire, et qu'il fallut pour cela du plâtre cuit à propos, il faudrait alors envoyer à la carrière, prendre celui qui se trouve au milieu du four, étant ordinairement plus tôt cuit que celui des extrémités. Je dis au milieu du four, parce que les ouvriers ont bien soin de ne jamais le laisser trop cuire, étant de leur intérêt de consommer moins de bois. Sans cette précaution, on est sur d'avoir toujours de mauvais plâtre : car, après la cuisson, ils le mêlent tout ensemble ; et quand il est en poudre, celui des extrémités du four et celui du milieu sont confondus. Ce dernier qui eut été excellent, s'il avait été employé à part, est altéré par le mélange que l'on en fait, et ne vaut pas à beaucoup près ce qu'il valait auparavant.
Il faut aussi éviter soigneusement de l'employer pendant l'hiver ou à la fin de l'automne, parce que le froid glaçant l'humidité de l'eau avec laquelle il a été gaché (e), et l'esprit du plâtre étant amorti, il ne peut plus faire corps ; et les ouvrages qui en sont faits tombent par éclats, et ne peuvent durer longtemps.
Le plâtre cuit se vend 10 à 11 livres le muid, contenant 36 sacs, ou 72 boisseaux, mesure de Paris, qui valent 24 pieds cubes.
Du plâtre selon ses qualités. On appelle plâtre cru la pierre propre à faire le plâtre, qui n'a pas encore été cuite au four, et qui sert quelquefois de moilons après l'avoir exposé longtemps à l'air.
Plâtre blanc, celui qui a été rablé, c'est-à-dire dont on a ôté tout le charbon provenant de la cuisson ; précaution qu'il faut prendre pour les ouvrages de sujétion.
Plâtre gris, celui qui n'a pas été rablé, étant destiné pour les gros ouvrages de maçonnerie.
Plâtre gras, celui qui, comme nous l'avons dit, étant cuit à-propos, est doux et facîle à employer.
Plâtre vert, celui qui ayant été mal cuit, se dissout en l'employant, ne fait pas corps, et est sujet à se gerser, à se fendre et à tomber par morceau à la moindre gelée.
Plâtre mouillé, celui qui ayant été exposé à l'humidité ou à la pluie, a perdu par-là la plus grande partie de ses esprits, et est de nulle valeur.
Plâtre éventé, celui qui ayant été exposé trop longtemps à l'air, après avoir été pulvérisé, a de la peine à prendre, et fait infailliblement une mauvaise construction.
Du plâtre selon ses façons. On appelle gros plâtre celui qui ayant été concassé grossièrement à la carrière, est destiné pour la construction des fondations, ou des gros murs bâtis en moilon ou libage, ou pour hourdir (f) les cloisons, bâtis de charpente, ou tout autre ouvrage de cette espèce. On appelle encore de ce nom les gravats criblés ou rebattus, pour les renformis (g), hourdis ou gobetayes. (h)
Plâtre au panier, celui qui est passé dans un manequin d'osier clair (fig. 139.), et qui sert pour les crépis (i), renformis, etc.
Plâtre au sas, celui qui est fin, passé au sas (k), et qui sert pour les enduits (l) des membres d'architecture et de sculpture.
Toutes ces manières d'employer le plâtre exigent aussi de le gacher serré, clair ou liquide.
On appelle plâtre gaché-serré celui qui est le moins abreuvé d'eau, et qui sert pour les gros ouvrages, comme enduits, scellement, etc.
Plâtre gaché clair, celui qui est un peu plus abreuvé d'eau, et qui sert à trainer au calibre des membres d'architectures, comme des chambranles, corniches, cimaises, etc.
Plâtre gaché liquide, celui qui est le plus abreuvé d'eau, et qui sert pour couler, caler, ficher et jointoyer les pierres, ainsi que pour les enduits des cloisons, plafonds, etc.
De la chaux en général. La chaux, du latin calx, est une pierre calcinée, et cuite au four, qui se détrempe avec de l'eau, comme le plâtre : mais qui ne pouvant agir seule comme lui pour lier les pierres ensemble, a besoin d'autres agens, tels que le sable, le ciment ou la pozzolane, pour la faire valoir. Si l'on pilait, dit Vitruve, des pierres avant que de les cuire, on ne pourrait en rien faire de bon : mais si on les cuit assez pour leur faire perdre leur première solidité et l'humidité qu'elles contiennent naturellement, elles deviennent poreuses et remplies d'une chaleur intérieure, qui fait qu'en les plongeant dans l'eau avant que cette chaleur soit dissipée, elles acquièrent une nouvelle force, et s'échauffent par l'humidité qui, en les refroidissant, pousse la chaleur au-dehors. C'est ce qui fait que quoique de même grosseur, elles pesent un tiers de moins après la cuisson.
De la pierre propre à faire de la chaux. Toutes les pierres sur lesquelles l'eau-forte agit et bouillonne, sont propres à faire de la chaux ; mais les plus dures et les plus pesantes sont les meilleures. Le marbre même, lorsqu'on se trouve dans un pays où il est commun, est préférable à toute autre espèce de pierre. Les coquilles d'huitres sont encore très-propres pour cet usage : mais en général celle qui est tirée fraichement d'une carrière humide et à l'ombre, est très-bonne. Palladio rapporte que dans les montagnes de Padoue, il se trouve une espèce de pierre écaillée, dont la chaux est excellente pour les ouvrages exposés à l'air, et ceux qui sont dans l'eau, parce qu'elle prend promptement et dure très-longtemps.
(e) Gâcher du plâtre, c'est le mêler avec de l'eau.
(f) Hourdir, est maçonner grossièrement avec du mortier ou du plâtre ; c'est aussi faire l'aire d'un plancher sur des lattes.
(g) Renformis, est la réparation des vieux murs.
(h) Gobeter, c'est jeter du plâtre avec la truelle, et le faire entrer avec la main dans les joints des murs.
(i) Crépis, plâtre ou mortier employé avec un balai, sans passer la main ni la truelle par-dessus.
(k) Sas, est une espèce de tamis, fig. 140.
(l) Enduit, est une couche de plâtre ou de mortier sur un mur de moilon, ou sur une cloison de charpente.
Vitruve nous assure que la chaux faite avec des cailloux qui se rencontrent sur les montagnes, dans les rivières, les torrents et ravins, est très-propre à la maçonnerie ; et que celle qui est faite avec des pierres spongieuses et dures, et que l'on trouve dans les campagnes, est meilleure pour les enduits et crépis. Le même auteur ajoute que plus une pierre est poreuse, plus la chaux qui en est faite est tendre ; plus elle est humide, plus la chaux est tenace ; plus elle est terreuse, plus la chaux est dure ; et plus elle a de feu, plus la chaux est fragile.
Philibert Delorme conseille de faire la chaux avec les mêmes pierres avec lesquelles on bâtit, parce que, dit-il, les sels volatils dont la chaux est dépourvue après sa cuisson, lui sont plus facilement rendus par des pierres qui en contiennent de semblables.
De la manière à faire cuire la chaux. On se sert pour cuire la chaux de bois ou de charbon de terre, mais ce dernier est préférable, et vaut beaucoup mieux ; parce que non-seulement il rend la chaux beaucoup plus grasse et plus onctueuse, mais elle est bien plutôt cuite. La meilleure chaux, selon cet auteur, est blanche, grasse, sonore, point éventée ; en la mouillant, rend une fumée abondante ; et lorsqu'on la détrempe, elle se lie fortement au rabot, fig. 117. On peut encore juger de sa bonté après la cuisson, si en mêlant un peu de pulvérisée avec de l'eau que l'on bat un certain temps, on s'aperçoit qu'elle s'unit comme de la colle.
Il est bon de savoir que plus la chaux est vive, plus elle faisonne en l'éteignant, plus elle est grasse et onctueuse, et plus elle porte de sable.
Si la qualité de la pierre peut contribuer beaucoup à la bonté de la chaux, aussi la manière de l'éteindre avant que de l'unir avec le sable ou le ciment, peut réparer les vices de la pierre, qui ne se rencontre pas également bonne par-tout où l'on veut bâtir.
De la manière d'éteindre la chaux. L'usage ordinaire d'éteindre la chaux en France, est d'avoir deux bassins A et B, fig. 30 et 31. L'un A tout à fait hors de terre, et à environ deux pieds et demi d'élévation, est destiné à éteindre la chaux : l'autre B creusé dans la terre à environ six pieds plus ou moins de profondeur, est destiné à la recevoir lorsqu'elle est éteinte. Le premier sert à retenir les corps étrangers, qui auraient pu se rencontrer dans la chaux vive, et à ne laisser passer dans le second que ce qui doit y être reçu. Pour cet effet, on a soin de pratiquer non-seulement dans le passage C qui communique de l'un à l'autre, une grille pour retenir toutes les parties grossières, mais encore de tenir le fond de ce bassin plus élevé du côté du passage C ; afin que ces corps étrangers demeurent dans l'endroit le plus bas, et ne puissent couler dans le second bassin. Ces précautions une fois prises, on nettoyera bien le premier qu'on fermera hermétiquement dans sa circonférence, et que l'on emplira d'eau et de chaux en même temps. Il faut prendre garde de mettre trop ou trop peu d'eau ; car le trop la noye et en diminue la force, et le trop peu la brule, dissout ses parties et la réduit en cendre : ceci fait, on la tourmentera à force de bras avec le rabot (fig. 117.) pendant quelque temps, et à diverses reprises ; après quoi on la laissera couler d'elle-même dans le second bassin, en ouvrant la communication C de l'un à l'autre, et la tourmentant toujours jusqu'à ce que le bassin A soit vuidé. Ensuite on refermera le passage C, et on recommencera l'opération jusqu'à ce que le second bassin soit plein.
La chaux ainsi éteinte, on la laissera refroidir quelques jours, après lesquels on pourra l'employer. Quelques-uns prétendent que c'est-là le moment de l'employer, parce que ses sels n'ayant pas eu le temps de s'évaporer, elle en est par conséquent meilleure.
Mais si on voulait la conserver, il faudrait avoir soin de la couvrir de bon sable, d'environ un pied ou deux d'épaisseur. Alors elle pourrait se garder deux ou trois ans sans perdre sa qualité.
Il arrive quelquefois que l'on trouve dans la chaux éteinte des parties dures et pierreuses, qu'on appelle biscuits ou recuits, qui ne sont d'aucun usage, et qui pour cela sont mis à part pour en tenir compte au marchand. Ces biscuits ne sont autre chose que des pierres qui ont été mal cuites, le feu n'ayant pas été entretenu également dans le fourneau ; c'est pour cela que Vitruve et Palladio prétendent que la chaux qui a demeuré deux ou trois ans dans le bassin, est beaucoup meilleure ; et leur raison est que s'il se rencontre des morceaux qui aient été moins cuits que les autres, ils ont eu le temps de s'éteindre et de se détremper comme les autres. Mais Palladio en excepte celle de Padoue, qu'il faut, dit-il, employer aussi-tôt après sa fusion : car si on la garde, elle se brule et se consomme de manière qu'elle devient entièrement inutile.
La manière que les anciens pratiquaient pour éteindre la chaux, était de faire usage seulement d'un bassin creusé dans la terre, comme serait celui B de la figure 30, qu'ils remplissaient de chaux, et qu'ils couvraient ensuite de sable, jusqu'à deux pieds d'épaisseur : ils l'aspergeaient ensuite d'eau, et l'entretenaient toujours abreuvée, de manière que la chaux qui était dessous pouvait se dissoudre sans se bruler ; ce qui aurait très-bien pu arriver, sans cette précaution. La chaux ainsi éteinte, ils la laissaient, comme nous l'avons dit, deux ou trois ans dans la terre, avant que de l'employer ; et au bout de ce temps cette matière devenait très-blanche, et se convertissait en une masse à-peu-près comme de la glaise, mais si grasse et si glutineuse, qu'on n'en pouvait tirer le rabot qu'avec beaucoup de peine, et faisait un mortier d'un excellent usage pour les enduits ou pour les ouvrages en stucs. Si pendant l'espace de ce temps on s'apercevait que le sable se fendait dans sa superficie, et ouvrait un passage à la fumée, on avait soin aussi-tôt de refermer les fentes avec d'autre sable.
Les endroits qui fournissent le plus communément de la chaux à Paris et aux environs, sont Boulogne, Senlis, Corbeil, Melun, la Chaussée près Marly, et quelques autres. Celle de Boulogne qui est faite d'une pierre un peu jaunâtre, est excellente et la meilleure. On emploie à Mets et aux environs une chaux excellente qui ne se fuse point. Des gens qui n'en connaissaient pas la qualité s'avisèrent d'en fuser dans des trous bien couverts de sable. L'année suivante, ils la trouvèrent si dure, qu'il fallut la casser avec des coins de fer, et l'employer comme du moilon. Pour bien éteindre cette chaux, dit M. Belidor, il la faut couvrir de tout le sable qui doit entrer dans le mortier, l'asperger ensuite d'eau à différente reprise. Cette chaux s'éteint ainsi sans qu'il sorte de fumée au dehors, et fait de si bon mortier, que dans ces pays-là toutes les caves en sont faites sans aucun autre mélange que de gros gravier de rivière, et se change en un mastic si dur, que lorsqu'il a fait corps, les meilleurs outils ne peuvent l'entamer.
Comme il n'est point douteux que ce ne peut être que l'abondance des sels que contiennent de certaines pierres, qui les rendent plus propres que d'autres à faire de bonne chaux ; il est donc possible par ce moyen d'en faire d'excellente dans les pays où elle a coutume d'être mauvaise, comme on le Ve voir.
Il faut d'abord commencer, comme nous l'avons dit ci-dessus, par avoir deux bassins A et B, fig. 31 ; l'un A plus élevé que l'autre, mais tous deux bien pavés, et revêtus de maçonnerie bien enduite dans leur circonférence. On remplira ensuite le bassin supérieur A de chaux que l'on éteindra, et que l'on fera couler dans l'autre B comme à l'ordinaire. Lorsque tout y sera passé, on jettera dessus autant d'eau qu'on en a employé pour l'éteindre, qu'on broyera bien avec le rabot, et qu'on laissera ensuite reposer pendant vingt-quatre heures, ce qui lui donnera le temps de se rasseoir, après lequel on la trouvera couverte d'une quantité d'eau verdâtre qui contiendra presque tous ses sels, et qu'on aura soin de mettre dans des tonneaux ; puis on ôtera la chaux qui se trouvera au fond du bassin B, et qui ne sera plus bonne à rien : ensuite on éteindra de la nouvelle chaux dans le bassin supérieur A, et au lieu de se servir d'eau ordinaire, on prendra celle que l'on avait versée dans les tonneaux, et on fera couler à l'ordinaire la chaux dans l'autre bassin B. Cette préparation la rend sans doute beaucoup meilleure, puisqu'elle contient alors deux fois plus de sel qu'auparavant. S'il s'agissait d'un ouvrage de quelqu'importance fait dans l'eau, on pourrait la rendre encore meilleure, en recommençant l'opération une seconde fais, et une troisième s'il était nécessaire. Mais la chaux qui resterait dans le bassin B cette seconde et cette troisième fais, ne serait pas si dépourvue de sels, qu'elle ne put encore servir dans les fondations, dans le massif des gros murs, ou à quelqu'autre ouvrage de peu d'importance. A la vérité il en coutera pour cela beaucoup plus de temps et de peine ; mais il ne doit point être question d'économie lorsqu'il s'agit de certains ouvrages qui ont besoin d'être faits avec beaucoup de précaution. Ainsi, comme dit M. Bélidor, faut-il que parce que l'on est dans un pays où les matériaux sont mauvais, on ne puisse jamais faire de bonne maçonnerie, puisque l'art peut corriger la nature par une infinité de moyens ?
Il faut encore remarquer que toutes les eaux ne sont pas propres à éteindre la chaux ; celles de rivière et de source sont les plus convenables : celle de puits peut cependant être d'un bon usage, mais il ne faut pas s'en servir sans l'avoir laissée séjourner pendant quelque temps à l'air, pour lui ôter sa première fraicheur qui ne manquerait pas sans cela de resserrer les pores de la chaux, et de lui ôter son activité. Il faut surtout éviter de se servir d'eau bourbeuse et croupie, étant composée d'une infinité de corps étrangers capables de diminuer beaucoup les qualités de la chaux. Quelques-uns prétendent que l'eau de la mer n'est pas propre à éteindre la chaux, ou l'est très-peu, parce qu'étant salée, le mortier fait de cette chaux serait difficîle à sécher. D'autres au contraire prétendent qu'elle contribue à faire de bonne chaux, pourvu que cette dernière soit forte et grasse, parce que les sels dont elle est composée, quoique de différente nature, concourent à la coagulation du mortier ; au lieu qu'étant faible, ses sels détruisent ceux de la chaux comme leur étant inférieurs.
De la chaux selon ses façons. On appelle chaux vive celle qui bout dans le bassin lorsqu'on la détrempe.
Chaux éteinte ou fusée, celle qui est détrempée, et que l'on conserve dans le bassin. On appelle encore chaux fusée, celle qui n'ayant point été éteinte, est restée trop longtemps exposée à l'air, et dont les sels et les esprits se sont évaporés, et qui par conséquent n'est plus d'aucun usage.
Lait de chaux, ou laitance, celle qui a été détrempée claire, qui ressemble à du lait, et qui sert à blanchir les murs et plafonds.
La chaux se vend à Paris, au muid contenant douze septiers, le septier deux mines, et la mine deux minots, dont chacun contient un pied cube. On la mesure encore par futailles, dont chacune contient quatre pieds cubes : il en faut douze pour un muid dont six sont mesurés combles, et les autres rases.
Du sable. Le sable, du latin sabulum, est une matière qui diffère des pierres et des cailloux ; c'est une espèce de gravier de différente grosseur, âpre, raboteux et sonore. Il est encore diaphane ou opaque, selon ses différentes qualités, les sels dont il est formé, et les différents terrains où il se trouve : il y en a de quatre espèces ; celui de terrain ou de cave, celui de rivière, celui de ravin, et celui de mer. Le sable de cave est ainsi appelé, parce qu'il se tire de la fouille des terres, lorsque l'on construit des fondations de bâtiment. Sa couleur est d'un brun noir. Jean Martin, dans sa traduction de Vitruve, l'appelle sable de fossé. Philibert de Lorme l'appelle sable de terrain. Perrault n'a point voulu lui donner ce nom, de peur qu'on ne l'eut confondu avec terreux, qui est le plus mauvais dont on puisse jamais se servir. Les ouvriers l'appellent sable de cave, qui est l'arena di cava des Italiens. Ce sable est très-bon lorsqu'il a été séché quelque temps à l'air. Vitruve prétend qu'il est meilleur pour les enduits et crépis des murailles et des plafonds, lorsqu'on l'emploie nouvellement tiré de la terre ; car si on le garde, le soleil et la lune l'altèrent, la pluie le dissout, et le convertit en terre. Il ajoute encore qu'il vaut beaucoup mieux pour la maçonnerie que pour les enduits, parce qu'il est si gras et se seche si promptement, que le mortier se gerse ; c'est pourquoi, dit Palladio, on l'emploie préférablement dans les murs et les voutes continues.
Ce sable se divise en deux espèces ; l'une que l'on nomme sable mâle, et l'autre sable femelle. Le premier est d'une couleur foncée et égale dans son même lit ; l'autre est plus pâle et inégale.
Le sable de rivière est jaune, rouge, ou blanc, et se tire du fond des rivières ou des fleuves, avec des dragues, fig. 119. faites pour cet usage ; ce qu'on appelle draguer. Celui qui est près du rivage est plus aisé à tirer ; mais n'est pas le meilleur, étant sujet à être mêlé et couvert de vase ; espèce de limon qui s'attache dessus dans le temps des grandes eaux et des débordements. Alberti et Scamozzi prétendent qu'il est très-bon lorsqu'on a ôté cette superficie qui n'est qu'une croute de mauvaise terre. Ce sable est le plus estimé pour faire de bon mortier, ayant été battu par l'eau, et se trouvant par-là dégorgé de toutes les parties terrestres dont il tire son origine : il est facîle de comprendre que plus il est graveleux, pourvu qu'il ne le soit pas trop, plus il est propre par ses cavités et la vertu de la chaux à s'agraffer dans la pierre, ou au moilon à qui le mortier sert de liaison. Mais si au contraire, on ne choisit pas un sable dépouillé de toutes ses parties terreuses, qu'il soit plus doux et plus humide, il est capable par-là de diminuer et d'émousser les esprits de la chaux, et empêcher le mortier fait de ce sable de s'incorporer aux pierres qu'il doit unir ensemble, et rendre indissolubles.
Le sable de rivière est un gravier, qui selon Scamozzi et Alberti, n'a que le dessus de bon, le dessous étant des petits cailloux trop gros pour pouvoir s'incorporer avec la chaux et faire une bonne liaison. Cependant on ne laisse pas que de s'en servir dans la construction des fondements, gros murs, etc. après avoir été passé à la claye. (m)
Le sable de mer est une espèce de sablon fin, que l'on prend sur les bords de la mer et aux environs,
(m) Une claie est une espèce de grille d'osier qui sert à tamiser le sable.
qui n'est pas si bon que les autres. Ce sable joint à la chaux, dit Vitruve, est très-long à sécher. Les murs qui en sont faits ne peuvent pas soutenir un grand poids, à moins qu'on ne les bâtisse à différente reprise. Il ne peut encore servir pour les enduits et crépis, parce qu'il suinte toujours par le sel qui se dissout, et qui fait tout fondre. Alberti prétend qu'au pays de Salerne, le sable du rivage de la mer est aussi bon que celui de cave, pourvu qu'il ne soit point pris du côté du midi. On trouve encore, dit M. Bélidor, une espèce de sablon excellent dans les marais, qui se connait lorsqu'en marchant dessus, on s'aperçoit qu'il en sort de l'eau ; ce qui lui a fait donner le nom de sable bouillant.
En général, le meilleur sable est celui qui est net, et point terreux ; ce qui se connait de plusieurs manières. La première, lorsqu'en le frottant dans les mains, on sent une rudesse qui fait du bruit, et qu'il n'en reste aucune partie terreuse dans les doigts. La seconde lorsqu'après en avoir jeté un peu dans un vase plein d'eau claire et l'avoir brouillé ; si l'eau en est peu troublée, c'est une marque de sa bonté. On le connait encore, lorsqu'après en avoir étendu sur de l'étoffe blanche, ou sur du linge, on s'aperçoit qu'après l'avoir secoué, il ne reste aucune partie terreuse attachée dessus.
Du ciment. Le ciment n'est autre chose, dit Vitruve, que de la brique ou de la tuîle concassée ; mais cette dernière est plus dure et préférable. A son défaut, on se sert de la première, qui étant moins cuite, plus tendre et plus terreuse, est beaucoup moins capable de résister au fardeau.
Le ciment ayant retenu après sa cuisson la causticité des sels de la glaise, dont il tire son origine, est bien plus propre à faire de bon mortier, que le sable. Sa dureté le rend aussi capable de résister aux plus grands fardeaux, ayant reçu différentes formes par sa pulvérisation. La multiplicité de ses angles fait qu'il peut mieux s'encastrer dans les inégalités des pierres qu'il doit lier, étant joint avec la chaux dont il soutient l'action par ses sels ; et qui l'ayant environné, lui communique les siens ; de façon que les uns et les autres s'animant par leur onctuosité mutuelle, s'insinuent dans les pores de la pierre, et s'y incorporent si intimement qu'ils coopèrent de concert à recueillir, et à exciter les sels des différents minéraux auxquels ils sont joints : de manière qu'un mortier fait de l'un et de l'autre est capable, même dans l'eau, de rendre la construction immuable.
De la pozzolane, et des différentes poudres qui servent aux mêmes usages. La pozzolane, qui tire son nom de la ville de Pouzzoles, en Italie, si fameuse par ses grottes et ses eaux minérales, se trouve dans le territoire de cette ville, au pays de Bayes, et aux environs du Mont-Vésuve ; c'est une espèce de poudre rougeâtre, admirable par sa vertu. Lorsqu'on la mêle avec la chaux, elle joint si fortement les pierres ensemble, fait corps, et s'endurcit tellement au fond même de la mer, qu'il est impossible de les désunir. Ceux qui en ont cherché la raison, dit Vitruve, ont remarqué que dans ces montagnes et dans tous ces environs, il s'y trouve une quantité de fontaines bouillantes, qu'on a cru ne pouvoir venir que d'un feu souterrain, de soufre, de bitume et d'alun, et que la vapeur de ce feu traversant les veines de la terre, la rend non-seulement plus légère, mais encore lui donne une aridité capable d'attirer l'humidité. C'est pourquoi lorsque l'on joint par le moyen de l'eau ces trois choses qui sont engendrées par le feu, elles s'endurcissent si promptement et font un corps si ferme, que rien ne peut le rompre ni dissoudre.
La comparaison qu'en donne M. Bélidor, est que la tuîle étant une composition de terre, qui n'a de vertu pour agir avec la chaux, qu'après sa cuisson et après avoir été concassée et réduite en poudre : de même aussi la terre bitumineuse qui se trouve aux environs de Naples, étant brulée par les feux souterrains, les petites parties qui en résultent et que l'on peut considérer comme une cendre, composent la poudre de pozzolane, qui doit par conséquent participer des propriétés du ciment. D'ailleurs la nature du terrain et les effets du feu peuvent y avoir aussi beaucoup de part.
Vitruve remarque que dans la Toscane et sur le territoire du Mont-Appenin, il n'y a presque point de sable de cave ; qu'en Achaïe vers la mer Adriatique, il ne s'en trouve point du tout ; et qu'en Asie au-delà de la mer, on n'en a jamais entendu parler. Desorte que dans les lieux où il y a de ces fontaines bouillantes, il est très-rare qu'il ne s'y fasse de cette poudre, d'une manière ou d'une autre ; car dans les endroits où il n'y a que des montagnes et des rochers, le feu ne laisse pas que de les pénétrer, d'en consumer le plus tendre, et de n'y laisser que l'âpreté. C'est pour cette raison, que la terre brulée aux environs de Naples, se change en cette poudre. Celle de Toscane se change en une autre à-peu-près semblable, que Vitruve appelle carbunculus, et l'une et l'autre sont excellentes pour la maçonnerie ; mais la première est préférée pour les ouvrages qui se font dans l'eau, et l'autre plus tendre que le tuf, et plus dure que le sable ordinaire, est réservée pour les édifices hors de l'eau.
On voit aux environs de Cologne, et près du bas-Rhin, en Allemagne, une espèce de poudre grise, que l'on nomme terrasse de Hollande, faite d'une terre qui se cuit comme le plâtre, que l'on écrase et que l'on réduit en poudre avec des meules de moulin. Il est assez rare qu'elle soit pure et point falsifiée ; mais quand on en peut avoir, elle est excellente pour les ouvrages qui sont dans l'eau ; résiste également à l'humidité, à la sécheresse, et à toutes les rigueurs des différentes saisons : elle unit si fortement les pierres ensemble, qu'on l'emploie en France et aux Pays-Bas, pour la construction des édifices aquatiques, au défaut de pozzolane, par la difficulté que l'on a d'en avoir à juste prix.
On se sert encore dans le même pays au lieu de terrasse de Hollande, d'une poudre nommée cendrée de Tournay, que l'on trouve aux environs de cette ville. Cette poudre n'est autre chose qu'un composé de petites parcelles d'une pierre bleue, et très-dure, qui tombe lorsqu'on la fait cuire, et qui fait d'excellente chaux. Ces petites parcelles en tombant sous la grille du fourneau, se mélent avec la cendre du charbon de terre, et ce mélange compose la cendrée de Tournay, que les marchands débitent telle qu'elle sort du fourneau.
On fait assez souvent usage d'une poudre artificielle, que l'on nomme ciment de fontainier ou ciment perpétuel, composé de pots et de vases de grais cassés et pilés, de morceaux de machefer, provenant du charbon de terre brulé dans les forges, aussi réduit en poudre, mêlé d'une pareille quantité de ciment, de pierre de meule de moulin et de chaux, dont on compose un mortier excellent, qui résiste parfaitement dans l'eau.
On amasse encore quelquefois des cailloux ou galets, que l'on trouve dans les campagnes ou sur le bord des rivières, que l'on fait rougir, et que l'on réduit ensuite en poudre ; ce qui fait une espèce de terrasse de Hollande, très-bonne pour la construction.
Du mortier. Le mortier, du latin mortarium, qui, selon Vitruve, signifie plutôt le bassin où on le fait, que le mortier même, est l'union de la chaux avec le sable, le ciment ou autres poudres ; c'est de cet alliage que dépend toute la bonté de la construction. Il ne suffit pas de faire de bonne chaux, de la bien éteindre, et de la mêler avec de bon sable, il faut encore proportionner la quantité de l'un et de l'autre à leurs qualités, les bien broyer ensemble, lorsqu'on est sur le point de les employer ; et s'il se peut n'y point mettre de nouvelle eau, parce qu'elle surcharge et amortit les esprits de la chaux. Perrault, dans ses commentaires sur Vitruve, croit que plus la chaux a été corroyée avec le rabot, plus elle devient dure.
La principale qualité du mortier étant de lier les pierres les unes avec les autres, et de se durcir quelque temps après pour ne plus faire qu'un corps solide ; cette propriété venant plutôt de la chaux que des autres matériaux, il sera bon de savoir pourquoi la pierre, qui dans le four a perdu sa dureté, la reprend étant mêlée avec l'eau et le sable.
Le sentiment des Chimistes étant que la dureté des corps vient des sels qui y sont répandus, et qui servent à lier leurs parties ; de sorte que selon eux, la destruction des corps les plus durs qui se fait à la longueur des temps, vient de la perte continuelle de leurs sels qui s'évaporent par la transpiration ; et que s'il arrive que l'on rende à un corps les sels qu'il a perdus, il reprend son ancienne dureté par la jonction de ses parties.
Lorsque le feu échauffe et brule la pierre, il emporte avec lui la plus grande partie de ses sels volatils et sulfurés qui liaient toutes ses parties ; ce qui la rend plus poreuse et plus légère. Cette chaux cuite et bien éteinte, étant mêlée avec le sable, il se fait dans ce mélange une fermentation causée par les parties salines et sulfurées qui restent encore dans la chaux, et qui faisant sortir du sable une grande quantité des sels volatils, se mêlent avec la chaux, et en remplissent les pores ; et c'est la plus ou moins grande quantité de sels qui se rencontrent dans de certains sables, qui fait la différence de leurs qualités. De-là vient que plus la chaux et le sable sont broyés ensemble, plus le mortier s'endurcit quand il est employé, parce que les frottements réitérés font sortir du sable une plus grande quantité de sels. C'est pour cela que le mortier employé aussitôt, n'est pas si bon qu'au bout de quelques jours, parce qu'il faut donner le temps aux sels volatils du sable de passer dans la chaux, afin de faire une union indissoluble ; l'expérience fait encore voir que le mortier qui a demeuré longtemps sans être employé, et par conséquent dont les sels se sont évaporés, se desseche, ne fait plus bonne liaison, et n'est plus qu'une matière seche et sans onctuosité ; ce qui n'arrive pas étant employé à propos, faisant sortir de la pierre d'autres sels, qui passent dans les pores de la chaux, lorsqu'elle-même s'insinue dans ceux de la pierre ; car quoiqu'il semble qu'il n'y ait plus de fermentation dans le mortier lorsqu'on l'emploie, elle ne laisse pas cependant que de subsister encore fort longtemps après son emploi, par l'expérience que l'on a d'en voir qui acquièrent de plus en plus la dureté par les sels volatils qui passent de la pierre dans le mortier, et par la transpiration que sa chaleur y entretient ; ce que l'on remarque tous les jours dans la démolition des anciens édifices, où l'on a quelquefois moins de peine à rompre les pierres qu'à les désunir, surtout lorsque ce sont des pierres spongieuses, dans lesquelles le mortier s'est mieux insinué.
Plusieurs pensent que la chaux a la vertu de bruler certains corps, puisqu'elle les détruit. Il faut se garder de croire que ce soit par sa chaleur : cela vient plutôt de l'évaporation des sels qui liaient leurs parties ensemble, occasionnée par la chaux, et qui sont passés en elle, et qui n'étant plus entretenus se détruisent, et causent aussi une destruction dans ces corps.
La dose du sable avec la chaux est ordinairement de moitié ; mais lorsque le mortier est bon, on y peut mettre trois cinquiemes de sable sur deux de chaux, et quelquefois deux tiers de sable sur un de chaux, selon qu'elle faisonne plus ou moins ; car lorsqu'elle est bien grasse et faite de bons cailloux, on y peut mettre jusqu'à trois quarts de sable sur un de chaux ; mais cela est extraordinaire, car il est fort rare de trouver de la chaux qui puisse porter tant de sable. Vitruve prétend que le meilleur mortier est celui où il y a trois parties de sable de cave, ou deux de sable de rivière ou de mer, contre une de chaux, qui, ajoute-t-il, sera encore meilleur, si à ce dernier on ajoute une partie de tuileau pilé, qui n'est autre chose que du ciment.
Le mortier fait de chaux et de ciment se fait de la même manière que le dernier ; les doses sont les mêmes plus ou moins, selon que la chaux faisonne. On fait quelquefois aussi un mortier composé de ciment et de sable, à l'usage des bâtiments de quelque importance.
Le mortier fait avec de la pozzolane se fait aussi à-peu-près comme celui de sable. Il est, comme nous l'avons dit ci-devant, excellent pour les édifices aquatiques.
Le mortier fait de chaux et de terrasse de Hollande se fait en choisissant d'abord de la meilleure chaux non éteinte, et autant que l'on peut en employer pendant une semaine ; on en étend un pied d'épaisseur dans une espèce de bassin, que l'on arrose pour l'éteindre ; ensuite on le couvre d'un autre lit de terrasse de Hollande, aussi d'environ un pied d'épaisseur ; cette préparation faite, on la laisse reposer pendant deux ou trois jours, afin de donner à la chaux le temps de s'éteindre, après quoi on la brouille et on la mêle bien ensemble avec des houes (fig. 118.), et des rabots (fig. 117.), et on en fait un tas qu'on laisse reposer pendant deux jours, après quoi on en remue de nouveau ce que l'on veut en employer dans l'espace d'un jour ou deux, la mouillant de temps en temps jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le mortier ne perd point de sa qualité.
En plusieurs provinces le mortier ordinaire se prépare ainsi, cette manière ne pouvant que contribuer beaucoup à sa bonté.
Comme l'expérience fait voir que la pierre dure fait toujours de bonne chaux, et qu'un mortier de cette chaux mêlé avec de la poudre provenant du charbon ou mâche-fer que l'on tire des forges, est une excellente liaison pour les ouvrages qui sont dans l'eau ; il n'est pas étonnant que la cendrée de Tournay soit aussi excellente pour cet usage ; participant en même temps de la qualité de ces deux matières ; car il n'est pas douteux que les parties de charbon qui se trouvent mêlées avec la cendrée, ne contribuent beaucoup à l'endurcir dans l'eau.
Pour faire de bon mortier avec la cendrée de Tournay, il faut d'abord bien nettoyer le fond d'un bassin B fig. 31, qu'on appelle batterie, qui doit être pavé de pierres plates et unies, et construit de la même manière dans sa circonférence, dans lequel on jettera cette cendrée. On éteindra ensuite dans un autre bassin A, à côté de la chaux, avec une quantité d'eau suffisante pour la dissoudre, après quoi on la laissera couler dans le bassin B, où est la cendrée, à travers une claie C, faite de fil d'archal ; tout ce qui ne pourra passer au travers de cette claie sera rebuté. Enfin on battra le tout ensemble dans cette batterie pendant dix à douze jours consécutifs, et à différente reprise, avec une damoiselle, fig. 147, espèce de cylindre de bois ferré par-dessous, du poids d'environ trente livres, jusqu'à ce qu'elle fasse une pâte bien grasse et bien fine. Ainsi faite, on peut l'employer sur le champ, ou la conserver pendant plusieurs mois de suite sans qu'elle perde de sa qualité, pourvu que l'on ait soin de la couvrir et de la mettre à l'abri de la poussière, du soleil et de la pluie.
Il faut encore prendre garde quand on la rebat pour s'en servir de ne mettre que très-peu d'eau, et même point du tout s'il se peut, car à force de bras, elle devient assez grasse et assez liquide ; c'est pourquoi ce sera plutôt la paresse des ouvriers, et non la nécessité, qui les obligera d'en remettre pour la rebattre ; ce qui pourrait très-bien, si l'on n'y prenait garde, la dégraisser, et diminuer beaucoup de sa bonté.
Ce mortier doit être employé depuis le mois d'Avril jusqu'au mois de Juillet, parce qu'alors il n'éclate jamais, ce qui est une de ses propriétés remarquables, la plupart des ciments étant sujets à se gerser.
Il arrive quelquefois qu'on la mêle avec un sixième de tuileau pilé ; M. Belidor souhaiterait qu'on la mêlât plutôt avec de la terrasse de Hollande ; ce qui serait, dit-il, un ciment le plus excellent qu'il fût possible d'imaginer, pour la construction des ouvrages aquatiques.
Dans les provinces où la bonne chaux est rare, on en emploie quelquefois de deux espèces en même temps ; l'une faite de bonne pierre dure, qui est sans contredit la meilleure, et qu'on appelle bon mortier, sert aux ouvrages de conséquence ; et l'autre faite de pierre commune, qui n'a pas une bonne qualité, et qu'on appelle pour cela mortier blanc, s'emploie dans les fondations et dans les gros ouvrages. On se sert encore d'un mortier qu'on appelle bâtard, et qui est fait de bonne et mauvaise chaux, qu'on emploie aussi dans les gros murs, et qu'on se garde bien d'employer dans les édifices aquatiques.
Quelques-uns prétendent que l'urine dans laquelle on a détrempé de la suie de cheminée, mêlée avec l'eau dont on se sert pour corroyer le mortier, le fait prendre promptement ; mais ce qu'il y a de vrai, c'est que le sel armoniac dissout dans l'eau de rivière, qui sert à corroyer le mortier, le fait prendre aussi promptement que le plâtre ; ce qui peut être d'un bon usage dans les pays où il est très-rare ; mais si au lieu de sable on pulvérisait de la même pierre avec laquelle on a fait la chaux, et qu'on s'en servit au lieu de plâtre, ce mortier serait sans-doute beaucoup meilleur.
Le mortier, dit Vitruve, ne saurait se lier avec lui-même, ni faire une bonne liaison avec les pierres, s'il ne reste longtemps humide ; car lorsqu'il est trop tôt sec, l'air qui s'y introduit dissipe les esprits volatils du sable et de la pierre à mesure que la chaux les attire à elle, et les empêche d'y pénétrer pour lui donner la dureté nécessaire ; ce qui n'arrive point lorsque le mortier est longtemps humide ; ces sels ayant alors le temps de pénétrer dans la chaux. C'est pourquoi dans les ouvrages qui sont dans la terre, on met moins de chaux dans le mortier, parce que la terre étant naturellement humide, il n'a pas tant besoin de chaux pour conserver son humidité ; ainsi une plus grande quantité de chaux ne fait pas plus d'effet pendant peu de temps, qu'une moindre pendant un long temps. C'est par cette raison-là que les anciens faisaient leurs murs d'une très-grande épaisseur, persuadés qu'ils étaient qu'il leur fallait à la vérité beaucoup de temps pour sécher, mais aussi qu'ils en devenaient beaucoup plus solides.
Des excavations des terres, et de leurs transports. On entend par excavation, non-seulement la fouille des terres pour la construction des murs de fondation, mais encore celles qu'il est nécessaire de faire pour dresser et applanir des terrains de cours, avant-cours, basse-cours, terrasses, etc. ainsi que les jardins de ville ou de campagne ; car il n'est guère possible qu'un terrain que l'on choisit pour bâtir, n'ait des inégalités qu'il ne faille redresser pour en rendre l'usage plus agréable et plus commode.
Il y a deux manières de dresser le terrain, l'une qu'on appelle de niveau, et l'autre selon sa pente naturelle ; dans la première on fait usage d'un instrument appelé niveau d'eau, qui facilite le moyen de dresser sa surface dans toute son étendue avec beaucoup de précision ; dans la seconde on n'a besoin que de raser les butes, et remplir les cavités avec les terres qui en proviennent. Il se trouve une infinité d'auteurs qui ont traité de cette partie de la Géométrie pratique assez amplement, pour qu'il ne soit pas besoin d'entrer dans un trop long détail.
L'excavation des terres, et leur transport, étant des objets très-considérables dans la construction, on peut dire avec vérité que rien ne demande plus d'attention ; si on n'a pas une grande expérience à ce sujet, bien loin de veiller à l'économie, on multiplie la dépense sans s'en apercevoir ; ici parce qu'on est obligé de rapporter des terres par de longs circuits, pour n'en avoir pas assez amassé avant que d'élever des murs de maçonnerie ou de terrasse ; là, parce qu'il s'en trouve une trop grande quantité, qu'on est obligé de transporter ailleurs, quelquefois même auprès de l'endroit d'où on les avait tirés : de manière que ces terres au-lieu de n'avoir été remuées qu'une fais, le sont deux, trois, et quelquefois plus, ce qui augmente beaucoup la dépense ; et il arrive souvent que si on n'a pas bien pris ses précautions, lorsque les fouilles et les fondations sont faites, on a dépensé la somme que l'on s'était proposée pour l'ouvrage entier.
La qualité du terrain que l'on fouille, l'éloignement du transport des terres, la vigilance des inspecteurs et des ouvriers qui y sont employés, la connaissance du prix de leurs journées, la provision suffisante d'outils qu'ils ont besoin, leur entretien, les relais, le soin d'appliquer la force, ou la diligence des hommes aux ouvrages plus ou moins pénibles, et la saison où l'on fait ces sortes d'ouvrages, sont autant de considérations qui exigent une intelligence consommée, pour remédier à toutes les difficultés qui peuvent se rencontrer dans l'exécution. C'est-là ordinairement ce qui fait la science et le bon ordre de cette partie, ce qui détermine la dépense d'un bâtiment, et le temps qu'il faut pour l'élever. Par la négligence de ces différentes observations et le désir d'aller plus vite, il résulte souvent plusieurs inconvéniens. On commence d'abord par fouiller une partie du terrain, sur laquelle on construit ; alors l'attelier se trouve surchargé d'équipages, et d'ouvriers de différente espèce, qui exigent chacun un ordre particulier. D'ailleurs ces ouvriers, quelquefois en grand nombre, appartenant à plusieurs entrepreneurs, dont les intérêts sont différents, se nuisent les uns aux autres, et par conséquent aussi à l'accélération des ouvrages. Un autre inconvénient est, que les fouilles et les fondations étant faites en des temps et des saisons différentes, il arrive que toutes les parties d'un bâtiment où l'on a préféré la diligence à la solidité ayant été bâtis à diverses reprises, s'affaissent inégalement, et engendrent des surplombs, lézardes (n), etc.
Le moyen d'user d'économie à l'égard du transport des terres, est non-seulement de les transporter le moins loin qu'il est possible, mais encore d'user des charrais les plus convenables ; ce qui doit en décider, est la rareté des hommes, des bêtes de somme ou de voitures, le prix des fourrages, la situation des lieux, et d'autres circonstances encore
(n) Espèces de crevasses.
que l'on ne saurait prévoir ; car lorsqu'il y a trop loin, les hottes, fig. 134. brouettes, fig. 135. bauveaux, fig. 136. ne peuvent servir. Lorsque l'on bâtit sur une demi-côte, les tombereaux ne peuvent être mis en usage, à moins que, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de quelque importance, on ne pratique des chemins en zigzague pour adoucir les pentes.
Cependant la meilleure manière, lorsqu'il y a loin, est de se servir de tombereaux qui contiennent environ dix à douze pieds cubes de terre chacun, ce qui coute beaucoup moins, et est beaucoup plus prompt que si l'on employait dix ou douze hommes avec des hottes ou brouettes, qui ne contiennent guère chacune qu'un pied cube.
Il faut observer de payer les ouvriers préférablement à la taise, tant pour éviter les détails embarrassants que parce qu'ils vont beaucoup plus vite, les ouvrages trainent moins en longueur, et les fouilles peuvent se trouver faites de manière à pouvoir élever des fondements hors de terre avant l'hiver.
Lorsque l'on aura beaucoup de terre à remuer, il faudra obliger les entrepreneurs à laisser des témoins (o) sur le tas jusqu'à la fin des travaux, afin qu'ils puissent servir à taiser les surcharges et vuidanges des terres que l'on aura été obligé d'apporter ou d'enlever, selon les circonstances.
Les fouilles pour les fondations des bâtiments se font de deux manières : l'une dans toute leur étendue, c'est-à-dire dans l'intérieur de leurs murs de face : lorsqu'on a dessein de faire des caves souterraines, acqueducs, etc. on fait enlever généralement toutes les terres jusqu'au bon terrain : l'autre seulement par partie, lorsque n'ayant besoin ni de l'un ni de l'autre, on fait seulement des tranchées, de l'épaisseur des murs qu'il s'agit de fonder, que l'on trace au cordeau sur le terrain, et que l'on marque avec des repaires.
Des différentes espèces de terrains. Quoique la diversité des terrains soit très-grande, on peut néanmoins la réduire à trois espèces principales ; la première est celle de tuf ou de roc, que l'on connait facilement par la dureté, et pour lesquels on est obligé d'employer le pic, fig. 128. l'aiguille, fig. 116. le coin, fig. 78. la masse, fig. 79. et quelquefois la mine : c'est une pierre dont il faut prendre garde à la qualité. Lorsqu'on emploie la mine pour la tirer, on se sert d'abord d'une aiguille, fig. 116. qu'on appelle ordinairement trépan, bien acéré par un bout, et de six à sept pieds de longueur, manœuvré par deux hommes, avec lequel on fait un trou de quatre ou cinq pieds de profondeur, capable de contenir une certaine quantité de poudre. Cette mine chargée on bouche le trou d'un tampon chassé à force, pour faire faire plus d'effet à la poudre ; on y met ensuite le feu par le moyen d'un morceau d'amadou, afin de donner le temps aux ouvriers de s'éloigner ; la mine ayant ébranlé et écarté les pierres, on en fait le déblai, et on recommence l'opération toutes les fois qu'il est nécessaire.
La seconde est celle de rocaille, ou de sable, pour lesquels on n'a besoin que du pic, fig. 128. et de la pioche, fig. 130. l'une, dit M. Bélidor, n'est autre chose qu'une pierre morte mêlée de terre, qu'il est beaucoup plus difficîle de fouiller que les autres ; aussi le prix en est-il à peu près du double. L'autre se divise en deux espèces ; l'une qu'on appelle sable ferme, sur lequel on peut fonder solidement ; l'autre sable mouvant, sur lequel on ne peut fonder qu'en prenant des précautions contre les accidents qui pourraient arriver. On les distingue ordinairement par la terre que l'on retire d'une sonde de fer, fig. 155. dont le bout est fait en tarière, et avec laquelle on a percé le terrain. Si la sonde resiste et a de la peine à entrer, c'est une marque que le sable est dur ; si au contraire elle entre facilement, c'est une marque que le sable est mouvant. Il ne faut pas confondre ce dernier avec le sable bouillant, appelé ainsi parce qu'il en sort de l'eau lorsque l'on marche dessus, puisqu'il arrive souvent que l'on peut fonder dessus très-solidement, comme on le verra dans la suite.
La troisième est de terres franches, qui se divise en deux espèces ; les unes que l'on appelle terres hors d'eau, se tirent et se transportent sans difficultés ; les autres qu'on appelle terres dans l'eau, coutent souvent beaucoup, par les peines que l'on a de détourner les sources, ou par les épuisements que l'on est obligé de faire. Il y en a de quatre sortes, la terre ordinaire, la terre grasse, la terre glaise, et la terre de tourbe. La première se trouve dans tous les lieux secs et élevés ; la seconde que l'on tire des lieux bas et profonds, est le plus souvent composée de vase et de limon, qui n'ont aucune solidité ; la troisième qui se tire indifféremment des lieux bas et élevés, peut recevoir des fondements solides, surtout lorsqu'elle est ferme, que son banc a beaucoup d'épaisseur, et qu'elle est par-tout d'une égale consistance ; la quatrième est une terre grasse, noire, et bitumineuse, qui se tire des lieux aquatiques et marécageux, et qui étant séche se consume au feu. On ne peut fonder solidement sur un pareil terrain, sans le secours de l'art et sans des précautions que l'on connaitra par la suite. Une chose très-essentielle, lorsque l'on voudra connaître parfaitement un terrain, est de consulter les gens du pays : l'usage et le travail continuel qu'ils ont fait depuis longtemps dans les mêmes endroits, leur ont fait faire des remarques et des observations dont il est bon de prendre connaissance.
La solidité d'un terrain, dit Vitruve, se connait par les environs, soit par les herbes qui en naissent, soit par des puits, citernes, ou par des trous de sonde.
Une autre preuve encore de sa solidité, est lorsque laissant tomber de fort haut un corps très-pesant, on s'aperçoit qu'il ne raisonne ni ne tremble, ce que l'on peut juger par un tambour placé près de l'endroit où doit tomber ce corps, ou un vase plein d'eau dont le calme n'en est pas troublé.
Mais avant que d'entrer dans des détails circonstanciés sur la manière de fonder dans les différents terrains, nous dirons quelque chose de la manière de planter les bâtiments.
De la manière de planter les bâtiments. L'expérience et la connaissance de la géométrie sont des choses également nécessaires pour cet objet, c'est par le moyen de cette dernière que l'on peut tracer sur le terrain les tranchées des fondations d'un bâtiment, qu'on aura soin de placer d'alignement aux principaux points de vue qui en embellissent l'aspect : cette observation est si essentielle, qu'il y a des occasions où il serait mieux de préférer les alignements directs des principales issues, à l'obliquitté de la situation du bâtiment.
Il faut observer de donner des desseins aux traits, les coter bien exactement, marquer l'ouverture des angles, supprimer les saillies au-dessus des fondations, exprimer les empatements nécessaires pour le retour des corps saillans ou rentrants, intérieurs ou extérieurs, et prendre garde que les mesures particulières s'accordent avec les mesures générales.
Alors pour faciliter les opérations sur le terrain, on place à quelque distance des murs de face, des
(o) Des Témoins sont des mottes de terre de la hauteur du terrain, qu'on laisse de distance à autre, pour pouvoir le taiser après le déblais ou remblais.
pièces de bois bien équarries, que l'on enfonce assez avant dans la terre, et qui servent à recevoir des cordeaux bien tendus, pour marquer l'épaisseur des murs, et la hauteur des assises. On aura soin de les entretenir par des espèces d'entretoises, non-seulement pour les rendre plus fermes, mais afin qu'ils puissent aussi entretenir les cordeaux à demeure tels qu'on les a placés, selon les cotes du plan.
Il ne sera pas inutîle encore, lorsque les fondations seront hors de terre, de recommencer les opérations d'alignement, afin que les dernières puissent servir de preuves aux premières, et par-là s'assurer de ne s'être pas trompé.
Des fondements en général. Les fondements exigent beaucoup d'attention pour parvenir à leur donner une solidité convenable. C'est ordinairement de-là que dépend tout le succès de la construction : car, dit Palladio, les fondements étant la base et le pied du bâtiment, ils sont difficiles à réparer ; et lorsqu'ils se détruisent, le reste du mur ne peut plus subsister. Avant que de sonder, il faut considérer si le terrain est solide : s'il ne l'est pas, il faudra peut-être fouiller un peu dans le sable ou dans la glaise, et suppléer ensuite au défaut de la nature par le secours de l'art. Mais, dit Vitruve, il faut fouiller autant qu'il est nécessaire jusqu'au bon terrain, afin de soutenir la pesanteur des murs, bâtir ensuite le plus solidement qu'il sera possible, et avec la pierre la plus dure ; mais avec plus de largeur qu'au rez-de-chaussée. Si ces murs ont des voutes sous terre, il leur faudra donner encore plus d'épaisseur.
Il faut avoir soin, dit encore Palladio, que le plan de la tranchée soit de niveau, que le milieu du mur soit au milieu de la fondation, et bien perpendiculaire ; et observer cette méthode jusqu'au faite du bâtiment ; lorsqu'il y a des caves ou souterrains, qu'il n'y ait aucune partie du mur ou colonne qui porte à faux ; que le plein porte toujours sur le plein, et jamais sur le vide ; et cela afin que le bâtiment puisse tasser bien également. Cependant, dit-il, si on voulait les faire à plomb, ce ne pourrait être que d'un côté, et dans l'intérieur du bâtiment, étant entretenues par les murs de refend et par les planchers.
L'empatement d'un mur que Vitruve appelle stéréobatte, doit, selon lui, avoir la moitié de son épaisseur. Palladio donne aux murs de fondation le double de leur épaisseur supérieure ; et lorsqu'il n'y a point de cave, la sixième partie de leur hauteur : Scamozzi leur donne le quart au plus, et le sixième au moins ; quoiqu'aux fondations des tours, il leur ait donné trois fois l'épaisseur des murs supérieurs. Philibert de Lorme, qui semble être fondé sur le sentiment de Vitruve, leur donne aussi la moitié ; les Mansards aux Invalides et à Maisons, leur ont donné la moitié ; Bruaut à l'hôtel de Belle-Isle, leur a donné les deux tiers. En général, l'épaisseur des fondements doit se régler, comme dit Palladio, sur leur profondeur, la hauteur des murs, la qualité du terrain, et celle des matériaux que l'on y emploie ; c'est pourquoi n'étant pas possible d'en régler au juste l'épaisseur, c'est, ajoute cet auteur, à un habîle architecte qu'il convient d'en juger.
Lorsque l'on veut, dit-il ailleurs, ménager la dépense des excavations et des fondements, on pratique des piles A, fig. 32. et 33. que l'on pose sur le bon fond B, et sur lesquelles on bande des arcs C ; il faut faire attention alors de faire celle des extrémités plus fortes que celles du milieu, parce que tous ces arcs C, appuyés les uns contre les autres, tendent à pousser les plus éloignés ; et c'est ce que Philibert de Lorme a pratiqué au château de Saint-Maur, lorsqu'en fouillant pour poser les fondations de ce château, il trouva des terres rapportées de plus de quarante pieds de profondeur. Il se contenta alors de faire des fouilles d'un diamètre convenable à l'épaisseur des murs, et fit élever sur le bon terrain des piles éloignées les unes des autres d'environ douze pieds, sur lesquelles il fit bander des arcs en plein ceintre, et ensuite bâtir dessus comme à l'ordinaire.
Léon Baptiste Alberti, Scamozzi, et plusieurs autres, proposent de fonder de cette manière dans les édifices où il y a beaucoup de colonnes, afin d'éviter la dépense des fondements et des fouilles au-dessous des entrecolonnements ; mais ils conseillent en même temps de renverser les arcs C, fig. 33. de manière que leurs extrados soient posés sur le terrain, ou sur d'autres arcs bandés en sens contraire, parce que, disent-ils, le terrain où l'on fonde pouvant se trouver d'inégale consistance, il est à craindre que dans la suite quelque pîle venant à s'affaisser, ne causât une rupture considérable aux arcades, et par conséquent aux murs élevés dessus. Ainsi par ce moyen, si une des piles devient moins assurée que les autres, elle se trouve alors arcboutée par des arcades voisines, qui ne peuvent céder étant appuyées sur les terres qui sont dessous.
Il faut encore observer, dit Palladio, de donner de l'air aux fondations des bâtiments par des ouvertures qui se communiquent ; d'en fortifier tous les angles, d'éviter de placer trop près d'eux des portes et des croisées, étant autant de vides qui en diminuent la solidité.
Il arrive souvent, dit M. Belidor, que lorsque l'on vient à fonder, on rencontre des sources qui nuisent souvent beaucoup aux travaux. Quelques-uns prétendent les éteindre en jetant dessus de la chaux vive mêlée de cendre ; d'autres remplissent, disent-ils, de vif argent les trous par où elles sortent ; afin que son poids les oblige à prendre un autre cours. Ces expédiens étant fort douteux, il vaut beaucoup mieux prendre le parti de faire un puits au-delà de la tranchée, et d'y conduire les eaux par des rigoles de bois ou de brique couvertes de pierres plates, et les élever ensuite avec des machines : par ce moyen on pourra travailler à sec. Néanmoins pour empêcher que les sources ne nuisent dans la suite aux fondements, il est bon de pratiquer dans la maçonnerie des espèces de petits aqueducs, qui leur donnent un libre cours.
Des fondements sur un bon terrain. Lorsque l'on veut fonder sur un terrain solide, il ne se trouve pas alors beaucoup de difficultés à surmonter ; on commence d'abord par préparer le terrain, comme nous l'avons Ve précédemment, en faisant des tranchées de la profondeur et de la largeur que l'on veut faire les fondations. On passe ensuite dessus une assise de gros libages, ou quartiers de pierres plates à bain de mortier ; quoique beaucoup de gens les posent à sec, ne garnissant de mortier que leurs joints. Sur cette première assise, on en élève d'autres en liaison à carreau et boutisse alternativement. Le milieu du mur se remplit de moilon mêlé de mortier : lorsque ce moilon est brut, on en garnit les interstices avec d'autres plus petits que l'on enfonce bien avant dans les joints, et avec lesquels on arrose les lits. On continue de même pour les autres assises, observant de conduire l'ouvrage toujours de niveau dans toute sa longueur ; et des retraites ; on talude en diminuant jusqu'à l'épaisseur du mur au rez-de-chaussée.
Quoique le bon terrain se trouve le plus souvent dans les lieux élevés, il arrive cependant qu'il s'en trouve d'excellents dans les lieux aquatiques et profonds, et sur lesquels on peut fonder solidement, et avec confiance ; tels que ceux de gravier, de marne, de glaise, et quelquefois même sur le sable bouillant, en s'y conduisant cependant avec beaucoup de prudence et d'adresse.
Des fondements sur le roc. Quoique les fondements sur le roc paraissent les plus faciles à faire par la solidité du fonds, il n'en faut pas pour cela prendre moins de précautions. C'est, dit Vitruve, de tous les fondements les plus solides, parce qu'ils sont déjà fondés par le roc même. Ceux qui se font sur le tuf et la seareute (p), ne le sont pas moins, dit Palladio, parce que ces terrains sont naturellement fondés eux-mêmes.
Avant que de commencer à fonder sur le roc A, fig. 34. et 35. il faut avec le secours de la sonde, fig. 155. s'assurer de la solidité ; et s'il ne se trouvait dessous aucune cavité, qui par le peu d'épaisseur qu'elle laisserait au roc, ne permettrait pas d'élever dessus un poids considérable de maçonnerie, alors il faudrait placer dans ces cavités des piliers de distances à autres, et bander des arcs pour soutenir le fardeau que l'on veut élever, et par-là éviter ce qui est arrivé en bâtissant le Val-de-Grace, où, lorsqu'on eut trouvé le roc, on crut y asseoir solidement les fondations ; mais le poids fit fléchir le ciel d'une carrière qui anciennement avait été fouillée dans cet endroit ; de sorte que l'on fut obligé de percer ce roc, et d'établir par-dessous œuvre dans la carrière des piliers pour soutenir l'édifice.
Il est arrivé une chose à-peu-près semblable à Abbeville, lorsque l'on eut élevé les fondements de la manufacture de Vanrobais. Ce fait est rapporté par M. Briseux, dans son traité des maisons de campagne, et par M. Blondel, dans son Architecture française. Ce bâtiment étant fondé dans sa totalité, il s'enfonça également d'environ six pieds en terre : ce fait parut surprenant, et donna occasion de chercher le sujet d'un événement si subit et si général. L'on découvrit enfin, que le même jour on avait achevé de percer un puits aux environs, et que cette ouverture ayant donné de l'air aux sources, avait donné lieu au bâtiment de s'affaisser. Alors on se détermina à le combler ; ce que l'on ne put faire malgré la quantité de matériaux que l'on y jeta ; de manière que l'on fut obligé d'y enfoncer un rouet de charpente de la largeur du puits, et qui n'était point percé à jour. Lorsqu'il fut descendu jusqu'au fond, on jeta dessus de nouveaux matériaux jusqu'à ce qu'il fût comblé : mais en le remplissant, on s'aperçut qu'il y en était entré une bien plus grande quantité qu'il ne semblait pouvoir en contenir. Cependant lorsque cette opération fut finie, on continua le bâtiment avec succès, et il subsiste encore aujourd'hui.
Jean-Baptiste Alberti, et Philibert de Lorme, rapportent qu'ils se sont trouvés en pareil cas dans d'autres circonstances.
Lorsque l'on sera assuré de la solidité du roc A, fig. 34 et que l'on voudra bâtir dessus, il faudra y pratiquer des assises C, par ressauts en montant ou descendant, selon la forme du roc, leur donnant le plus d'assiette qu'il est possible. Si le roc est trop uni, et qu'il soit à craindre que le mortier ne puisse pas s'agraffer, et faire bonne liaison, on aura soin d'en piquer les lits avec le têtu, fig. 87. ainsi que celui des pierres qu'on posera dessus ; afin que cet agent entrant en plus grande quantité dans ces cavités, puisse consolider cette nouvelle construction.
Lorsque l'on y adossera de la maçonnerie B, fig. 35. on pourra réduire les murs à une moindre épaisseur, en pratiquant toujours des arrachements piqués dans leurs lits, pour recevoir les harpes C des pierres.
Lorsque la surface du roc est très-inégale, on peut s'éviter la peine de le tailler, en employant toutes les menues pierres qui embarrassent l'attelier, et qui avec le mortier remplissent très-bien les inégalités du roc. Cette construction était très-estimée des anciens, et souvent préférée dans la plupart des bâtiments. M. Belidor en fait beaucoup de cas, et prétend que lorsqu'elle s'est une fois endurcie, elle forme une masse plus solide et plus dure que le marbre ; et que par conséquent elle ne peut jamais s'affaisser, malgré les poids inégaux dont elle peut être chargée, ou les parties de terrains plus ou moins solides sur lesquels elle est posée.
Ces sortes de fondements sont appelés pierrées, et se font de cette manière.
Après avoir creusé le roc A, fig. 36. d'environ sept à huit pouces, on borde les alignements des deux côtés B et C, de l'épaisseur des fondements, avec des cloisons de charpente, en sorte qu'elles composent des coffres dont les bords supérieurs B et C, doivent être posés le plus horizontalement qu'il est possible ; les bords inférieurs D, suivant les inégalités du roc. On amasse ensuite une grande quantité de menues pierres, en y mêlant si l'on veut les décombres du roc, lorsqu'ils sont de bonne qualité, que l'on corroie avec du mortier, et dont on fait plusieurs tas. Le lendemain ou le surlendemain au plus, les uns le posent immédiatement sur le roc, et en remplissent les coffres sans interruption dans toute leur étendue, tandis que les autres le battent également par-tout avec la damoiselle, fig. 147. à mesure que la maçonnerie s'élève ; mais surtout dans le commencement, afin que le mortier et les pierres s'insinuent plus facilement dans les sinuosités du roc. Lorsqu'elle est suffisamment seche, et qu'elle a déjà une certaine solidité, on détache les cloisons pour s'en servir ailleurs. Cependant lorsque l'on est obligé de faire des ressauts en montant ou en descendant, on soutient la maçonnerie par les côtés avec d'autres cloisons E ; et de cette manière, on surmonte le roc jusqu'à environ trois ou quatre pieds de hauteur, selon le besoin ; ensuite on pose d'autres fondements à assises égales, sur lesquels on élève des murs à l'ordinaire.
Lorsque le roc est fort escarpé A, fig. 37. et que l'on veut éviter les remblais derrière les fondements B, on se contente quelquefois d'établir une seule cloison sur le devant C, pour soutenir la maçonnerie D, et on remplit ensuite cet intervalle de pierrée comme auparavant.
La hauteur des fondements étant établie, et arasée convenablement dans toute l'étendue que l'on a embrassée ; on continue la même chose en prolongeant, observant toujours de faire obliques les extrémités de la maçonnerie déjà faite, jeter de l'eau dessus, et bien battre la nouvelle, afin de les mieux lier ensemble. Une pareille maçonnerie faite avec de bonne chaux, dit M. Bélidor, est la plus excellente et la plus commode que l'on puisse faire.
Lorsque l'on est dans un pays où la pierre dure est rare, on peut, ajoute le même auteur, faire les soubassements des gros murs de cette manière, avec de bonne chaux s'il est possible, qui, à la vérité renchérit l'ouvrage par la quantité qu'il en faut ; mais l'économie, dit-il encore, ne doit pas avoir lieu lorsqu'il s'agit d'un ouvrage de quelque importance. Cependant, tout bien considéré, cette maçonnerie coute moins qu'en pierre de taille ; ses parements ne sont pas agréables à la vue à cause de leurs inégalités ; mais il est facîle d'y remédier, comme nous allons le voir.
Avant que de construire on fait de deux espèces de mortier ; l'un mêlé de gravier, et l'autre, comme nous l'avons dit, de menues pierres. Si on se trouvait dans un pays où il y eut de deux espèces de
(p) La seareute est une espèce de pierre très-suffisante pour supporter les grands bâtiments, tant dans l'eau que dehors.
chaux, la meilleure servirait pour celui de gravier, et l'autre pour celui des menues pierres. On commence par jeter un lit de mortier fin dans le fond du coffre, s'agraffant mieux que l'autre sur le roc ; ensuite d'une quantité d'ouvriers employée à cela, les uns jettent le mortier fin de part et d'autre sur les bords intérieurs du coffre qui soutiennent les parements ; d'autres remplissent le milieu de pierrée, tandis que d'autres encore le battent. Si cette opération est faite avec soin, le mortier fin se liant avec celui du milieu, formera un parement uni qui, en se durcissant, deviendra avec le temps plus dur que la pierre, et fera le même effet : on pourra même quelque temps après, si on juge à propos, y figurer des joints.
Il est cependant beaucoup mieux, disent quelques-uns, d'employer la pierre, ou le libage, s'il est possible, surtout pour les murs de face, de refend ou de pignons ; et faire, si l'on veut, les remplissages en moilon à bain de mortier, lorsque le roc est d'inégale hauteur dans toute l'étendue du bâtiment.
On peut encore par économie, ou autrement, lorsque les fondations ont beaucoup de hauteur, pratiquer des arcades B, fig. 28, dont une retombée pose quelquefois d'un côté sur le roc A, et de l'autre sur un pied droit ou massif C, posé sur un bon terrain battu et affermi, ou sur lequel on a placé des plates formes. Mais alors il faut que ces pierres qui composent ce massif, soient posées sans mortier, et que leurs surfaces aient été frottées les unes sur les autres avec l'eau et le grais, jusqu'à ce qu'elles se touchent dans toutes leurs parties ; et cela jusqu'à la hauteur D du roc ; et si on emploie le mortier pour les joindre ensemble, il faut lui donner le temps nécessaire pour sécher ; afin que d'un côté ce massif ne soit pas sujet à tasser, tandis que du côté du roc il ne tassera pas. Il ne faut pas cependant négliger de remplir de mortier les joints que forment les extrémités des pierres ensemble, et avec le roc, parce qu'ils ne sont pas sujets au tassement, et que c'est la seule liaison qui puisse les entretenir.
Des fondements sur la glaise. Quoique la glaise ait l'avantage de retenir les sources au-dessus et au-dessous d'elle, de sorte qu'on n'en est point incommodé pendant la bâtisse, cependant elle est sujette à de très-grands inconvéniens. Il faut éviter, autant qu'il est possible, de fonder dessus, et prendre le parti de l'enlever, à moins que son banc ne se trouvât d'une épaisseur si considérable, qu'il ne fût pas possible de l'enlever sans beaucoup de dépense ; et qu'il ne se trouvât dessous un terrain encore plus mauvais, qui obligerait d'employer des pieux d'une longueur trop considérable pour atteindre le bon fonds ; alors il faut tourmenter la glaise le moins qu'il est possible, raison pour laquelle on ne peut se servir de pilotis ; (q) l'expérience ayant appris qu'en enfonçant un pilot, fig. 43, à une des extrémités de la fondation, où l'on se croyait assuré d'avoir trouvé de bon fonds, on s'apercevait qu'en en enfonçant un autre à l'autre extrémité, le premier s'élançait en l'air avec violence. La glaise étant très-visqueuse, et n'ayant pas la force d'agraffer les parties du pilot, le défichait à mesure qu'on l'enfonçait ; ce qui fait qu'on prend le parti de creuser le moins qu'il est possible, et de niveau dans l'épaisseur de la glaise, on y pose ensuite un grillage de charpente A, fig. 39, d'un pied ou deux plus large que les fondements, pour lui donner plus d'empatement, assemblé avec des longrines B, et des traversines C, de neuf ou dix pouces de grosseur, qui se croisent, et qui laissent des intervalles ou cellules que l'on remplit ensuite de brique, de moilon ou de cailloux à bain de mortier, sur lequel on pose des madriers, bien attachés dessus avec des chevilles de fer à têtes perdues ; ensuite on élève la maçonnerie à assises égales dans toute l'étendue du bâtiment, afin que le terrain s'affaisse également partout.
Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment de peu d'importance, on se contente quelquefois de poser les premières assises sur un terrain ferme, et lié par des racines et des herbes qui en occupent la totalité, et qui se trouvent ordinairement de trois ou quatre pieds d'épaisseur posés sur la glaise.
Des fondements sur le sable. Le sable se divise en deux espèces ; l'une qu'on appelle sable ferme, est sans difficulté le meilleur, et celui sur lequel on peut fonder solidement et avec facilité ; l'autre qu'on appelle sable bouillant, est celui sur lequel on ne peut fonder sans prendre les précautions suivantes.
On commence d'abord par tracer les alignements sur le terrain, amasser près de l'endroit où l'on veut bâtir, les matériaux nécessaires à la construction, et ne fouiller de terre que pour ce que l'on peut faire de maçonnerie pendant un jour ; poser ensuite sur le fond, le plus diligemment qu'il est possible, une assise de gros libages, ou de pierres plates, sur laquelle on en pose une autre en liaison, et à joint recouvert avec de bon mortier ; sur cette dernière on en pose une troisième de la même manière, et ainsi de suite, le plus promptement que l'on peut, afin d'empêcher les sources d'inonder le travail, comme cela arrive ordinairement. Si l'on voyait quelquefois les premières assises flotter, et paraitre ne pas prendre une bonne consistance, il ne faudrait pas s'épouvanter, ni craindre pour la solidité de la maçonnerie, mais au contraire continuer sans s'inquiéter de ce qui arrivera ; et quelque temps après on s'apercevra que la maçonnerie s'affermira comme si elle avait été placée sur un terrain bien solide. On peut ensuite élever les murs, sans craindre jamais que les fondements s'affaissent davantage. Il faut surtout faire attention de ne pas creuser autour de la maçonnerie, de peur de donner de l'air à quelques sources, et d'y attirer l'eau, qui pourrait faire beaucoup de tort aux fondements. Cette manière de fonder est d'un grand usage en Flandre, principalement pour les fortifications.
Il se trouve à Bethune, à Arras, et en quelques autres endroits aux environs, un terrain tourbeux, qu'il est nécessaire de connaître pour y fonder solidement. Dès que l'on creuse un peu dans ce terrain, il en sort une quantité d'eau si prodigieuse, qu'il est impossible d'y fonder sans qu'il en coute beaucoup pour les épuisements. Après avoir employé une infinité de moyens, on a enfin trouvé que le plus court et le meilleur était de creuser le moins qu'il est possible, et de poser hardiment les fondations, employant les meilleurs matériaux que l'on peut trouver. Cette maçonnerie ainsi faite, s'affermit de plus en plus, sans être sujette à aucun danger. Lorsque l'on se trouve dans de semblables terrains que l'on ne connait pas, il faut les sonder un peu éloignés de l'endroit où l'on veut bâtir, afin que si l'on venait à sonder trop avant, et qu'il en sortit une source d'eau, elle ne put incommoder pendant les ouvrages. Si quelquefois on emploie la maçonnerie de pierrée, dit M. Belidor, ce devrait être principalement dans ce cas ; car étant d'une prompte exécution, et toutes ses parties faisant une bonne liaison, surtout lorsqu'elle est faite avec de la pozzolane, de la cendrée de Tournay, ou de la terrasse de Hollande, elle fait un massif, ou une espèce de banc, qui ayant reçu deux pieds ou deux pieds et demi d'épaisseur, est si solide, que l'on peut fonder dessus avec confiance. Cependant, lorsque l'on est obligé d'en faire usage, il faut donner plus d'empatement à la fondation, afin que comprenant plus de
(q) Pilotis est un assemblage de pilots fichés près-à-près dans la terre.
terrain, elle en ait aussi plus de solidité.
On peut encore fonder d'une manière différente de ces dernières, et qu'on appelle par coffre, fig. 40 : on l'emploie dans les terrains peu solides, et où il est nécessaire de se garantir des éboulements et des sources. On commence d'abord par faire une tranchée A, d'environ quatre ou cinq pieds de long, et qui ait de largeur l'épaisseur des murs. On applique sur le bord des terres, pour les soutenir, des madriers B, d'environ deux pouces d'épaisseur, soutenus à leur tour de distance en distance par des pièces de bois C en travers, qui servent d'étrésillons. Ces coffres étant faits, on les remplit de bonne maçonnerie, et on ôte les étrésillons C, à mesure que les madriers B se trouvent appuyés par la maçonnerie ; ensuite on en fait d'autres semblables à côté, dont l'abondance plus ou moins grande des sources, doit déterminer les dimensions, pour n'en être pas incommodé. Cependant s'il arrivait, comme cela se peut, que les sources eussent assez de force pour pousser sans qu'on put les en empêcher, malgré toutes les précautions que l'on aurait pu prendre, il faut selon quelques-uns, avoir recours à de la chaux vive, et sortant du four, que l'on jette promptement dessus, avec du moilon ou libage, mêlé ensuite de mortier, et par ce moyen on bouche la source, et on l'oblige de prendre un autre cours, sans quoi on se trouverait inondé de toutes parts, et on ne pourrait alors fonder sans épuisement. Lorsque l'on a fait trois ou quatre coffres, et que la maçonnerie des premiers est un peu ferme, on peut ôter les madriers qui servaient à la soutenir, pour s'en servir ailleurs ; mais si on ne pouvait les retirer sans donner jour à quelques sources, il serait mieux alors de les abandonner.
Lorsque l'on veut fonder dans l'eau, et qu'on ne peut faire des épuisements, comme dans de grands lacs, bras de mer, etc. si c'est dans le fond de la mer, on profite du temps que la marée est basse, pour unir le terrain, planter les repaires, et faire les alignements nécessaires. On doit comprendre pour cela non-seulement le terrain de la grandeur du bâtiment, mais encore beaucoup au-delà, afin qu'il y ait autour des murailles, une berme assez grande pour en assurer davantage le pied ; on emplit ensuite une certaine quantité de bateaux, des matériaux nécessaires, et ayant choisi le temps le plus commode, on commence par jeter un lit de cailloux, de pierres, ou de moilons, tels qu'ils sortent de la carrière, sur lesquels on fait un autre lit de chaux, mêlé de pozzolane, de cendrée de Tournay, ou de terrasse de Hollande. Il faut avoir soin de placer les plus grosses pierres sur les bords, et leur donner un talut de deux fois leur hauteur ; ensuite on fait un second lit de moilon ou de cailloux que l'on couvre encore de chaux et de pozzolane comme auparavant, et alternativement un lit de l'un et un lit de l'autre. Par la propriété de ces différentes poudres, il se forme aussi-tôt un mastic, qui rend cette maçonnerie indissoluble, et aussi solide que si elle avait été faite avec beaucoup de précaution ; car quoique la grandeur des eaux et les crues de la mer empêchent qu'on ne puisse travailler de suite, cependant on peut continuer par reprises, sans que cela fasse aucun tort aux ouvrages. Lorsque l'on aura élevé cette maçonnerie au-dessus des eaux, ou au rez-de-chaussée, on peut la laisser pendant quelques années à l'épreuve des inconvénients de la mer, en la chargeant de tous les matériaux nécessaires à la construction de l'édifice, afin qu'en lui donnant tout le poids qu'elle pourra jamais porter, elle s'affaisse également et suffisamment par-tout. Lorsqu'au bout d'un temps on s'aperçoit qu'il n'est arrivé aucun accident considérable à ce massif, on peut placer un grillage de charpente, comme nous l'avons déjà Ve fig. 39, et bâtir ensuite dessus avec solidité, sans craindre de faire une mauvaise construction. Il serait encore mieux, si l'on pouvait, de battre des pilots autour de la maçonnerie, et former un bon empatement, qui garantirait le pied des dégradations qui pourraient arriver dans la suite.
On peut encore fonder dans l'eau d'une autre manière (fig. 41.) en se servant de caissons A, qui ne sont autre chose qu'un assemblage de charpente et madriers bien calfatés, dans l'intérieur desquels l'eau ne saurait entrer, et dont la hauteur est proportionnée à la profondeur de l'eau où ils doivent être posés, en observant de les faire un peu plus hauts, afin que les ouvriers ne soient point incommodés des eaux. On commence par les placer et les arranger d'alignement dans l'endroit où l'on veut fonder ; on les attache avec des câbles qui passent dans des anneaux de fer attachés dessus ; quand ils sont ainsi préparés on les remplit de bonne maçonnerie. A mesure que les ouvrages avancent, leur propre poids les fait enfoncer jusqu'au fond de l'eau ; et lorsque la profondeur est considérable, on augmente leur hauteur avec des hausses, à mesure qu'elles approchent du fond : cette manière est très-en usage, d'une grande utilité, et très-solide.
Des fondements sur pilotis. Il arrive quelquefois qu'un terrain ne se trouvant pas assez bon pour fonder solidement, et que voulant creuser davantage, on le trouve au contraire encore plus mauvais : alors il est mieux de creuser le moins que l'on pourra, et poser dessus un grillage de charpente A, fig. 42, assemblé comme nous l'avons Ve précédemment, sur lequel on pose quelquefois aussi un plancher de madriers, mais ce plancher B ne paraissant pas toujours nécessaire, on se contente quelquefois d'élever la maçonnerie sur ce grillage, observant d'en faire les parements en pierre jusqu'au rez-de-chaussée, et plus haut, si l'ouvrage était de quelque importance. Il est bon de faire régner autour des fondations sur le bord des grillages des heurtoirs C ou espèces de pilots, enfoncés dans la terre au refus du mouton (fig. 153.) pour empêcher le pied de la fondation de glisser, principalement lorsqu'il est posé sur un plancher de madriers ; et par-là prévenir ce qui est arrivé un jour à Bergue-Saint-Vinox, où le terrain s'étant trouvé très-mauvais, une partie considérable du revêtement de la face d'une demi-lune s'est détachée et a glissé tout d'une pièce jusque dans le milieu du fossé.
Mais lorsqu'il s'agit de donner encore plus de solidité au terrain, on enfonce diagonalement dans chacun des intervalles du grillage, un ou deux pilots D de remplage ou de compression sur toute l'étendue des fondations ; et sur les bords du grillage, des pilots de cordage ou de garde E près-à-près, le long desquels on pose des palplanches pour empêcher le courant des eaux, s'il s'en trouvait, de dégrader la maçonnerie. Palladio recommande expressément, lorsque l'on enfonce des pilots, de les frapper à petits coups redoublés, parce que, dit-il, en les chassant avec violence, ils pourraient ébranler le fond. On acheve ensuite de remplir de charbon, comme dit Vitruve, ou, ce qui vaut encore mieux, de cailloux ou de moilons à bain de mortier, les vides que la tête des pilots a laissés : on arase bien le tout, et on élève dessus les fondements.
Pour connaître la longueur des pilots, que Vitruve conseille de faire en bois d'aune, d'olivier ou de chêne, et que Palladio recommande surtout de faire en chêne, il faut observer, avant que de piloter, jusqu'à quelle profondeur le terrain fait une assez grande résistance, et s'oppose fortement à la pointe d'un pilot que l'on enfonce exprès. Ainsi sachant de combien il s'est enfoncé, on pourra déterminer la longueur des autres en les faisant un peu plus longs, se pouvant rencontrer des endroits où le terrain résiste moins et ne les empêche point d'entrer plus avant. Palladio conseille de leur donner de longueur la huitième partie de la hauteur des murs qui doivent être élevés dessus ; lorsque la longueur est déterminée, on en peut proportionner la grosseur en leur donnant, suivant le même auteur, environ la douzième partie de leur longueur, lorsqu'ils ne passent pas douze pieds, mais seulement douze ou quatorze lorsqu'ils vont jusqu'à dix-huit ou vingt pieds ; et cela pour éviter une dépense inutîle de pièces de bois d'un gros calibre.
Comme ces pilots ont ordinairement une de leurs extrémités faite en pointe de diamant, dont la longueur doit être depuis une fois et demie de leur diamètre jusqu'à deux fais, il faut avoir soin de ne pas leur donner plus ni moins ; car lorsqu'elles ont plus, elles deviennent trop faibles et s'émoussent lorsqu'elles trouvent des parties dures ; et lorsqu'elles sont trop courtes, il est très-difficîle de les faire entrer. Quand le terrain dans lequel on les enfonce ne résiste pas beaucoup, on se contente seulement, selon Palladio, de bruler la pointe pour la durcir, et quelquefois aussi la tête, afin que les coups du mouton ne l'éclatent point ; mais s'il se trouve dans le terrain des pierres, cailloux ou autres choses qui résistent et qui en émoussent la pointe, on la garnit alors d'un sabot ou lardoir A, fig. 43, espèce d'armature de fer (fig. 44.) faisant la pointe, retenue et attachée au pilot par trois ou quatre branches. L'on peut encore en armer la tête B d'une virole de fer qu'on appelle frette, pour l'empêcher de s'éclater, et l'on proportionne la distance des pilots à la quantité que l'on croit avoir besoin pour rendre les fondements solides. Mais il ne faut pas les approcher l'un de l'autre, ajoute encore Palladio, de plus d'un diamètre, afin qu'il puisse rester assez de terre pour les entretenir.
Lorsque l'on veut placer des pilots de bordage ou de garde A, fig. 45, entrelacés de palplanches B le long des fondements, on fait à chacun d'eux, après les avoir équarris, deux rainures C opposées l'une à l'autre de deux pouces de profondeur sur toute leur longueur, pour y enfoncer entre deux des palplanches B qui s'y introduisent à coulisse, et dont l'épaisseur diffère selon la longueur : par exemple, si elles ont six pieds, elles doivent avoir trois pouces d'épaisseur ; si elles en ont douze, qui est la plus grande longueur qu'elles puissent avoir, on leur donne quatre pouces d'épaisseur, et cette épaisseur doit déterminer la largeur des rainures C sur les pilots, en observant de leur donner jusqu'aux environs d'un pouce de jeu, afin qu'elles y puissent entrer plus facilement.
Pour joindre les palplanches avec les pilots, on enfonce d'abord deux pilots perpendiculairement dans la terre, distant l'un de l'autre de la largeur des palplanches, qui est ordinairement de douze à quinze pouces, en les plaçant de manière que deux rainures se trouvent l'une vis-à-vis de l'autre. Après cela on enfonce au refus du mouton une palplanche entre les deux, et on la fait entrer à force entre les deux rainures ; ensuite on pose à la même distance un pilot, et on enfonce comme auparavant une autre palplanche, et on continue ainsi de suite à battre alternativement un pilot et une palplanche. Si le terrain résistait à leur pointe, on pourrait les armer comme les pilots, d'un sabot de fer par un bout, et d'une frette par l'autre.
On peut encore fonder sur pilotis, en commençant d'abord par enfoncer le long des fondements, au refus du mouton, des rangées de pilots (fig. 46.) éloignés les uns des autres d'environ un pied ou deux, plus ou moins, disposés en échiquier ; en observant toujours de placer les plus forts et les plus longs dans les angles, ayant beaucoup plus besoin de solidité qu'ailleurs pour retenir la maçonnerie : ensuite on récépera tous les pilots au même niveau, sur lesquels on posera un grillage de charpente A, comme ci-devant, de manière qu'il se trouve un pilot sous chaque croisée, pour l'arrêter dessus avec une cheville à tête perdue (fig. 47.), après quoi on pourra enfoncer des pilots de remplage et élever ensuite les fondements à l'ordinaire : cette manière est très-bonne et très-solide.
Quoiqu'il arrive très-souvent que l'on emploie les pilots pour affermir un mauvais terrain, cependant il se trouve des circonstances où on ne peut les employer, sans courir un risque évident. Si l'on fondait, par exemple, dans un terrain aquatique, sur un sable mouvant, etc. alors les pilots seraient non seulement très-nuisibles, mais encore éventeraient les sources, et fourniraient une quantité prodigieuse d'eau qui rendrait alors le terrain beaucoup plus mauvais qu'auparavant : d'ailleurs on voit tous les jours que ces pilots ayant été enfoncés au refus du mouton avec autant de difficulté que dans un bon terrain, sortent de terre quelques heures après, ou le lendemain, l'eau des sources les ayant repoussés, en faisant effort pour sortir ; de manière que l'on a renoncé à les employer à cet usage.
Si l'on entreprenait de rapporter toutes les manières de fonder, toutes les différentes qualités de terrains, et toutes les différentes circonstances où l'on se trouve, on ne finirait jamais. Ce que l'on vient de voir est presque suffisant pour que l'on puisse de soi-même, avec un peu d'intelligence et de pratique, faire un choix judicieux des différents moyens dont on peut se servir, et suppléer aux inconvénients qui surviennent ordinairement dans le cours des ouvrages.
Des outils dont se servent les carriers pour tirer la pierre des carrières. La fig. 48 est une pince de fer carré, arrondi par un bout A, et aminci par l'autre B, d'environ six à sept pieds de long, sur deux pouces et demi de grosseur, servant de levier.
La fig. 49 est une semblable pince, mais de deux pouces de grosseur sur quatre à cinq pieds de long, employée aux mêmes usages.
La fig. 50 est un rouleau qui se place dessous les pierres ou toute espèce de fardeau, pour les transporter, et que l'on fait rouler avec des leviers, fig. 158 et 159, dont les bouts A entrent dans les trous B du rouleau, fig. 50, ne pouvant rouler d'eux-mêmes, à cause du grand fardeau qui pese dessus.
La fig. 51 est aussi un rouleau de bois, mais sans trous, et qui pouvant rouler seul en poussant le fardeau, n'a pas besoin d'être tourné avec des leviers, comme le précédent.
Les fig. 52 et 53 sont des instruments de fer, appelés esses, qui ont depuis dix jusqu'à treize et quatorze pouces de long, sur quinze à vingt lignes de grosseur, ayant par chaque bout une pointe camuse aciérée ; le manche a depuis quatre jusqu'à huit pieds de long. Ces esses servent à souchever entre les lits des pierres pour les dégrader.
La fig. 54 est la même esse vue du côté de l'oeil.
Les fig. 55 et 57 sont des masses de fer carrées, appelées mails, qui ont depuis trois jusqu'à quatre pouces et demi de grosseur, sur neuf à quatorze pouces de long, avec un manche d'environ deux pieds à deux pieds et demi de longueur, fort menu et élastique, pour donner plus de coup à la masse. Ils servent à enfoncer les coins, fig. 62 et 63, dans les filières (r) des pierres, ou les entailles que l'on y a
(r) Des filières sont des espèces de joints qui se trouvent naturellement entre les pierres dans les carrières.
faites avec le marteau, fig. 61, pour le rompre.
Les fig. 56 et 58 sont les mêmes mails vus du côté de l'oeil.
La fig. 59 est un instrument appelé tire-terre, fait à-peu-près comme une pioche, dont le manche diffère, comme celui des esses, fig. 52 et 53. Il sert à tirer la terre que l'on a souchevée avec ces mêmes esses entre les lits des pierres ; ce qui lui a donné le nom.
La fig. 60 est le même tire-terre Ve du côté de l'oeil.
Les fig. 62 et 63 sont deux coins de fer, depuis vingt lignes jusqu'à trois pouces de grosseur, et depuis neuf pouces jusqu'à un pied de long, amincis par un bout pour placer dans des filières ou entailles faites dans les pierres pour les séparer.
La fig. 64 est un cric composé d'une barre de fer plat, enfermé dans l'intérieur d'un morceau de bois, ayant des dents sur sa longueur, et mu en montant et en descendant, par un pignon arrêté à demeure sur la manivelle A ; ce qui fait qu'en tournant cette manivelle, et qu'en posant le croc B du cric sous un fardeau, on peut l'élever à la hauteur que l'on juge à propos.
La fig. 65 est une espèce de plateau appelé baquet, suspendu sur des cordages A, et ensuite à l'esse B, qui répond au treuil du singe, fig. 26, qui sert à monter les moilons que l'on arrange dessus.
Des outils dont se servent les maçons et tailleurs de pierre dans les bâtiments. La fig. 66 est une règle de bois plate, de six pieds de long, qui sert aux maçons pour tirer des lignes sur des planchers, murs, etc. Il s'en trouve de cette espèce jusqu'à douze pieds de long.
La fig. 67 est aussi une règle de bois de six pieds de long, mais carrée, qui se place dans les embrasures (s) des portes et croisées, pour en former la feuilleure.
La fig. 68 est une règle de bois de quatre pieds de long, carrée comme la dernière, et servant aux mêmes usages. Ces trois espèces de règles se posent souvent et indifféremment à des surfaces sur lesquelles on pose les deux pieds A du niveau, fig. 75, afin d'embrasser un plus long espace, et par-là prendre un niveau plus juste.
La fig. 69 est une équerre de fer mince, depuis dix-huit pouces jusqu'à trois pieds de longueur chaque branche, à l'usage des tailleurs de pierre.
La fig. 70 est un instrument de bois appelé fausse-équerre, sauterelle ou beuveau droit, fait pour prendre des ouvertures d'angle.
La fig. 71 est un instrument aussi de bois, appelé beuveau concave, fait pour prendre des angles mixtes.
La fig. 72 est encore un instrument appelé beuveau convexe, fait aussi pour prendre des angles mixtes. Ces trois instruments se font depuis un pied jusqu'à deux pieds de longueur chaque branche, et la longueur à proportion. Ils peuvent s'ouvrir et se fermer tout à fait par le moyen des charnières A et des doubles branches B.
La fig. 73 est une fausse-équerre ou grand compas, qui sert à prendre des ouvertures d'angles et des espaces, et que les appareilleurs portent souvent avec eux pour appareiller les pierres.
La fig. 74 est un petit compas à l'usage des tailleurs de pierre.
La fig. 75 est un instrument appelé niveau, qui avec le secours d'une grande règle, pour opérer plus juste, sert à poser les pierres de niveau, à mesure que les murs s'élèvent.
La fig. 76 est aussi un niveau, mais d'une autre espèce.
La fig. 77 est une règle d'appareilleur, ordinairement de quatre pieds de long, sur laquelle les pieds et les pouces sont marqués, et que les appareilleurs portent toujours avec eux dans les bâtiments.
La fig. 78 est un coin de fer d'environ deux ou trois pouces de grosseur, et depuis huit jusqu'à douze pouces de long, pour fendre les pierres, et les débiter.
La fig. 79 est une masse de fer appelée grosse masse, d'environ deux à trois pouces de grosseur, sur dix à quatorze pouces de long, et qui avec le secours du coin, comme nous l'avons Ve ci-devant, sert à fendre et débiter les pierres.
La fig. 80 est le même mail Ve du côté de l'oeil.
La fig. 81 est une autre masse de fer plus petite que la précédente, appelée petite masse, d'environ dixhuit lignes ou deux pouces de grosseur, sur six à huit pouces de long, qui avec la pointe ou poinçon, fig. 110, sert à faire des trous dans la pierre.
La fig. 82 est la même masse vue du côté de l'oeil.
La fig. 83 et 85 sont des marteaux appelés têtus, à l'usage des tailleurs de pierre, lorsqu'ils ont des masses de pierre à rompre. Ces espèces de marteaux ont depuis deux jusqu'à trois pouces de gros, et depuis neuf pouces jusqu'à un pied de long, et les deux bouts en sont creusés en forme d'un V.
La fig. 84 et 86 sont les mêmes têtus vus du côté de l'oeil.
La fig. 87 est aussi un têtu, mais plus petit et plus long, et dont un côté est fait en pointe, à l'usage des maçons pour démolir.
La fig. 88 est le même Ve du côté de l'oeil.
La fig. 89 est un marteau à deux pointes, dont se servent les tailleurs de pierre pour dégrossir les pierres dures, les piquer et les rustiquer.
La fig. 90 est le même marteau Ve du côté de l'oeil.
La fig. 91 est un marteau à pointe du côté A, servant aux mêmes usages que le précédent, et de l'autre B, aminci en forme de coin, avec un tranchant taillé de dents qu'on appelle bretelures ; ce côté sert pour brételer les pierres dures ou tendres lorsqu'elles ont été dégrossies avec la pointe A du même marteau, ou celle A du marteau fig. 95.
La fig. 92 est le même Ve du côté de l'oeil.
La fig. 93 est un marteau dont le côté brételé B sert aux mêmes usages que le précédent, et l'autre côté appelé hache, sert pour hacher les pierres et les finir lorsqu'elles ont été brételées. Ce côté A est fait comme le côté B, excepté qu'il n'y a point de brételures.
La fig. 94 est le même Ve du côté de l'oeil.
La fig. 95 est un marteau dont le côté B sans brételure est appelé hache, et l'autre aussi appelé hache, mais plus petite, est fait pour dégrossir les pierres tendres.
La fig. 96 est le même Ve du côté de l'oeil.
La fig. 97 est un marteau dont les deux côtés sont faits pour tailler et dégrossir la pierre tendre.
La fig. 98 est le même Ve du côté de l'oeil.
La fig. 99 est un ciseau large, mince et aciéré par un bout, qui avec le secours du maillet, fig. 111, sert à tailler les pierres et à les équarrir.
La fig. 100 est un marteau à l'usage des maçons, dont un côté est carré et l'autre est fait en hache, pour démolir les cloisons ou murs faits en plâtre.
La fig. 101 est le même Ve du côté de l'oeil.
La fig. 102 est un marteau à deux pointes aussi à l'usage des maçons, pour démolir toutes espèces de murs en plâtre, moilon ou pierre.
La fig. 103 est le même Ve du côté de l'oeil.
(s) Une embrasure est l'intervalle d'une porte ou d'une croisée, entre la superficie extérieure du mur et la superficie intérieure.
La fig. 104 est un marteau carré d'un côté et à pointe de l'autre, ainsi que le précédent, aussi à l'usage des maçons pour démolir.
La fig. 105 est le même Ve du côté de l'oeil.
La fig. 106 est un marteau plus petit que les autres ; et appelé pour cela hachette, à cause de la petite hache A qu'il a d'un côté ; l'autre B est carré.
La fig. 107 est le même Ve du côté de l'oeil.
La fig. 108 est un marteau appelé décintroir ; les deux côtés sont faits en hache, mais l'une est tournée d'un sens et l'autre de l'autre. Il sert aussi aux maçons pour démolir les murs et cloisons en plâtre.
La fig. 109 est le même décintroir Ve du côté de l'oeil.
La fig. 110 est un poinçon qui, avec la masse fig. 81, et le maillet, fig. 111, sert à percer des trous dans la pierre.
La fig. 111 est une espèce de marteau de bois appelé maillet, moins pesant que la masse, et par conséquent plus commode pour tailler la pierre avec le ciseau fig. 99, ou le poinçon fig. 110.
La fig. 112 est un ciseau à main à l'usage des maçons, pour tailler les moulures plates des angles des corniches en plâtre : il y en a de plusieurs largeurs selon les moulures.
La fig. 113 est une gouge, espèce de ciseau arrondi fait pour tailler les moulures rondes des mêmes angles de corniche en plâtre : il y en a aussi de plusieurs grosseurs, selon les moulures, et plus ou moins cintrées, selon les courbes.
La fig. 114 est un instrument appelé riflard sans brételure, à l'usage des maçons et tailleurs de pierre, pour rifler et unir la pierre, ou les murs en plâtre lorsqu'ils sont faits.
La fig. 115 est un semblable riflard, mais avec brételures, servant aux mêmes usages que le précédent.
La fig. 116 est une aiguille ou trépan aciéré par le bout A, pour percer la pierre ou le marbre avec le secours d'un levier à deux branches, comme celui A de la sonde, fig. 155, surtout lorsque l'on veut faire jouer la mine.
La fig. 117 est un rabot tout de bois, dont le manche a environ depuis six jusqu'à huit pieds de longueur, qui sert aux Limousins dans les bâtiments pour corroyer le mortier, éteindre la chaux, etc.
La fig. 118 est un instrument de fer appelé houe, emmanché sur un bâton à-peu-près de même longueur que le précédent, servant aux mêmes usages, surtout en Allemagne.
La fig. 119 est un instrument de fer appelé drague, très-mince, et percé de plusieurs trous du côté A, le côté B ayant une douille sur laquelle s'emmanche une perche depuis sept jusqu'à dix et douze pieds de longueur, avec laquelle on tire le sable du fond des rivières.
La fig. 120 est un petit morceau de bois A sur lequel on enveloppe un cordeau ou une ligne, espèce de ficelle qu'on appelle fouet, au bout de laquelle pend un petit cylindre B de cuivre, de plomb ou de fer, appelé plomb, qui sert à prendre des à-plombs, niveaux et alignements. La pièce C est une petite plaque aussi de fer ou de cuivre, mince et carrée, du même diamètre que le plomb, et que l'on appuie le long d'un mur pour former, avec l'espace B C et la ligne du mur, deux parallèles qui font juger si le mur est d'à-plomb.
La fig. 121 est un instrument de fer appelé rondelle, large, mince et coudé par un bout A, et appointé par l'autre B, enfoncé dans un manche de bois C, pour rifler la pierre et surtout le plâtre dans des parties circulaires.
La fig. 122 est un pareil instrument de fer appelé crochet sans brételure, fait aussi pour rifler la pierre ou le plâtre dans des parties plates et unies.
La fig. 123 est un semblable instrument de fer, mais avec des brételures, servant aussi aux mêmes usages.
La fig. 124 est un instrument de fer appelé aussi riflard, composé d'une plaque de tôle forte, aminci de deux côtés B et C, avec des brételures d'un côté B, et sans brételure de l'autre C, attaché au bout d'une tige de fer à deux branches d'un côté C et à pointe de l'autre D, entrant dans un manche de bois, à l'usage des maçons, pour rifler les murs en plâtre lorsqu'ils sont faits.
La fig. 125 est un instrument de cuivre appelé truelle, ayant par un bout A une plaque large, mince, arrondie et coudée, et par l'autre B, une pointe coudée, enfoncée dans un manche de bois, dont les Maçons se servent pour employer le plâtre. Cet instrument est plutôt de cuivre que de fer, parce que le fer se rouillant par l'humidité, laisserait souvent des taches jaunes sur les murs en plâtre.
La fig. 126 est une autre truelle de fer, plate, large, mince et pointue par un bout A, et a une pointe coudée de l'autre B, emmanchée dans un manche de bois, pour employer le mortier ; elle est plutôt de fer que de cuivre, parce que les sels de la chaux et du sable la rongeraient, et feraient qu'elle ne serait jamais unie ni lisse.
La fig. 127, est une semblable truelle, mais avec des bretelures, pour faire des enduits de chaux sur les murs.
La fig. 128 est un instrument appelé pic d'environ douze à quinze pouces de long, à pointe d'un côté A, et à douille par l'autre B ; emmanché sur un bâton d'environ trois ou quatre pieds de long, à l'usage des Terrassiers.
La fig. 129 est le même pic, Ve du côté de la douille.
La fig. 130 est un instrument appelé pioche, d'environ douze à quinze pouces de long, dont un bout A est aminci en forme de coin, et l'autre B, à douille, emmanché aussi sur un bâton de trois ou quatre pieds de long.
La fig. 131 est la même pioche vue du côté de la douille.
La fig. 132, est une pelle de bois, trop connue pour en faire la description ; elle sert aux Terrassiers et aux Limousins dans les bâtiments.
La fig. 133 est un bâton rond, appelé batte, plus gros par un bout que par l'autre, fait pour battre le plâtre, en le prenant par le plus petit bout.
La fig. 134 est une hotte contenant environ un pied cube de terre, qui sert aux Terrassiers et aux Limousins dans les bâtiments, pour transporter les terres.
La fig. 135 est une brouette, trainée par un seul homme ; elle contient environ un pied cube de terre, et sert aussi aux Terrassiers et aux Limousins pour transporter des terres, de la chaux, du mortier, etc.
La fig. 136 est un banneau, trainé par deux hommes ; il contient environ cinq à six pieds cubes de terre, et sert aux mêmes usages que les brouettes.
La fig. 137 est un instrument de bois, appelé oiseau, à l'usage des Limousins pour transporter le mortier sur les épaules.
La fig. 138 est une auge de bois à l'usage des Maçons, dans laquelle on gache le plâtre pour l'employer.
La fig. 139 est un panier d'osier clair, d'environ deux pieds à deux pieds et demi de diamètre, à l'usage des Maçons pour passer le plâtre propre à faire des crépis.
La fig. 140 est une espèce de tamis, appelé sas fait aussi pour tamiser le plâtre ; mais plus fin que le précédent, et propre à faire des enduits.
La fig. 141 est un instrument de bois, appelé bar, d'environ six à sept pieds de long sur deux pieds de large, avec des traverses A, porté par deux ou plusieurs hommes, fait pour transporter des pierres d'un moyen poids dans les bâtiments ; les trous B sont faits pour y passer, en cas de besoin, un boulon de fer claveté pour rendre le bar plus solide.
La fig. 142 est un instrument aussi de bois, appelé civière, avec des traverses comme le précédent, servant aussi aux mêmes usages.
La fig. 143 est une scie sans dent pour débiter la pierre dure ; elle est manœuvrée par un ou deux hommes, lorsque les pierres sont fort longues.
La fig. 144 est une espèce de cuillière de fer, emmanchée sur un petit bâton, depuis six jusqu'à dix pieds de long, à l'usage des scieurs de pierres, pour arroser avec de l'eau et du grais les pierres qu'ils débitent à la scie sans dent.
La fig. 145 est une scie avec dent pour débiter la pierre tendre, manœuvrée par deux ou quatre hommes, selon la grosseur de la pierre.
La fig. 146, est une scie à main avec dent, faite pour scier les joints des pierres tendres, et par-là, livrer passage au mortier ou au plâtre, et faire liaison.
La fig. 147, est un instrument appelé demoiselle, dont on se sert en Allemagne pour corroyer le mortier ; c'est une espèce de cône tronqué dans son sommet, dont la partie inférieure A est armée d'une masse de fer, et la partie supérieure d'une tige de bois en forme de T, pour pouvoir être manœuvrée par plusieurs hommes.
La fig. 148 est une scie à main sans dent, faite pour scier les joints des pierres dures, et faire passage au mortier ou au plâtre, pour former liaison.
La fig. 149 est une lame de fer plate, d'environ trois pieds de long, appelée fiche, faite pour ficher le mortier dans les joints des pierres.
La fig. 150 est un assemblage de charpente, appelé brancard, d'environ cinq à six pieds de long, sur deux ou trois pieds de large et de hauteur, fait avec le secours du gruau, fig. 160, ou de la grue, fig. 162, pour monter sur le bâtiment des pierres de sujétions ou des moilons.
La fig. 151 est un instrument appelé bouriquet, avec lequel, par le secours du gruau, fig. 160, ou de la grue, fig. 162, on monte des moilons sur le bâtiment ; les cordages A s'appellent brayer du bouriquet ; et B, l'esse du même bouriquet.
La fig. 152 est un châssis de bois, appelé manivelle, de deux ou trois pieds de hauteur, sur environ dix-huit pouces de large, percé de plusieurs trous pour y placer un boulon A à la hauteur que l'on juge à propos, à l'usage des Maçons et Tailleurs de pierre, pour servir avec le secours du levier, fig. 158, à lever les pierres ou toute espèce de fardeau.
La fig. 153 est un assemblage de charpente, appelé mouton, d'environ quinze à vingt pieds d'élévation, dont on se sert pour planter des pilotis A. Cet assemblage est composé de plusieurs pièces, dont la première marquée B, est un gros billot de bois, appelé mouton, fretté par les deux bouts, attaché au bout des deux cordages C, tiré et lâché alternativement par des hommes ; ce cordage roule sur des poulies D ; et c'est ce qu'on appelle sonnettes. E, est le sol ; F, la fourchette ; G, les moutons ; H, les bras ou liens ; I, le ranche garni de chevilles ; K, la jambette.
La fig. 154 est un échafaud adossé à un mur A, dont se servent les Maçons dans les bâtiments ; il est composé de perches B, de boulins C, attachés dessus avec des cordages, et des planches ou madriers D posés dessus, et sur lesquels les Maçons travaillent à la surface des murs.
La fig. 155 est une seconde composée de plusieurs tringles de fer B, selon la profondeur du terrain que l'on veut sonder, chacune de six à sept pieds de long, sur quinze à dix-huit lignes de grosseur en carré, portant par le bout d'en haut une vis C, et par l'autre une douille D, creusée, et à écrou qui se visse sur le bout C ; E, est une espèce de cuillere en forme de vrille pour percer le terrain ; F, est une fraise pour percer le roc ; A, est le manche ou levier avec lequel on manœuvre la sonde.
La fig. 156 est une chèvre faite pour lever des fardeaux d'une moyenne pesanteur, composée d'un treuil A, d'un cordage B, de deux leviers C, d'une poulie D, de deux bras E, et de deux traverses F.
La fig. 157 est un cabestan appelé dans les bâtiments vindas, qui sert à transporter des fardeaux, en faisant tourner par des hommes les leviers A, qui entrent dans les trous du treuil B, et qui en tournant, enfîle d'un côté C le cordage D ; et de l'autre E, le défile.
Les fig. 158 et 159 sont des leviers ou boulins de différente longueur à l'usage des bâtiments.
La fig. 160 est un gruau d'environ trente à quarante pieds de hauteur, fait pour enlever les pierres, les grosses pièces de charpente, et toute espèce de fardeau fort lourd, pour les poser ensuite sur le bâtiment ; il est composé de leviers A, d'un treuil B, d'un cordage C, de deux ou trois poulies D, d'un poids quelconque E. F, est le sol du gruau ; G, la fourchette ; H, les bras ; I, la jambette ; K, le ranche garni de chevilles ; L, la sellette ; M, le poinçon ; N, le lien ; et O, les moises, retenues de distances en distances par des boulons clavetés.
La fig. 161 est la partie supérieure d'un gruau d'une autre espèce ; A, en est le poinçon ; B, la sellette ; C, le fauconneau ou estourneau ; D, les liens ; E, le cordage ; et F, les poulies.
La fig. 162, est une grue d'environ cinquante à soixante pieds de hauteur, servant aussi à enlever de grands fardeaux, et est composée d'une roue A, fermée dans sa circonférence, et dans laquelle des hommes marchent, et en marchant font tourner le treuil B, qui enveloppe la corde ou chable C, attaché de l'autre côté à un grand poids D ; au lieu de cette roue, on y en place quelquefois une autre, comme celle de la fig. 26. E, est l'empatement de la grue ; F, l'arbre ; G, les bras ou liens en contrefiches ; H, le poinçon ; I, le ranche garni de chevilles ; K, les liens ; L, les petites moises ; M, la grande moise ; N, la soupente ; O, le mamelon du treuil ; et P, la lumière du même treuil.
La fig. 163, est un instrument appelé louve, qui s'engage jusqu'à l'oeil A dans la pierre que l'on doit enlever et poser sur le bâtiment, afin d'éviter par-là d'écorner ses arêtes, en y attachant des cordages, et en même temps afin que les pierres soient mieux posées, plus tôt, et plus facilement ; ce qui produit de l'accélération nécessaire dans la bâtisse. B, est la louve ; C, sont les louveteaux, espèce de coins qui retiennent la louve dans l'entaille faite dans la pierre ; D en est l'esse.
La fig. 164 est un ciseau à louver, d'environ dixhuit pouces de long. M. LUCOTTE.
Articles populaires Science
CONSERVATION
subst. f. (Métaphysique) La conservation du monde a été de tout temps un grand objet de méditation et de dispute parmi les Philosophes. On voit bien que toute créature a besoin d'être conservée. Mais la grande difficulté, c'est d'expliquer en quoi consiste l'action de Dieu dans la conservation.Plusieurs, après Descartes, soutiennent qu'elle n'est autre chose qu'une création continuée. Ils craient que nous dépendons de Dieu, non-seulement parce qu'il nous a donné l'existence, mais encore parce qu'il la renouvelle à chaque instant. Cette même action créatrice se continue toujours, avec cette seule différence, que dans la création elle a tiré notre existence du néant, et que dans la conservation elle soutient cette existence, afin qu'elle ne rentre pas dans le néant. Une comparaison Ve rendre la chose sensible. Nous formons des images dans notre imagination : leur présence dépend d'une certaine opération de notre âme, qu'on peut comparer, en quelque façon, à la création. Pendant que cette opération dure, l'image reste présente : mais sitôt qu'elle cesse, l'image cesse aussi d'exister. De même pendant que l'opération créatrice de Dieu dure, l'existence des choses créées dure aussi : mais aussi-tôt que l'autre cesse, celle-ci cesse aussi.
Lire la suite...