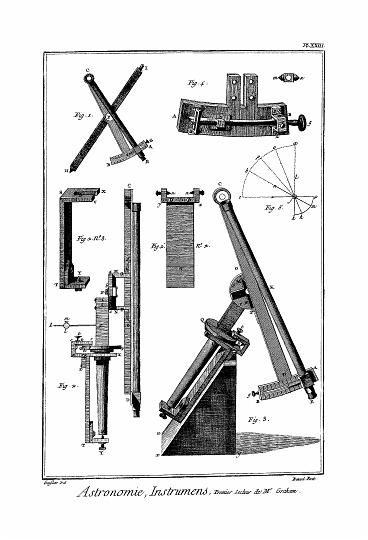S. m. (Arts mécaniques) Il y a un grand nombre de forges différentes : on en trouvera les descriptions aux différents articles des arts et métiers qui s'en servent ; mais en général, c'est un fourneau où l'on fait chauffer les métaux, pour les travailler ensuite. Il faut distinguer dans une forge le massif de la forge, sur lequel l'âtre est placé, la cheminée, la tuyere, l'auge, etc. Voyez ci-après l'article GROSSES FORGES.
FORGES, (GROSSES-) c'est ainsi qu'on appelle les usines où l'on travaille la mine du fer.
La manufacture du fer, le plus nécessaire de tous les métaux, a été jusqu'ici négligée. On n'a point encore cherché à connaître et suivre une veine de mine ; à lui donner ou ôter les adjoints nécessaires ou contraires à la fusion ; et la façon de la convertir en fers utiles au public. Les fourneaux et les forges sont pour la plupart à la disposition d'ouvriers ignorants. Le point utîle serait donc d'apprendre à chercher la mine, la fondre, la conduire au point de solidité et de dimension qui constituent les différentes espèces de fer ; à le travailler en grand au sortir des forges, dans les fonderies, batteries, et fileries ; d'où il se distribuerait aux différents besoins de la société. Le fer remue la terre ; il ferme nos habitations ; il nous défend ; il nous orne : il est cependant assez commun de trouver des gens qui regardent d'un air dédaigneux le fer et le manufacturier. La distinction que méritent des manufactures de cette espèce, devrait être particulière : elles mettent dans la société des matières nouvelles et nécessaires ; il en revient au roi un produit considérable, et à la nation un accroissement de richesses égal à ce qui excède la consommation du royaume, et passe chez l'étranger.
Pour mettre cette partie sous les yeux, en attendant de plus amples connaissances, on a suivi l'ordre du travail et des opérations.
La première regarde les qualités du maître, commis, et principaux ouvriers.
La seconde, la recherche des minières, et disposition des mines.
La troisième, la manière de tirer les mines.
La quatrième, les règlements à ce sujet.
La cinquième, la façon d'en séparer les corps étrangers.
La sixième, les réservoirs et dépense de l'eau.
La septième, l'achat, l'exploitation, l'emploi des bois.
La huitième, le service qu'on tire de l'air.
La neuvième, le fourneau pour gueuses et pour marchandises.
La dixième, la forge.
La onzième, la fenderie.
La douzième, la batterie.
La treizième, la filerie.
On n'entreprend pas de détailler chaque forge en particulier ; il n'est question que d'une description générale d'un travail susceptible de modifications, suivant les circonstances particulières.
ARTICLE I. Du maître. La probité et l'honneur sont les premières choses que tout homme, dans toutes sortes d'états, ne doit jamais perdre de vue. Dans les forges, le danger est prochain. Communément au milieu des campagnes, souvent au milieu des bois, nécessairement environné d'un grand nombre d'ouvriers et domestiques ; il faut veiller pour se garantir des vices qu'engendrent la solitude, la grossiereté des ouvriers, le maniement de l'argent.
Soyez bon voisin, confrère sans jalousie, ami avec discernement ; faites vos achats et vos ventes sans mensonge ; vendez vos denrées en bon citoyen ; distribuez votre argent en bon économe ; veillez au travail ; faites vos fournitures de bonne heure ; ne laissez pas manquer votre caisse.
Il faut à un maître de forges la connaissance de son état, de la santé, de l'ordre, et de l'argent. Comme le gouvernement d'une forge s'étend à beaucoup d'objets différents, un petit détail fera voir les soins et les démarches qu'il demande.
Vous proposez-vous de bâtir, acheter, ou prendre à bail une forge ? Combinez votre santé, votre argent, avec la connaissance du terrain, des héritages voisins, du cours d'eau, des bois, des mines, de la qualité du fer, du débit : voilà le premier pas.
Je dis votre santé, par le travail attaché à cet état : votre argent, pour ne pas trop entreprendre : la connaissance du terrain et des héritages voisins, tant pour la dépense et la solidité de la construction, que pour le danger de se jeter dans des dédommagements ; du cours d'eau, pour lui opposer une force capable de la retenir, ménager des sorties pour l'excédent, et des réservoirs pour le nécessaire : des bois, tant d'affouages qu'en traite, pour savoir sur quoi vous pouvez compter : la connaissance des mines, leur traite, leur produit, la qualité du fer, le débit.
Déterminé sur cette première combinaison, ne perdez point de temps à faire les apprêts nécessaires. Les bois veulent être coupés dans un certain temps, d'une certaine mesure, séchés, dressés, cuits, hébergés dans certaines saisons. Le travail des mines doit être suivi avec la même exactitude : l'intelligence doit surtout s'exercer au fourneau et à la forge, qu'il faut pour cela bien connaître. La vente des fers, ainsi que des autres parties, consiste en trois choses ; à qui, combien, et comment. Je veux dire, connaître les marchands, pour ne point exposer sa fortune ; la valeur des choses et des temps, pour ne point être la dupe ; et prendre garde à ses engagements, qu'on doit remplir en quantité, qualité, temps, et lieu, et aux payements qui doivent être combinés avec le courant des affaires, afin que la caisse ne manque pas.
Une bonne réputation, ce qu'en terme d'art on appelle bon crédit, est bien nécessaire : elle vous donne le choix dans les ouvriers, la préférence dans les bois des seigneurs, souvent dans les usines qui leur appartiennent. Vous aurez ce crédit parmi les ouvriers, par l'égalité entre ceux de la même valeur, le retranchement sans retour et avec éclat des vicieux, la fidélité dans les comptes et payements ; vous l'acquerrez des marchands, par le soin de remplir vos traités : vos voisins de quelque état qu'ils soient, ne pourront vous le refuser, par l'habitude où vous les aurez mis de vous voir remplir votre travail sans ostentation et sans détour.
Il y a entr'autres trois ouvriers auxquels il ne faut donner sa confiance qu'après les avoir bien connus ; le charbonnier, le fondeur, et le marteleur. Comment juger de leurs talents, si on ignore le travail du charbon, de la fonte, et du fer ? Voyez les articles FER et CHARBON.
Quelquefois une affaire est trop considérable par les fonds qu'elle demande ; c'est le cas de choisir un ou plusieurs associés. Les sociétés bien composées sont le nerf, le soutien, l'agrément du commerce : mais nous voyons mille exemples funestes des sociétés où plusieurs gouvernent les mêmes parties, pour une qui finit en paix. Comment trouver dans plusieurs personnes la même exactitude, pour ne pas dire fidélité ? Dans le cas de société, partagez l'affaire ; et que chacun régisse une partie pour son compte.
Il y a des forges auxquelles sont joints des domaines qui fournissent beaucoup de denrées : nous voyons aussi des maîtres qui en achetent pour remettre à leurs ouvriers ; ceux qui le font dans l'idée d'entretenir l'abondance et le bon marché, font bien ; mais le droit de garde et de déchet décele un peu l'envie de gagner. Il est commun que ceux qui fournissent des denrées perdent par la mort ou la fuite des ouvriers : ne pourrait-on pas en soupçonner la raison et la punition ?
Je ne puis finir les qualités d'un maître de forges, sans faire remarquer que celles de sa femme sont essentielles à cet état, et en font souvent le bien ou le mal. Si la paix et l'ordre ne régnent pas dans l'intérieur de la maison, il est impossible de réussir. La paix demande de bonnes mœurs, de la douceur, de la simplicité, de l'ordre, de l'intelligence, du travail, du bon exemple.
Des commis. Avoir une fidélité à toute épreuve ; se connaître bien en bois, en mines ; mieux aux exploitations, au travail des forges et fourneaux ; visiter souvent les denrées, les domestiques, les écuries, les chevaux, les harnais ; savoir tenir les livres, et rendre compte de son travail. Pour tout dire, il faut qu'un commis soit en état de remplacer un maître. Comment espérer de trouver un pareil homme ?
Vous aurez plus aisément pour le fait des mines un principal ouvrier, qui content d'une moyenne rétribution, vous rendra compte du travail ; il faut qu'il soit homme connu, auquel vous donniez l'autorité nécessaire ; et vous veillerez qu'il n'en prenne au-delà.
Pour les bois, élevez vous-même un domestique en qui vous découvrirez quelques dispositions. Une condition avantageuse entretient les gens dans le bien. Si le maître fait ses payements, et qu'il ait des yeux un peu clair-voyans, il est difficîle qu'il soit trompé longtemps, et dans des choses essentielles. Un homme aux mines, un dans les bois, ne vous couteront pas moitié d'un commis. Tenez vos livres, et faites les payements vous-même : si vous ne pouvez, ayez un troisième élève qui remplisse cette partie sous vos yeux.
Des charbonniers. Le devoir particulier d'un charbonnier est de veiller au dressage, tant pour le nettoyement des places à fourneaux, que pour l'arrangement du bois ; faire fouiller et couvrir ses fourneaux dans les temps convenables à la quantité qu'il doit fournir ; ne point manquer à cette fourniture, sans presser aucune pièce ; faire la provision de clayes dans la saison, et relativement à son travail ; savoir gouverner le feu ; le conduire également partout ; se souvenir que jour et nuit, et à proportion des mauvais temps et changements de vent, le travail augmente : point de retard à s'y transporter ; et pour cet effet, tenir le soir ses lanternes prêtes, ses outils toujours en bon état ; avoir de bons compagnons, de bons valets. Un charbonnier chasseur, ou, pour mieux dire, braconnier, est un ouvrier dont il faut se défaire.
Des fondeurs. Les fondeurs sont ordinairement fort mystérieux sur leurs ouvrages ; par-là ils obvient aux questions qu'ils ne peuvent résoudre : ils ne savent que mécaniquement telle ou telle dimension ; ils craignent de multiplier les gens de leur espèce. Il est rare de voir le fondeur d'une province qui emploie certaines espèces de mines réussir dans une autre province avec des mines différentes : il faudrait donc qu'un fondeur connut parfaitement les dispositions de chaque mine, le nettoyement, le mélange, l'arbuè, la castine, et les opérations intérieures des fourneaux. Les mines, au sortir des lavoirs, doivent spécialement regarder le fondeur ; elles devraient être préparées d'avance pour qu'il put régler son ouvrage en conséquence : c'est à lui à présider au bâtiment des parois et de l'ouvrage ; examiner les matériaux qu'on y emploie ; connaître ceux qui résistent au feu ; dresser les soufflets ; être instruit de la quantité des charbons ; bien diriger et entretenir sa thuyere ; distinguer aux crasses et au feu les altérations ou indigestions de l'intérieur ; et savoir les remédes convenables. Ils ont ordinairement sous eux des garde-fourneaux, dont le métier est de conduire le fondage, et qui, à l'ouvrage près, qu'ils ne sont pas censés savoir, doivent avoir toutes les connaissances d'un fondeur, et y joindre beaucoup de soin et d'activité. Il est étonnant qu'on ne se soit pas encore avisé d'établir une école de fondeurs : d'habiles maîtres, avec la dépense des expériences, rendraient un service essentiel, en diminuant la consommation des bois ; et on jouirait de fondeurs qui sauraient les raisons de leur travail.
Des marteleurs. Les marteleurs sont une classe d'ouvriers qui devraient être instruits, laborieux, fidèles et doux. L'ouvrage particulier d'un marteleur regarde les foyers ; ce qui suppose la connaissance de la fonte qu'il a à employer : il doit aussi bien connaître l'équipage du marteau, parce que cette partie le regarde seul, et que les autres ne sont que comme des bras qu'il fait mouvoir. Dans les forges où l'on se sert de marteaux et hurasses de fer, il doit en savoir la fabrication, en préparer ou réparer dans les eaux basses, pour ne pas retarder le travail. Chargé de tous les outils, il doit les entretenir, les renouveller et n'en jamais manquer. Sa fidélité doit être grande, par le maniement des matières fabriquées ; qu'il réponde à sa supériorité sur les autres, à l'exemple qu'il leur doit, à la confiance que le maître a nécessairement en lui ; il doit surtout entretenir le bon ordre et une sévère discipline dans son atelier. Il lui faut beaucoup de douceur et de fermeté dans le besoin.
ARTICLE II. De la recherche des mines et de leur disposition. Rien de si commun que les mines de fer, et de si varié : figure, couleur, mélange, profondeur, inégalité presque par-tout différentes ; elles feront toujours un sujet nouveau de recherches. Rien n'est d'un usage si nécessaire que le fer : tout le monde s'en sert : tout le monde croit le connaître, nous le voyons journellement naître et périr ; et quand il est question d'approfondir ce que c'est que mines, ce que nous faisons constamment avec certaines méthodes, devient par sa constitution élémentaire, impénétrable.
Quand nous comparons quelques livres de mine brute avec un ressort de montre ; que nous considérons toutes les opérations que ce ressort a dû essuyer, la combinaison et l'industrie dont ces opérations ont été accompagnées, qui ne croirait que l'homme connait l'essence de la mine ? Cependant il n'en est rien ; c'est un des effets ordinaires de la Providence, qui laisse à notre portée ce qui est nécessaire à nos besoins, et qui dérobe à nos recherches le principe des choses. Le philosophe et l'artiste en sont réduits à quelques raisonnements et expériences, desquelles ils déduisent la manière la plus utîle d'employer les choses.
Voyez à l'article FER, ce que c'est que la mine de fer. Nous ne connaissions pas la façon de convertir tous les fers en acier du dernier degré. Les fers differents entr'eux ; ce serait un grand malheur qu'ils fussent tous égaux ; nos besoins ne le sont pas.
Bien des gens étonnés de la prodigieuse quantité de fer qui se fabrique annuellement dans les mêmes endroits, demandent si les mines se reproduisent. Cela arrive dans le sens que des particules de mines en poussière, rassemblées par toutes les causes qui mettent le corps en mouvement, les dirigent en un même lieu, les appliquent les unes aux autres, en forment de petites masses, peuvent être rassemblées, et avec le temps donner des morceaux ou grains assez pesans pour être employés. Il est encore commun, proche et dans les minières, de trouver des pierres remplies de parties de mines qu'on abandonne à cause de sa solidité et de la quantité de corps étrangers. La gelée dans les corps solides comprime si fort les ressorts de l'air qui cherchent à se détendre, que des matières très-compactes ne peuvent y résister. La chaleur dilatant les mêmes ressorts, occasionne le même effet : d'où il s'ensuit que ces pierres qui ne sont qu'un mélange de mines et castine, jointes par une partie d'argile, sont aisément mises en poussière par la compression ou dilatation de l'air. Les parties de mines qui ont résisté à cette dissolution appelée macération, sont d'un bon service. Par-tout où il y a des mines en poussière, ou des pierres exposées à l'air, remplies de parties de mines, le temps peut renouveller une minière utile.
On trouve des parties de mine répandues partout, même jusqu'au sommet des plus hautes montagnes, toujours du côté du midi, aux environs des minières et des fourneaux, quoique la fouille dans l'intérieur n'en donne point. C'est un phénomène qui demande des éclaircissements, et qui a souvent occasionné bien de la dépense et du travail, à des gens qui n'ont jamais voulu comprendre que l'air seul peut en porter beaucoup en petites parties, et que ces petites parties peuvent être rassemblées par des agens naturels en une ou plusieurs fort grosses.
Ces parties de mine que j'appelle accidentelles peuvent se connaître de plusieurs façons. La première, c'est de se rencontrer dans des lieux élevés et disposés à ne pouvoir être regardés comme l'écoulement d'une minière. La seconde, c'est que les morceaux en paraissent purs ou mélangés : purs, la couleur en est d'un rouge foncé ou noirâtre ; la figure extrêmement rameuse, plate ou anguleuse, ce qui fait voir qu'ils n'ont pas fait beaucoup de chemin ; la masse très-souvent creuse, ou avec quelques marques d'ébullition, parce que n'ayant pu se rassembler que par le mouvement et dépôt de l'air, et la jonction de l'eau, il y a dilatation, boursoufflement, quand la contexture est solide ; ou crevasse, quand la liaison n'est pas assez nerveuse : mélangés, les corps qui feront l'alliage seront semblables à ceux du terrain où on les trouvera.
Ces parties de mine accidentelles peuvent encore venir des orages qui laissent le terrain à découvert, et de la sublimation que la chaleur peut faire ; ce qui fortifie cette conjecture, c'est que nous voyons des sommets de montagnes sur lesquels on ne trouve des parties de mine rassemblées, que du côté le plus exposé au soleil, et des campagnes entières qui en sont couvertes.
La connaissance des mines de fer qui sont à la surface de la terre, ou qui en sont proches, est chose aisée à des yeux exercés et clairvoyans. Quant à celles qui s'éloignent de la surface de la terre, il faut user de grandes précautions pour ne pas courir les risques d'une infructueuse dépense. Mais on sera éclairé par la force de l'eau qui entraîne, un tremblement de terre qui détache, un feu souterrain qui se fait jour, l'examen des autres matières concomitantes, et la ressemblance des terrains qui fournissent des minières connues. L'eau, l'air et le feu sont les agens qui donneront des idées sur l'intérieur de la terre. L'eau entre autre peut nous découvrir des mines de plusieurs façons ; par une éruption violente qui entraîne des parties de montagnes, des rochers ; qui creuse des profondeurs, des abîmes ; qui dans la force de son courant, mêle et confond tout ce qu'elle charrie ; qui en se ralentissant dépose suivant certaines lois ; qui coulant sous la terre, quoique quelquefois assez tranquillement, mais pendant des siècles, ronge et entraîne des parties de mine qu'elle met à découvert ; ou qui après s'être excavé un bassin plus grand, fait perdre l'équilibre à la voute, et occasionne un effondrement. L'air extérieur en déposant, le feu en soulevant, donnent aussi lieu à la découverte de matières nouvelles.
Si l'on rencontre quelques parties de mine, la première attention est de bien examiner si ce ne sont point des mines accidentelles ; ensuite voir si par la forme du terrain elles peuvent être venues de loin ; leur figure, la matière qui les accompagne, doivent vous décider. Si vous prévoyez qu'elles ne soient pas venues de loin, faites une ouverture proche le premier enfoncement, et du côté du nord ; pour en régler la profondeur, voyez si la couche des pierres et des autres matières indique quelque dérangement ; poussez tant que vous aurez lieu d'en soupçonner un, puisque nous disons que ces parties de mine doivent venir d'une éruption ou d'une excavation, quoique tout paraisse presque rempli : mais quand vous trouverez les choses gissantes dans un état naturel, sans rencontrer ni l'espèce de glaise qui accompagne ordinairement la mine, ni aucunes parties de mine mêlées avec les pierres ou autres matières, abandonnez le travail, du moins dans nos contrées.
Pour trouver la minière dont l'eau aura entrainé des parties, représentez-vous par l'inspection du terrain, le cours que l'eau a dû faire naturellement : dans un coude vous en trouverez de l'entassée, mais selon la position conforme à l'angle qu'a décrit l'eau ; concluez des couches de différentes matières, que ce n'est qu'une alluvion ; suivez, et de temps en temps vous rencontrerez de petits puits remplis de mines mêlées avec d'autre matière ; plus loin des amas plus gros ; et à la fin, et surtout par l'inspection des lieux, vous déterminerez de quel côté vient l'écoulement, ou lequel a essuyé l'écoulement. Arrivé à ce point, ne vous flattez encore de rien : l'eau a peut-être entrainé toute la veine de mine, ou la partie qui reste se trouvera défendue par des rochers, ou engloutie dans les eaux. Ces observations au moins vous mettront à l'abri d'un travail inutîle ou mal entendu.
Dans le cas où vous aurez lieu d'espérer que vous êtes arrivé à la minière, et qu'elle peut être ouverte sans trop grands frais, employez d'abord la sonde ; si elle ne suffit ou ne convient pas, il ne faut pas hésiter de travailler plus haut, en tirant au nord, que le dérangement que vous entrevoyez : ne faites d'abord qu'un trou cylindrique ; un tour enlève les déblais : examinez si vous êtes bien au-dessus des eaux ; avec deux bons ouvriers, en peu de temps et sans grande dépense, vous devez trouver la mine. Enlevez le matin les eaux que la suinte de la terre aura rassemblées pendant la nuit. Si l'excavation vous occasionne une plus grande abondance d'eaux, vous trouverez à la traite des mines, la façon de vous en débarrasser.
La recherche que nos besoins nous font faire de toutes espèces de matières, a quelquefois fait découvrir des mines de fer ; mais on en a plus communément l'obligation à la ressemblance d'un terrain qu'on voit, qu'à celui où il y a déjà des minières ouvertes : mais pour cela il faut des yeux accoutumés et intelligens.
De-là on peut conclure que l'incertitude et la dépense de pareilles recherches, doivent engager un maître qui veut prendre une forge, à bien savoir où il trouvera des mines. Je conseillerai toujours les tentatives faites avec réflexion ; mais elles ne doivent aller qu'au mieux de la chose. Réussissez-vous, vous êtes récompensé ; ne réussissez-vous pas, vous avez recours aux minières, sur lesquelles vous deviez compter.
Comme il serait avantageux pour la société, que les traces de mines fussent suivies quand on les découvre, et que l'on prit des précautions pour qu'on put toujours les retrouver, le plus expédient serait que les maîtres de forges fissent toutes les tentatives convenables selon une grande probabilité, et que sur leurs mémoires les seigneurs fissent les tentatives couteuses : mais où trouver un maître de forge qui pense au bien public, et un seigneur qui tente un bien à venir ?
Nous devons toujours être étonnés de voir en combien de façons la nature s'est diversifiée dans la partie des mines de fer. Sans entrer dans le détail des variétés infinies qui naissent des différents alliages, nous chercherons à nous en faire une distinction par les combinaisons des choses que nous y connaissons, et qui peuvent nous diriger dans leur travail. Il y a des pierres, des terres et du fer pur, avec son phlogistique. Les pierres et les terres sont ou apyres, ou calcaires, ou vitrescibles. Combinez toutes ces substances de toutes les manières possibles avec le fer pur, et vous aurez autant de mines à traiter diversement.
Ces corps joints à la mine sont ou terre seule, ou terre et pierre également ; ou beaucoup de terre et peu de pierres accrochées faiblement ; moins de terre et plus de pierres liées très-étroitement ; ou pierre très-solide, jointe très-fortement à la mine. La distance de chaque degré est remplie d'une infinité de modifications, par les différentes espèces de terre, de pierre, leur mélange, leur adhésion, leur figure : de-là les différentes couleurs, formes, difficulté à la fusion.
La terre qui fait ordinairement corps avec une mine propre à la fusion, est communément remplie de parties calcaires ou argilleuses ; la pierre, de parties vitrescibles et apyres : les unes et les autres combinées sont fusibles.
Nous appelons arbue et castine, les deux substances ou fondants que nous employons spécialement à la fusion des mines.
Vous discernerez l'arbue du meilleur usage, lorsque l'espèce d'argile, connue dans les forges sous ce nom, n'est point mélangée d'autres corps ; qu'au toucher elle est douce ; que la couleur n'en est point d'un rouge trop foncé ; que pétrie avec peu d'eau elle devient bien compacte, seche à l'ombre sans crevasse, et résiste longtemps au feu. L'arbue que la charrue a travaillée est la plus nerveuse, la plus douce et huileuse, soit parce que les plantes ont pompé une partie des sels, soit que le soleil et la végétation ne laissent que les parties les plus nerveuses des engrais, comme moins propres à la sublimation. L'attraction des parties de certains fumiers la rendent plus grasse, plus compacte, plus tenue, et par conséquent plus en état de résister au feu.
La bonne castine se connait aisément au microscope, par toutes les parties qui en sont transparentes et propres à la calcination. Ne vous y trompez pas, et ne prenez pas pour de la castine des pierres qui portent des grains brillans, et réfléchissant la lumière comme le grès. L'arbue qui, mêlée à la mine, résiste le plus longtemps au feu, et la castine qui cause le plus aisément la fusion, sont de la meilleure espèce ; l'arbue se connait à sa vitrescibilité ; la castine, à sa nature calcaire.
Il est innombrable de voir combien il y a de diversité dans l'arbue et dans la castine ; elle est aussi grande, que la possibilité d'être mélangée avec différentes matières. Dans un siècle où tous les Arts sont honorés, enrichis des lumières des savants, ne s'en trouvera-t-il point un qui daigne tourner son travail sur les manufactures des fers, où il y a tant à rectifier ? C'est une vieille matière toute neuve à traiter ; ce qui serait peut-être déjà arrivé, si le fer ne naissait que dans le Pérou. Que d'obligations n'aurait-on pas à une analyse des différentes mines, arbue et castine, qui déterminât exactement les degrés de chaleur et de mélange ? Nous sommes réduits à aller en tâtonnant ; si chaque pays produisait également et séparément la mine, l'arbue et la castine, on pourrait établir par les faits connus, des règles fondées sur des mélanges uniformes ou gradués.
Mais une observation importante, soit pour l'éclaircissement de cet article, soit pour l'intelligence des maîtres de forge, qu'on sera dans le cas de consulter ; c'est que la nature des matières, telles que la castine et l'arbue qu'on mêle aux mines, soit pour les rendre fusibles, soit pour donner de la qualité aux fers, peut varier à l'infini ; et que par conséquent le seul moyen d'avoir des idées réelles, c'est de prendre ces substances, et d'en faire l'analyse chimique : c'est ainsi que nous nous sommes assurés que la castine dont on parle dans cet article est une pierre calcaire ; et l'arbue un mélange vitrescible d'argille, de glaise, de terre calcaire, et d'un peu de fer.
ART. III. Manière de tirer les mines. Nous avons dit que les corps joints à la mine étaient terre seule, première espèce ; terre et pierre en petits volumes également, deuxième ; beaucoup de terre et peu de pierre accrochées faiblement, troisième ; moins de terre et plus de pierre liées plus étroitement, quatrième ; pierre très-solide jointe très-fortement à la mine, cinquième : ces différentes espèces sont ou sur la surface, ou dans certaine profondeur de la terre, ou exposées à beaucoup d'eau.
Si elles sont proches la surface de la terre, la traite en est aisée ; et pour les trois premières espèces, il n'y a autre chose qu'à les séparer en les tirant des terres qu'on voit n'en être point imprégnées, et à les voiturer sur les ateliers destinés à les nettoyer.
La quatrième espèce demande plus de précaution, soit en laissant sur l'attelier les plus grosses pierres, détachant les parties de mine mêlées de terre, ou laissant le tout ensemble. Si les pierres sont fort chargées de mine, ou que ces pierres soient en grande quantité, sans être en trop gros volume, elles seront portées à l'attelier convenable.
La cinquième espèce sera tranchée dans les bancs comme la pierre dans les carrières, cassée à bras d'homme et coups de masse en morceaux de trois ou quatre livres, et de-là voiturées à l'attelier destiné à faire le reste de la division. Il y en a d'assez riches dont il ne faut que réduire les morceaux en d'autres morceaux plus petits, et qu'on porte ainsi au fourneau. Quand les bancs sont extrêmement solides, ainsi que nous le supposons ; comme il n'est pas essentiel d'avoir des morceaux tranchés nettement, et d'une telle dimension, vous avancerez l'ouvrage en vous servant, lorsque le banc sera découvert au-delà d'un déjoint, s'il y en a, d'un morceau de fer rond d'environ un pouce de diamètre, finissant en langue de serpent, bien acéré, aiguisé, et trempé, de la longueur d'un pied. Il faut être muni d'un compagnon, d'un maillet de bois, de sable en poudre et d'eau ; l'un tient le foret, verse un peu d'eau et de sable ; et l'autre touche à petits coups, ayant soin de changer la position du tranchant, en se relayant l'un l'autre : en très-peu de temps vous aurez un trou cylindrique de la profondeur que vous souhaitez. Ce trou ou plusieurs, pour un plus grand effet, s'emplissent de poudre à canon au tiers, l'ouverture se ferme avec une cheville de bois chassée fortement, dans laquelle on perce un petit trou pour loger une meche lente à bruler, ou de la poudre humectée, pour avoir le temps de se retirer : bien-tôt vous aurez une grande quantité de quartiers détachés, et deux hommes en fourniront ainsi plus que dix à trancher.
Si les mines sont à plusieurs degrés de profondeur, pour tirer celles des trois premières espèces, pratiquez des trous cylindriques de quatre pieds de diamètre ; ayez un tour, un câble, des paniers, et deux hommes à chaque ouverture, ils viendront aisément à-bout de ce travail ; ils changeront d'occupation une ou deux fois le jour, et en peu de temps ils arriveront à la mine. Si le banc est assez épais, pour y entrer, ils feront plusieurs galeries, laissant de bons et forts piliers ; iront au loin chercher la mine avec des brouettes, et la conduiront au milieu du puits pour la tirer avec le tour, jetant dans les galeries vides les pierres et autres corps étrangers.
Il y a des minières où au bout de quelques années, toutes les galeries vides s'effondrent, ce qui est aisé à connaître ; alors il n'y a aucun danger de tirer les piliers qui deviendront alors galeries.
Quand les mines ne sont pas bien à fond, on se contente de faire une ouverture carrée fort large ; descendu de quelques pieds, on ménage un repos ; arrivé à la mine, l'ouvrier du bas jette la mine sur le repos, et son compagnon du repos la jette sur le sol.
Les minières en roches solides demandent une ouverture beaucoup plus grande pour la commodité du travail ; il faut armer le cylindre du tour d'une roue très-élevée, afin de se procurer de plus longs leviers, et enlever les plus gros quartiers, qu'on travaille plus aisément dehors. On conçoit que dans les mines en roche, l'effondrement est moins à craindre que dans les autres, et que la solidité doit régler la largeur des galeries et l'épaisseur des piliers.
Il est difficîle dans les mines à fond de n'avoir pas à vider au moins les eaux de la suinte de la terre ; mais il peut arriver qu'en n'y travaillant que dans les saisons les plus seches, le tour et les seaux suffisent pour en débarrasser : sinon il n'y a pas à hésiter, il faut établir une ou plusieurs pompes. Voyez POMPE. Pour cet effet vous ferez un puits assez large pour la placer, et pour travailler sans être gêné : si le bassin de la pompe est beaucoup plus profond que la minière, les eaux s'y rendront de toutes les galeries. Quand on en est réduit-là, il ne faut pas espérer de travailler, ni pendant les pluies et les fontes de neiges, ni pendant les fortes gelées : choisissez le temps le plus sec, moitié de l'été et moitié de l'automne, et assurez-vous d'un assez grand nombre d'ouvriers pendant ce temps, pour faire vos provisions pour l'année. N'oublions pas de dire qu'il y a des minières, au fond desquelles il se trouve un banc de marne, sous lequel passe l'eau, que la marne tient si fort comprimée ; que si vous avez l'imprudence de le percer, vous vous jetterez dans un épuisement dont vous ne pourrez venir à-bout qu'à grands frais, ou qui vous forcera à abandonner le travail : il faut alors examiner si on ne pourrait pas ouvrir une galerie de côté, qui par sa pente débarrassât de toutes les eaux.
ART. IV. Droits sur la mine et règlements. On distingue le droit sur les mines et celui sur la traite, parce que le premier appartient au domaine de la couronne, et le second aux propriétaires des héritages où se trouvent les minières. La confusion que mettent ceux-ci dans leurs prétentions à ce sujet, donne lieu journellement à des contestations, et occasionne des décisions de cours souveraines opposées entr'elles : quelques-unes même paraissent s'éloigner des intérêts du roi et du bien public. Pour jeter quelque lumière sur cette partie, il faut jeter l'oeil sur les ordonnances qui distinguent clairement le droit du roi, celui du public, et celui du propriétaire.
Le règlement au sujet des mines, de Charles VI. du 30 Mai 1413, rappelant ceux des rois prédécesseurs, confirmé par Louis XII. le 20. Novemb. 1498, et par François premier en Décembre 1515, est conçu en ces termes : " Avons, par manière d'édit, statut, loi ou ordonnance royale, irrévocable, dit, décerné et déclaré.... que nul seigneur spirituel ou temporel, de quelque état, dignité ou prééminence, condition ou autorité, quel qu'il sait, en notredit royaume, n'en aura ne doit avoir, à quelque titre, cause, occasion quelle qu'elle sait, pouvoir ne autorité de prendre, reclamer ne demander esdites mines, ni en autres quelconques, assises en notredit royaume, la dixième partie, ni autre droit de mines, mais en seront par notredite ordonnance et droit, forclos ; car à nous seuls, et par le tout à cause de nos droits et majesté royaux, appartient la dixième et non à autres.... Voulons.... que les hauts-justiciers, moyens et bas, sous quelque juridiction et seigneurie que lesdites mines soient situées et assises, baillent et délivrent auxdits ouvriers, marchands et maîtres desd. mines, moyennant et par payant juste et raisonnable prix, chemins et voies, entrées, issues, par leurs terres et pays, bois, rivières, et autres choses nécessaires auxdits faisants l'œuvre et ouvriers, lieux plus profitables pour l'ouvrage faire, et le moins dommageable pour lesdites seigneuries.... Voulons.... que tous mineurs et autres, puissent querir, ouvrer et chercher mines par tous les lieux où ils penseront en trouver, et icelles traire et faire ouvrer, payant à nous notre dixième franchement, et en faisant certification ou contenter à celui ou à ceux que lesdites choses seront ou appartiendront au dire de deux prudhommes.... Que dorénavant les marchands, maîtres faisant l'œuvre, et lesdits ouvriers qui esdites mines ouvrent et s'occupent, et font résidence sur le lieu du martinet, ou mines, ou leurs députés pour eux, auraient.... un juge, bon et convenable commissaire, et tel comme nous leur ordonnerons, lequel connaitra et déterminera de tout cas mu et à mouvoir, qui esdits marchands, maîtres et ouvriers pourra toucher, et auxquels seront baillé nos ordonnances ".... S'ensuit la franchise des tailles et autres subsides, avec défenses de molester les mineurs du royaume ".... " Considérez qu'ils vaquent continuellement au bien de nous et de la chose publique "....
Ordonnance d'Henri II. du 30 Septembre 1548... " Avons aussi permis et permettons, qu'il puisse prendre aux lieux plus prochains qui lui sembleront être propres à ce, tant terres, héritages, ruisseaux, en les payant raisonnablement aux propriétaires, ou le dommage et intérêt qui leur serait fait pour le regard de la valeur desdites terres seulement, et non des mines y étant "....
Dans celle donnée à Reims le 10 Octob. 1552.... " N'entendons ni ne voulons, les ouvrages desdites mines ou minières, être retardés, ains continués, et notre droit de dixième être mis à part.... de la recette duquel ils seront crus sur leur livre ordinaire, et serment sur ce fait ".... Ces ordonnances regardent entr'autres le fer, puisque plus bas il est dit :... " Quant aux autres métaux, comme cuivre, étain, plomb, potin et fer en fontes communes, duquel fer ne prendront qu'un dixième de celui qui sera tiré sur nos terres et seigneuries.... sans que lesdits propriétaires puissent prétendre aucun droit esdites mines, et demander autres intérêts que la récompense des terres, superficie ou incommodité d'icelles ; encore qu'en icelles lesdites mines soient tirées.... quoique soit après que pardevant notaire ou justice, il aura actuellement et à deniers découverts, fait offre aux propriétaires de leur récompense, telle qui sera arbitrée par gens à ce connaissants, à faute d'accorder par eux et icelle consignée "....
Extrait de l'ordonnance de François II. du 29 Juillet 1560.... " En s'accommodant avec ceux à qui appartiendront lesdits héritages, et les satisfaisant de gré à gré suivant l'avis et estimation de gens experts et arbitres de juges, sans toutefois que ledit prix s'en puisse aucunement augmenter pour raison de l'utilité qui se pourra tirer à cause desdites mines "....
Autres ordonnances de Charles IX. du 6 Juillet 1561, 26 Mai et 25 Septembre 1563, de Henri III. du 20 Octobre 1574, confirmative des précédentes,
Edit d'Henri IV. du mois de Juin 1601.
Article I. " Nous avons confirmé et approuvé, et par ces présentes confirmons et approuvons lesdits édits et déclarations de point en point, selon leur forme et teneur, pour, suivant iceux, notredit droit être payé franc et quitte, pur et affiné en toutes lesdites mines ".
Article II. " Sans toutefois comprendre en icelles les mines de soufre, salpetre, de fer, lesquelles, pour certaines bonnes et grandes considérations, nous en avons excepté, et par grâce spéciale exceptons en faveur de notre noblesse, et pour gratifier nos bons et fidèles sujets, propriétaires desdits lieux "....
Ordonnance de Louis XIV. du mois de Juin 1680, qui évalue les droits du roi à 3 sols 6 d. par quintal de mine de fer, 8 s. 9 d. par quintal de fonte en gueuse, et à raison de 13 s. 6 d. par quintal de fer.
L'article 9. dit " que ceux qui ont des mines de fer dans leurs fonds, seront tenus à la première sommation qui leur sera faite par les propriétaires des fourneaux voisins, d'y établir des fourneaux pour convertir la matière en fer ; sinon permettons au propriétaire du plus prochain fourneau, et à son refus aux autres propriétaires des fourneaux de proche en proche, et à ceux qui les font valoir, de faire ouvrir la terre et d'en tirer la mine de fer, en payant aux propriétaires des fonds, pour tout dédommagement, un sou par chaque tonneau de mine de cinq cent pesant "....
De cette succession d'édits, règlements, ordonnances, il est aisé de conclure,
1°. Que le premier mobîle du cœur des rois est le bien de leurs sujets. Charles VI. VII. VIII. Louis XII. François I. Henri II. François II. n'ont fait qu'augmenter les privilèges, quitter une partie des droits de leur domaine, établir des juridictions particulières, des exemptions, immunités, pour la fouille des mines : considéré que les entrepreneurs et ouvriers vaquent continuellement au bien de nous et de la chose publique. Le public est préféré à leur intérêt particulier, puisqu'ils quittent partie de leurs droits.
Henri IV. confirme et approuve les déclarations de ses prédécesseurs ; l'exception qu'il fait des mines de fer et quelques autres, est fondée sur de bonnes et grandes considérations, c'est une grâce spéciale réservée pour sa noblesse et ses bons sujets, propriétaires des lieux. Le manufacturier et ses ouvriers sont toujours dans les mêmes privilèges ; il n'y a que l'emploi des revenus du roi de changé.
Louis XV. n'a-t-il pas de nos jours gratifié des revenus de cette partie de son domaine, par ses lettres patentes du 6 Aout 1719, le sieur Marcin de Saint-Germain, par un privilège de vingt années d'exploitation de mines de fer, dans une certaine étendue ? avec quelle confiance les manufacturiers, qui cherchent le bien public dans leur travail, ne peuvent-t-ils pas après cela espérer le renouvellement des privilèges, et une disposition favorable aux plaintes qu'ils sont en droit de faire, tant contre certains propriétaires qui amplifient leurs droits, qu'à l'occasion de certains arrêts de cours souveraines, qui n'ont pu être uniformes, l'art. 9 de l'ordonnance de 1680 n'ayant point prévu les abus survenus depuis ?
2°. Les déclarations et édits prouvent que les minières de fer appartiennent au domaine du roi ; que le droit est d'un dixième, qui se perçait actuellement sur les fontes en gueuse ou travaillées, suivant l'évaluation qui en a été faite au conseil. Il ne convient pas à un bon citoyen de raisonner sur un tarif que le roi a lui-même rédigé ; et si je fais la réflexion que le droit du domaine étant du dixième, la marque des fontes valant aujourd'hui cinq livres cinq sous par mille, il s'ensuivrait que les fontes devraient valoir 52 livres 10 sous le mille ; c'est pour blâmer hautement ceux qui ne regardent que leur intérêt particulier, sans entrer dans ceux de l'état. N'est-on pas en droit de leur répéter les raisons d'Henri IV ?
3°. Toutes les anciennes ordonnances disent que les propriétaires des fonds doivent être dédommagés. Charles VI. VII. VIII. Louis XII. François I. " faisant certification ou contenter à celui ou à ceux à qui les choses seront et appartiendront, au dire de deux prudhommes ". Henri II. " sans que les propriétaires puissent prétendre aucun droit esdites mines, et demander autre intérêt que la récompense des terres, superficie, ou incommodité d'icelles, lesdites mines soient tirées.... François II. " en satisfaisant les propriétaires de gré à gré, suivant l'avis et estimation de gens experts et arbitres de juges, sans toutefois que le prix s'en puisse aucunement augmenter pour raison de l'utilité qui se pourra tirer à cause desdites mines ". Confirmation pareille d'Henri II. et d'Henri III. celle d'Henri IV. ne regarde que son droit personnel, que sa conduite ordinaire lui fait réserver pour faire le bien, confirmant les autres dispositions.
L'ordonnance de 1680 parle bien aussi de la traite des mines et du dédommagement des propriétaires, mais en fixe le prix d'une manière si concise, qu'elle ne tire pas les propriétaires et les manufacturiers de bien des inconvénients ; je pourrais même dire les juges. La preuve en est acquise par les arrêts souvent opposés entr'eux et à l'ordonnance.
Si l'article neuvième n'est pas rédigé suivant l'intention du roi ; ou bien, et c'est la même chose, s'il nous jette dans des embarras dont les juges mêmes ont peine à nous tirer d'une façon uniforme, ne pouvons-nous pas dire que cet article a besoin d'interprétation, explication, ou réformation ?
Ne perdons pas de vue que le bien public et l'intention du roi sont la même chose, sauf son droit et celui d'autrui.
Le droit du roi ne fait aucune équivoque ; celui d'autrui n'est pas de même. L'article neuvième dit que ceux qui auront des mines de fer dans leurs fonds seront tenus, à la première sommation qui leur sera faite par les propriétaires des fourneaux voisins, d'y établir des fourneaux pour convertir la matière en fer. Ne croirait-on pas de-là pouvoir conclure que dans le cas où le propriétaire bâtirait un fourneau en vertu de sommation, il faudrait qu'il le bâtit sur son propre fonds, même sur la minière, et que cet article seul lui donnerait le droit de bâtir, pendant que le roi s'est réservé de donner des lettres-patentes à ce sujet ? Ne croirait-on pas encore que plusieurs fourneaux voisins seraient en droit, en vertu de sommation, de tirer concurremment ? mais la suite de l'article donne le privilège au plus prochain fourneau : comme si la bonté du roi et le bien public pouvaient être mesurés par l'éloignement d'un terrain. Voilà la source d'une infinité de procès, au moyen desquels les fourneaux les mieux approvisionnés de bois ont manqué de mines.
Cette clause fait encore dépendre deux ou trois bons fourneaux d'un seul médiocre et chétif, qui ouvrira plusieurs minières pour faire valoir son droit, n'en tirera que la partie la moins couteuse, et privera le public de l'abondance.
En payant, dit la fin de l'article, aux propriétaires des fonds, pour tout dédommagement, un sou par chaque tonneau de mine de cinq cent pesant. Ces derniers mots sont totalement contraires aux droits du roi, et font la seconde source des contestations.
Ne sommes-nous pas convaincus que les minières appartiennent au roi, et que le droit sur les mines est un droit de son domaine ? N'avons-nous pas prouvé que les rois ne l'ont jamais abandonné que pour un temps, et comme une récompense aux entrepreneurs, ou réservé pour la noblesse, ou leurs bons et fidèles sujets ? De faire payer la traite de mines au poids, n'est-ce pas faire payer conséquemment à l'épaisseur de la minière ? c'est donc aller contre le droit domanial, qui d'ailleurs est payé sur les fontes.
La mine n'appartenant point à un particulier, qu'il n'apparaisse une concession faite par le roi, son héritage ne peut donc être mesuré que par la superficie et non la profondeur de la mine, sans que le prix, dit François II. s'en puisse aucunement augmenter pour raison de l'utilité qui se pourra tirer à cause desdites mines. Henri II. " sans que les propriétaires puissent prétendre et demander autre intérêt que la récompense des terres, superficie ou incommodité d'icelles ". Le payement au tonneau tombe précisément sur la minière, et en cela est contraire aux droits du roi ; et le payement relatif à la superficie est vraiment le droit du propriétaire.
Avec une preuve si décisive, examinons les abus dans lesquels précipite cette façon de payer.
Comment s'arranger pour le poids ? Sont-ce les mines qu'on doit peser ? Sont-ce les terres à mines, sur lesquelles il y a un déchet de plus de deux tiers ? Le propriétaire se fait payer sur les terres à mines, malgré un arrêt du conseil du 6 Septembre 1727, qui ordonne que le droit de 3 s. 4. den. par quintal de mine, ne sera levé à la sortie du royaume que sur les mines lavées et préparées ; et au cas de sortie de mines brutes et terres, que le droit en sera payé sur le pied de l'estimation qui en sera faite de gré à gré, ou par experts ou gens à ce connaissants, dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office par le juge de la marque des fers, auquel la connaissance en appartient.
Qui fournira les poids, mesures, et gens nécessaires pour un travail inutîle ?
Perdra-t-on un beau temps précieux pour l'approvisionnement d'un fourneau, en s'amusant à remuer et peser un monceau de mines ?
En payant relativement à la mine, les maîtres des forges les tirent très-superficiellement ; au lieu qu'ils feraient la dépense d'excavation et d'épuisement, s'ils ne payaient que relativement à la superficie du terrain. Cette façon de travailler leur fait boucher des trésors, qu'il faut des siècles et des dépenses extrêmes pour retrouver.
Il serait aisé de prouver que tel journal a produit au propriétaire vingt fois la valeur du fonds, dont il a toujours la possession... Qui osera dire que ce sait-là l'intention du roi ?
Le parlement de Bourgogne, pays où il y a beaucoup de forges, a bien senti l'embarras du payement au poids, et a pris sur lui de rendre un arrêt contradictoire qui détermine une façon encore plus préjudiciable aux maîtres des forges, contre la disposition de l'ordonnance. Le voici :.... " maintient le sieur Boyer, et quelques-autres maîtres de forges, qui étaient parties intervenantes, dans le droit et la possession de tirer des mines de fer dans les fonds et héritages où il s'en trouvera, en payant pour tout dédommagement un sol par tonneau de mines brutes et non lavées, pour le payement desquelles les propriétaires des fonds à mines et les maîtres des forges se régleront de gré à gré entr'eux ; sinon qu'à l'avenir les parties conviendront d'experts, pour reconnaître au pied cube la quantité de mines brutes et non lavées qui aura été tirée dans lesdits creux ; pourquoi lesdits maîtres des forges ne pourront faire aucun changement dans lesdits creux, jusqu'à ce que ladite reconnaissance ait été faite ; après laquelle ils seront tenus de rejeter dans lesdits creux les terres qui en auront été tirées, après que toute la mine en aura été enlevée ; sauf auxdits propriétaires des fonds d'achever de remplir lesdits creux, et de remettre leurs héritages en culture, sans que les maîtres des forges puissent être tenus à aucun dédommagement, soit de rétablissement en état de culture, ou par non-jouissance des fonds, que le sol par tonneau de mines brutes et non lavées ; sans cependant qu'il leur soit permis de préjudicier à la culture des terres ".
Dans cet arrêt on a perdu de vue 1°. que les minières appartiennent au roi.
2° Que l'arrêt du conseil du 6 Septembre 1727 décide que les droits du roi ne seront payés que sur les mines censées lavées : peut-on espérer que des particuliers puissent être dans un cas plus privilégié ?
3°. A ne supposer des bancs de mines que de trois pieds d'épaisseur en mines brutes, un journal de terre, au désir de l'arrêt, serait payé 16 fois sa valeur, et appartiendrait toujours au propriétaire.
4°. Cet arrêt laisse la traite des mines libre, sans avoir la liberté de jeter derrière soi les matières étrangères qui embarrassent : c'est occasionner une double dépense.
5°. A ajouté à la déclaration les mots de brutes et non lavées.
6°. Dit que les maîtres des forges donneront un sou pour tout dédommagement, conséquemment à l'ordonnance, et les oblige néanmoins, au-delà des termes mêmes de l'ordonnance, de rejeter dans les creux les terres qu'il oblige à laisser sur les bords par une disposition particulière.
7°. Dit que les maîtres des forges ne seront point tenus de mettre les héritages en culture ; ce qui suppose que la traite des mines y préjudicie : leur défendant néanmoins d'y préjudicier.
Cet arrêt, comme plusieurs de la cour des aides, montre évidemment que l'article neuvième de l'ordonnance de 1680, a besoin d'être réformé et rédigé différemment.
Comme nous vivons sous un règne où les gens attachés aux intérêts du Roi et du bien public, peuvent mettre leurs idées au jour, de ce que nous avons dit on pourrait conclure :
1°. Que sans faire sommation de bâtir fourneau à un particulier qui ne possédant ni eaux ni bois, ne peut obtenir des lettres-patentes, les fourneaux voisins seraient les maîtres de tirer des mines, chacun à leur proximité, ou concurremment ou séparément, et ce à proportion de leur travail ; sauf aux propriétaires qui obtiendraient des lettres-patentes à les faire signifier ; l'exclusion n'étant que pour la propriété.
2°. Que les maîtres des forges seraient les maîtres de prendre l'eau nécessaire pour laver lesdites mines, en dédommageant les propriétaires à dire d'experts nommés par le juge de la marque des fers, sans néanmoins pouvoir préjudicier aux usines nécessaires et établies.
3°. Que les propriétaires des champs où il y a des minières seraient dédommagés au prorata de la superficie, qui est leur bien, en payant la portion d'héritage, suivant l'arpentage qui en serait fait aux frais du manufacturier, conformément au tarif du pays ; sauf après la traite, à remettre au propriétaire gratuitement son héritage dans l'état qu'il se trouvera : c'est rendre au Roi, au public, aux manufacturiers, aux propriétaires ce qui leur appartient.
ART. V. De la manière de nettoyer les mines. Ayons devant les yeux les différents genres de mines ; celles jointes à de la terre seule, premier genre ; terre et pierre en petits volumes, second genre ; beaucoup de terre, et peu de pierres accrochées faiblement, troisième genre ; moins de terre et plus de pierres liées plus étroitement, quatrième genre ; pierre très-solide jointe très-fortement, cinquième genre.
L'attelier propre à nettoyer celles du premier genre, s'appelle patouillet. Voyez les Pl. de grosses forges, parmi celles de métallurgie. Le patouillet est composé de deux châssis en bois FF, éloignés de six, sept, ou huit pieds, sur trois ou quatre pieds de hauteur, arrêtés par le bas par de fortes traverses G, et terminés aussi par le bas en plein ceintre H. On ménage une feuillure profonde au-dedans des chevalets, pour y attacher ou des membrures bien jointes H, ou des plaques de fonte coulées dans les fourneaux : on garnit de même les côtés L L ; ce qui forme la huche. Au-dessus de la huche, du côté de la rivière, vous ajustez un canal A, tout près le côté opposé à la roue : ce canal formé de bois ou pierres, carré ou rond, de quatre pouces de largeur, sur autant de hauteur, fournit l'eau du réservoir. Au milieu du bas de la huche, du côté opposé à ce canal, vous ménagez une ouverture C de six pouces en carré, ferme en-dehors par sa pelle de bois C à longue queue, et appuyé par un morceau de bois traversant le dessus d'un petit canal M, qui sert de déchargeoir. Du côté du coursier, tout au-dessus de la huche, vous ménagez une ouverture E deux fois plus large et moins haute que l'entrée de l'eau, afin qu'il puisse en sortir autant qu'il en entre, sur moins de profondeur.
La huche est traversée par un cylindre de bois N, qu'on appelle l'arbre, garni aux deux bouts de tourillons O de fer ou fonte, portant sur des empoises P, traversé des bras d'une roue qui tombe exactement dans un coursier, et garni dans l'intérieur de l'étendue de la huche, de trois barreaux R coudés à deux branches, enclavés les uns dans les autres à tiers points, de la profondeur de la huche ; de façon que quand un barreau finit de travailler, le voisin commence, et de même le troisième ; ils entretiennent alternativement le mouvement dans la mine, au fond et sur les côtés de la huche.
L'ouverture du bas de la huche servant de déchargeoir, est garnie en-dehors d'un canal en bois Q, de la même dimension que l'ouverture, sur la longueur de quatre pieds, garni des deux côtés d'un hérisson en pierre, ou affermi par du bois : il faut que ce canal aille un peu en pente, et aboutisse à un lavoir S de dix pieds en carré, au-dessus duquel, du côté opposé au canal, il y a une ouverture très-large sans être profonde, suffisante pour passer l'eau de la huche, quand il est nécessaire. Au bas de ce lavoir, et du même côté dans un coin, vous ménagez une ouverture fermée par une pelle T qui coule entre deux rainures. Il est avantageux ensuite de ce lavoir, d'en avoir un second V, qui recueille la mine que la force de l'eau pourrait faire échapper du premier.
Le jeu de cette machine consiste à laisser entrer l'eau par le canal A ; l'ouverture B étant fermée de la pelle C, la huche s'emplit d'eau jusqu'à la hauteur D ; la huche s'emplit de terre aux deux tiers ; la roue mise en mouvement par l'eau du coursier, le premier barreau soulève la terre proportionnément à son étendue, puis le deux et troisième. L'eau bourbeuse s'échappe par l'ouverture E, pendant qu'elle se renouvelle par l'ouverture A ; et en très-peu de temps, on est débarrassé de la terre qui se mêle perpétuellement à l'eau, pendant que la mine plus lourde gagne toujours le fond.
Vous connaissez avec un peu d'habitude quand la terre est lavée ; mais elle l'est certainement, quand vous voyez que le mouvement de la roue est retardé au point qu'elle s'arrêterait ; parce que quand la mine est bien nettoyée, elle s'entasse si fort, que les barreaux ont grande peine à y entrer : d'où il est avantageux pour les soulager, ainsi que la roue, de les tailler en prisme, présentant un angle au travail. Alors vous tirez la pelle C, ayant soin que les pelles des lavoirs de dessous soient baissées : l'eau et la mine de la huche aidées par l'eau nouvelle et par le mouvement des barreaux, descendent dans le premier lavoir, et l'eau s'échappe par l'ouverture du dessus, faisant la même manœuvre dans le second. Quand la mine de la huche est coulée, vous fermez la pelle C ; et pendant qu'un ouvrier Ve remplir la huche, l'autre nettoie avec un riaule le devant des pelles des lavoirs, et les leve. Comme elles tirent l'eau du fond, la mine reste seule et à sec ; de-là il Ve vider à emplir la huche, afin que le lavage s'opère pendant qu'ils viendront achever l'opération : pour cet effet, à quatre ou cinq pieds de distance du premier lavoir, il faut en avoir un qui tire l'eau directement du réservoir. Les ouvriers tirent la mine patouillée, et la posent sur le bord de ce dernier lavoir, dans lequel un ouvrier plonge le panier X, et le second jette la mine dedans : en remuant continuellement le papier, la mine passe au fond du lavoir, et les morceaux mal nettoyés se mettent à côté de la huche ; ils ramassent la mine criblée, la tirent d'un côté du lavoir, pour la mettre en tas à côté : quand elle est égouttée, elle est prête à être mise au fourneau ; pendant cette opération, celle de l'intérieur de la huche est faite.
On place le canal A tout contre le côté opposé à l'ouverture D, afin que l'eau soit obligée de faire tout le tour de l'intérieur de la huche, avant de sortir ; ce qui donne le temps à la mine de gagner le fond ; on place l'ouverture D du côté de la roue, tout contre le dessus ; et on la fait plus large et moins profonde, pour la même raison. D'ailleurs les barreaux poussant toujours la mine du côté du devant, il n'est pas possible qu'il s'en échappe, à moins que ce ne soient des mines legeres, qu'on appelle folles, qu'il est plus avantageux de perdre à l'eau que de bruler. L'arbre d'un patouillet peut être garni de six barreaux au lieu de trois, ou de cuillières qui se succedent. Plus vous opposerez de résistance, plus il faut de force, conséquemment plus d'eau : faites établissement après calcul.
Les patouillets supposent de la mine qui ne se mette pas en poussière, et qui soit plus chargée de terre que de pierre ; sans quoi le frottement userait la mine, sans diminuer la pierre : c'est une faute dans laquelle bien des gens sont tombés, et ont en conséquence décrié la machine.
Il faut avoir soin de beaucoup éloigner la huche du réservoir, afin que cette étendue donne lieu à une ample provision.
Il faut, pour servir un patouillet, deux ouvriers exacts, parce que s'ils retardent quand la mine est nettoyée, elle s'use par le frottement : il faut que ces ouvriers soient munis de pelles A, de pics B, de riaules, de bons paniers. Nous avons dit que les morceaux de terre qui avaient résisté à l'opération, se jetaient à côté du panier, au sortir de la huche : quand les ouvriers quittent le soir l'ouvrage, et même pendant leurs repas, ils jettent ces morceaux dans la huche. La nuit, ou plus de temps, leur fait prendre l'eau ; et frottés les uns contre les autres, la mine reste au fond de la huche.
Le patouillet est excellent pour les mines du premier et du troisième genre ; et des paniers bien serrés d'osier ou d'autre bois, suffisent, et ne sont pas d'une grande dépense.
Les mines du second genre veulent des lavoirs et égrapoirs : les lavoirs ne sont autre chose qu'un trou carré A, dont le fond B est garni de planches enterrées d'un pied de profondeur, sur six à sept pieds d'étendue, garni de quatre costières C de bois de trois à quatre pouces d'épaisseur, sur un pied d'élévation ; elles se joignent par des encoches D, et sont serrées en-dehors par des pierres. On échancre les costières du dessus et dessous E E de la largeur de six pouces, sur la profondeur de trois ou quatre, et vous tirerez un petit courant F d'eau, qui entre dans le lavoir, le remplit, et sort par l'échancrure du bas. Vous emplissez un des côtés de terre à mine ; et un ou deux ouvriers sont munis de riaules. Un riaule G est un morceau de fer battu, de la largeur de six à huit pouces, recourbé H de cinq à six, pour prendre aisément le fond du lavoir sans gêner l'ouvrier, finissant dans la partie supérieure par un tuyau en écrou K, propre à recevoir un long manche de bois L.
Les ouvriers se campent du côté que vient l'eau ; et ayant tiré au courant la terre la plus proche de la sortie, achevent de la faire passer de l'autre côté, en changeant de position, de-là, la reconduisent d'où elle est venue : chaque changement s'appelle un demi-tour. Suivant la connaissance que l'on acquiert aisément à l'inspection, on décide qu'une telle mine est à deux, trois, quatre, etc. demi-tours : quand elle est nettoyée suffisamment, ils la tirent avec leurs pelles, et la mettent en monceaux à côté d'eux, avec les pierres ou sable que l'eau n'a pu enlever, jusqu'à ce qu'il y en ait en assez grande quantité pour être porté à l'égrappoir ; nom qui vient de ce que l'on appelle grappes les petites pierres ou sables mêlés avec la mine ; ce qui est une espèce de castine : autrement ce seraient des mines qu'il faudrait abandonner. Les lavoirs peuvent encore se faire en carrés longs O O, ce qui donne de la force au courant ; c'est l'affaire des yeux intelligens à voir et disposer suivant le besoin.
Plusieurs pour égrapper les mines, se servent de paniers M de taule ou de cuivre percés de l'échantillon de la mine, attachés par l'anse N à une corde attachée à une perche flexible O. Ce travail est gênant et long.
L'égrappoir A (v. les Pl.) du meilleur service est composé de deux membrures B B de six pieds de longueur sur six pouces de hauteur : ces membrures sont tenues par deux traverses C C, d'un pied de longueur dans l'intérieur, passant par des mortaises D D, emmortaisées elles-mêmes E en-dehors, pour êtres serrées par des clefs F : dans les membrures, à un pouce de hauteur, on pratique une rainure G G ; vous arrangez dans ces rainures des baguettes de fer fondu H, d'un pied de longueur, dressées à la lime, et écrasées par-dessous. Vous arrêtez et séparez les baguettes par de petits morceaux de bois qui laissent des intervalles propres à laisser passer les grains de mine. Le total A A fait un grillage dont les côtés depuis les baguettes, ont quatre pouces et demi de hauteur : vous posez ce grillage sur le côté d'un lavoir I, de façon que le bas soit au-delà de la costière L ; et vous élevez le dessus M où aboutit le courant d'eau, de façon que cela fasse un plan incliné de 18 ou 20 degrés. L'eau du réservoir arrive au-dessus du grillage par un canal N, auquel vous ajustez une trémie O, dans laquelle vous jetez la mine, afin qu'elle ne tombe que successivement. La mine entrainée par l'eau passe à-travers les baguettes, tombe dans le lavoir ; et les sables plus gros que le grain de mines, sont chassés au-delà : il faut pour cette opération deux ouvriers, dont l'un jette la mine dans la trémie, et l'autre la tire de l'autre côté du lavoir : quand ce côté est plein, les ouvriers se joignent pour la tirer et la mettre en tas ; par cette manœuvre, qui Ve très-vite, vous êtes au-moins assurés que les sables qui restent dans la mine, ne sont que du même échantillon.
Les pierres qui sont dans les mines du quatrième genre, ou sont par bancs dans les minières, un de pierre, un de mines ; ou sont pêle-mêle en gros volumes, dont on peut avec pics et marteaux séparer la mine ; cette séparation faite, vous les passez au lavoir, de-là à l'égrappoir, abandonnant les pierres, si la minière peut fournir d'ailleurs ; sinon mettez-les à part, pour les travailler comme celles qui suivent.
Les mines en roches, ou sont assez riches pour être brulées sans séparation de la pierre, ou demandent à en être séparées.
Dans le premier cas, il ne s'agit que de les mettre en plus petits volumes ; ce que feront bien des bocards. Voyez BOCARD. J'ajouterai seulement que les pilons doivent être coulés en plusieurs pointes, pour diviser au lieu de mettre en poussière ; que les pilons frappent sur une taque de fonte ; et que le derrière soit garni de barreaux de fer qui ne laissent passer que ce qui est assez divisé.
Dans le second cas, les lavoirs simples ne feront rien ; le patouillet usera sans séparer ; le bocard écrasera la mine comme la pierre ; et ce qui restera sera toujours dans la même proportion de mine et de pierre.
Pour ces mines, il faut recourir à la macération ; il y a la naturelle et l'artificielle : la naturelle s'opère en exposant en peu d'épaisseur les pierres à mines ou mines en roche déjà brisées au marteau, aux grandes chaleurs et aux gelées : cela demande bien du temps et de l'espace.
L'artificielle Ve plus vite, et ne consiste que dans un certain degré de chaleur : pour cet effet, ayez proche vos minières ou vos bois des trous préparés, comme pour la calcination des pierres ; ayez-en plusieurs, et conséquemment à votre travail. Vos fours dressés avec les pierres à mines, comme les fours à chaux, faites mettre en fagots les restes des exploitations, et chauffez. Comme il y a des pierres à mines qui se fendent avec éclat au premier degré de chaleur, il faut les faire porter sur des grillages de fer, ou voute faite de pierres calcaires : la cuisson faite, ainsi que l'expérience l'aura bien-tôt appris, vous transporterez sur les lavoirs ; à la première eau, tout sera dessoudé. La chaux coulera avec l'eau ; le grain ou les lames tomberont au fond du lavoir ; s'il reste beaucoup de pierres, l'égrappoir vous en débarrassera ; s'il y en a qui ne soient pas assez calcinées, laissez-les à la macération naturelle, qui en peu de temps achevera la séparation.
Comme l'eau qui sort de ces mines est dangereuse pour les ruisseaux ou rivières où elle se décharge, vous ferez faire au bas des lavoirs plusieurs grands et spacieux trous, qui s'empliront les uns après les autres de votre eau de mine ; ce qui donnera le temps à la transpiration, l'évaporation, et au dépôt. Quand vous reprendrez le travail le matin, vous acheverez de vider ces réceptacles avec une pelle et par un petit déchargeoir qui tire l'eau. Quand ils seront remplis, vous les ferez vider à la pelle, et conserverez cette espèce de marne pour engraisser les terres ; ce qui vous dédommagera d'une partie de la dépense, moins effrayante au fond que par la nouveauté. Le reste sera amplement payé par le produit du fourneau, avec moins de charbon.
Un point essentiel pour un manufacturier, est de connaître ses mines, de les mélanger conséquemment à leur qualité, dans la proportion convenable.
On a l'expérience, que les mines venues dans l'arbue portent avec elles un degré, soit de réfraction, soit de facilité à la fusion, proportionné à l'arbue dont elles restent pénétrées ou imprégnées ; et celles nées dans la castine ont les mêmes qualités dans un degré proportionné aux parties de castine que vous n'aurez pu leur ôter.
Nous avons encore observé que l'emploi de l'arbue répondait assez à celui du soufre dans la poudre-à-canon, quatre parties sur une livre ; et la castine à celui du salpêtre, dix parties sur une livre.
Pour connaître ce que les mines portent d'arbue et de castine dans nos cantons, on peut se servir de la méthode suivante.
Ayez une mesure d'un pied cube A : il faut, autant qu'on peut, faire les épreuves sur le plus grand volume : vous emplirez cette mesure de mine, en la coulant par un entonnoir B, pour l'entasser également. Supposons mine du second genre, telle que vous l'avez préparée pour la mettre au fourneau, vous raclerez la mesure, et peserez ; vous prendrez assez de temps pour mettre à part les grains de mine et les pierres que vous mesurerez et peserez séparément ; vous ferez griller la mine, pour aider la séparation de l'arbuè ; laverez, laisserez sécher, mesurerez, et peserez : donc il y avait tant d'arbuè. Vous calcinerez les pierres, laverez, mesurerez, et peserez : donc il y avait tant de castine. Vous ferez de même l'épreuve des différentes mines, pour les mélanger ou y joindre arbuè ou castine ; posant pour règle, qu'il faut un dixième d'arbuè et un vingt-cinquième de castine : ainsi, si dans cent livres de mines il y a vingt livre d'arbue, ajoutez cent livres de mines qui portent huit livres de castine ; cet exemple doit suffire pour faire entendre le mélange de toutes les espèces de mines.
Ne regardez néanmoins ceci que comme une approximation ; joignez l'expérience ; ajoutez ou retranchez ; et au lieu de faire le mélange au fourneau, faites-le dans les apprêts. On est sur de l'uniformité, et d'avoir obvié à la négligence et l'oubli des ouvriers, quand les mines sont séparées : le mélange, pour certaines mines, ne peut être fait avec plus d'exactitude que par le patouillet. Quant à celles, par exemple, que l'éloignement ou autres raisons vous auront fait passer au lavoir, et qui auront besoin d'être passées une seconde fois au panier ; ayez au-dessus du patouillet un plancher en pente, garni de costières, où passera l'eau qui arrive à la huche, et dans laquelle vous criblerez la mine, qui, à l'aide de l'eau, descend naturellement dans la huche.
Il est assez inutîle de parler de la façon de voiturer et mesurer les mines ; chaque pays ayant sa méthode et sa mesure pour les recevoir des ouvriers. On dit ordinairement une queue de mines, ce qui devrait naturellement être de la même dimension qu'une queue de vin, divisée en muids et feuillettes. La feuillette à mine A, est de bois de fente, reliée en cercles de fer B, avec des poignées extérieures C C, attachées au cercle du milieu, sans fond, pour que les ouvriers, quand elle est pleine, puissent aisément l'enlever.
ART. VI. Des réservoirs et de la dépense de l'eau. L'eau est pour les forges une puissance nécessaire, dont on ne tire pas tout l'avantage possible sans beaucoup d'intelligence, de travail, et de dépense. La première attention, quand vous voulez bâtir une forge, est de bien connaître si vous en pouvez rassembler assez, à quelle hauteur ; et vous débarrasser de l'excédent.
Chacun sait que pour donner de la force aux liqueurs, il faut les ramasser en grands volumes ; et que pour fournir à une grande dépense, il faut des réservoirs spacieux. Pour joindre la hauteur et l'espace, on cherche l'endroit le plus favorable pour établir une chaussée ; et cette chaussée est percée de deux ouvertures : la première est distribuée en plusieurs cases, fermées de pelles ou pales, qu'on lève ou qu'on baisse pour donner une quantité déterminée d'eau ; cela s'appelle l'empalement du travail : la seconde est distribuée également, pour servir de décharge à l'excédent de l'eau, et s'appelle l'empalement de décharge.
Il n'est pas nécessaire de dire qu'il ne faut pas entreprendre la construction d'une forge, si par le calcul fait d'avance, il est clair qu'on ne puisse pas ramasser assez d'eau, et à une telle hauteur ; la hauteur de la chaussée décide de la hauteur de l'eau : quant à l'espace, il faut être bien assuré que cette élévation ne pourra préjudicier aux héritages voisins.
Une chose essentielle à savoir, c'est que les eaux retenues contre un empalement de travail, en plus grande abondance qu'il n'en laisse échapper, obligées par conséquent de retourner à l'empalement de décharge, pour trouver une sortie proportionnée à leur quantité, s'élèvent en reculant, d'environ un pouce pour dix taises. Tirons de cette expérience, que le plus avantageux pour augmenter la force de l'eau, est d'avoir un empalement de décharge très-éloigné de celui du travail ; puisque l'eau sera pressée de l'élévation d'environ un pouce par dix taises. Pour cet effet, quand vous voudrez ramasser toutes les eaux des petits ruisseaux, fontaines, étangs, rivière peu considérable, pour la dépense de votre travail ; au point de la jonction de plusieurs eaux, établissez l'empalement de décharge ; et de ce même point, faites creuser un canal le plus long que vous pourrez, au bout duquel vous établirez l'empalement de travail : vous gagnerez de la hauteur d'eau relativement à la pente du terrain et à son éloignement de l'empalement de décharge.
Comme l'empalement de décharge tire l'eau du fond, il y a lieu de penser qu'il pourrait faire perdre une partie du fruit qu'on attend de son éloignement de celui du travail, quand une petite crue d'eau le fait lever : pour prévenir cet inconvénient, on laisse l'empalement pour les grandes crues d'eau, et à côté on bâtit un roulis qui débarrasse du superflu de l'ordinaire.
Quand vous voulez bâtir une forge sur une rivière abondante, et que vous n'avez besoin que d'une partie de l'eau, il faut, le plus loin que vous pourrez de l'empalement de travail, faire un arrêt qui traverse la rivière, et qui tourne l'eau dans un canal creusé et allongé ; le reste doit passer sur l'arrêt. On peut ménager des portes pour le passage des grandes eaux et usages de la rivière.
Si l'empalement de travail donne assez de hauteur à l'eau pour faire travailler les roues par-dessus, vous ferez une huche qui la distribuera sur des roues à seaux : si vous n'avez pas assez de hauteur, vous prendrez l'eau du fond, qui, distribuée dans des coursiers, fera mouvoir des roues à aubes.
Quoique ces parties soient détaillées chacunes à leurs articles ; pour mettre le tout sous les yeux, nous allons les parcourir, sans entrer dans de trop grands détails.
Il ne faut rien ménager ni oublier, quand il est question de faire des fondations d'empalements, de roulis, d'arrêts, etc. détournez les eaux autant qu'il est possible ; excavez ; cherchez le terrain ferme ; ou servez-vous de pilots ou de grillages, et employez de bons matériaux. Nous donnerons un exemple de fondation à l'article des FOURNEAUX.
Pour un empalement de décharge, quand vous serez élevé à un pied près du fond de l'eau, établissez un bon grillage qui avance de dix à douze pieds dans l'eau, et soit assez grand pour garnir tout l'intérieur des bajoyers, et entrer sous la mâçonnerie qui s'élève à chaque bout du seuil.
Le seuil ou sous-gravier sera encoché dans le grillage, et arrêté à ses extrémités sous la mâçonnerie : dans le dessus, vous emmortaiserez des bois de séparation, dans lesquels vous ménagerez des feuillures du côté de l'eau, pour y couler les pelles : ces bois de séparation s'appellent potilles : les potilles sont emmortaisées par en-haut dans une forte pièce de bois, qu'on appelle chapeau. Les potilles seront soutenues dehors par des bras arrêtés dans les traversines du châssis : ces bois posés et arrêtés, vous élevez une mâçonnerie assez forte pour résister à la poussée de l'eau ; laquelle embrasse aux deux-tiers le potille des bouts : cette mâçonnerie s'élargit du côté du bas, pour diminuer la force de l'eau, en lui donnant plus d'espace ; on remplit les vides du grillage avec pierre, chaux, et sable, ou de glaise bien corroyée ; et on clouè dessus des planches bien dressées et épaisses ; pour plus grande sûreté, on garnit le devant et le derrière du grillage de pieux très-proches, bien enracinés, et sciés à fleur.
Les pelles sont des planches clouées ou chevillées sur deux traverses, et une pièce de bois de trois à quatre pouces d'équarrissage, qui lui sert de queue. On coule les pelles dans les rainures de deux potilles ; et la queue est arrêtée dans une encoche, ou une mortaise pratiquée dans le chapeau.
Quand l'empalement n'est pas assez large pour demander plusieurs pelles, et qu'une seule serait trop difficîle à lever, vous y mettez une queue à chaque côté, passant par le chapeau, finissant en vis : les écrous commençant à travailler contre le dessus du chapeau, font lever la pelle sans grand effort.
L'empalement de travail se fabrique comme celui de décharge ; il faut seulement observer que les potilles sont divisées, pour que leurs ouvertures ne donnent que l'eau dont on a besoin : le dehors de chaque potille sera garni de madriers d'épaisseur, entassés et brochés les uns sur les autres, portant sur de bons châssis, et faisant les coursiers proportionnés aux roues qu'ils reçoivent pour leur communiquer l'eau : le fond des coursiers est garni de planches épaisses clouées sur les châssis. On a soin dans les coursiers, de ménager une pente qu'on appelle saut, dans l'endroit où l'eau commence à travailler sur les aubes des roues : au milieu de la roue, le coursier sera élargi de moitié, afin que l'eau qui a passé le travail, trouvant un plus large espace, s'échappe plus vite, et ne retarde point le mouvement de la roue, en touchant le derrière des aubes. Quand on pose le seuil d'un empalement de travail, il faut savoir ce qu'il restera de pente pour le coursier, le saut, et la fuite de l'eau dans le sousbisf.
Le sousbisf est un canal qui Ve rejoindre celui de décharge, dans le point qu'on aura mesuré n'être plus par sa pente exposé au regonflement de l'eau : comme l'eau perd de sa force par ces frottements, au prorata de la longueur des coursiers, vous les disposerez proche de l'empalement, suivant le plus ou moins de travail : par exemple, celui du marteau sera le plus proche ; ensuite ceux des fonderies, des chaufferies, etc. il faut encore prendre garde que ces coursiers passant les uns à côté des autres, on est nécessité d'avoir des arbres plus longs les uns que les autres ; par conséquent les plus courts doivent être ceux du plus grand travail.
Puisqu'il est avantageux de prendre l'eau près des empalements, il le serait donc, dans une grande usine, de multiplier les empalements : pour cet effet, on en pourrait ménager un de chaque côté du corps de la forge, et un de l'autre côté du corps de la fonderie. Par le moyen de ces trois empalements, on pourrait, dans l'intérieur de la forge, avoir deux marteaux, et le nombre de feux nécessaires pour les assortir, des autres côtés des deux empalements ; d'une part le fourneau, d'autre une roue de fonderie ; et de l'autre côté de la fonderie, la deuxième roue sur le troisième empalement.
Quand on a assez d'hauteur d'eau pour la faire tomber sur les roues, alors au lieu de l'empalement à potilles et pelles, on pratique une huche qui vient aboutir sur la roue du plus grand travail, et distribue l'eau à celles du moindre, par des coursiers soutenus sur des chevalets.
Une huche est un coffre de bois servant d'allongement au réservoir d'eau, du côté duquel elle est ouverte : ce coffre est soutenu sur des chevalets, sous lesquels sont les roues, auxquelles on donne de l'eau par le fond de la huche, au moyen de pelles qu'on baisse ou qu'on lève suivant le besoin. Il me parait qu'en raisonnant bien, on trouverait que la dépense d'une huche est inutile, en tirant directement l'eau du réservoir conduite sur les roues par un coursier.
La structure des roues vient des deux manières de prendre l'eau, ou par-dessus ou par-dessous : il semble que dans les forges on affecte de ne point la prendre de côté dans des roues à seaux ; il ne serait peut-être pas impossible de prouver que ce serait la manière la plus avantageuse : celles qui reçoivent l'eau pardessus, s'appellent des roues à seaux ; elles marchent suivant la poussée et la pesanteur de l'eau dans les seaux. Les roues à aubes prennent l'eau par-dessous ; recevant leur mouvement de l'impulsion de l'eau, elles ne peuvent l'avoir que conséquemment à la force de l'eau, laquelle force dépend du poids et de la chute.
Les roues à aubes sont composées d'une grande quantité de séparations beaucoup plus larges que les aubes, faisant un total fort pesant : il n'est pas si clair que bien des gens se l'imaginent, que les roues à seaux, pour les forges, soient d'un meilleur service que celles à aubes ; il y en a qui demandent de la force et de la vitesse : je n'entends parler que relativement à des chutes de huit à neuf pieds et au-dessous. Si sous huit pieds j'établis une roue à seaux de cinq pieds de diamètre, il est clair que j'ai des leviers très-courts ; que je perds la hauteur et l'étendue d'eau de cinq pieds ; que la force de l'eau diminue à proportion : d'ailleurs ces roues demandent beaucoup d'entretien ; ainsi je crois que la perte de la hauteur de l'eau et l'entretien préjudicient et retardent le travail autant qu'une plus grande dépense d'eau dans les roues à aubes, dont je puis dans le besoin allonger les leviers, dont l'entretien est facile, et qui tirent l'eau du fond. Delà je concluerais volontiers, que quand on n'est pas dans le cas de manquer d'eau relativement à un travail bien entendu, ou que les chutes ne sont pas au-delà de neuf pieds, le meilleur est de s'en tenir aux roues à aubes.
ART. VII. Des bois. Les bois faisant la plus grande dépense des forges, font un objet très-intéressant ; cette partie consiste dans l'achat, l'exploitation et l'emploi.
L'achat doit être réglé par la qualité du terrain, l'espèce de bois, l'âge, l'épaisseur, la hauteur, et la traite.
Ne peut-on pas assurer que le bois est rempli de parties sulphureuses ou nitreuses, en plus ou moins grande quantité, selon la nature du sol ; que ces parties y sont serrées à proportion du nombre des couches que chaque année accumule, et de la solidité de la partie nerveuse ? Un bois venu dans l'arbue, suivant ce que nous avons dit, ne doit-il pas être regardé comme un bois nerveux ; celui venu dans la pierre, la castine, comme un bois aisé à séparer ? notre proportion ne pourrait-elle pas être ici appliquée comme dans la mine ? Un bois venu dans l'arbue ne pourrait-il pas être deux fois et demi plus difficîle à réduire en cendres, que celui venu dans la castine, à pareil degré de siccité ? Un pied cube de bois nourri dans l'arbue, pese au moins moitié plus qu'un nourri dans la castine : donc la contexture en est plus ferme ; donc le remplissage est de parties plus tenues et plus serrées. La chaleur du charbon venu dans l'arbue est fort concentrée ; il veut être bien soufflé : celui venu dans la castine fuse, s'évapore aisément. Le cœur et le pied du bois sont plus durs que l'extérieur et le dessus : le cœur est serré par les couches qui l'environnent ; les tuyaux de l'extérieur sont remplis de beaucoup d'eau, qui sert de véhicule aux parties plus lourdes, mais divisées pour être transportées. N'est-il pas naturel que les parties plus lourdes et plus embarrassées restent au bas de l'arbre, tandis que les plus legeres et les plus aiguës montent ? le dessus de l'arbre n'est-il pas aussi abreuvé et entretenu par les parties que l'air dépose ? Ces parties sublimées sont censées legeres : de-là nous voyons que le cœur du bois et le pied tiennent le feu beaucoup plus longtemps que l'extérieur et le dessus. On pourrait donc par le poids seul, faire la différence du bois qui résiste le plus longtemps au feu.
Ne pouvant douter que les bois ne soient en relation exacte avec le terrain, la première règle pour l'achat doit donc être la connaissance du terrain, d'autant que c'est ce qui règle l'espèce : les unes par leur constitution veulent des nourritures solides, d'autres plus legeres ; quelques-unes ont de larges tuyaux, etc. Il serait à souhaiter d'avoir l'analyse de tous les différents bois : mais en général au poids on ne sera point trompé.
La seconde règle est l'âge du bois ; on le connait aux cercles que vous voyez quand le bois est coupé. On compte dans un arbre un peu âgé le cœur pour trois ans ; chaque cercle pour une sève, et l'écorce pour trois ans. Si le cœur et le pied ont des parties plus solides, comme on n'en peut douter, quand le bois a atteint un certain âge ; cet âge est donc d'une extrême conséquence. Il faut mettre en compte la hauteur et l'épaisseur du bois : c'est ce qui donne la quantité. Par la traite, j'entends l'éloignement et la qualité du trajet.
Un manufacturier qui a mis en compte l'entretien, le cours d'eau, la mine, la main d'œuvre, l'exploitation, la traite, voit d'un coup-d'oeil ce qu'il peut donner de la superficie d'un bois, et sait qu'un autre en pareille traite et du même âge, par le terrain seul, peut valoir le double et jusqu'à trois cinquiemes, le bénéfice restant plus grand : la preuve en résulte de ce qu'ayant sous un même volume de bois de quoi faire un plus grand travail, l'exploitation et transport sont moins couteux. Il serait à souhaiter que les propriétaires et manufacturiers voulussent se rendre à ces vérités ; on n'entendrait pas les uns se plaindre de l'inégalité du prix de bois qui leur semblent de la même valeur, et les autres exposer leur fortune par des achats mal combinés.
De ce que nous avons dit il ne faut pas inférer que plus un bois serait vieux, meilleur il serait ; soit taillis, soit futaye, attendez tant qu'ils profitent beaucoup ; quand vous entrevoyez de la langueur, coupez.
Pour l'exploitation des bois en général, voyez BOIS et FORET. Pour l'usage particulier des forges, il convient qu'elle soit faite pendant que le bois est défeuillé : il faut se pourvoir d'un nombre d'ouvriers suffisant ; la méthode la plus ordinaire est de couper le bois de deux pieds et demi ; le fendre en morceaux de trois à quatre pouces de diamètre ; et le mettre en cordes entre deux piquets, suivant les étendues et conventions arbitraires. Veillez aux coupeurs, qu'ils ne touchent point à ce qui est réservé ; laissant le nombre et la qualité des baliveaux ; coupant proche de terre ; brulant, si on n'a pas lieu d'en faire autre usage, les petites branches inutiles ; empilant leurs bois sans fraude : il faut se conformer aux clauses des marchés, sans jamais anticiper ni retarder les coupes ; se servir des anciennes places à charbon, des anciens chemins ; et ne jamais traiter avec les propriétaires qu'on sait être trop scrupuleux et intéressés : les recollements alors, avec toute la bonne foi et le soin qu'on a pu apporter, deviennent des sources de procès et de ruine. L'accident le plus à craindre pour les exploitations, est le feu.
Si à l'exploitation des taillis on a joint la coupe de quelque futaie, il sera avantageux de faire travailler le tout ensemble. Il est bien entendu que les corps d'arbres seront débités suivant leurs qualités, fente, sciage, charpente, charronnage ; le reste, qui est de notre objet présent, sera scié de deux pieds quatre pouces de longueur, fendu en morceaux de trois à quatre pouces, et dressé en cordes, comme les branches et taillis : ces gros bois, que nous supposons n'être point viciés, doivent naturellement résister au feu, mieux que les taillis : au mois de Mars, il faut avoir soin de faire ramasser de la feuille pour faire couvrir les fourneaux dans le temps. Quand tous les bois seront en cordes, ce qui doit être fini pour le mois d'Avril, on les laisse sécher jusqu'en Septembre : alors il ne faut point perdre de temps à les faire dresser, voyez CHARBON. Ce n'est que dans le dernier besoin, qu'il faut faire de nouvelles places à charbon. Cette partie demande toute l'attention possible. Où le fond est arbue et plein, alors les nettoyer et battre suffit ; où le fond est en coteau, le mieux est de prendre des pionniers pour les unir, et de bons bras pour les battre ; où le fond est pierraille ou sable, quelquefois avec des crevasses, le mieux est d'y faire conduire de l'arbue, et de la faire battre. Les aires préparées, les dresseurs auront soin de mettre une partie de petits bois pour commencer, c'est ce qu'on appelle l'alume ; ensuite les plus gros dans le foyer, et les plus petits à mesure qu'on s'éloigne du centre : par ce moyen, tout se trouve dans la place qui lui convient. Le grand point est que le bois ne soit point trop couché en-dedans ni sur les côtés ; sans quoi au moindre affaissement, tout se dérange et cause un désordre préjudiciable. Le dressage doit laisser une égale liberté au feu de circuler de tout côté : si une partie est trop garnie, le feu pénètre avec peine : ne l'étant pas assez, il se jette tout-d'un-coup où il trouve moins de résistance : si le gros bois tient une place séparée du petit, l'un brule, l'autre ne cuit pas ; si la place n'est pas ferme, tout le bois qui entre en terre ne deviendra jamais charbon ; s'il s'y trouve des fentes ; si elles communiquent à l'air extérieur, elles soufflent ; si elles ne communiquent pas, et qu'il y ait beaucoup d'humidité, la raréfaction peut faire culebuter une pièce entière ; si le bois est mal arrangé et garni, il s'y forme des entonnoirs, qu'on ne bouche et remplit jamais sans perte.
Quand les fourneaux sont dressés, on les couvre de feuilles, d'un peu de terre et fasins, pour concentrer la chaleur : si on a affaire à un terrain pierre, je le répète encore, voiturez de la terre et des fasins, vous serez dédommagé de cette dépense. La règle pour l'épaisseur de la terre qui couvre les fourneaux, n'est point arbitraire ; il faut que la fumée et la flamme ne puissent passer que dans les endroits qu'on le souhaite. Trop de terre empêchera la cuisson de la partie qui lui est contiguè : il y a des sels qui s'évaporent avec les fumées ; ne serait-ce point ces sels qui les rendent si dangereuses ? Quand le feu est dans un fourneau, il faut veiller s'il marche également ; s'il se jette d'un côté, couvrez-le de fasins, et donnez jour dans le voisinage. Quand le milieu commence à s'affaisser, couvrez-le bien, et piquez dans des environs et au bas ; si une partie parait résister au feu, tandis que le reste passe, ouvrez, et laissez-la s'enflammer à l'air libre ; quand le feu y aura bien mordu, couvrez. Ne pressez jamais un fourneau. Comme il ne peut aller vite qu'en prenant beaucoup d'air : outre une grande diminution, le charbon qui reste a beaucoup perdu de ses parties inflammables, comme on le voit à sa grande division et legereté.
Le charbon doit naturellement rester pénétré des qualités du bois. Aussi voyons nous que celui venu et cuit dans l'arbue résiste longtemps au feu ; et celui venu dans la castine s'évapore aisément : la pesanteur est une règle aussi assurée pour le charbon que pour le bois. Il est aisé de se convaincre que deux morceaux de bois sec de même dimension, l'un venu dans l'arbue, l'autre dans la castine, pesent, après leur réduction bien faite en charbon, dans la même proportion qu'ils étaient avant : le charbon le plus lourd tient le feu le plus longtemps. On sent bien que le bois de pied et du dessus étant dans les fourneaux, c'est avoir mélangé le fort et le faible : il est rare, avec cela, de n'avoir pas, dans de grosses exploitations, quelques espèces de bois leger ; en tout cas, quand vous aurez des bois différents par la nature du fond, le plus expédient est de mélanger les charbons dans la proportion du mélange des mines ; dix parties du charbon venu dans l'arbue, quatre de celui venu dans la castine, cela réussit bien à l'expérience et au travail. Le charbon vigoureux convient bien aux fourneaux dans lesquels on cherche à concentrer la chaleur, et où on emploie la force de l'air ; il convient encore à la macération des fontes, etc.
Pour les fours des fonderies qui se chauffent avec du bois, je n'ai pas besoin de dire que ceux venus dans la pierraille donnent une flamme plus passagère, mais plus vive et plus prompte, et conséquemment conviennent mieux.
Il est aisé de conclure qu'ayant besoin pour cuire le charbon, d'une certaine épaisseur de terre et de fasins, soutenue par la feuille sur les fourneaux ; les grandes pluies, qui entassent, battent, et entraînent ; les gelées, qui soulèvent ; les grandes chaleurs, qui raréfient ; les vents qui dérangent, y sont très-préjudiciables : le plus expédient est de choisir le temps qui parait le moins sujet à ces inconvénients ; Mars, Avril, Septembre, et Octobre, paraissent les plus propres ; il faut en profiter, pour faire la provision nécessaire : pour cet effet, il faut des voituriers, des releveurs de charbon.
En général, les halles doivent être au vent du nord des usines ; cette exposition est moins dangereuse pour le feu ; les uns les font bâtir solidement et à demeure ; les autres ont une carcasse en bois, dont les côtés ont des coulisses qu'on garnit de planches, ainsi que le dessus, à mesure que le charbon arrive : par ce moyen, on les allonge tant qu'on juge à-propos. Le charbon craint sur toutes choses l'humidité : ainsi il ne faut point tarder, quand il est cuit, à le voiturer et le mettre à l'abri ; plus il est brisé, plus à l'air seul il perd de ses parties inflammables. Le charbon récent donne de la chaleur ; mais il est bien-tôt consumé : la raison est qu'ayant tous les pores ouverts, il est plus disposé à une prompte dissolution par une inflammation totale. Il est utîle que le refroidissement ait fermé ses pores, pour ne se prêter qu'à une inflammation successive : sur toutes choses, garantissez-le de l'humidité.
La façon de voiturer les charbons n'est pas égale par-tout : les uns se servent de voitures à quatre roues, qu'on renverse ; mauvaise méthode, qui en écrase une grande quantité : d'autres se servent de bennes sur deux roues, avec des claies par-dessous, qu'on ouvre pour le laisser couler : d'autres se servent de sacs qu'ils chargent sur des bêtes de somme ; la meilleure manière est celle qui brise moins ; la façon de mesurer le charbon est aussi différente ; on parle de muid, de van, de basche, etc. Quand nous aurons besoin d'une dimension, nous la déterminerons par pieds ; par ex. un van de Bourgogne équivaut à 5 pieds cubes.
La règle pour la mesure des bois, est, par l'ordonnance, fixée à cent perches de vingt-deux pieds de roi pour un arpent. Les arpenteurs sont joints aux corps des maitrises, pour travailler dans l'étendue de leurs ressorts. Je ne puis passer sous silence un abus prodigieux : les bois sont communément dans de grandes inégalités, hauteurs, et profondeurs : on traine la chaîne en montant, on la traine en descendant dans une surface convexe ; c'est la demi-circonférence, ou autre courbe qui est mesurée, pendant que ce devrait être la base.
ART. VIII. De l'air. L'air absolument nécessaire pour la fusion des mines dans les fourneaux, l'est de même pour les forges, fonderies, etc. il est simplement question d'en proportionner la force et la direction suivant le genre de travail.
On communique l'air à des foyers par le moyen de l'eau, ou de soufflets, ou d'ouvertures exposées à l'air libre.
Le premier moyen veut une chute considérable, quoique d'une petite quantité d'eau. Supposons deux ou trois pouces tombans de douze ou quinze pieds ; vous aurez sur le sol du fourneau ou de la forge, du côté et au bas de la thuyere, un bassin percé par le fond d'une ouverture proportionnée à l'eau qui doit tomber : le dessus de ce bassin sera encore percé vis-à-vis le trou de la thuyere ; à cette ouverture il faut adapter un robinet qui étant ouvert laisse entrer l'air par la thuyere, et ferme le jet de côté. Au-dessus de ce bassin sera adapté et scellé un tuyau perpendiculaire de la hauteur de la chute, au-dessus duquel il y a un entonnoir qui reçoit l'eau à l'air libre ; cette eau est amenée par une conduite, qui ne laisse passer qu'une quantité déterminée et exacte. L'eau entrant dans le tuyau avec beaucoup d'air, et tombant perpendiculairement, est déterminée par son poids à s'échapper par l'ouverture d'en-bas ; l'air moins pesant trouvant une issue ouverte du côté de la thuyere, s'échappe avec une force proportionnée à la hauteur et largeur du tuyau. La difficulté d'avoir de pareilles chutes et une quantité régulière d'eau, les gelées, et autres inconvéniens, n'ont pas donné à une machine si simple tout le crédit qu'elle devrait avoir ; l'habitude ne laissant pas même entrevoir les ressources des différentes positions.
Le second moyen a été d'employer des soufflets : d'abord on les a fait de cuir, plus grands, mais de la même forme que ceux des petites boutiques, ils étaient mus par l'eau et rabaissés par des contrepoids. Depuis peu on a trouvé une manière plus ingénieuse et sujette à moins d'entretien, en les faisant de bois ; en voici la construction, tant pour les fourneaux que pour les forges ; ils ne diffèrent que par la grandeur : ceux des fourneaux ont depuis quinze jusqu'à vingt pieds de longueur ; et ceux des forges, depuis sept jusqu'à neuf pieds, sur la largeur proportionnée. M. de Réaumur a calculé qu'un soufflet de forge de sept pieds et demi de longueur jusqu'à la tête, de quarante-deux pouces de largeur, finissant à quatorze sur l'élévation de la caisse, de quatorze pouces à sa plus grande portion de cercle, donne 20151 pouces et un tiers en bas, pour le volume d'air poussé par chaque coup de soufflet ; qu'un soufflet de fourneau de 14 pieds de longueur donne 98280 pouces en bas.
Les soufflets sont composés du fond et de la caisse ; (Voyez les Pl.) le fond d'un soufflet de fourneau est une table de bois M, de quinze pieds de longueur jusqu'à la tête R, sur cinq pieds de largeur dans le dessus, finissant à 18 pouces vers la tête ; prolongée de 18 pouc. finissant à 1 pied de largeur, pour faire le fond de la tête S. Sur cette table seront fermement attachés tout-autour, jusqu'à la tête, des rebords de six pouces de hauteur sur trois à quatre pouces d'épaisseur, bien dressés : sur ces rebords vous appareillerez des tringles de bois h, aussi bien dressées, enclavées par leurs extrémités les unes dans les autres, par une encoche et un tenon mobîle 9, 10, 11, 12, 13 ; et dans les coins, par des encoches sur le plat à mi-bois. C C, trois ou quatre liteaux de chaque côté, deux au-dessus, 3, 4, 5, 6, deux vers la tête 9, 10, 12, 13 : ces tringles C C s'appellent liteaux : ces liteaux seront affermis par des mentonnets Z : le mentonnet est composé de la racine 1, qui se cloue en-dedans des rebords Y S, formant un angle droit avec le menton 2, et tenus ensemble par un tenon et une mortaise : on arrache et place les mentonnets suivant le besoin ; il faut que le menton serre les liteaux de façon qu'ils puissent se mouvoir sans se déranger. Entre le mentonnet et les liteaux, on passe dans un trait de scie pratiqué dans la racine du mentonnet u, des ressorts xx, qui poussent les liteaux en-dehors d'environ un pouce. On engraisse de bonne huîle d'olive le dessus des rebords, liteaux, et mentons ; et on serre les liteaux contre les ressorts avec des tourniquets de bois attachés en-dehors des rebords. On décloue ces tourniquets à mesure que la caisse emboite les liteaux.
Dans le fond, à un pied du dessus, on fait un trou carré m, de quinze pouces de diamètre, pour qu'un ouvrier puisse y passer dans le besoin : on couvre cette ouverture d'un morceau de bois à charnières, d'un côté garni en-dessous de peau de mouton en poil, et retenu en-dessus par une courroie lâche de cuir, de façon qu'il puisse lever et baisser et fermer exactement ; cela fait l'office d'une soupape, et s'appelle le venteau.
Le fond du soufflet, depuis le rebord r, du côté de la tête, est allongé, comme nous l'avons dit, de dix-huit pouces, finissant à douze : cet excédent, dans sa longueur, sert à loger l'épaisseur d'un tuyau de fer couché dessus ; ce tuyau a quatre pouces de diamètre, finissant à deux ; et deux pieds et demi de longueur au-delà de l'allongement : ce tuyau s'appelle bure ou beuse, F. La tête S est un morceau de bois excavé pour emboiter la beuse, bien attaché à l'allongement qui fait le fond, finissant de même à un pied d'épaisseur ; le tout bien lié en fer.
Dans le dessus de la tête, à sept ou huit pouces des liteaux, on fait une encoche terminée en demi-cercle de deux pouces de profondeur sur un pouce de diamètre, propre à recevoir une cheville de fer P P : vers les liteaux de la tête, vous ôtez assez de bois pour placer librement le bout de la caisse, contre lequel ces liteaux doivent frotter.
La caisse est un coffre de bois O O P P, de trois ou quatre pouces d'épaisseur, de la même figure que le fond : les côtés qu'on appelle panne, servent à emboiter le fond, sur le jeu de deux ou trois lignes. Les bouts des deux côtés de la panne P P sont prolongés d'un pied, et à quatre pouces de l'extrémité, traversés d'une cheville de fer qui se place naturellement dans l'encoche qui lui est préparée ; en dehors de chaque côté de cette cheville, entre la tête et la panne, il y a des clés de fer qui la reçoivent pour être arrêtée en-dessous ; ce qui rend cette cheville assez ferme pour n'avoir de mouvement que sur elle-même.
Cette cheville doit être regardée comme le centre du mouvement de la caisse, dont le bout d'en-haut doit être taillé en portion de cercle B D partant du centre : voilà le grand mystère des Souffletiers. Quand la caisse monte et baisse, elle décrit plus d'espace à-mesure qu'elle s'éloigne du centre du mouvement ; c'est ce qui doit faire la règle pour la hauteur des côtés, qui, dans le soufflet que nous décrivons, pourraient avoir trois pieds et demi dans le bout d'en-haut, finissant à huit ou dix pouces.
Pour loger la caisse, vous la placez sur un levier qui traverse le milieu du fond, portant sur les liteaux ; vous placez la cheville ouvrière, et l'arrêtez : la caisse commençant à emboiter partie des liteaux, vous éloignez le levier du centre ; et à-mesure que la caisse se loge, vous arrachez les tourniquets qui tenaient les liteaux.
Il est inutîle de dire avec quelle exactitude les côtés de la caisse doivent être joints, polis, et graissés, puisque tout l'effet de la machine dépend de la précision, qui doit être assez grande pour ne laisser d'autre sortie à l'air que l'ouverture de la bure.
Les caisses des soufflets, ainsi que les fonds, se font avec du bois leger et sec, de trois ou quatre pouces d'épaisseur. Quand les soufflets ne font plus le travail nécessaire, par la perte du vent, on les relève en desserrant la cheville, ôtant la caisse, nettoyant et visitant tous les joints et les liteaux, et collant sur les endroits qu'on entrevait donner passage à l'air, des bandes de basanne. C'est une fort bonne méthode que de garnir le fond du soufflet proche la tête avec des lames de fer blanc ou fer battu. Le devant de la tête exposé à gerser, se remplit avec colle et coins de bois, et s'enduit de bourre détrempée dans de la colle de farine de seigle.
Le fond des soufflets vers le venteau est soutenu sur des chevalets I G, qui y sont attachés ; et la tête porte sur un banc de pierre L, qui est placé devant et sous la thuyere. On a encore soin de les appuyer dans le milieu sur des blocs de bois K, qu'on place où on juge à-propos : les soufflets sont bandés contre les marastres par des morceaux de bois qui appuyent sur la tête E, afin de rendre le fond immobile.
La caisse des soufflets est armée par-dessus de deux anneaux de fer, dans lesquels on passe un double crochet de fer plié par le dessus, répondant à un autre crochet mobîle enclavé dans le fond des bascules.
La bascule est un levier dont le point d'appui est environ aux deux cinquiemes de sa longueur ; un bout répondant aux crochets du soufflet, et l'autre chargé de pierre, pour faire le contre-poids. Le dessus de la caisse est aussi garni de deux boites de fer N N, dans lesquelles passe et est arrêtée une lame épaisse de fer M X, débordant le dessus de la caisse de quatre ou cinq pouces, finissant en portion de cercle M ; cela s'appelle baliscorne ou basseconde.
Pour donner le mouvement aux soufflets, soit de fourneaux, soit de forges, vous avez un coursier (V. les Pl. et leur explic.) qui communique à l'empalement du travail ou une huche avec rouet et lanterne M N K C G : dans l'un et l'autre cas, l'eau fait mouvoir une roue qui donne le mouvement à un gros cylindre de bois, passant et tournant devant les bassecondes ; cet arbre est armé de six cames à tiers-point, trois pour chaque soufflet. Une came est un morceau de bois debout, enclavé et serré dans des mortaises pratiquées à cet effet : les cames doivent être bien évuidées du talon, et arrondies comme les bassecondes, afin que quand elles travaillent, elles tendent à abaisser la caisse, et non à la pousser. Quand une came a fait baisser un soufflet, elle échappe ; et le contre-poids le fait relever pendant que l'autre soufflet baisse : moyennant quoi, pour avoir le vent sans relâche, il faut deux soufflets ; le soufflet leve, le venteau s'ouvre et laisse entrer l'air : quand la came le presse, le venteau se ferme par son propre poids, et l'air est obligé de sortir par la bure.
Comme les soufflets de forge demandent par leur étendue moins de force ; au lieu de contrepoids, leurs crochets ou chaînes répondent aux extrémités d'un balancier en bois D, ou de fer, appelé courbotte : ce balancier est attaché par le milieu à une perche flexible F ; l'un par conséquent ne peut baisser que l'autre ne lève ; et la perche, par son élasticité, se prête aux différents mouvements.
En général soit fourneau ou forge, le fond des soufflets doit être mis en ligne parallèle à celle du fond de l'ouvrage ; et la véritable direction est celle selon laquelle le souffle des deux soufflets se rencontre au milieu de l'ouvrage.
A l'article FONDERIE, on trouvera la façon d'y communiquer l'air ; les autres ateliers se servent de soufflets, et il y en a en bois à double vent pour les martinets.
ART. IX. Des fourneaux. Pour se former une idée utîle d'un fourneau à fondre la mine de fer, il faut voir les différentes parties qui le composent, et ne pas oublier qu'il doit résister à trois agens, l'eau, l'air et le feu, dont le dernier degré de force n'est peut-être pas bien connu.
Un fourneau doit être composé d'une fondation solide (Suivez les Pl.) B B C C, de conduits voutés Q sous le massif et sous l'ouvrage, d'un massif P S P S, de fausses parois I G, de parois et de l'ouvrage I K ; le tout sur le bord d'un courant d'eau, ou sous la chute d'un petit courant.
Nous trouverons l'épaisseur du total en donnant au massif 8 pieds, un pied aux fausses parais, laissant dans l'intérieur un vide de six à sept pieds pour construire les parois et l'ouvrage ; ce qui fera en tout vingt-quatre à vingt-cinq pieds.
Il faut commencer par excaver cette partie, connaissant le terrain, les déblais serviront à renforcer une chaussée, etc. Si vous pouvez trouver aisément un fonds solide, bâtissez en gros matériaux, avec chaux et sable, autant que vous le pourrez ; pratiquez des conduits dans l'épaisseur du massif, dont le dessus excède les plus grandes eaux. Faites de même une croisée voutée dans le milieu, qui se trouvera sous l'ouvrage, sans néanmoins monter les voutes trop haut ; cela influerait sur la hauteur des roues et autres équipages, parce que sur la voute il faut l'épaisseur d'un pied pour placer le fond.
Si après une excavation de six pieds plus bas que le commencement des voutes, et après avoir sondé le terrain, vous ne pouvez trouver le solide sans aller plus bas, élargissez l'excavation de deux pieds tout-autour, prenez des bois de huit jusqu'à douze pouces d'équarrissage (supposons-les de douze) et sur la totalité du vide vous établirez des longrines à douze pouces de distance, dans les encoches desquelles vous établirez des traversines de pareil échantillon, ce qui produira une grille moitié bois et moitié vide ; vous remplirez les vides de bons matériaux. Sur ce premier grillage vous en établirez un second avec une recoupe autour d'un pied ; et plaçant en longrines ce qui tenait lieu de traversines avec pareil remplissage, il résultera que sur les six pieds d'excavation, il y a deux pieds d'élévation ; que ces deux pieds peuvent être regardés comme un total de charpente, que le plus fort poids ne peut qu'affermir ; et que recoupant encore un pied tout-autour pour commencer un massif total en maçonnerie, l'excédent peut être regardé comme autant de points d'appui. Vous ferez de même pour les chaufferies, fonderies, etc.
Quand sur ces grillages le total de maçonnerie sera élevé de quatre pieds, il faut distribuer l'ouvrage pour ménager les conduits dont nous avons parlé. Les conduits voutés à un demi-pié au-dessus des plus grandes eaux, et de l'épaisseur d'un pied de voute, vous éleverez tout-autour le massif seul, de 9 pieds d'épaisseur sur 4 pieds d'hauteur. Comme sur le devant et le côté de la thuyere, la maçonnerie est diminuée d'épaisseur du haut en-bas, et que le travail y est grand, il faut que la maçonnerie des angles qu'on appelle piliers G G, soit des plus solidement bâties, et ces parties garnies de plaques de fonte B B B, fortes et épaisses, tenant tout l'espace entre les piliers, dans lesquels il faut ménager à cinq pieds d'hauteur, une naissance de ceintre pour renforcer et fermer le dessus du devant et de la thuyere, ayant soin de ménager en-devant une ouverture pour les fumées. Le mieux serait encore, que de ces mêmes piliers sortissent deux autres ceintres, pour vouter tant sur le moulage que les soufflets. Ces voutes bandées contre de bons murs d'appui, affermissent toute la maçonnerie.
Sur le massif élevé de quatre pieds, ce qui ne doit être regardé que comme trois, en en supposant un pour l'épaisseur du fond, vous ferez une recoupe intérieure d'un pied, ce qui réduira le massif à huit pieds d'épaisseur, que vous éleverez de douze pieds ; ce qui joint aux trois ci-dessus et trois pieds de banc, fera une élévation de 18 pieds : elle peut être poussée à vingt et vingt-quatre. Sur cette recoupe, vous éleverez en bonne maçonnerie, pierre ou brique, un mur d'un pied d'épaisseur, qu'on nomme fausses parais. Il faut remarquer que ces fausses parois du côté du devant, ne sont quelquefois pas disjointes, mais font un total avec le massif, que la nécessité du travail fait beaucoup diminuer par le bas dans cette partie. Ces fausses parois seront élevées à la hauteur du massif. Il ne faut pas négliger de pratiquer des ventouses provenant du fond, sans quoi la maçonnerie se fendra en plusieurs endroits. Ces ventouses sont de petits soupiraux ménagés, et circulant dans la maçonnerie. Comme les fumées qui en sortiront seront dangereuses, il faut en placer l'ouverture dans les endroits que les ouvriers ne fréquentent pas. Ces soupiraux font un effet plus assuré que les liens de fer ou grosses pièces de bois D D, que plusieurs emploient pour tenir la maçonnerie en respect, et qui ne résistent jamais à la raréfaction. Donnez jour à l'évaporation, et l'ouvrage est sauvé.
On ne pratique des fausses parais, que parce qu'il arrive communément que le feu ne se contentant pas de détruire les parais, il perce souvent et ronge une partie des fausses parais, quelquefois même du massif. Le cas arrivant, il est aisé de les réparer, ou en partie, ou même de les refaire en entier sans toucher au massif.
Dans les six à sept pieds de vide qui restent dans l'intérieur des fausses parais, on établit les parais. C'est ici que commence la science du fondeur.
Nous supposons les soufflets N N, posés ou imaginés dans une ligne parallèle au fond de l'ouvrage R, et dont le vent doit se croiser dans le milieu R ; nous supposerons encore les parois à monter pour des mines mêlées, ni trop chaudes ni trop froides, en termes d'art ; la construction que nous allons décrire étant donnée, il sera aisé de diminuer, augmenter, varier les dimensions, suivant la qualité des mines, quand on en saura bien les raisons.
Du milieu de l'entre-deux des soufflets posés ou imaginés, vous tirez avec un cordeau une ligne droite, qui traverse le vide que les fausses parois ont laissé. Du milieu de chaque soufflet, vous tirez deux autres lignes. Le point où elles se croisent sur la première, doit faire le milieu R. Du fourneau, du point de chaque côté de la première ligne, vous tirerez deux perpendiculaires, ou une prolongée qui traverse le point milieu ; ce qui formera une croix à angles droits. Vous terminerez les extrémités des lignes du côté de la thuyere et du contrevent, à compter du point milieu, à deux pieds trois pouces, et celles du côté du devant et de la rustine, à deux pieds et demi. Au bout de chacune de ces lignes, vous ferez avec une équerre des retours, et vous aurez formé un carré de cinq pieds sur quatre et demi. Les fondeurs se servent ordinairement de baguettes, dont l'une a cinq pieds, et l'autre quatre pieds et demi dans notre hypothèse ; et en les couchant l'une sur l'autre, ils les allongent pour avoir la diagonale, qui est d'environ six pieds neuf pouces ; ce qu'ils font mécaniquement, se réglant seulement à vue d'oeil sur l'ouverture destinée à placer la thuyere : de-là les abus immenses dont on rejette l'évenement sur des choses qui n'y ont aucune part.
De dessus la voute du côté du contrevent et de la rustine, vous réglant sur les marastres du devant et du dessus de la thuyere, vous éleverez dans les dimensions ci-dessus perpendiculairement les parois M I, dont vous prendrez la naissance pour le devant, et la thuyere sur les marastres, et les pousserez tout-autour à environ deux pieds plus haut que la véritable position de la thuyere.
Il faut au-dessus du massif deux chevalets, ou autres points d'appui mobiles, à la hauteur de six pieds, avec une traverse qui porte un plomb tombant sur le point du milieu, afin qu'avec cette ligne vous soyez assuré de faire un carré au-dessus E, répondant à celui du bas. Dans les dimensions dont nous allons parler, et qui seront désignées par les cordeaux, qui partiront des angles de la maçonnerie du bas du côté de la thuyere, et passeront sur les points d'appui ; et de même des angles du côté du contrevent, vous arrêterez ces cordeaux aux points d'appui par des clous plantés de chaque côté ; de façon néanmoins qu'ils puissent se mouvoir aisément de haut en-bas, et seront arrêtés aux angles du bas par des coins percés et fourrés entre les pierres, dans le trou desquels vos cordeaux passés, ils seront tendus par des pierres attachées à leurs extrémités, de façon que l'ouvrier puisse les remuer de temps-en-temps, pour les faire suivre exactement à sa maçonnerie. Vous terminerez le dessus G G à trois pieds plus haut que le massif P, et les fausses parois (cet excédent s'appelle la bune), dont la hauteur est marquée à un des cordeaux par une épingle qui le traverse.
Dans notre hypothèse, l'ouverture du dessus répondant à celle d'en-bas, formera un carré, dont les côtés de la thuyere et du contrevent auront vingt-six pouces, et la rustine vingt-deux.
Nous aurons donc un vide pyramidal de quinze pieds d'élévation, sans compter les trois du bas montés perpendiculairement, dont la base a de deux côtés soixante pouces terminés à vingt-six, et des deux autres cinquante quatre terminés à vingt-deux. Suivant cette proportion, les parois auront la pente rentrante d'un peu plus de treize lignes par pied de deux côtés, et d'un peu moins de treize lignes des deux autres.
Les fourneaux se chargent par l'ouverture de dessus E, du côté de la rustine ; et c'est la raison pour laquelle en élevant ces parais, on tient ce côté droit et uni, pendant qu'on ceintre les autres de deux à trois pouces de profondeur, à commencer au-dessus des échelages, et finissant insensiblement au-dessous de la charge. La charge est l'espace supérieur d'environ trois pieds et demi de profondeur, qu'on remplit de nouveaux aliments, quand les précédents sont descendus à cette diminution.
Les parois élevées jusqu'à la hauteur prescrite, on fait l'ouvrage.
Le fond E est la première pierre qui se pose bien de niveau, et capable seule de remplir l'étendue de l'ouvrage et du devant. Nous avons dit que le fond serait à un pied au-dessus de la voute de la croisée ; mais négligeant le plus ou le moins en cette partie, le fond doit être posé treize pouces sous la véritable position de la thuyere.
Le fond posé, du milieu des dessus vous laissez tomber un plomb, et vous tracez un point sur le fond. Du milieu du dessus du côté de la rustine, vous laissez encore tomber le plomb, et du point qu'il donnera avec celui que vous avez, vous ferez une ligne droite qui fait l'angle du reste.
A six pouces et demi de cette ligne, du côté de la thuyere et du contrevent, vous en tracez deux autres parallèles C C.
Vous avez deux blocs de pierre préparés, de la longueur de trois pieds et demi ou quatre pieds, sur douze à treize pouces de hauteur appelés costières, que vous placez de chaque côté à fleur de ces deux dernières lignes qui laissent entr'elles un espace E de treize pouces ; à six pouces et demi du milieu vous placez une autre pierre D ou plusieurs, bien maçonnées faisant une pareille épaisseur, terminant le carré du côté opposé au-devant, et qui s'appelle la rustine. Sur les costières qui doivent affleurer le devant du fourneau, à treize pouces du point du milieu, vous tracez une ligne pour placer une pierre taillée qu'on appelle tympe. Avant de la poser, vous placez à l'extrémité des costières, sur le devant, un morceau de fer D de quatre pouces en carré, qu'on nomme aussi tympe ; et sur ce morceau de fer, une plaque de fonte qu'on appelle taqueret, qui termine le dessus de l'ouvrage en-dehors ; ce qui doit aller jusqu'à la première marastre B, contre laquelle il appuie : vous posez ensuite la tympe en pierre qui doit exactement remplir l'espace depuis les treize pouces jusqu'à la tympe en fer. Vous renforcez extérieurement le bout des costières de deux petits murs C C, de façon que vous avez à découvert le devant de l'ouvrage.
La thuyere M se pose sur la costière répondant précisément au point du milieu, et sur une plaque de fer battu mise bien de niveau ; c'est à cette partie qu'il faut employer les meilleurs matériaux, et faire une maçonnerie qui indépendamment de la thuyere se trouve à treize pouces du fond.
Depuis la thuyere on élève la maçonnerie M K tout-autour également d'environ deux pieds de hauteur ; puis on travaille en retraite K P en plan incliné, pour joindre les parois à la hauteur de six pieds P, à compter du fond L ; à cette hauteur on a soin de tracer une ligne pour servir de règle. Cette maçonnerie se nomme étalage ou échelage.
Toute la partie dont nous venons de parler L M K P se nomme l'ouvrage, terminé en-devant de la largeur de sept pouces, par de l'arbue pétrie qu'on appelle bouchage C ; et le reste est fermé d'une grosse pierre F, ou ancienne enclume de forge qu'on nomme la dame. La position de la dame est bonne quand entre elle et les tympes C D, on peut commodément travailler avec des ringards dans toutes les parties inférieures de l'ouvrage et supérieures, jusqu'au-devant de la thuyere. On élève ou baisse la dame suivant le besoin.
La thuyere est un morceau de fer battu comme de la tole, recourbé en demi-cercle concentrique, dont celui de dehors donne quinze à vingt pouces d'ouverture, et celui contre l'ouvrage deux pouces : cela est assez ressemblant à une hure de sanglier. Cette partie pose sur une plaque de fer battu, le tout scellé dans la maçonnerie, de façon néanmoins que dans un besoin extrême, on peut le réparer sans endommager la maçonnerie, que pour cet effet nous avons dit devoir se soutenir par elle-même.
Au-dessus et sur le bord extérieur des trois côtés du massif, on bâtit de la hauteur de sept à huit pieds, un mur de dix-huit ou vingt-quatre pouces d'épaisseur, qui s'appelle bataille A A A : le quatrième côté P est pour le passage des ouvriers. Les batailles servent à rompre l'effort des vents, et à en mettre à l'abri la bune et les ouvriers. Quelques-uns profitent de ces murs pour élever une espèce de lanterne de pierre choisie ou de brique en façon de dôme : la méthode en est très-bonne. Il faut que les chargeurs puissent passer commodément dessous ; et que le milieu répondant à la bune, laisse libre sortie à la flamme et aux vapeurs. A ce défaut on élève sur la moitié de la bune un mur de garantie pour les ouvriers.
Les outils pour le travail sont de gros et petits ringards, des crochets T pour le devant, un plus petit et une spatule V de fer à longue queue pour la thuyere ; des paniers pour porter le charbon et la mine ; des pelles de fer ; un bout de planche triangulaire S, avec un manche dans le milieu appelé charrue, pour tracer le moule de la gueuse ; une plaque de fer et un marteau pour sonner les charges, afin d'avertir le maître ou commis ; une romaine X, avec ses crochets Z, et un pied de chèvre r ; des roulets pour transporter les gueuses.
Avant de mettre le fourneau en feu, il faut veiller à ce que tout soit en bon état ; que le charbon, la mine, l'arbue, la castine, le sable pour le moulage, ne puissent manquer.
Dans les pays de marque on est obligé d'avertir le directeur du département du jour qu'on met en feu, et de celui qu'on tire la palle, en cette forme : " Je soussigné.... propriétaire, régisseur, ou maître du fourneau de.... sis à.... demeurant à.... déclare à M..... directeur de la marque des fers au département de.... que le.... mois.... année.... je ferai mettre le feu audit fourneau pour y tirer la palle, le.... afin qu'il ait à y faire trouver les commis qu'il jugera à-propos ; déclarant que ledit jour je ferai procéder à la coulée des gueuses ou marchandises, tant en absence que présence, à ce que ledit sieur.... n'en ignore, dont acte. A... le.. et signer ". Ces actes se font sur papier simple.
Les droits de marque pour fontes ou gueuses sont de cinq livres cinq sous par mille, payables tous les trois mois au domicîle du receveur. L'ordonnance de 1680 vous dira l'obligation de numéroter les gueuses. 1. 5. 10. 20. 100. etc.
Il faut être muni pour le service d'un fourneau, au-moins de trois ouvriers, un fondeur ou garde-fourneau, et deux chargeurs.
Les fourneaux se bâtissent de pierre ou de brique. Quand vous faites le corps de la maçonnerie et les fausses parois en brique, il faut qu'elle soit cuite. Pour les parais, vous vous servez de terre à brique, moulée, séchée et liée ; en bâtissant avec de la même terre pétrie, la chaleur du fourneau les aura bientôt cuit. Les briques sont les meilleurs matériaux pour les fourneaux ; des parois peuvent durer plusieurs fondages, au-lieu qu'avec de la pierre à chaque feu il faut les rebâtir : on les trouve calcinées, et souvent même une partie des fausses parais.
L'ouvrage se fait avec des pierres qui n'éclatent point au feu et qui se calcinent le moins ; mais cela dépend de ce que fournit le pays. Il est commun pour les usines d'un grand travail, d'avoir deux fourneaux accolés ; ils travaillent alternativement ou tous deux ensemble, quand on a besoin de beaucoup de matière : quand il n'est question que de fonte en gueuses, il suffit d'avoir depuis le bouchage I, un assez grand espace pour faire le moule long de 18 à 20 pieds. Le moule I L consiste en du sable humecté à un certain degré, dans lequel on passe la charrue, pour former un vide triangulaire ; on bat les côtés avec une pelle de fer ; on y imprime le n°. M. on perce le bas du bouchage, et la fonte en fusion y coule. Les marchandises sont à la fin de cet article.
Quand il est question de mettre en travail un fourneau bâti et muni de charbon, et mines mêlées ou disposées naturellement, on commence par bien nettoyer l'intérieur, et les chargeurs avec leurs paniers l'emplissent de charbon. On met le feu par le bas ; on le laisse de lui-même gagner le dessus : quand le charbon est baissé de trois pieds et demi, ce qu'on appelle une charge, ou un vide équivalent environ à vingt pieds, ce qu'on connait avec la mesure X X, on le remplit de charbon, et sur ce charbon on met un panier de mines. Un panier à mines n'a point de dimension fixe, les unes étant plus lourdes que les autres ; c'est ce qu'un chargeur peut commodément porter et lever sur la bune. Le fourneau encore baissé d'une charge, on le remplit de charbon. On met du côté de la thuyere un peu d'arbue seche et en poussière, et deux paniers de mines ; puis on commence à faire des grilles par le bas.
Les grilles consistent à garnir l'intérieur de l'ouvrage, par le dessus de la dame, de ringards, à assez peu de distance les uns des autres, pour empêcher les charbons de tomber ; on tire par la coulée ceux qui sont dans l'ouvrage, et on laisse reverbérer la chaleur pour échauffer le fond. On fait et recommence des grilles, jusqu'à-ce qu'on voie que le fond est assez enflammé, pour paraitre tout en feu et jeter des étincelles. Ce temps se trouve ordinairement proportionné à celui qu'il faut à la première mine, pour venir à la thuyere : alors avant que d'ôter la dernière grille, vous garnissez le fond, le devant et les coins de fasins, pour empêcher que la première fonte ou fusion ne s'attache aux parois ou au fond, qui n'ont pas encore un assez grand degré de chaleur ; vous pétrissez de l'arbue, et vous l'employez à fermer l'ouverture de la coulée jusqu'à la hauteur de la dame ; vous faites marcher les soufflets, pour donner à l'intérieur le degré de chaleur propre à la fusion. Avec la spatule on garnit le bout de la thuyere d'arbue, et à chaque charge on augmente le degré de la mine, jusqu'à-ce qu'on voie que les charges n'en peuvent porter davantage. Il faut beaucoup d'attention sur cette partie. Vous connaissez que le fourneau n'a pas assez de mine, à la grande facilité qu'a la flamme de s'échapper par le dessus, la couleur extrêmement blanche, les charges qui descendent très-vite, la fonte qui noircit en refroidissant. Vous pourrez augmenter la mine jusqu'à-ce que les fontes commencent à blanchir et soient très-coulantes ; ce que l'on appelle vives. Le trop de mine rend les fontes bourbeuses, peu coulantes, cassant aisément, chargées de crevasses, aisées d'ailleurs à travailler à la forge, mais avec grand déchet. Le manque de mine ou le trop de chaleur, les rend très-grises, même noires, dures, difficiles à travailler, mais avec peu de déchet. La qualité de la fonte dépend beaucoup de la façon de la travailler au fourneau. Quand un fourneau est trop chargé de mines, avec bon vent et charbon, il est tout simple que la dépuration du métal n'ait pas eu le temps de se faire, surtout si le travail y a manqué, ou n'a pu y suffire, comme il arrive dans les barbouillages. Les corps étrangers, l'abondance des corps étrangers se trouvant mêlés avec le métal, il est clair qu'il ne coule point avec facilité ; et qu'obligés d'en faire la séparation à la forge, le déchet doit être très-grand et le travail aisé, puisque ces adjoints se dissolvent aisément. Quand un fourneau manque de mines, et que par la qualité des charbons, ou autres raisons, elles sont très-longues à descendre, il faut beaucoup de temps pour en ramasser une quantité. L'ouvrier cherche naturellement à avancer la fusion des charges supérieures, par le travail du ringard et l'augmentation du vent. La chaleur et le travail donnent le temps et l'aide à un plus grand dépouillement ; ce qui approche le métal de la qualité de fer, puisqu'il est constant que le changement de la fonte en fer se fait par le dépouillement jusqu'à un certain degré, et le travail bien entendu aux foyers des forges : delà il est clair que ces fontes doivent changer de couleur ; qu'elles doivent être d'autant plus dures et moins coulantes, qu'elles approchent plus de la nature du fer, conséquemment sujettes à moins de déchet, et plus difficiles à travailler. Cette difficulté oblige quelquefois à jeter dans le foyer des crasses de forges pilées, qui servent de fondant.
Il est aisé de sentir pourquoi les fontes bourbeuses sont fort cassantes : les corps dont elles sont mêlées en trop grande abondance gonflent les nerfs, les éloignent, les séparent ; de-là le fer qui par la qualité de la mine serait doux et nerveux, s'il ne tombe pas entre les mains d'un ouvrier intelligent qui sache lui ôter ce qu'il a de trop, se ressent de la mauvaise constitution de la fonte.
Les fontes bien grises se mettent en grains, qui résistent au ciseau, mais qui se détachent les uns des autres. L'aire d'une enclume de forge, par exemple, au travail seul s'égrenera ; ne pourrait-on pas en trouver la raison dans le degré de chaleur qu'elle a essuyé au fourneau ?
La plupart des fondeurs font diminuer la quantité de mines, quand ils veulent couler des enclumes ou autres agrès de forge : les charges alors produisent moins de fonte. Dans la nécessité d'en amasser assez pour couler une masse de 2 à 3000, il faut beaucoup de temps ; la chaleur augmente par ce temps, et par la quantité de métal en bain.
Pour mettre au jour cette partie essentielle, distinguons cinq degrés de chaleur, abstraction faite pour un moment du plus ou moins de mines, ce qui y contribue beaucoup ; et disons que les nerfs des mines en fusion au premier degré, seront gonflés, éloignés les uns des autres, par le remplissage, fontes bourbeuses, cassantes et blanches.
Au deuxième, le dépouillement sera fait de façon qu'il reste assez de matière pour remplir les vides des nerfs sans les gonfler ni séparer ; fontes solides, d'un blanc un peu mêlé, et coulantes ; ce sont celles qu'on appelle vives.
Au troisième, les nerfs restent joints les uns aux autres ; mais le remplissage nécessaire est beaucoup détruit. Fontes grises, cette couleur venant des vides qui paraissent noirs, et de la cassure des parties nerveuses qui parait blanche.
Au quatrième, les nerfs recourbés par la violence du feu, feront des grains très-durs, mais aisés à séparer les uns des autres ; le remplissage brulé, couleur noire et fontes point coulantes.
Plus de chaleur acheve de détruire le grain, rend la matière spongieuse, aisée à casser, les débris friables, comme on le voit au fer brulé : de-là on peut conclure que les fontes vives sont de la meilleure qualité.
Nous sommes entrés dans ce détail pour faire entendre que la qualité du fer vient de l'espèce de mine ; que quand un fer est doux de sa nature, il peut néanmoins être cassant, ou par le trop de remplissage qui gonfle et éloigne les nerfs, ou par la forme circulaire qu'un trop grand degré de chaleur ou la trempe lui aura fait prendre. Otez au premier ce qui l'embarrasse ; au second rendez l'extension et la souplesse par le mélange de nouveaux fondants ; et à la trempe, par un refroidissement naturel, vous aurez du fer doux relativement à la qualité de la mine. Employez tout ce que vous voudrez ; d'un fer cassant par la nature de la mine, vous n'en ferez jamais un fer doux.
L'exactitude du produit d'un fourneau dépend de l'égalité du vent, de la régularité des charges, de l'uniformité des mines et des charbons, et de l'intelligence du fondeur dans son travail.
Le travail consiste à garantir du feu toutes les parties du bas, mais principalement la thuyere. Pour cet effet il faut y veiller, en ôter ce qui s'y attache ou l'embarrasse, et ne pas la laisser échauffer faute d'arbue.
Avec les matériaux que nous avons supposé, un fourneau échauffé peut, à vingt charges, produire cinq milliers de fonte en vingt-quatre heures, et soutenir un an et plus de travail. On dit qu'il y a des espèces de mines qui produisent, à travail égal, jusqu'à six et sept milliers : en tout cas la qualité des mines, des charbons, le manque de soin ou d'intelligence, en réduisent souvent le produit à moins quelquefois de trois milliers. Quand les charges rendent moins, sans qu'il y ait de dérangement dans un fourneau, il est bien clair que cela vient de la qualité de la mine.
Il y a plusieurs choses essentielles ; les dimensions qu'on donne à un fourneau, l'inclinaison des parais, le foyer qui est le plus grand espace au-dessus des échalages, la position de la thuyere, l'ouverture du dessus.
L'inclinaison des parois facilite la descente de la mine ; donc si vous en avez qui descendent plus difficilement, qui se mettent en masses, vous pourrez augmenter l'inclinaison ; si elle s'attache aux angles, vous pouvez les arrondir ; si le degré de chaleur n'est pas assez grand au foyer, outre qu'une plus grande inclinaison des parois donnera un plus grand espace, vous l'agrandirez encore en le ceintrant ou en élevant la tour et la bune. La thuyere doit être posée de façon qu'elle distribue le vent également : c'est à son passage que les mines en dissolution sont forcées de se séparer des corps étrangers, par la violence et le rafraichissement subit du vent. En l'examinant un peu de temps, on voit cette séparation par le produit des étincelles, qu'une seule ou plusieurs parties de mines accrochées jettent en forme d'étoiles. Cette séparation est aussi sensible et brillante à la coulée des gueuses, la fraicheur de l'air ou du moule comprimant les ressorts des parties extérieures, les fait éclater, et ce à proportion du degré de froid. Bien plus sensible encore, si vous jetez en l'air de la fonte liquide : mieux enfin à la compression du gros marteau sur les loupes ou renards, dont on rapproche les parties étendues par la chaleur, quand il se trouve des parties de fontes mal travaillées dans les foyers de la forge.
Nous n'avons cessé de répéter le mélange de l'arbue et de la castine avec la mine. La raison est que la castine fondant la première, chaque partie se grossit de sa voisine, et en tombant laisse des vides qui donnent entrée à la chaleur. L'arbue résiste plus longtemps, et tient toute cette matière liée et criblée dans le foyer, jusqu'à-ce que la mine en fondant l'entraîne elle-même, à quoi contribue beaucoup la pesanteur des charges qui se renouvellent par le dessus. Si vous mettez séparément la castine, la mine, l'arbue ; l'une fond d'abord, la mine tombe toute crue, et l'arbue reste : au lieu que dans le mélange tout descend uniformément.
Comme la matière de fer en fusion pese davantage, elle se précipite dans le creux et sous le vent, où elle en trouve déjà en bain, et où les scories en fusion plus legeres surnagent : quand elles ont le degré de liquidité convenable, aidées du vent, elles sortent par le dessus de la dame, et ce à mesure que le creuset se remplit. Quand les crasses commencent à vouloir sortir, l'ouvrage du fondeur ou de celui qui le remplace, est de remuer avec un ringard la fonte en fusion dans le creuset, ce qui aide la dépuration du métal ; cela desserre le devant du fourneau et donne liberté aux crasses de sortir. Il verra aussi si la thuyere n'est point embarrassée ; et dans le cas où les matières qui viennent du dessus l'échaufferaient ou en boucheraient l'ouverture, d'un coup de ringard par le dessus de la dame il la débarrassera et la rafraichira de pâte d'arbue. Les crasses trop liquides annoncent une trop grande quantité de castine ; les tenaces et gluantes trop d'arbue. L'ouverture du dessus trop étroite, défaut où tombent les fondeurs qui cherchent à augmenter le degré de chaleur, fait bruler l'ouvrage : la raison en est sensible ; il faut une ouverture proportionnée à une circulation d'air convenable, et on a Ve combien il entre d'air dans un fourneau.
Les fourneaux sont sujets à beaucoup d'accidents. Les plus communs sont la déflagration de la thuyere, de la tympe, de toute une partie de l'ouvrage, les barbouillages, les éruptions. La déflagration peut venir 1°. d'une mauvaise construction, ou fausse direction du total ; 2°. d'une partie de l'ouvrage mal jointe ; 3°. d'une fausse position des soufflets ; 4°. de mines attachées au-dessus du foyer ; 5°. de la qualité de la mine.
Dans le premier cas il n'y a point de remède, il faut mettre hors ; c'est arrêter le fourneau : dans le second, à force de rafraichir d'arbue les parties attaquées du feu, on parvient à y faire fondre des parties qui remplissent les vides ; c'est ce qu'on appelle plombage : dans le troisième il n'y a pas à hésiter à rectifier la position des soufflets : dans le quatrième il faut, avec de longs ringards du dessus de la bune, détacher les parties accrochées aux angles, et pendant quelques charges augmenter la castine et le vent. Ces morceaux seront aisément criblés par la fusion de la castine, et fondus par une augmentation de chaleur, sinon ils occasionneront un barbouillage, comme nous le dirons dans le cinquième cas. Ou mêlez différentes mines, ou si vous ne pouvez, ajoutez-y les parties d'arbue convenables. Ces accidents n'arrivent jamais sans faute. Dans le cas où la thuyere serait bien endommagée du feu, il faut arrêter les soufflets, défaire le moins de maçonnerie qu'on pourra, y en substituer une nouvelle, et la réparer avec pierre et arbue le mieux que vous pourrez ; et du dessus mettant de l'arbue de ce côté-là, vous pouvez parvenir à la plomber et à continuer utilement votre ouvrage. Si c'est la tympe qui est brulée, il faut arrêter les soufflets, boucher le feu avec de la terre, ouvrir le mur aux deux bouts, et y en mettre une autre, que vous maçonnerez avec pierre et arbue.
Comme avec l'allongement qu'on fait à la thuyere avec de l'arbue, on peut tourner le vent plus d'un côté que d'un autre, c'est à un fondeur à se servir de ce remède quand il voit quelques parties attaquées, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à les plomber.
Les barbouillages viennent des mines mal nettoyées, mal mélangées, et en conséquence mal dirigées, tombant dans l'ouvrage quelquefois en gros volumes, provenans ou des morceaux détachés, comme nous l'avons dit, ou des mines gelées, ou trop humides, ou trop chargées d'arbue, ou des mines trop seches qui coulent à-travers les charbons, ou de la qualité des charbons, ou de l'inégalité des charges ou de trop de mines.
Dans tous ces cas, le remède est d'augmenter le vent, de soigner que les morceaux ne bouchent la thuyere, en les divisant à coups de ringard sans relâche : faites aider les ouvriers, multipliez-les ; le moindre retard est capable d'arrêter le vent : rectifiez vos charbons et les mines dans les charges qui suivent. Il est avantageux d'avoir des halles qui garantissent vos matériaux des gelées et de la pluie. Dans les grandes sécheresses on humecte les mines, pour les empêcher de couler trop vite. Quand malgré le travail des ringards, qui doit principalement avoir la thuyere pour but, vous avez lieu de craindre que la quantité ou la qualité des matières qui tombent dessus, n'infirment l'ouverture ; insinuez-y des charbons forts, qui entretiendront un degré de chaleur dans cette partie.
En général quand un dérangement viendra de manque de chaleur, gardez-vous bien de faire comme la plupart des fondeurs qui diminuent la quantité de mines ; au contraire entretenez le même degré tout-au-moins, mais choisissez celles qui fondent le mieux, ou joignez-y de la castine.
Ces accidents sont toujours très-mauvais ; le moins est la perte de bien des matériaux, souvent d'une tympe, d'une thuyere, et la fin est quelquefois la mise-hors.
Un fourneau est vraiment un estomac qui veut être rempli avec égalité, uniformité et sans relâche ; sujet à des altérations par le défaut de nourriture, à des indigestions et crudités par la qualité ou l'excès, et veut des remèdes prompts. Vous connaissez le mal aux scories. Les mines chargées d'arbue les rendent si tenaces, qu'il faut les tirer avec les crochets, les vider à la pele ; de sorte qu'il en reste beaucoup qui n'ont pu se séparer de la fonte : le trop de castine les rend trop fluides, et dégraisse, pour ainsi parler, le métal. Les crasses des premières sont boursoufflées, rapeuses, couleur de peau de crapaud ; les crasses des secondes sont blanchâtres et legeres. Les digestions louables sont d'un beau noir poli, mêlé de verdâtre.
Il arrive encore qu'il s'attache dans l'ouvrage et le creuset même, des morceaux qu'il est difficîle de détacher ; quand c'est du côté de la rustine, il n'y a rien à craindre : le travail du ringard, quand il y aura beaucoup de matière en bain, en viendra à-bout : si c'est devant la coulée, et que les ringards n'aient pu les détacher, le plus expédient est de lever la pierre qui est sous le bouchage, qu'on nomme aussi coulée, et d'y en substituer une beaucoup plus élevée. Cette opération laissant au fond du creuset toujours de la fonte en bain, ce qui est attaché se dissoudra, aidé de la pointe du ringard, surtout si, après avoir coulé, vous y jetez des crasses de forges pulvérisées, et y tournez le vent de la thuyere.
On entend que quand le fourneau est en feu, il faut qu'il soit servi nuit et jour et sans relâche, puisque le moindre refroidissement coagule les matières en fusion : quand néanmoins il arrive quelque réparation à faire, comme aux soufflets, on prend le parti de le boucher. Quand les parois sont de brique, et l'ouvrage de grès, et qu'il n'y a rien d'endommagé, vous pouvez le vider entièrement, boucher le dessus avec une plaque de fonte garnie d'arbue, pour ôter la communication à l'air ; fermer la thuyere et le devant avec de l'arbue, achevant de couvrir le devant par une grande quantité de fasins secs. Quand les parois et l'ouvrage sont de pierre calcaire, que la moindre fraicheur mettrait en dissolution, vous laissez fondre toute la mine qui est dans le fourneau, ne faisant les charges que de charbon, et vous bouchez exactement ; s'il ne prend point d'air, vous trouverez au bout de plusieurs jours le charbon à la même hauteur. En recommençant le travail, vous ne lui donnerez de la mine que par gradation. Un fourneau bien fermé peut attendre dix ou douze jours, quelquefois vingt à vingt-cinq : quand vous ne l'arrêtez que pour un jour ou deux, vous ne faites que trois charges sans mine ; et quand elles arriveront à l'ouvrage, vous coulez : nettoyez bien surtout le devant, et bouchez.
Quand l'ouvrage est bien dérangé par le feu, vous pouvez dans les mêmes parois de pierre calcaire en faire un autre : pour cela vous tiendrez tous vos matériaux prêts, nettoyerez bien le dedans, ferez souffler pour rafraichir ; pendant que vous ouvrirez le devant et débarrasserez, garantissez les parois de l'humidité ; en deux ou trois jours un ouvrage peut et doit être en état de travailler. Comme l'humidité n'attaque pas la brique, il est avantageux surtout dans ces occasions, que les parois en soient construits.
Les éruptions sont pour les ouvriers et bâtiments voisins l'accident le plus terrible ; elles portent la mort au proche, et le feu au loin. C'est une explosion subite qui jette hors et très-loin toutes les matières, fondues ou non, qui sont dans un fourneau ; c'est un volcan qui lance par toutes les ouvertures, et de toutes sortes de volumes, des morceaux enflammés : on a Ve des charbons voler jusqu'à cinquante taises.
L'éruption, ou n'a lieu que dans le bas d'un fourneau, ou dans le dessus, ou elle est totale. Des morceaux attachés tombant tout-à-coup en gros volumes dans l'ouvrage où il y a déjà des matières en fusion, font sortir ces matières par le devant de la thuyere : c'est ce qu'on appelle cracher. Des mines liées d'arbue, attachées au-dessous de la charge, ayant laissé un vide entr'elles, et les matières qui descendent venant à tomber sur les matières inférieures, la rapidité de l'air qui s'échappe et la prodigieuse et subite expansibilité de l'humidité, jettent hors la dernière charge. On connait la proximité de ces accidents, par la flamme qui concentrée se jetait fort en-devant, et y manque tout-à-coup quand il se trouve un passage libre pour la chute des matières. Quand les ouvriers s'en aperçoivent, la fuite est le plus expédient.
L'éruption générale ne peut venir que de la raréfaction de l'eau, quand les conduits se trouvent bouchés. La preuve négative est que dans les fourneaux bien voutés dont on a soin de nettoyer les conduits et dont le fond est bien au-dessus des eaux, jamais cet accident n'est arrivé.
Parvenu à acquérir quelques connaissances sur le mélange le plus avantageux pour la fusion des mines, je suis obligé d'avouer qu'on n'est point parvenu à savoir ce qui, à travail égal, distingue les fers entr'eux. On se contente de dire en général que les mines sont de différentes espèces, et que conséquemment leur produit doit être différent.
Je ne croirais rien hasarder de dire que les mines ont entr'elles une qualité de configuration distinctive, qu'elles ne perdent pas même dans le raffinement du fer. Un ouvrier, dit-on, fait du fer cassant ; un autre le fait doux : disons de bonne-foi, qu'un ouvrier ne change point la qualité du fer ; mais qu'avec un tel degré de chaleur ou de travail, le fer peut s'épurer ou s'altérer. Travaillez également les différentes espèces de mines ; réduites en fontes, elles produiront toujours suivant leur nature, les unes des grains, les autres des prismes, des lames plus ou moins fines et longues, etc. En fer les mêmes qualités se trouvent. Le travail peut affermir ou appauvrir le nerf, la liaison, y laisser trop ou pas assez de remplissage, comme nous l'avons détaillé ; poussez le feu et le travail trop loin, vous détruisez. On dirait que ce ne sont pas les particules de mines qui ont été en fusion, mais les corps qui les rassemblent, ou qui y sont mêlés ; et que purifier ce métal, n'est proprement, comme nous le verrons au travail de la forge, que lui laisser les parties convenables de nerf et de remplissage, et cela suivant la qualité de chaque espèce de mines.
Planches. Des fourneaux, figure 1. ouvrier qui travaille à son fourneau : 2. 3. et 4. ouvriers qui mettent hors une gueuse, à l'aide de roulets : 5e. fondeur qui pese une gueuse : I pied de chèvre : X romaine : la gueuse : 6e, chargeur qui avec une brouette voiture les scories sur le crassier u u : o est le pont pour arriver à la halle : q bêtes chargées de sacs de charbon : p halle.
Fig. 2. ouvrier qui casse la mine riche en roche : 2e, ouvrier passant avec un panier de mine ou charbon sur le pont K K, pour arriver à la bune G G, et charger le fourneau par l'ouverture E : A A A sont les batailles : H S S la couverture sur les soufflets : P la roue qui fait mouvoir les soufflets R R : T massif en maçonnerie, sous lequel passe l'eau de la roue, et s'échappe par l'ouverture C : Q chevalet du tourillon de l'arbre des soufflets : D D liens de fer ou bois qui embrassent le dessus du massif M : L halle à charbon.
Planches suivantes. Total d'un devant de fourneau, avec ses murs extérieurs. Fig. 1. le fondeur après avoir coulé une gueuse : 2e, un chargeur qui a apporté l'arbue pour le bouchage : 3e, autre chargeur qui apporte un panier de menus charbons pour garnir le devant, et sous la tympe.
Fig. 2. A A les piliers : B B B les marastres : D le taqueret : C C la tympe en fer : G le bouchage F la dame : H la gueuse : I K un tuyau d'évaporation.
Fig. 3. représente la position des soufflets : 99 les piliers : 6 le pont pour aller à la bune.
Des fontes marchandes. On appelle fontes marchandes, toutes celles qu'on dispose à rendre d'autres services, que celui d'être converties en fer : pour cet effet au lieu de les forger on se sert de leur état de liquidité, dans la fusion, pour les jeter en moule. Les services que les fontes nous rendent dans cette partie, sont d'autant plus précieux qu'ils sont en grand nombre, d'un usage ordinaire, et d'un prix médiocre.
La première manière de couler les fontes a été de faire les moules de terre, la plus industrieuse de les faire en sable. Sans entrer dans l'énumération de tous les ouvrages qu'on peut faire en fonte, nous nous contenterons d'en décrire quelques-uns, qui mettront à portée d'imaginer ce qu'on peut faire de mieux et de nouveau.
Les canons principalement pour la marine, de petites cloches, des bombes, se coulent en terre dans des moules préparés, et amplement détaillés aux articles CANON, CLOCHE, BOMBE. Nous observerons qu'on ne fait point de cloches de fonte au-dessus de deux cent livres. On s'est imaginé qu'elle ne vaudrait rien que pour les grosses pièces, comme les canons. On a deux fourneaux accolés et en travail, pour ne pas manquer de métal. Les bombes qui peuvent se couler en sable, valent beaucoup mieux en terre.
C'est encore en terre que se coulent les gros mortiers, et de gros tuyaux pour la conduite des eaux.
Pour faire le moule en terre d'un tuyau, ce qui servira à faire entendre ceux des autres pièces, il faut une table de bois solide, du dessus de laquelle partent deux barres de fer entaillées de distance en distance, pour recevoir une broche de fer débordant la table : cette broche équarrie dans un des bouts pour recevoir une manivelle, au moyen de laquelle, de la corde, et du marche-pié, l'ouvrier peut faire tourner la broche. Pour de grosses pièces il faut un compagnon. On corroie fortement de l'arbue, mêlée avec de la fiente de cheval, et on en environne la broche. Cette première couche séchée, on y en met une seconde, et ainsi jusqu'à la grosseur nécessaire. Cette partie s'appelle le noyau, qui doit être de la dimension du vide intérieur du tuyau. Pour lui donner cette exactitude et la forme nécessaire, l'ouvrier a son échantillon, qui n'est autre chose qu'un morceau de planche entaillé, qu'il laisse frotter contre le noyau. Ce noyau fait et séché, on le saupoudre par-tout de cendres, et on le couvre de terre préparée de l'épaisseur que doit être le métal : cette partie dressée à l'échantillon, séchée et saupoudrée de cendres, est couverte d'une couche de terre préparée, épaisse, relativement à la grosseur du tuyau. Cette partie s'appelle la chape. La chape pour être enlevée, se coupe longitudinalement en deux avec le couteau ; on casse et détache la partie que le métal doit occuper, et ayant resserré et affermi la chape autour du noyau, on ensable un ou plusieurs moules à portée de la coulée du fourneau. Dans les grosses pièces on ménage un évent, dont on casse la bavure au sortir du moule.
Pour un moule de marmite à pieds et oreilles, le noyau se bâtit sur une planche, tant pour le corps du pot que les oreilles ; s'enduit de la partie que le métal doit occuper, et de la chape. Au dessus du cul du pot dans la chape, on ménage l'ouverture de la coulée, et de quoi loger les moules des pieds qui sont à part ; on coupe en deux la chape, etc. si ce sont des pièces auxquelles on veuille joindre quelque ornement. Voyez CANON, CLOCHE. Ces exemples doivent suffire pour faire entendre la fabrique des fontes moulées en terre : nous ajouterons seulement que pour les grosses pièces, on tire la fonte directement du fourneau, et pour les autres on les coule à la poche, comme celles en sable.
Les moules en terre demandent beaucoup de temps et de travail ; on a imaginé d'y substituer le sable, qui dans peu de temps est rassemblé et desuni. Les grosses pièces auxquelles il ne faut qu'une ouverture, comme les marteaux pour les forges ; les pièces solides, comme les enclumes, les contre-cœurs de cheminées, et toutes autres plaques qui ne demandent des ornements que d'un côté, se moulent à découvert. Pour une enclume, etc. proche la coulée du fourneau, vous faites une excavation convenable pour enterrer le moule de la pièce : ce moule est de bois ; vous battez en fond du sable ; posez le moule sur ce sable, qui reçoit et conserve l'empreinte, et battez du sable tout-autour. Le moule ou modèle enlevé, vous débouchez la coulée du fourneau, et laissez emplir de fonte le moule : quand il est plein, vous arrêtez la fonte avec un morceau de pâte d'arbue, et la tournez dans un ou plusieurs moules autant que le fourneau en peut fournir. Pour faire l'oeil des marteaux ; quand le modèle de bois est enlevé, vous avez un châssis monté à crochets, que vous placez où l'oeil doit être ; vous emplissez l'intérieur du châssis de sable bien battu ; vous décrochez, et retirez les pièces ; le sable reste ; et la fonte tournant autour, laisse le vide de l'oeil.
Pour les pièces autres que les plates ou solides, il faut qu'un atelier soit fourni de modèles de toutes façons, 2, 3, de sable extrêmement fin et gras ; de tamis 21, pour le passer ; de pelles et de rabots 17, 18, 19, 20, pour le remuer ; de battes 14, 19, 16 ; de maillet 7, pour le battre ; de rapes 8, 9, pour le détacher des pièces ; d'un ecouvillon 12, 13, pour l'humecter ; d'un sac de toîle 10, rempli de poussière ; de charbon tendre pour saupoudrer les chapes et noyaux, pour que la fonte ne s'attache point au sable ; de plusieurs châssis, suivant les différents ouvrages ; de la poche 4, pour couler ; de la manche 5, pour garnir le bras gauche, pour le garantir du feu.
Un sableur qui veut faire le moule d'une marmite (V. la Pl.), ayant sur son banc pour travailler à son aise, son sable humecté et tamisé, y pose la planche A A, et sur cette planche le châssis G ; ce châssis doit être précisément de la hauteur du corps de la marmite, garni des pieds dont les empreintes se font séparément, comme nous le dirons ; il renverse dans le châssis le corps de marmite H, met du sable autour, et le consolide avec ses battes ; place la monture des pieds, les patins, et la partie de la coulée qui est de la hauteur du châssis ; emplit le tout de sable bien battu : le total doit se trouver au niveau du châssis. L'ouvrier prend et renverse la partie du châssis m m, mettant les crochets en en-haut ; emplit toute l'épaisseur du quadre de sable bien battu au-tour d'un morceau de bois figuré, pour faire le reste de la coulée, comme on le voit en X ; cette partie posée sur une planche A A, on la saupoudre de blanc ; le blanc est le sable sans être humecté, que les rapes ont détaché des pièces moulées : on renverse dessus la partie G H, aussi saupoudrée de blanc ; en la renversant, la partie de la coulée et les patins tombent. On poudre les empreintes de poussière de charbon ; cette partie se rapatronne exactement par les guides m m, qui traversent les ouvertures pratiquées dans le corps du châssis, pour les loger ; et on arrête ces deux pièces par des crochets. T V X Y représentent cette partie moulée.
La monture des pièces et le corps de la marmite restant dans le châssis, la marmite se trouve alors les pieds en-bas ; elle doit bien affleurer le châssis, comme en a b. On emplit l'intérieur de sable bien battu ; on le rase avec le règlet au niveau du châssis ; et on renverse le tout sur la troisième partie du châssis, dont le quadre est exactement rempli de sable battu, comme en Z : en soulevant les deux premières parties accrochées ensemble, on laisse à découvert le noyau Y ; on frappe sur le modèle avec une batte pour le desserrer, et on le retire ; le modèle des pieds tombe ensuite. La place des anses se fait en perçant le sable dans l'endroit qui leur est destiné, y insinuant deux morceaux de bois recourbés qui se rencontrent dans le milieu ; le sable affermi autour de ces morceaux de bois, on les retire, et le vide reste. On saupoudre tant le noyau que la chape de poussière de charbon, dont on les enduit exactement avec les cuillières, qui sont des morceaux de fer plat et courbé, pour passer sur toutes les parties plates et cintrées, et y comprimer la poussière du charbon : ensuite on renverse la chape sur la partie du châssis qui soutient le noyau : on accroche les pièces ensemble ; elles se trouvent nécessairement dans la précision convenable, au moyen de la justesse du châssis et des guides : on porte le moule en cet état proche la gueule du fourneau pour les emplir de fonte, quand il y a le nombre de moules suffisans.
Toute cette manœuvre demande de l'adresse et de l'habitude : il y a, comme vous le voyez aux différents châssis, des poignées pour que l'ouvrier puisse les tourner commodément. Quand les pièces sont considérables, ils se mettent plusieurs : si la marmite avait un gros ventre, comme il s'en fait quelques-unes, et comme il pourrait arriver pour d'autres pièces, il ne s'agit que d'avoir un corps de châssis de deux pièces, qui se joindront à la plus grande circonférence ; le modèle sera de deux pièces coupées de même ; chaque pièce ensablée séparément et rejointe quand les modèles seront retirés. Les couvercles se moulent dans deux pièces de châssis rapprochées ; une porte la coulée, elle se fait dans l'intérieur du couvercle ; et l'autre, l'anneau qui se moule avec deux morceaux de bois courbés qui se joignent au milieu, pour qu'on puisse les retirer aisément.
Quatre sableurs peuvent desservir un fourneau qui produirait deux milliers en vingt-quatre heures. Quand les sableurs ont la quantité de moules relative à la fonte qui est en fusion, ils enduisent leurs proches d'arbue pétrie avec fiente de cheval, pour que la fonte ne s'y attache pas, et les font chauffer. La poche est composée d'une queue de fer que le sableur embrasse de deux morceaux de bois excavés et arrêtés par un anneau de fer, met la manche à son bras gauche, et Ve puiser de la fonte dans l'ouvrage. La poche est appuyée sur le bras gauche, tenue et tournée par la main droite pour verser dans les moules, par la coulée. Comme il faut que les pièces soient faites d'un seul jet, quand elles sont considérables, pendant qu'un sableur coule, les autres entretiennent le métal dans sa poche, en y versant les leurs : toutes les pièces en sable se moulent de même. Quand ce sont des pièces solides, comme une hurasse, vous faites l'empreinte moitié sur une partie de châssis, moitié sur l'autre ; en les fermant, vous avez une hurasse entière : le sable se soutient dans tout ce travail, quand il est fin, gras, humecté à-propos, et bien battu. Il faut que le fondeur entretienne la fonte toujours vive ; une fonte bourbeuse ou approchante du fer ferait manquer toutes les pièces, ou les rendrait d'une mauvaise qualité : il faut pour cela des mines convenables. La tympe, dans ces fourneaux, doit être un peu plus éloignée de la dame, que dans ceux à gueuse, afin que les poches puissent y entrer : une poche peut porter quarante à cinquante livres de métal. Le bouchage ne se perce que les fêtes et dimanches, jours de repos pour les sableurs : on coule alors des gueuses qui se portent à la forge avec les coulées, les bavures, les pièces manquées.
On fait des marmites de toute sorte d'échantillon, de deux livres communément jusqu'à trente, des chaudières jusqu'à cinquante : on fait même, dans le besoin, de plus grosses pièces. Le poids est ordinairement marqué sur la pièce, et leur nom vient de-là ; on dit, des marmites de quatre, de dix, etc. Les modèles se font d'étain, pour être coulés en cuivre ou fonte : l'étain, à cause de son peu de fermeté, ne convient que pour tirer d'autres modèles.
Les tuyaux ordinaires pour les eaux, se moulent en deux parties de châssis rapprochées, dans lesquelles on a renfermé le noyau de terre monté sur la broche.
Les boulets se moulent dans deux coquilles ; les coquilles se font de fonte : chaque coquille est creuse de l'étendue de la moitié du boulet ; en les rapprochant, elles forment le boulet entier. On place les coquilles entre deux madriers : on les serre à force de coins, la coulée en en-haut, et on en coule tant qu'il y a de la fonte dans l'ouvrage.
Au sortir du châssis, on casse la coulée et les bavures des pièces montées ; on en ôte le sable, en passant dessus les nappes 8, 9, qui sont des morceaux de fonte coulés avec des entailles pour enlever le sable, qu'on appelle le blanc, servant à saupoudrer : on acheve de les perfectionner avec des marteaux à chapeler, des rapes plus fines, du grais, etc. La grande attention pour les pièces considérables, est de ménager des soupiraux, pour que l'air puisse s'échapper quand on les coule ; les ouvriers sont payés à la pièce, tant par douzaine de chaque échantillon, quelquefois au poids.
Les droits du roi se paient comme par fonte en gueuse dans les pays de marque, ou à la sortie de la province.
On a Ve en France une manufacture qui avait poussé la solidité, la précision, et l'ornement jusqu'à couler des balcons, des rampes d'escalier, des lustres, des bras, des feux, etc. et au moyen du recuit, à mettre ces ouvrages en état d'être recherchés avec netteté, et polis au dernier brillant. Cette manufacture n'a pas eu toute la satisfaction qu'elle méritait, parce qu'elle ôtait tout-d'un-coup le crédit aux ouvrages de fer, de cuivre, de bronze, extrêmement couteux : c'est ce qui m'a été raconté par un des intéressés à cette manufacture, actuellement vivant, et qui m'a ajouté que le prétexte qui en a imposé au public, a été le manque de solidité ; pendant qu'à l'épreuve, deux balcons ont soutenu la pesanteur de deux milliers à laquelle ils servaient de point d'appui, à douze pieds l'un de l'autre ; et pendant que nous voyons une enclume de forge essuyer pendant dix ans les coups d'un marteau de onze à douze cent pesant, au milieu de l'eau et du feu. Je conviens qu'il faut des fontes nerveuses : mais puisqu'il y en a des minières dans le royaume, le public n'a-t-il pas perdu au discrédit d'une manufacture peu couteuse ? c'est ce qu'a bien senti M. de Réaumur, qui, dans son art d'adoucir le fer fondu, dit, parlant de cet établissement, qu'un particulier a eu en France quelque chose de fort approchant du véritable secret d'adoucir du fer fondu qui a été jeté en moule ; qu'il entreprit d'en faire des établissements à Cosne et au fauxbourg S. Marceau à Paris ; qu'il rassembla une compagnie qui fit des avances considérables ; qu'il fit exécuter quelques beaux modèles, qui furent ensuite jetés en fer ; qu'il y eut divers ouvrages de fer fondu adouci ; que cependant l'entreprise échoua ; et que l'entrepreneur disparut sans avoir laissé son secret.
M. de Réaumur ajoute qu'il a trouvé ce secret, et en fait part au public. Mouler le fer avec précision et ornement, était une partie connue ; l'adoucir pour le rechercher et polir, est un bien recouvré par son travail.
Sans nous jeter dans tout le détail des fontes convenables à ces ouvrages, nous nous en tiendrons aux fontes vives et provenant d'une mine qui donne du nerf. Pour la fusion, si on n'a pas recours aux fourneaux ordinaires, on peut la faire, ainsi que le détaille M. de Réaumur, dans de plus petits fourneaux, même dans des poches, comme quelques coureurs en usent pour empoisonner certaines provinces de fontes à giboyer. Le grand secret est de faire recuire les pièces sans évaporation dans des creusets bien clos, avec une partie de poussière, de charbon, et deux parties d'os calcinés.
Une pareille manufacture peut remplacer toutes les pièces qui demandent des sommes immenses pour être coulées en cuivre ou en bronze ; des grilles, des balcons, des rampes ornées de fleurons et feuillages, des garnitures de portes cochères, des feux pour les cheminées, des palastres de serrure avec ornements, platines, targettes, verroux, fiches, gardes d'épées, boucles de souliers, de ceintures, des étuis, des clés de montre, des crochets : l'Eperonnerie, l'Arquebuserie trouveront aussi dans cette manufacture des avantages considérables ; elle sera même utîle au roi pour les canons. Ces avantages infinis sont tirés de l'art d'adoucir le fer, de M. de Réaumur, où on peut les voir exposés d'une manière plus brillante.
ART. X. Des forges. L'attelier pour convertir les fontes en gueuse, en fer, se nomme forge, dont les parties sont les cheminées et équipage du marteau ; le tout renfermé dans un bâtiment spacieux, proche la halle à charbon, le logement des ouvriers, l'empalement du travail, et sur le bord des coursiers.
Les cheminées sont appelées chaufferies, affineries, ou renardières, suivant l'espèce de travail, construites de différentes formes, carrées, rondes ; plus ou moins spacieuses et hautes, sans que dans ces différentes dimensions on ait consulté que la fantaisie.
Les cheminées en général doivent être solidement fondées sur le bord d'un coursier qui donnera le mouvement à la roue qui fera marcher les soufflets ; elles seront toujours bien quand elles auront six pieds carrés dans œuvre sur le sol, finissant en pyramide, dont le dans-œuvre de l'ouverture de dessus, aura vingt pouces en carré ; la mâçonnerie de vingt pouces d'épaisseur, si c'est en pierre ; et de quinze, si c'est en brique, à compter du dessus des piliers ; ces piliers s'établissent sur le sol, pour laisser un espace vide convenable au travail : l'espace du devant sera de toute la longueur du dans-œuvre, du côté des soufflets ; deux pieds et demi en carré, pour loger commodément la thuyere, à compter depuis la maçonnerie qui doit porter les beuses ou bures des soufflets, sous laquelle on a logé un tuyau de fer pour rafraichir le dessous du fond de l'ouvrage : du côté du courant l'ouverture sera de quinze ou dix-huit pouces en carré, pour que les gueuses puissent entrer et être mues librement, et du côté opposé à la thuyere, d'une hauteur et largeur convenable pour entrer aisément dans la cheminée. Cette partie, ainsi que celle sur l'eau, seront terminées par des ceintres en pierre ou brique, ou des marastres, que nous avons dit être des plaques de fonte. Le devant et le côté de la thuyere seront nécessairement renforcés chacun de deux marastres, à deux pieds environ de distance l'une de l'autre : le devant sera encore garni d'une troisième marastre, qui sera à quinze ou dix huit pouces d'élévation du côté du pilier de la thuyere, et trois pieds à l'autre bout. La raison de cette position est de retenir la flamme et d'en garantir les ouvriers, en laissant à l'autre bout vers le basche, un vide nécessaire pour le service du feu.
Les piliers du devant doivent être d'un bon quartier de tailles, mieux encore de plaques de fonte coulées d'échantillon, maçonnées les unes sur les autres jusque sous les premières marastres. La hauteur du comble du tait doit régler celle des cheminées, qui doivent être de cinq ou six pieds plus élevées, à cause des étincelles qu'elles jettent perpétuellement : cette construction convient à tout travail.
L'intérieur des cheminées sur le sol doit contenir l'ouvrage et le basche. Le basche est un auge de bois d'un pied de vide, sur six pieds de longueur, garni en-dedans et sur les côtés de fer, à cause du frottement des outils, placé à rez-de-chaussée en-dedans de la cheminée, du côté opposé à la thuyere, abreuvé d'un petit courant d'eau venant du réservoir, ou jetée par des sabots attachés à la roue, sur une chanlatte qui y aboutit. Le basche est nécessaire pour le raffraichissement des outils, et pour arroser le feu.
L'ouvrage est un creuset auquel la thuyere communique, construit de plaques de fonte dans lesquelles se fait le travail du fer.
Il y a quatre plaques pour faire les côtés du creuset ; la varme sous la thuyere ; du côté opposé le contre-vent ; l'aire au dessus ; le chio sur le devant, percé d'une ouverture à la hauteur de la thuyere, pour servir d'issue aux scories, et d'une à-fleur du fond, dont on se sert dans la macération des fontes : le bas de ce carré est garni d'une plaque qu'on appelle fond, parce qu'il en fait l'office. Depuis le chio, le devant est couvert d'une grande plaque de fonte portée sur deux autres, afin de laisser vide l'espace du chio, pour recevoir les crasses qui en découlent. La grande plaque est percée du côté du basche pour recevoir la racine d'un morceau de fer fendu par le dessus en forme d'Y, pour ôter des ringards et fourgons le fer qui s'y attache dans le travail. Dans les chaufferies et renardières, on met encore une plaque sur le contrevent pour retenir les charbons ; on la nomme contrevent du dessus. Toutes ces plaques, à la varme près, ont pris leur nom de leur service ; le contre-vent, le fond, l'aire, à cause qu'elle sert d'appui à la gueuse dans le foyer ; le chio, à cause de l'ouverture excrétoire, etc.
Faire un ouvrage n'est autre chose que donner un certain arrangement à ces taques, relativement à la thuyere et à l'espèce de fonte et de travail ; d'où affineries de deux espèces, chaufferie, renardière.
L'affinerie est un creuset qui ne sert qu'à dissoudre une portion de la gueuse, la travailler pour la porter au gros marteau : au sortir de l'affinerie, c'est une loupe ; du gros marteau, c'est une pièce.
La chaufferie est un creuset destiné à recevoir les pièces, pour les chauffer à-mesure qu'on acheve de les battre.
La renardière fait l'office des deux, fond la gueuse, et pousse les pièces à leur perfection. Le creuset d'une affinerie de la première espèce, est moins large, n'a point de contre-vent du dessus, et est moitié plus profond, à compter depuis la thuyere, que celui des chaufferies et renardières : dans ces dernières, le travail de la fonte, comme dans les affineries de la seconde espèce, se fait sur le fond ; dans les affineries de la première espèce, sur la sorne. Quand on aura Ve ces deux manières détaillées, on laissera à décider à ceux que les préjugés n'empêchent pas de voir le vrai, lequel est le plus avantageux.
En général, pour une renardière et une affinerie de la seconde espèce, il faut un creuset de quinze pouces de largeur, trente de longueur, cinq sous la thuyere pour l'affinerie, cinq, six, et six et demi pour la renardière, suivant la qualité des fontes ; le fond baissant un peu du côté du contre-vent ; le trou du chio à la hauteur de la thuyere ; la thuyere bien au milieu sur la varme ; son museau avançant dans le creuset de trois pouces ; l'aire, le contre-vent, et le chio élevés de onze pouces sur le fond pour les renardières, et de sept pouces pour les affineries de la seconde espèce ; les soufflets se croisant bien dans le milieu, distribuant le vent également : voilà ce qui peut convenir à la plus grande partie des fontes ; sauf à un maître et ouvrier intelligent à augmenter ou diminuer, suivant que certaines fontes peuvent le demander ; ayant pour principe que la gueuse est au-dessus du vent, et le travail au-dessous.
Pour donner certainement à un ouvrage les dimensions et relations ci-dessus ; du milieu de l'intervalle des soufflets tirez un cordeau passant par l'ouverture supposée de la thuyere, qui fasse une ligne parallèle avec le milieu du fond : du milieu des caisses des soufflets posés à égale distance de cette ligne, tirez-en deux secondes : le point où elles se couperont à angles égaux sera le milieu de l'ouvrage ; l'égalité des angles certifie celle des soufflets. Le total ayant quinze pouces de largeur, à sept pouces et demi du point du milieu du côté de la thuyere, posez la varme perpendiculairement, carrément, et précisément sous la première ligne : vous continuerez à poser l'aire et le contre-vent quiexcéderont la hauteur de la varme de six pouces et demi ; vous poserez deux morceaux de fontes, pour servir de chantier au fond, qui sera placé à quatre pouces et demi plus bas que le dessus de la varme. Le vide de dessous le fond répond au tuyau qui doit le rafraichir : vous tiendrez le fond un peu en penchant sur le devant et le contre-vent, pour attirer les laictiers dans cette partie ; puis vous placerez le chio et la grande taque : posez ensuite la thuyere, dont vous réglerez la direction sur la position de la varme dont elle doit occuper le milieu, et entrer de trois pouces dans l'ouvrage. Rangez les barres des soufflets selon les lignes répondantes au milieu ; affermissez-les, et faites mâçonner les côtés et le dessus de la thuyere jusqu'aux marastres ; c'est l'ouvrage des goujats ; de la pierre et de l'arbue détrempées, font la solidité et la liaison : cela s'appelle faire le mureau, qui se renouvelle toutes les fois qu'il est nécessaire de toucher à la thuyere.
Si c'est une chaufferie destinée à chauffer sans fondre la gueuse, la quantité de fers qu'on y met à-la-fais demandant plus d'espace, il faut tenir le creuset plus large et les barres des soufflets plus éloignées l'une de l'autre, pour éloigner le centre.
Si c'est une affinerie, le foyer doit être plus proche ; le fond conséquemment moins large, et à neuf pouces sous la thuyere, quelquefois à dix et onze, suivant l'idée de certains ouvriers, qui n'ont d'autres raisons pour se faire valoir, que la singularité.
Les thuyeres sont de cuivre battu tout d'une pièce ; le museau bien épais, pour résister au feu ; poli, pour que rien ne s'y accroche : quinze lignes d'ouverture sur douze, pour la partie qui communique le vent ; s'élargissant sur la longueur de quinze à dix-huit pouces en une ouverture de vingt pouces sur dix à douze ; cet évasement est nécessaire pour placer commodément les barres des soufflets, qui doivent être de façon que le vent se croise au milieu de l'ouvrage ; ce qui le distribue également par-tout. Le vent doit passer sous la gueuse et sur le travail qui se fait dans le creuset.
Il faut que les cheminées soient fournies d'ouvriers et d'outils : pour une renardière ou autre qui Ve sans relâche, il faut six ouvriers, le marteleur, trois chauffeurs, deux goujats ; à l'affinerie, le maître affineur et trois valets ; le marteleur est chargé de l'équipage de sa renardière ou chaufferie, de l'entretien des outils, et doit travailler à son tour avec un chauffeur ; deux ouvriers font ordinairement six, quelquefois huit renards par tournées ; la tournée finie, ils sont relevés par deux autres chauffeurs et un goujat, et ainsi de suite. L'affinerie Ve de même par tournée ; et le maître affineur est spécialement chargé de l'entretien de son ouvrage et des outils de son affinerie.
Ces outils consistent en un gros ringard, deux moyens, deux fourgons, une pelle de fer, une écuelle à mouiller, des tenailles à cingler, à chauffer avec leurs clés ou clames, à forger avec leur anneau, un crochet, et plusieurs masses.
Un ringard est un barreau de fer dont les angles sont abattus ; le bout destiné au travail finissant en coin.
Le grand ringard se passe sous la gueuse qui est au feu, et sert au goujat de levier, pour l'avancer ou le reculer suivant le besoin. Les ringards ordinaires servent à détacher des côtés et du fond de l'ouvrage la fonte en fusion, et la ramasser en un volume. Les fourgons moins gros que les ringards, sont arrondis, et servent à être passés à-travers la fonte en fusion dans l'ouvrage ; tant pour joindre un morceau à l'autre, que pour faire jour à la chaleur et aux scories en fusion.
Dans les tenailles, on distingue les branches et le mord. Le mord est la partie depuis le clou qui sert à serrer : dans les tenailles à cingler, les branches sont arrondies et les mords unis, rentrant seulement un peu en-dedans à l'extrémité ; dans celles à chauffer, les branches sont plus fortes et mi-plates, les angles abattus, les mords très-gros, longs, et forts pour embrasser les pièces. Les branches se serrent avec des clés ou clames : une clame est un morceau de fer plat et étroit, courbé aux deux extrémités, faisant précisément une S, qu'on tire en en-haut des branches pour serrer, et que le chauffeur desserre d'un coup de pied, quand la pièce est hors du feu sur la grande taque, pour être reprise par une tenaille à forger ; la tenaille à forger est la même que la tenaille à cingler, à cela près qu'un des mords est large et arrondi pour embrasser plus fortement la pièce ; d'où on les appelle tenailles à coquille. Les branches se serrent par un anneau de fer mobile, que l'ouvrier pousse tant qu'il est nécessaire, en serrant de la main le bout des branches. La pelle de fer avec un manche de bois pour être plus légère, sert à ramasser les charbons autour du feu, les morceaux de fer autour de l'enclume ; enlever les crasses du chio, etc. L'écuelle à mouiller est une calotte de fer battu, d'un pied de diamètre, avec une douille de fer qui lui sert de manche ; sa place est proche le basche ; elle sert à arroser le feu, rafraichir la partie forgée des maquettes, jeter de l'eau sous le marteau quand on pare le feu, etc. Le crochet sert à tirer les loupes ou renards du feu, les masses ; à les battre et y pratiquer une place pour la tenaille : elles servent aussi à l'entretien des équipages, où il y a souvent à serrer et desserrer, etc. il y a encore le hacheret qui est un double ciseau avec un manche de bois ; il sert à couper les pailles qui se lèvent sur le fer en le forgeant ; des ciseaux de toute espèce, à chaud, à froid, pour tailler les enclumes et marteaux de fonte, etc. des marteaux à chapeler, qui sont des doubles ciseaux à froid, dont l'usage est de dresser les aires des enclumes et marteaux, en frappant de tous sens ; ils servent à enlever une bosse : le trait du ciseau et autres traces s'effacent par le frottement d'un morceau de pierre de meule et du grais.
Il faut encore qu'une forge soit munie ou d'une pompe qui puisse jeter l'eau par-tout, ou au-moins d'une seringue de cuivre tenant beaucoup d'eau.
L'équipage du marteau consiste en pièces cachées et en pièces vues. Les pièces cachées sont les grillages servant de fondation ; les longrines, qui emboitent le bas des attaches, la croisée, le pied d'écrevisse, le stoc : les pièces vues sont l'arbre, le court-carreau, les attaches, les bras-boutants, le drosme, les jambes, le ressort, l'enclume, le marteau.
Comme il est question d'une grande solidité, il faut que toutes ces pièces se soutiennent mutuellement avec une fondation ferme : le tout sur le bord de l'eau qui doit mettre la roue en mouvement.
Pour cet effet, excavez l'espace nécessaire pour loger toutes les pièces : il faut vingt pieds sur quinze pour donner dix-huit pouces d'épaisseur à la grande attache, deux pieds et demi d'intervalle de la grande attache au court-carreau ; deux pieds d'épaisseur au court-carreau ; du court-carreau au stoc, sept pieds ; trois pieds d'épaisseur au stoc, et quatre pieds devant le stoc, pour placer et affermir les châssis qui doivent l'embrasser : pour la largeur, le court-carreau devant être au milieu, on aura pour un côté un pied de court-carreau ; du court-carreau à l'arbre, pour placer la jambe, dix-huit pouces ; l'épaisseur de l'arbre, de deux pieds et demi ; le petit bras-boutant de l'attache à un pied au-delà de l'arbre ; et un pied et demi de vide pour le passage.
L'excavation faite, si le terrain n'est pas solide, bâtissez en grillages, comme à la fondation des fourneaux ; et quand vous aurez trois grillages d'établis et garnis, placez le stoc, et le faites embrasser par le bas d'un châssis en bois à encoches, dont les longrines et traversines doivent tenir un grand espace, et être enfermées dans la maçonnerie.
Le stoc est communément un bloc de fort bois de chêne, de 7, 8, ou 9 pieds de longueur sur au-moins trois pieds de diamétre, posé debout pour recevoir l'enclume. Quand vous serez au milieu du stoc, vous l'affermirez encore d'un pareil châssis enfermé dans le massif avec un troisième châssis au-dessus, dont les côtés passeront sous la croisée et les traversines de la grande attache : le dessus du stoc se garnit de trois ou quatre forts cercles de fer ; et on pratique dans le milieu une ouverture carrée propre à recevoir l'enclume et l'y affermir : cette ouverture s'appelle la chambre de l'enclume.
Comme un morceau de bois de cette grosseur est rare et couteux dans certaines provinces, quelques-uns se servent de quatre morceaux bien joints et liés en fer ; cela ne dure guère : le plus expédient est, depuis la fondation, d'élever châssis sur croix alternativement jusqu'au dernier, que vous ferez le plus épais, et qui formera la chambre de l'enclume : il doit être cramponé et broché en fer dans celui de dessous, qui est arrêté dans la mâçonnerie, et dont les côtés passent sous la croisée : des bois de 7 à 8 pouces pour le fond, et de 12 pour le dernier, font un excellent ouvrage. Le dessus, en cas de vétusté, est aisé à renouveller ; au lieu que c'est un ouvrage pénible et couteux, quand il faut déraciner un stoc : dans le cas qu'un stoc debout périt par la chambre, comme cela arrive toujours, on peut achever de raser les bords, et établir des châssis pour remplacer le dessus.
Quand la totalité du massif sera près du sol, vous établirez quatre longrines depuis le bord sur le coursier qui remplissent la longueur du total, posées un peu en pente pour ne pas gêner les bouts de la roue ; une à chaque bout, une de chaque côté, et à deux pieds du stoc, arrêtées par trois traversines à encoches et broches, une devant et à deux pieds du stoc ; une devant et derrière le court-carreau. L'encoche de la tête des longrines sur l'eau est en-dessous, et porte sur deux fortes traversines, dans le milieu desquelles traversines on a ménagé une ouverture pour recevoir la grande attache et lui servir de collier.
La grande attache est une pièce de bois de dix-huit pouces d'équarrissage, sur douze ou quinze pieds de hauteur, mortaisée par le devant d'une ouverture qui la traverse, de six pouces de largeur sur trois pieds de longueur, pour recevoir le tenon du drosme et le monter et descendre suivant le besoin : derrière et sur les côtés de l'attache, il y a des mortaises plus hautes que celle ci-dessus, lesquelles sont destinées à recevoir les tenons des bras-boutants : ceux des côtés portent sur les traversines, et celui de derrière sur un châssis, placé en terre, d'où il a pris le nom de taupe : au devant de la grande attache et vis-à-vis l'ouverture du court-carreau qui reçoit le ressort, on fait encore une ouverture à mi-bois pour en recevoir la queue : au bas de cette ouverture est une petite recoupe avec une mortaise pour recevoir et porter le culard, porté de l'autre bout par le court-carreau : le bas de la grande attache est entaillé devant et derrière, laissant une grosse tête d'un pied d'épaisseur sous l'entaille, et se place dans l'ouverture des deux traversines qui lui servent de collier : ces traversines sont affermies par de fortes broches de fer qui percent dans les longrines ; elles le sont encore par le pied d'écrevisse.
La petite attache porte l'autre extrémité du drosme ; est taillée de même que la grande, et ne se pose et enclave dans ses châssis et colliers, que quand le drosme est posé. Il est essentiel d'affermir le bas des attaches, parce que tout l'effort se fait en en-haut : elles sont soutenues et affermies par le bras-boutant : celui de dehors de la grande attache doit être long et fort.
A quatre pieds et demi de la grande attache élevée et affermie, on pose la croisée.
La croisée est une pièce de bois de dix-huit pouces d'équarrissage sur sept pieds de longueur, entaillée par-dessous aux extrémités, pour entrer et être serrée dans les encoches ménagées dans les longrines du milieu. Le dessus et le milieu de la croisée sont encochés d'un pied de largeur sur huit pouces de profondeur ; et à dix-huit pouces du point du milieu, on pratique des mortaises qu'on appelle mortiers, de dix pouces de profondeur, dix pouces de largeur et douze de longueur, du côté de l'arbre, et dix-huit de l'autre côté : ces mortiers servent à recevoir le pied des jambes. Chaque extrémité des mortiers doit être liée d'un bon cercle de fer ; les côtés de l'intérieur, garnis de plaques aussi de fer, passant sous les cercles et le fond de fer battu. Cette partie fatigue beaucoup.
Le pied d'écrevisse est une forte pièce de bois, fourchu, dont le pied aussi encoché entre dans l'encoche du milieu de la croisée avec un fort menton en-dehors ; cette pièce appuye sur les traversines de la grande attache dont elle embrasse le pied exactement avec ses fourches bien brochées en fer. A fleur de la croisée, le pied d'écrevisse doit être assez large pour l'étendue du court-carreau qu'il porte, et doit avoir une mortaise pour recevoir le tenon du bas.
Le court-carreau ou poupée est un bloc de bois de deux pieds d'équarrissage sur sept pieds de longueur, réduits à six par les tenons de chaque bout, qui s'emboitent dans les mortaises du pied d'écrevisse et du drosme : le milieu est traversé d'une ouverture d'un pied en carré, baissant du côté de la grande attache, pour recevoir le ressort et en élever la tête : les côtés sont aussi traversés d'une mortaise de six pouces de largeur sur huit ou neuf de hauteur, empiétant un peu sur l'ouverture du ressort qu'elle traverse par le bas : elle sert à passer sous le ressort une clé de bois qu'on serre contre le dessus par des coins qu'on chasse sous cette clé.
Derrière le court-carreau on ménage une petite recoupe et mortaise au bas du passage du ressort, pour placer et recevoir un bout du culart. Le culart est un morceau de bois de sept à huit pouces d'équarrissage, portant la queue du ressort. L'intervalle se garnit de coins pour serrer le ressort contre le dessus de la chambre de la grande attache qui en reçoit l'extrémité.
Le drosme est un morceau de bois d'une pièce, de deux ou de quatre ; de deux pieds d'équarrissage sur au moins 30 pieds de longueur : il a à chaque bout un tenon qui entre dans les mortaises des attaches, dessous une mortaise qui reçoit le tenon du court-carreau, sur lequel il porte. L'excédent des mortaises des attaches sous les tenons du drosme se remplit de clés et de coins de bois, qui chassés avec force serrent le drosme contre le court-carreau : cette opération fatiguant beaucoup les tenons du drosme, qui est une pièce à ménager, il est utîle d'en garnir le dessus d'un faux tenon de bois ; quand il est usé, on desserre les broches qui le tiennent, et on en substitue un autre. Il est encore prudent de garnir le dehors des tenons, ainsi que le dessus de la grande attache, de taule ou fer blanc, pour les garantir de l'humidité de l'air.
Il faut au drosme de la force et de la pesanteur, pour tenir tout l'équipage ferme et de longueur, pour que les ouvriers puissent se tourner avec les bandes de fer, pour les parer sans toucher à la petite attache.
On ménage deux encoches dans les côtés du drosme, de quinze pouces de largeur sur six pouces de profondeur, répondantes aux mortiers, pour recevoir la tête des jambes, qu'on avance ou recule suivant le besoin dans ces encoches, et qu'on arrête par des coins chassés de chaque côté à coups de masses. Quand le travail a fort endommagé les côtés des encoches, au lieu de mettre un drosme au rebut, on enlève ce qui est endommagé ; et dans le vif on fait une entaille finissant en pointe, pour que la pièce qu'on y appareille ne puisse se déranger. Cette pièce doit être bien brochée, et se renouvelle dans le besoin.
Les jambes sont deux morceaux de bois de dix pouces d'équarrissage vers les boites, finissant à six ou sept au pied et à la tête ; un bout porte dans le mortier, l'autre dans l'encoche du drosme : celle qui est proche de l'arbre s'appelle la jambe sur l'arbre, l'autre, la jambe sur la main. Sous le drosme, chaque jambe est percée d'une ouverture carrée de trois pouces sur huit, lesquelles se répondent, pour passer un morceau de bois qu'on nomme la clé tirante, de l'échantillon de la mortaise sur six pouces de hauteur, laissant une tête à un bout. On passe la clé par la mortaise de la jambe sur l'arbre, à laquelle elle est arrêtée par la tête, traversant celle sur la main : dans ce qui déborde, on fait de côté une mortaise, dans laquelle chassant des clés et des coins, elle rapproche les jambes l'une contre l'autre, les serrant contre le drosme.
Pour empêcher la clé de vaciller, entr'elle et le drosme on pose un morceau de bois qui embrasse la clé par une encoche ; et en chassant des coins sous la clé par les mortaises des jambes, ce morceau de bois appelé tabarin, se serre contre le drosme, et tient la clé ferme.
Les jambes en-dedans et vis-à-vis l'une de l'autre, à huit pouces de hauteur depuis le dessus des mortiers, sont emmortaisées d'une ouverture de cinq pouces de largeur, quinze de hauteur, et quatre de profondeur pour recevoir les boites. Les jambes sont bien serrées dessus et dessous les boites, et les côtés de la mortaise garnis de lames de fer.
Une boite est un morceau de fonte ou de fer, long de neuf à dix pouces, large et épais de quatre, qui se place dans les mortaises, et y est arrêté par des coins dans le point convenable : on en change la position de haut et bas, devant et arrière, suivant la portée de la mortaise.
Dans les boites de fer, on fait plusieurs excavations rondes d'un pouce de diamétre, sous six ou sept lignes de profondeur, pour recevoir les bouts de la hurasse. Un morceau d'acier trempé et froid sur lequel on frappe quand la boite est rouge, fait promptement ces excavations ; dans les boites de fonte, on les ménage en les moulant. Les jambes sont affermies à la tête dans les encoches du drosme ; sous le drosme, par la clé tirante ; au pied, par les mortiers.
Le ressort est une pièce de bois de hêtre, ou autre souple et ferme, d'environ neuf pouces d'équarrissage, de la longueur convenable, pour du fond de la mortaise qui lui est destinée dans la grande attache, en passant par le court-carreau, aboutir proche le marteau. On distingue dans le ressort la tête et la queue : la tête est le bout proche le marteau, plus gros que le reste, évuidé à la distance d'un pied jusqu'à son entrée au court-carreau : la queue est la partie qui porte sur le culart, et s'insinue dans la mortaise de la grande attache où elle est serrée : le ressort est encore serré dans le court-carreau par la clé qui est dessous. Il faut, pour qu'un ressort joue bien, qu'il ne soit ni trop rude ni trop faible, suivant la force de l'attelier ; que depuis le court-carreau, il soit choisi et taillé de façon à tourner la tête du côté de l'arbre sans toucher la jambe : la position de l'enclume le veut ainsi, pour que les bandes de fer ne donnent pas dans les bras de l'arbre.
L'enclume est un bloc de fonte carré par le bas, de seize à dix sept pouces de diamétre, sur la hauteur d'environ vingt-quatre ; et depuis ces vingt-quatre pouces venant insensiblement de deux côtés en diminuant se terminer à quatre pouces d'épaisseur sur la hauteur de seize ; ce qui fait une hauteur totale de trois pieds quatre pouces, et peut peser environ deux mille cinq cent : le bas de l'enclume s'appelle le bloc ; et le dessus où on bat le fer s'appelle l'aire : l'aire d'une enclume se taille au ciseau, au marteau à chapeler, et se polit avec la pierre de meule et le grais. Il y a des fontes qui souffrent la lime. Il faut que l'aire de l'enclume soit bien dressée, inclinée du côté du court-carreau : il faut aussi que le dessus de l'enclume soit plus tourné vers l'arbre que la partie qui regarde les jambes ; de façon qu'une bande de fer, en suivant l'aire de l'enclume, puisse passer entre le court-carreau et la jambe sur la main : cette direction empêche que les barres de fer qu'on pare ne donnent dans les bras de l'arbre. L'enclume ainsi disposée dans la chambre du stoc, de la profondeur d'un pied, se serre avec des morceaux de bois de chêne posés debout, et farcis de coins chassés à force. On ménage dans un coin la place d'un morceau de bois qu'on place du sens contraire, qui s'appelle la clé ; c'est ce qui s'enlève d'abord, quand il faut débloquer une enclume.
Le marteau doit se poser bien à-plomb sur l'enclume, et son aire doit avoir les mêmes dimensions ; cette partie comprend le manche, la hurasse, la brée, et le marteau.
Le manche est une pièce de bois de hêtre ou charme, de neuf jusqu'à douze pouces d'équarrissage ; les arêtes abattues tenant depuis le derrière des boites jusqu'au-devant de l'enclume. La partie qui répond à l'aire de l'enclume est taillée à entrer dans l'oeil du marteau, et s'appelle l'emmanchure ; la queue est la partie qui répond aux boites, et qui est garnie de la hurasse.
La hurasse est un anneau d'un pouce et demi d'épaisseur sur cinq à six pouces de largeur, de fer ou de fonte, propre à recevoir la queue du manche. La hurasse est terminée du côté de la jambe sur l'arbre, par un bouton de trois pouces de longueur, qu'on place dans l'excavation de la boite, et qui s'appelle le court-bouton : l'autre côté est allongé d'environ vingt pouces, et aboutit à l'excavation de la jambe sur la main ; cette partie s'appelle la grande branche. La queue du manche est bien serrée dans la hurasse par des coins de fer chassés dans le bois pour le renfler.
La brée est un morceau de fer battu, embrassant le manche du marteau vis-à-vis les bouts de l'arbre, s'élargissant à la partie exposée au frottement des sabots qui lèvent le manche. C'est pour le garantir de ce frottement qu'on se sert de brée. Des bouts de la brée, l'un finit en anneau, et l'autre en pointe ; elle se pose à chaud : quand la pointe est entrée dans la boucle, on la courbe pour l'arrêter, et on refroidit.
Le marteau est de fer ou de fonte, de deux pieds et demi de hauteur, sur un pied de largeur jusqu'au-dessous de l'oeil, et plus ou moins d'épaisseur, suivant le poids qu'on veut lui donner, et la longueur de l'aire de l'enclume. Depuis l'oeil le bloc s'épaissit, ensuite diminue, pour être réduit aux mêmes dimensions que l'aire de l'enclume. Un marteau pese depuis six cent jusqu'à un millier. L'oeil a cinq ou six pouces de largeur, sur quinze à dix-huit de hauteur. La tête doit avoir une épaisseur proportionnée, environ deux pouces. L'oeil est pour recevoir l'emmanchure du manche, garni de sa hurasse, placée dans les boites. Le manche est arrêté au marteau par une clé et coins de bois, chassés à force sous l'emmanchure. Par la disposition des pièces, il est aisé de mettre le marteau bien sur l'enclume. La jambe sur l'arbre ne se remue du pied que le moins qu'il est possible ; le bout du court-bouton est comme le centre des mouvements. La jambe sur la main avance, recule aisément dans le mortier, et l'encoche ; et conséquemment avance ou recule la grande branche et le marteau. La boite se lève ou baisse suivant le besoin. Quand on est parvenu à bien placer le marteau, on serre toutes les pièces. Le ressort ne s'arrête que quand le marteau est fixé. Le manche doit le frapper entre le marteau et la brée ; la distance du manche au ressort est environ de seize à dix-huit pouces.
L'on donne le mouvement au marteau par le moyen d'une roue placée dans un coursier, proche l'empalement du travail, si c'est une roue à aubes, ou sous la huche, si c'est une roue à seaux. Les bouts de la roue traversent, et font mouvoir un cylindre de bois, qu'on appelle l'arbre du marteau.
L'arbre du marteau doit être de la longueur convenable à l'espace, qui est depuis l'enclume jusqu'au delà du coursier ; il s'arrondit pour être plus propre au mouvement circulaire, et doit porter trente pouces au-moins de diamétre au gros bout vers l'enclume, finissant à vingt-quatre. A chaque bout on ménage une ouverture pour placer les tourillons.
Un tourillon est une pièce de fonte, dans laquelle on distingue la meche et les ailes. La meche est la partie arrondie qui tourne sur l'empoise ; et les ailes la partie large et aplatie, qui entre et est serrée dans les bouts de l'arbre. La meche doit être précisément au milieu ; plus son diamétre est petit, plus l'arbre tourne aisément. La meche peut être solide, étant de trois pouces de diamétre, sans la faire de sept ou huit. Les ailes doivent être larges pour être mieux serrées, sans être trop profondes, parce que cela éloignerait les bras du bout de l'arbre ; dix pouces suffisent.
L'empoise est un morceau de fonte plat, creusé par le dessus pour recevoir la meche. L'empoise du tourillon de la roue peut avoir six pouces de hauteur, douze de longueur, trois d'épaisseur. Pour la reculer ou avancer, suivant le besoin, on la pose dans une entaille d'un chevalet de bois, beaucoup plus longue que l'empoise ; on l'arrête avec clé et coins par les bouts. Celle du tourillon des bras est beaucoup plus haute, et a son pied de la largeur du diamètre de l'arbre. En coulant, on a ménagé deux trous dont on se sert pour le mouvoir, à l'aide de deux ringards ; elle porte sur une enclume qui sert de chevalet. Le chevalet doit être plus bas que l'aire de l'enclume au stoc, pour ne pas gêner le forgeage du fer.
L'arbre vis-à-vis le coursier ou sous la huche, est percé pour recevoir les bras de la roue ; il est aussi percé à dix pouces de bord de l'autre extrémité pour recevoir les bras.
Les bras sont deux morceaux de bois de hêtre ou chêne, encochés en croix par le milieu et à mi-bois, de neuf pouces d'équarrissage, traversant l'arbre dans lequel ils sont serrés avec clé et coins. Chaque extrémité des bras déborde l'arbre de douze pouces, réduits par-derrière à six pour l'échappement du manche. L'arbre étant proche le manche et les bras sous la brée, il ne peut tourner que les bras ne fassent lever le manche : quand le bras est passé, le manche tombe par le poids du marteau ; le second bras le releve, et ainsi de suite : la violence du mouvement s'exerce aux boutons de la hurasse contre les jambes. Le marteau lève et baisse quatre fois à chaque tour d'arbre ; et sur un bon courant, l'arbre peut faire vingt-cinq tours par minute. Cette vitesse jetterait le marteau bien haut, s'il n'était arrêté et renvoyé par le ressort, ce qui augmente la force des coups de marteau, et les distribue également. On donne par le moyen de la palle, l'eau qu'on juge à-propos ; pour la lever ou baisser on a un levier qui lui est attaché, un point d'appui, et une petite perche pendante à l'autre extrémité du levier proche le marteau.
Comme on ne peut renouveller les bras que le frottement use sans y employer bien du temps et fatiguer l'arbre, on les garnit par-dessus d'un morceau de bois de hêtre de la même forme que le bras, bien taillé pour poser sur l'arbre auquel on laisse des bosses pour cette raison. Ce morceau de bois s'appelle sabot ; il est arrêté intérieurement contre le bras par des boulons de fer, et serré par le bas d'un fort lien de fer qui enveloppe le sabot et les bras : quand les sabots sont usés, on lève les liens et on y en substitue d'autres ; c'est l'affaire de deux ou trois heures.
L'arbre est relié en fer depuis le tourillon des bras jusqu'aux sabots, huit ou dix liens derrière les sabots, autant derrière les bras de la roue, sur le tourillon en plein. L'arbre doit aller en diminuant, afin qu'en enfilant les liens par le plus petit diamètre on puisse les serrer en le chassant à force.
Il n'est pas toujours possible de trouver des pièces pour faire un arbre d'une seule ; alors on peut en employer quatre ou neuf. L'attention qu'il faut avoir en pareil cas, est d'employer du bois sec, bien dressé et venu dans le même terrain, pour qu'un côté ne soit pas sensiblement plus lourd qu'un autre.
Un arbre plus pesant d'un côté, soit par la qualité du bois, soit par la fausse position des tourillons, ou faute d'être bien dressé, est un arbre qui périt nécessairement en peu de temps par l'inégalité du travail. Quand un arbre est de plusieurs pièces, il faut multiplier les liens de fer.
Plusieurs choses diminuent l'effort des bras pour lever le marteau ; la petitesse des tourillons, la moindre longueur des bras et du manche, la proximité des bras de la tête du marteau, le moindre diamètre des boutons de la hurasse, un peu d'inclinaison de l'arbre du côté de la roue ; il vaut mieux que ce tourillon soit plus chargé que l'autre : le frottement échauffant prodigieusement les tourillons, les boites, la hurasse, on a soin de ramasser dans de petites chanlattes l'eau que la roue jette très-haut, pour en conduire partout. Les bras sont rafraichis et alaisés par l'eau qu'ils rencontrent en-dessous.
Pour ne point retarder le travail, il faut qu'une forge soit munie de clés, de coins, de sabots, de bras, de manches, de plusieurs boites, hurasses, marteaux, enclumes, etc.
Les hurasses se font de fonte ou de fer : de fonte, elles se moulent en sable : de fer, elles se fabriquent dans les forges, ajoutant, ainsi que pour la fabrication des marteaux, plusieurs mises de fer sur un bloc préparé sous le gros marteau. Pour fabriquer les marteaux, il faut deux foyers, un pour chauffer le bloc, l'autre pour chauffer les mises ; il faut être muni d'un nombre de bons bras armés de masses pesantes, pour souder à grands coups et promptement les mises au bloc. Tout dépend d'un degré de chaleur convenable. On en fait de même quand il y a une réparation à faire. La soudure n'est autre chose que la compression vive et prompte d'un morceau de fer bien chaud, sur un autre morceau de fer bien chaud. L'ouvrage se polit par le ciseau, dont les traces s'effacent par des coups de marteau polis, ou par la lime.
On n'a qu'à consulter nos Planches et leur explication, pour prendre des notions justes de toutes les pièces qu'on vient de détailler, de leur position, de leur figure, de leur usage, etc.
Dans les renardières, le travail du fer se fait en avançant la gueuse dans l'ouvrage contre le contrevent, la couvrant de charbons et faisant marcher les soufflets ; bien-tôt cette partie de la gueuse qui est au-dessus du vent, se met en dissolution et tombe par morceaux, quelquefois assez gros, dans l'ouvrage. L'office du goujat est d'entretenir le charbon, de le bien retrousser sur le foyer, et de l'arroser souvent d'eau pour concentrer la chaleur. Celui du chauffeur est, à mesure que la gueuse se dissout, d'éloigner les parties de fontes du contrevent et de la thuyere, avec la pointe du ringard : quand il sent qu'il a assez de fontes, il pique avec le ringard sur le fond et les côtés, pour détacher et ramasser sa matière en un volume ; il acheve d'épurer le métal, et de joindre une partie à l'autre en y insinuant de toutes parts le fourgon. Le vide du fourgon fait entrée à la chaleur, et sortie aux corps étrangers en fusion. Toute cette opération se fait sous le vent. Par les parties que rapportent les ringards et fourgons, l'ouvrier connait l'abondance, ou la rareté, ou la qualité des scories dites laictiers ; il n'en faut qu'une certaine quantité, le chio débarrasse l'excédent, un coup de ringard en débouche l'ouverture. La tenacité des scories se corrige en jetant dans le foyer des scories, et la trop grande fluidité en y jetant de l'arbue : cette pâte, ainsi travaillée dans le creuset, s'appelle renard. Il faut qu'un renard soit bien ramassé et pétri. De-là il est clair que c'est l'application du phlogistique, et le travail des ringards et des fourgons, qui changent la fonte en fer. Ce travail ne consistant qu'à donner lieu à la sortie des scories, et à joindre et broyer les parties : le changement ne s'opère donc que par une espèce de trituration et séparation faite sous le vent. S'il était possible de joindre à une espèce de fer des corps qui en changeassent la qualité, ce serait-là surement le temps. Quand le renard est travaillé, le goujat jette dessus une pelletée de battitures de fer mouillées, qui se ramassent autour de l'enclume. Ce rafraichissement durcit le dessus du renard, et concentre la chaleur. Pour le tirer du foyer, un chauffeur le soulève avec un ringard, du côté de la thuyere, et l'autre du côté du contrevent. Quand il a fait un demi-tour, on le tire avec le crochet, et le roule sur un paquet de fonte mise à fleur de terre, qu'on appelle refouloir. Quand le renard tombe de la grande taque, il est à craindre qu'il n'y ait de l'eau. L'eau comprimée par la chute et raréfiée par la chaleur, jette le renard en éclats au risque des ouvriers. On obvie à cet inconvénient, en le laissant couler doucement à l'aide d'un ringard. Le renard sur le refouloir est battu à coup de masse pour l'affermir, et faire la place de la tenaille à cingler.
Cingler est porter le renard sous le gros marteau : cette opération demande de l'adresse et de la promptitude, et le réduit en un carré long d'environ quatre pouces d'épaisseur, ayant soin de faire battre les angles. Le renard change de nom, et s'appelle alors la pièce. Pendant qu'un chauffeur cingle son renard, l'autre a fait avancer la gueuse pour en obtenir un autre. La pièce se porte sur la grande taque ; le second chauffeur la serre dans les tenailles à chauffer, et la fourre dans le foyer. Quand elle est chaude au fondant, elle est reprise par des tenailles à coquille, portée au marteau, auquel on fait battre le milieu pour la réduire dans les dimensions qu'on donnera au reste ; c'est alors une encrenée. Chauffée du bout opposé à la tenaille, et battue comme l'encrenée, elle devient maquette, qu'on refroidit dans le basche pour faire chauffer la tête, qui acheve de se forger à une, deux, trois chaudes, pour enfin prendre le nom de bande ou barreau. Dans un feu bien servi, quatre ouvriers peuvent faire douze à quinze cent de fer en vingt-quatre heures. Un seul marteau peut desservir deux renardières.
Le fond, dans les affineries, de la première espèce est éloigné de la thuyere de neuf à dix pouces. On ne se sert point de contrevent de dessus : quand il est question d'y faire du feu, on avance la gueuse, on garnit le fond de fasins ; et quand la gueuse est en dissolution, on ramasse et presse la matière, en tirant le ringard appuyé aux angles de l'aire. Le travail se fait à plus de quatre pouces de hauteur du fond. Les scories coulent sur le fond ; et à mesure que les fasins se consomment, elles en occupent la place ; ce qui en refroidissant s'appelle sorne, sur laquelle le travail se fait. Quand il y a trop de laictiers on lève des morceaux de la sorne dans les coins pour leur faire place. Dans les renardières il y a aussi des scories en fusion qui forment une sorne quand on arrête le vent et qu'on met hors, quand on recommence le travail. La matière pétrie et ramassée sur la sorne, s'appelle loupe, qu'on tire, refoule, cingle comme les renards, et porte à la chaufferie pour être chauffée et battue.
Les affineurs n'ont d'autre occupation que de faire des loupes et les cingler. Pour servir une chaufferie, il faut au moins deux affineries : quand on n'en a qu'une, on fait aller la chaufferie en affinerie, et on amasse un nombre suffisant de pièces pour monter une chaufferie. Pour voir l'avantage des renardières ou affineries, il n'y a qu'à en considérer les opérations ; l'une et l'autre en travail dépense autant de charbon. Dans la renardière, tout l'ouvrage se fait dans un même foyer ; dans une affinerie, on ne fait que des pièces ; il faut un second foyer pour les achever, d'autant dispendieux, qu'il faut réchauffer tout ce qui ne vient pas de dessous le marteau. Il est vrai que les pièces sont plutôt faites aux affineries qu'aux renardières, parce que le foyer et l'ouvrier n'ont qu'une occupation : mais dans une manufacture y a-t-il à balancer entre l'abondance et l'épargne ? Vous aurez un quart d'ouvrage de plus (c'est porter la chose trop loin), et sur le total vous dépenserez un quart de charbon de plus. Entrant dans l'intérieur des deux foyers, la sorne ne fait-elle pas vraiment l'office du fond ? A l'élévation de la sorne, pourquoi ne pas substituer un fond ? la sorne n'absorbe-t-elle pas elle-même beaucoup de parties de fer ? Passez au bocard les scories des renardières et les sornes des affineries, pour en être convaincu. Le fer, dit-on, s'engraisse, s'adoucit dans les laictiers : cela est vrai quand le fer en a manqué ; mais dans tous les cas y en ayant toujours en fusion sur le fond des renardières, le fer est plus à portée de s'en abreuver que sur la sorne des affineries : l'expérience ne nous dit-elle pas que le fer des renardières, à fontes égales, est le meilleur ?
Les affineries ont été en vigueur tant que dans certains cantons on n'a point connu les renardières, dans des temps où les bois étaient en abondance, et conséquemment de peu de valeur. Qu'importait la dépense d'un quart de plus de charbon, pour avoir plus d'ouvrage ? La coutume pour des gens qui en respectent jusqu'aux abus, la prévention, le manque de fermeté, sont aujourd'hui le soutien des affineries. D'honnêtes manufacturiers de dessus la Marne m'ont dit qu'ils n'avaient pu déterminer les ouvriers à les quitter, qu'il y aurait même du danger à les vouloir forcer.
Le travail, dans les affineries de la seconde espèce, se fait comme dans les renardières, sur le fond à cinq pouces, sous la thuyere. La multiplicité des pièces ou la qualité des fontes oblige dans les renardières à mettre le fond à six et quelquefois à sept sous la thuyere, ayant chio pour vider les laictiers, contre-vent pour conserver les charbons, etc. le bien qui résulte de cette façon de travailler, c'est de faire plus d'ouvrage ; et que le fer porté à la chaufferie soit moins exposé à bruler que dans les renardières, le forgeage étant la seule occupation des chauffeurs. On peut donc travailler utilement dans les renardières et affineries de la seconde espèce, avec chaufferie. Pour les affineries de la première espèce, il faut les abandonner.
Bien des gens voudraient trouver ici le moyen de faire des fers doux ou cassants avec les mêmes fontes, par le seul moyen des foyers. Je le répète encore, les qualités essentielles du fer viennent de l'espèce de la mine ; les qualités relatives viennent du travail, qui peut purifier, rectifier, diminuer, ajouter, altérer, mais ne peuvent jamais changer la nature. Ne pouvant parler qu'en général d'une matière si diversifiée, possédant la position des soufflets, de la thuyere, la distribution du vent entre la gueuse et le travail, son égalité dans tout l'ouvrage, est-il si difficîle de faire, suivant le besoin, des mutations dans le foyer ? Eloigner, rapprocher, agrandir, retrécir, etc. sont des choses auxquelles un maître devrait présider, et avec lesquelles il trouverait aisément le degré convenable à ses matériaux. Un maître devrait dire aux ouvriers les raisons de leur travail ; par exemple que les coups de ringard des côtés sont pour ramasser la fonte en dissolution sur le fond, pour la soulever à un certain degré, pour la serrer et pétrir ; que trop soulevée, elle se remet en dissolution comme la fonte ; que le charbon bien ramassé et arrosé, concentre la chaleur ; que le plus grand degré de chaleur est au milieu de l'ouvrage sur le vent, etc.
Il y a des fontes cuivreuses dont le fer, à cause de ce mauvais alliage, est d'un très-mauvais usage. On le corrige par la macération.
La macération est la dissolution et fusion de la fonte dans un foyer, qu'on lâche sans travail par le trou du chio qui est contre le fond ; de-là elle est portée dans un second foyer pour y être travaillée en fer. Cette opération brule les parties cuivreuses qui résistent moins à un grand degré de chaleur, surtout quand il est multiplié.
On se sert encore de la macération pour les gros blocs de fontes, comme les enclumes, quand on veut les réduire en fer. Les parties fondues se mettent dans les renardières, à côté de la gueuse, proche le contrevent, et se mêlent et travaillent avec les parties de la gueuse en dissolution.
On emploie de même les vieilles ferrailles, abandonnant celles où on a employé du cuivre ; les morceaux de fontes ou fers tirés des scories par les bocards ; la vieille poterie, etc.
Forger le fer est quand il est chaud le porter entre l'enclume et le marteau dans leur sens étroit ; le remuer et tourner à-propos pour le souder ; ramasser, allonger et le mettre à-peu-près de l'échantillon qu'on veut donner à la barre. Le parer est placer ce même fer ainsi battu, sur la longueur des aires de l'enclume et du marteau, en commençant par l'extrémité ; ce qui abat les inégalités et les empreintes du marteau. En retour on acheve de le polir, en y jetant de l'eau.
Les fers doivent être bien travaillés, également battus, sans pailles ; ce qui dépend du degré de chaleur, de la justesse du marteau et de l'enclume, et de l'adresse des ouvriers. Quand il reste quelques pailles, le goujat les coupe avec l'acherot, et le marteau en efface les marques. Le fer en forgeant se couvre d'une espèce de peau, provenant des matières que le coup du marteau en fait sortir. L'eau jetée sur le fer quand on le pare, fait sauter avec éclat cette sueur et les petites pailles.
Quand dans une pièce il se trouve quelque corps étranger d'enfermé, le fer se crevasse et ne soudra jamais : alors si vous prévoyez qu'une chaude donnée à cet endroit ne puisse fondre ce corps ; quand la barre d'ailleurs sera finie, vous la coupez à cet endroit et chauffez les deux bouts, les rengraissant d'un peu de fer dans le foyer, les appliquant l'un sur l'autre sous le marteau ; la soudure est faite au premier coup ; vous achevez de battre et parer. Il ne faut faire cette opération que quand le fer du foyer est travaillé. On en fait de même pour ajouter du fer nouveau à un ringard, etc.
Les fers se distinguent en fers fins, channins, et cassants. Les espèces intermédiaires sont appelées fers bâtards. Les fers se fabriquent en marchands, de fenderie, de batterie ; les marchands sont en lames, en barreaux. Les lames sont depuis 14 à 15 lignes de largeur, jusqu'à 40 et 45 ; de 15 à 20 lignes s'appellent petits fers ; de 20 à 30, fers larges ; de 30 et au-delà, petits et grands larges. Les barreaux ordinaires sont depuis 9 lignes jusqu'à 12. On en peut faire jusqu'à 4 pouces d'épaisseur ; mais passé deux pouces, c'est un prix différent du courant. On fait aussi des demi-barreaux, qu'on appelle mi-plats. Les barreaux au-dessous de neuf lignes, et les barres au-dessous de 15, se battent au martinet, dont on donnera un petit détail à la fin de cet article.
Les fers de fenderie se fabriquent de 25 à 30 lignes de largeur, sur 6 à 9 lignes d'épaisseur, et se transportent aussi dans les fenderies.
Ceux des batteries se divisent en barres et souchons ; les barres sont d'un pouce sur un et demi ; les souchons d'un pouce et demi sur quatre.
Le déchet ordinaire de la fonte réduite en fer, est au moins d'un tiers, quinze cent de fonte pour un mille de fer. Le poids diminuant au prorata du nombre des chaudes et des coups de marteau, il n'est pas étonnant que la diminution soit plus grande dans les fers marchands, que dans les autres. Une pièce pour être mise en barre de fer marchand, se bat à quatre ou cinq chaudes, en fenderie et batterie à trois chaudes, en souchons à deux ; ainsi quelquefois il faudra plus de 1500 de fonte au fer marchand, et moins aux autres espèces. Le poids de forge est de quarante livres par mille.
Les fers fins que fournissent plus abondamment le Berri et la Comté, sont spécialement destinés pour la marine et les armes ; les fers approchant du fin, se fondent pour les clous des chevaux ; les cassants, pour les clous à ardoise.
Les fers fins composés de beaucoup de nerfs longs, forts et déliés, se battent et polissent bien ; ceux qui s'en éloignent, ayant les nerfs plus gros et moins longs, sont sujets à être pailleux ; les cassants ne sont point sujets aux pailles, étant composés de molécules qui se prêtent et s'arrangent suivant les coups de marteau.
Le grand débit des fers se fait à Paris et à Lyon, d'où ils se distribuent aux autres provinces. Lyon fournit les manufactures de Saint-Etienne et la foire de Beaucaire.
La France étant fournie de manufactures de fer bien au-delà de sa consommation, et comme il est vrai d'ailleurs que la multiplicité des forges est une des causes de la diminution des bois de chauffage et d'autres services ; cette diminution étant la cause de leur cherté, et relativement de celle du fer, ne serait-ce pas rendre service au public de faire détruire les usines qui n'ont point d'affouages par elles-mêmes, puisque c'est un moyen d'épargner les bois, de les vendre à un moindre prix, et conséquemment le fer ? Quelques propriétaires de forges pourraient perdre à cet arrangement. Ceux qui pensent bien, sacrifieraient volontiers une petite partie de leur revenu en faveur du public : il ne faut guère s'inquiéter de ceux qui pensent mal.
Des martinets. Les martinets sont composés d'un foyer et d'un ou plusieurs marteaux mis en mouvement par l'eau.
Le foyer d'un martinet est élevé pour l'aisance de l'ouvrier ; l'aire est de terre battue comme un foyer d'une forge de maréchal ; le devant garni d'une grande taque, sous laquelle on place en pente un chio, dont le trou est à fleur du foyer ; la thuyere est aussi à fleur du foyer. Il n'y a qu'un soufflet double de cuir ou de bois, pour communiquer le vent ; le soufflet est mis en mouvement par ses cammes ou une manivelle, répondant de l'arbre au soufflet par des leviers multipliés, ce qui fait lever le soufflet ; il est rabaissé par un contre-poids. Devant le foyer il y a un chevalet de bois pour soutenir le bout des bandes.
Le marteau pese depuis 50 jusqu'à 150 livres. La hurasse est au tiers du manche. Les branches de la hurasse sont d'égale longueur. Les boites sont dans de fortes jumelles de bois, arrêtées en-dessous dans un fort châssis, et au-dessus par une traverse. L'ouverture pour placer les boites est à jour, et elles se montent, baissent, reculent, ou avancent par des coins qu'on chasse en-dehors. L'arbre du martinet doit être le plus gros qu'il est possible, pour y loger beaucoup de cammes, qui doivent répondre à la queue du manche. Quand une camme vient à appuyer sur sa queue, le marteau lève ; pour qu'il soit levé et rabaissé également, sous la queue on place une taque de fonte à assez de distance pour laisser échapper la camme. Cette taque renvoye le manche ; il est rabaissé par une autre camme, etc. L'arbre peut porter de douze jusqu'à vingt cammes, et conséquemment dans un tour, le marteau frappera de douze jusqu'à vingt coups. Un même arbre peut faire marcher plusieurs martinets. Le marteau est de fer ; l'enclume est aussi un morceau de fer enchâssé dans un bloc de fonte servant de stoc, dans lequel elle est serrée par des coins. L'enclume et le marteau se dressent à la lime. L'objet du martinet est d'étirer le fer de forges, et de le réduire en plus petits volumes, bien dressé et poli pour différents ouvrages de serrurerie. Pour servir un martinet, il faut deux ou quatre ouvriers ; ordinairement ils ne sont que deux, le martineur et le chauffeur. On coupe le fer de forge de deux à trois pieds de longueur ; on en met dix, douze morceaux à-la-fais au fer : on commence par faire chauffer le milieu. Le martineur est assis proche le marteau sur un banc, tenant d'un bout dans un crochet de fer où il est mobile, et suspendu de l'autre par une chaîne, afin de pouvoir avancer et reculer sans se déplacer. Le chauffeur porte une pièce quand elle est chaude ; le martineur la fait battre sur le travers de l'enclume et du marteau, pour l'étirer. Il ne se lève que pour parer, et arrose lui-même le fer en tournant un petit robinet répondant au-dessus du marteau. Quand la première est battue d'une étendue convenable à la chaude, le chauffeur en apporte une seconde, et successivement, jusqu'à ce qu'ils en aient ce qu'ils peuvent forger en un jour ; puis on recommence à chauffer une autre partie de la barre, et ainsi jusqu'à ce qu'elles soient finies. Le marteau n'arrête que pour les repas et le soir, qu'on emploie à botteler la journée. Les bottes sont de cinquante livres poids de marc. Les fers se battent en barreaux de cinq, six, à sept lignes ; en mi-plats, en ronds, en bandes de deux à trois lignes d'épaisseur, pour cercles de foudre, etc. On y bat et arrondit du fer pour les fileries ; dans ce cas le martineur ne le pare jamais, mais se contente de l'étirer sur le travers, crainte de déranger le fil des nerfs. Deux ouvriers peuvent forger cinq cent de fer par jour.
On voit dans nos Planches un martinet : m n le soufflet : k un morceau de fer tenant au soufflet, et répondant au levier g h, qui répond par les leviers n c aux cammes de l'arbre, pour donner le mouvement au soufflet : S est un ouvrier qui a débouché le chio. Figure 3. autre ouvrier qui acheve de nettoyer son foyer : I le bout de la thuyere. La figure 1. est le martineur, avec sa bande sous le marteau : a l'enclume : n le marteau, etc. La vue seule indique toutes les autres pièces.
ART. XI. Les fenderies. Le but des fenderies est de diviser une lame en plusieurs baguettes, suivant l'échantillon qu'on juge à-propos. Pour faire cette division avec exactitude, il faut que les barres de fer soient de la même épaisseur ; ce qui se fait dans des cylindres. Voyez nos Planches. A B est une barre de fer qu'on aplatit dans les cylindres, espatards ou aplatissoirs C D, qu'on passe ensuite dans les taillans ou ciseaux, représentés ailleurs de différents échantillons. Il ne serait pas possible d'aplatir et fendre une barre de fer, si elle n'était adoucie au feu ; ce qui donne lieu à une espèce de construction de fours, pour les chauffer en grand nombre et à peu de frais. Pour profiter de la chaleur donnée au fer, qui, quoique adouci, occasionne un violent travail aux aplatissoires et aux taillans, on emploie la puissance de l'eau d'une chute, ou de rouets, ou lanternes, pour avoir un grand mouvement. Un coup-d'oeil fait voir que tout dépend de la solidité et de l'exactitude des pièces d'une fenderie.
On les fait simples ou doubles ; les simples sont celles dans lesquelles, comme on voit, d'abord on ne monte que les espatards pour aplatir une quantité de fer, ensuite on démonte les espatards, et on substitue les taillans : cette espèce a le désavantage qu'il faut chauffer deux fois le fer ; mais il faut moins d'eau, et on peut en espérer plus d'exactitude.
Pour faire les deux ouvrages à-la-fais, on établit l'équipage des aplatissoirs, et dans la meche M O du cylindre du dessus, à la partie O, et en continuant la meche du cylindre du bas, on ajuste l'équipage des taillans de façon que le travail se fait sur la même ligne et par le même mouvement. La barre au sortir du four est présentée aux aplatissoirs C D, reçue en B par un ouvrier qui la tire avec des tenailles pour l'entretenir, et la passe par-dessus l'équipage à un ouvrier qui la présente aux taillans : toute cette opération Ve assez vite pour n'être point obligé de chauffer le fer deux fois : mais l'inconvénient de ces fenderies est, qu'étant obligé de serrer et desserrer souvent les tourillons des cylindres, il n'est pas possible que cela n'influe sur les taillans, puisque le mouvement est commun : cette espèce de fenderie est très-commune.
La troisième espèce est celle que vous voyez, où les espatards sont devant et les taillans derrière ; le tout dans un mouvement uniforme, par la distribution des rouets et lanternes : figure 1. un ouvrier qui tire le fer du four ; 2 et 3. ouvriers qui le présentent aux espatards, et le présentent aux taillans 5. et 6. qui reçoivent la verge au sortir des taillans.
Pour donner une idée claire des fenderies, nous dirons qu'il faut une assez grande quantité d'eau, pour donner le mouvement aux aplatissoirs et taillans de dessus, et à ceux de dessous en sens contraire, afin qu'ils mordent et attirent ce qu'on leur présente, et assez de vitesse pour qu'une barre soit tirée du four, passe sous les espatards, et soit fendue dans les taillans en une minute. Il faut que l'intérieur des bâtiments soit spacieux pour loger les deux équipages l'un derrière l'autre et sur la même ligne ; le four à la tête, avec un espace au moins de quinze pieds pour manier les bandes de fer ; derrière l'équipage, de quoi les tirer, placer la verge ; les bancs pour l'embottelage, les romaines ; la petite boutique pour la construction des outils, et le magasin.
Comme il faut que les deux roues de chaque côté qui reçoivent l'eau du même réservoir, tournent en sens contraire, s'il y a assez de hauteur, l'eau prendra l'une par-dessus et l'autre par-dessous ; sinon, à un côté on ajoutera un rouet et une lanterne.
Les roues traverseront un cylindre de bois, qu'on appelle arbre de fenderie, avec tourillons ordinaires de fonte ou de fer, du côté du coursier ; et dans l'intérieur, au lieu de tourillon, un morceau de fer carré F, de trois pouces et demi de diamètre, faisant crosse dans l'intérieur du bout de l'arbre E où il est serré, arrondi contre l'arbre pour porter sur une empoise, et du reste équarri pour recevoir une boite : ce morceau de fer s'appelle la meche F.
Une boite G ou N, est un morceau de fer ou de fonte d'environ neuf pouces de longueur sur sept pouces de diamètre ou équarrissage, dans le milieu duquel il y a une ouverture carrée propre à recevoir le bout de la meche F, d'environ quatre pouces de longueur : le reste de l'intérieur de la boite est pour recevoir le bout carré de l'espatard H, ou le bout carré de la meche qui a traversé les taillans.
L'espatard R Q S T est simple ; le double consiste en ce que contre la partie R il faut ajouter encore une partie carrée comme T, pour recevoir une boite à chaque extrémité. Un espatard est un morceau de fonte moulé composé de cinq parties ; la bosse Q de sept pouces de diamètre ; les deux parties arrondies R S, servant de tourillon, de cinq à six pouces de diamètre ; et la partie carrée T avec sa correspondante supposée pour le tourillon double.
L'arbre et l'espatard du bas portent, sur une empoise mise sous la meche vers l'arbre, et sur les empoises retenues dans les côtés des châssis A A, B B ; et l'arbre et l'espatard du dessus portent sur une empoise posée sur un chevalet supposé sous le tourillon O, et sont retenus par les empoises renversées et serrées dans les châssis A B. Quand c'est une fenderie double, il en est de même pour les taillans, dont la mecheexcédant le châssis, est cousue avec le carré débordant de l'espatard, par une boite. Supposons, pour ne pas multiplier les figures, que le bout de l'arbre T fût une trousse de taillans.
Dans une fenderie double, sur la même ligne, l'équipage des espatards et celui des taillans sont environ à six pieds de distance l'un de l'autre pour l'aisance du travail. Leur solidité dépend de la plate-forme et des montants.
La plate-forme est un morceau de bois de douze pieds de longueur sur deux pieds d'équarrissage, enclavé dans les encoches d'un fort châssis sur lequel il porte, de façon à pouvoir être reculé ou avancé par des coins qu'on chasse contre les parois des encoches.
A trois pieds du milieu de la plate-forme, partent quatre montants E E pour les espatards ; autant de l'autre côté, pour les taillans. Tout ceci sera bien aisé à appliquer aux autres espèces de fenderies.
Ces montants sont des pièces de fer de trois pouces d'épaisseur réduites en-dedans sur un pouce en un demi-cercle de dix-huit lignes de diamètre, pour recevoir les extrémités des empoises, qui excavées dans la même dimension, sont rendues inébranlables. Les montants traversent la plate-forme, et sont arrêtés en-dessous par des clés de fer. Le devant et derrière sont arrêtés en-dessus par les traverses aussi de fer GG. Les empoises sont des morceaux de fonte moulés en terre comme les espatards, ayant le milieu excavé en ceintre pour recevoir les tourillons VXY : les bouts des empoises XY sont aussi excavés pour entrer et être affermis dans le demi-cercle des montants.
Quand on veut monter un espatard ou trousse de taillans, on commence par poser l'empoise d'en-bas sous les tourillons de l'espatard D, ensuite le second espatard C, et l'empoise renversée dessus ; tout son effort se faisant en en-haut. Le dessus des côtés des montants est arrêté par de fortes traverses HH, au milieu desquelles il y a un écrou traversé d'une vis H K, portant sur le milieu de l'empoise I, pour la serrer ou la desserrer d'un coup de main, en maniant la partie coudée K ; par ce moyen, on approche les espatards l'un de l'autre, tant qu'on juge à-propos pour l'espèce de fer qu'on aplatit : il en est de même pour les taillans, comme il est facîle de voir par les figures ; d'autres au lieu de vis pratiquent des mortaises dans les montants (voyez les fig.) ; et au moyen des clés A A, serrent et desserrent les espatards ou taillans.
Les taillans sont composés de rondelles O de fer battu, bien aciérées et trempées, de même dimension et diamètre, percées dans le milieu d'une ouverture carrée et exacte, pour recevoir la meche que nous avons dit être de trois pouces et demi d'épaisseur : il y a les grandes rondelles O, et les petites N ; les grandes peuvent avoir dix à onze pouces de diamètre, et les petites, deux pouces et demi de moins : les unes et les autres sont également percées de quatre trous de huit lignes de diamètre, à un pouce des bords de l'ouverture carrée. Quand on veut monter une trousse, ce qui est une quantité de taillans, on pose pour la trousse du bas une grande rondelle, puis une petite, autant que l'espace du travail le demande, en mettant toujours une de plus dessous que dessus : on fait de même pour celle de dessus ; on fait traverser les trousses par quatre broches de fer qu'on insinue par les trous que vous voyez en O et N, et on les enfîle dans les meches. Les taillans du dessus et du dessous doivent s'insinuer réciproquement et exactement, de la profondeur d'environ six lignes dans les vides que laissent le moindre diamètre des petites rondelles ; ainsi qu'on le voit à toutes les figures de nos Planches de Fenderies. Quand les taillans sont ainsi bien dirigés, on les serre et tient en respect par des morceaux de fer qu'on place entre eux et les côtés des montants. On met un taillant de plus dessous que dessus, parce que ceux des côtés du dessous entretiennent le reste : c'est de-là qu'on les fait plus forts et qu'ils ont pris le nom de guides ou faux-taillans.
Pour obvier à ce que le fer fendu ne suive le tour des taillans, dans chaque montant de derrière on pratique des mortaises, dans lesquelles mortaises sont arrêtées, à la distance de trois pouces l'une de l'autre, deux lames de fer qui affleurent le derrière des taillans. Sur ces lames, à chaque séparation de taillans, on pose un morceau de fer d'échantillon dont le bout qui est poussé contre la lame de fer, est taillé en Y, pour ne pouvoir reculer : l'autre bout déborde, en rasant, l'autre côté des taillans, pour laisser libre entrée au fer, qui est contraint de suivre la direction de ces dents, et de venir passer entre les lames : toute cette partie s'appelle le peigne.
Le devant des taillans est garni d'un morceau de fer arrêté dans les montants, dans lequel on pratique une ouverture pour passer le bout de la barre, qu'on présente aux taillans pour l'empêcher de se dévoyer ; ce qui s'appelle le guide.
Il y a aussi un guide pour les espatards. On trouvera dans nos Planches les différentes trousses de taillans réprésentées. Les baguettes de fer fendu s'appellent verge : la verge a différents noms, et se fend en plus ou moins de taillans.
La cloutière, sans compter les gardes, se fend à onze taillans de quatre lignes d'épaisseur ; la solière, à neuf taillans de cinq à six lignes ; la moyenne, à sept taillans de six à sept lignes ; le fanton, à cinq taillans de neuf à dix lignes ; le petit feuillard, pour le fer aplati, à trois taillans douze lignes ; la vitrière, pour le fil-de-fer, à onze taillans trois lignes.
On tient la grosse verge moins épaisse que large, pour faciliter la fente : on se sert aussi des espatards pour passer l'embattage des roues, qui se fait d'une seule pièce.
Le four doit avoir la gueule vis-à-vis et à la distance d'environ quinze pieds des équipages : pour être chauffé en bois, il sera bâti sur un massif de trois pieds de hauteur, de huit pieds de longueur dans œuvre, deux pieds de largeur, et dix-huit pouces de hauteur, sous voute ; en-devant et au milieu, on laisse une ouverture qu'on appelle la gueule, de huit pouces de largeur, sur quinze à seize pouces de hauteur : la gueule se fait d'une seule pièce de fonte, à cause du frottement du fer. A un des côtés du four on fait une maçonnerie carrée de six pieds de hauteur, dont quatre pieds sous l'aire du four, et deux pieds au-dessus ; le tout de deux pieds dans œuvre, à l'exception du dernier pied du dessus qui se termine en une ouverture carrée d'un pied. Dans l'intérieur, à deux pieds au-dessous de l'aire du four, on fait un grillage en fer pour soutenir le bois qu'on jette par le dessus ; le dessous du grillage s'appelle le cendrier, et est ouvert par-devant. L'ouverture supérieure est garnie d'une plaque de fonte, pour en préserver les bords ; elle se bouche d'un morceau de fer battu, pour ne pas laisser évaporer la flamme : cette partie, jusqu'au grillage, s'appelle la toquerie ; c'est où on jette le bois. La flamme communique au four par une ouverture, à compter de l'aire du four, de dix pouces de hauteur sur sept à huit de largeur. Il faut toujours entretenir dans la toquerie un feu vif et clair ; c'est l'ouvrage d'un ouvrier, qui n'a pour se reposer que le temps qu'on met à passer chaque fournée, une heure environ dans trois. Le fer se fourre par la gueule, et se range dans le four en croix de saint André ou en grillage, afin que la chaleur le pénètre par-tout. On trouvera dans nos Planches deux parties de four. P est l'ouverture qui communique au four ; R est le grillage : dans l'autre, F est la toquerie ; E est le cendrier ; B B C D, deux barres de fer en croix de saint André ; A la voute du four.
Nous avons dit qu'ordinairement le four avait huit pieds de profondeur : quand c'est pour passer des bandages qui demandent une grande longueur, on peut lui donner jusqu'à quatorze ou quinze pieds. Pour l'ordinaire, on casse le fer de six à sept pieds de longueur pour l'enfourner ; on en met jusqu'à un millier, quand le fer est chauffé : il faut environ deux heures pour chauffer une fournée à blanc ; c'est le degré qu'il faut. Une corde de bois de saison de quatre pieds de hauteur sur huit pieds de couche, et le bois de trois pieds et demi de longueur, peut faire quatre fournées à bon vent. Le vent influe prodigieusement sur cette partie ; le bon est celui qui passant par l'ouverture du devant du cendrier, pousse la flamme dans le four ; le mauvais est celui qui passant par la gueule, la repousse dans la toquerie : le seul remède employé jusqu'ici, mais insuffisant, a été de boucher la gueule d'une plaque de fer. Ne pourrait-on pas en employer deux ? le premier en faisant une toquerie à chaque côté, bouchant l'ouverture de communication de celle en mauvais vent, suivant le besoin. L'ouverture étant de dix pouces sur sept, dans un mur de séparation, ne pourrait-on pas monter les côtés de ce mur en briques, et y ménager des coulisses, pour laisser descendre et élever, suivant le besoin, un morceau de terre à brique d'échantillon ; le second en opposant le vent au vent, avec des tuyaux répondants au grillage, et à une large ouverture extérieure et mobile, qu'on pourrait tourner au vent.
Le fer, dans les fenderies où on se sert de charbon de terre, comme celles qui sont dans le Forez sur la rivière de Gier et sur quelques ruisseaux, et qui refendent six à sept millions de fer, se chauffe dans des cheminées bâties comme une chaufferie avec soufflets ; le fer s'y place par barres de deux pieds et demi, à trois pieds de longueur, dans la quantité de trois à quatre cent pesant à-la fais, qu'il faut environ une heure pour chauffer. Il y a un ouvrier chauffeur qui doit veiller à l'arrangement du fer, qui le place par trois barres l'un dessus l'autre, et travaille à ce que ce qui est exposé au vent ne fonde pas, pendant que les bouts n'ont pas le degré de chaleur convenable. Il faut environ pour six francs de charbon pour fendre un mille de fer, etc.
Pour desservir une fenderie, il faut cinq ouvriers ; le maître fendeur, qui doit entretenir le bon ordre, tous les outils, dresser les équipages, régler le temps de tirer le fer, etc. le second, pour tirer le fer du four et le présenter aux espatards ; un pour le recevoir, et le remettre au maître, qui le présente aux taillans, desquels le quatrième le reçoit pour porter la verge à la pîle de son échantillon ; le cinquième est celui qui met le bois dans la toquerie. Une fournée d'un mille peut être fendue en une heure. Celui qui défourne a soin de la toquerie pendant la fente ; la fente faite, on enfourne de nouveau ; c'est alors l'affaire du maître fendeur, de visiter et rétablir ce qui pourrait être dérangé. Il ne faut pas laisser manquer les espatards et les taillans de rafraichissement et de graisse. Le rafraichissement se donne perpétuellement par de l'eau conduite par des chanlattes : les taillans s'engraissent de suif fondu à toutes bandes, et les espatards cinq ou six fois à chaque fournée.
La verge se met en bottes de cinquante livres, poids de marc : pour cet effet, les embotteleurs ont un établi C D (voyez les Pl.), garni de demi-ronds de fer e d, pour placer la verge après l'avoir redressée, et la lier en trois endroits, après qu'elle aura été pesée, en la serrant avec la chaîne et l'étrier 9. a est la tenaille pour serrer la verge de la main droite, et b le crochet, pour en supporter l'extrémité de la main gauche. l est une cisaille ; h i, les demi-ronds, pour recevoir la verge ; K K, des bottes de verges.
Le moulin établi à Essonne pour profiler le fer, appartient de droit aux fenderies, dont il n'est qu'une espèce particulière ; c'est, suivant le rapport de MM. les commissaires de l'académie des Sciences, du 23 Décembre 1752, un laminoir (voyez nos Pl.) composé de deux cylindres de fer C D, dont l'un, que nous supposerons C, est profilé sur sa circonférence, pour imprimer sur les plates-bandes A B les moulures qu'on veut leur donner. Les deux cylindres de ce laminoir, sont menés par deux roues à l'eau ; le cylindre inférieur D est mené immédiatement par le tourillon E, dont le bout qui se termine par un carré F se joint au carré H du cylindre, par le moyen d'une boite de fer ; l'autre roue est menée au moyen de renvois de roues dentées et lanternes, qui font tourner le cylindre de dessus G en sens contraire.
Ces deux cylindres étant en mouvement, on présente la bande de fer rouge au profil qu'on veut y imprimer ; saisie entre les deux cylindres, et entrainée par leur mouvement, elle s'allonge et se profîle d'une seule opération sur toute sa longueur, en très-peu de temps.
Pour empêcher que la bande de fer qu'on profîle ne s'enveloppe autour du cylindre profilé, un ouvrier la saisit avec la pince aussi-tôt qu'elle commence à passer de l'autre côté du cylindre, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement sortie.
Pour connaître, disent les commissaires, si le laminage ne change point la qualité du fer, nous avons fait rompre une barre de fer avant et après l'expérience faite à Essonne le 28 Janvier 1751 ; avant l'expérience, le fer était aigre ; les deux bouts rompus semblaient se toucher par des facettes, dans toute l'épaisseur de la bande ; on n'y voyait point de parties saillantes dans les bouts rompus. Après l'expérience, on voyait de part et d'autre, dans toute l'épaisseur des filaments, des parties saillantes en forme de lames plates et allongées ; c'est ce que les ouvriers appellent le nerf, dans les fers doux ; et c'est à cette marque qu'on le reconnait pour être de bonne qualité. Il parait donc que le fer acquiert de la qualité par le laminage : ce qu'on savait d'ailleurs par les expériences faites dans les fabriques de fil-d'archal.
Malgré un témoignage aussi respectable, la vérité m'oblige de dire que le laminage ne peut changer la qualité du fer ; du fer cassant de sa nature en faire du fer doux. Convenons qu'un fer dont le nerf est gonflé de trop de remplissage, peut casser comme celui de l'épreuve, sans laisser beaucoup de parties saillantes, ou que trempé il peut faire le même effet ; ayant lieu de croire que le grand et subit degré de fraicheur fait retirer et courber les nerfs ; puisque le même fer étant chauffé à blanc et refroidi naturellement, les nerfs reprennent leur souplesse : mais ce phénomène aura lieu surtout, en conséquence de la compression des cylindres qui leur fait dégorger une partie de ce qui les gonflait. Cette espèce de croute qui tombe devant les cylindres en est une preuve ; c'est ce qui occasionne la différence du poids du fer en barres au fer laminé : de-là on peut conclure que le fer cassant par accident a été rendu à sa nature par une opération ; mais non pas que le laminage d'un fer aigre de sa nature en puisse faire un fer doux. Ne pourrait-on pas encore soupçonner que les entrepreneurs du moulin d'Essonne ne se contentant pas de l'avantage réel de la machine, aient cherché à y joindre du merveilleux, et à surprendre l'attention de MM. les commissaires, par le changement impossible du fer cassant en fer doux ? Nous avons l'expérience constante de la diversité de fers entr'eux. Ces fers, après le travail des aplatissoires, restent chacun dans leur nature, mais seulement plus épurés.
On a tenté plusieurs fois de filer le fer dans les cylindres : on doit être convaincu que surtout pour dégrossir, il n'a manqué que l'exactitude et la précision.
ART. XII. Batterie. L'équipage d'une forge et d'une batterie est le même ; une cheminée, deux soufflets mus par l'eau, un atelier de marteau : la différence est qu'au foyer d'une batterie, il n'y a point de contre-vent du dessus, ni d'aire ; que le fond est à environ sept pouces de la thuyere, le trou du chio à la hauteur de la thuyere ; le basche dans l'intérieur de la cheminée couvert : c'est par son côté que se met le charbon. Les marteaux sont de la même forme que ceux de forge ; ils ne pesent que quatre à cinq cent.
L'objet des batteries est de rendre le fer de forge propre à différents usages, par son étendue, son peu d'épaisseur, sa souplesse ; il prend alors le nom général de taule, et les surnoms particuliers de rangette, à étrille, à serrure, à cric, palastre, ronde, couvercle de four, enseignes, fers de charrue. La différence de ces espèces consiste dans l'étendue et l'épaisseur ; ce qui les fait chauffer et battre différemment.
Pour faire la rangette, on coupe le fer, qui au sortir des forges est d'environ trente lignes de largeur sur douze d'épaisseur, en morceaux pesans environ huit livres : chaque morceau se chauffe à blanc, et se bat en deux chaudes, puis on le plie en deux, et s'appelle doublon : et en deux autres chaudes, on lui donne la largeur d'environ quatre pouces, sur douze à treize de longueur ; ce qu'on appelle arbelage. De-là, on prend quatre doublons ensemble, trempés en eau d'arbue, pour empêcher les feuilles de se souder les unes aux autres : on les chauffe couleur de cerise, et bat à quatre chaudes ; ce qui leur donne environ dix pouces de largeur, et dix-neuf à vingt de longueur. On y joint quatre autres doublons en pareil état, et on bat les huit doublons en deux chaudes couleur de cerise qui les réduisent à leur dernière perfection. La rangette porte quatorze à quinze pouces de largeur sur vingt-un à vingt-deux de longueur : il entre ordinairement huit doublons dans un paquet pesant cinquante livres, poids de marc ; les paquets se lient en deux endroits avec des bandes de taule coupées à la cisaille. Quand les feuilles sont plus larges ou plus longues les unes que les autres, on les égalise avec les cisailles ; quand il y en a de percées, crevassées, ou mal fabriquées, on les coupe pour faire les liens ; ces liens servent à la ferrure des seaux et autres ; on en fait même quelques paquets.
La taule à étrille de dix à onze pouces sur trente à trente-deux, se bat en six doubles, avec autant de chaudes que la rangette : huit à neuf doublons au paquet de cinquante livres.
La taule à serrure de différents échantillons, se bat en un doublon à différentes chaudes, suivant la largeur et épaisseur.
Le palastre se bat en feuilles de neuf à quatorze pouces de largeur sur quatre à dix pieds de longueur et de différentes épaisseurs : c'est avec le palastre qu'on garnit le bas des portes cochères, les bornes, etc.
La taule à réchaud, de six à sept pouces sur vingt-un à vingt-deux, se bat à huit doublons : 20 à 21 au paquet de cinquante livres.
La taule à cric pour les équipages, de six à sept pouces de largeur, sur quatre à cinq lignes d'épaisseur, et quatre pieds environ de longueur, se bat en feuilles.
La taule à enseigne se bat en feuille à quatre ensemble, portant treize à quatorze pouces de largeur sur dix-huit de hauteur, une ligne d'épaisseur ; on peut en battre de plus grandes.
Les taules rondes pour poesles et poeslons, se battent en deux feuilles, ménageant un endroit plus étroit au milieu de la feuille ; c'est où on les plie : cet excédent est pour souder la queue ; elles se finissent en les élargissant à deux doublons.
Les couvercles de four se battent en feuilles à demi rond en quatre chaudes ; et on acheve de les battre quatre ensemble.
Dans toutes les taules, les feuilles du milieu s'élargissent toujours plus que les autres ; c'est pour cela qu'aux deux dernières chaudes on les change.
C'est aussi dans les batteries qu'on prépare les taules pour le fer-blanc ; elles se battent à plusieurs doublons, entre un marteau et une enclume bien dressés. Les feuilles se coupent d'échantillon à la cisaille, et se vendent au cent pour être blanchies et étamées.
Les fers de charrue se battent seuls à différentes chaudes, suivant leur force et étendue ; on en fabrique de huit jusqu'à quinze livres.
Pour fabriquer un millier de taule assorti de plusieurs échantillons, on passe au maître batteur 1060 jusqu'à 1100 de fer, et 30 ou 35 vants de charbon ; le van équivalant à cinq pieds.
Le maître batteur doit avoir soin du foyer, de l'équipage du marteau, qu'il doit bien dresser, et de tous les outils. Dans les batteries où l'eau et les matériaux ne manquent pas, les ouvriers se relaient, comme dans les forges : quatre ouvriers peuvent faire cinq à sept cent de taules en vingt-quatre heures ; cela dépend beaucoup du fer, du charbon, de l'espèce de marchandise, et de l'adresse des ouvriers. On fait aller une batterie en grosses-forges, quand on le juge à-propos ; il n'y a que le foyer à changer.
ART. XIII. La filerie. L'objet de la filerie est de donner au fer, par la figure ronde, la surface polie et égale ; la diversité, la flexibilité, un degré d'utilité qui s'étend depuis les baguettes de dix lignes de diamètre, en nuances infiniment multipliées, jusqu'à nous procurer les plus fines cordes des tympanons, même de remplacer la finesse des cheveux ; nous n'entendons ici que donner l'explication de la manufacture, sans indiquer tous les ouvrages auxquels le fer filé s'emploie.
Filer le fer, est l'obliger de passer par des ouvertures dont il prend le diamètre : comme ce travail demande beaucoup de force, on a eu recours à l'eau pour faire mouvoir une roue. A, Pl. XII. est un cylindre de bois tournant sur ses empoises ; ce cylindre est armé de cammes B C, qui appuyant sur la queue Z, la fait baisser ; elle est relevée après le passage de la camme, par la perche élastique X, tenant à la queue par la chaîne Y. La queue Z ne peut baisser que le montant F, auquel elle est attachée, ne soit tiré en-arrière ; et ce à proportion de la longueur de la camme : ce montant a un mouvement libre de devant en arrière, par une cheville de fer qui le traverse dans la pièce de bois K.
Au-devant du montant F il y a un anneau de fer dont la racine est arrêtée de l'autre côté par une clé ; cet anneau s'appelle davier ; il reçoit le crochet C de l'anneau de la grosse tenaille ; cet anneau, avec son prolongement et son crochet, s'appelle chainon. L'anneau du chainon enferme les bouts ceintrés de la tenaille A ; le montant F ne peut être tiré, que le chainon ne le sait, ainsi que la tenaille, dont les mâchoires serrent à proportion que les branches sont serrées, et décrivent en reculant autant d'espace que le montant F ; la perche élastique faisant remonter la queue Z. Le montant et le chainon sont également renvoyés : le chainon ne peut être repoussé qu'il ne desserre les branches, et conséquemment les mords de la tenaille. Si nous imaginons que la tenaille tienne un morceau de fer, elle le serrera et tirera en reculant. Quand elle sera desserrée, elle reprendra sa place par son propre poids, qui la fait couler le long d'un plan incliné ; étant retirée, elle mordra et tirera, et ainsi de suite. Voilà ce que c'est qu'une filerie. Il y a des montants auxquels le mouvement est donné de côté. Imaginons, pour ne pas multiplier les figures, que le montant F est prolongé en en-bas ; et que la camme, au lieu d'en abaisser, en pousse la queue, pour que l'ouvrier soit le maître d'arrêter le mouvement de la tenaille : la partie qui est exposée au frottement de la camme, est garnie d'une fausse queue bien coulante entre deux anneaux de fer ; à la tête de la fausse queue, prend une corde qui passant sur une poulie attachée au-dessus de l'attelier, vient se rendre à un morceau de bois flexible attaché par une de ses extrémités au plancher, vers le pied de l'ouvrier, élevé de l'autre de la hauteur de la camme ; l'ouvrier mettant le pied sur ce morceau de bois, le fait baisser, et conséquemment fait lever la fausse queue ; moyennant quoi, les cammes passent sans rien rencontrer.
La tenaille est de fer, et pour dégrossir peut peser jusqu'à deux cent livres ; le chainon de cinquante à soixante ; il y en a de différentes grosseurs. La tenaille peut avoir deux pieds de longueur : la force doit être aux branches depuis le clou aux mords. Cette partie porte quatre à cinq pouces de largeur, sur trois à quatre pouces d'épaisseur : le derrière des mords est évuidé pour le passage du fer, qui doit se tirer à côté. L'intérieur des mords est entaillé, pour que le fer ne puisse s'échapper quand il est serré.
L'équipage est monté sur un châssis élevé, pour que l'auge logé en-dessus puisse être dirigé et réparé commodément ; sur ce châssis est fortement attachée en plan incliné une pièce de bois de 18 à 20 pouces d'équarrissage, nommé atelier ; le reste du châssis est garni de planches. Le montant F est rendu mobîle par une mortaise pratiquée dans l'attelier, et ne peut se dévoyer, au moyen d'une broche de fer qui traverse la partie enfermée dans l'attelier. Quand la queue est en retour, comme en Z, l'extrémité de l'attelier est encochée. Quand la queue n'est qu'un prolongement du montant, l'attelier est percé à jour : pour que la tenaille descende aisément par son propre poids, on en élève les branches, comme vous voyez en I et G ; et le dessous est garni d'une plaque de fer.
Contre les mords de la tenaille de l'attelier, portent quatre montants de fer de deux pouces d'équarrissage sur six pouces d'hauteur, bien claveté en-dessous, mortaisés en-dessus : ces montants N N se répondent deux à deux à la distance de quinze à vingt lignes ; une paire éloignée de l'autre d'environ un pied : c'est dans ces montants que se placent les filières.
Une filière est un morceau d'acier de trois pouces de largeur sur un pouce d'épaisseur, et deux à trois pieds de longueur. Le morceau d'acier se perce en échiquier de deux rangs de trous de différents diamètres, moitié plus large en-devant que contre la tenaille, pour l'entrée du fer, pour que le frottement se fasse sur une moindre étendue. Pour faire un trou, il faut trois poinçons. Quand le morceau d'acier est chauffé on frappe sur le plus gros poinçon pour l'enfoncer jusqu'au tiers, ensuite un de moindre diamètre, et finalement le plus petit. On n'attend point que le troisième poinçon perce à jour : quand on voit l'empreinte de l'ouverture, on laisse refroidir l'acier, pour l'achever à froid. Les trous se placent à un pouce de bord et à un pouce de distance les uns des autres : quand ils sont tous recherchés, on trempe la filière, et on la place dans les montants de fer N N, où elle est arrêtée en-dessus par les clés O, en-dessous et des côtés par des coins. Il faut que le milieu de la tenaille soit vis-à-vis les trous du bas. Quand on veut faire travailler ceux du dessus, on ne fait que mettre sous la tenaille une lame de fer d'un pouce d'épaisseur.
Le fer le plus doux est le meilleur pour la filière ; on se sert de celui qui a passé à la fenderie, ou qu'on a battu sous le martinet, choisissant celui-ci qui par sa grosseur approche le plus de l'épaisseur qu'on veut donner au fil. L'ouvrier fait chauffer le bout des baguettes, afin de les arrondir et diminuer sur la longueur d'environ six pouces ; ce qui s'appelle amorcer. Il présente à la plus grosse filière la partie amorcée, et dirige la tenaille, dans les mords de laquelle il en fait recevoir l'extrémité, et donne l'eau à la roue : l'ouvrier est assis à côté, tenant d'une main un linge trempé dans l'huîle autour du fer Q, et de l'autre main reçoit le fil au sortir des mords I. Pour dégrossir du gros fil, il n'y a que deux ou trois cammes à la roue ; pour du fil plus petit, il peut y en avoir davantage, surtout si l'arbre est gros. Un même arbre peut faire marcher plusieurs ateliers, comme vous le voyez à la Pl. XII. quand le fer est ébarbé à la première filière, l'ouvrier le présente à un de moindre diamètre, et ainsi de suite. Pour le plus gros fer, il faut dix à quinze filières ; pour le moyen, vingt à trente ; le plus petit, trente à quarante : cette opération Ve très-vite ; chaque coup de tenaille pouvant tirer 2 pouces. L'arbre monté à deux cammes peut faire 10 tours par minute ; conséquemment tirer quarante pouces ; plus le fer est fin, plus l'arbre peut aller vite, et être chargé de cammes : deux ouvriers en gros fil peuvent fabriquer cent cinquante pesant par jour ; en moyen, quatre-vingt ou cent au dessous : le plus ou le moins dépend de la finesse. Quand on veut filer extrêmement fin, comme le frottement n'est pas violent, on peut le tirer à bras d'hommes, comme vous le voyez à la Pl. XI. Pour un mille de fer filé gros et moyen, il faut environ trois pintes d'huîle et quatre vants de charbon. Il y a un déchet d'environ cinquante liv. par mille. Les fils-de-fers gros et moyens se mettent dans les manufactures en bottes de vingt-cinq livres, liées en quatre endroits : pour le fil fin les bottes sont depuis cinq à quinze. Voyez à l'article TRIFILERIE, toutes les espèces différentes de fil et leur emploi. Cet article est de M. BOUCHU, maître des forges à Veuxsaules, proche Château-vilain.
Articles populaires Science
ANNUITÉ
S. f. (Commerce et Mathématiques) se dit d'une rente qui n'est payée que pendant un certain nombre d'années ; de sorte qu'au bout de ce temps le débiteur se trouve avoir acquitté son emprunt avec les intérêts, en donnant tous les ans une même somme.Les annuités sont extrêmement avantageuses au commerce dans les pays où elles sont en usage ; le débiteur trouve dans cette manière d'emprunter, la facilité de s'acquitter insensiblement et sans se gêner, si le créancier a des dettes à payer avant l'échéance des annuités, il s'en sert comme de l'argent en déduisant les intérêts à proportion du temps qu'il y a à attendre jusqu'à l'échéance.
Lire la suite...