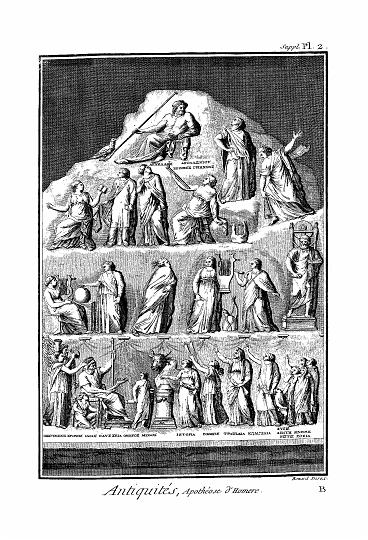LIVRES, (Histoire romaine) anciens livres d'oracles et de prédictions extrêmement accrédités chez les Romains. Ils furent apportés à Tarquin le Superbe, ou, selon Pline, à Tarquin l'ancien, par une vieille mystérieuse qui disparut comme une ombre ; on la crut sibylle elle-même. On assembla les augures, on enferma les livres dans le temple de Jupiter au capitole ; on créa des pontifes pour les garder ; on ne douta point que les destinées de Rome n'y fussent écrites. Ces livres prophétiques périrent cependant dans l'incendie du capitole l'an 671 de Rome, sous la dictature de Sylla ; mais on se hâta de réparer cette perte. On en recueillit d'autres dans la ville d'Eythrée et ailleurs ; on les rédigea par extraits. Auguste les renferma dans des coffres dorés, et les mit sous la base du temple d'Apollon Palatin qu'il venait de bâtir. Ils y demeurèrent jusqu'au temps d'Honorius en 405 de J. C. et cet empereur, dit-on, donna des ordres à Stilion de les jeter dans le feu. Traçons en détail toute cette histoire d'après les écrits de M. Freret, et faisons-la précéder de ses réflexions intéressantes sur cette maladie incurable de l'esprit humain, qui, toujours avide de connaître l'avenir, change sans-cesse d'objets, ou déguise sous une forme nouvelle les anciens objets qu'on veut lui arracher. Croyons que l'histoire des erreurs qui semblent les plus décriées, peut encore ne pas être aujourd'hui des recherches de pure curiosité.
Dans tous les siècles et dans tous les pays, les hommes ont été également avides de connaître l'avenir ; et cette curiosité doit être regardée comme le principe de presque toutes les pratiques superstitieuses qui ont défiguré la religion primitive chez les peuples policés, aussi-bien que chez les nations sauvages.
Les différentes espèces de divination que le hasard avait fait imaginer, et qu'adopta la superstition, consistaient d'abord dans une interprétation conjecturale de certains événements qui par eux-mêmes ne méritaient le plus souvent aucune attention ; mais qu'on était convenu de prendre pour autant de signes de la volonté des dieux. On commença probablement par l'observation des phénomènes célestes, dont les hommes furent toujours très-vivement frappés ; mais la rareté de ces phénomènes fit chercher d'autres signes qui se présentaient plus fréquemment, ou même que l'on put faire paraitre au besoin. Ces signes furent le chant et le vol de certains oiseaux ; l'éclat et le mouvement de la flamme qui consumait les choses offertes aux dieux ; l'état où se trouvaient les entrailles des victimes ; les paroles prononcées sans dessein, que le hasard faisait entendre ; enfin, les objets qui se présentaient dans le sommeil à ceux qui par certains sacrifices ou par d'autres cérémonies, s'étaient préparés à recevoir ces songes prophétiques.
Les Grecs furent pendant plusieurs siècles sans connaître d'autres moyens que ceux-là de s'instruire de la volonté des dieux ; et chez les Romains, si on en excepte quelques cas singuliers, cette divination conjecturale fut toujours la seule que le gouvernement autorisa ; on en avait même fait un art qui avait ses règles et ses principes.
Dans les occasions importantes c'était par ces règles que se conduisaient les hommes les plus sensés et les plus courageux ; la raison subjuguée dès l'enfance par le préjugé religieux, ne se croyait point en droit d'examiner un système adopté par le corps de la nation. Si quelquefois séduite par cette nouvelle philosophie, dont Tite-Live fait gloire de s'être garanti, elle entreprenait de se révolter, bientôt la force de l'exemple, et le respect pour les anciennes opinions la contraignaient de rentrer sous le joug. En voulez-vous un exemple bien singulier ? le voici.
Jules César ne peut être accusé ni de petitesse d'esprit, ni de manque de courage, et on ne le soupçonnera pas d'avoir été superstitieux ; cependant, ce même Jules César ayant une fois versé en voiture, n'y montait plus sans réciter certaines paroles, qu'on croyait avoir la vertu de prévenir cette espèce d'accident. Pline qui nous rapporte le fait, liv. XXVII. chap. IIe assure que de son temps, presque tout le monde se servait de cette même formule, et il en appelle la conscience de ses lecteurs à témoin.
Du temps d'Homère et d'Hesiode, on ne connaissait point encore les oracles parlans, ou du-moins ils avaient fort peu de célébrité ; j'appelle oracles parlans, ceux où l'on prétendait que la divinité consultée de vive voix, répondait de la même manière par l'organe d'un prêtre, ou d'une prétresse qu'elle inspirait. L'oracle de Delphes qui fut le premier des oracles parlans, ne répondait qu'un seul jour dans l'année, le septième du mois busios, usage qui subsista même assez longtemps : ainsi on imagina pour la commodité de ceux qui voulaient connaître l'avenir, de dresser des recueils d'oracles ou de prédictions écrites, que pouvaient consulter les curieux qui n'avaient pas le loisir d'attendre. Ces prédictions, conçues en termes vagues et ambigus, comme ceux des oracles parlans, étaient expliquées par des devins particuliers, qu'on nommait chresmologues, ou interprêtes d'oracles.
On trouve dans les anciens écrivains trois différents recueils de cette espèce, celui de Musée, celui de Bacis, et celui de la Sibylle. Quoique ce dernier ait été beaucoup plus célèbre chez les Romains que chez les Grecs, on voit néanmoins par les ouvrages de ces derniers, qu'ils ne laissaient pas d'en faire usage. Il fallait même que ces prédictions fussent très-connues aux Athéniens, puisque le poète Aristophane en fait le sujet de ses plaisanteries dans deux des comédies qui nous restent de lui.
Différents pays, et différents siècles avaient eu leurs sibylles : on conservait à Rome avec le plus grand soin les prédictions de celle de Cumes, et on les consultait avec appareil dans les occasions importantes ; cependant les écrivains de cette ville, Pline, l. XIII. c. XIIIe et Denys d'Halicarnasse, l. I, c. iv. ne sont d'acord ni sur le nombre des livres qui composaient ce recueil, ni sur le roi auquel il fut présenté. Ils s'accordent seulement à dire que Tarquin, soit le premier, soit le second de ceux qui ont porté ce nom, fit enfermer ce recueil dans un coffre de pierre, qu'il le déposa dans un souterrain du temple de Junon au capitole, et qu'il commit à la garde de ces vers qu'on prétendait contenir le destin de Rome, deux magistrats sous le titre de duumviri sacris faciundis, auxquels il était défendu de les communiquer, et à qui même il n'était permis de les consulter que par l'ordre du roi, et dans la suite par celui du sénat. Cette charge était une espèce de sacerdoce ou de magistrature sacrée, qui jouissait de plusieurs exemptions, et qui durait autant que la vie.
Quand les plébéïens eurent été admis à partager les emplois avec les patriciens, l'an 366 avant J. C. on augmenta le nombre de ces interpretes des destinées de la nation, comme les appelle P. Decius dans Tite-Live, fatorum populi Romani interpretes. On les porta jusqu'à dix, dont cinq seulement étaient patriciens, et alors on les nomma décemvirs. Dans la suite, ce nombre fut encore accru de cinq personnes, et on les appela quindécemvirs. L'époque précise de ce dernier changement, n'est pas connue ; mais comme une lettre de Caelius à Cicéron, épist. famil. l. VIII, c. iv, nous apprend que le quindécimvirat est plus ancien que la dictature de Jules César, on peut conjecturer que le changement s'était fait sous Sylla.
Ces magistrats que Cicéron nommait tantôt sibyllinorum interpretes, tantôt sibyllini sacerdotes, ne pouvaient consulter les livres sibyllins sans un ordre exprès du sénat, et de-là vient l'expression si souvent répétée dans Tite-Live libros adire jussi sunt. Ces quindécimvirs étant les seuls à qui la lecture de ces livres fût permise, leur rapport était reçu sans examen, et le sénat ordonnait en conséquence, ce qu'il croyait convenable de faire. Cette consultation ne se faisait que lorsqu'il s'agissait de rassurer les esprits alarmés, par la nouvelle de quelques présages fâcheux, ou par la vue d'un danger dont la république semblait être ménacée : ad deponendas potius quàm ad suscipiendas religiones, dit Cicéron ; et afin de connaître ce qu'on devait faire pour apaiser les dieux irrités, et pour détourner l'effet de leurs menaces, comme l'observent Varron et Tite-Live.
La réponse des livres sibyllins était communément, que pour se rendre la divinité favorable, il fallait instituer une nouvelle fête, ajouter de nouvelles cérémonies aux anciennes, immoler telles ou telles victimes, etc. Quelquefois même les prêtres sibyllins jugeaient, qu'on ne pouvait détourner l'effet du courroux céleste que par des sacrifices barbares, et immolant des victimes humaines. Nous en trouvons un exemple dans les deux premières guerres puniques, les années 227 et 217 avant J. C.
Les décemvirs ayant Ve dans les livres sibyllins que des Gaulois et des Grecs s'empareraient de la ville, urbem occupaturos, on imagina que, pour détourner l'effet de cette prédiction, il fallait enterrer vif dans la place, un homme et une femme de chacune de ces deux nations, et leur faire prendre ainsi possession de la ville. Toute puérîle qu'était cette interprétation, un très-grand nombre d'exemples nous montre que les principes de l'art divinatoire admettaient ces sortes d'accommodements avec la destinée.
Le recueil des vers sibyllins déposé par l'un des Tarquins dans le capitole, périt comme on l'a Ve au temps de la guerre sociale, dans l'embrasement de ce temple en 671. Mais on se hâta de remédier à la perte qu'on venait de faire, et dès l'an 76 avant J. C. le sénat sur la proposition des consuls Octavius et Curion, chargea trois députés d'aller chercher dans la ville d'Erythrée, ce qu'on y conservait des anciennes prédictions de la sibylle. Varron et Fenestella cités par Lactance, ne parlent que d'Erythrée ; mais Denys d'Halicarnasse et Tacite ajoutent les villes grecques de la Sicîle et de l'Italie.
Tacite qui devait être instruit de l'histoire des livres sibyllins, puisqu'il était du corps des quindecimvirs, dit qu'après le retour des députés, on chargea les prêtres sibyllins de faire l'examen des différents morceaux qu'on avait rapportés ; et Varron assurait selon Denys d'Halicarnasse, que la règle qu'ils avaient suivie, était de rejeter comme faux tous ceux qui n'étaient pas assujettis à la méthode acrostiche. Nous indiquerons dans la suite quelle était cette méthode.
Auguste étant devenu souverain pontife, après la mort de Lepidus, ordonna une recherche de tous les écrits prophétiques, soit grecs, soit latins, qui se trouvaient entre les mains des particuliers, et dont les mécontens pouvaient abuser pour troubler sa nouvelle domination. Ces livres remis au préteur, montaient à deux mille volumes qui furent brulés ; et l'on ne conserva que les vers sibyllins, dont on fit même une nouvelle révision.
Comme l'exemplaire écrit au temps de Sylla commençait à s'altérer, Auguste chargea encore les quindecimvirs d'en faire une copie de leur propre main, et sans laisser voir ce livre à ceux qui n'étaient pas de leur corps. On croit que, pour donner un air plus antique et plus vénérable à leur copie, ils l'écrivirent sur ces toiles préparées qui composaient les anciens libri lintei, avant qu'on connut dans l'occident l'usage du papier d'Egypte, et avant qu'on eut découvert à Pergame l'art de préparer le parchemin, carta Pergamena.
Cet exemplaire des vers sibyllins fut enfermé dans deux coffrets dorés, et placés dans la base de la statue d'Apollon Palatin, pour n'en être tirés que dans les cas extraordinaires.
Il serait inutîle de suivre les différentes consultations de ces livres, marquées dans l'histoire romaine ; mais nous croyons devoir nous arrêter sur celle qui se fit par l'ordre d'Aurélien, au mois de Décembre de l'an 270 de J. C. parce que le récit en est extrêmement circonstancié dans Vopiscus.
Les Marcomants ayant traversé le Danube, et forcé les passages des Alpes, étaient entrés dans l'Italie, ravageaient les pays situés au nord du Pô, et menaçaient même la ville de Rome, dont un mouvement mal-entendu de l'armée romaine, leur avait ouvert le chemin. A la vue du péril où se trouvait l'empire, Aurélien naturellement superstitieux, écrivit aux pontifes, pour leur ordonner de consulter les livres sibyllins. Il fallait pour la forme un decret du sénat ; ainsi le préteur proposa dans l'assemblée le requisitoire des pontifes, et rendit compte de la lettre du prince. Vopiscus nous donne un précis de la délibération, qu'il commence en ces termes : praetor urbanus dixit, referimus ad vos, patres conscripti, pontificum suggestionem, et principis litteras quibus jubetur ut inspiciantur fatales libri, etc. Le decret du sénat rapporté ensuite, ordonne aux pontifes sibyllins de se purifier, de se revêtir des habits sacrés, de monter au temple, d'en renouveller les branches de laurier, d'ouvrir les livres avec des mains sanctifiées, d'y chercher la destinée de l'empire, et d'exécuter ce que ces livres ordonneront. Voici les termes dans lesquels Vopiscus rapporte l'exécution du decret : itum est ad templum, inspecti libri, proditi versus, lustrata urbs ; cantata carmina, amburbium celebratum, ambarvalia promissa, atque ita solennitas quae jubebatur expleta est.
La lettre de l'empereur aux pontifes, qu'il appelle patres sancti, finit par des offres de contribuer aux frais des sacrifices, et de fournir les victimes que les dieux demanderont, même s'il le faut des captifs de toutes les nations, cujuslibet gentis captivos, quaelibet animalia regia. Cette offre montre que, malgré les édits des empereurs, on croyait, comme je l'ai dit, les sacrifices humains permis dans les occasions extraordinaires, et qu'Aurélien ne pensait pas que les dieux se contenteraient de cantiques et de processions.
Sa lettre aux pontifes commence d'une façon singulière, il marque qu'il est surpris qu'on balance si longtemps à consulter les livres sibyllins. Il semble, ajoute-t-il, que vous ayez cru délibérer dans une église de chrétiens, et non dans le temple de tous les dieux : perindè quasi in christianorum ecclesiâ, non in templo deorum omnium tractaretis. Ce qui augmente la singularité et l'expression de l'empereur, c'est qu'il est prouvé par les ouvrages de S. Justin, de Théophîle d'Antioche, de Clément d'Alexandrie, et d'Origène, que depuis près de six vingt ans, les chrétiens citaient, au temps d'Aurélien, les ouvrages de la sibylle, et que quelques-uns d'entr'eux la traitaient de prophétesse.
Les livres sibyllins ne furent point ôtés du temple d'Apollon Palatin par les premiers empereurs chrétiens. Ils y étaient encore au temps de Julien qui les fit consulter en 363 sur son expédition contre les Perses ; mais au mois de Mars de cette année, le feu ayant consumé le temple d'Apollon, on eut beaucoup de peine à sauver ces livres qu'on plaça sans-doute dans quelqu'autre lieu religieux : car Claudien nous apprend qu'on les consulta quarante ans après sous Honorius, lors de la première invasion de l'Italie, par Alaric en 403. Ce poète parle encor de ces vers dans son poème sur le second consulat de Stilicon en 405.
Il faut conclure de-là, que si, comme le dit Rutilius Numatianus, Stilicon fit jeter ces livres au feu, ce fut au plutôt dans les années 406, ou 407. Au reste, comme ce poète, zélateur ardent de l'ancienne religion, accuse en même temps Stilicon d'avoir appelé les barbares, et d'avoir détruit les vers sibyllins, dans la vue de causer la ruine de l'empire, en lui enlevant le gage de sa durée éternelle ; peut-être la seconde de ces deux accusations n'est-elle pas mieux fondée que la première.
Après avoir donné cette espèce d'histoire des livres sibyllins, qui renferme tout ce qu'on en sait d'assuré, je dois ajouter quelques remarques sur ce qu'ils contenaient. Ce que Tite-Live et Denis d'Halicarnasse nous racontent touchant les diverses consultations qu'on en faisait, donne lieu de penser, qu'on ne publiait point le texte même des prédictions, mais seulement la substance de ce qu'on prétendait y avoir trouvé ; c'est-à-dire, le détail des nouvelles pratiques religieuses ordonnées par la sibylle pour apaiser les dieux. Comme il ne nous reste aucun des historiens antérieurs à la perte du premier recueil des vers sibyllins, il faut nous contenter de ce qu'en disent Denis et Tite-Live ; et nous devons même regarder comme supposé le long fragment des vers sibyllins, rapporté par Zozime, à l'occasion des jeux séculaires.
Ces vers qui devaient être tirés de l'ancien recueil, ne sont point dans la forme acrostiche ; ils contiennent le nom de Rome, du Tibre, de l'Italie, etc. et prescrivent les cérémonies qui devaient accompagner les jeux séculaires dans un détail qui démontre la supposition.
Le second recueil compilé sous Sylla, nous est un peu mieux connu, et je vais rapporter ce que les anciens nous en apprennent. 1°. Varron cité par Lactance, assure que ce recueil contenait d'abord mille vers au plus ; et comme Auguste ordonna une seconde révision, qui en fit encore rejeter quelques-uns, ce nombre fut probablement diminué.
2°. Ce que disait Varron cité par Denis d'Halicarnasse, qu'on avait regardé comme supposés tous les vers qui interrompaient la suite des acrostiches, montre que cette forme regnait d'un bout à l'autre de l'ouvrage.
3°. Cicéron nous explique en quoi consistait cette forme. Le recueil était partagé en diverses sections, et dans chacune, les lettres qui formaient le premier vers, se trouvaient répétés dans le même ordre au commencement des vers suivants ; en sorte que l'assemblage de ces lettres initiales devenait aussi la répétition du premier vers de la section : acrostichus dicitur, cùm deinceps ex primis versus litteris aliquid connectitur.... In sibyllinis ex primo versu cujusque sententiae primis litteris illius sententiae carmen omne praetextitur.
4°. Les prédictions contenues dans ce recueil étaient toutes conçues en termes vagues et généraux, sans aucune désignation de temps ou de lieu ; ensorte, dit Cicéron, qu'au moyen de l'obscurité dans laquelle l'auteur s'est habilement enveloppé, on peut appliquer la même prédiction à des événements différents : Callide, qui illa composuit, perfecit ut, quodcumque accidisset, praedictum videretur, hominum et temporum definitione sublatâ. Adhibuit etiam latebram obscuritatis ut iidem versus alias in aliam rem posse accommodari viderentur.
Dans le dialogue où Plutarque recherche pourquoi la Pythie ne répondait plus en vers, Boéthius, un des interlocuteurs qui attaque vivement le surnaturel des oracles, observe dans les prédictions de Musée, de Bacis et de la Sibylle, les mêmes défauts que Cicéron avait reprochés aux vers sibyllins. Ces auteurs de prédictions, dit Boéthius, ayant mêlé au hasard des mots et des phrases qui conviennent à des événements de toute espèce, les ont, pour ainsi dire, versés dans la mer d'un temps indéterminé : ainsi lors même que l'événement semble vérifier leurs prophéties, elles ne cessent pas d'être fausses, parce que c'est au hasard seul qu'elles doivent leur accomplissement.
Plutarque nous a conservé dans la vie de Démosthène, un de ses oracles qui couraient dans la Grèce sous le nom de la Sibylle ; c'est à l'occasion de la défaite des Athéniens, près de Chéronée ; on était, dit Plutarque, dans une grande inquiétude avant la bataille, à cause d'un oracle dont tout le monde s'entretenait : " Puissai-je, disait-il, m'éloigner de la bataille du Thermodon, et devenir un aigle pour contempler du haut des nues ce combat, où le vaincu pleurera, et où le vainqueur trouvera sa perte ". Il était bien difficîle d'appliquer cet oracle à la défaite de Chéronée ; 1°. il fallait trouver un Thermodon auprès du champ de bataille ; et Plutarque qui était de Chéronée même, avoue qu'il n'a pu découvrir dans les environs de cette ville, ni ruisseaux, ni torrent de ce nom. 2°. Le vainqueur ne trouva point sa perte à cette bataille, et même il n'y fut pas blessé.
Lorsqu'on examinera les prédictions des oracles les plus accrédités, celles de la Pythie, de Musée, de Bacis, de la sibylle, etc. rapportées dans les anciens, on trouvera toujours que Cicéron, liv. II. n. 56. de divinat. a raison de dire, que celles qui n'ont pas été faites après-coup, étaient obscures et équivoques, et que si quelques-unes n'avaient pas été démenties par l'événement, c'était au hasard qu'elles le devaient.
Quelques absurdes que fussent les conséquences que les partisans du surnaturel de la divination se trouvaient obligés de soutenir dans les controverses philosophiques, ils étaient excusables jusqu'à un certain point. Le principe qu'ils défendaient, faisait chez eux une partie essentielle de la religion commune ; ce principe une fois admis, l'absurdité des conséquences ne devait point arrêter des hommes religieux. Mais que dire de ces rusés politiques, qui pour couvrir les desseins de leur ambition, forgeaient à leur gré des oracles sibyllins ? C'est ainsi que P. Lentulus Sura, un des chefs de la conjuration catilinaire n'eut point de honte de semer comme vraie, une prétendue prédiction des sibylles, annonçant que trois Cornéliens jouiraient à Rome de la souveraine puissance.
Sylla et Cinna, tous deux de la famille Cornélienne, avaient déjà vérifié une partie de la prédiction. Lentulus qui était de la même famille, répandit dans le public que l'oracle devait avoir son accomplissement dans sa personne ; et peut-être eut-il réussi sans l'heureuse prévoyance de Cicéron, qui fit mentir l'oracle.
Pompée voulant rétablir Ptolomée Auletès dans son royaume d'Egypte, la faction qui était contraire à ce puissant citoyen, prit le parti d'inventer une prédiction sibylline qui portait, qu'au cas qu'un roi d'Egypte eut recours aux Romains, ils devaient l'assister de leur protection, sans lui fournir de troupes. Cicéron qui soutenait le parti de Pompée, savait bien que l'oracle était supposé ; mais persuadé qu'il était plus sage de l'éluder que de le réfuter, il fit ordonner au proconsul d'Afrique, d'entrer en Egypte avec son armée, de conquérir ce pays, et d'en gratifier Ptolémée au nom des Romains.
Jules-César s'étant emparé de l'autorité souveraine sous le nom de dictateur, ses partisans qui cherchaient à lui faire déférer la qualité de roi, répandirent dans le public un nouvel oracle sibyllin, selon lequel les Parthes ne pouvaient être assujettis que par un roi des Romains. Le peuple était déjà déterminé à lui en accorder le titre, et le sénat se trouvait contraint d'en signer le decret, le jour même que César fut assassiné.
Enfin cet abus de faire courir dans Rome et dans toute l'Italie des prédictions sibyllines, alla si loin, que Tibere tremblant qu'on n'en répandit contre lui, défendit à qui que ce fût d'avoir aucun papier de prédictions sibyllines, ordonnant à tous ceux qui en auraient de les porter dans le jour même au préteur : simul commonefecit, Tiberius, quia multa vana sub nomine celebri vulgabantur, sanxisse Augustum, quem intrà diem ad praetorem urbanum deferrentur, neque habere privatim liceret.
Ce qui cause mon étonnement, n'est pas de voir que les Romains crussent aux oracles des sibylles, c'était un principe de leur religion, quelque ridicule qu'il fût en lui-même ; mais je suis toujours surpris que dans des temps éclairés, tel qu'était la fin du dernier siècle, la question du surnaturel des oracles eut encore besoin d'être traitée sérieusement, et qu'une opinion si folle et contredite par les faits mêmes sur lesquels on la fondait dans le paganisme, ait trouvé de nos jours, pour ainsi dire, et dans le sein du christianisme, des défenseurs très-zélés. (D.J.)
SIBYLLINS, LIVRES, (Histoire ecclésiastique) l'ouvrage moderne qui nous est parvenu sous ce nom, est une compilation informe de prophéties différentes, supposées la plupart vers le premier ou le second siècle du christianisme, par quelques-uns de ces hommes, qui joignant la fourberie au fanatisme, ne font point scrupule d'appeler le mensonge et l'imposture au secours de la vérité.
Les livres ou vers sibyllins dont nous parlons, sont encore remplis de choses contre l'idolatrie et la corruption des mœurs des payens, mais on a eu soin pour accréditer ces prophéties, d'y insérer plusieurs circonstances véritables que fournissaient les anciennes histoires qui subsistaient alors, et que la barbarie des siècles postérieurs a détruites. Il est aussi fait mention dans ces vers, d'une comete que l'auteur annonce devoir précéder certains événements qu'il prédit à-coup-sur, puisqu'ils étaient arrivés ainsi que la comete, plusieurs siècles avant lui ; mais on attend sans-doute de nous quelques détails de plus sur cette collection de vers sibyllins.
Elle est divisée en huit livres, et a été imprimée pour la première fois en 1545 sur des manuscrits, et publiée plusieurs fois depuis avec d'amples commentaires, surchargés d'une érudition souvent triviale, et presque toujours étrangère au texte que ces commentaires éclaircissent rarement. Les ouvrages composés pour et contre l'authenticité de ces livres sibyllins, sont en très-grand nombre, et quelques-uns même très-savants ; mais il y règne si peu d'ordre et de critique, et leurs auteurs étaient tellement dénués de tout esprit philosophique, qu'il ne resterait à ceux qui auraient eu le courage de les lire, que l'ennui et la fatigue de cette lecture.
Le savant Fabricius, dans le premier livre de sa bibliothèque grecque, donne une espèce d'analyse de ces différents ouvrages, à laquelle il joint une notice assez détaillée de huit livres sibyllins. On peut y avoir recours ; c'est assez de nous borner dans cet article à quelques observations générales sur ces huit livres sibyllins modernes.
1°. Il est visible, qu'ils ne sont autre chose qu'une misérable compilation informe de divers morceaux détachés, les uns dogmatiques, les autres supposés prophétiques, et ceux-ci toujours écrits depuis les événements, et le plus souvent chargés de détails fabuleux ou du moins peu assurés.
2°. Il est encore certain que tous ces morceaux sont écrits dans une vue absolument différente de celle que s'étaient proposée les auteurs des vers qui composaient le premier et le second des deux recueils gardés à Rome. Les anciens vers sibyllins prescrivaient les sacrifices des cérémonies, et les fêtes par lesquelles les Romains pouvaient apaiser le courroux des dieux qu'ils adoraient. Le recueil moderne est au contraire rempli de déclamations très-vives contre le polythéisme et contre l'idolâtrie ; et partout on y établit, ou du moins on y suppose l'unité de Dieu. Presque aucun de ces morceaux n'a pu sortir de la plume d'un payen ; quelques-uns peuvent avoir été faits par des Juifs, mais le plus grand nombre respire le christianisme ; il suffit de les lire pour s'en convaincre.
3°. Les prédictions des vers sibyllins conservés à Rome, et celles qui étaient répandues dans la Grèce, dès le temps d'Aristophane et de Platon, étaient, comme l'observent Cicéron et Boèthus, des prédictions vagues, applicables à tous les temps et à tous les lieux ; elles se pouvaient ajuster avec des événements opposés : ut idem versus aliàs in aliam rem posse accomodari viderentur.... ut, quodcumque accidisset, praedictum videretur. Au contraire dans la nouvelle collection tout est si bien circonstancié, qu'on ne peut se méprendre aux faits que l'auteur avait en vue. S'il ne nomme pas toujours les villes, les pays et les peuples dont il veut parler, il les désigne si clairement qu'on ne saurait les méconnaître, et le plus souvent il indique le temps où ces choses sont arrivées d'une manière qui n'est point susceptible d'équivoque.
4°. Les anciens oracles sibyllins gardés à Rome étaient écrits de telle sorte qu'en réunissant les lettres initiales des vers qui composaient chaque article, on y retrouvait le premier vers de ce même article. Le nouveau recueil n'offre aucun exemple de cette méthode, car l'acrostiche inséré dans le huitième livre, et qui est emprunté d'un discours de l'empereur Constantin, est d'une espèce différente. Il consiste en trente-quatre vers, dont les lettres initiales forment , mais ces mots ne se trouvent point dans le premier vers.
5°. Les nouveaux vers sibyllins contiennent des choses qui n'ont pu être écrites que par un homme instruit des dogmes du Christianisme, et des détails de l'histoire de Jesus-Christ rapportés par les évangélistes. L'auteur se dit même dans un endroit enfant du Christ : ailleurs il assure que ce Christ est le fils du Très-haut, et il désigne son nom par le nombre 888, valeur numérale des lettres du mot dans l'alphabet grec.
6°. Quoique les morceaux qui forment ce recueil puissent avoir été composés en différents temps, celui auquel on a mis la dernière main à la compilation se trouve clairement indiqué dans le cinquième et dans le huitième livre. On fait dire à la sibylle que l'empire romain aura quinze rois : les quatorze premiers sont désignés par la valeur numérale de la première lettre de leur nom dans l'alphabet grec. Elle ajoute que le quinzième, qui sera, dit-on, un homme à tête blanche, portera le nom d'une mer voisine de Rome : le quinzième des empereurs romains est Hadrien, et le golfe adriatique est la mer dont il porte le nom. De ce prince, continue la sibylle, il en sortira trois autres qui régiront l'empire en même temps ; mais à la fin, un seul d'entr'eux en restera possesseur. Ces trois rejetons, , comme la sibylle les appele, sont Antonin, Marc-Aurele et Lucius-Vérus, et elle fait allusion aux adoptions et aux associations qui les unirent. Marc-Aurele se trouva seul maître de l'empire à la mort de Lucius-Vérus, arrivée au commencement de l'an 169, et il le gouverna sans collègue l'an 177, qu'il s'associa son fils Commode. Comme il n'y a rien qui puisse avoir quelque rapport avec ce nouveau collègue de Marc-Aurele, il est visible que la compilation doit avoir été faite entre les années 169 et 177 de Jesus-Christ.
7°. On trouve encore un autre caractère chronologique, mais moins précis dans le huitième livre. Il est dit que la ville de Rome, , subsistera pendant neuf cent quarante-huit ans seulement, suivant la valeur des lettres numérales de son nom, après quoi elle deviendra une ruine, . Cette destruction de Rome est annoncée dans presque tous les livres du recueil, mais sa date n'est marquée qu'en ce seul endroit. Nous lisons dans l'histoire de Dion, qu'au temps de Tibere il courut sur la durée de Rome une prédiction attribuée à la sibylle, où cette durée était fixée à neuf cent ans. Cet oracle attira l'attention de Tibere, et occasionna une nouvelle recherche des vers sibyllins conservés par les particuliers ; cependant on ne comptait alors que l'an 772 de la fondation de Rome, et on ne devait pas être fort alarmé. Cette réflexion de l'historien nous montre que l'addition de quarante-huit ans avait été faite à dessein par quelqu'un qui écrivait après l'an 900 de Rome, 148 de Jesus-Christ, mais avant l'an 196 : la valeur numérale des lettres du mot était sans-doute ce qui l'avait déterminé à préférer le nombre de 948.
Josephe, dans ses antiquités judaïques, liv. XX. chap. XVIe composées depuis les livres de la guerre des juifs et vers la treizième année de Domitien l'an 93 de l'ère vulgaire, cite un ouvrage de la sibylle où l'on parlait de la tour de Babel et de la confusion des langues, à-peu-près comme dans la Genèse ; si, dans le temps auquel écrivait Josephe, cet ouvrage de la sibylle n'eut pas déjà passé pour ancien, s'il n'eut pas été dans les mains des Grecs, l'historien juif ne l'aurait pas cité en confirmation du récit de Moïse. Il résulte de-là que les Chrétiens ne sont pas les premiers auteurs de la supposition des livres sibyllins. Josephe ne rapportant pas les paroles mêmes de la sibylle, nous ne sommes plus en état de vérifier si ce qui est dit de ce même événement dans notre collection était tiré de l'ouvrage que cite Josephe ; mais on est sur que plusieurs des vers attribués à la sibylle dans l'exhortation qui se trouve parmi les œuvres de S. Justin, dans l'ouvrage de Théophîle d'Antioche, dans Clément d'Alexandrie, et dans quelques autres pères, ne se lisent point dans notre recueil ; et comme la plupart de ces vers ne portent aucun caractère de christianisme, il serait possible qu'ils fussent l'ouvrage de quelque juif platonisant.
Lorsqu'on acheva sous M. Aurele la compilation des vers sibyllins, il y avait déjà quelque temps que les sibylles avaient acquis un certain crédit parmi les Chrétiens. Nous en avons la preuve dans deux passages de Celse, et dans les réponses que lui fait Origène. Celse qui écrivait sous Hadrien et sous ses successeurs, parlant des différentes sectes qui partageaient les Chrétiens, supposait une secte de Sibyllistes ; sur quoi Origène observe qu'à la vérité ceux d'entre les Chrétiens qui ne voulaient pas regarder la sibylle comme une prophétesse, désignaient par ce nom les partisans de l'opinion contraire ; mais qu'on n'avait jamais connu de sectes particulières des Sibyllistes. Celse reproche aux Chrétiens dans le second passage d'avoir corrompu le texte des vers sibyllins, desquels, leur dit-il, quelques-uns d'entre vous emploient les témoignages, ; et vous les avez corrompus, ajoute-t-il, pour y mettre des blasphêmes. Il entendait par-là sans-doute les invectives contre le polythéisme et contre l'idolâtrie. Origène se contente de répondre au reproche, en défiant Celse de produire d'anciens exemplaires non-altérés.
Ces passages de Celse et d'Origène semblent prouver deux choses ; 1°. que l'authenticité de ces prédictions n'était point alors mise en question, et qu'elle était également supposée par les payens et par les Chrétiens ; 2°. que parmi ces derniers il y en avait seulement quelques-uns, , qui regardaient les sibylles comme des prophétesses, et que les autres chrétiens blâmant la simplicité de ces hommes crédules, leur donnaient l'épithète de Sibyllistes. Plutarque qui vivait presque dans le même temps, appelle ainsi, dans la vie de Marius, les interpretes des prédictions de la sibylle, ou les chresmologues. Ceux qui ont avancé que les païens donnaient à tous les Chrétiens le nom de Sibyllistes, n'ont compris le vrai sens ni du reproche de Celse, ni de la réponse d'Origène.
L'opinion favorable aux sibylles qui, de l'aveu de Celse, était d'abord celle d'un assez petit nombre de Chrétiens, devint peu - à - peu l'opinion commune. Les vers sibyllins paraissant favorables au Christianisme, on les employait dans les ouvrages de controverse avec d'autant plus de confiance que les Payens eux-mêmes, qui reconnaissaient les sibylles pour des femmes inspirées, se retranchaient à dire que les Chrétiens avaient falsifié leurs écrits, question de fait qui ne pouvait être décidée que par une comparaison des différents manuscrits, que très-peu de gens étaient en état de faire.
Les règles de la critique et même celles de la saine logique étaient alors peu connues, ou du - moins très-négligées : à cet égard, les plus célèbres philosophes du paganisme n'avaient aucun avantage sur le commun des auteurs chrétiens. Il suffira d'en citer pour exemple les dialogues et les traités dogmatiques de Plutarque, qui, malgré ce grand sens dont on le loue, ne parait jamais occupé que de la crainte d'omettre quelque chose de tout ce qu'on peut dire de vrai et de faux sur le sujet qu'il traite. Ce même défaut règne dans les ouvrages de ceux qui sont venus après lui. Celse, Pausanias, Philostrate, Porphyre, l'empereur Julien, en un mot, tous les auteurs payens n'ont ni plus de critique, ni plus de méthode que Plutarque. On les voit tous citer sous le nom d'Orphée, de Musée, d'Eumolpe, et des autres poètes antérieurs à Homère, des ouvrages fabriqués par les nouveaux Platoniciens, et donner comme authentiques des oracles supposés par ces mêmes philosophes, ou plutôt par les sectateurs du nouveau Pythagorisme, ou de la secte orphique, qui joignait les dogmes égyptiens et chaldéens à quelques points de l'ancienne doctrine de Pythagore.
Comme les auteurs de ces oracles et de ces vers philosophiques supposaient la spiritualité, l'infinité, la toute-puissance du Dieu suprême, que plusieurs blâmaient le culte des intelligences inférieures, condamnaient les sacrifices et faisaient quelquefois allusion à la Trinité platonicienne, parlant d'un Père, d'un Fils, d'un Esprit, les Chrétiens crurent qu'il leur était permis d'employer ces autorités dans la controverse avec les payens, pour les battre par leurs propres armes. Mémoires des Inscriptions, t. XXIII. (D.J.)
SIBYLLINS
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Antiquité romaine
- Affichages : 1209