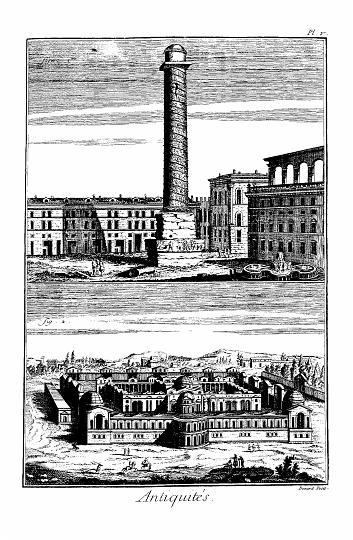(Géographie moderne) province méditerranée d'Angleterre, dans le diocese de Peterborough, avec titre de duché. C'est la plus petite province d'Angleterre, car elle n'a que 40 milles de tour ; mais elle est très-fertile, abondante en blé et en bétail ; elle a beaucoup de bois, de parcs, et est arrosée de plusieurs petites rivières, ce qui fait qu'elle nourrit quantité de brebis, dont la laine est rougeâtre, ainsi que le terroir. Oakham est la principale ville de cette province.
Elle a été bien illustrée par la naissance de Jacques Harrington, fils du chevalier Sapcote Harrington. Il naquit en 1611, et donna dès sa tendre jeunesse de grandes espérances de ce qu'il deviendrait un jour. Après avoir étudié à Oxford, il quitta l'université pour aller voyager en Hollande, en France, en Italie, en Danemarck et en Allemagne, et il apprit la langue de ces divers pays. Lorsqu'il fut de retour, le roi Charles I. le fit gentilhomme privé extraordinaire, et il accompagna le monarque en cette qualité dans sa première expédition contre les Ecossais. Il servit toujours ce prince fidèlement, et il employa son crédit pour amener les choses à un accommodement général qui ne réussit pas. En 1661, après le rétablissement de Charles II. il fut arrêté par son ordre, ayant été accusé de trahison et de mauvaises pratiques ; mais comme les commissaires des deux chambres, ne purent jamais rien trouver à sa charge, on le mit en liberté. Il mourut à Westminster en 1677, âgé de 66 ans.
Entre ses ouvrages politiques, son oceana, ou la république, qui parut à Londres en 1656, in-fol. est extrêmement célèbre en Angleterre. Lorsque l'auteur fit voir à ses amis le manuscrit de cet ouvrage, avant qu'il fût imprimé, il leur dit, que depuis qu'il avait commencé à penser sérieusement, il s'était attaché principalement à l'étude du gouvernement, comme à un objet de la dernière importance pour le bonheur du genre humain ; et qu'il avait réussi, du moins à son gré, s'étant convaincu qu'il n'y a aucune sorte de gouvernement qui soit aussi accidentel qu'on se l'imagine d'ordinaire, parce qu'il y a dans les sociétés des causes naturelles, qui produisent aussi nécessairement leurs effets, que celles de la terre et de l'air.
Fondé sur ce principe, il soutenait que les troubles de l'Angleterre ne devaient pas être absolument attribués à l'esprit de faction, au mauvais gouvernement du prince, ni à l'opiniâtreté du peuple ; mais au défaut d'équilibre entre les différentes autorités ; le roi et les seigneurs ayant trop perdu depuis le temps de Henri VIII. et la balance panchant trop de jour en jour du côté des communes : non qu'il prétendit approuver les infractions que le roi avait faites aux lais, ni excuser la manière dure dont quelques-uns des sujets avaient traité ce prince, mais pour montrer que tant que les causes du désordre subsisteraient, elles produiraient nécessairement les mêmes effets.
Il ajoutait que d'un côté, pendant que le roi chercherait toujours à gouverner de la même manière que ses prédécesseurs, le peuple ferait surement tous ses efforts pour se procurer de nouveaux privilèges, et pour étendre sa liberté, aussi souvent qu'il réussirait heureusement, comme le passé le démontrait. Son principal dessein était donc de trouver un moyen de prévenir de pareils dérangements, ou d'y appliquer les meilleurs remèdes lorsqu'ils arriveraient.
Il soutenait que tant que la balance demeurerait inégale, il n'y a pas de prince qui put être hors d'atteinte (quelqu'attentif qu'il fût à se rendre agréable au peuple), et que quoiqu'un bon roi put ménager passablement les choses pendant sa vie, cela ne prouvait point que le gouvernement fût bon, puisque sous un prince moins prudent, l'état ne pourrait manquer de tomber en désordre ; au lieu que dans un état bien réglé, les méchants deviennent gens de bien, et les fous se conduisent sagement. Il est le premier qui ait prouvé que l'autorité suit la propriété, soit qu'elle réside entre les mains d'un seul, d'un petit nombre, ou de plusieurs.
Il n'eut pas plutôt commencé à répandre son système, ayant beaucoup de connaissances, que tout le monde s'attacha à examiner la matière, chacun selon ses préjugés ; mais plusieurs personnes cherchèrent à disputer avec lui sur cette matière dans la vue de s'en mieux instruire.
Harrington trouva de grandes difficultés à faire paraitre son ouvrage, parce que tous les partis, opposés les uns aux autres, s'étaient comme réunis contre lui. Les principaux obstacles vinrent de la part du défenseur de la tyrannie de Cromwel, d'autant plus que l'auteur en faisant voir qu'une république est un gouvernement dirigé par les lais, et non par le pouvoir militaire, dévoilait la violente administration du protecteur par ses majors-généraux. D'un autre côté, les cavaliers le taxaient d'ingratitude à la mémoire du feu roi, et préféraient la monarchie même sous un usurpateur, à la république la mieux réglée.
Il répondit à ces derniers, que c'était assez qu'il eut évité de publier ses sentiments pendant la vie du roi ; mais que la monarchie étant absolument détruite, et la nation dans un état d'anarchie, ou plutôt sous l'usurpation ; il était non-seulement libre, mais obligé en qualité de bon citoyen, de communiquer à ses compatriotes le modèle de gouvernement, qui lui paraissait le plus propre à assurer leur tranquillité, leur bonheur et leur gloire. Il ajoutait qu'il n'y avait personne à qui son plan dû. plaire davantage qu'aux cavaliers, puisque s'il était reçu, ils se verraient délivrés de toute oppression ; parce que dans une république bien réglée, il ne peut y avoir de distinction de partis, le chemin des emplois étant ouvert au mérite. D'ailleurs, si le prince était rétabli, sa doctrine de la balance l'éclairerait sur ses devoirs, ce qui le mettrait en état d'éviter les fautes de son père, puisque son système ne convenait pas moins à une monarchie gouvernée par les lois qu'à une véritable démocratie.
Cependant, quelques courtisans ayant su que l'ouvrage d'Harrington était sous presse, ils firent tant de recherches, qu'ils découvrirent le lieu où il s'imprimait. On se saisit du manuscrit, et on le porta à Whitehall. Tous les premiers mouvements que l'auteur se donna pour le recouvrer surent inutiles. Il réfléchit enfin que mylady Claypole, fille du protecteur, et qui avait beaucoup de crédit sur son esprit, était d'un caractère plein de bonté pour tout le monde, et qu'elle s'intéressait très-souvent pour les malheureux. Quoique cette dame lui fût inconnue, il résolut de s'adresser à elle, et se fit annoncer, s'étant rendu dans son antichambre.
Pendant qu'il y était, quelques-unes des femmes de Mylady Claypole entrèrent dans la chambre, suivies de sa petite fille, âgée d'environ trois ans ; cette enfant s'arrêta auprès de lui, et il se mit à badiner avec elle, de manière qu'elle souffrit qu'il la prit dans ses bras, où elle était, lorsque sa mère parut. Harrington s'avança vers Mylady Claypole, et mit l'enfant à ses pieds, en lui disant : Madame, vous êtes arrivée fort à-propos, sans quoi j'aurais certainement volé cette charmante petite demoiselle. Volée ! reprit la mère avec vivacité, hé pourquoi, je vous prie ; car elle est trop jeune pour être votre maîtresse. Madame, répondit Harrington, quoique ses charmes l'assurent d'une conquête plus importante que la mienne, je vous avouerai que je ne me serais porté à ce larcin, que par un motif de vengeance, et non d'amour. Quelle injure vous ai-je donc fait, repliqua la dame, pour vous obliger à me dérober mon enfant ? Aucune, reprit Harrington, mais ç'aurait été pour vous engager à porter mylord votre père à me rendre justice, et à me restituer mon enfant, qu'il m'a dérobé. Mylady Claypole repliqua que cela ne pouvait point être, son père ayant lui-même assez d'enfants, et ne songeant certainement pas à en voler à personne au monde.
Harrington lui apprit alors qu'il était question de la production de son esprit, dont on avait donné de fausses idées à son altesse, et qui avait été enlevée par son ordre de chez l'Imprimeur. Elle lui promit sur le champ qu'elle lui ferait rendre son ouvrage, pourvu qu'il n'y eut rien de contraire au gouvernement de son père. Il l'assura que c'était une espèce de roman politique, qui contenait si peu de choses préjudiciables aux intérêts du protecteur, qu'il espérait qu'elle voudrait bien l'informer, qu'il avait même dessein de le lui dédier, et il lui promit qu'elle aurait un des premiers exemplaires. Mylady Claypole fut si contente du tour qu'il avait pris, qu'elle lui fit bientôt rendre son livre.
Il le dédia, suivant sa parole à Cromwel, qui après l'avoir lu, dit que l'auteur avait entrepris de le dépouiller de son autorité ; mais qu'il ne quitterait pas pour un coup de plume, ce qu'il avait acquis à la pointe de l'épée. Il ajouta, qu'il approuvait moins que qui que ce fût, le gouvernement d'un seul ; mais qu'il avait été forcé de prendre la fonction d'un commissaire supérieur, pour maintenir la paix dans la nation, convaincu que si on l'eut laissée à elle-même, ceux qui la composaient ne se seraient jamais accordé sur une forme de gouvernement, et auraient employé leur pouvoir à se perdre les uns les autres.
Pour parler à présent de l'ouvrage, il est écrit en forme de roman, à l'imitation de l'histoire Atlantique de Platon. L'Oceana, est l'Angleterre ; Adoxus, est le roi Jean ; Convallium, c'est Hampton - court ; Corannus, est Henri VIII ; Dicoitome, Richard II ; Emporium, Londres ; Halcionia, la Tamise ; Halo, Whitehall ; Hiera, Westminster ; Leviathan, Hobbes ; Marpesia, l'Ecosse ; Morphée, le roi Jacques I ; le mont Célia, Windsor ; les Neustriens, sont les Normands ; Olphans Mégaletor, c'est Olivier Cromwel ; Panopaea, l'Irlande ; Panthéon, la grande salle de Westminster ; Panurge, Henri VIII ; Parthenio, la reine Elisabeth ; les Scandiens, sont les Danois ; les Teutons, les Saxons ; Turbon, c'est Guillaume le conquérant ; Verulamius, est mylord Bacon.
Cet ouvrage est composé de trois parties ; les préliminaires, accompagnés d'une section intitulée : le conseil des Législateurs. Suit le plan de la république ou le corps de l'ouvrage, et enfin les corollaires ou la conclusion.
Les préliminaires contiennent les fondements, l'origine et les effets de toutes sortes de gouvernements, monarchique, aristocratique ou démocratique. Il parle de la corruption de ces diverses espèces de gouvernements, d'où naissent la tyrannie, l'oligarchie et l'anarchie.
Dans la première partie, il traite en particulier de ce qu'il appelle la prudence ancienne, c'est-à-dire de cette espèce de gouvernement qui fut la plus commune dans le monde jusqu'au temps de Jules - César. Il s'agit dans la seconde partie, des préliminaires, de la prudence moderne, c'est-à-dire de cette espèce de gouvernement qui a prévalu dans le monde, après que Rome eut perdu sa liberté. L'auteur s'attache particulièrement aux lois établies, depuis que les peuples barbares eurent commencé à inonder l'empire romain. Il donne une idée claire et juste de la manière dont l'Angleterre a été gouvernée par les Romains, les Saxons, les Danois et les Normands, jusqu'à l'entière ruine de ce gouvernement sous Charles I.
On voit ensuite le conseil des législateurs, car l'auteur travaillant à donner le modèle d'un gouvernement parfait, avait étudié à fond les gouvernements anciens et modernes, pour en prendre tout ce qui lui paraitrait praticable, et pour éviter tout ce qu'il y trouverait d'impraticable. Dans ce dessein, il introduit sous des noms feints, neuf législateurs parfaitement instruits des diverses espèces de gouvernements, qu'ils doivent faire connaître. Le premier est chargé d'exposer le gouvernement de la république d'Israèl ; le second, celui d'Athènes ; le troisième, Lacédemone ; le quatrième, Carthage ; le cinquième, les Achéens, les Aetoliens et les Lyciens ; le sixième, Rome ; le septième, Venise ; le huitième, la Suisse ; et le neuvième, la Hollande. Il tire ce qu'il y a de bon de ces divers gouvernements, et en y joignant ses propres idées, il en forme le plan de son océana. La méthode dans son plan de gouvernement, est d'établir d'abord une loi, d'y joindre ensuite l'explication, et de l'accompagner d'un discours qu'il fait faire à quelqu'un des législateurs.
Les divers corps de la république (qu'il en appelle les roues, the orbs) étant civils, militaires ou provinciaux, sont fondés sur la division du peuple en quatre ordres. Le premier, des citoyens et des domestiques ; le second, des anciens et des jeunes gens ; le troisième, de ceux qui ont un revenu annuel de 100 liv. sterlings en terres, en argent ou autres effets ; ceux-là composent la cavalerie, et ceux qui ont un moindre revenu, l'infanterie. En quatrième lieu, ils sont partagés selon les lieux de leur demeure ordinaire, en paroisses, centuries et tribus.
Le peuple est le tribunal suprême de la nation, ayant droit d'entendre et de décider les causes d'appel de tous les magistrats, et des cours provinciales ou domestiques ; il peut aussi appeler à compte tout magistrat, quand il est sorti de charge, si les tribuns ou quelqu'un d'entr'eux propose la chose.
L'auteur détaille ensuite ses idées sur le corps militaire, sur l'armée, et sur les polémarques.
Enfin dans les corollaires, il explique comment on peut achever l'ouvrage de sa république ; il ne se contente pas d'y développer ce qui concerne le sénat et l'assemblée du peuple, la manière de faire la guerre, et de gouverner en temps de paix ; il y parle encore de ce qui regarde la discipline à l'égard de la religion, des moyens d'assurer la liberté de conscience, de la forme du gouvernement particulier pour l'Ecosse, l'Irlande, et les autres provinces de la république ; du gouvernement de Londres et de Westminster, qui doivent être le modèle du gouvernement des autres villes et communautés.
Il y donne des directions pour faire fleurir et pour augmenter le commerce ; des lois pour régler les universités ; des avis pour l'éducation de la jeunesse ; des conseils pour faire utilement la guerre sur mer, pour établir des manufactures, pour encourager l'agriculture. Il propose des règlements sur le droit, la médecine, la religion, et surtout sur la manière de former un gentilhomme accompli. Il y parle du nombre, du choix, du devoir, des revenus des magistrats, de tous ceux qui ont quelque charge dans l'état ; enfin de toutes les dépenses de la république.
Je me suis étendu contre ma coutume, sur cet ouvrage profond, parce qu'il est peu ou point connu des étrangers. A peine eut-il paru, qu'il fut attaqué bien ou mal par divers écrivains. Pour moi, je pense avec l'auteur de l'esprit des Lais, que M. Harrington, en examinant le plus haut point de liberté où la constitution de l'Angleterre pouvait être portée, a bâti Chalcédoine, ayant le rivage de Bysance devant les yeux. Je ne sai comment il pouvait espérer qu'on regarderait son ouvrage, autrement qu'on regarde un beau roman. Il est certain que tous les efforts ont été inutiles en Angleterre, pour y fonder la démocratie ; car il arriva qu'après bien des mouvements, des chocs et des secousses, il fallut se reposer dans le gouvernement même qu'on avait proscrit, où d'ailleurs la liberté politique est établie par les lais, et l'on n'en doit pas chercher davantage.
Quoi qu'il en sait, l'auteur donna en 1659, un abrégé in-8 °. de son Océana. Il est divisé en trois livres, dont le premier roule sur les fondements et la nature de toutes sortes de gouvernements. Dans le second, il s'agit de la république des Hébreux ; et on trouve dans le troisième, un plan de république propre à l'état où se trouvait la nation anglaise. Il a mis à la fin une petite dissertation intitulée : Discours touchant une chambre de pairs.
Le recueil de tous les ouvrages de ce beau génie, a paru à Londres en 1737, in-folio ; sur quoi, voyez biblioth. Britan. tom. IX. part. II. art. 10.
Au reste, l'Océana d'Harrington, comme le dit M. Hume, convenait parfaitement au goût d'un siècle, où les plans imaginaires de républiques faisaient le sujet continuel des disputes et des conversations ; et de nos jours même, on accorde à cet ouvrage le mérite du génie et de l'invention. Cependant la perfection et l'immortalité dans une république, paraitront toujours aussi chimériques, que dans un homme. Il manque au style d'Harrington, d'être plus facîle et plus coulant ; mais ce défaut est avantageusement compensé par l'excellence de la matière. (D.J.)
RUTLAND
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Géographie moderne
- Affichages : 989