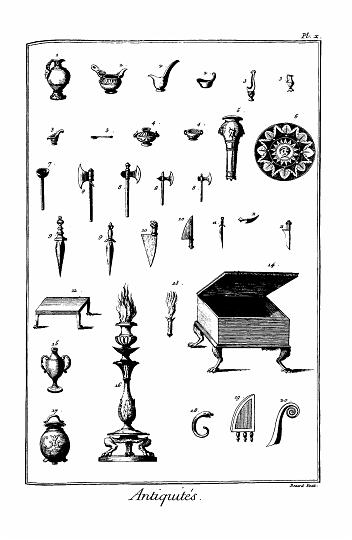(Géographie moderne) village de Hollande, sur le chemin de Leyde à Haerlem, mais village illustré le 31 Décembre de l'an 1668, par la naissance de Herman Boerhaave, un des grands hommes de notre temps, et un des plus célèbres médecins qu'il y ait eu depuis Hippocrate, dont il a fait revivre les principes et la doctrine.
Son père, ministre du village, cultiva l'éducation de ce fils, qu'il destinait à la théologie, et lui enseigna ce qu'il savait de latin, de grec, et de belles-lettres. Il l'occupait pour fortifier son corps, à cultiver le jardin de la maison, à travailler à la terre, à semer, planter, arroser. Peu-à-peu, cet exercice journalier qui délassait son esprit, endurcit son corps au travail. Il y fit provision de forces pour le reste de sa vie, et peut-être en rapporta-t-il ce goût dominant qu'il a toujours eu pour la Botanique.
Agé d'environ douze ans, il fut attaqué d'un ulcère malin à la cuisse, qui résista tellement à tout l'art des Chirurgiens, qu'on fut obligé de les congédier : le malade prit le parti de se faire de fréquentes fomentations avec de l'urine, où il avait dissout du sel, et il se guérit lui-même. Les douleurs qu'il souffrit à cette occasion pendant près de cinq ans, lui donnèrent la première pensée d'apprendre la Médecine ; cependant cette longue maladie ne nuisit presque pas au cours de ses études. Il avait par son goût naturel trop d'envie de savoir, et il en avait trop de besoin par l'état de sa fortune ; car son père le laissa à l'âge de quinze ans, sans secours, sans conseil, et sans bien.
Il obtint néanmoins de ses tuteurs, la liberté de continuer ses études à Leyde, et il y trouva d'illustres protecteurs qui encouragèrent ses talents, et le mirent en état de les faire valoir. En même temps qu'il étudiait la Théologie, il enseignait les Mathématiques à de jeunes gens de condition, afin de n'être à charge à personne. Sa théologie était le grec, l'hébreu, le chaldéen, l'Ecriture-sainte, la critique du vieux et du nouveau Testament, les anciens auteurs ecclésiastiques, et les commentateurs les plus renommés.
Un illustre magistrat l'encouragea à joindre la médecine à la théologie, et il ne fut pas difficîle de le porter à y donner aussi toute son application. En effet, il faut avouer, que quoiqu'également capable de réussir dans ces deux sciences, il n'y était pas également propre. Le fruit d'une vaste et profonde lecture avait été de lui persuader que la religion était depuis longtemps défigurée par de vicieuses subtilités philosophiques, qui n'avaient produit que des dissensions et des haines, dont il aurait bien de la peine à se garantir dans le sacré ministère ; enfin, son penchant l'emporta pour l'étude de la nature. Il apprit par lui-même l'anatomie, et s'attacha à la lecture des Médecins, en suivant l'ordre des temps, comme il avait fait pour les auteurs ecclésiastiques.
Commençant par Hippocrate, il lut tout ce que les Grecs et les Latins nous ont laissé de plus savant en ce genre ; il en fit des extraits, il les digéra, et les réduisit en systèmes, pour se rendre propre tout ce qui y était contenu. Il parcourut avec la même rapidité et la même méthode, les écrits des modernes. Il ne cultiva pas avec moins d'avidité la chimie et la botanique ; en un mot, son génie le conduisit dans toutes les sciences nécessaires à un médecin ; et s'occupant continuellement à étudier les ouvrages des maîtres de l'art, il devint l'Esculape de son temps.
Tout dévoué à la Médecine, il résolut de n'être désormais théologien qu'autant qu'il le fallait pour être bon chrétien. Il n'eut point de regret, dit M. de Fontenelle, à la vie qu'il aurait menée, à ce zèle violent qu'il aurait fallu montrer pour des opinions fort douteuses, et qui ne méritaient que la tolérance, enfin à cet esprit de parti dont il aurait dû prendre quelques apparences forcées, qui lui auraient couté beaucoup, et peu réussi.
Il fut reçu docteur en médecine l'an 1693, âgé de 25 ans, et ne discontinua pas ses leçons de mathématique, dont il avait besoin, en attendant les malades qui ne vinrent pas sitôt. Quand ils commencèrent à venir, il mit en livres tout ce qu'il pouvait épargner, et ne se crut plus à son aise, que parce qu'il était plus en état de se rendre habîle dans sa profession. Par la même raison qu'il se faisait peu-à-peu une bibliothèque, il se fit aussi un laboratoire de chimie ; et ne pouvant se donner un jardin de botanique, il herborisa dans les campagnes et dans les lieux incultes.
En 1701, les curateurs de l'université de Leyde le nommèrent lecteur en médecine, avec la promesse de la chaire qui vint bientôt à vacquer. Les premiers pas de sa fortune une fois faits, les suivants furent rapides : en 1709, il obtint la chaire de botanique, et en 1718, celle de chimie.
Ses fonctions multipliées autant qu'elles pouvaient l'être, attirèrent à Leyde un concours d'étrangers qui enrichissaient journellement cette ville. La plupart des états de l'Europe fournissaient à Boerhaave des disciples ; le Nord et l'Allemagne principalement, et même l'Angleterre, toute fière qu'elle est, et avec justice, de l'état florissant où les sciences sont chez elle. Il abordait à Leyde des étudiants en médecine de la Jamaïque et de la Virginie, comme de Constantinople et de Moscow. Quoique le lieu où il tenait ses cours particuliers, fût assez vaste, souvent pour plus de sûreté, on s'y faisait garder une place par un collègue, comme nous faisons ici aux spectacles qui réussissent le plus.
Outre les qualités essentielles au grand professeur, M. Boerhaave avait encore celles qui rendent aimable à des disciples ; il leur faisait sentir la reconnaissance et la considération qu'il leur portait, par les grâces qu'il mettait dans ses instructions. Non-seulement il était très-exact à leur donner tout le temps promis, mais il ne profitait jamais des accidents qui auraient pu légitimement lui épargner quelques leçons, et même quelquefois il priait ses disciples d'agréer qu'il en augmentât le nombre. Tous les équipages qui venaient le chercher pour les plus grands seigneurs étaient obligés d'attendre que l'heure des cours fût écoulée.
Boerhaave faisait encore plus vis-à-vis de ses disciples ; il s'étudiait à connaître leurs talents ; il les encourageait et les aidait par des attentions particulières. Enfin s'ils tombaient malades, il était leur médecin, et il les préférait sans hésiter, aux pratiques les plus brillantes et les plus lucratives ; en un mot, il regardait ceux qui venaient prendre ses instructions, comme ses enfants adoptifs à qui il devait son secours ; et en les traitant dans leurs maladies, il les instruisait encore efficacement.
Il remplissait ses trois chaires de professeur de la même manière, c'est-à-dire avec le même éclat. Il publia en 1707, ses Institutions de médecine, et l'année suivante ses Aphorismes sur la connaissance et sur la cure des maladies. Ces deux ouvrages qui se réimpriment tous les trois ou quatre ans, sont admirés des maîtres de l'art. Boerhaave ne se fonde que sur l'expérience bien avérée, et laisse à part tous les systèmes, qui ne sont ordinairement que d'ingénieuses productions de l'esprit humain désavouées par la nature. Aussi comparait-il ceux de Descartes à ces fleurs brillantes qu'un beau jour d'été voit s'épanouir le matin, et mourir le soir sur leur tige.
Les Institutions forment un cours entier de médecine théorique, mais d'une manière très-concise, et dans des termes si choisis, qu'il serait difficîle de s'exprimer plus nettement et en moins de mots. Aussi l'auteur n'a eu pour but que de donner à ses disciples des germes de vérités réduits en petits, et qu'il faut développer, comme il le faisait par ses explications. Il prouve dans cet ouvrage que tout ce qui se fait dans notre machine, se fait par les lois de la mécanique, appliquées aux corps solides et liquides dont le nôtre est composé. On y voit encore la liaison de la physique et de la géométrie avec la médecine ; mais quoique grand géomètre, il n'a garde de regarder les principes de sa géométrie comme suffisans pour expliquer les phénomènes du corps humain.
L'utilité de ce beau livre a été reconnue jusque dans l'Orient ; le mufti l'a traduit en arabe, ainsi que les Aphorismes ; et cette traduction que M. Schultens trouva fidèle, a été mise au jour dans l'imprimerie de Constantinople fondée par le grand-vizir.
Tout ce qu'il y a de plus solide par une expérience constante, règne dans les Aphorismes de Boerhaave ; tout y est rangé avec tant d'ordre, qu'on ne connait rien de plus judicieux, de plus vrai, ni de plus énergique dans la science médicinale. Nul autre, peut-être, après l'Esculape de la Grèce, n'a pu remplir ce dessein, ou du-moins n'a pu le remplir aussi dignement, que celui qui guidé par son propre génie, avait commencé à étudier la médecine par la lecture d'Hippocrate, et s'était nourri de la doctrine de cet auteur. Il a encore rassemblé dans cet ouvrage, avec un choix judicieux, tout ce qu'il y a de plus important et de mieux établi dans les médecins anciens grecs et latins, dans les principaux auteurs arabes, et dans les meilleurs écrits modernes. On y trouve enfin les différentes lumières que répandent les découvertes modernes, dont de beaux génies ont enrichi les sciences. Toute cette vaste érudition est amplement développée par les beaux commentaires de Van-Swieten sur cet ouvrage, et par ceux de Haller sur les Institutions de médecine.
J'ai dit que M. Boerhaave fut nommé professeur de Botanique en 1709, année funeste aux plantes par toute l'Europe. Il trouva dans le jardin public de Leyde environ trois mille simples, et dix ans après, il avait déjà doublé ce nombre. Je sais que d'autres mains pouvaient travailler au soin de ce jardin ; mais elles n'eussent pas été conduites par les mêmes yeux. Aussi Boerhaave ne manqua pas de perfectionner les méthodes déjà établies pour la distribution et la nomenclature des plantes.
En 1722, il fut attaqué d'une violente maladie dont il ne se rétablit qu'avec peine. Il s'était exposé, pour herboriser, à la fraicheur de l'air et de la rosée du matin, dans le temps que les pores étaient tout ouverts par la chaleur du lit. Cette imprudence qu'il recommandait soigneusement aux autres d'éviter, pensa lui couter la vie. Une humeur goutteuse survint, et l'abattit au point qu'il ne lui restait plus de mouvement ni presque de sentiment dans les parties inférieures du corps ; la force du mal était si grande, qu'il fut contraint pendant longtemps de se tenir couché sur le dos, et de ne pouvoir changer de posture par la violence du rhumatisme goutteux, qui ne s'adoucit qu'au bout de quelques mois, jusqu'à permettre des remèdes. Alors M. Boerhaave prit des potions copieuses de sucs exprimés de chicorée, d'endive, de fumeterre, de cresson aquatique et de veronique d'eau à larges feuilles : ce remède lui rendit la santé comme par miracle. Mais ce qui marque jusqu'à quel point il était considéré et chéri, c'est que le jour qu'il recommença ses leçons, tous les étudiants firent le soir des réjouissances publiques, des illuminations et des feux de joie, tels que nous en faisons pour les plus grandes victoires.
En 1725, il publia, conjointement avec le professeur Albinus, une édition magnifique des œuvres de Vésale, dont il a donné la vie dans la préface.
En 1727, il fit paraitre le Botanicon parisiense de Sébastien Vaillant. Il mit à la tête une préface sur la vie de l'auteur et sur plusieurs particularités qui regardent ce livre. On y trouve un grand nombre de choses nouvelles qui ne se rencontrent point dans l'ouvrage de Tournefort. On y voit les caractères des plantes et les synonymes marqués avec la dernière exactitude. Il y règne encore une savante critique touchant les descriptions, les figures et les noms que les auteurs ont donnés des plantes ; enfin la beauté des planches répond au reste.
En 1728, parut son traité latin des maladies vénériennes, qui fut reçu avec tant d'accueil en Angleterre, qu'on en fit une traduction et deux éditions en moins de trois mois. Le traité dont nous parlerons, sert de préface au grand recueil des auteurs qui ont écrit sur cette même maladie, et qui est imprimé à Leyden en deux tom. in-fol.
Vers la fin de 1727, M. Boerhaave avait été attaqué d'une seconde rechute presque aussi rude que la première de 1722, et accompagnée d'une fièvre ardente. Il en prévit de bonne heure les symptômes qui se succéderaient, prescrivit jour-par-jour les remèdes qu'il faudrait lui donner, les prit et en rechappa ; mais cette rechute l'obligea d'abdiquer deux ans après, les chaires de Botanique et de Chimie.
En 1731, l'académie des Sciences de Paris le nomma pour être l'un de ses associés étrangers, et quelque temps après, il fut aussi nommé membre de la société royale de Londres. M. Boerhaave se partagea également entre les deux compagnies, en envoyant à chacune la moitié de la relation d'un grand travail sur le vif-argent, suivi nuit et jour sans interruption pendant quinze ans sur un même feu, d'où il résultait que le mercure était incapable de recevoir aucune vraie altération, ni par conséquent de se changer en aucun autre métal. Cette opération ne convenait qu'à un chymiste fort intelligent, fort patient et en même temps fort aisé. Il ne plaignit pas la dépense, pour empêcher, s'il est possible, celle où l'on est si souvent et si malheureusement engagé par les alchymistes. Le détail de ses observations à ce sujet se trouve dans l'hist. de l'acad. des Sciences, année 1734, et dans les Trants. philosop. n °. 430, année 1733. On y verra avec quelle méthode exacte, rigide et scrupuleuse, il a fait ses expériences, et combien il a fallu d'industrie et de patience pour y réussir.
La même année 1731, Boerhaave avait donné, avec le secours de M. Grorenvelt, médecin et magistrat de Leyde, une nouvelle édition des œuvres d'Arétée de Cappadoce ; il avait dessein de faire imprimer en un corps et de la même manière, tous les anciens médecins grecs ; mais ses occupations ne lui permirent pas d'exécuter cet utîle projet.
En 1732, parurent ses éléments de Chimie, Lugd. Bat. 1732, in-4°. 2 vol. ouvrage qui fut reçu avec un applaudissement universel. Quoique la Chimie eut déjà été tirée de ces ténèbres mystérieuses où elle se retranchait anciennement, il semblait néanmoins qu'elle ne se rangeait pas encore sous les lois générales d'une science réglée et méthodique ; mais M. Boerhaave l'a réduite à n'être qu'une simple physique claire et intelligible. Il a rassemblé toutes les lumières acquises, et confusément répandues en mille endroits différents, et il en a fait, pour ainsi dire, une illumination bien ordonnée, qui offre à l'esprit un magnifique spectacle. La beauté de cet ouvrage parait surtout dans le détail des procédés, par la sévérité avec laquelle l'auteur s'est astreint à la méthode qu'il s'est prescrite, par son exactitude à indiquer les précautions nécessaires pour faire avec sûreté et avec succès les opérations, et par les corollaires utiles et curieux qu'il en tire continuellement.
Voilà les principaux ouvrages par lesquels Boerhaave s'est acquis une gloire immortelle. Je passe sous silence ses élégantes dissertations recueillies en un corps après sa mort, et quelques-uns de ses cours publics sur des sujets importants de l'art, que les célèbres docteurs Van-Swieten et Tronchin nous donneront exactement quand il leur plaira. Tous les élèves de ce grand maître ont porté pendant sa vie dans toute l'Europe son nom et ses louanges. Chacune des trois fonctions médicinales dont il donnait des leçons, fournissait un flot qui partait, et se renouvellait d'année en année. Une autre foule presque aussi nombreuse venait de toutes parts le consulter sur des maladies singulières, rebelles à la médecine commune, et quelquefois même par un excès de confiance, sur des maux incurables ; sa maison était comme le temple d'Esculape, et comme l'est aujourd'hui celle du professeur Tronchin à Genève.
Il guérit le pape Benait XIII. qui l'avait consulté, et qui lui offrit une grande récompense. Boerhaave ne voulut qu'un exemplaire de l'ancienne édition des opuscules anatomiques d'Eustachi, pour la rendre plus commune, en la faisant réimprimer à Leyde. Enfin son éclatante réputation avait pénétré jusqu'au bout du monde ; car il reçut un jour du fond de l'Asie, une lettre dont l'adresse était simplement, à monsieur Boerhaave, médecin en Europe.
Après cela, on ne sera pas surpris que des souverains qui se trouvaient en Hollande, tels que le czar Pierre I. et le duc de Lorraine aujourd'hui empereur, l'aient honoré de leurs visites. Le czar vint pour Boerhaave à Leyde en yacht, dans lequel il passa la nuit aux portes de l'académie, pour être de grand matin chez le professeur, avec lequel il s'entretint assez longtemps. " Dans toutes ces occasions, c'est le public qui entraîne ses maîtres, et les force à se joindre à lui ".
Pendant que ce grand homme était couvert de gloire au-dehors, il était comblé de considération dans son pays et dans sa famille. Suivant l'ancienne et louable coutume des Hollandais, il ne se détermina au choix d'une femme, qu'après qu'il eut Ve sa fortune établie. Il épousa Marie Drolenvaux, et vécut avec elle pendant 28 ans dans la plus grande union. Lorsqu'il fit réimprimer en 1713, ses Institutions de médecine, il mit à la tête une épitre dédicatoire à son beau-pere, par laquelle il le remercie dans les termes les plus vifs, de s'être privé de sa fille unique, pour la lui donner en mariage. C'était au bout de trois années, dit joliment M. de Fontenelle, que venait ce remerciment, et que M. Boerhaave faisait publiquement à sa femme une déclaration d'amour.
Toute sa vie a été extrêmement laborieuse, et son tempérament robuste n'y devait que mieux succomber. Il prenait encore néanmoins de l'exercice, soit à pied, soit à cheval sur la fin de ses jours. Mais depuis sa rechute de 1727, des infirmités différentes l'affoiblirent et le minèrent promptement. Vers le milieu de 1737, parurent les avant-coureurs de la dernière maladie qui l'enleva l'année suivante, âgé de 69 ans, 3 mois et 8 jours.
M. Boerhaave était grand, proportionné et robuste. Son corps aurait paru invulnérable à l'intempérie des éléments, s'il n'eut pas eu un peu trop d'embonpoint. Son maintien était simple et décent. Son air était vénérable, surtout depuis que l'âge avait blanchi ses cheveux. Il avait l'oeil vif, le regard perçant, le nez un peu relevé, la couleur vermeille, la voix fort agréable, et la physionomie prévenante. Dans ce corps sain logeait une très-belle âme, ornée de lumières et de vertus.
Il a laissé un bien considérable, plus de deux millions de notre monnaie. Mais si l'on réfléchit qu'il a joui longtemps des émoluments de trois chaires de professeur ; que ses cours particuliers produisaient beaucoup ; que les consultations qui lui venaient de toutes parts étaient payées, sans qu'il l'exigeât, sur le pied de l'importance des personnes dont elles venaient, et sur celui de sa réputation ; enfin si l'on considére qu'il menait une vie simple, sans fantaisies, et sans goût pour les dépenses d'ostentation, on trouvera que les richesses qu'il a laissées sont modiques, et que par conséquent elles ont été acquises par les voies les plus légitimes. Mais je n'ai pas dit encore tout ce qui est à l'honneur de ce grand homme.
Il enseignait avec une méthode, une netteté et une précision singulières. Ennemi de tout excès, à la réserve de ceux de l'étude, il regardait la joie honnête comme le baume de la vie. Quand sa santé ne lui permit plus l'exercice du cheval, il se promenait à pied ; et de retour chez lui, la musique qu'il aimait beaucoup, lui faisait passer des moments délicieux, où il reprenait ses forces pour le travail. C'était surtout à la campagne qu'il se plaisait. La mort l'y a trouvé, mais ne l'y a point surpris. J'ai Ve et j'ai reçu de ses lettres dans les derniers jours de sa dernière maladie. Elles sont d'un philosophe qui envisage d'un oeil stoïque la destruction prochaine de sa machine. Sa vie avait été sans taches, frugale dans le sein de l'abondance, modérée dans la prospérité, et patiente dans les traverses.
Il méprisa toujours la vengeance comme indigne de lui, fit du bien à ses ennemis, et trouva de bonne heure le secret de se rendre maître de tous les mouvements qui pouvaient troubler sa philosophie. Un jour qu'il donnait une leçon de médecine, où j'étais présent, son garçon chymiste entra dans l'auditoire pour renouveller le feu d'un fourneau ; il se hâta trop et renversa la coupelle. Boerhaave rougit d'abord. C'est, dit-il en latin à ses auditeurs, une opération de vingt ans sur le plomb, qui est évanouie en un clin d'oeil. Se tournant ensuite vers son valet désespéré de sa faute. " Mon ami, lui dit-il, rassurez-vous, ce n'est rien ; j'aurais tort d'exiger de vous une attention perpétuelle qui n'est pas dans l'humanité ". Après l'avoir ainsi consolé, il continua sa leçon avec le même sens-froid, que s'il eut perdu le fruit d'une expérience de quelques heures.
Il se mettait volontiers à la place des autres, ce qui (comme le remarque très-bien M. de Fontenelle) produit l'équité et l'indulgence ; et il mettait aussi volontiers les autres en sa place, ce qui prévient ou réprime l'orgueil. Il désarmait la satyre en la négligeant, comparant ses traits aux étincelles qui s'élancent d'un grand feu, et s'éteignent aussi-tôt qu'on ne souffle plus dessus.
Il savait par sa pénétration démêler au premier coup-d'oeil le caractère des hommes, et personne n'était moins soupçonneux. Plein de gratitude, il fut toujours le panégyriste de ses bienfaiteurs, et ne croyait pas s'acquitter en prenant soin de la vie de toute leur famille. La modestie qui ne se démentit jamais chez lui, au milieu des applaudissements de l'Europe entière, augmentait encore l'éclat de ses autres vertus.
Tous mes éloges n'ajouteront rien à sa gloire : mais je ne dois pas supprimer les obligations particulières que je lui ai. Il m'a comblé de bontés pendant cinq ans, que j'ai eu l'honneur d'être son disciple. Il me sollicita longtemps avant que je quittasse l'académie de Leyde, d'y prendre le degré de docteur en Médecine, et je ne crus pas devoir me refuser à ses désirs, quoique résolu de ne tirer de cette démarche d'autre avantage que celui que l'homme recherche par l'humanité, j'entends de pouvoir secourir charitablement de pauvres malheureux. Cependant Boerhaave estimant trop une déférence, qui ne pouvait que m'être honorable, voulut la reconnaître, en me faisant appeler par le stadhouder à des conditions les plus flatteuses, comme gentilhomme et comme médecin capable de veiller à la conservation de ses jours. Mais la passion de l'étude forme naturellement des âmes indépendantes. Eh ! que peuvent les promesses magnifiques des cours sur un homme né sans besoins, sans désirs, sans ambition, sans intrigue ; assez courageux pour présenter ses respects aux grands, assez prudent pour ne les pas ennuyer, et qui s'est bien promis d'assurer son repos par l'obscurité de sa vie studieuse ? Après tout, les services éminens que M. Boerhaave voulut me rendre étaient dignes de lui, et sont chers à ma mémoire. Aussi, par vénération et par reconnaissance, je jetterai toute ma vie des fleurs sur son tombeau.
Manibus dabo lilia plenis.
Purpureos spargam flores, et fungar inani
Munere.
(D.J.)
VOORHOUT
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Géographie moderne
- Affichages : 1024