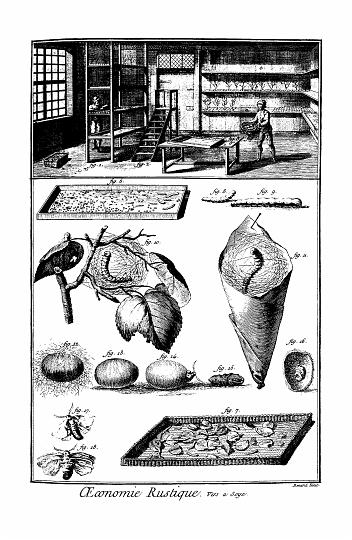(Arts, Commerce et Politique) Les maitrises et receptions sont censées établies pour constater la capacité requise dans ceux qui exercent le négoce et les arts, et encore plus pour entretenir parmi eux l'émulation, l'ordre et l'équité ; mais au vrai, ce ne sont que des raffinements de monopole vraiment nuisibles à l'intérêt national, et qui n'ont du reste aucun rapport nécessaire avec les sages dispositions qui doivent diriger le commerce d'un grand peuple. Nous montrerons même que rien ne contribue davantage à fomenter l'ignorance, la mauvaise foi, la paresse dans les différentes professions.
Les Egyptiens, les Grecs, les Romains, les Gaulois, conservaient beaucoup d'ordre dans toutes les parties de leur gouvernement ; cependant on ne voit pas qu'ils aient adopté comme nous les maitrises, ou la profession exclusive des arts et du commerce. Il était permis chez eux à tous les citoyens d'exercer un art ou négoce ; et à peine dans toute l'histoire ancienne trouve-t-on quelque trace de ces droits privatifs qui font aujourd'hui le principal règlement des corps et communautés mercantilles.
Il est encore de nos jours bien des peuples qui n'assujettissent point les ouvriers et les négociants aux maitrises et réceptions. Car sans parler des orientaux, chez qui elles sont inconnues, on assure qu'il n'y en a presque point en Angleterre, en Hollande, en Portugal, en Espagne. Il n'y en a point du tout dans nos colonies, non plus que dans quelques-unes de nos villes modernes, telles que l'Orient, S. Germain, Versailles et autres. Nous avons même des lieux privilégiés à Paris où bien des gens travaillent et trafiquent sans qualité légale, le tout à la satisfaction du public. D'ailleurs combien de professions qui sont encore tout à fait libres, et que l'on voit subsister néanmoins à l'avantage de tous les sujets ? D'où je conclus que les maitrises ne sont point nécessaires, puisqu'on s'en est passé longtemps, et qu'on s'en passe tous les jours sans inconvénient.
Personne n'ignore que les maitrises n'aient bien dégénéré de leur première institution. Elles consistaient plus dans les commencements à maintenir le bon ordre parmi les ouvriers et les marchands, qu'à leur tirer des sommes considérables ; mais depuis qu'on les a tournées en tribut, ce n'est plus, comme dit Furetière, que cabale, ivrognerie et monopole, les plus riches ou les plus forts viennent communément à bout d'exclure les plus faibles, et d'attirer ainsi tout à eux ; abus constants que l'on ne pourra jamais déraciner qu'en introduisant la concurrence et la liberté dans chaque profession : Has perniciosas pestes ejicite, refrenate coemptiones istas divitum, ac velut monopolii exercendi licentiam. Lib. I. Eutopiae Mori.
Je crois pouvoir ajouter là-dessus ce que Colbert disait à Louis XIV. " La rigueur qu'on tient dans la plupart des grandes villes de votre royaume pour recevoir un marchand, est un abus que votre majesté a intérêt de corriger ; car il empêche que beaucoup de gens ne se jettent dans le commerce, où ils réussiraient mieux bien souvent que ceux qui y sont. Quelle nécessité y a-t-il qu'un homme fasse apprentissage ? cela ne saurait être bon tout au plus que pour les ouvriers, afin qu'ils n'entreprennent pas un métier qu'ils ne savent point ; mais les autres, pourquoi leur faire perdre le temps ? Pourquoi empêcher que des gens qui en ont quelquefois plus appris dans les pays étrangers qu'il n'en faut pour s'établir, ne le fassent pas, parce qu'il leur manque un brevet d'apprentissage ? Est-il juste, s'ils ont l'industrie de gagner leur vie, qu'on les en empêche sous le nom de votre majesté, elle qui est le père commun de ses sujets, et qui est obligée de les prendre en sa protection ? Je crois donc que quand elle ferait une ordonnance par laquelle elle supprimerait tous les règlements faits jusqu'ici à cet égard, elle n'en ferait pas plus mal ". Testam. polit. ch. XVe
Personne ne se plaint des foires franches établies en plusieurs endroits du royaume, et qui sont en quelque sorte des dérogeances aux maitrises. On ne se plaint pas non plus à Paris de ce qu'il est permis d'y apporter des vivres deux fois la semaine. Enfin ce n'est pas aux maitrises ni aux droits privatifs qu'on a dû tant d'heureux génies qui ont excellé parmi nous en tous genres de littérature et de science.
Il ne faut donc pas confondre ce qu'on appelle maitrise et police : ces idées sont bien différentes, et l'une n'amène peut-être jamais l'autre. Aussi ne doit-on pas rapporter l'origine des maitrises ni à un perfectionnement de police, ni même aux besoins de l'état, mais uniquement à l'esprit de monopole qui règne d'ordinaire parmi les ouvriers et les marchands. On sait en effet que les maitrises étaient inconnues il y a quatre à cinq siècles. J'ai Ve des règlements de police de ces temps-là qui commencent par annoncer une franchise parfaite en ce qui concerne les Arts et le Commerce : Il est permis à cil qui voudra, &c.
L'esprit de monopole aveugla dans la suite les ouvriers et les négociants ; ils crurent mal-à-propos que la liberté générale du négoce et des arts leur était préjudiciable : dans cette persuasion ils complotèrent ensemble pour se faire donner certains règlements qui leur fussent favorables à l'avenir, et qui fussent un obstacle aux nouveaux venus. Ils obtinrent donc premièrement une entière franchise pour tous ceux qui étaient actuellement établis dans telle et telle profession ; en même temps ils prirent des mesures pour assujettir les aspirants à des examens et à des droits de réception qui n'étaient pas considérables d'abord, mais qui sous divers prétextes se sont accrus prodigieusement. Sur quoi je dois faire ici une observation qui me parait importante, c'est que les premiers auteurs de ces établissements ruineux pour le public, travaillèrent sans y penser contre leur postérité même. Ils devaient concevoir en effet, pour peu qu'ils eussent réfléchi sur les vicissitudes des familles, que leurs descendants ne pouvant pas embrasser tous la même profession, allaient être asservis durant des siècles à toute la gêne des maitrises ; et c'est une réflexion que devraient faire encore aujourd'hui ceux qui en sont les plus entêtés et qui les craient utiles à leur négoce, tandis qu'elles sont vraiment dommageables à la nation. J'en appelle à l'expérience de nos voisins, qui s'enrichissent par de meilleures voies, en ouvrant à tout le monde la carrière des Arts et du Commerce.
Les corps et communautés ne voient qu'avec jalousie le grand nombre des aspirants, et ils font en conséquence tout leur possible pour le diminuer ; c'est pour cela qu'ils enflent perpétuellement les droits de réception, du-moins pour ceux qui ne sont pas fils de maîtres. D'un autre côté, lorsque le ministère en certains cas annonce des maitrises de nouvelle création et d'un prix modique, ces corps, toujours conduits par l'esprit de monopole, aiment mieux les acquérir pour eux-mêmes sous des noms empruntés, et par ce moyen les éteindre à leur avantage, que de les voir passer à de bons sujets qui travailleraient en concurrence avec eux.
Mais ce que je trouve de plus étrange et de plus inique, c'est l'usage où sont plusieurs communautés à Paris de priver une veuve de tout son droit, et de lui faire quitter sa fabrique et son commerce lorsqu'elle épouse un homme qui n'est pas dans le cas de la maitrise : car enfin sur quoi fondé lui causer à elle et à ses enfants un dommage si considérable, et qui ne doit être que la peine de quelque grand délit. Tout le crime qu'on lui reproche et pour lequel on la punit avec tant de rigueur, c'est qu'elle prend, comme on dit, un mari sans qualité. Mais quelle police ou quelle loi, quelle puissance même sur la terre peut gêner ainsi les inclinations des personnes libres, et empêcher des mariages d'ailleurs honnêtes et légitimes ? De plus, où est la justice de punir les enfants d'un premier lit et qui sont fils de maître, où est, dis-je, la justice de les punir pour les secondes nôces de leur mère ?
Si l'on prétendait simplement qu'en épousant une veuve de maître l'homme sans qualité n'acquiert aucun droit pour lui-même, et qu'avenant la mort de sa femme il doit cesser un négoce auquel il n'est pas admis par la communauté, à la bonne heure, j'y trouverais moins à redire ; mais qu'une veuve qui a par elle-même la liberté du commerce tant qu'elle reste en viduité, que cette veuve remariée vienne à perdre son droit et en quelque sorte celui de ses enfants, par la raison seule que les statuts donnent l'exclusion à son mari, c'est, je le dis hautement, l'injustice la plus criante. Rien de plus opposé à ce que Dieu prescrit dans l'Exode xxij. 22. viduae et pupillo non nocebitis. Il est visible en effet qu'un usage si déraisonnable, si contraire au droit naturel, tend à l'oppression de la veuve et de l'orphelin ; et l'on sentira, si l'on y réfléchit, qu'il n'a pu s'établir qu'à la sourdine, sans avoir jamais été bien discuté ni bien approfondi.
Voilà donc sur les maitrises une législature arbitraire, d'où il émane de prétendus règlements favorables à quelques-uns et nuisibles au grand nombre ; mais convient-il à des particuliers sans autorité, sans lumières et sans lettres, d'imposer un joug à leurs concitoyens, d'établir pour leur utilité propre des lois onéreuses à la société ? Et notre magistrature enfin peut-elle approuver de tels attentats contre la liberté publique ?
On parle beaucoup depuis quelques années de favoriser la population, et sans doute que c'est l'intention du ministère ; mais sur cela malheureusement nous sommes en contradiction avec nous-mêmes, puisqu'il n'est rien en général de plus contraire au mariage que d'assujettir les citoyens aux embarras des maitrises, et de gêner les veuves sur cet article au point de leur ôter en certains cas toutes les ressources de leur négoce. Cette mauvaise politique réduit bien des gens au célibat ; elle occasionne le vice et le désordre, et elle diminue nos véritables richesses.
En effet, comme il est difficîle de passer maître et qu'il n'est guère possible sans cela de soutenir une femme et des enfants, bien des gens qui sentent et qui craignent cet embarras, renoncent pour toujours au mariage, et s'abandonnent ensuite à la paresse et à la débauche : d'autres effrayés des mêmes difficultés, pensent à chercher au loin de meilleures positions ; et persuadés sur le bruit commun que les pays étrangers sont plus favorables, ils y portent comme à l'envi leur courage et leurs talents. Du reste, ce ne sont pas les disgraciés de la nature, les faibles ni les imbéciles qui songent à s'expatrier ; ce sont toujours les plus vigoureux et les plus entreprenans qui vont tenter fortune chez l'étranger, et qui vont quelquefois dans la même vue jusqu'aux extrémités de la terre. Ces émigrations si déshonorantes pour notre police, et que différentes causes occasionnent tous les jours, ne peuvent qu'affoiblir sensiblement la puissance nationale ; et c'est pourquoi il est important de travailler à les prévenir. Un moyen pour cela des plus efficaces, ce serait d'attribuer des avantages solides à la société conjugale, de rendre, en un mot, les maitrises gratuites ou peu couteuses aux gens mariés, tandis qu'on les vendrait fort cher aux célibataires, si l'on n'aimait encore mieux leur donner l'entière exclusion.
Quoi qu'il en sait, les maitrises, je le répete, ne sont point une suite nécessaire d'une police exacte ; elles ne servent proprement qu'à fomenter parmi nous la division et le monopole ; et il est aisé sans ces pratiques d'établir l'ordre et l'équité dans le commerce.
On peut former dans nos bonnes villes une chambre municipale, composée de cinq ou six échevins ayant un magistrat à leur tête, pour régler gratuitement tout ce qui concerne la police des arts et du négoce, de manière que ceux qui voudront fabriquer ou vendre quelque marchandise ou quelqu'ouvrage, n'auront qu'à se présenter à cette chambre, déclarant à quoi ils veulent s'attacher, et donnant leur nom et leur demeure pour que l'on puisse veiller sur eux par des visites juridiques dont on fixera le nombre et la rétribution à l'avantage des surveillans.
A l'égard de la capacité requise pour exercer chaque profession en qualité de maître, il me semble qu'on devrait l'estimer en bloc sans chicane et sans partialité, par le nombre des années d'exercice ; je veux dire que quiconque prouverait, par exemple, huit ou dix ans de travail chez les maîtres, serait censé pour lors ipso facto, sans brevet d'apprentissage, sans chef-d'œuvre et sans examen, raisonnablement au fait de son art ou négoce, et digne enfin de parvenir à la maitrise aux conditions prescrites par sa majesté.
Qu'est-il nécessaire en effet d'assujettir les simples compagnons à de prétendus chefs-d'œuvre, et à mille autres formalités gênantes auxquelles on n'assujettit point les fils de maître ? On s'imagine sans doute que ceux-ci sont plus habiles, et cela devrait être naturellement ; cependant l'expérience fait assez voir le contraire.
Un simple compagnon a toujours de grandes difficultés à vaincre pour s'établir dans une profession ; il est communément moins riche et moins protégé, moins à portée de s'arranger et de se faire connaître ; cependant il est autant qu'un autre membre de la république, et il doit ressentir également la protection des lais. Il n'est donc pas juste d'aggraver le malheur de sa condition, ni de rendre son établissement plus difficîle et plus couteux, en un mot d'assujettir un sujet faible et sans défense à des cérémonies ruineuses dont on exempte ceux qui ont plus de facultés et de protection.
D'ailleurs est-il bien constant que les chefs-d'œuvre soient nécessaires pour la perfection des Arts ? pour moi je ne le crois en aucune sorte ; il ne faut communément que de l'exactitude et de la probité pour bien faire, et heureusement ces bonnes qualités sont à la portée des plus médiocres sujets. J'ajoute qu'un homme passablement au fait de sa profession peut travailler avec fruit pour le public et pour sa famille, sans être en état de faire des prodiges de l'art. Vaut-il mieux dans ce cas-là qu'il demeure sans occupation ? A Dieu ne plaise ! il travaillera utilement pour les petits et les médiocres, et pour lors son ouvrage ne sera payé que sa juste valeur ; au lieu que ce même ouvrage devient souvent fort cher entre les mains des maîtres. Le grand ouvrier, l'homme de goût et de génie sera bientôt connu par ses talents, et il les emploiera pour les riches, les curieux et les délicats. Ainsi, quelque facilité qu'on ait à recevoir des maîtres d'une capacité médiocre, on ne doit pas appréhender de manquer au besoin d'excellents artistes. Ce n'est point la gêne des maitrises qui les forme, c'est le goût de la nation et le prix qu'on peut mettre aux beaux ouvrages.
On peut inférer de ces réflexions que tous les sujets étant également chers, également soumis au roi, sa majesté pourrait avec justice établir un règlement uniforme pour la réception des ouvriers et des commerçans. Et qu'on ne dise pas que les maitrises sont nécessaires pour asseoir et pour faire payer la capitation, puisqu'enfin tout cela se fait également bien dans les villes où il n'y a que peu ou point de maitrises : d'ailleurs on conserverait toujours les corps et communautés, tant pour y maintenir l'ordre et la police, que pour asseoir les impositions publiques.
Mais je soutiens d'un autre côté que les maitrises, et réceptions sur le pied qu'elles sont aujourd'hui, font éluder la capitation à bien des sujets qui la payeraient en tout autre cas. En effet, la difficulté de devenir maître forçant bien des gens dans le Commerce et dans les Arts à vieillir garçons de boutique, courtiers, compagnons, etc. ces gens-là presque toujours isolés, errants et peu connus, esquivent assez facilement les impositions personnelles : au lieu que si les maitrises étaient plus accessibles, il y aurait en conséquence beaucoup plus de maîtres, gens établis pour les Arts et pour le Commerce, qui tous payeraient la capitation à l'avantage du public et du roi.
Un autre avantage qu'on pourrait trouver dans les corps que le lien des maitrises réunit de nos jours, c'est qu'au lieu d'imposer aux aspirants des taxes considérables qui fondent presque toujours entre les mains des chefs et qui sont infructueuses au général, on pourrait, par des dispositions plus sages, procurer des ressources à tous les membres contre le desastre des faillites ; je m'explique.
Un jeune marchand dépense communément pour sa réception, circonstances et dépendances, environ 2000 francs, et cela, comme nous l'avons dit, en pure perte. Je voudrais qu'à la place, après l'examen de capacité que nous avons marqué ou autre qu'on croirait préférable, on fit compter par les candidats la somme de 10000 livres, pour lui conférer le droit et le crédit de négociant ; somme dont on lui payerait l'intérêt à quatre pour cent tant qu'il voudrait faire le commerce. Cet argent serait aussi-tôt placé à cinq ou six pour cent chez des gens solvables et bien cautionnés d'ailleurs. Au moyen des 10000 liv. avancées par tous marchands, chacun aurait dans son corps un crédit de 40000 francs à la caisse ou au bureau général : en sorte que ceux qui lui fourniraient des marchandises ou de l'argent pourraient toujours assurer leur créance jusqu'à ladite somme de 40000 livres.
Au lieu qu'on marche aujourd'hui à tâtons et en tremblant dans les crédits du commerce, le nouveau règlement augmenterait la confiance et par conséquent la circulation ; il préviendrait encore la plupart des faillites, par la raison principale qu'on verrait beaucoup moins d'avanturiers s'introduire en des négoces pour lesquels il faudrait alors du comptant, ce qui serait au reste un exclusif plus efficace, plus favorable aux anciennes familles et aux anciens installés, que l'exigence actuelle des maitrises, qui n'opèrent d'autre effet dans le commerce que d'en arrêter les progrès.
Avec le surplus d'intérêt qu'aurait la caisse, quand elle ne placerait qu'à cinq pour cent, elle remplacerait les vides et les pertes qu'elle essuyerait encore quelquefois, mais qui seraient pourtant assez rares, parce que le commerce, comme on l'a vu, ne se ferait plus guère que par des gens qui auraient un fonds et des ressources connues. Si cependant la caisse faisait quelque perte au-delà de ses produits, ce qui est difficîle à croire, cette perte serait supportée alors par le corps entier, suivant la taxe de capitation imposée à chacun des membres. Cette contribution, qui n'aurait peut-être pas lieu en vingt ans, deviendrait presqu'imperceptible aux particuliers, et elle empêcherait la ruine de tant d'honnêtes gens qu'une seule banqueroute écrase souvent aujourd'hui. Quand un homme voudrait quitter le commerce, on lui rendrait ses 10000 liv. pourvu qu'il eut satisfait les créanciers qui auraient assuré à la caisse.
Au surplus, ce qu'on dit ici sommairement en faveur des marchands, se pourrait pratiquer à proportion pour les ouvriers ; on pourrait employer à-peu-près les mêmes dispositions pour augmenter le crédit des notaires et la sécurité du public à leur égard.
Quoi qu'il en sait, comme il est naturel d'employer les récompenses et les punitions pour intéresser chacun dans son état à se rendre utîle au public, ceux qui se seront distingués pendant quelques années par leur vigilance, leur droiture et leur habileté, pourront être gratifiés d'une sorte d'enseigne, que la police leur accordera comme un témoignage authentique de leur exactitude et de leur probité. Au contraire, si quelqu'un commet des malversations ou des friponneries avérées, il sera condamné à l'amende, et obligé de souffrir pendant quelque temps à sa porte une enseigne de répréhension et d'infamie ; pratique beaucoup plus sage que de murer sa boutique.
En un mot, on peut prendre toute sorte de précautions, pour que chacun remplisse les devoirs de son état ; mais il faut laisser à tous la liberté de bien faire : et loin de fixer le nombre des sujets qu'il doit y avoir dans les professions utiles, ce qui est absolument déraisonnable, à moins qu'on ne fixe en même temps le nombre des enfants qui doivent naître ; il faut procurer des ressources à tous les citoyens, pour employer à propos leurs facultés et leurs talents.
Il est à présumer qu'avec de tels règlements chacun voudra se piquer d'honneur, et que la police sera mieux observée que jamais, sans qu'il faille recourir à des moyens embarrassants, et qui sont une source de divisions et de procès entre les différents corps des arts et du commerce. Il résulte encore une autre utilité des précautions qu'on a marquées, c'est que l'on connaitrait aisément les gens surs et capables à qui l'on pourrait s'adresser ; connaissance qui ne s'acquiert aujourd'hui qu'après bien des épreuves que l'on fait d'ordinaire à ses dépens.
Pour répondre à ce que l'on dit souvent contre la liberté des arts et du commerce ; savoir qu'il y aurait trop de monde en chaque profession ; il est visible que l'on ne raisonnerait pas de la sorte, si l'on voulait examiner la chose de près : car enfin la liberté du commerce ferait-elle quitter à chacun son premier état pour en prendre un nouveau ? Non, sans doute : chacun demeurerait à sa place, et aucune profession ne serait surchargée, parce que toutes seraient également libres. A la vérité, bien des gens à présent trop misérables pour aspirer aux maitrises, se verraient tout-à-coup tirés de servitude, et pourraient travailler pour leur compte, en quoi il y aurait à gagner pour le public.
Mais, dit-on, ne sentez-vous pas qu'une infinité de sujets qui n'ont aucun état fixe, voyant la porte des arts et du négoce ouverte à tout le monde, s'y jetteraient bientôt en foule, et troubleraient ainsi l'harmonie qu'on y voit régner ?
Plaisante objection ! si l'entrée des arts et du commerce devenait plus facîle et plus libre, trop de gens, dit-on, profiteraient de la franchise. Hé, ne serait-ce pas le plus grand bien que l'on put désirer ? Si ce n'est qu'on croie peut-être qu'il vaut mieux subsister par quelque industrie vicieuse, ou croupir dans l'oisiveté, que de s'appliquer à quelque honnête travail. En un mot, je ne comprents pas qu'on puisse hésiter pour ouvrir à tous les sujets la carrière du négoce et des arts ; puisqu'enfin il n'y a pas à délibérer, et qu'il est plus avantageux d'avoir bien des travailleurs et des commerçans, dû.-il s'en trouver quelques-uns de mal-habiles, que de rendre l'oisiveté presque inévitable, et de former ainsi des fainéans, des voleurs et des filous.
Que le sort des hommes est à plaindre ! Ils n'ont pas la plupart en naissant un point où reposer la tête, pas le moindre espace dans l'immensité qui appartienne à leurs parents, et dont il ne faille payer la location. Mais c'était trop peu que les riches et les grands eussent envahi les fonds, les terres, les maisons ; il fallait encore établir les maitrises, il fallait interdire aux faibles, aux indéfendus l'usage si naturel de leur industrie et de leurs bras.
L'arrangement que j'indique ici produirait bientôt dans le royaume un commerce plus vif et plus étendu ; les manufacturiers et les autres négociants s'y multiplieraient de toutes parts, et seraient plus en état qu'aujourd'hui de donner leurs marchandises à un prix favorable, surtout si, pour complément de réforme, on supprimait au-moins les trois quarts de nos fêtes, et qu'on rejettât sur la capitation générale le produit des entrées et des sorties qu'on fait payer aux marchandises et denrées, au-moins celles qui se perçoivent dans l'intérieur du royaume, et de province à province.
On est quelquefois surpris que certaines nations donnent presque tout à meilleur marché que les François ; mais ce n'est point un secret qu'elles aient privativement à nous. La véritable raison de ce phénomène moral et politique, c'est que le commerce est regardé chez elles comme la principale affaire de l'état, et qu'il y est plus protégé que parmi nous. Une autre raison qui fait beaucoup ici, c'est que leurs douannes sont moins embarrassantes et moins ruineuses pour le commerce, au moins pour tout ce qui est de leur fabrique et de leur cru. D'ailleurs ces peuples commerçans ne connaissent presque point l'exclusif des maitrises ou des compagnies ; ils connaissent encore moins nos fêtes, et c'est en quoi ils ont bien de l'avantage sur nous. Tout cela joint au bas intérêt de leur argent, à beaucoup d'économie et de simplicité dans leur manière de vivre et de s'habiller, les met en état de vendre à un prix modique, et de conserver chez eux la supériorité du commerce. Rien n'empêche que nous ne profitions de leur exemple, et que nous ne travaillions à les imiter, pour-lors nous irons bientôt de pair avec eux. Rentrons dans notre sujet.
On soutient que la franchise générale des arts et du négoce nuirait à ceux qui sont dejà maîtres, puisque tout homme pourrait alors travailler, fabriquer et vendre.
Sur cela il faut considérer sans prévention, qu'il n'y aurait pas tant de nouveaux maîtres qu'on s'imagine. En effet, il y a mille difficultés pour commencer ; on n'a pas d'abord des connaissances et des pratiques, et surtout on n'a pas, à point nommé, des fonds suffisans pour se loger commodément, pour s'arranger, risquer, faire des avances, etc. Cependant tout cela est nécessaire, et c'est ce qui rendra ces établissements toujours trop difficiles ; ainsi les anciens maîtres profiteraient encore longtemps de l'avantage qu'ils ont sur tous les nouveaux-venus. Et au pis aller, la nation jouissant dans la suite, et jouissant également de la liberté du commerce, elle se verrait à-peu-près, à cet égard, au point qu'elle était il y a quelques siècles, au point que sont encore nos colonies, et la plupart même des étrangers, à qui la franchise des arts et du négoce procure, comme on sait, l'abondance et les richesses.
Au surplus, on peut concilier les intérêts des anciens et des nouveaux maîtres, sans que personne ait sujet de se plaindre. Voici donc le tempérament que l'on pourrait prendre ; c'est que pour laisser aux anciens maîtres le temps de faire valoir leurs droits privatifs, on n'accorderait la franchise des arts et du commerce qu'à condition de payer pour les maitrises et réceptions la moitié de ce que l'on débourse aujourd'hui, ce qui continuerait ainsi pendant le cours de vingt ans ; après quoi, on ne payerait plus à perpétuité que le quart de ce qu'il en coute, c'est-à-dire qu'une maitrise ou réception qui revient à 1200. liv. serait modifiée d'abord à 600 liv. et au bout de vingt ans, fixée pour toujours à 300. liv. le tout sans repas et sans autres cérémonies. Les sommes payables par les nouveaux maîtres, pendant l'espace de vingt ans, seraient employées au profit des anciens, tant pour acquitter les dettes de leur communauté, que pour leur capitation particulière, et cela pour les dédommager d'autant, mais dans la suite, les sommes qui viendraient des nouvelles réceptions, et qui seraient payées également par tous les sujets, fils de maîtres et autres, seraient converties en octrais à l'avantage des habitants, et non-dissipées, comme aujourd'hui, en Te Deum, en pains benis, en repas, en frairies, etc.
Au reste, je crois qu'en attendant la franchise dont il s'agit, on pourrait établir dès-à-présent un marché franc dans les grandes villes, marché qui se tiendrait quatre ou cinq fois par an, avec une entière liberté d'y apporter toutes marchandises non-prohibées ; mais avec cette précaution essentielle, de ne point assujettir les marchands à se mettre dans certains bâtiments, certains enclos, où l'étalage et les loyers sont trop chers.
Outre l'inconvénient qu'ont les maitrises de nuire à la population, comme on l'a montré ci-devant, elles en ont un autre qui n'est guère moins considérable, elles font que le public est beaucoup plus mal servi. Les maitrises, en effet, pouvant s'obtenir par faveur et par argent, et ne supposant essentiellement ni capacité, ni droiture dans ceux qui les obtiennent ; elles sont moins propres à distinguer le mérite, ou à établir la justice et l'ordre parmi les ouvriers et les négociants, qu'à perpétuer dans le commerce l'ignorance et le monopole : en ce qu'elles autorisent de mauvais sujets qui nous font payer ensuite, je ne dis pas seulement les frais de leur réception, mais encore leurs négligences et leurs fautes.
D'ailleurs la plupart des maîtres employant nombre d'ouvriers, et n'ayant sur eux qu'une inspection générale et vague, leurs ouvrages sont rarement aussi parfaits qu'ils devraient l'être ; suite d'autant plus nécessaire que ces ouvriers subalternes sont payés maigrement, et qu'ils ne sont pas fort intéressés à ménager des pratiques pour les maîtres ; ne visant communément qu'à passer la journée, ou bien à expédier beaucoup d'ouvrages, s'ils sont, comme l'on dit, à leurs pièces ; au lieu que s'il était permis de bien faire à quiconque en a le vouloir, plusieurs de ceux qui travaillent chez les maîtres, travailleraient bientôt pour leur compte ; et comme chaque artisan pour-lors serait moins chargé d'ouvrage, et qu'il voudrait s'assurer des pratiques, il arriverait infailliblement que tel qui se néglige aujourd'hui en travaillant pour les autres, deviendrait plus soigneux et plus attaché dès qu'il travaillerait pour lui-même.
Enfin le plus terrible inconvénient des maitrises, c'est qu'elles sont la cause ordinaire du grand nombre de fainéans, de bandits, de voleurs, que l'on voit de toutes parts ; en ce qu'elles rendent l'entrée des arts et du négoce si difficîle et si pénible, que bien des gens, rebutés par ces premiers obstacles, s'éloignent pour toujours des professions utiles, et ne subsistent ordinairement dans la suite que par la mendicité, la fausse monnaie, la contrebande, par les filouteries, les vols et les autres crimes. En effet, la plupart des malfaiteurs que l'on condamne aux galères, ou que l'on punit du dernier supplice, sont originairement de pauvres orphelins, des soldats licenciés, des domestiques hors de place, ou tels autres sujets isolés, qui n'ayant pas été mis à des métiers solides, et qui trouvant des obstacles perpétuels à tout le bien qu'ils pourraient faire, se voient par-là comme entrainés dans une suite affreuse de crimes et de malheurs.
Combien d'autres gens d'espèces différentes, hermites, souffleurs, charlatants, etc. combien d'aspirants à des professions inutiles ou nuisibles, qui n'ont d'autre vocation que la difficulté des arts et du commerce, et dont plusieurs sans bien et sans emploi ne sont que trop souvent réduits à chercher, dans leur désespoir, des ressources qu'ils ne trouvent point par-tout ailleurs ?
Qu'on favorise le commerce, l'agriculture et tous les arts nécessaires, qu'on permette à tous les sujets de faire valoir leurs biens et leurs talents, qu'on apprenne des métiers à tous les soldats, qu'on occupe et qu'on instruise les enfants des pauvres, qu'on fasse régner dans les hôpitaux l'ordre, le travail et l'aisance, qu'on reçoive tous ceux qui s'y présenteront, enfin qu'on renferme et qu'on corrige tous les mendiants valides, bientôt au lieu de vagabonds et de voleurs si communs de nos jours, on ne verra plus que des hommes laborieux ; parce que les peuples trouvant à gagner leur vie, et pouvant éviter la misere par le travail, ne seront jamais réduits à des extrémités fâcheuses ou funestes.
Pauciores alantur otio, reddatur agricolatio, lanificium instauretur, ut sit honestum negotium quo se utiliter exerceat otiosa ista turba, vel quos hactenùs inopia fures facit, vel qui nunc errones aut otiosi sunt ministri, fures nimirum utrique futuri. Lib. I. Eutopiae. Article de M. FAIGUET DE VILLENEUVE.
MAITRISES
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Commerce
- Catégorie : Commerce & Politique
- Affichages : 1777