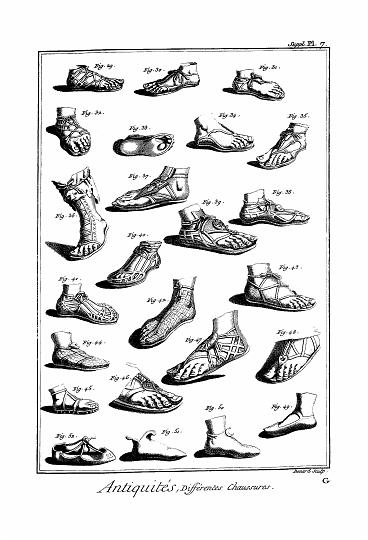LE, (Géographie moderne) ou le VIVAREZ ; petite province de France, dans le gouvernement du Languedoc ; elle est bornée au nord par le Lyonnais, au midi par le diocèse d'Uzès, au levant par le Rhône, qui la sépare du Dauphiné, et au couchant par le Vélay et le Gévaudan.
Le Vivarais a pris son nom de la ville de Viviers. Les peuples de ce pays s'appelaient autrefois Helvii, et appartenaient à la province romaine du temps de Jules César. Après la nouvelle division des provinces sous Constantin et ses successeurs, les Helviens furent attribués à la première Viennaise. Leur capitale s'appelait Albe, et même Albe-Auguste, aujourd'hui Alps ; mais ce n'est plus qu'un bourg, qui a succédé à l'ancienne ville ruinée par les Barbares.
Lorsque l'empire romain s'écroula dans le cinquième siècle, les peuples helviens tombèrent sous l'empire des Bourguignons, et ensuite sous celui des François ; tout le pays est nommé dans Pline, Helvicus Pagus ; cet historien en fait mention, ainsi que du vin de son territoire, helvicum vinum.
Le Vivarais est divisé en haut et bas Vivarais par la rivière d'Erieu. Le haut Vivarais est couvert de montagnes qui nourrissent quantité de bestiaux. Le bas Vivarais est encore plus cultivé par l'industrie des habitants.
Argoux (Gabriel) avocat du parlement de Paris, mort au commencement de ce siècle, était né dans le Vivarais ; son institution au droit français est un ouvrage estimé.
La Fare (Charles-Auguste de) né en 1644 au château de Valgorge en Vivarais, mourut à Paris en 1712. Il est connu par ses mémoires et par des vers agréables où règne le bon goût et la finesse du sentiment. Il lia l'amitié la plus étroite avec l'abbé de Chaulieu, et tous deux faisaient les délices de la bonne compagnie. Inspirés par leur esprit, par la déesse de Cythere et par le dieu du vin, ils chantaient délicatement dans les soupers du Temple les éloges de ces deux divinités. Mais ce qu'il y a de singulier, c'est que le talent du marquis de la Fare pour la poésie ne se développa que dans la maturité de l'âge. " Ce fut, dit M. de Voltaire, madame de Cailus, l'une des plus aimables personnes de son siècle par sa beauté et par son esprit, pour laquelle il fit ses premiers vers, et peut-être les plus délicats qu'on ait de lui. "
M'abandonnant un jour à la tristesse,
Sans espérance, et même sans désirs,
Je regrettai les sensibles plaisirs
Dont la douceur enchanta ma jeunesse.
Sont-ils perdus, disais-je, sans retour ?
Et n'es-tu pas cruel, Amour,
Toi que j'ai fait dès mon enfance
Le maître de mes plus beaux jours,
D'en laisser terminer le cours
A l'ennuyeuse indifférence ?
Alors j'aperçus dans les airs
L'enfant maître de l'univers,
Qui plein d'une joie inhumaine,
Me dit en souriant, Tircis, ne te plains plus,
Je vais mettre fin à ta peine ;
Je te promets un regard de Cailus.
Quoique M. de la Fare vécut dans le grand monde, il en connaissait aussi bien que personne la frivolité et les erreurs. Voyez comme il en parle dans son ode sur la campagne. Elle est pleine de réflexions d'un philosophe qui nous enchante par sa morale judicieuse.
Je vois sur des coteaux fertiles.
Des troupeaux riches et nombreux,
Ceux qui les gardent, sont heureux,
Et ceux qui les ont, sont tranquilles.
S'ils ont à redouter les loups,
Et si l'hiver vient les contraindre,
Ce sont-là tous les maux à craindre ;
Il en est d'autres parmi nous.
Nous ne savons plus nous connaître,
Nous contenir encore moins.
Heureux, nous faisons par nos soins,
Tout ce qu'il faut pour ne pas l'être.
Notre cœur soumet notre esprit
Aux caprices de notre vie ;
En vain la raison se récrie,
L'abus parle, tout y souscrit.
Ici je rêve à quoi nos pères
Se bornaient dans les premiers temps :
Sages, modestes et contens,
Ils se refusaient aux chimères.
Leurs besoins étaient leurs objets ;
Leur travail était leur ressource
Et la vertu toujours la source
De leurs mœurs et de leurs projets.
Ils savaient à quoi la nature
A condamné tous les humains.
Ils ne devaient tous qu'à leurs mains,
Leur vêtement, leur nourriture.
Ils ignoraient la volupté,
Et la fausse délicatesse,
Dont aujourd'hui notre mollesse
Se fait une félicité.
L'intérêt ni la vaine gloire
Ne dérangeaient pas leur repos ;
Ils aimaient plus dans leurs héros,
Une vertu qu'une victoire.
Ils ne connaissaient d'autre rang,
Que celui que la vertu donne ;
Le mérite de la personne
Passait devant les droits du sang.
Heureux habitants de ces plaines,
Qui vous bornez dans vos désirs,
Si vous ignorez nos plaisirs,
Vous ne connaissez pas nos peines ;
Vous goutez un bonheur si doux,
Qu'il rappelle le temps d'Astrée ;
Enchanté de cette contrée,
J'y reviendrai vivre avec vous.
Personne n'a mieux rendu que M. de la Fare, le naturel, la tendresse, la délicatesse, et l'élégante simplicité de Tibulle, témoin sa traduction de la première élégie du poète latin : ceux qui la connaissent comme ceux qui ne la connaissent pas, me sauront gré de la leur transcrire.
Que quelqu'autre aux dépens de sa tranquillité
Amasse une immense richesse ;
Pour moi de mes désirs la médiocrité
Me livre entier à la paresse.
Je suis content, pourvu que ma vigne et mes champs,
Ne trompent point mon espérance,
Et que dans mon grenier et ma cave en tout temps,
Je retrouve un peu d'abondance.
Je ne dédaigne point, pressant de l'aiguillon
Du bœuf tardif la marche lente,
De tracer quelquefois un fertîle sillon ;
Quelquefois j'arrose une plante.
Si le soir par hasard je trouve en mon chemin
Un agneau laissé par sa mère,
L'appelant doucement je l'emporte en mon sein,
Et je le rends à sa bergère.
Je lave et purifie avec soin mes troupeaux,
Pour me rendre Palès propice ;
Et lorsque la saison produit des fruits nouveaux,
J'en fais à Pan un sacrifice.
Je révère ces dieux et celui des confins,
Et Cérès d'épis couronnée,
Et chez moi, du puissant protecteur des jardins,
La tête de fleurs est ornée.
Et vous aussi, jadis d'un plus ample foyer,
O divinités tutélaires,
Recevez de vos soins un plus faible loyer,
Et des offrandes plus légères.
J'offrais une génisse, à-présent un agneau
Convient à mon peu de richesse ;
Autour de lui se rend de mon petit hameau
Toute la rustique jeunesse ;
Qui crie à haute voix : ô dieux ! assistez-nous,
Acceptez les présents peu dignes
Qu'humblement nous venons offrir à vos genoux ;
Bénissez nos champs et nos vignes.
La première liqueur qu'on versa pour les dieux
Fut mise en des vases d'argille ;
Nos vases, comme au temps de nos premiers ayeux,
Ne sont que de terre fragile.
O vous, loups ravisseurs, épargnez nos moutons,
Allez chercher dans nos prairies,
Pour y rassasier vos appétits gloutons,
De plus nombreuses bergeries.
Je suis pauvre et veux l'être, et ne souhaite pas
Des grands l'importune abondance ;
Peu de chose suffit à mes meilleurs repas,
En mon lit est mon espérance.
O qu'il est doux, pendant une orageuse nuit,
D'embrasser un objet aimable !
Et de se rendormir dans ses bras, au doux bruit
Que fait une pluie agréable !
Qu'un tel bonheur m'arrive ; et soit riche à bon droit
Celui qui bravant la furie
De la mer et des vents, abandonne son tait ;
Pour moi j'irai dans ma prairie,
Eviter, si je puis, la chaleur des étés,
A l'abri d'un bocage sombre,
Et sous un chêne assis à l'ombre,
Voir couler en rêvant les ruisseaux argentés.
Ah ! périssent plutôt l'or et les diamants,
Que je cause la moindre alarme
A ma douce maîtresse, et qu'à ses yeux charmants
Mon absence coute une larme !
C'est à toi, Messala, d'aller de mers en mers
Signaler ton nom par les armes ;
Je suis avec plaisir arrêté dans les fers
D'une beauté pleine de charmes.
Pour la gloire mon cœur ne peut former des vœux ;
Oui, je consens, chère Délie,
D'être estimé de tous, faible et peu généreux,
Pour t'avoir consacré ma vie.
Qu'avec toi le désert le plus inhabité
A mes yeux paraitrait aimable !
Qu'en tes bras, sur la mousse, en un mont écarté
Mon sommeil serait agréable !
Sans le dieu des amours, sans ses douces faveurs,
Que le lit le plus magnifique
Est souvent arrosé d'un déluge de pleurs !
Car ni la broderie antique,
Ni l'or, ni le duvet, ni le doux bruit des eaux,
Ni le silence et la retraite,
N'ont assez de douceur pour assoupir les maux
Qui troublent une âme inquiete.
Celui-là porterait, Délie, un cœur de fer,
Qui pouvant jouir de ta vue,
S'en irait, assuré de vaincre et triompher,
Chercher une terre inconnue.
Que je vive avec toi, que j'expire à tes yeux,
Et puisse ma main défaillante,
Serrer encore la tienne en mes derniers adieux !
Puisse encor ma bouche mourante
Recevoir tes baisers mêlés avec tes pleurs !
Car tu n'es point assez cruelle,
Pour ne pas honorer par de vives douleurs,
La mort de ton amant fidèle.
Il n'est jeune beauté qui regardant ton deuil
Ne sente émouvoir ses entrailles,
Qui n'en soit attendrie, et n'ait la larme à l'oeil,
Au retour de mes funérailles.
Epargne toutefois l'or de tes blonds cheveux,
C'est faire à mes manes outrage
Qu'attenter à ton sein l'objet de tous mes vœux,
Ou meurtrir un si beau visage.
En attendant, cueillons le fruit de nos amours,
Le temps qui fuit nous y convie ;
La mort trop tôt, hélas ! mettra fin pour toujours
Aux douceurs d'une telle vie.
La vieillesse s'avance, et nos ardents désirs
S'évanouiront à sa vue,
Car il serait honteux de pousser des soupirs
Avec une tête chenue.
C'est maintenant qu'il faut profiter des moments
Que Vénus propice nous donne,
Pendant qu'à nos plaisirs et nos amusements
La jeunesse nous abandonne.
J'y veux être ton maître, et disciple à mon tour.
Loin de moi tambours et trompettes,
Allez porter ailleurs qu'en cet heureux séjour
Le bruit éclatant que vous faites.
De la richesse ainsi que de la pauvreté,
Exempt dans ma douce retraite,
J'y saurai bien jouir en pleine liberté
D'une félicité parfaite.
Enfin le célèbre Rousseau a consacré un sonnet, ou si l'on veut une épigramme, à la gloire de M. de la Fare. Il fait à son ami, dans cette épigramme, l'application du vers si connu de l'anthologie.
VIVARAIS
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Géographie moderne
- Affichages : 1052