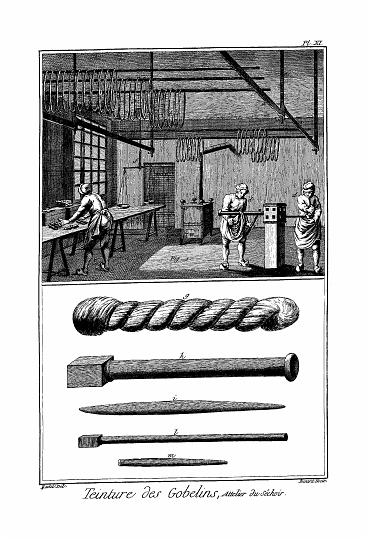S. f. (Médecine) Galien nous apprend que ce mot crise est un terme du barreau que les Médecins ont adopté, et qu'il signifie, à proprement parler, un jugement.
Hippocrate qui a souvent employé cette expression, lui donne différentes significations. Toute sorte d'excrétion est, selon lui, une crise ; il n'en excepte pas même l'accouchement, ni la sortie d'un os d'une plaie. Il appelle crise tout changement qui arrive à une maladie. Il dit aussi qu'il y a crise dans une maladie, lorsqu'elle augmente ou diminue considérablement, lorsqu'elle dégénere en une autre maladie, ou bien qu'elle cesse entièrement. Galien prétend, à-peu-près dans le même sens, que la crise est un changement subit de la maladie en mieux ou en pis ; c'est ce qui a fait que bien des auteurs ont regardé la crise comme une sorte de combat entre la nature et la maladie ; combat dans lequel la nature peut vaincre ou succomber : ils ont même avancé que la mort peut à certains égards être regardée comme la crise d'une maladie.
La doctrine des crises était une des parties les plus importantes de la Médecine des anciens : il y en avait à la vérité quelques-uns qui la rejetaient, comme vaine et inutîle ; mais la plupart ont suivi Hippocrate et Galien, dont nous allons exposer le système, avant de parler du sentiment des médecins qui leur étaient opposés, et de rapporter les différentes opinions des modernes sur cette partie de la Médecine pratique.
La crise, dit Galien, et d'après lui toute son école, est précedée d'un dérangement singulier des fonctions ; la respiration devient difficile, les yeux deviennent étincelans ; le malade tombe dans le délire, il croit voir des objets lumineux ; il pleure, il se plaint de douleurs au-derrière du cou, et d'une impression fâcheuse à l'orifice de l'estomac ; sa lèvre inférieure tremble, tout son corps est vivement secoué : les hypocondres rentrent quelquefois, et les malades se plaignent d'un feu qui les brule dans l'intérieur du corps, ils sont altérés : il y en a qui dorment ou qui s'assoupissent ; et à la suite de tous ces changements, se montrent une sueur ou un saignement du nez, un vomissement, un devoiement, ou des tumeurs. Les efforts et les excrétions sont proprement la crise ; elle n'est, à proprement parler, qu'un redoublement ou un accès extraordinaire, qui termine la maladie d'une façon ou d'autre.
La crise se fait, ou finit par un transport de matière d'une partie à l'autre, ou par une excrétion ; ce qui établit deux différentes espèces de crises. Les crises diffèrent encore en tant qu'elles sont bonnes ou mauvaises, parfaites ou imparfaites, sures ou dangereuses.
Les bonnes crises sont celles qui font au moins espérer que le malade se rétablira ; et les mauvaises, celles qui augmentent le danger. Les crises parfaites sont celles qui enlèvent, qui évacuent ou qui transportent toute la matière morbifique (voyez COCTION) ; et les imparfaites, celles qui ne l'enlèvent qu'en partie. Enfin la crise sure ou assurée, est celle qui se fait sans danger ; et la dangereuse est celle dans laquelle le malade risque beaucoup de succomber dans l'effort de la crise même. On pourrait encore ajouter à toutes ces espèces de crises, l'insensible, appelée solution par quelques auteurs, et qui est celle dans laquelle la matière morbifique se dissipe peu-à-peu.
Chaque espèce de crise a des signes particuliers, et qui sont différents, suivant que la crise doit se faire par les voies de la sueur ; par celles des urines, par les selles, par les crachats, ou par hémorrhagie ; c'est à la faveur de ces signes que le médecin peut juger du lieu que la nature a choisi pour la crise. On trouvera dans tous les articles qui regardent les différents organes secrétoires, et notamment aux mots URINE, CRACHAT, SUEUR, HEMORRHAGIE, etc. les moyens de connaître l'événement de la maladie, relativement aux différentes excrétions critiques, ou la détermination de la crise.
Les anciens ne se sont pas contentés d'avancer et de soutenir qu'il y a une crise dans la plupart des maladies aiguës, et de donner des règles pour déterminer l'organe, ou la partie spéciale dans laquelle ou par laquelle la crise doit se faire ; ils ont cru encore pouvoir fixer le temps de la crise : c'est ce qui a donné lieu à leur doctrine sur les jours critiques, que nous allons exposer, en nous attachant seulement à ce qu'il y avait de plus communément adopté parmi la plupart des anciens eux-mêmes ; car il y en avait qui osaient douter de la vertu des règles les plus reçues. Ce sont ces règles qui furent autrefois les plus reçues, que nous allons rapporter. Les voici.
Toutes les maladies aiguës se terminent en quarante jours, et souvent plutôt ; il y en a beaucoup qui finissent vers le trentième, et plus encore au vingt, au quatorze ou au sept. C'est donc dans l'espace de sept, de quatorze, de vingt ou de quarante jours au plus, qu'arrivent toutes les révolutions des maladies aiguës, qui sont celles qui ont une marche marquée par des crises et des jours critiques, ou du moins dans lesquelles ce caractère est plus sensible, plus observable.
Les jours d'une maladie dans lesquels les crises se font, sont appelés critiques, et tous les autres se nomment non-critiques. Ceux-ci peuvent pourtant devenir critiques quelquefois, comme Galien en convient lui-même ; mais cet événement est contraire aux règles que la nature suit ordinairement. De ces jours critiques il y en a qui jugent parfaitement et favorablement, et qui sont nommés principaux ou radicaux par les Arabes, ou bien simplement critiques ; tels sont le septième, le quatorzième, le vingtième. Il en est d'autres qui ont été regardés comme tenant le second rang parmi les jours heureux ; ce sont le neuvième, le onzième et le dix-septième : le troisième, le quatrième et le cinquième jugent moins parfaitement : le sixième juge fort souvent, mais il juge mal et imparfaitement ; c'est pourquoi il a été regardé comme un tyran ; au lieu que le septième, qui juge pleinement et favorablement, a été comparé à un bon roi. Le huitième et le dixième jugent mal aussi, mais ils jugent rarement. Enfin le douzième, le seizième et le dix-huitième ne jugent presque jamais.
(Nota. Tout lecteur entendra parfaitement le sens de ce mot juger que nous venons d'employer, et qui est technique, s'il veut bien se rappeler la signification propre du mot crise, que nous avons expliquée au commencement de cet article.)
On voit par ce précis quels sont les bons et les mauvais jours dans une maladie aiguë ; les éminemment bons sont le septième, le quatorzième et le vingtième. Galien dit avoir remarqué dans un seul été plus de quatre cent maladies parfaitement jugées au septième ; et quoiqu'on trouve dans les épidémies d'Hippocrate des exemples de gens morts au septième, ce n'est que par un accident rare, et dû à la force de leur tempérament, qui a fait que leur maladie s'est prolongée jusqu'à ce terme, qu'elle ne devait pas atteindre dans le cours ordinaire. C'est toujours Galien qui parle, et qui veut sauver son septième jour, qu'il a comparé à un bon prince qui pardonne à ses sujets ou qui les retire du danger, comme nous l'avons déjà observé. Le quatorzième est le second dans l'ordre des jours salutaires ; il est heureux, et juge très-souvent : il supplée au septième, il a même mérité de lui être préféré par quelques anciens. Quant au vingtième, il est aussi vraiment critique et salutaire ; mais il n'est pas en possession paisible de ses droits ; Archigène, dont nous parlerons dans la suite de cet article, lui a préféré le vingt-unième.
Tous les jours, excepté les trois dont nous venons de parler, sont plus ou moins dangereux et mauvais ; ils jugent quelquefois, comme nous venons de le dire, mais ils ne valent pas les premiers, en tant que critiques ; ils ne sont pas même précisément regardés comme tels : c'est pourquoi on leur a donné des dénominations particulières, et on les a distinguées en indices, en intercalaires, et en vides.
Les jours indices, ou indicateurs, qui forment le premier ordre après les trois critiques, et qu'on appelle aussi contemplatifs, sont ceux qui indiquent ou qui annoncent que la crise sera parfaite, et qu'elle se fera dans un des jours radicaux : de cet ordre sont le quatrième, le onzième et le dix-septième. Le quatrième qui est le premier des indices, comme le septième est le premier des critiques, annonce ce septième, qui n'est jamais aussi parfait qu'il doit l'être, s'il n'est indiqué ou annoncé. Ceux qui doivent être jugés au septième, ont une hypostase blanche dans l'urine au quatrième, dit Hippocrate dans ses Aphorismes. Ainsi le quatrième est, par sa nature, indice du septième, suivant Galien, pourvu qu'il n'arrive rien d'extraordinaire ; car il peut se faire non-seulement qu'il soit critique lui-même (comme nous l'avons remarqué ci-dessus, et comme il est rapporté dans les épidémies d'Hippocrate, de Périclès qui guérit par une sueur abondante au quatrieme), mais encore qu'il n'indique rien, soit par la nature de la maladie, lorsqu'elle est très-aiguè, soit par les mauvaises manœuvres du médecin, ou par quelqu'autre cause à laquelle il ne faut pas s'attendre ordinairement. Enfin le quatrième indique quelquefois que la mort peut arriver avant le septième ; et c'est ce qu'il faut craindre, lorsque les changements qu'il excite passent les bornes ordinaires. Le onzième est indice du quatorzième ; il est moins régulier, moins exact que le quatrième, &, comme lui, il devient quelquefois critique, et même plus souvent : car Galien a observé que tous ses malades furent jugés au onzième dans une certaine automne. Le dix-septième est indice du vingtième ; mais il perd apparemment cette prérogative pour la céder au dix-huitième, si le vingtième cesse d'être critique, ainsi que nous avons dit qu'Archigène l'a prétendu.
Les jours qu'on nomme intercalaires ou provocateurs, sont le troisième, le cinquième, le neuvième, le treizième et le dix-neuvième ; ils sont comme les lieutenans des critiques, mais ils ne les valent jamais : s'ils font la crise, on doit craindre une rechute ; Hippocrate l'a dit nommément du cinquième, qui fut mortel à quelques malades des épidémies. Le neuvième se trouvant entre le septième et le quatorzième, peut être quelquefois heureux ; Galien le place entre les critiques du second ordre, et cela parce qu'il répare la crise du septième, ou qu'il avance celle du quatorzième. Le treizième et le dix-neuvième sont très-foibles, le dernier plus encore que le premier.
Les jours vides, qu'on nomme ainsi parce qu'ils ne jugent pour l'ordinaire que malheureusement, parce qu'ils n'indiquent rien, et qu'ils ne sauraient suppléer aux critiques, sont le sixième, le huitième, le dixième, le douzième, le seizième, le dix-huitième, etc. Galien n'épargne pas sa rhétorique contre le sixième ; il fait contre ce jour une déclamation véhémente : d'abord il le compare à un tyran, comme nous l'avons déjà rapporté ; et après lui avoir dit cette injure, il descend de la sublimité du trope, pour l'accuser au propre de causer des hémorrhagies mortelles, des jaunisses funestes, des parotides malignes, ce en quoi Actuarius n'a pas manqué de le copier. Le huitième est moins pernicieux que le sixième, mais il n'en approche que trop, ainsi que le dixième. Le douzième est, si on peut s'exprimer ainsi, un jour inutîle ; il n'est bon qu'à être compté, non plus que le seizième et le dix-huitième.
Tous les jours, excepté le redoutable sixième, sont, comme on voit, de peu de conséquence, relativement à la figure qu'ils font dans la marche de la nature, mais ils sont par cela même très-précieux aux médecins, auxquels ils présentent le temps favorable pour placer leurs remèdes : aussi ces jours-là ont-ils été appelés médicinaux ; ce sont pour ainsi dire les jours de l'Art, qui n'a presqu'aucun droit sur tous les autres, puisqu'il ne lui est jamais permis de déranger la nature, qui partage son travail entre les jours critiques et indicateurs, et qui se repose ou prend haleine les jours vides.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des maladies qui ne passent pas le vingtième jour ; mais il y en a qui vont jusqu'au quarantième, et qui ont aussi dans la partie de leur cours, qui s'étend au-delà du vingtième, leurs crises et leurs jours critiques : de ce nombre sont le vingt-septième, le trente-quatrième, et le quarantième lui-même. On compte ceux-ci de sept en sept, au lieu que depuis le premier jour jusqu'au vingtième, on les compte non-seulement par sept ou par septenaires, mais encore par quatre ou par quartenaires. Le septième, le quatorzième, le vingtième ou le vingt-unième, sont les trois septenaires les plus importants ; le quatrième, le huitième, le douzième, le seizième et le vingtième, sont les quartenaires les plus remarquables, et les seuls auxquels on fasse attention. Quelques anciens ont appelé ces derniers jours demi-septenaires ; ils ont aussi divisé les jours en général, en pairs et en impairs. Les uns et les autres avaient plus ou moins de vertu, suivant que les maladies étaient sanguines ou bilieuses, les bilieuses ayant leurs mouvements aux jours impairs, et les sanguines aux jours pairs.
Il parait que c'est à ce précis qu'on peut le plus raisonnablement réduire tout ce que les anciens nous ont laissé au sujet de la différence des jours ; il serait fort inutîle de relever les contradictions dans lesquelles ils sont tombés quelquefois, et de les suivre dans toutes les tournures qu'ils ont tâché de donner à leur système. Nous ne nous attacherons ici qu'à parler de quelques-uns de leurs principaux embarras, et ces considérations pourront devenir intéressantes pour l'histoire des maladies.
Les anciens ne sont pas d'accord sur la manière dont on doit fixer le jour. Qu'est-ce qu'un jour en Médecine, ou dans une maladie ? Voilà ce que les anciens n'ont pas assez clairement défini. Ils se sont pourtant assez généralement réduits à faire un jour qu'ils appelaient médical ou medicinal, et qui était de vingt-quatre heures, comme le jour naturel. La première heure de ce jour medical était la première heure de la maladie, qui ne commençant pas toujours au commencement d'un jour naturel, pouvait n'être qu'à son second jour, lorsqu'on comptait le troisième jour naturel depuis son commencement, etc.
Mais il ne fut pas aussi aisé de se fixer à l'égard de ce qu'il faut prendre pour le premier jour dans une maladie. En effet, s'il est des cas dans lesquels une maladie s'annonce subitement et évidemment par un frisson bien marqué, il est aussi des maladies où le malade traine deux et trois jours, et quelquefois davantage, sans presque s'en apercevoir. On se bornait, dans ces cas, à compter les jours de la maladie, du moment auquel les fonctions étaient décisivement lésées ; mais ce moment-là même n'est pas toujours aisé à découvrir. La complication des maladies est encore fort embarrassante pour le compte des jours. Par exemple, une femme grosse fait ses couches ayant actuellement la fièvre ; une autre est saisie de la fièvre trois ou quatre jours après ses couches : où faudra-t-il alors prendre le commencement de la maladie ? Hippocrate s'est contredit sur cette matière, et Galien veut qu'on compte toujours du moment de l'accouchement, ce en quoi il a été suivi par Rhazès, Amatus Lusitanus, etc. Il y en a eu qui prétendaient faire marcher les deux maladies à la fais, et les compter chacune à part. D'autres, tels qu'Avicenne, Zacutus Lusitanus, etc. ont distingué l'accouchement contre nature d'avec le naturel, et ils ont pris celui-ci pour un terme fixe, et pour leur point de partance dans le compte des jours, en regardant l'autre comme un symptôme de la maladie. Mais tout cela n'éclaircit pas assez la question, parce que les explications particulières, ne sont souvent que des ressources que chacun se ménage pour éluder les difficultés. L'histoire des rechutes, et celle des fièvres aiguës entées sur des maladies habituelles ou chroniques, embrouillent encore davantage le compte des jours ; et ce qu'il y a de plus fâcheux pour ce système, c'est qu'une crise durant quelquefois trois et quatre jours, on ne sait à quel jour on doit la placer. Il faut l'avouer, toutes ces remarques que les anciens, les plus attachés à la doctrine des crises, avaient faites, et dont ils tâchaient d'éluder la force, rendent leur doctrine obscure, vague, et sujette à des mécomptes qui pourraient être de conséquence, et qui n'ont pas peu contribué à décrier les crises et les jours critiques. Il y a plus, c'est que Galien lui-même est forcé de convenir (ch. VIe des jours critiques) qu'on ne saurait dissimuler, si on est de bonne foi, que la doctrine d'Hippocrate sur les jours critiques ne soit très-souvent sujette à erreur. Si cela est, si on risque de se tromper très-souvent, à quoi bon s'y exposer en admettant des dogmes incertains ? D'ailleurs on trouve des contradictions dans les livres d'Hippocrate, au sujet des jours critiques. (Ces contradictions ont été vivement relevées par Marsilius Cagnatus.) Ce qu'Hippocrate remarque dans ses épidémies, n'est pas toujours conforme à ses pronostics et à ses aphorismes. Galien a senti de quelle conséquence étaient ces contradictions ; il tâche d'éluder l'argument qu'on peut en tirer contre son opinion favorite, en disant que les livres des épidémies étaient informes, et destinés seulement à l'usage particulier d'Hippocrate. Dulaurents Ve plus loin, et il veut faire croire qu'Hippocrate n'avait pas encore acquis, lorsqu'il composait ses livres des épidémies, une connaissance complete des jours critiques. Mais à quoi servent ces subterfuges ? Tout ce qu'on peut supposer de plus raisonnable en faveur d'Hippocrate, s'il est l'auteur de ces ouvrages dans lesquels on trouve des contradictions, c'est que ces contradictions sont dans la nature, et qu'il a, dans toutes les occasions, peint la nature telle qu'elle s'est présentée à lui ; mais il a toujours eu tort de se presser d'établir des règles générales : ses épidémies doivent justifier ses aphorismes, sans quoi ceux-ci manquant de preuves, ils peuvent être regardés comme des assertions sur lesquelles il ne faut pas compter.
D'ailleurs, Dioclès et Archigène dont nous avons déjà parlé, ne comptaient point les jours comme Hippocrate et Galien ; ils prétendaient que le 21 devait être mis à la place du 20, d'où il s'ensuivait que le 18 devenait jour indicatif, et que le 25, le 28, le 32, et les autres dans cet ordre, étaient critiques. Dioclès et Archigène avaient leurs partisans ; Celse, s'il faut compter son suffrage sur cette matière, donne même la préférence au 21 sur le 20. On en appelait de part et d'autre à l'expérience et à l'observation ; pourquoi nous déterminerions-nous pour un des partis plutôt que pour l'autre, n'ayant d'autre motif que le témoignage ou l'autorité des parties intéressées elles-mêmes.
Nous l'avons déjà dit, les anciens sentaient la force de ces difficultés, ils se les faisaient à eux-mêmes, et malgré cela la doctrine des jours critiques leur paraissait si essentielle, qu'ils n'osaient se résoudre à l'abandonner : ceux qui se donnaient cette sorte de liberté, tels qu'un des Asclépiades, étaient regardés par tous leurs confrères comme très-peu médecins, ou comme téméraires. Cependant Celse loue Asclépiade de cette entreprise, et donne une très-bonne raison du zèle des anciens pour les jours critiques : c'est, dit-il en parlant des premiers médecins qu'il nomme antiquissimi, qu'ils ont été trompés par les dogmes des Pythagoriciens.
Il y a apparence que ces dogmes devinrent à la mode, qu'ils pénétrèrent jusqu'au sanctuaire des sectes des médecins. Ceux-ci furent aussi surpris de découvrir quelques rapports entre les opinions des philosophes et leurs expériences, que charmés de se donner l'air savant : en un mot, ils payèrent le tribut aux systèmes dominans de leur siècle ; ce qui est arrivé tant de fois depuis, et ce que nous conclurons surtout d'un passage d'Hippocrate que voici.
Il recommande à son fils Thessalus de s'attacher exactement à l'étude de la science des nombres ; parce que la connaissance des nombres suffit pour lui enseigner, et le circuit ou la marche des fièvres, et leur transmutation, et les crises des maladies, et leur danger ou leur sûreté. C'est évidemment le Pythagoricien qui donne un pareil conseil, et non le médecin. Il n'en faut pas davantage pour prouver, qu'avec de pareilles dispositions, Hippocrate était très-porté à tâcher de plier l'observation à la théorie des nombres. L'esprit de système perce ici manifestement ; on ne peut le méconnaître dans ce passage, qui découvre admirablement les motifs d'Hippocrate dans toutes les peines qu'il s'est donné pour arranger méthodiquement les jours critiques. C'est ainsi que par des traits qui ont échappé à un fameux moderne, on découvre facilement sa manière de philosopher en Médecine. Voici un de ces traits, qui paraitra bien singulier, sans-doute, à quiconque n'aura pas donné dans les illusions de la médecine rationnelle. Après avoir donné pour la cause des fièvres intermittentes la viscosité des humeurs, l'auteur dont nous parlons avance, qu'il est plus difficîle de distinguer la vraie cause des fièvres, que d'en imaginer une au moyen de laquelle on puisse tout expliquer ; et tout de suite il procede à la création de cette cause, il raisonne, et il propose des vues curatives d'après sa chimère, etc.
Quant à Galien, qui aurait dû être moins attaché qu'Hippocrate à la doctrine des nombres, qui avait déjà vieilli de son temps, on peut le regarder comme un commentateur et comme un copiste d'Hippocrate : d'ailleurs, son opinion sur l'action de la lune, dont nous parlerons plus bas, et plus que tout cela, son imagination vive, son génie incapable de supporter le doute, dubii impatiens, ont dû le faire échouer contre le même écueil.
Cependant il faut convenir que Galien montre de la sagesse et de la retenue dans l'examen de la question des jours critiques ; car outre ce que nous avons déjà rapporté de la bonne-foi avec laquelle il avouait, que cette doctrine pouvait souvent induire en erreur, il parait avoir des égards singuliers pour les lumières et les connaissances d'Archigène, et des autres médecins qui n'étaient pas de son avis. Galien fait d'ailleurs un aveu fort remarquable au sujet de ce qu'il a écrit sur la vertu ou l'efficacité des jours : Ce que j'ai dit sur cette matière, je l'ai dit comme malgré moi, et pour me prêter aux vives instances de quelques-uns de mes amis : ô dieux ! vous savez ce qui en est ; je vous fais les témoins de ma sincérité. Vos, ô dii immortales, novistis ! vos in testimonium voco. On ne saurait ce semble soupçonner que Galien ait voulu tromper ses lecteurs et ses dieux sur une pareille matière ; et cette espèce de serment indique qu'il n'était pas tout à fait content de ses idées : eut-il pensé qu'elles devaient passer pour des lois sacrées pendant plusieurs siècles, et qu'en se prêtant aux instances de ses amis intéressés à le voir briller, il deviendrait le tyran de la Médecine ?
C'est donc sur la prétendue efficacité intrinseque des jours et des nombres, qu'étaient fondés les dogmes des jours critiques : c'est de leur force naturelle que les Pythagoriciens tiraient leurs arcanes, et ces arcanes étaient sacrés pour tout ce qui s'appelait philosophe. On ne peut voir sans étonnement toutes leurs prétentions à cet égard, et surtout l'amas singulier de conformités ou d'analogies qu'ils avaient recueillies pour prouver cette prétendue force : par exemple, celle du septième jour ou du nombre septenaire, au sujet duquel, dit Dulaurents, les Egyptiens, les Chaldéens, les Grecs, et les Arabes, ont laissé beaucoup de choses par écrit. Le nombre septenaire, dit Renaudot, médecin de la faculté de Paris, est tant estimé des Platoniciens, pour être composé du premier nombre impair, et du premier tout pair ou carré, qui sont le 3 et le 4 qu'ils appellent mâle et femelle, et dont ils font un tel cas qu'ils en fabriquent l'âme du monde ; et c'est par leur moyen que tout subsiste : la conception de l'enfant se fait au septième jour ; la naissance au septième mois. Tant d'autres accidents arrivent aux septenaires : les dents poussent à sept mois ; l'enfant se soutient à deux fois sept ; il délie sa langue à trois fois sept ; il marche fermement à quatre fois sept ; à sept ans les dents de lait sont chassées ; à deux fois sept il est pubere ; à trois fois sept il cesse de croitre, mais il devient plus vigoureux jusqu'à sept fais.... le nombre sept est donc un nombre plein, appelé des Grecs d'un nom qui veut dire vénérable. Hoffman n'a pas manqué de répéter toutes ces belles remarques, dans sa dissertation de fato physico et medico.
Voilà la première cause de tous les calculs des médecins, voilà l'idole à laquelle ils sacrifiaient leurs propres observations, qu'ils retournaient toujours jusqu'à ce qu'elles fussent conformes à leur opinion maîtresse ou fondamentale ; trop semblables dans cette sorte de fanatisme à la plupart des modernes, dont les uns ont tout rappelé à la matière subtile, les autres à l'attraction, à l'action des esprits animaux, à l'inflammation, aux acrimonies, et à tant d'autres dogmes, qui n'ont peut-être d'autre avantage sur la doctrine des nombres, que celui d'être nés plutard, et d'être par-là plus conformes à notre manière de penser.
Cette doctrine des nombres vieillissait du temps de Galien, nous l'avons déjà dit ; elle s'usait elle-même peu-à-peu ; l'opinion des jours critiques s'affoiblissait à proportion : la théorie hardie et sublime d'Asclépiade, fort opposée au génie calculateur ou numérique des anciens, si on peut ainsi parler, aurait infailliblement pris le dessus, si Galien lui-même n'avait ménagé une ressource aux sectateurs des crises. C'est à l'influence de la lune, dont les anciens avaient aussi parlé avant lui, qu'il eut recours pour les expliquer : il porta les choses jusqu'à imaginer un mois medical ou medicinal, au moyen duquel les révolutions de la lune s'accordant avec celles des crises, celles-ci lui paraissaient dépendre des phases de la lune.
Les Arabes ne changèrent presque rien à la doctrine des crises et des jours critiques ; ils la supposaient irrévocable et connue, et ils eurent occasion de l'appliquer à la petite-vérole, à laquelle elle ne Ve pas mal : ils étaient trop décidés en faveur de Galien, d'Aetius et d'Oribase, pour former quelque doute sur leur système. Hali-Abbas regardait le 20 et le 21 comme des jours critiques ; il semble qu'il voulut concilier Galien et Archigène.
L'Astrologie étant devenue fort à la mode dans le temps du renouvellement des Sciences, elle se glissa bien-tôt dans la théorie medicinale : il y eut quelques médecins qui osèrent traiter le mois medical de Galien de monstrueux et d'imaginaire. Mais le commun des praticiens ne renonça pas pour cela à l'influence de la lune sur les crises et les jours critiques ; on ne manquait jamais de consulter les astres avant d'aller voir un malade. J'ai connu un médecin mathématicien qui, ayant été mandé pour un malade qui avait la salivation à la suite des frictions mercurielles, ne voulut partir qu'après avoir calculé si la chose était possible, Ve la dose de minéral employée. Ce mathématicien eut été surement astrologue il y a deux siècles.
La lune, disaient les Astrologues, a autant d'influence sur les maladies, que sur la plupart des changements qui arrivent dans notre globe ; c'est d'elle que dépendent les variations des maladies, et la vertu ou l'action des jours critiques. Un calcul bien simple le prouve : si quelqu'un tombe malade le jour de la nouvelle lune, il se trouvera qu'au 7 la lune sera au premier quartier, qu'on aura pleine lune au 14, et qu'au troisième septenaire elle sera dans son dernier quartier. D'où il parait qu'il y a un rapport évident entre les jours critiques, le 7, le 14, et le 21, et les phases de la lune, sans compter ses rapports avec les jours indices. Aussi toutes les maladies qui se trouveront suivre exactement les changements de la lune, et commencer avec la nouvelle lune, auront-elles des crises complete s et parfaites.
Mais comme il y a beaucoup de maladies qui ne commencent pas à la nouvelle lune, les révolutions de chaque quartier ne sauraient avoir lieu dans ces cas ; cependant il y aura toujours dans les mouvements de la lune des révolutions notables, qui répondront au 7, au 14 et au 21, et au 4, au 11 et au 17, ainsi que peut le découvrir tout lecteur assez patient et assez curieux de calculs.
Parmi les médecins qui ont déduit la marche des crises de cette cause, il y en avait qui ne trouvant pas bien leur compte avec la lune seule, avaient recours à tous les astres, au signe du zodiaque et aux planètes, qui présidaient chacune à des maladies particulières.
Le dirai-je ? Cette action de la lune à laquelle Vanhelmont même n'a osé se dispenser de soumettre son grand archée, et en général les influences des astres sur les corps sublunaires, pourraient peut-être être expliquées assez physiquement, ainsi que M. Richard Mead a commencé de le faire parmi les modernes, ou au moins être reçues comme phénomènes existants dans la nature, quoique non compris. Ce n'est pas qu'il faille ajouter foi aux ridicules et puériles calculs des anciens : mais on ne peut, lorsqu'on examine les choses de bien près, s'empêcher de se rendre à certains faits généraux, qui méritent au moins qu'on les examine et qu'on doute. On trouve tous les jours tant de gens de bon sens qui assurent avoir des preuves de l'action de la lune sur les plantes, et sur des maladies mêmes, telles que la goutte et les rhumatismes, qu'on ne saurait se déterminer, ce me semble, sans témérité à regarder ces sortes d'assertions comme destituées de tout fondement, quelques folles applications que le peuple en fasse. Car de quelle vérité n'abuse-t-on point en Physique ? Il en est comme des effets ou de l'influence de l'imagination des femmes grosses sur leurs enfants ; le peuple les admet ; les Philosophes, ceux surtout qui ont une antipathie marquée pour toutes les idées populaires, qui ne sont que les restes des opinions de l'antiquité, ces philosophes rejettent l'influence de l'imagination des femmes grosses sur leurs enfants ; mais il parait malheureusement que c'est parce qu'ils n'en savent point la cause. N'est-ce pas pour la même raison, à-peu-près, qu'on rejette l'action ou l'influence de la lune et des autres astres sur nos corps ? Après tout, pourquoi prendre sans hésiter un ton si décisif contre des choses que les anciens les plus respectables ont admis, jusqu'à ce qu'on ait démontré par des faits constatés, qu'ils se sont trompés autant dans leurs observations, que dans les applications qu'ils en ont faites ? On a laissé présider la lune au flux et reflux de la mer ; comment peut-on assurer après cela que la lune occasionnant des révolutions si singulières sur la mer, et plus que probablement sur l'air, ne produise pas quelque effet sur nos humeurs ? Pourquoi notre frêle machine sera-t-elle à l'abri de l'action de cette planète ? n'est-elle ni compressible ni attirable en tout ou en partie ? la sensibilité animale n'est-elle pas même une propriété qui expose plus qu'aucune autre, cette machine dont nous parlons, à un agent qui cause tant de révolutions dans l'atmosphère ?
Quoiqu'il en sait, Fracastor qui vivait au XVe siècle, fut un des plus redoutables ennemis du système dominant au sujet de l'action de la lune sur les jours critiques et les crises ; il était d'autant plus intéressé à la destruction de ce système, qu'il en substituait un autre fort ingénieux ; le désir de faire recevoir ses propres idées, a fait faire à plus d'un philosophe des efforts efficaces contre les opinions reçues avant lui, On aura peut-être besoin de l'hypothèse de Fracastor, lorsqu'on viendra à discuter la question des crises et des jours critiques, comme elle mérite de l'être ; c'est ce qui nous engage à en donner ici un court extrait.
Fracastor par des principes reçus chez tous les Galénistes au sujet des humeurs, la pituite, la bile, et la mélancholie, qui ont, disaient-ils, différents mouvements, qui occasionnent chacune leurs maladies particulières, leurs fièvres, leurs tumeurs, etc. c'était débuter d'une manière bien séduisante pour des gens qui croyaient à ces humeurs ; la mélancholie, ajoute-t-il, qui se meut de quatre en quatre jours, fait que tous les quartenaires sont critiques. En effet, il est vraisemblable que toutes les humeurs pechent plus ou moins dans la plupart des maladies ; ces humeurs peccantes sont celles dont la nature tâche de se défaire ; elle ne le peut si ces humeurs ne sont préparées, la coction devant toujours précéder une bonne crise : or la coction de la mélancholie ayant besoin de quatre jours pour être parfaite, puisque la coction doit suivre les mouvements des humeurs, il suit de-là que la crise se fera de quatre en quatre jours, c'est-à-dire dans le temps du mouvement de la mélancholie, qui étant la plus épaisse et la plus lourde des humeurs, doit pour ainsi dire entraîner toutes les autres lorsqu'elle se meut, et causer une secousse qui fait la crise.
Mais l'humeur mélancholique ne se trouve pas toujours en même quantité, et les autres sont plus ou moins abondantes qu'elle. Ces différences font qu'elle se meut plus ou moins évidemment ou plus ou moins vite, et qu'elle parait suivre quelquefois le mouvement des autres humeurs ; et c'est de-là que dépendent les différentes maladies, et leurs différentes coctions ou crises : par exemple, les maladies aiguës etant occasionnées par une matière extrêmement chaude, autre que la mélancholie, leur mouvement commence dès le premier jour ; au lieu que les humeurs étant lentes et tenaces dans les maladies longues, rien ne force la mélancholie à se mouvoir avant le quatrième jour ; et elle se meut au deuxième dans les maladies médiocres, Ve le degré d'activité de la matière qui la détermine. Si donc la mélancholie se meut dès le premier jour, les crises seront au quatrième jour, au septième, au dixième, au treizième, suivant le plus ou le moins de division des humeurs : si la mélancholie ne se meut qu'au deuxième jour, alors les mouvements critiques se manifesteront au cinquième, au huitième, au onzième, au quatorzième, au dix-septième, au vingtième : et enfin si la mélancholie ne se meut qu'au troisième jour, alors le sixième, le neuvième, la douzième, le quinzième, le dix-huitième, le vingt-unième le vingt-quatrième, le vingt-septième, et le trentième, seront les jours critiques, qui sont de trois ordres ou de trois espèces dans l'opinion de Fracastor.
On voit que ce système dérange les calculs des anciens ; c'est-là aussi ce qu'on lui a opposé de plus fort ; et la plupart des médecins qui ont succédé à Fracastor, s'en sont tenus à admettre les jours critiques à la façon de Galien, en donnant cependant pour causes des crises et des jours critiques la diversité des humeurs à cuire, la différence des tempéraments, et même l'action de la lune, à laquelle on attribuait plus ou moins de vertu : ils ont établi une de ces opinions mixtes qui sont intermédiaires entre les systèmes, ou qui sont des espèces de recueils ; ressource ordinaire des compilateurs. Prosper Alpin, qu'on doit mettre dans cette classe, mérite d'être consulté, tant par rapport à ses observations précieuses, que par rapport à ses mouvements combinés de l'atrabîle et de la bile, etc.
On trouvera tous les auteurs Galénistes qui ont travaillé depuis Fracastor, occupés des mêmes questions, et suivants à-peu-près le même plan, c'est-à-dire ce que leurs prédécesseurs leur avaient appris. Dulaurents chancelier de la faculté de Montpellier, et premier médecin d'Henri IV. a été un de ceux qui ont donné un traité des plus complets et des mieux faits sur les crises : il y a dans ce traité des idées particulières à l'auteur, qui méritent beaucoup d'attention ; et son exactitude a fait que plusieurs médecins qui ont travaillé depuis lui, se sont contentés de le copier : tel est entr'autres, pour le dire ici en passant, le fameux Sennert : ceux qui ont dit de ce dernier que Rivière, un des plus grands médecins de son siècle, l'avait copié et abrégé, auraient pu ajouter que le médecin français n'a fait que reprendre au sujet des crises, ce que Sennert a pris dans Dulaurents, et que pour le reste Rivière et Sennert ont puisé dans les mêmes sources, et n'ont fait que suivre leurs prédécesseurs dans la plupart des questions ; en cela fort ressemblans à bien des modernes, qui se sont copiés les uns les autres, depuis Harvée, Vieussens, et Baglivi, jusqu'à nos jours.
Les Chimistes ayant foudroyé le Galénisme, et la plupart des opinions répandues dans les écoles, qui avaient à dire vrai, besoin d'une pareille secousse, la doctrine des crises se ressentit de la fougue des réformateurs. Ce fut en vain qu'Arnaud de Villeneuve, qui se montre toujours fort sage dans la pratique, se déclara pour les jours critiques, en avançant qu'on passait les bornes de la Médecine, si on prétend aller plus loin qu'Hippocrate à cet égard. C'est en vain que Paracelse eut recours aux différents sels pour expliquer les crises : Il n'est rien, disait Vanhelmont toujours en colere, de plus impertinent que la comparaison qu'on a fait des crises avec un combat ; un vrai médecin doit nécessairement négliger les crises auxquelles il ne faut point avoir recours, lorsqu'on sait enlever la maladie à propos. A quoi servent tant de pénibles recherches sur les jours critiques ? Le vrai médecin est celui qui sait prévenir ou modérer la malignité des maladies mortelles, et abréger celles qui doivent être longues, en un mot empêcher les crises. J'ai, ajoute-t-il, composé étant jeune cinq livres sur les jours critiques, et je les ai fait bruler depuis. Il y avait déjà longtemps que la doctrine des crises avait été combattue par des clameurs et des bons mots ; on avait traité la médecine des anciens de méditation sur la mort. Ainsi Vanhelmont se servait pour lors des mêmes traits lancés par des esprits non moins ardents que le sien ; et ces répétitions ne paraissent pas devoir faire regretter les livres qu'il a brulés. Il faut pourtant convenir que les expressions ou la contenance de Vanhelmont ne peuvent que frapper tout lecteur impartial ; on est naturellement porté à approuver ou à désirer une médecine héroïque et vigoureuse, qui sut résister efficacement aux maladies et les emporter d'emblée. La doctrine des crises et des jours critiques a un air de lenteur, qui semble devoir ennuyer les moins impatiens, et donner singulièrement à mordre aux Pyrrhoniens.
Les chimistes plus modernes, et moins ennemis des écoles que Vanhelmont, tels que Sylvius-Deleboè, et quelques autres, n'ont pas même daigné parler des crises et des jours critiques, et on les a totalement perdues de vue, ou du moins on n'a fait qu'étendre les railleries de Vanhelmont ; il faut avouer que la brillante théorie des chimistes, leurs spécifiques, et leurs altérants, ne pouvaient guère conduire qu'à cela : enfin les chimistes ont perdu peut-être trop tôt l'empire de la médecine, qu'ils avaient arraché à force ouverte à ceux qui en étaient en possession, et qui avaient fait dans l'art une de ces grandes révolutions dont les avantages et les désavantages sont si confondus, qu'il est bien difficîle de juger quels sont ceux qui l'emportent.
Baglivi parut, il consulta la nature ; il crut la trouver bien peinte dans Hippocrate : Il est inutile, s'écria-t-il, de se moquer des anciens, et de ce qu'ils ont dit des jours critiques ; laissons toutes les injures qu'on leur a dites, venons au fait. La fermentation à laquelle on convient que le mouvement du sang a du rapport, a ses lais, et son temps marqué pour se manifester ; pourquoi les dépurations du sang n'auraient-elles pas les leurs ? On observera les crises évidemment sur les paysans qui n'ont pas recours aux médecins ; et il ne faut pas s'étonner qu'elles ne se fassent point, lorsqu'on les dérange par la multitude des remèdes ; il faut pourtant avouer qu'il y a des maladies malignes dans lesquelles on ne doit pas s'attendre aux coctions et aux crises : d'ailleurs le tempérament du malade, le pays qu'il habite, la constitution de l'année, et la différence des saisons, sont cause que les crises ne se font point dans nos pays, précisément comme en Grèce, en Asie ; ce que Houllier avait déjà avancé avant lui.
La comparaison que Baglivi fait du mouvement des humeurs animales avec la fermentation des liqueurs spiritueuses, mérite une réflexion ; elle est sortie de l'école des chimistes, et il me semble qu'elle prouve qu'il fallait bien que Baglivi fût persuadé de la vérité des crises et des jours critiques. En effet l'attachement que Baglivi avait pour le solidisme, ne permet pas de douter qu'il n'eut fait des efforts pour l'appliquer à la marche des crises. Il nous a fait part ailleurs de ses essais à cet égard ; mais ici il se sert du système des humoristes, soit qu'il voulut les persuader par leur propre système, soit qu'il préférât de bonne grâce la vérité de l'observation à ses explications. Il serait à souhaiter que tous les Médecins imitassent cette candeur ; les exemples de ceux qui ne mettent au jour que les observations qui quadrent bien avec leur système particulier, et qui oublient, ou qui n'aperçoivent peut-être pas, celles qui pourraient le déranger, ne sont que trop communs. Chacun a sa manière de voir les objets, chacun en juge à sa façon ; c'est pourquoi la diversité même des systèmes peut avoir ses usages en Médecine.
Les Médecins plus modernes que Baglivi, ceux de l'école de Montpellier qui ont succédé à Rivière, tels que Barbeïrac qui est un des premiers législateurs parmi les modernes, et qu'un de ses compatriotes, célèbre professeur du dernier siècle, un des Châtelains, regarde (dans des manuscrits qui n'ont point Ve le jour) comme le premier auteur de tout ce que Sidenham a publié de plus précieux, Barbeïrac, et ses autres confrères, qui ont pratiqué et enseigné la Médecine avec beaucoup plus de netteté, de simplicité et de précision que les Chimistes et les Galénistes, ont négligé les crises, et n'en ont presque point parlé ; ils ne les ont, ni adoptées comme les anciens, ni vilipendées comme les Chimistes, auxquels ils n'ont rien reproché à cet égard ; en un mot ces questions sont devenues pour eux comme inutiles, comme non avenues, et comme tenant aux hypothèses des vieilles écoles. La même chose est arrivée à-peu-près aux médecins de l'école de Paris (à moins qu'on ne doive en excepter Hecquet qui a tant varié). Ils ont été longtemps à se concilier sur les systèmes chimiques ; et il y en a eu beaucoup qui ont paru rester attachés à la méthode de Houllier, Duret, Baillou. Ces grands hommes auront assuré à l'école de Paris la prééminence sur toutes les autres de l'Europe, principalement si la doctrine des crises vient à reprendre le dessus, puisqu'ils ont été les restaurateurs des opinions anciennes sur cette matière, et qu'ils ont fondé un système de pratique qui a duré malgré les Chimistes jusqu'aux temps des Chirac et des Silva.
Il y eut dans le dernier siècle, qui est celui dans lequel vivaient les médecins de Montpellier dont je viens de parler, bien de grands hommes dont Hoffman cite quelques-uns dans sa dissertation sur les crises, qui crurent qu'il était inutîle de s'attacher à la doctrine des crises dans nos climats, parce qu'elles ne pouvaient pas se faire comme dans les pays qu'habitaient les anciens médecins. Il ne les taxaient point de superstition ni d'ignorance, ainsi que les chimistes ; ils tâchaient de concilier tous les partis, en donnant quelque chose à chacun d'eux. Ces médecins ne doivent donc pas être regardés comme des ennemis des crises, et ils diffèrent aussi de ceux de Montpellier dont il a été question ci-dessus, et qui gardaient un profond silence au sujet des crises.
On peut placer Sidenham au nombre de ces médecins, c'est-à-dire de ceux que j'appelle de Montpellier : tout le monde connait la retenue et la modération de Sidenham, aussi-bien que le penchant qu'il avait pour l'expectation, surtout dans les commencements des épidémies. Je ne parlerai ici que d'une de ses prétentions, que je trouve dans son traitement de la pleurésie : cette prétention mérite quelque consideration ; elle est conçue en ces termes : Mediante venae sectione morbifica materia penes meum est arbitrium : et orificium à phlebotomo incisum tracheae vices subire cogitur ; " je peux à mon gré tirer par la saignée toute la matière morbifique qui aurait dû être emportée par les crachats ". Ce n'est point ici le lieu d'examiner si cette proposition est bien ou mal fondée ; il suffit de remarquer qu'elle parait directement opposée à la méthode des anciens, ou à leur attention à ne pas troubler la nature. C'est une assertion hardie, qui appuie singulièrement la vivacité et l'activité des Chimistes, et de tous les ennemis des crises, et des jours critiques : car enfin quelqu'un qui se flatte de maitriser la nature comme Sidenham, et de lui dérober la matière des excrétions, peut-il être regardé comme son ministre, dans le sens que les anciens donnaient à cette dénomination ? Joignez à cette réflexion les louanges que Harris donne à Sidenham, pour avoir osé purger dans tous les temps de la fièvre, sans compter la manière dont celui-ci s'efforçait de diminuer la force de la fièvre par l'usage des rafraichissants dans la petite vérole, et vous serez obligé de convenir que la pratique de Sidenham pourrait bien n'avoir pas été conforme au ton de douceur qu'il avait su prendre, ni à la définition qu'il donnait lui-même de la maladie, qu'il regardait comme un effort utîle et nécessaire de la nature. C'est où j'en voulais venir, et je conclus de-là, qu'il ne faut pas toujours juger de la pratique journalière d'un médecin, par ce qu'il se vante lui-même de faire ; tel qui se donne pour un athlete prêt à combattre de front une maladie, est souvent très-timide dans le traitement : d'autre côté, il en est qui vantent leur prudence, leur attention à ne pas déranger la nature, et qui sont souvent ses ennemis les plus décidés. Serait-ce que dans la Médecine comme ailleurs, les hommes ont de la peine à se guider par leurs propres principes ? J'insisterais moins sur cette matière, si je n'avais connu des médecins qui se trompent, pour ainsi dire, eux-mêmes, et qui pourraient induire à erreur, les gens qui voudraient les croire sur ce qu'ils disent de leur méthode. C'est en les voyant agir vis-à-vis des malades, qu'on apprend à les bien connaître : c'est alors que le masque tombe.
Stahl et toute son école ont eu un penchant très-décidé pour les crises et pour les jours critiques ; leur autocratie les conduisait à imiter la lenteur et la méthode des anciens, plutôt que la vivacité des Chimistes ; l'expectation devint un mot pour ainsi dire sacré dans cette secte, d'autant plus qu'il lui attira comme on sait, de piquantes railleries de la part d'un Harvée, fameux satyrique en Médecine. Nenter, Stahlien déclaré, a donné l'histoire et les divisions des jours critiques à la façon des anciens. En un mot il est à présumer, par tout ce qu'on trouve à ce sujet dans les ouvrages de Stahl et dans ceux de ses disciples, qu'ils auraient très-volontiers suivi et attendu les crises et les jours critiques, s'ils n'avaient été arrêtés par la difficulté qu'il y avait de livrer l'ordre, la marche, et les changements des redoublements à l'âme, à laquelle ils n'avaient déjà donné que trop d'occupation. Comment oser dire en effet que l'âme choisit les septenaires pour redoubler ses forces contre la matière morbifique, et qu'elle se détermine de propos délibéré à annoncer ces septenaires par des revolutions qu'elle excite aux quartenaires ? A dire vrai, ces prétentions auraient pu ne pas réussir ; il valut mieux biaiser un peu sur ces matières, et rester dans une sorte d'indécision. Nichols a pourtant franchi le pas ; mais disons-le puisque l'occasion s'en présente : il serait à souhaiter pour la mémoire de Stahl, qu'il se fût moins avancé au sujet de l'âme, ou qu'il eut trouvé des disciples moins dociles à cet égard ; c'est-là, il faut l'avouer, une tache dont le Stahlianisme se lavera difficilement. On pourrait peut-être le prendre sur le pied d'une sorte de retranchement, que Stahl s'était ménagé pour fuir les hypothèses, les explications physiques, et les calculs : mais cette ressource sera toujours regardée comme le rêve de Stahl ; rêve d'un des plus grands génies qu'ait eu la Médecine, il est vrai, mais d'autant plus à craindre, qu'il peut jeter les esprits médiocres dans un labyrinthe de recherches et d'idées purement métaphysiques.
L'école de Montpellier aurait été infailliblement entrainée dans cet écueil, sans la prudence des vrais médecins qui la composaient ; et sans la sagesse de celui-là même qui y soutint le premier le Stahlianisme publiquement, et qui apprend aujourd'hui à ses disciples à s'arrêter au point qu'il faut.
Hoffman avance dans la dissertation dont j'ai parlé ci-dessus, et que M. James a traduite comme tant d'autres du même auteur, qu'il se fait des crises dans les maladies chroniques ; telles que l'épilepsie, les douleurs, et les fièvres intermittentes, ainsi que dans les maladies aiguës. Il répète en un mot ce que bien des auteurs ont dit avant lui ; il a recours, pour ce qui concerne les révolutions septenaires, à la volonté du Créateur, ce que quelques-uns de ses prédécesseurs n'avaient pas manqué de faire : il ajoute qu'il est impossible que les parties nerveuses ne soient irritées par la matière morbifique, et par les stases des humeurs, et qu'il arrive par-là de certains mouvements en de certains temps, certi motus, certis temporibus, et il appelle cela, pour le dire en passant, reddere rationem crisium, expliquer la manière dont se font les crises. Il donne à son ordinaire un coup de dent à Stahl sur le principe interne, directeur de la vie ; il cite Baglivi ; il parle des crises dans la petite vérole et la rougeole. Il avoue qu'il y a des fièvres malignes, dans lesquelles on ne saurait remarquer l'ordre des jours. Il dit enfin qu'il ne faut pas déranger les crises, dans lesquelles il a observé à-peu-près la marche que les anciens leur ont fixée ; en un mot Hoffman se décide formellement en faveur des crises ; cependant il semble laisser son lecteur dans une incertitude d'autant plus grande, que lorsqu'il parle du traitement des maladies, telle que l'angine, la fièvre sinoche, etc. il n'observe pas les jours critiques, ou du moins il ne s'explique pas là-dessus. On ne sait donc pas bien clairement s'il faut mettre Hoffman au nombre des partisans des crises, c'est-à-dire de ceux qui les attendent dans les maladies, ou avec les praticiens qui les négligent, scientes et volentes : pour me servir d'une expression de Sidenham, et qui se dirigent dans le traitement des maladies, suivant l'exigence des symptômes. La plupart des anciens attendaient les crises, les Chimistes n'en voulaient point entendre parler non plus qu'Asclepiade, qui assurait que non certo aut legitimo tempore morbi solvuntur, ni d'autres qui ont traité les idées des anciens de pures niaiseries ; nugae, comme disait Sinapius. Voilà deux partis bien opposés. Il en est un troisième qui tâche de les concilier. Hoffman est de ce dernier. Les Médecins qui ne parlent des crises, ni en bien, ni en mal, font un quatrième parti peut-être plus sage que tous les autres.
Boerhaave, que nous plaçons ici à côté de Stahl et d'Hoffman, a dit dans ses instituts (§. 931) qu'il arrive ordinairement dans les maladies aiguës humorales et en de certains temps, un changement subit de la maladie, suivi de la santé ou de la mort, changement qu'on nomme crise. Il dit (§. 939) que la crise salutaire, parfaite, évacuante, séparant le sain du malade, separatio morbosi à sano, est celle qui est entr'autres conditions, précédée de la coction ; il appelle coction (§. 927) l'état de la maladie, dans lequel la matière crue (c'est-à-dire celle qui est (§. 922) disposée à causer ou à augmenter la maladie), est changée de façon qu'elle soit peu éloignée de l'état de santé et par conséquent moins nuisible, et appelée alors cuite. Il appelle coction parfaite (§. 945) celle par laquelle, coctio quâ, la matière crue est parfaitement et très-vite, perfectissimè et citissimè, rendue semblable à l'humeur naturelle ; matière résolue (§. 930) resoluta, celle qui est devenue très-semblable à la matière saine, salubri ; et résolution, l'action par laquelle cela arrive, action qui sera la guérison parfaite, qui se fait sans aucune évacuation.
D'où il parait 1°. que par les propres paroles de Boerhaave, la résolution et la coction parfaite sont la même chose, puisqu'elles ne sont l'une et l'autre que l'action par laquelle la matière morbifique est rendue semblable à l'humeur naturelle ou saine, naturali, salubri ; ce qui est bien, à peu de chose près, l'idée de Sidenham, mais ce qui est fort éloigné de celle que les anciens ont eu de la coction : car ils ont dit que les humeurs étaient cuites, lorsqu'elles sont propres à l'excrétion ; ils prétendaient que toute coction se fait en épaississant ; Hippocrate a dit en termes exprès (Aph. XVIe sect. 2. prognost.), qu'il faut que tout excrément s'épaississe lorsque la maladie approche du jugement : or ni l'épaississement ni la disposition à l'excrétion ne conviennent à la matière de la résolution lorsqu'elle est résolue, resoluta, surtout si, comme le veut Boerhaave, elle est alors devenue très-semblable à la matière saine.
2°. Il suit de ce qu'avance Boerhaave, que la résolution guérissant parfaitement une maladie sans aucune évacuation, la coction parfaite qui lui est analogue, pourrait aussi n'être point suivie d'évacuation ; ce qui est encore fort éloigné des dogmes des anciens, et d'Hippocrate lui-même, qui prétend que, pour qu'une coction soit parfaite, elle doit être continue et universelle ; continue, en ce qu'elle doit toujours charger les urines de sédiment blanc, uni, et égal ; et universelle, en ce qu'elle doit se montrer dans tous les excréments, en un mot les anciens n'ont jamais jugé de la coction que par la nature des évacuations, et une coction de la matière morbifique sans évacuation, ou sans metastase, aurait été pour eux un être imaginaire ; car leur solution supposait des évacuations.
3°. Boerhaave même parait être de cet avis, lorsqu'il avance que la crise parfaite, separatio morbosi à sano, crisis evacuans, doit toujours être précédée de la coction ; preuve que ce qui est cuit n'est point simîle salubri, crisis debet sequi coctionem ut bona esse possit (§. 941. Haller, comment.) ; mais cette coction qui doit précéder la crise, selon Boerhaave, ne doit pas être parfaite, car celle-ci ou la coction parfaite est, par la définition qu'il en donne lui-même, celle par laquelle la matière crue est rendue parfaitement semblable à l'humeur naturelle ; de sorte que la crise parfaite n'est pas précédée d'une coction parfaite : ce qui est aussi fort éloigné des prétentions des anciens, et ce qui, à dire vrai, n'est pas bien clair.
4°. En supposant avec Boerhaave que la coction simple ou non parfaite ; différente de la coction parfaite (car il faut en faire de deux espèces pour sauver la contradiction) ; en supposant, dis-je, que cette coction est, comme il l'avance (§. 927), l'état dans lequel la matière crue est changée de façon qu'elle soit peu éloignée de l'état de santé, on ne voit guère comment cette coction peut être suivie de la crise ; en effet Boerhaave prétend (§. 932) que la cause du mouvement critique est la vie restante, vita superstes, irritée par la matière morbifique douée de différentes qualités : mais comment la matière cuite, si elle est peu éloignée de l'état de santé, peut-elle irriter la vie et causer une révolution subite ? comment est-elle douée de différentes qualités, praedita variis conditionibus, si elle est peu éloignée de l'état de santé ?
D'ailleurs Boerhaave assure (§. 941) que l'évacuation critique qui arrive à un jour critique, est bonne ; que la doctrine d'Hippocrate (§. 942. Haller, comm.) sur les jours indices, le quatre indice du sept, le cinq du neuf, ne trompe pas lorsqu'on livre la nature à elle-même : haec non fallunt quamdiu naturae morbum committis, neque te immisces curationi ; il ajoute (§. 941. Hall.) que la crise qui se fait en Norvege est différente de celle qui se fait en Grèce, et que celle qui se fait dans une femme diffère de celle qui se fait dans un homme. Il dit (§. 1178), après avoir fait un détail des remèdes, correctifs, des acrimonies, acide, alkaline, muriatique, huileuse, aromatique, bilieuse, exuste, putride, rance, acrimonia, aromatica, exusta, etc. que celui qui entend bien, recte intellexit, tout ce qu'il vient de dire, et qui a lu avec soin les ouvrages d'Hippocrate et les beaux commentaires de Galien, Galeni in illa eruditas curas, connaitra certainement, profecto, les remèdes propres à faire digérer, gouverner la coction et la crise des maladies, ad excitandam, promovendam, gubernandam, absolvendam coctionem et crisim.
Il suit de ces passages et de ceux que nous avons rapporté ci-dessus, ainsi que de plusieurs autres que je passe sous silence, que Boerhaave ne rejetait pas la doctrine des crises, mais qu'il n'était pas bien décidé sur ces matières, ou du moins qu'il est difficîle de pénétrer le plan qu'il s'était formé à cet égard. En effet s'il est vrai que l'évacuation critique, qui arrive à un jour critique, est bonne, il y a donc des jours critiques : mais quels sont-ils ? C'est ce que Boerhaave ne décide point assez précisément. S'il est vrai que la doctrine des jours indices ne trompe point, tandis qu'on livre la maladie à la nature, en quoi cette vérité est-elle utîle à savoir ? et jusqu'à quel point faut-il livrer la nature à elle-même, et ne pas se mêler de la cure, se immiscère curationi ? Voilà un point d'autant plus embarrassant, que Boerhaave lui-même suppose que quelquefois (§. 940) le médecin, non auscultat naturae neque crisim expectat, ne se prete pas aux mouvements de la nature, et n'attend pas la crise. Il est donc des cas où il est permis de s'opposer à la nature, et de ne pas attendre les crises, expectare crisim : mais quels sont-ils ? C'est ce que Boerhaave ne dit point, et ce qu'il fallait dire. Outre cela, si un médecin qui entend bien, recte intellexit, les préceptes que Boerhaave donne sur les acrimonies ; si un médecin, dis-je, qui sait manier comme il faut les médicaments opposés aux acrimonies dont Boerhaave fait autant de spécifiques, connait certainement, profecto, la façon de faire, de diriger, et de gouverner la crise et la coction, à quoi bon les attendre de la nature ? comment cette action permutante des spécifiques s'accorde-t-elle avec les jours critiques ? pourquoi s'en tenir, comme Boerhaave le fait (§. 1210. Haller), à la loi d'Hippocrate, qui vetat purgare in statu cruditatis, qui défend de purger pendant que les humeurs sont crues, et qui ordonne d'attendre la coction ? pourquoi ne pas la faire cette coction avec les spécifiques ? et s'ils réussissent, ou si on croit qu'ils peuvent réussir, quelle nécessité y a-t-il de s'en tenir à des lois anciennes ? pourquoi ne pas se décider contre-elles comme les Chimistes ? Enfin Boerhaave a bien dit, que la crise est différente en Grèce et en Norvege ; mais on ne sait point si cette différence regarde la nature de la crise, ou l'organe par lequel elle se fait, ou bien les jours auxquels elle arrive : et cela n'est pas mieux décidé au §. 941, dans lequel Boerhaave prétend que la crise est différente dans les différents climats, crisis varia est ratione regionis ; de manière qu'il parait avoir à peine touché à l'opinion de ceux dont nous parlons ci-dessus, et qui prétendent que les crises ne se font point aux mêmes jours en Grèce et dans ce pays-ci.
En un mot il me semble qu'il est assez difficile, quelque parti qu'on prenne, de s'appuyer du sentiment de Boerhaave. Il a écrit des généralités ; ses propositions ne paraissent pas assez circonscrites. Il n'a pas bien exactement fixé sa façon de penser ; tantôt il semble vouloir concilier les modernes et les anciens, le plus souvent il donne la préférence à ces derniers : mais, encore une fais, tout ce qu'il avance n'est ni assez clair, ni assez déterminé, surtout pour les commençans. Il est fâcheux que le savant M. Haller n'ait pas jugé qu'il fût convenable de toucher à toutes ces questions essentielles, et les seules peut-être qui soient vraiement intéressantes. Lorsque Boerhaave parle des crises, qu'il donne des lois à ce sujet, qu'il propose des choses, qu'il appelle (941. &c.) recepta, reçues, axiomata, des axiomes ; M. Haller garde le silence sur ces lais, sur les sources où son maître les a puisées, sur leur vérité et leur authenticité ; il ne cite pas même les ouvrages d'Hippocrate et de Galien, dans lesquels Boerhaave a pris presque tout ce qu'il avance de positif. Chacun peut, il est vrai, s'orienter sur ces matières par lui-même ; mais lorsqu'il s'agit de la manière dont Boerhaave assure que ce qu'il dit est reçu, et qu'il en fait des axiomes, chose fort importante pour l'histoire de la Médecine que M. Haller a tant à cœur, n'est-il pas surprenant, qu'il ne nous apprenne point dans quel endroit ces axiomes étaient reçus, lorsque Boerhaave composait son ouvrage (en 1709 et 1710), et de quel oeil les partisans de Silvius Deleboé, qui étaient les dominans à Leyde, regardaient ces axiomes ? S'il s'agit d'un petit muscle, d'une figure anatomique, d'une discussion curieuse, M. Haller ne s'épargne point, il cite des auteurs avec une abondance qui fait honneur à son érudition, il fait mille pénibles recherches, il instruit son lecteur en le conduisant dans tous les coins de sa bibliothèque ; et lorsqu'il s'agit des matières de Pathologie, il n'a rien à dire, rien à citer. Un médecin, par exemple Vanswieten, que les praticiens peuvent à bon droit appeler l'enfant légitime ou le fils ainé de Boerhaave, aurait fait précisément le contraire.
Si on consulte Boerhaave dans ses aphorismes, il veut que dans l'angine inflammatoire (ap. 809) on ait recours " à de promptes saignées, et si abondantes, que la débilité, la pâleur, et l'affaissement des vaisseaux s'ensuivent ", cita, magna, repetita missio sanguinis, quousque ut debilitas, palor, vasorum collapsus ; et tout de suite " à de forts purgatifs ", valida alvi subductio, per purgantia ore hausta ; " sans oublier les suffumigations humides ", vapore humido, molli, tepido, assidue hausto. Boerhaave prétend que dans la péripneumonie inflammatoire et récente (ap. 854), " il faut recourir à de promptes saignées ", citam largam missionem sanguinis, ut diluentibus spatium concedatur, " pour faire place aux délayans ". Il donne les mêmes préceptes pour l'inflammation des intestins, pour la pleurésie, etc. mais s'il faut suivre ces règles, il n'est plus question de choisir, des jours déterminés, il n'y a pas même lieu d'attendre la coction et la crise sans les déranger. Il est vrai que Boerhaave présente les mêmes maladies sous d'autres points de vue ; mais on ne trouvera jamais une conformité parfaite entre le traitement qu'il prescrit, et la doctrine des jours critiques, reçue chez les anciens ; et il demeure incontestable que, comme nous l'avons dit, le système de Boerhaave est indéterminé, et qu'au reste il a du rapport avec ce que Baglivi, Stahl, Hoffman, et bien d'autres pratiquaient avant lui. L'illustre Vanswieten est plus précis et plus décidé que son maître ; il s'explique au sujet des crises, à l'occasion d'un ouvrage de M. Nihell, dont je parlerai plus bas, et il le fait d'une manière qui annonce le praticien expérimenté, l'homme qui a Ve et vérifié ce qu'il a lu. Il est à souhaiter que ce médecin puisse communiquer un jour les observations nombreuses dont il parle, et dans lesquelles il s'est convaincu de la vérité du fond de la doctrine des anciens.
Il n'est pas douteux enfin, que les modernes, qui ont joint la pratique aux principes de l'école de Boerhaave, parmi lesquels il faut placer quelques Anglais de réputation, tels que M. Heuxam, ne fussent très-portés à admettre la doctrine des crises ; le docteur Martine mérite d'être mis dans cette dernière classe.
Chirac, un des réformateurs ou des fondateurs de la médecine Française, qui se donne lui-même pour disciple de Barbeïrac et des autres médecins de Montpellier, quitta cette fameuse école, où il avait déjà formé bien des élèves, et où il avait soutenu pendant dix-huit ou vingt ans (en s'en rapportant à un passage d'un de ses ouvrages que je citerai dans un moment), des opinions erronées qui l'égaraient ; il vint prendre à Paris des connaissances, qui y sont aujourd'hui les fondements de la médecine ordinaire, de sorte qu'on ne saurait bien décider si le système de Chirac est né à Montpellier ou à Paris, et s'il n'appartient pas par préférence à la médecine de la capitale, où Chirac trouva plus d'une occasion de s'instruire, et de revenir de ses opinions erronnées de Montpellier ; d'ailleurs la célébrité de son système est dû. aux médecins de la faculté de Paris.
Quoi qu'il en sait, les idées simples et lumineuses que Chirac nous a transmises, sont devenues des lois sous lesquelles la plupart des médecins François ont plié. On y a pris les maladies dans leurs causes évidentes ; on a combattu les idées des anciens et celles des Chimistes ; on a formé une médecine toute nouvelle, à laquelle la nature a pour ainsi dire obéi, et qu'on a bien fait de comparer au Cartésianisme dans la Physique.
La retenue et les préjugés des anciens, qui n'osaient rien remuer dans certains jours, ont été singulièrement combattus par Chirac. Il a employé les purgatifs, les émétiques, et les saignées dans tous les temps de la maladie, où les symptômes ont paru l'exiger ; enfin il a bouleversé et détruit la médecine ancienne : il n'en reste aucune trace dans l'esprit de ses disciples, trop généralement connus et trop illustres, pour qu'il soit nécessaire de s'arrêter à les nommer. Ils ont peut-être été eux-mêmes plus loin que leur maître, et ils ont rendu la médecine en apparence si claire, si à portée de tout le monde, que si par hasard on venait à découvrir, qu'elle n'a point acquis entre leurs mains autant de sûreté que de brillant et de simplicité, on ne saurait s'empêcher de regretter des opinions qui semblent bien établies, et de faire des efforts pour détruire tout ce qu'on pourrait leur opposer.
Voici quelques propositions tirées du Chiracisme, qui feront mieux juger que je ne pourrais le faire du genre de cette médecine : Hippocrate et Galien, dit Chirac (trait. des fiévres malig. et int.), ne doivent pas avoir plus de privilège qu'Aristote ; ils n'étaient que des empyriques, qui dans une profonde obscurité ne cherchaient qu'à tatons ; ils ne peuvent être regardés par des esprits éclairés, que comme des maréchaux ferrants, qui ont reçu les uns des autres quelques traditions incertaines... Quand même ils n'auraient jamais existé, et que tous leurs successeurs n'auraient jamais écrit, nous pourrions déduire des principes que j'ose me flatter qu'on trouvera dans mon ouvrage, tout ce qui a été observé par les anciens et par les modernes... Les Chimistes pleins de présomption n'ont fait qu'imaginer... leur audace n'a produit qu'un exemple contagieux pour plusieurs médecins ; ils m'ont égaré moi-même pendant plus de dix-huit ou vingt ans, par des opinions erronées que j'ai eu bien de la peine à effacer de mon esprit. C'est en suivant les mêmes principes, que M. Fizes s'explique ainsi dans son traité des fiévres (tractat. de febrib.) : " la fiévre est une maladie directement opposée au principe vital " : principio vitali directe oppositus.... Sic, ajoute-t-il, naturam errantem dirigimus, et collabentem sustinemus, non otiosi crisium spectatores : " c'est ainsi que nous dirigeons la nature qui s'égare, et que nous la relevons dans ses chutes, sans attendre négligemment les crises ".
Je choisis ces propositions, comme les plus éloignées de l'expecta des Stahlliens, et du quo natura vergit des anciens : on pourrait peut-être les trouver trop fortes ; mais ce n'est ni par des injures, ni par des épigrammes qu'il faut les combattre. Le fait est de savoir si elles sont vraies, si en effet le médecin peut retourner, modifier, et diriger les mouvements du corps vivant ; si on peut s'opposer à des dépôts d'humeurs, emporter des arrêts, replier des courants d'oscillations ; et purger, saigner, et faire suer, ainsi que Chirac le prétend, dans tous les temps, sans craindre les dérangements qui faisaient tant de peur aux anciens : après tout ce sont-là des choses de fait. Le Chiracisme n'est fondé que sur un nombre infini d'expériences, qui se renouvellent chaque jour dans tout le royaume : est-on en droit de présumer que cette méthode, si elle était pernicieuse, fût suivie journellement par tant de grands praticiens ? et suivie de propos déliberé, avec connaissance de cause, par des gens qu'on ne saurait soupçonner de ne pas savoir tout ce que les anciens ont dit, tout ce que leur sagesse, leur timidité ou leur inexpérience leur avaient si vivement persuadé. Nous purgeons, saltem alternis, au moins de deux en deux jours, dit souvent M. Fizes ; notre méthode n'effarouche que ceux qui ne voient que des livres et non des malades, qui aegrotos non vident : nous saignons toutes les fois que la vivacité et la roideur du pouls l'exigent, à la fin des maladies comme au commencement ; comment se persuaderait-on, que des gens qui parlent ainsi se trompent, ou qu'ils veulent tromper les autres ? c'est ce qui s'appelle être décidé, et avoir un système positif, fixe, déterminé.
Ce n'est pas à dire qu'il ne reste bien des ressources aux défenseurs du système des anciens ; Chirac lui-même, qui le croirait ? a fait des observations qui paraissent favorables à ce système : Quelques malades (c'est Chirac qui parle), n'échappaient que par des sueurs critiques qui arrivaient le septième jour, le onzième, et le quatorzième.... Ceux en qui les bubons ou les parotides parurent le quatrième, le cinquième ou le sixième, perirent tous ; il n'échappa que ceux en qui les bubons parurent le septième ou le neuvième.... Il y en avait qui mouraient avant le quatrième et au septième, au neuvième, au onzième.... Les purgatifs n'agissent jamais pour vider absolument qu'après sept, quatorze, ou vingt-un jours, quoiqu'il soit dangereux de ne pas purger les malades avant ce temps-là.... La résolution et la séparation des humeurs n'arrivent qu'après le septième, le quatorzième, et le vingt-unième, mais on peut toujours purger en attendant.... Les fièvres inflammatoires ne se terminent heureusement qu'à certains jours fixes, comme le septième, le quatorzième, et le vingt-unième.... On reviendra au sept, aux délayans ; c'est un jour respectable et qui demande une suspension des grands remèdes : le temps de la digestion des humeurs, ou celui de la résolution est de cinq jours, de sept, de onze, et de quatorze, ou bien de dix-huit et de vingt-un, et cela plus communément qu'au six, au neuf, au douze, au quinze... Le premier terme critique des inflammations est le septième, et lorsqu'elles ne peuvent y arriver, elles s'arrêtent au deuxième et au troisième. Habemus confitentem reum, diront les sectateurs de l'antiquité ; en faut-il davantage pour faire sentir la certitude, l'invariabilité, et la nécessité de la doctrine des anciens ? Le septième, le quatorzième, le vingt-unième, sont ordinairement heureux, de l'aveu de Chirac ; le sixième l'est moins que le septième ; le onzième et le quatorzième le suivent de près : n'est-ce pas-là précisément ce que Galien et Hippocrate ont enseigné ?
A quoi se réduisent donc les efforts et les projets des médecins actifs qui prétendent diriger la Nature, puisqu'ils sont obligés de recourir au compte des jours ? la ressource qu'ils veulent se ménager, par la liberté où ils disent qu'ils sont de manier et d'appliquer la saignée et les purgatifs, ne vaut pas à beaucoup près ce qu'ils imaginent. En effet, la multitude des saignées auxquelles bien des médecins semblent borner tous les secours de l'art, n'est pas bien parlante en faveur de la médecine active : on réitère souvent ce secours ou cet adminicule, il est vrai, mais les anciens tiraient plus de sang dans une seule saignée qu'on n'en tire aujourd'hui en six : on les traite de timides, ils étaient plus entreprenans que les modernes ; car quel peut être l'effet de quelques onces de sang qu'on fait tirer par jour ? la plupart de ces évacuations sont souvent comme non avenues, et heureusement elles ne sont qu'inutiles ; elles n'empêchent pas le cours des maladies. Les médecins qui saignent fréquemment et peu à la fais, attendent des crises sans le savoir ; et voilà à quoi tous leurs efforts se bornent : heureux encore de ne rien déranger, ce qui arrive dans quelques maladies, comme on veut bien l'accorder : mais il est aussi des maladies dans lesquelles le nombre des saignées n'est point indifférent ; et on nie hautement à leurs partisans, qu'ils viennent à bout de ces maladies aussi aisément qu'on pourrait le penser, en s'en rapportant à ce qu'ils avancent ; il suffit pour s'en convaincre d'opposer les modernes à eux-mêmes, ils sont partagés. Ceux qui se laissant emporter par la théorie des prétendues inflammations, ne veulent jamais qu'évacuer le sang, et qui sont sectateurs de Chirac, dont ils mêlent la pratique à la théorie légère et spécieuse de Hecquet, ces médecins, dis-je, sont directement opposés à d'autres sectateurs du même Chirac, qui sont plus attachés à la purgation qu'à la saignée. C'est-là aujourd'hui un des grands sujets de dispute entre les praticiens ; les uns ont recours à la saignée plus souvent que Chirac même, et les autres prétendent que les purgations fréquentes sont très-préférables aux saignées : il y a même des gens qui croient que c'est ici une dispute entre les médecins de Paris et ceux de Montpellier ; les premiers, dit-on, saignent souvent et purgent peu, et ceux de Montpellier purgent beaucoup et ne saignent presque pas. Quoiqu'il en sait, dira le partisan des anciens ou le pyrrhonien, voilà les médecins actifs divisés entr'eux sur la manière d'agir, avant d'avoir bien démontré qu'on doit agir en effet.
D'ailleurs, ajouteront-ils, prenez-garde que la plupart des médecins purgeurs, qui prétendent guérir et emporter leurs maladies avec les catartiques, profitent comme les médecins saigneurs, de quelques mouvements legers auxquels la Nature veut bien se prêter, quoiqu'occupée au fond à conduire la maladie principale à sa fin ; ils attendent les crises sans s'en douter, comme les médecins qui font des saignées peu copieuses et réitérées : ils purgent ordinairement avec de la casse et des tamarins ; ils ont recours à des lavements pour avoir deux ou trois selles, qui ne sont souvent que le produit de la quantité de la médecine elle-même. Quels purgatifs ! Quelle activité que celle de ces drogues ! En un mot, il est très-rare qu'elles fassent un effet de purgation bien marqué : on peut les prendre sur le pied de très-legers laxatifs ou de lavages ; et c'est à ce titre qu'heureusement ils ne dérangent pas toujours le cours de la maladie : ainsi, que ceux qui y ont recours avec beaucoup de confiance, cessent de nous vanter leur efficacité.
Il est vrai qu'il y a quelques médecins qui semblent regarder comme des remèdes de peu de conséquence, les lavages, les apozemes, les sirops, et toutes les sortes de tisanes légèrement aiguisées, qu'on emploie communément, sous prétexte qu'il faut toujours tâcher d'avoir quelqu'évacuation sans trop irriter. Les médecins vraiment purgeurs, et en cela fidèles sectateurs des anciens, emploient comme eux les remèdes à forte dose ; mais ils ménagent leurs coups, ils attendent le moment favorable pour placer leurs purgatifs, c'est-à-dire qu'ils purgent au commencement d'une maladie, ou lorsque la coction est faite, à-peu-près comme les anciens eux-mêmes ; et ceux qui les verront pratiquer, auront lieu d'observer que, s'ils manquent l'occasion favorable, et surtout s'ils purgent violemment lorsque la Nature a affecté quelqu'organe particulier, pour évacuer la matière morbifique cuite, ils font de très-grands ravages ; c'est ce qui fait qu'ils deviennent d'eux-mêmes très-réservés, et que peu s'en faut qu'ils ne comptent les jours ainsi que les anciens.
Les mêmes sectateurs des anciens diront encore, que quelques prétentions que puissent avoir les médecins modernes non expectateurs, quoiqu'ils avancent que leurs principes sont non-seulement appuyés de l'expérience, mais encore évidents par eux-mêmes, il serait aisé de leur faire voir qu'il en est peu qui puissent être regardés autrement que comme des hypothèses ingénieuses, ou plutôt hardies, qui, en réduisant toute la médecine à quelques possibilités et à des raisonnements vagues, n'en ont fait que des systèmes purement rationnels très-variables, ouvrant ainsi dans un art sacré, dont l'expérience seule apprend les détours, une carrière qu'on parcourt très-facilement lorsqu'on se livre au désordre de l'imagination.
Prenons pour exemple quelques-uns des principes des disciples de Chirac ; principes déjà adoptés par Freind dans ses commentaires sur les épidémies, et qui ont, à dire vrai, quelque chose de spécieux et de séduisant. Veulent-ils prouver qu'il faut saigner dans les maladies aiguës ? voici comment ils raisonnent : La nature, disent-ils, livrée à elle-même, procure des hémorrhagies du nez et des autres parties : il suit de-là qu'il est essentiel de faire des saignées artificielles pour suppléer aux saignées naturelles ; mais on ne prend pas garde que la nature suit des lois particulières dans ses évacuations ; qu'elle choisit des temps marqués pour agir ; qu'elle affecte de faire ces évacuations par des organes, ou des parties déterminées. Comment s'est-on convaincu que l'art peut à son gré changer le lieu, le temps et l'ordre d'une évacuation ? En raisonnant sur ce principe, il n'y aurait qu'à saigner une femme qui est au point d'avoir ses règles, pour suppléer à cette évacuation ; il n'y aurait qu'à saigner une femme qui doit avoir ses vuidanges, dans la même vue : enfin il n'y aurait qu'à saigner un homme qui a des hémorrhoïdes. Mais l'expérience et les épreuves trop réitérées que la liberté, ou plutôt la licence de raisonner et d'agir ainsi, font naître, prouvent assez combien ces sortes d'assertions sont peu fondées, et combien M. Bouillet, qui est fort attaché aux principes de Chirac, a eu tort de se persuader qu'elles avaient les qualités nécessaires à des axiomes ou à des postulatum de Mathématique.
Il serait aisé de faire les mêmes remarques sur la plupart des propositions qui en ont imposé à beaucoup de modernes ; mais il suffit de dire en un mot, qu'une hémorrhagie ou toute autre évacuation critique ou même symptomatique, ménagée par la nature, a des effets bien différents de ceux qu'elle produit lorsqu'elle est dû. à l'art. Quelques gouttes de sang qui se videront par les narines, par l'une des deux par préférence ; quelques crachats, trois ou quatre croutes sur les lèvres, très-peu de sédiment dans les urines ; ces évacuations, qui semblent de peu de conséquence, feront beaucoup d'effet, et auront un succès fort heureux lorsque la nature les aura préparées, comme elle sait le faire : et des livres de sang répandues, des séaux de tisane rendus par les urines, des évacuations réitérées par les selles, que l'art s'efforcera de procurer, ne changeront pas la marche d'une maladie ; ou si elles font quelque changement, ce sera de la masquer ou de l'empirer.
Ne nous égarons pas nous-mêmes dans le labyrinthe des raisonnements. Je ne fais comme on voit ; qu'ébaucher très-légèrement cette matière, que l'observation seule peut éclaircir et décider, et qu'il est dangereux de prétendre examiner autrement que par la comparaison des faits bien constatés. Je ne puis oublier ce qu'a dit sur une matière à peu-près semblable un auteur moderne ; c'est M. de Bordeu père, docteur de Montpellier, et célèbre médecin de Peau en Béarn. Il est fort partisan des remèdes actifs, même dans les maladies chroniques du poumon ; et il parait avoir abandonné le système de Chirac, quant à la façon d'appliquer la théorie et le raisonnement physique à la Médecine. Un théoricien (dit-il dans son excellente dissertation sur les eaux minérales du Béarn), un théoricien ne prouverait-il pas, ne démontrerait-il pas au besoin, que des émétiques et des purgatifs doivent nécessairement augmenter les embarras du poumon dans toutes les péripneumonies ; effaroucher l'inflammation et procurer la gangrene ? Qui pourrait résister aux raisonnements puisés dans la théorie sur cette matière ? Mais il est sur que quelque spécieux qu'ils paraissent, ils sont démentis par la pratique. En un mot il faut convenir qu'on s'égare presque nécessairement, lorsqu'on se livre sans réserve au raisonnement en Médecine. La dispute entre les anciens et les modernes, dont je viens de dire quelque chose, ne peut et ne doit être vuidée que par l'observation.
Or si, comme je l'ai remarqué ci-dessus, le Chiracisme ou la Médecine active est le système généralement reçu aujourd'hui, surtout en France, il y a aussi des praticiens respectables des pays étrangers, tels que M. Tronchin médecin célèbre à Amsterdam, qui sont expectateurs, et qui ménagent les crises dans les maladies aiguës ; ainsi la doctrine des anciens est pour ainsi dire prête à reparaitre en Europe. Attachons-nous uniquement à ce qui regarde la France. Nous devons à l'attention et au goût de M. Lavirotte médecin de Montpellier et de Paris, très-connu dans la république des Lettres, la connaissance d'une découverte fort remarquable, publiée en Anglais par M. Nihell, au sujet des observations sur les crises, faites principalement par le docteur Don Solano médecin espagnol. Je ne parlerai pas ici de ces observations, qui mettront, si elles sont bien constatées, Solano à côté des plus grands médecins ; elles regardent l'hémorrhagie du nez, le cours de ventre et la sueur ; évacuations critiques que Solano se flatte de pouvoir prédire par le pouls, Voyez POULS.
Je parlerai seulement ici d'une dissertation que M. Nihell a faite sur la nature des crises, sur l'attention des anciens et la négligence des modernes au sujet des crises ; c'est le quatrième chapitre de son ouvrage, qui a paru en français sous le titre d'observations nouvelles et extraordinaires sur la prédiction des crises par le pouls, année 1748.
M. Nihell avance d'abord qu'on n'a jamais démontré publiquement la fausseté des observations des anciens sur les crises, ni justifié le peu de cas qu'on en fait aujourd'hui, et cela est vrai ; mais il est aisé de répondre à M. Nihell, qu'il s'agit de démontrer la vérité, et surtout l'utilité des observations des anciens, et non point de dire qu'on n'en a pas prouvé la fausseté. Il a lui-même senti la difficulté qu'il y avait de le faire ; car il commence par prévenir son lecteur qu'il est éloigné de ses livres : mais ce ne sont pas les livres qui nous manquent à cet égard, ce sont les faits évidents et bien discutés.
Il se réduit ensuite à avancer, 1°. que les jours septenaires et demi-septenaires sont particulièrement consacrés aux révolutions critiques, sans exclusion des autres jours : 2°. que les crises peuvent être prédites par les signes que les anciens ont donnés pour cela. La première proposition de M. Nihell est contenue en termes au moins équivalents, dans ce que nous avons rapporté de Chirac, et dans plusieurs autres ; ainsi elle apprend seulement que M. Nihell est de cet avis, et on peut la regarder comme la principale question. Quant à ce que M. Nihell ajoute, que les crises peuvent être prédites par les signes que les anciens ont donnés pour cela, il l'avance, mais il ne le prouve pas. D'ailleurs il ne suffit pas que les crises puissent être prédites ; il faudrait, pour poursuivre les anti-critiques dans leurs derniers retranchements, prouver que les crises doivent être attendues.
Il est évident, dit M. Nihell, que les objections tirées des différentes façons de compter les jours des fièvres aiguës, sont nulles et de nulle valeur, puisque les différences ne sont pas positivement prouvées dans les faits particuliers rapportés en faveur des anciennes observations sur les crises. M. Nihell ne s'est pas rappelé qu'Hippocrate se contredit, comme je l'ai dit ci-dessus, et qu'on l'a vivement attaqué en faisant voir le peu de rapport qu'avaient ses propres observations dans les épidémies, avec son système des jours critiques, et celui de Galien.
M. Nihell observe ensuite que de quarante-huit histoires de maladies dont Forestus fait mention, les trois quarts furent accompagnées de crises ; cinq arrivèrent au quatrième jour, et des cinq malades trois moururent : vingt-deux, dont trois malades moururent, furent terminées au septième, et toutes les autres se terminèrent heureusement ; sept au quatorzième, deux au onzième, une au dix-septième, et une au vingt-unième ; ce qui est en effet très-favorable au système des anciens, auquel Forestus était attaché.
M. Nihell après avoir fait quelques remarques qui ne sont pas tout à fait concluantes contre la méthode des modernes, rappelle un fait arrivé à Galien, qui s'opposa à une saignée ordonnée par ses confrères, prévoyant une hémorrhagie critique du nez, qui arriva en effet. M. Nihell a peine à croire qu'il y eut aucun médecin moderne qui n'eut voulu être à la place de Galien ; mais on pourrait lui demander s'il aurait lui-même voulu être à la place du malade ; et s'il voudrait encore dans ce moment-ci risquer pareille aventure, sachant la vérité du pronostic de Galien, et de ceux de Solano même. Pitcarne n'aurait pas manqué de faire cette demande, lui qui avançait sans façon qu'il y aurait peu de médecins qui voulussent risquer leur bien en faveur de leurs opinions particulières.
M. Nihell continue ses remarques contre les modernes ; elles peuvent se réduire la plupart à des reproches ou à des raisonnements, tels que ceux que j'ai observé ci-dessus, devoir être évités sur cette matière. Il s'appuie de ce qu'Albertinus a fait insérer dans les mémoires de l'académie de Boulogne, au sujet de l'action du quinquina, qu'il dit ne pas empêcher qu'il n'arrive des évacuations critiques dans les fièvres d'accès ; ce qui ne parait pas directement opposé au système des modernes sur les crises, (voyez QUINQUINA). Car enfin, si les remèdes n'empêchent pas les crises, il est inutîle de s'élever contre leur usage, surtout s'ils sont utiles ou nécessaires d'ailleurs, ne fût-ce que comme le quinquina qu'il faut donner dans de certaines fièvres, pour arrêter ou modérer les accès, à moins qu'on ne veuille exposer les malades à un danger évident, disent bien des praticiens.
Enfin M. Nihell finit en remarquant fort judicieusement, que toutes les disputes entre les anciens et les modernes, se réduisent à des faits de part et d'autre. Il avance que l'observation des crises n'est aucunement opposée à une vigoureuse méthode de pratiquer ; ce qui ne parait pas bien conséquent à tout ce qu'il a voulu établir contre l'activité de la Médecine des modernes. Il fait encore quelques autres remarques dans lesquelles je ne le suivrai point. Il serait à souhaiter que ce médecin eut continué ses recherches, qui ne pouvaient manquer d'être utiles, étant faites avec la précaution qu'il a prise dans l'examen des observations de Solano. Voyez POULS. Je dois ajouter, par rapport à ce dernier médecin, qu'il est très-décidé en faveur des crises et des jours critiques, et qu'il a même fait des remarques importantes à cet égard : mais l'intérêt qu'il aurait à faire valoir ses signes particuliers, pourrait bien affoiblir son témoignage ; et dans ce cas-là M. Nihell qui a fait un voyage en Espagne pour consulter Solano, doit être regardé comme son disciple, et non point comme un juge dans toutes ces disputes. Je parlerai plus bas des caractères nécessaires à un juge de ces matières ; ils me paraissent bien différents de ceux d'un simple témoin.
Il y a encore des auteurs plus modernes que M. Nihell, qui semblent annoncer quelque chose de nouveau sur toutes ces importantes questions, et qui font présumer que la Médecine française pourrait bien changer de face, ou du moins n'être pas aussi uniforme qu'elle l'est, sur le peu de cas qu'on parait faire de la doctrine des crises.
L'un de ces auteurs est celui du specimen novi Medicinae conspectus, 1751. C'est ainsi qu'il s'explique : Omnis motus febrilis, quia tendit ad superandum morbosum obicem, criticus censendus est, vel tendents ad crises : " Tout mouvement fébrîle doit être regardé comme critique, ou tendant à procurer des crises, parce qu'il tend à la destruction de l'arrêt qui cause ou qui fait la maladie. " Crisium typus, ajoute le même auteur, dierumque criticorum, quorum ab Hippocrate traditus ordo, non tam facîle quàm plerique clamant clinici, venae sectionibus et medicamentis patitur immutari seu accelerari : " Il n'est pas aussi aisé que la plupart des médecins le pensent, de changer ou d'accélerer l'ordre des jours critiques établi par Hippocrate. " Ce qui fait assez voir que cet excellent observateur, très-connu, quoiqu'il ne se nomme pas dans son ouvrage, n'est pas éloigné de l'opinion des anciens sur les crises, et qui doit le faire regarder en France comme un des premiers qui aient trouvé à redire à la méthode des modernes.
M. Quesnay médecin consultant du Roi, " considère la nature des crises avec une très-grande sagacité (dans son traité des Fièvres, 1753). Il parait avoir profondément réfléchi sur cette matière importante ; et tout ce qu'il dit à cet égard, mérite d'être lu avec beaucoup d'attention. Il y a en général trois sortes de jours critiques ; les jours indicatifs, les jours confirmatifs, et les décisifs. Les jours indicatifs sont ceux qui annoncent la crise par les premières marques de coction, comme le quatrième, le onzième, le dix-septième, etc. Les jours confirmatifs sont ceux où on observe les signes qui assurent du progrès de la coction ; tels sont les jours de redoublement, qui arrivent entre les jours indicatifs et les jours décisifs. Ces derniers sont ceux auxquels la crise arrive, comme le septième, le quatorzième et le vingt-unième. Les jours décisifs sont assujettis à une période de sept jours ; et si la maladie dure plusieurs septenaires, il n'y a que le dernier qui soit regardé comme critique. Ce temps de crise avance plus ou moins, selon que les redoublements sont plus ou moins vifs ; et pour que la crise soit bien régulière, elle ne doit arriver que les jours impairs ; mais pour ne pas s'y tromper, il faut suivre l'énumération des jours mêmes du septenaire critique, et non pas simplement celle des jours de la maladie : car l'exacerbation du jour critique décisif, qui arrive le quatorzième jour de la maladie, se trouverait, selon cette dernière énumération, dans un jour pair ; mais selon celle du septenaire critique, elle se trouve dans un jour impair, parce qu'en quatorze jours il y a deux septenaires : et le dernier, qui est le septenaire critique, ne commence qu'à la fin du premier, c'est-à-dire au huitième jour. Ainsi la dernière exacerbation de ce second septenaire se trouve dans le septième jour, et par conséquent dans un jour impair. Ces deux premiers septenaires sont ceux que les anciens nommaient disjoints ; ils appelaient les autres conjoints, parce que le dernier jour du troisième septenaire, par exemple, était en même temps le premier jour du quatrième, et ainsi de suite ; en sorte qu'ils comptaient six septenaires dans l'espace de quarante jours naturels : mais dans ces quarante jours il y a vingt jours de remission et vingt-un jours de redoublement, et par conséquent quarante-un jours de maladie. C'est en partant de-là que l'auteur établit que le jour de maladie doit être à-peu-près de vingt-trois heures, ou vingt-deux heures cinquante-une minutes ; le quartenaire de trois jours naturels et huit heures ; le septenaire de six jours et seize heures, etc.
M. Quesnay observe ici que cette supputation des anciens est défectueuse, en ce qu'ils paraissent avoir eu plus d'égard aux rapports numériques des jours des maladies, qu'à l'ordre périodique des redoublements, qui cependant règle celui des jours critiques. Par leur division il se trouve quatre redoublements dans les deux premiers septenaires, tandis qu'il n'y en a que trois dans les autres. L'auteur donne ici une manière de compter fort ingénieuse, par laquelle on allie l'ordre et le nombre des redoublements avec les révolutions septenaires, et cela en faisant toujours commencer et finir chaque septenaire par un jour de redoublement : car les jours de remission doivent être réputés nuls. Ainsi, par exemple, on laissera le huitième jour, comme un jour interseptenaire, et on fera commencer le second septenaire au neuvième jour, et finir au quinzième ; et ce dernier sera le premier jour du troisième septenaire, et ainsi de suite. Par ce moyen il se trouvera six septenaires en quarante jours naturels, et dans chacun quatre redoublements ; car si le second septenaire était le critique, la dernière exacerbation serait celle du quinzième de la maladie ; ou s'il y a d'autre septenaire, ce quinzième jour sera aussi le premier jour, et le premier redoublement du troisième septenaire : il est vrai cependant que c'est en faire un double emploi. Quoiqu'il en sait, l'auteur a construit suivant cette idée une table fort curieuse, où, en supposant les jours de maladie de vingt-trois heures, on voit les six septenaires compris en quarante jours naturels ; espace qui est le terme des maladies aiguës et des maladies critiques régulières.
Il ne regarde pas les jours critiques comme des jours de combat entre la nature et la maladie, suivant l'idée des anciens ; mais il croit que c'est la fièvre elle-même qui, si elle est simple, opère par son mécanisme la guérison de la maladie : si au contraire elle est troublée et dérangée par des accidents étrangers d'une certaine violence, on n'aperçoit rien dans les jours de redoublement qui puisse faire prédire la mort, que le progrès de ces épiphénomènes dangereux, et le défaut des signes de coction. Il examine ensuite les différentes crises, en particulier les principaux signes qui les annoncent, et les voies par lesquelles elles se font. Il définit la crise en général, le produit de la dernière exacerbation de la fièvre, par laquelle la cause de la maladie est incorporée dans l'humeur purulente, et chassée avec celle-ci hors des voies de la circulation par les excrétoires du corps.... " C'est-là le jugement porté par l'auteur du journal des savants (Juill. 1753), sur ce que M. Quesnay avance au sujet des crises.
L'académie de Dijon avait proposé pour les prix de l'année 1751, d'examiner si les jours critiques sont les mêmes en nos climats, qu'ils étaient dans ceux où Hippocrate les a observés, et quels égards on doit y avoir dans la pratique. L'académie a couronné la dissertation de M. Aymen docteur en Médecine. Cette dissertation vient d'être rendue publique. Je ne saurais m'empêcher d'en dire ici quelque chose, et je ne manquerai pas de parler de celle de M. Normand médecin de Dole, qui avait été adressée à la même académie, et qui a Ve le jour par hasard.
M. Aymen prétend que dans nos climats les jours critiques sont les mêmes que dans ceux où Hippocrate les a observés ; que tous les jours de la maladie sont décrétoires ou critiques ; que ces jours critiques existent réellement, mais qu'ils ne sont pas bornés au nombre septenaire ou quartenaire ; qu'ils arrivent aussi les autres jours ; que la combinaison, le rang des jours décrétoires prouvent la superstition des anciens, et que cette doctrine est fondée sur les observations d'Hippocrate.
J'emploie les propres expressions de M. Aymen. Telle est son opinion sur la première partie de la question proposée, qui est celle sur laquelle il s'est le plus étendu. Il établit son sentiment, en faisant l'énumération d'une grande quantité d'observations répandues dans les différents auteurs. Il commence par le premier jour, il finit par le vingtième ; et il prouve par des faits qu'il y a eu des crises dans tous ces jours, le premier, le second, le troisième, le quatrième, le 5e, etc. jusqu'au 20e (& non le 21) ; d'où M. Aymen conclut que les crises arrivent dans tous les jours d'une maladie indifféremment. Cette conclusion parait d'abord nécessaire et évidente ; elle peut pourtant donner lieu à quelques considérations particulières, qui me paraissent mériter l'attention de l'auteur.
1°. Les partisans de l'antiquité ne conviendront pas avec M. Aymen, qu'Hippocrate ait cru que les crises se font dans tous les jours d'une maladie indifféremment. Cette doctrine, dit-il, est la même que celle du célèbre auteur des Coaques. Comment cela serait-il possible, puisqu'Hippocrate parait avoir établi dans les Aphor. 23 et 24. de la seconde section ; Aphor. 31 et 32. sect. 4. lib. I. des Epid. sect. 3. Coac. praenot. praesag. lib. 3. et ailleurs, qu'il y a des jours qui sont les uns plus remarquables et plus heureux que les autres ? D'ailleurs tous les commentateurs, les Grecs et les Arabes, qui ont travaillé après lui, se sont appuyés de sa décision là-dessus ; il est regardé comme le créateur des quartenaires et des septenaires, ainsi que de toute la doctrine que j'ai exposée ci-dessus : Septenorum quartus est index, alterius septimanae, octavus principium ; est autem et undecimus contemplabilis ; ipse enim quartus est alterius septimanae ; rursùs vero et decimus-septimus contemplabilis, ipse siquidem quartus est à quarto-decimo, septimus vero ab undecimo, dit Hippocrate, Aphor. 24. sect. 2. Voilà les septenaires, les quartenaires, les indices, les jours vides et les critiques, établis dans un seul aphorisme.
On est donc très-formellement opposé à Hippocrate, lorsqu'on soutient que tous les jours sont indifférents pour les crises. Il est bien vrai qu'on peut prouver par les observations répandues dans les différents écrits d'Hippocrate, qu'il est en contradiction avec lui-même, comme je l'ai remarqué au commencement de cet article ; mais Galien, Dulaurents et tous les autres, tâchent de concilier ces contradictions, comme je l'ai aussi observé. Les adversaires d'Hippocrate s'en sont servis pour détruire son opinion. M. Aymen aurait donc pu raisonner ainsi : Je prouve par les observations d'Hippocrate même, qu'il se fait des crises dans d'autres jours que les jours appelés critiques ; je ne suis donc pas du sentiment d'Hippocrate. C'est, encore une fais, le raisonnement qu'ont fait les antagonistes de ce médecin grec. D'ailleurs tous les partisans des crises, et notamment Galien, de dieb. decret. cap. IIe lib. I. ont avoué que les jours indices et les jours vides pouvaient juger quelquefois. C'est-là encore une observation que j'ai faite plus haut, et que je devais à la bonne foi des anciens. Je n'en connais point qui aient dit formellement que les crises ne pouvaient se faire que les jours qu'ils ont désignés, pour me servir de l'expression de M. Aymen (p. 32.) c'est-à-dire les jours vraiment critiques. Il s'agit de savoir s'il n'y a pas des jours qui jugent plus parfaitement, plus heureusement et plus communément que d'autres. La nature a plutôt choisi le septième qu'un autre nombre (dit Dulaurents, trad. de Gelée) pour ce que Dieu le père et créateur de toutes choses, lui a imposé cette loi ; car il a sanctifié le septième jour ; il l'a recommandé aux enfants d'Israèl, comme le plus célèbre de tous, et s'est voulu reposer en icelui de ses œuvres, après avoir parachevé la création : et partant la nature particulière, comme chambrière et imitatrice de l'universelle, fait en chaque septième jour des crises parfaites.... Les crises se font aussi quelquefois aux jours intercalaires.
2°. M. Aymen dit lui-même qu'Hippocrate observa le premier les crises, ou le changement subit de la maladie qui suit l'évacuation ; (ce qui est fort douteux, pour le dire en passant, comme on peut s'en convaincre dans le commentaire d'Hecquet sur les Aphorismes.) M. Aymen ajoute qu'Hippocrate vit que ce changement arrivait plus souvent certains jours que d'autres ; qu'il nomma ces jours critiques ou décrétoires (p. 24.) que les crises arrivent plutôt certains jours que d'autres. Il convient (p. 28.) que les maladies finissent le plus souvent les jours qui ont été remarqués ; que quelques affections ont leur temps limité : (p. 41.) que dans notre partie du monde, les maladies aiguës finissent le plus souvent les jours que les médecins ont notés : (p. 108.) que plusieurs maladies sont terminées le même jour, c'est-à-dire dans un espace réglé ; que les maladies sont terminées d'une ou d'autre façon, plus souvent certains jours que d'autres. Il y a donc des jours critiques marqués : tous les jours ne sont donc pas critiques indifféremment ; ils n'ont pas la même force, la même vertu ; ou s'ils sont critiques, ce n'est que par accident, comme disaient les anciens. L'observation des jours n'est donc point une observation inutîle et superstitieuse, diraient les amateurs de la vieille Médecine.
3°. Ils pourraient encore dire, en lisant l'ouvrage de M. Aymen, que puisqu'il donne un moyen certain de déterminer le jour critique, qui est de faire attention aux jours indicatifs, et qu'il soutient sur la parole de Solano qu'il cite, que tous les jours, quels qu'ils soient pour le quantième, dans lesquels on aperçoit les signes indicatifs d'une crise décisive, doivent être tenus comme le quatrième jour avant la crise à venir : les partisans des anciens pourraient, dis-je, avancer, qu'il faut qu'il y ait quelque différence entre le jour indicatif et l'indiqué ou le critique, et plus encore entre ces deux jours et les intermédiaires que Galien aurait appelés vides. Or si plusieurs observations ont démontré que le quatrième jour, par exemple, est souvent indicatif du septième, et le onzième du quatorzième, etc. (ce que les anciens prétendent, ainsi que Solano, que M. Aymen ne peut pas récuser), il est essentiel de se le tenir pour dit dans le traitement des maladies ; d'où il suit, qu'il y a une différence marquée entre les jours. C'est sur ces différences que sont fondées les règles d'Hippocrate et de Galien. Il est bon de remarquer que M. Aymen est beaucoup plus opposé à ces règles, par exemple, que Chirac, comme on peut le voir dans ce que nous avons rapporté ci-dessus de ce dernier ; ainsi Chirac qui déchire les anciens par ses épigrammes, est plus conforme au fond à leur manière de penser, que M. Aymen qui ne cesse d'en faire l'éloge.
4°. Quant à la manière dont M. Aymen prétend prouver son opinion, on ne peut s'empêcher d'être surpris, qu'après avoir avancé (p. 107), que les crises sont indiquées quatre jours avant qu'elles arrivent, et que les signes de coction précédent toujours le jugement ; il s'efforce d'établir par des faits pris dans les différents auteurs, que le premier jour, le deux, et le trois sont decrétoires : car enfin, ou ces jours ne sont pas decrétoires, ou la crise n'est pas indiquée quatre jours avant qu'elle arrive, ou bien les signes de coction ne précédent pas toujours le jugement. D'ailleurs les observations que M. Aymen rapporte pour prouver que le premier jour est decrétoire, sont elles bien concluantes ? Hippocrate, dit-il, a Ve des fièvres éphemères ; ces fièvres sont-elles définitivement jugées dès le premier jour, comme Hoffman le prétend ? M. Aymen ajoute que dans la constitution de Thasos certains malades qui paraissaient guéris le six, retombaient, et que le premier jour de la rechute était distinctif : n'est-il pas évident que ces maladies étaient jugées au sept ou au neuf, et non point au premier jour ? La rechute arrivait, parce que les maladies n'étaient pas jugées ; parce que le six, auquel elles changeaient, n'est pas un bon jour ; la rechute suppose que la maladie a toujours duré, et qu'elle n'était pas terminée. Un Gascon, ajoute encore M. Aymen, eut sur la fin d'une maladie une catalepsie qui l'enleva en vingt-quatre heures : cette catalepsie arrivée à la fin d'une maladie, était la crise de cette maladie, la catalepsie était perturbatio critica. Tout le monde est convenu que le redoublement qui précède la crise est extraordinaire. M. Aymen fait bien de passer sous silence des apoplexies qui enlèvent les malades en peu d'heures ; et il trouvera bien des médecins qui prétendront que les fièvres malignes dont il parle, et qui ont été terminées en vingt-quatre heures, ne sauraient être regardées comme des maladies d'un jour ; elles se préparaient ou parcouraient leur temps depuis bien des jours ; elles étaient insensibles, mais elles n'en existaient pas moins : d'ailleurs les anciens et les modernes conviennent, ainsi que Baglivi l'a dit expressément, qu'il y a des fièvres malignes qui ne suivent pas les règles ordinaires.
5°. Tout lecteur peut aisément appliquer ces réflexions à ce que M. Aymen dit du deuxième jour, du troisième, et de bien d'autres, et il n'est pas difficîle d'apercevoir qu'il a eu plus de peine à trouver des exemples de crises arrivées aux jours vides, qu'aux jours vraiment critiques. Ainsi, quoique M. Aymen présente le sept, le quatorze, le vingt, et le neuf avec les autres jours, et qu'il les fasse pour ainsi dire passer dans la foule, ils méritent pourtant d'être distingués par la grande quantité de crises observées dans ces jours-là précisément. Je n'en apporterai ici d'autre preuve que celle qu'on peut tirer des observations de Forestus, que M. Aymen rapporte d'après M. Nihell, mais dont il ne fait pas le même usage que le médecin Anglais : de quarante-huit malades, dit-il, p. 113. de fièvre putride, ardente, maligne, dont Forestus rapporte les observations dans son second livre, dix-neuf ont été jugés heureusement par des flux critiques. M. Aymen aurait pu achever la remarque de M. Nihell, et ajouter que de ces quarante-huit malades, cinq furent jugés au quatre, vingt-deux au sept, sept au quatorze, deux au onze, un au dix-sept et un au vingt-un ; et cette observation aurait démontré la différence des jours : car si de quarante-huit maladies les trois quarts finissent aux jours critiques, ces jours là ne sauraient être confondus avec les autres ; et si parmi ces jours critiques, il y en a qui de trente maladies en jugent vingt-deux, d'autres sept, comme le sept et le quatorze l'ont fait dans les observations dont il s'agit, il n'est pas douteux que ce sept et ce quatorze ne méritent une sorte de préférence sur tous les autres jours. En voilà assez, ce me semble, pour justifier le calcul des anciens.
Au reste je suis fort éloigné de penser que tout ce que je viens de rapporter doive diminuer en rien la gloire de M. Aymen. Sa dissertation est des plus savantes, et les connaisseurs la trouvent très-sagement ordonnée. Le public me parait souscrire en tout à la décision de l'académie de Dijon. Il est aisé d'apercevoir que M. Aymen est assez fort pour résister à une sorte de critique dictée par l'estime la moins équivoque, ou plutôt à l'invitation qu'on lui fait de continuer ses travaux sur cette importante matière, et surtout de joindre ses observations particulières aux lumières que son érudition lui fournira. Les amateurs de l'art doivent être bien-aises, qu'il se trouve parmi nous des gens propres à le cultiver sérieusement ; M. Aymen parait être du nombre de ces derniers.
J'ai dit que je ne manquerais pas de parler de la dissertation de M. Normand, médecin de Dole, qui s'est placé de lui-même à côté de M. Aymen. Mais ce n'est point à moi à prendre garde aux motifs qui l'ont porté à faire imprimer son ouvrage ; chacun peut voir dans sa préface le détail de ses raisons, sur lesquelles le journaliste de Trévoux s'est expliqué assez clairement. M. Normand avait quelques doutes, qui ne lui restent apparemment plus depuis la publicité de la dissertation de M. Aymen. Je n'ai qu'un mot à dire sur la raison qu'il a eu d'écrire sa dissertation en latin : c'est, dit-il après Baglivi, de peur d'instruire les cuisinières, et de leur apprendre à disputer avec les Médecins ; linguâ vernaculâ docère mulierculas è culinâ, cum ipsis etiam medicinae principibus arroganter disputare. Ces précautions pourront paraitre usées, et peu nécessaires aujourd'hui. Celse aurait ri sans-doute de ceux qui lui auraient dit qu'il fallait traiter la Médecine en grec dans le sein de Rome.
Quoiqu'il en sait, la dissertation de M. Normand, qui est un petit in -4°. de 19 pages en comptant la préface, est, comme on voit, en latin, et on pourrait la regarder, pour m'exprimer dans la langue favorite de l'auteur, veluti elenchum aliquot Medicinae principum sententiarum : en effet, l'auteur parcourt les Médecins grecs, arabes, et latins ; il en donne une liste, et il prouve qu'ils étaient la plupart attachés au système des crises, ce dont je crois que personne n'a jamais douté. M. Normand parait fort occupé à la lecture des anciens ; c'est pourquoi sans doute il s'arrête parmi les modernes à M. Mead et au docteur Bark : de sorte qu'on ne sait pas si les Vanswieten, les Solano, les Nihell, et bien d'autres, sont encore parvenus jusqu'à Dole.
Au reste M. Normand cite beaucoup d'auteurs ; son ouvrage n'est qu'une chaine de passages et d'autorités. Une partie de la dissertation d'Hoffman, de sato medico et physico, dans laquelle ce médecin rapporte tout ce que l'on a dit des septenaires, fait le premier chapitre de la dissertation de M. Normand. L'auteur termine ce premier chapitre en citant contre Themison disciple d'Asclepiade, et par conséquent fort opposé aux crises, ce vers de Juvenal,
Quot Themison aegros autumno occiderit uno.
Bien des gens pourront penser que cette réflexion n'est pas plus concluante contre Themison, que tous les traits de Moliere contre les Médecins français ; il faut la regarder comme la plaisanterie de ce roi d'Angleterre, qui prétendait que son médecin lui avait tué plus de soldats que les ennemis. Ce sont-là de ces bons mots dont on ne peut jamais se servir sérieusement contre quelqu'un qu'on veut combattre ; ils font honneur à ceux auxquels on les oppose, et on pourrait présumer par le vers seul de Juvénal, que Themison fut un médecin des plus célèbres.
Le deuxième chapitre de la dissertation de M. Normand fait, à proprement parler, le corps de l'ouvrage ; on y trouve la plus pure doctrine des anciens : l'auteur n'y a rien changé. Le troisième chapitre contient des réflexions fort judicieuses sur l'importance des crises et des jours critiques, et sur les différentes voies par lesquelles les crises se font ; il remarque que les jours critiques sont rarement de vingt-quatre heures précises, adaequate. Enfin personne ne disconviendra jamais que cet ouvrage ne puisse être de quelque utilité pour ceux qui travailleront dans la suite sur les crises. Il est fâcheux que l'auteur se soit uniquement livré à l'autorité des anciens, et qu'il n'ait pas rapporté quelques-unes de ses observations particulières, qui n'auraient certainement pas déparé sa dissertation.
On doit se rappeler que j'ai avancé ci-dessus qu'il y avait toujours eu dans la faculté de Paris des médecins attachés aux dogmes de Baillou, de Houllier, de Duret, et de Fernel, qui ont renouvellé dans cette fameuse école les opinions des anciens. Je tire mes preuves, tant des différents ouvrages qui sont entre les mains de tout le monde, que du recueil des thèses dont M. Baron, doyen de la faculté, vient de faire imprimer le catalogue : ce catalogue fait connaître parfaitement la manière de penser des Médecins, et les progrès de leurs opinions. C'est une espèce de chronologie aussi intéressante pour l'histoire de la Médecine, que pour celle de l'esprit humain ; on y découvre les vues précieuses de nos prédécesseurs, et les traces des efforts qu'ils ont faits pour perfectionner notre art et toutes ses branches : c'est-là la source pure des différents systèmes ; ils s'y présentent tels qu'ils furent dans leur naissance. Semblable aux anciens temples dans lesquels on consacrait les observations et les découvertes en Médecine, la faculté de Paris conserve le dépôt sacré que ses illustres membres lui ont confié ; et il serait à souhaiter que toutes celles de l'Europe l'imitassent à cet égard.
Or parmi les thèses trop peu connues, qu'on a soutenues à la faculté, et qui ont quelque rapport au système des crises ; j'en choisis une qui est antérieure à tous les ouvrages des modernes dont je viens de parler, et dans laquelle on trouve la doctrine des crises exposée avec beaucoup de précision et de clarté. Cette thèse a pour titre : An à rectâ crisium doctrinâ et observatione medicina certior ? savoir si la saine doctrine des crises et leurs observations rendent la médecine plus certaine. Année 1741. Elle a été soutenue sous la présidence de M. Murry, qui en est l'auteur ; et on voit qu'elle a beaucoup de rapport avec le programme de l'académie de Dijon.
M. Murry, après avoir fait quelques réflexions sur l'importance de la doctrine des crises, et sur la manière dont elle a été arrêtée et pour ainsi dire ensevelie par les différents systèmes, en fait une exposition tirée d'Hippocrate et de Galien. Il insiste beaucoup après Prosper Martianus et Petrus Castellus, sur la nécessité qu'il y a de ne point compter scrupuleusement les jours naturels dans les maladies ; il fait voir qu'il faut s'en tenir aux redoublements ; et qu'en suivant exactement leur marche, on trouve son compte dans le calcul des anciens : ce qui fournit en effet de très-grands éclaircissements, et qui est conforme à l'avis de Celse, qui était ennemi déclaré des jours critiques. D'ailleurs la thèse dont il est question, est pleine de préceptes sages et de réflexions très-sensées. En un mot, on doit la regarder comme un abrégé parfait de tout ce que les anciens on dit de mieux sur cette matière, et on y trouve bien des remarques qui sont propres à l'auteur.
Cette thèse qui manquait à M. Normand, a beaucoup servi à M. Aymen, qui a eu la précaution de la citer. Il en a tiré notamment trois remarques particulières. En premier lieu, une observation rare faite par M. Murry, et conforme en tout à la loi d'Hippocrate ; cette loi est conçue en ces termes : In febribus ardentibus oculorum distorsio, aut caecitas, aut testium tumores, aut mammarum elevatio, febrem ardentem solvit : " La fièvre ardente peut se terminer par le dérangement du corps des yeux, par la perte de la vue, par une tumeur aux testicules, ou par l'élévation des mammelles ". L'auteur de la thèse a précisément Ve le cas de la tumeur au testicule et de la perte de la vue, et il a cité Hippocrate, dont il a eu le plaisir de confronter la décision avec sa propre observation. La deuxième remarque que M. Aymen a pu extraire de la thèse dont il est question, regarde le docteur Clifton Witringham, qui a observé pendant seize ans les maladies des habitants d'Yorck, et le changement des saisons, qui a découvert que les maladies suivaient exactement les mouvements de la liqueur du baromètre, et qui s'est convaincu que ces maladies étaient semblables à celles de la Grèce. Enfin la troisième observation est une idée très-lumineuse de M. Duverney, médecin de la faculté de Paris, qui soutint dans une thèse en 1719, qu'il y avait beaucoup d'analogie entre la théorie des crises et celle des périodes des maladies ; magnam cum periodis affinitatem habet crisium theoria ; si enim stati sunt morborum decursus, cur non et solutiones ? Ce sont autant de matériaux pour l'éclaircissement de la doctrine des crises.
Il y aurait bien des réflexions à faire sur tous les ouvrages dont je viens de parler ; je les réduis à trois principales. 1°. On ne peut qu'admirer la sagesse de tous ces auteurs modernes, qui se contentent d'admettre la doctrine des crises comme un tissu de phénomènes démontré par l'observation ; ils ne rappellent qu'avec une sorte d'indignation les explications que les anciens ont voulu donner de ces phénomènes ; ils regardent ces explications prétendues comme des romans, ou plutôt comme des rêveries, qui sont autant de taches faites à la pure doctrine d'Hippocrate. Ils ne sont pourtant pas bien d'accord sur l'usage qu'on peut faire de la théorie et des systèmes des nouvelles écoles pour l'explication des crises, et pour en découvrir les causes, vero consentaneum non censui, s'écrie M. Normand, propositum probare ex physicis vel hypotheticis ratiociniis, ut plurimum inconstantibus et incertis : ut ut magis multò pompam redoleant. " Chaque auteur, dit M. Aymen, a bâti selon son idée une hypothèse, et donné un nom ridicule à la cause des crises " ; et il avance bientôt après, que la cause des crises est simple, et qu'elle se présente naturellement. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on est trop avancé aujourd'hui dans la physique du corps humain, pour qu'on ne puisse pas tenter au moins de déterminer si les crises sont possibles, et tâcher de chercher une explication de leur mécanisme. Je ne doute pas que ces efforts ne fissent un bien considerable au fonds de la doctrine des crises, et qu'elle ne reçut un nouvel éclat, si on la présentait de manière à satisfaire l'imagination des Physiciens. Il faut l'avouer, les faits épars et isolés n'ont jamais autant de grâce, surtout pour quiconque n'est pas en droit de douter, que lorsqu'ils sont liés les uns aux autres par un système quel qu'il puisse être. Les systèmes sont la pâture de l'imagination, et l'imagination est toujours de la partie dans les progrès de l'esprit ; elle peint les objets de l'entendement, elle classe ceux de la mémoire. Sinesius et Plotin appelaient la nature magicienne (Gelée, trad. de Dulaurens) : cette dénomination conviendrait mieux à l'imagination. Voilà la grande magicienne qui dirige les têtes les moins ordinaires comme les plus communes ; le nombre des élus qui lui résistent est infiniment petit, il faut qu'il le sait.
M'est-il permis, cela étant, et pour ne rien négliger de ce qui peut servir à bâtir un système, de rappeler ici ce que j'ai placé dans mes recherches anatomiques sur les glandes ? Supposé, ai-je dit, §. 127, que tel organe agisse tous les jours dans le corps, c'est-à-dire, qu'il exerce sa fonction à telle heure précisément, ne pourrait-on pas soupçonner qu'il concourt à produire les phénomènes qu'on observerait dans ce même temps ; et s'il y a des organes dont les actions ou les fonctions se rencontrent de deux en deux ; ou de trois en trois jours, ne pourrait-on pas aussi établir les mêmes soupçons, éclaircir par-là bien des phénomènes dont on a tant parlé, les crises et les jours critiques. et distinguer ce qu'il y a d'imaginaire et de réel sur ces matières ? Ce sont-là des problèmes que je me suis proposé, et dont j'attendrai la résolution de la part de quelque grand physiologiste et médecin qui les trouvera dignes de son attention, jusqu'à ce que je sois en droit de proposer mes idées. Je ne puis m'empêcher de parler d'une prétention d'Hippocrate, qui me parait fort importante : il dit (de morb. lib. IV.) que la coction parfaite des aliments se fait ordinairement en trois jours ; et que la nature suivant les mêmes lois dans les maladies que dans l'état de santé, les redoublements doivent ordinairement être plus forts aux jours impairs. M. Murry tire un grand parti de cette remarque, qui mérite d'être encore examinée avec attention.
Ma deuxième remarque roule sur le fameux passage de Celse, qui accusait les anciens d'avoir été trompés par la philosophie de Pythagore, et d'avoir fondé leur système des jours critiques sur les dogmes de cette école, dans laquelle les nombres, surtout les impairs, jouaient un très-grand rôle. Ce passage porte un coup mortel à la doctrine des crises, il en sappe les fondements ; aussi a-t-il été attaqué vivement par tous les sectateurs des crises, tant anciens que modernes. Genuina Hippocratis praeceptorum traditio, dit M. Murry, Celso non innotuit, cui per tempus non vacabat, aut quem animus non stimulabat, ut medicinae clinicae navaret operam... Celsus ait in praefatione recentiores fateri Hippocratem optime praesagisse, quamvis in curationibus quaedam mutaverint ; " Celse n'a pas eu le temps de s'instruire, surtout par la pratique de la véritable doctrine d'Hippocrate ; et il dit que les médecins de son temps avouaient qu'Hippocrate était fort pour le pronostic ". Ainsi la plupart de tous ceux qui ont parlé de Celse, l'ont accusé de n'être pas praticien, et par conséquent d'être hors d'état de rien statuer sur la matière des crises. Je me suis contenté ci-dessus de révoquer son témoignage particulier en doute, et il me semble que c'est tout ce qu'on peut faire de plus. En effet, quand je vois que Celse prétend, dans le même endroit où il réfute le système des anciens sur le nombre des jours, qu'il faut observer les redoublements et non point les jours, ipsas accessiones intueri debet medicus, cap. IVe lib. III. et que tous les modernes sont obligés d'en revenir à cette façon de calculer, je ne puis m'empêcher d'en conclure qu'il fallait que Celse y eut regardé de bien près, ou du moins qu'il eut reçu des éclaircissements de la part des médecins les mieux instruits. Après tout, si Celse n'a pas été praticien, il est naturel de présumer qu'il s'en est uniquement tenu à la pratique des fameux médecins de son temps ; et ces médecins disciples d'Asclépiade, ne peuvent pas être regardés comme n'ayant point Ve de malades. Ajoutez à tout cela la bonne-foi que Celse et ceux dont il expose le sentiment montrent à l'égard d'Hippocrate : il savait, disent-ils, très-bien former un pronostic, mais nous avons changé quelque chose à sa façon de traiter les maladies ; c'est-à-dire que si Hippocrate avait été à portée d'observer les maladies vénériennes, par exemple, il aurait très-bien su dire après des épreuves réitérées, et en voyant un malade atteint de cette maladie : dans tant de jours le palais sera carié, les os seront exostosés, les cheveux tomberont, et qu'Asclépiade aurait cherché un remède pour arrêter les progrès de la maladie ; lequel vaut le mieux ? Il est donc important de ne pas se décider légèrement contre Celse ; et comme je l'ai déjà remarqué, c'est beaucoup faire que de rester dans le doute sur ses lumières particulières ; mais il sera toujours vrai que les fameux praticiens de son temps étaient de l'avis qu'il expose.
Traisiemement enfin, quels que soient les travaux des modernes que nous venons de citer, quelle que soit leur exactitude, il ne faut pas penser que les anticritiques demeurent sans aucune ressource ; il leur reste toujours bien des raisons qui ont au moins l'air fort spécieuses, pour ne rien avancer de plus. En effet, diront-ils, nous avouons qu'il arrive des crises dans les maladies, et qu'il y a des jours marqués pour les redoublements ; s'ensuit-il delà que cette doctrine puisse avoir quelqu'application dans la pratique ? C'est ici qu'il faut en appeler aux vrais praticiens, à ceux qui sont chargés du traitement des malades : ils ont souvent éprouvé qu'il est pour l'ordinaire impossible de connaître les premiers temps d'une maladie : ils nous apprendront qu'ils sont appelés chaque jour pour calmer de vives douleurs, pour remédier à des symptômes pressants ; que les malades veulent être soulagés, et que les médecins leur deviennent inutiles s'ils prétendent attendre et compter les jours. La marche des crises sera, si l'on veut, aussi-bien réglée et aussi bien connue que la circulation du sang ; en quoi ces connaissances peuvent-elles être utiles ? qui oserait se proposer d'en faire usage ? Il peut être aussi certain qu'il y a des crises, comme il est certain qu'il se fait des changements dans les urines ; on saura l'histoire des crises, comme on sait celle de la transpiration : tout cela n'aboutit après tout, qu'à quelques règles générales que tout le monde sait, et dont personne ne fait usage. Cette doctrine des crises contient de petites vérités de détail, qui ne peuvent frapper que ceux qui ne connaissent pas les maladies par eux-mêmes, et qui cherchent à se faire des règles qui suppléent à leurs lumières. Attendre les crises, compter les redoublements d'une maladie, c'est vouloir connaître les vices des humeurs par le microscope, le degré de fièvre à la faveur d'un thermomètre, ou au moyen d'un pulsiloge ou d'un pendule à pouls, machine puérile, dont l'application serait encore plus puérile, et que les praticiens regarderont toujours comme un ornement gothique, qui ne peut qu'être rebuté par les vrais artistes. Cette précision peut amuser, mais elle n'instruit pas ; elle a l'air de la science, mais elle n'en a pas l'utilité : ce n'est point par des calculs scrupuleux qu'on apprend à juger d'une maladie, et à faire usage des remèdes ; on devient en calculant, timide, temporiseur, indéterminé, et par conséquent moins utîle à la société : la nature a ses lois ; mais on ne les compte pas, on ne saurait les classer.
Le véritable médecin, diront encore les anticritiques, est l'homme de génie qui porte un coup-d'oeil ferme et décidé sur une maladie ; la nature et le grand usage l'ont rendu de concert, propre à se laisser emporter par cette sorte d'enthousiasme, si peu connu des théoriciens : il juge des temps d'une maladie, pour ainsi dire, sans s'en apercevoir ; il peut avoir appris tout ce que la théorie enseigne, mais il n'en fait point usage, il l'oublie, et il se détermine par l'habitude et comme malgré lui ; tel est le praticien. Que la maladie soit organique ou humorale, qu'elle soit un effort salutaire de la nature ou un bouleversement de ses mouvements, que la crise se prépare ou qu'elle se fasse, que le redoublement soit pair ou impair, l'état présent décide le véritable connaisseur, les symptômes le déterminent à se presser ou à attendre ; il vous dira ce malade est mal, et vous devez l'en croire, celui-ci ne risque rien, et l'évenement justifiera pour l'ordinaire son pronostic : si vous lui demandez des raisons, il n'en saurait donner dans bien des occasions ; c'est demander à un peintre pourquoi ce tableau est dans la belle nature, et au musicien les raisons de tous ces accords mélodieux qui enchantent l'oreille. Le praticien qui cherche des raisons peut s'égarer, parce qu'alors son génie ne le guide plus ; les expressions doivent lui manquer, parce que le sentiment ne s'exprime pas ; l'ensemble des symptômes l'a frappé, sans qu'il puisse vous dire comment : apprenez à voir, s'écrie-t-il, veni et vide. Le gout, le talent, et l'expérience, font le praticien ; le goût et le talent ne s'acquièrent pas ; l'habitude et l'expérience peuvent y suppléer jusqu'à un certain point : l'habitude apprend à connaître les maladies et à en juger, comme elle apprend à connaître les physionomies et les couleurs : les règles, quelles qu'elles soient, restent toujours dans l'espace immense des généralités ; et ces généralités qui peuvent, peut-être, être utiles à celui qui apprend l'art, sont certainement très-inutiles pour celui qui l'exerce actuellement ; elles n'enseignent rien de déterminé, rien de réel, rien d'usuel ; inescant, non pascunt. Voyez MEDECINE.
On voit par tout ce que je viens de détailler sur les crises, sur les jours critiques, et sur la manière dont chaque parti soutient son opinion dans cette sorte de controverse, combien elle est importante et épineuse. Je finirai cet article en exhortant tous les médecins qui sont sincèrement attachés aux progrès de l'art, à ne pas négliger les occasions et les moyens d'éclaircir toutes ces questions : il s'agit de savoir et de décider par l'observation, s'il y a des crises dans les maladies, si elles ont des jours déterminés, ou s'il y a des jours vraiement critiques, et d'autres qui ne le sont pas ; si, supposé qu'il y ait des crises, il faut les ménager et les attendre ; si les remèdes dérangent les crises, et comment et jusqu'à quel point ; s'ils les retardent ou s'ils les accélèrent, et quels sont les remèdes les plus propres à produire ces effets, s'il y en a ; s'il y a dans les maladies des jours marqués pour appliquer les remèdes, et d'autres dans lesquels on ne doit rien remuer, nihil movendum ; si, et en quel sens, et jusqu'à quel point il est utîle ou nécessaire de regarder une maladie comme l'effort salutaire de la nature de la machine, ou comme aussi opposée à la vie et à la nature qu'à la santé ; si la sûreté du pronostic d'un médecin qui saurait prévoir les crises, est d'une utilité réelle ; si un praticien sage et expérimenté qui ne connait pas la doctrine des crises, ne sera pas porté, en suivant les symptômes, à agir comme s'il savait l'histoire des crises ; s'il est indifférent d'attendre les crises ou de ne pas les attendre ; enfin si un médecin expectateur ne serait point aussi sujet à se tromper, qu'un médecin actif ou qui se presse un peu.
J'ai dit qu'il faudrait décider tous les problèmes que je viens de proposer par l'observation, ce qui exclud d'abord les idées purement hypothétiques, qui ne sauraient avoir lieu dans des matières de fait : non point qu'il faille renoncer à toute sorte de systèmes pour expliquer les crises ; on peut s'en permettre quelqu'un pour lier les faits et les observations ; ceux qui pourront s'en passer sauront le mettre à part ; mais il en faut au commun des hommes, comme je l'ai remarqué ci-dessus. Le point principal serait que les observations fussent bien faites et bien constatées. Je n'entrerai pas là-dessus dans un détail inutîle et déplacé ; je dirai seulement que j'appellerais une observation constatée, c'est-à-dire, celle sur laquelle on pourrait compter, une observation faite depuis longtemps, rédigée sans aucune vue particulière pour ou contre quelqu'opinion, et présentée avant de la mettre en usage à quelque faculté ou à quelqu'académie. Il serait bon qu'on exigeât des preuves d'observation, et que chaque observateur eut ses journaux à pouvoir communiquer à tout le monde : ces sortes de précautions sont nécessaires, parce qu'on se trompe souvent soi-même, on adopte une opinion quelquefois par hazard ; on se rappelle vaguement tout ce qu'on a Ve de favorable à cette opinion, mais pour le reste, on l'oublie insensiblement. L'observateur ou celui qui pourrait fournir des observations bien faites, ne serait point à ce compte celui qui se contenterait de dire, j'ai vu, j'ai fait, j'ai observé ; formules avilies aujourd'hui par le grand nombre d'aveugles de naissance qui les emploient. Il faudrait que l'observateur put prouver ce qu'il avance par des pièces justificatives, et qu'il démontrât qu'il a Ve et su voir en tel temps ; ce serait le seul moyen de convaincre les Pyrrhoniens, qui n'ont que trop le droit de vous dire où avez-vous vu, comment avez-vous Ve ? et qui plus est encore, de quel droit avez-vous Ve ? de quel droit croyez-vous avoir Ve ? qui vous a dit que vous avez Ve ?
Au reste, quels talents ne devrait pas avoir un bon observateur ? Il ne s'agit point ici seulement d'être entrainé, pour ainsi dire, passivement, comme le praticien, et de recevoir un rayon de cette vive lumière qui accompagne le vrai, et qui force au consentement ; il faut revenir de cet état passif, et peindre exactement l'effet qu'il a produit, c'est-à-dire exprimer clairement ce qu'on a aperçu dans cette sorte d'extase, et l'exprimer par des traits réfléchis, et combinés de manière qu'ils puissent éclairer le lecteur comme la nature le ferait. Tel est l'objet de l'observateur, tel est le talent rare qu'il doit posséder ; talent bien différent de celui du simple praticien, qui n'a que des idées passageres qu'il ne peut pas rendre, et qui se renouvellent au besoin, mais que le besoin seul fait reparaitre, et non la réflexion.
Il est donc évident que l'examen de la doctrine des crises regarde plus particulièrement les médecins au-dessus du commun ; ceux qui se contenteraient de suivre leurs idées, leurs systèmes, et non la nature, ne pourraient que former d'inutiles ou de dangereux romans, fort éloignés du but qu'on doit se proposer. Les observateurs même qui se réduisent à ramasser des faits, sans avoir assez de génie pour distinguer les bons d'avec les mauvais, et pour les lier les uns aux autres, n'en approcheraient pas de plus près. Enfin les praticiens les plus répandus n'ont pas assez de temps à eux ; et il est rare, outre ce que nous en avons dit ci-dessus, qu'ils puissent être atteints, lorsque leur réputation est déjà établie, de la passion de faire des réformes générales dans l'Art. Il faudrait que des observateurs suivissent exactement ces praticiens, et fissent un recueil exact de leurs différentes manœuvres, ainsi que les poètes et les historiens le faisaient autrefois des belles actions des héros.
Quant aux médecins qui sont faits pour enseigner dans les écoles, ils ne sont que trop souvent obligés de s'attacher à un système qui leur vaut toute leur considération. C'est de cette sorte de médecins, très respectables et très-utiles sans-doute, qu'on peut dire avec Hippocrate, unusquisque suae orationi testimonia et conjecturas addit... vincitque hic, modo ille, modo iste, cui potissimum lingua volubilis ad populum contigerit : " Chacun cherche à s'appuyer de conjectures et d'autorités.... l'un terrasse aujourd'hui son adversaire, et il vient à en être terrassé à son tour ; le plus fort est communément celui dont le peuple trouve la langue la mieux pendue ". Ce sont les malheurs de l'état de professeur, qui a bien des avantages d'ailleurs.
En un mot, il est nécessaire pour terminer la question des crises, ou pour l'éclaircir, d'être libre, et initié dans cette sorte de Médecine philosophique ou transcendante, à laquelle il n'est peut-être pas bon que tous les médecins populaires, je veux dire cliniques, s'attachent. En effet on pourrait demander si ces médecins populaires ne sont pas faits la plupart pour copier seulement, ou pour imiter les grands maîtres de l'Art. N'y aurait-il pas à craindre que ces esprits copistes ou imitateurs, qui sont peut-être les plus sages et les meilleurs pour la pratique journalière de la Médecine, ne tombassent dans le pyrrhonisme, si on leur laissait prendre un certain essor ? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on doit chercher parmi eux ce que j'appellerais les témoins des faits particuliers en Médecine ; et il semble qu'il convienne qu'ils soient assujettis à des règles déterminées, tant pour leur propre tranquillité, que pour la sûreté des malades : Sint in memoria tibi morborum curationes et horum modi, et quomodo in singulis se habeant ; hoc enim principium est in Medicina, et medium et finis : " Le commencement, le milieu et la fin de la Médecine, sont de bien savoir le traitement des maladies, et leur histoire ". Voilà ce qu'Hippocrate exigeait de ses disciples. De decenti ornat.
Voilà ce qui regarde les médecins ordinaires, voués à des travaux qui intéressent journellement la société, et dont les services sont d'autant plus précieux qu'ils sont plus réitérés, et qu'ils ne peuvent souffrir aucune sorte de distraction de la part du praticien.
Il y a des questions qui sont réservées pour les législateurs de l'art ; telle est la doctrine des crises. J'appelle un législateur de l'art, le médecin philosophe qui a commencé par être témoin, qui de praticien est devenu grand-observateur, et qui franchissant les bornes ordinaires, s'est élevé au-dessus même de son état. Ouvrez les fastes de la Médecine, comptez ses législateurs. Voyez MEDECIN et MEDECINE.
Cet article a été fourni par M. DE BORDEU docteur de la faculté de Montpellier, et médecin de Paris.
CRISE
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Physique particulière
- Catégorie : Médecine