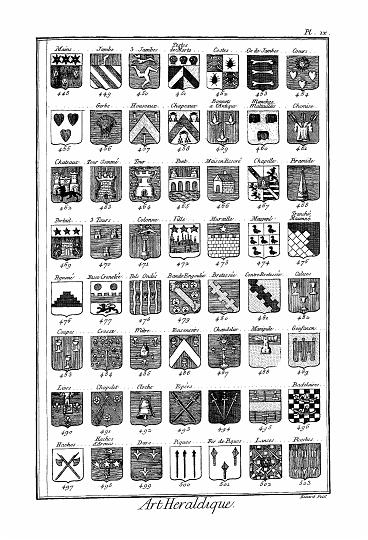frapper, (Grammaire) Battre marque plusieurs coups ; c'est avoir frappé que d'en avoir donné un. On n'est point battu qu'on ne soit frappé ; on est quelquefois frappé sans être battu. Battre suppose toujours de l'intention ; on peut frapper sans le vouloir. Le plus violent frappe le premier ; le plus faible doit être battu. Frapper est toujours un verbe actif ; battre devient neutre dans se battre : car se battre ne signifie point se frapper soi-même de coups redoublés, mais seulement combattre quelqu'un. La loi du prince défend de se battre en duel ; celle de Jesus-Christ défend même de frapper.
BATTRE, en terme de l'Art militaire, signifie attaquer une place, un ouvrage, etc. avec beaucoup d'artillerie. Voyez BATTERIE.
Battre en breche, c'est ruiner avec le canon le revêtement ou le rempart de quelque ouvrage que ce sait, pour y faire une ouverture par laquelle on puisse y entrer.
Battre par camarade, est quand plusieurs pièces de canon tirent tout à la fois sur un même ouvrage, soit d'une même batterie, soit de plusieurs.
Battre en salve : c'est tirer tout à la fois les différentes pièces d'une batterie, avec lesquelles on bat un ouvrage en breche.
Battre en écharpe ; c'est battre un ouvrage sous un angle au plus de 20 degrés.
Battre de bricole ; c'est battre un ouvrage par réflexion, c'est-à-dire faire frapper le boulet à une partie du revêtement, en sorte qu'il puisse se réflechir, et se porter à celle qu'on veut détruire ou incommoder.
Battre en sappe, c'est battre un ouvrage par le pied de son revêtement. (Q)
Battre la chamade. Voyez CHAMADE.
BATTRE la mesure, en Musique ; c'est en marquer les temps par des mouvements de la main ou du pied, qui en règlent la durée, et qui rendent toutes les mesures semblables parfaitement égales en temps.
Il y a des mesures qui ne se battent qu'à un temps, d'autres à deux, à trois, et à quatre qui est le plus grand nombre de temps que puisse renfermer une mesure : encore cette dernière espèce peut-elle toujours se résoudre en deux mesures à deux temps. Dans toutes ces différentes mesures, le temps frappé est toujours sur la note qui suit la barre immédiatement ; celui qui la précède est toujours levé, à moins que la mesure ne soit à un seul temps.
Le degré de lenteur ou de vitesse qu'on donne à la mesure, dépend 1°. de la valeur des notes qui la composent ; on voit bien qu'une mesure qui contient une ronde, doit se battre plus posément et durer davantage que celle qui ne contient que deux croches : 2°. du caractère du mouvement énoncé par le mot François ou Italien, qu'on trouve ordinairement à la tête de l'air. Gravement, gai, vite, lent, etc. sont autant d'avertissements sur les manières de modifier le mouvement d'une espèce de mesure.
Les musiciens français battent la mesure un peu différemment des Italiens : ceux-ci dans la mesure à quatre temps, frappent successivement les deux premiers temps, et lèvent les deux autres ; ils frappent aussi les deux premiers dans la mesure à trois temps, et lèvent le troisième. Les François ne frappent jamais que le premier temps, et marquent les autres par différents mouvements de la main à droite et à gauche : cependant la Musique Française aurait beaucoup plus besoin que l'Italienne d'une mesure bien marquée ; car elle ne porte point sa cadence par elle-même ; le mouvement n'en a aucune précision naturelle, on le presse, on le ralentit au degré du chanteur. Tout le monde est choqué à l'opéra de Paris du bruit desagréable et continuel que fait avec son bâton celui qui bat la mesure. Sans ce bruit personne ne la sentirait : la Musique par elle-même ne la marque point : aussi les étrangers n'aperçoivent-ils presque jamais la mesure dans les mouvements de nos airs. Si l'on y réfléchit bien, on trouvera que c'est ici la différence spécifique de la Musique Française et de l'Italienne. En Italie, la mesure est l'âme de la Musique ; c'est elle qui gouverne le musicien dans l'exécution : en France, c'est le musicien qui gouverne la mesure, et le bon goût consiste à ne la pas même laisser sentir.
Les anciens, dit M. Burette, battaient la Musique en plusieurs façons : la plus ordinaire consistait dans le mouvement du pied, qui s'élevait de terre et la supposait alternativement, selon la mesure des deux temps égaux ou inégaux. (Voyez RYTHME) : c'était ordinairement la fonction du maître de Musique appelé Coryphée, ; parce qu'il était placé au milieu du chœur des musiciens, et dans une situation élevée, pour être Ve et entendu plus facilement de toute la troupe. Ces batteurs de mesure se nommaient en Grec et à cause du bruit de leurs pieds ; , à cause de l'uniformité, et si l'on peut parler ainsi, de la monotonie du rythme qu'ils battaient toujours à deux temps. Ils s'appelaient en Latin pedarii, podarii, pedicularii. Ils garnissaient ordinairement leurs pieds de certaines chaussures ou sandales de bois ou de fer, destinées à rendre la percussion rythmique plus éclatante, et nommée en Grec ; et en Latin pedicula, scabella ou scabilla, à cause qu'ils ressemblaient à de petits marche-piés ou de petites escabelles.
Ils battaient la mesure non-seulement du pied, mais aussi de la main droite, dont ils réunissaient tous les doigts pour frapper dans le creux de la main gauche ; et celui qui marquait ainsi le rythme, s'appelait manuductor. Outre ce claquement de main et le bruit de sandale, les anciens avaient encore pour battre la mesure, celui des coquilles, des écailles d'huitres, et des ossements d'animaux, qu'on frappait l'un contre l'autre, comme on fait aujourd'hui les castagnettes, le triangle, et autres pareils instruments. (S)
BATTRE, a plusieurs sens dans le Manège, où l'on dit qu'un cheval bat à la main ou bégaye, pour marquer un cheval qui n'a pas la tête ferme, qui lève le nez, qui branle et secoue la tête à tout moment en secouant sa bride. Les chevaux turcs et les cravates sont sujets à battre à la main. Un cheval bat à la main, parce qu'ayant les barres trop tranchantes, il ne peut souffrir la sujetion du mors, quelque doux qu'il sait. Pour lui ôter l'envie de battre à la main, et lui affermir la tête, il n'y a qu'à mettre sous sa muserole une petite bande de fer plate et tournée en arc, qui réponde à une martingale. Cet expédient au reste ne fait que suspendre l'habitude ; car la martingale n'est pas plutôt ôtée, que le cheval retombe dans son vice. Voyez MARTINGALE. On dit aussi qu'un cheval bat la poudre ou la poussière, lorsqu'il trépigne ; qu'il fait un pas trop court, et avance peu : ce qui se dit de tous ces temps et mouvements. Un cheval bat la poudre au terre-à-terre, lorsqu'il n'embrasse pas assez de terrain avec les épaules, et qu'il fait tous ses temps trop courts, comme s'il les faisait dans une place. Il bat la poudre aux courbettes, lorsqu'il les hâte trop et les fait trop basses. Il bat la poudre au pas, lorsqu'il Ve un pas trop court, et qu'il avance peu, soit qu'il aille au pas par le droit, ou sur un rond, ou qu'il passege. On dit enfin qu'un cheval bat du flanc, quand il commence à être poussif. Le battement des flancs du cheval est une marque de plusieurs maladies. Battre des flancs, c'est les agiter avec violence. (V)
BATTRE l'eau, terme de Chasse ; quand une bête est dans l'eau, alors on dit aux chiens, il bat l'eau.
Se faire battre, c'est se faire chasser longtemps dans un même canton : on dit, ce chevreuil s'est fait battre longtemps.
* BATTRE, dans les Arts mécaniques, a différentes acceptions : tantôt il se prend pour forger, comme chez presque tous les ouvriers en métaux ; tantôt pour écraser, comme chez presque tous les ouvriers qui emploient, la pierre, les minéraux, les fossiles. On bat le beurre ; Voyez BEURRE. On bat le tan ; voyez TAN. On bat en grange, voyez BATTAGE. On bat des pieux pour les enfoncer ; voyez MOUTON. On bat le papier, l'or, l'argent, les livres, etc. voyez ci-dessous quelques autres significations du même terme, ou quelques-unes des précédentes plus détaillées.
* BATTRE l'or, l'argent, le cuivre (Ordre encyc. Entend. Mém. Histoire Histoire de la Nat. employée, Arts Mécan. Art de battre l'or) c'est l'action de réduire ces métaux en feuilles extrêmement minces, mais plus ou moins cependant, selon le prix qu'on se propose de les vendre : cette action s'appelle batte, et l'ouvrier batteur.
Les opérations principales sont la fonte, la forge, le tirage au moulin, et la batte. On peut appliquer ce que nous allons dire de l'or aux autres métaux ductiles.
L'or qu'on emploie est au plus haut titre, et il est difficîle d'en employer d'autre : l'alliage aigrit l'or, le rend moins ductîle ; et l'ouvrier qui l'allierait s'exposerait à perdre plus par l'inutilité de son travail, qu'il ne gagnerait par le bas aloi de la matière. Les Batteurs d'or le prennent en chaux chez l'affineur de la monnaie, à vingt-quatre carats moins un quart, ou à cent trois livres l'once. Il y en a qui préfèrent à cet or les piastres, et autres anciennes pièces d'Espagne : ils prétendent que même en alliant l'or de ces monnaies il se bat mieux et plus facilement que celui qu'ils sont obligés d'acheter à cent trois livres l'once. Il y a trois sortes d'or en feuille ou battu ; l'or pâle, l'or fin ou verd, et l'or commun. On emploie l'or dans toute sa pureté, et comme il vient de l'affinage dans l'or fin battu : il y a quatre gros de blanc ou d'argent sur l'once d'or, dans l'or pâle ou verd ; et jusqu'à douze grains de rouge, ou de cuivre de rosette, et six grains de blanc ou d'argent dans l'or commun.
On fond l'or dans le creuset avec le borax comme on voit Pl. du Batteur d'or, fig. 1. et quand il a acquis le degré de fusion convenable, on le jette dans la lingotière a, qu'on a eu grand soin de faire chauffer auparavant pour en ôter l'humidité, et de frotter de suif.
Ces précautions sont nécessaires : elles garantissent de deux inconvénients également nuisibles ; l'un en ce que les parties de la matière fondue qui toucheraient l'endroit humide pourraient rejaillir sur l'ouvrier ; l'autre en ce que les particules d'air qui s'insinueraient dans l'effervescence causée par l'humidité entre les particules de la matière, y produiraient de petites loges vides ou soufflures, ce qui rendrait l'ouvrage défectueux. Après la fonte on le fait recuire au feu pour l'adoucir, et en ôter la graisse de la lingotière.
Quand la matière ou le lingot est refroidi, on le tire de la lingotière pour le forger. On le forge sur une enclume b qui a environ trois pouces de large, sur quatre de long, avec un marteau c qu'on appelle marteau à forger ; il est à tête et à panne ; il pese environ trois livres ; sa panne peut avoir un pouce et demi en carré, et son manche six pouces de long. Si l'ouvrier juge que ce marteau ait rendu sa matière écrouie, il la fait encore recuire. d est le bloc de l'enclume.
Ou l'on destine la matière forgée et étirée au marteau à passer au moulin, ou non : si l'on se sert du moulin, il suffira de l'avoir réduite sur l'enclume à l'épaisseur d'environ une ligne et demie, ou deux lignes, au plus. Le moulin est composé d'un banc très-solide, vers le milieu duquel se fixe avec de fortes vis le châssis du moulin : ce châssis est fait de deux jumelles de fer d'un demi-pouce d'épaisseur, sur deux pouces et demi de largeur, et quatorze pouces de hauteur. Ces jumelles sont surmontées d'un couronnement, qui avec la traverse inférieure servent à consolider le tout. Le couronnement et les jumelles sont unis par de longues et fortes vis. Dans les deux jumelles sont enarbrés deux cylindres d'acier, polis, de deux pouces de diamètre, sur deux pouces et demi de longueur ; le supérieur traverse des pièces à coulisses, qui à l'aide d'une vis placée de chaque côté, l'approchent ou l'écartent plus ou moins de l'inférieur, selon que le cas le requiert : l'axe du cylindre inférieur est prolongé de part et d'autre du châssis ; à ses deux extrémités équarries s'adaptent deux manivelles d'un pied et demi de rayon, qui mettent les cylindres en mouvement. Les cylindres mobiles sur leur axe étendent en tournant la matière serrée entre leurs surfaces, et la contraignent de glisser par le mouvement qu'ils ont en sens contraire.
L'artiste se propose deux choses dans le tirage ; la première, d'adoucir les coups de marteau qui avaient rendu la surface du métal inégal et raboteuse ; la seconde, d'étendre en peu de temps le métal très-également. Les ouvriers suppléaient autrefois au moulin par le marteau ; et quelques-uns suivent encore aujourd'hui l'ancienne méthode.
Ceux qui se servent du moulin obtiennent par le moyen de cette machine un long ruban, qu'ils roulent sur une petite latte ; ils le pressent fortement sur la latte, afin qu'il prenne un pli aux deux côtés de la latte, qu'ils retirent ensuite ; et afin que le ruban ne se détortille pas, qu'il conserve son pli aux endroits où il l'a pris, et que les surfaces de ces tours restent bien exactement appliquées les unes sur les autres, ils font deux ligatures qui les contiennent dans cet état, l'une à un bout, et l'autre à l'autre ; ces ligatures sont de petites lanières de peau d'anguille. Cela fait, avec le même marteau qui a servi à forger, ils élargissent la portion du ruban comprise entre les deux ligatures, en chassant la matière avec la panne vers les bords, d'abord d'un des côtés du ruban, puis de l'autre ; ensuite ils frappent sur le milieu pour égaliser l'épaisseur, et augmenter encore la largeur.
Lorsque la portion comprise entre les ligaments est forgée, ils ôtent les ligatures, ils insèrent leurs doigts au milieu des plis, et amènent vers le milieu les portions qui étaient d'un et d'autre côté au-delà des ligatures ; de manière que quand les ligatures sont remises, ce qui est précisément au-delà des ligatures, est la partie forgée qui était auparavant comprise entr'elles ; et que ce qui a été amené entr'elles, est la partie qui n'a pu être forgée, qui formait le pli, et qui était au-delà des ligatures. Il est évident que cette portion doit former une espèce de croissant : on forge cette portion comme la précédente, en commençant par les bords, et s'avançant vers le milieu d'un et d'autre côté, puis forgeant le milieu, jusqu'à ce que le ruban se trouve également épais et large dans toute sa longueur : cette épaisseur est alors à peu près d'une demi-ligne, ou même davantage.
Si l'on ne se sert point du moulin, on forge jusqu'à ce que la matière ait à peu près l'épaisseur d'une forte demi-ligne, puis on la coupe toute de suite en parties qui ont un pouce et demi de long, sur un pouce de large ; ce qu'on ne fait qu'après le tirage au moulin, quand on s'en sert. Ces portions d'un pouce et demi de long sur un pouce de large, et une demi-ligne et davantage d'épais, s'appellent quartiers : on coupe ordinairement cinquante-six quartiers ; l'ouvrier prend entre ses doigts un nombre de ces quartiers, capable de former l'épaisseur d'un pouce ou environ, il les applique exactement les uns sur les autres, et il leur donne la forme carrée sur l'enclume et avec la panne du marteau, commençant à étendre la matière vers les bords, s'avançant ensuite vers le milieu, en faisant autant à l'autre côté, forgeant ensuite le milieu, et réduisant par cette manière de forger réitérée tous les quartiers du même paquet, et tous à la fais, à l'épaisseur d'une feuille de papier gris, et à la dimension d'un carré dont le côté aurait deux pouces.
Lorsque l'or est dans cet état, on prend des feuillets de vélin, on en place deux entre chaque quartier ; ainsi pour cela seul les cinquante-six quartiers exigent cent douze feuillets de vélin : mais il en faut encore d'autres qu'on met à vide en-dessus et en-dessous ; et sur ces feuillets vides, tant en-dessus qu'en-dessous, on met encore deux feuillets de parchemin. Cet assemblage s'appelle le premier caucher ; et les feuillets vides, avec les feuillets de parchemin ou sans eux, s'appellent emplures. Ainsi voici donc la disposition et l'ordre du premier caucher, deux feuillets de parchemin, une vingtaine plus ou moins de feuillets de vélin vides ; un quartier, deux feuillets de vélin ; un quartier, deux feuillets de vélin ; et ainsi de suite jusqu'à la concurrence de cinquante-six quartiers, une vingtaine de feuillets de vélin vides, et deux feuillets de parchemin. L'usage des emplures est d'amortir l'action des coups de marteau sur les premiers quartiers, et de garantir les outils. Les Batteurs d'or entendent par les outils l'assemblage des feuillets de vélin. Le caucher se couvre de deux fourreaux ; le fourreau est une enveloppe de plusieurs feuillets de parchemin appliqués les uns sur les autres, et collés par les deux bouts, de manière qu'ils forment une espèce de sac ouvert. On a deux fourreaux ; quand on a mis le caucher dans un, on fait entrer le caucher et ce premier fourreau dans le second, mais en sens contraire : d'où il arrive que quoique les fourreaux soient tous les deux ouverts, cependant ils couvrent partout le caucher. V. fig. 6. un caucher, et fig. 7. et 8. les fourreaux. Mettre les fourreaux au caucher, cela s'appelle enfourer. Les feuillets de vélin et de parchemin sont des carrés dont le côté a quatre pouces.
Le caucher ainsi arrangé, on le bat sur un marbre, comme on voit fig. 2. ce marbre est noir ; il a un pied en carré, et un pied et demi de haut. On ajuste à sa partie supérieure une espèce de boite F, ouverte du côté de l'ouvrier : cette boite s'appelle la caisse ; elle est faite de sapin, et revêtue en-dedans de parchemin collé : le parchemin collé qui s'étend jusque sur le marbre, n'en laisse apercevoir au milieu de la caisse que la portion e. La caisse est embrassée du côté de l'ouvrier par la peau h que l'ouvrier relève sur lui, et dont il se fait un tablier. Quand il travaille, cette peau ou tablier reçoit les lavures. On entend par les lavures, les parties de matière qui se détachent d'elles-mêmes, ou qu'on détache des cauchers.
Comme l'action continuelle d'un marteau de douze à quinze livres sur une masse de pierre d'un poids énorme, ne manquerait pas d'ébranler à la longue les voutes d'une cave, s'il s'en trouvait une immédiatement au-dessous ; dans ce cas, il est prudent de l'étayer, soit par une forte pièce de bois, soit par un massif de pierre, placé sous l'endroit qui correspond au marbre du batteur d'or.
Il faut que la surface du marbre et du marteau soit fort unie, sans quoi les caucher ou outils, et les feuilles d'or seraient maculées. On bat le premier caucher pendant une demi-heure, en chassant du centre à la circonférence, le retournant de temps en temps, et appliquant au marbre la surface sur laquelle on frappait, et frappant sur l'autre. Le marteau dont on se sert dans cette opération s'appelle marteau plat, ou à dégrossir : il pese quatorze à quinze livres ; sa tête est ronde et tant soit peu convexe : il a six pouces de haut, et Ve depuis sa tête jusqu'à son autre extrémité un peu en diminuant, ce qui le fait paraitre cone tronqué : sa tête a cinq pouces de diamètre ou environ. L'ouvrier a l'attention de défourrer de temps en temps son caucher, et d'examiner en quel état sont les quartiers. Il ne faut pas espérer qu'ils s'étendent tous également ; il en trouvera qui n'occuperont qu'une partie de l'étendue du feuillet de vélin ; d'autres qui l'occuperont toute entière ; d'autres qui déborderont : il pourra, s'il le veut, ôter les avant-derniers, et il fera bien d'ôter les derniers : il est évident qu'après cette soustraction le caucher sera moins épais. Mais on empêchera les fourreaux d'être lâches, en insérant des petits morceaux de bois dans les côtés, entr'eux et le caucher.
On continuera de battre jusqu'à ce qu'on ait amené les quartiers restants à l'étendue ou environ des feuillets de vélin qui les séparent : cela fait, la première opération de la batte sera finie. Si on laissait desafleurer les quartiers au-delà des outils, ceux-ci pourraient être gâtés.
Au sortir du premier caucher les quartiers sont partagés en quatre parties égales avec le ciseau. On a donc deux cent vingt-quatre nouveaux quartiers, dont on forme un second caucher de la manière suivante : on met deux feuillets de parchemin, une douzaine de feuillets de vélin vides ou d'emplures ; un quartier, un feuillet de vélin, un quartier, un feuillet de vélin ; et ainsi de suite jusqu'à cent douze inclusivement : une douzaine d'emplures, deux feuillets de parchemin ; deux autres feuillets de parchemin, une douzaine d'emplures ; un quartier, un feuillet de vélin ; un quartier, un feuillet de vélin ; et ainsi de suite jusqu'à cent douze inclusivement, douze emplures et deux feuillets de vélin.
D'où l'on voit que le second caucher est double du premier, et qu'il est séparé par le milieu en deux parts distinguées par quatre feuillets de parchemin, dont deux finissent la première part, et lui appartiennent, et deux appartiennent à la seconde part, et la commencent : en un mot il y a dans le milieu du second caucher quatre feuillets de parchemin entre vingt-quatre emplures de vélin, douze d'un côté et douze de l'autre. Au reste, il n'y a pas d'autre différence entre le premier caucher et le second : il a ses deux fourreaux aussi, il ne s'enfourre pas différemment, et les feuillets de vélin sont de la même forme et de la même grandeur.
Ce second caucher enfourré comme le premier, on le bat de la même manière, avec le même marteau, et pendant le même temps que le premier : observant non-seulement d'opposer tantôt une des faces, tantôt l'autre au marteau et au marbre : au marbre celle qui vient d'être opposée au marteau et au marteau celle qui vient d'être opposée au marbre : mais encore de défourrer de temps en temps, de séparer les deux parts du caucher, afin de mettre en-dedans la face de l'une et de l'autre part qui était en-dehors, et en-dehors celle qui était en-dedans ; et d'examiner attentivement quand les quartiers desafleurent les outils : lorsque les quartiers desafleurent les outils, alors la seconde opération sera finie.
On desemplit le second caucher ; pour cet effet, on a à côté de soi le caucher même : on écarte les deux parchemins et les emplures ; on prend la première feuille d'or que l'on rencontre, et on l'étend sur un coussin, on enlève le second feuillet de vélin, et l'on prend la seconde feuille d'or qu'on pose sur la première ; mais de manière que la seconde soit plus reculée vers la gauche que la première : on ôte un autre feuillet de vélin, et l'on prend une troisième feuille d'or que l'on étend sur la seconde, de manière que cette troisième soit plus avancée vers la droite que la seconde : en un mot, on range les feuilles en échelle ; on fait en sorte qu'elles ne se débordent point en-haut, mais qu'elles se débordent toutes à droite et à gauche d'un demi-pouce ou environ ; puis avec un couteau d'acier, émoussé par le bout, et à l'aide d'une pince de bois leger qu'on voit fig. 10. on les prend toutes quatre à quatre, et on les coupe en quatre parties égales ; ce qui donne huit cent quatre vingt-seize feuilles.
Quand cette division est faite, voici comment on arrange ces huit cent quatre-vingt-seize feuilles : on laisse-là les feuillets de vélin ; on en prend d'une autre matière qu'on appelle baudruche, et dont nous parlerons plus bas ; on met deux feuillets de parchemin, quinze emplures de baudruche, une feuille d'or, un feuillet de baudruche ; une feuille d'or, un feuillet de baudruche, et ainsi de suite jusqu'à quatre cent quarante-huit inclusivement ; puis quinze emplures, puis deux feuillets de parchemin ; puis encore deux feuillets de parchemin, puis quinze emplures ; puis une feuille d'or, puis un feuillet de baudruche, puis une feuille d'or, puis un feuillet de baudruche, et ainsi de suite, jusqu'à quatre cent quarante-huit inclusivement, puis quinze emplures de baudruche, et enfin deux feuillets de parchemin, cet assemblage s'appelle chaudret.
D'où l'on voit que le chaudret, ainsi que le second caucher, est divisé en deux parts au milieu, dans l'endroit où il se rencontre quatre feuillets de parchemin, dont deux appartiennent à la première part du chaudret, et la finissent, et deux à la seconde part, et la commencent.
Le feuillet du chaudret a environ cinq pouces en carré ; il est de baudruche, matière bien plus déliée et bien plus fine que le vélin ; c'est une pellicule que les Bouchers ou les Boyaudiers enlèvent de dessus le boyau du bœuf : deux de ces pellicules minces collées l'une sur l'autre, forment ce qu'on appelle le feuillet de baudruche ; et ces feuillets de baudruche et de parchemin, disposés comme nous venons de le prescrire, forment le chaudret ; le chaudret s'enfourre comme les cauchers.
On bat environ deux heures le chaudret : le marseau est le même que celui des cauchers ; on observe en le battant tout ce qu'on a observé en battant le second caucher ; je veux dire de défourrer de temps en temps, d'examiner si les feuilles d'or desafleurent ou non ; de mettre en-dedans les faces des deux parts qui sont en-dehors, et celles qui sont en-dehors, de les mettre en-dedans ; de battre selon l'art, en chassant du centre à la circonférence etc. Lorsqu'on s'aperçoit que toutes les feuilles desafleurent, la troisième opération est finie.
Alors on prend le chaudret défourré avec une tenaille a b c, qu'on voit figure 9. on sert le chaudret par un de ses angles, entre les extrémités a de la tenaille, on empêche la tenaille de se desserrer, en contraignant une de ses branches e, d'entrer dans un des trous de la plaque Xe attachée à l'autre branche b ; on a à côté de soi un coussin d'un pied de large, sur deux pieds et demi à trois pieds de long, couvert de peau de veau, comme on le voit en 1, 2, fig. 3 ; on lève les feuillets de baudruche de la main gauche ; et de la droite, on enlève avec une pince de bois qu'on voit figure 10. les feuilles d'or ; on les rogne avec un couteau d'acier, et on les range par échelle sur le coussin ; on les divise en quatre parties égales ; ce qui donne quatre fois huit cent quatre-vingt-seize feuilles d'or : on divise ce nombre de quatre fois huit cent quatre-vingt-seize feuilles en quatre portions d'environ huit cent feuilles chacune, et l'on arrange ces huit cent feuilles d'or de la manière suivante, afin de continuer le travail.
On prend deux feuillets de parchemin, vingt-cinq emplures de baudruche, une feuille d'or, un feuillet de baudruche ; une feuille d'or, un feuillet de baudruche, et ainsi de suite, jusqu'à huit cent inclusivement, puis vingt-cinq emplures, et enfin deux feuilles de parchemin. Cet assemblage forme ce qu'on appelle une moule ; les divisions du chaudret en quatre donnent de quoi former quatre moules qui se travaillent l'une après l'autre, et séparément.
La feuille de la moule a six pouces en carré, comme disent les ouvriers très-improprement, c'est-à-dire a la forme d'un carré, dont le côté a six pouces ; on l'enfourre, et on la bat plus ou moins de temps ; cela dépend de plusieurs causes ; de la disposition des outils, de la température de l'air, et de la diligence de l'ouvrier : il y a des ouvriers qui battent jusqu'à deux moules par jour. Chaque moule ne contient que huit cent feuilles d'or, quoiqu'il dû. y en avoir quatre fois huit cent quatre-vingt-seize pour les quatre ; ce qui fait plus de huit cent pour chacune : mais partie de cet excédent s'est brisé dans la batte, quand il est arrivé que la matière était aigre, ou qu'elle n'était pas assez épaisse pour fournir à l'extension ; partie a été employée à étouper les autres. On appelle étouper une feuille, appliquer une pièce à l'endroit faible où elle manque d'étoffe.
C'est ici le lieu d'observer qu'il importait assez peu que les cinquante-six premiers quartiers qui ont fourni un si grand nombre de feuilles, fussent un peu plus forts ou un peu plus faibles les uns que les autres ; la batte les réduit nécessairement à la même épaisseur : la seule différence qu'il y ait, c'est que dans le cours des opérations, les forts desafleurent beaucoup plus que les faibles.
On commence à battre la moule avec le marteau rond qui pese six à sept livres, qui porte quatre pouces de diamètre à la tête, et qui est un peu plus convexe qu'aucun de ceux dont on s'est servi pour les cauchers et le chaudret, il s'appelle marteau à commencer ; on s'en sert pendant quatre heures ; on lui fait succéder un second marteau qui pese quatre à cinq livres, qui porte deux pouces de diamètre à la tête, et qui est encore plus convexe que les précédents ; on l'appelle marteau à chasser, et l'on s'en sert pendant une demi-heure ; on reprend ensuite le marteau à commencer ; on revient au marteau à chasser, dont on se sert pendant encore une demi-heure, et l'on passe enfin au marteau à achever. Le marteau à achever porte quatre pouces de diamètre à la tête, est plus convexe qu'aucun des précédents, et pese douze à treize livres. On a eu raison de l'appeler marteau à achever ; car c'est en effet par lui que finit la batte.
On observe aussi pendant la batte de la moule, de la frapper tantôt sur une face, tantôt sur une autre ; de défourrer de temps en temps, et d'examiner si les feuilles desafleurent : quand elles desafleurent toutes, la batte est finie. Il ne s'agit plus que de tirer l'or battu d'entre les feuillets de la moule, et c'est ce que fait la fig. 3. et de les placer dans les quarterons.
Pour cet effet, on se sert de la tenaille de la fig. 9. on serre avec elle la moule par l'angle, et l'on en sort les feuilles battues les unes avec les autres, à l'aide de la pince de bois de la fig. 10. on les pose sur le coussin ; on souffle dessus pour les étendre, on prend le couteau de la fig. 11. fait d'un morceau de roseau 5 ; on coupe un morceau de la feuille en ligne droite ; ce côté de la feuille qui est coupé en ligne droite, se met exactement au fond du livret et du quarteron ; que la feuille déborde de tous les autres côtés ; on continue de remplir ainsi le quarteron ; quand il est plein, on en prend un autre, et ainsi de suite. Lorsque la moule est vide, on prend un couteau, et l'on enlève tout l'excédent des feuilles d'or qui parait hors des quarterons ou livrets ; et l'on emporte ce que le couteau a laissé, avec un morceau de linge qu'on appelle frottoir.
Les quarterons dont on voit un, fig. 5. sont des livrets de vingt-cinq feuillets carrés ; il y en a de deux sortes : les uns, dont le côté est de quatre pouces ; d'autres, dont le côté n'est que de trois pouces et demi. Un livret d'or dont le côté est de quatre pouces, se vend quarante sous ; un livret pareil d'argent, se vend six sous.
Quatre onces d'or donnent les cinquante-six quartiers avec lesquels on a commencé le travail. Il y a eu dans le cours du travail, tant en lavures qu'en rognures ou autrement, dix-sept gros de déchet. Ainsi quatre onces moins dix-sept gros, pourraient fournir trois mille deux cent feuilles carrées, chacune de trente-six pouces de surface : mais elles ne les donnent que de 16 pouces en carré ; car les feuilles qui sortent de la moule de 36 pouces en carré, s'enferment dans un quarteron de 16 pouces en carré. Ainsi l'on ne couvrirait qu'une surface de 41200 pouces carrés, avec quatre onces d'or moins dix-sept gros, ou deux onces un gros : mais on en pourrait couvrir une de 115200 pouces carrés.
Pour avoir de bons cauchers, il faut choisir le meilleur vélin, le plus fin, le plus serré et le plus uni. Il n'y a pas d'autre préparation à lui donner, que de le bien laver dans de l'eau froide, de le laisser sécher à l'air, et de le passer au brun ; on verra plus bas ce que c'est que le brun.
Quand à la baudruche, ou à cette pellicule qui se lève de dessus le boyau de bœuf, c'est autre chose : elle vient d'abord pleine d'inégalités et couverte de graisse ; on enlève les inégalités en passant légèrement sur sa surface le tranchant mousse d'un couteau. Pour cet effet on la colle sur les montants verticaux d'une espèce de chevalet ; le même instrument emporte aussi la graisse. Quand elle est bien égale et bien dégraissée, on l'humecte avec un peu d'eau ; et l'on applique l'une sur l'autre deux peaux de baudruche humides. L'humidité suffit pour les unir indivisiblement. Le batteur d'or paye soixante-quinze livres les huit cent feuilles ; cela est cher, mais elles durent : quatre mois, six mois, huit mois de travail continu les fatiguent, mais ne les usent point.
Avant que de les employer, le Batteur d'or leur donne deux préparations principales : l'une s'appelle le fond, et l'autre consiste à les faire suer. Il commence par celle-ci ; elle consiste à en exprimer ce qui peut y rester de graisse. Pour cet effet, il met chaque feuille de baudruche entre deux feuillets de papier blanc ; il en fait un assemblage considérable, qu'il bat à grands coups de marteau. L'effort du marteau en fait sortir la graisse, dont le papier se charge à l'instant. Donner le fond aux feuilles de baudruche, c'est les humecter avec une éponge, d'une infusion de canelle, de muscade, et autres ingrédiens chauds et aromatiques ; l'effet de ce fond est de les consolider, et d'en resserrer les parties. Quand on leur a donné le fond une première fais, on les laisse sécher à l'air, et on le leur donne une seconde fois ; quand elles sont seches, on les met à la presse et on les emploie.
Les Batteurs donnent en général le nom d'outils aux assemblages, soit de vélin, soit de baudruche : et quand ces assemblages ont beaucoup travaillé, ils disent qu'ils sont las ; alors ils cessent de s'en servir. Ils ont de grandes feuilles de papier blanc qu'ils humectent, les uns de vinaigre, les autres de vin blanc. Ils prennent les feuillets de baudruche las ; il les mettent feuillets à feuillets entre les feuilles de papier blanc préparées ; ils les y laissent pendant trois ou quatre heures : quand ils s'aperçoivent qu'ils ont assez pris de l'humidité des papiers blancs, ils les en retirent et les distribuent dans un outil de parchemin, dont chaque feuillet est un carré, dont le côté a douze pouces. Ils appellent cet outil plane. Pour faire sécher les feuillets de baudruche enfermés entre ceux de la plane ils battent avec le marteau la plane pendant un jour : puis ils les brunissent, ou donnent le brun ; c'est-à-dire, qu'ils prennent du gypse ou de ce fossîle qu'on appelle miroir d'âne, qu'on tire des carrières de plâtre ; qu'ils le font calciner, qu'ils le broyent bien menu, et qu'avec une patte de lièvre, ils en répandent sur les feuillets de baudruche d'un et d'autre côté.
Le brun se donne aussi aux outils de vélin.
Il faut que les outils de baudruche soient pressés et séchés toutes les fois qu'on s'en sert ; sans quoi l'humidité de l'air qu'ils pompent avec une extrême facilité, rendrait le travail pénible. Il ne faut pourtant pas les faire trop sécher ; la baudruche trop seche est perdue.
On a pour presser et sécher en même temps la baudruche, un instrument tel qu'on le voit fig. 4. La partie M N O P peut contenir du feu : c'est une espèce de vaisseau de fer ; le fond q est une plaque de fer : ce vaisseau et sa plaque peuvent se baisser et se hausser en vertu de la vis t u ; la bride a b c est fixe sur la plaque inférieure q r s : on insere entre ces plaques les outils enfermés entre deux voliches ; on serre la presse : on met du feu dans le vaisseau supérieur, dont la plaque m n o p fait le fond ; et l'on pose la plaque inférieure q r s, sur une poêle pleine de charbons ardents : les outils se trouvent par ce moyen entre deux feux.
Quant aux outils de vélin, quand ils sont très-humides, on les répand sur un tambour ; c'est une boite faite comme celle où l'on enfermerait une chaufrette, avec cette différence qu'elle est beaucoup plus grande et plus haute ; et qu'au lieu d'une planche percée, sa partie supérieure est grillée avec du fil d'archal ; on étend les feuillets de vélin sur cette grille, et l'on met du feu dans le tambour.
Il parait que les Romains ont possédé l'art d'étendre l'or : mais il n'est pas aussi certain qu'ils l'aient poussé jusqu'au point où nous le possédons. Pline rapporte que dans Rome on ne commença à dorer les planchers des maisons, qu'après la ruine de Carthage, lorsque Lucius Mummius était censeur ; que les lambris du capitole furent les premiers qu'on dora : mais que dans la suite le luxe prit de si grands accroissements, que les particuliers firent dorer les plats-fonds et les murs de leurs appartements.
Le même auteur nous apprend qu'ils ne tiraient d'une once d'or que cinq à six cent feuilles de quatre doigts en carré ; que les plus épaisses s'appelaient bracteae praenestinae, parce qu'il y avait à Preneste une statue de la Fortune, qui était dorée de ces feuilles épaisses ; et que les feuilles de moindre épaisseur se nommaient, bracteae quaestoriae. Il ajoute qu'on pouvait tirer un plus grand nombre de feuilles que celui qu'il a désigné.
Il était difficîle d'assujettir les Batteurs d'or à la marque. La nature de leur ouvrage ne permet pas de prendre cette précaution contre l'envie qu'ils pourraient avoir de tromper, en chargeant l'or qu'ils emploient, de beaucoup d'alliage : mais heureusement l'art même y a pourvu, car l'or se travaillant avec d'autant plus de facilité, et ayant d'autant plus de ductilité, qu'il est plus pur, ils perdent du côté du temps et de la quantité d'ouvrage, ce qu'ils peuvent gagner sur la matière, et peut-être même perdent-ils davantage. Leur communauté paye mille écus à la monnaie pour ce droit de marque.
Quoiqu'il ne s'agisse que de battre, cette opération n'est pas aussi facîle qu'elle le parait ; et il y a peu d'arts ou le savoir-faire soit si sensible ; tel habîle ouvrier fait plus d'ouvrage et plus de bon ouvrage en un jour, qu'un autre ouvrier n'en fait de mauvais en un jour et demi.
Cependant le meilleur ouvrier peut avoir contre lui la température de l'air, dans les temps pluvieux, humides : pendant les hivers nébuleux, les vélins et les baudruches s'humectent, deviennent molles, et rendent le travail très-pénible. C'est à la Physique à chercher un remède à cet inconvénient.
Il ne me reste plus qu'une observation à faire, c'est sur la découverte de la baudruche. Comment les hommes se sont-ils avisés d'aller chercher sur le boyau du bœuf cette pellicule déliée, sans laquelle ils auraient eu bien de la peine à étendre l'or ? Ce ne sont surement pas des considérations philosophiques qui les ont conduits là. La baudruche était-elle trouvée avant qu'on l'employât à cet usage ; ou bien est-ce le besoin qu'on en avait qui l'a fait chercher ?
BATTRE, en termes de Cardeur de laine, c'est préparer la laine pour être huilée, en la secouant sur une claie avec des baguettes, pour en ôter la poussière.
BATTRE, en termes de Filassier, c'est écraser et adoucir la filasse à coups de maillet de bois.
BATTRE une allée, c'est après qu'elle est réglée, en affermir la terre avec la batte, pour la recouvrir ensuite de sable.
BATTRE LA CHAUDE, terme d'ancien monnayage : avant la découverte du laminoir, on battait les lingots d'or, d'argent, etc. sur l'enclume à grands coups de marteau, après avoir été retirés du moule ; ensuite on les donnait aux ouvriers afin de recevoir les préparations nécessaires pour être empreints.
BATTRE, en termes de Potier, c'est étendre à la main un creuset, par exemple, sur son moule. Voyez MOULE.
BATTRE DU PAPIER, terme de Papetier, signifie l'aplatir, et le rendre uni en le battant sur la pierre avec un marteau pesant, dont le manche est court et la masse large. Voyez PAPIER.
Dans les manufactures de papier, on se sert pour battre le papier et le lisser, d'un marteau, ou plutôt d'une grosse masse de bois B fort pesante, emmanchée d'un long manche C aussi de bois, auquel l'arbre de la roue du moulin à papier, donne le mouvement par le moyen de plusieurs leviers ou morceaux de bois, qui sortent de cet arbre, et qui appuient sur l'extrémité du manche du marteau : l'ouvrier A est assis dans un creux, afin d'avoir les mains de niveau à la pierre D, sur laquelle il change le papier continuellement de place, pour le faire battre également partout ; il a autour de lui différentes piles de papier G G G, desquelles les unes sont le papier qu'il a retiré de dessous le marteau, et les autres celui qu'il doit y mettre.
BATTRE les livres pour les relier : le batteur doit tenir de la main droite un marteau pesant environ neuf à dix livres, et de la main gauche une partie du livre, que l'on nomme une battée, tel que Planc. première du Relieur, figure A. Son ouvrage est d'aplatir les feuilles du livre avec art, pour que le livre soit facîle à s'ouvrir. Il y a des papiers fort difficiles à unir.
BATTRE les cartons ; on bat sur la pierre à battre les cartons quand ils sont attachés au volume, pour en applanir toutes les inégalités.
BATTRE les ficelles : lorsque les ficelles sont passées dans les cartons, on en aplatit les bouts avec le marteau à endosser sur la pierre à parer, pour éviter qu'elles fassent de l'élévation sous la couverture. On dit aussi rabaisser les ficelles.
BATTRE les plats : lorsque le livre est marbré sur le plat et que la couleur est seche, on bat le plat sur la pierre à battre avec le marteau à battre pour mieux effacer toutes les inégalités, s'il en est resté, et pour renforcer la couverture.
BATTRE devant, se dit chez les ouvriers qui s'occupent à battre un morceau de fer sur l'enclume, de ceux qui aident le forgeron avec de gros marteaux et qui sont placés devant lui ou à ses côtés.
BATTRE du tan ; terme de Tanneur, qui signifie concasser de l'écorce de chêne dans des mortiers, ou la faire réduire en poudre sous les pilons d'un moulin. Voyez TAN.
BATTRE une dame au jeu du revertier, c'est mettre une dame sur la même flèche où était placée celle de son adversaire. Quand toutes les dames sont battues hors du jeu, on ne peut plus jouer, à moins qu'on ne les ait toutes rentrées.
* BATTRE au trictrac, c'est en comptant de la droite à la gauche les points amenés par les dés, tomber de la flèche la plus voisine d'une de ses dames, sur une flèche de son adversaire où il n'y ait qu'une dame, cette dame découverte est battue, si le dernier point d'un des dés ou de tous les deux tombe sur elle.
On peut battre de trois façons ; d'un dé, de l'autre, et des deux ensemble.
On bat par doublets, lorsqu'on a amené le même point des deux dés, comme deux quatre, deux cinq, etc.
On bat à faux, lorsqu'en comptant les points amenés par les deux dés, le dernier point de l'un et de l'autre des dés tombe sur une flèche de l'adversaire couverte de deux dames.
On gagne sur une dame battue simplement et d'une façon, dans le grand jan, deux points ; de deux façons, quatre ; de trois façons, six.
On gagne sur une dame battue par doublets dans le grand jan, quatre points ; six dans le petit jan.
Quand on bat à faux, on perd ce qu'on eut gagné en battant bien.
On bat le coin comme une dame, quand on a le sien et que l'adversaire ne l'a pas.
On bat les deux coins quand on n'a que deux dames abattues, et que les points amenés par l'un et l'autre dés tombent tous les deux sur le coin.
On gagne quatre points quand on bat le coin ou les deux coins simplement ; six quand on les bat par doublets.
On en perd autant si on bat le coin à faux ; ce qui arrive quand on n'a que deux dames abattues, et que l'adversaire a son coin.
Il y a encore d'autres manières de battre. Voyez TRICTRAC, DAME FLECHE, etc.