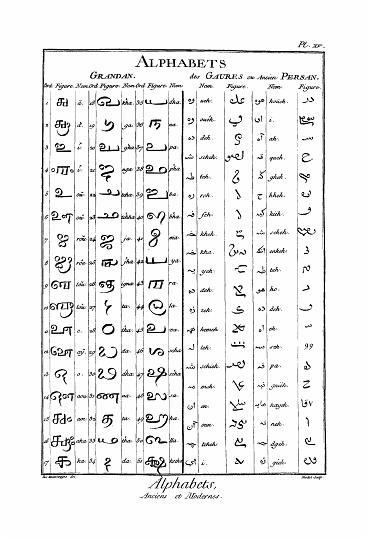adj. (Grammaire) mot composé de la préposition grecque , cùm, et du mot , nomen : de là , cognominatio, et , cognominans ; en sorte que vocabula synonyma sunt diversa ejusdem rei nomina. C'est la première idée que l'on s'est faite des synonymes, et peut-être la seule qu'en aient eu anciennement le plus grand nombre des gens de lettres. Une sorte de dictionnaire que l'on met dans les mains des écoliers qui fréquentent nos collèges, et que l'on connait sous le nom général de synonymes, ou sous les noms particuliers de Regia Parnassi, de Gradus ad Parnassum, etc. est fort propre à perpétuer cette idée dans toutes les têtes qui tiennent pour irréformable ce qu'elles ont appris de leurs maîtres. Que faut-il penser de cette opinion ? Nous allons l'apprendre de M. l'abbé Girard, celui de nos grammairiens qui a acquis le plus de droit de prononcer sur cette matière.
" Pour acquérir la justesse, dit-il, (synonymes franç. préf. page x.) il faut se rendre un peu difficîle sur les mots, ne point s'imaginer que ceux qu'on nomme synonymes, le soient dans toute la rigueur d'une ressemblance parfaite, en sorte que le sens soit aussi uniforme entr'eux que l'est la saveur entre les gouttes d'eau d'une même source ; car en les considérant de près, on verra que cette ressemblance n'embrasse pas toute l'étendue et la force de la signification, qu'elle ne consiste que dans une idée principale, que tous énoncent, mais que chacun diversifie à sa manière par une idée accessoire qui lui constitue un caractère propre et singulier. La ressemblance que produit l'idée générale, fait donc les mots synonymes ; et la différence qui vient de l'idée particulière qui accompagne la générale, fait qu'ils ne le sont pas parfaitement, et qu'on les distingue comme les diverses nuances d'une même couleur ".
La notion que donne ici des synonymes cet excellent académicien, il l'a justifiée amplement dans l'ouvrage ingénieux qu'il a fait exprès sur cette matière, dont la première édition était intitulée, justesse de la langue française, à Paris, chez d'Houry 1718, et dont la dernière édition est connue sous le nom de synonymes français, à Paris, chez la veuve d'Houry, 1741.
On ne saurait lire son livre sans désirer ardemment qu'il y eut examiné un plus grand nombre de synonymes, et que les gens de lettres qui sont en état d'entrer dans les vues fines et délicates de cet ingénieux écrivain, voulussent bien concourir à la perfection de l'édifice dont il a en quelque manière posé les premiers fondements. Je l'ai déjà dit ailleurs : il en résulterait quelque jour un excellent dictionnaire, ouvrage d'autant plus important, que l'on doit regarder la justesse du langage non-seulement comme une source d'agréments, mais encore comme l'un des moyens les plus propres à faciliter l'intelligence et la communication de la vérité. Les chefs-d'œuvres immortels des anciens sont parvenus jusqu'à nous ; nous les entendons, nous les admirons même ; mais combien de beautés réelles y sont entièrement perdues pour nous, parce que nous ne connaissons pas toutes ces nuances fines qui caractérisent le choix qu'ils ont fait et dû faire des mots de leur langue ! Combien par conséquent ne perdons-nous pas de sentiments agréables et délicieux, de plaisirs réels ! Combien de moyens d'apprécier ces auteurs, et de leur payer le juste tribut de notre admiration ! Nous n'avons qu'à juger par-là de l'intérêt que nous pouvons avoir nous-mêmes à constater dans le plus grand détail l'état actuel de notre langue, et à en assurer l'intelligence aux siècles à venir, nonobstant les révolutions qui peuvent l'altérer ou l'anéantir : c'est véritablement consacrer à l'immortalité les noms et les ouvrages de nos Homères, de nos Sophocles, de nos Eurypides, de nos Pindares, de nos Démosthènes, de nos Thucydides, de nos Chrysostomes, de nos Platons, de nos Socrates : et les consécrateurs ne s'assurent-ils pas de droit une place éminente au temple de Mémoire ?
Les uns peuvent continuer sur le plan de l'abbé Girard, assigner les caractères distinctifs des synonymes avec cette précision rare qui caractérise cet écrivain lui-même, et y adapter des exemples qui en démontrent la justesse, et l'usage qu'il faut en faire.
Les autres recueilleront les preuves de fait que leurs lectures pourront leur présenter dans nos meilleurs écrivains, de la différence réelle qu'il y a entre plusieurs synonymes de notre langue. Le p. Bouhours, dans ses remarques nouvelles sur la langue française, en a caractérisé plusieurs qui pourraient bien avoir fait naître l'idée de l'ouvrage de l'abbé Girard. Dans le journal de l'académie française, par l'abbé de Chaisy, que M. l'abbé d'Olivet a inséré dans les opuscules sur la langue française, on trouve l'examen exprès des différences des mots mauvais et méchant, gratitude et reconnaissance, crainte et frayeur, etc. Il y aura aussi une bonne récolte à faire dans les remarques de Vaugelas, et dans les notes de MM. Patru et Th. Corneille.
Mais il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les Grammairiens de profession qui puissent fournir à cette compilation ; la Bruyere peut fournir sans effort une douzaine d'articles tout faits : docteur et docte ; héros et grand-homme ; galante et coquette ; faible, inconstant, léger et volage ; infidèle et perfide ; émulation, jalousie et envie ; vice, défaut et ridicule ; grossiereté, rusticité et brutalité ; suffisant, important et arrogant ; honnête-homme et homme de bien ; talent et goût ; esprit et bon-sens.
Le petit, mais excellent livre de M. Duclos, considérations sur les mœurs de ce siècle, sera aussi fécond que celui des caractères : il a défini poli et policé ; conviction et persuasion ; probité et vertu ; avilir et déshonorer ; réputation et renommée ; illustre et fameux ; crédit et faveur ; abaissement et bassesse ; suivre et obéir ; naïveté, candeur et ingénuité ; finesse et pénétration, &c.
En général, tous nos écrivains philosophes contribueront beaucoup à ce recueil, parce que l'esprit de justesse est le véritable esprit philosophique ; et peut-être faut-il à ce titre même citer l'Encyclopédie, comme une bonne source, non-seulement à cause des articles exprès qu'on y a consignés sur cette matière, mais encore à cause des distinctions précises que l'examen métaphysique des principes des sciences et des arts a nécessairement occasionnées.
Mais la besogne la plus utîle pour constater les vraies différences de nos synonymes, consiste à comparer les phrases où les meilleurs écrivains les ont employés sans autre intention que de parler avec justesse. Je dis les meilleurs écrivains, et j'ajoute qu'il ne faut compter en cela que sur les plus philosophes ; ce qui caractérise le plus petit nombre : les autres, en se donnant même la peine d'y penser, se contentent néanmoins assez aisément, et ne se doutent pas que l'on puisse leur faire le moindre reproche ; en voici une preuve singulièrement frappante.
M. le duc de la Rochefoucault s'exprime en cette sorte (pens. 28, édit. de l'abbé de la Roche) : " La jalousie est en quelque manière juste et raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient, ou que nous croyons nous appartenir ; au lieu que l'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres ". Rien n'est plus commun, dit là-dessus son commentateur, que d'entendre confondre ces passions... Cependant elles ont des objets bien différents. Mais lui-même sert bientôt de preuve à ce qu'il observe ici ; car à l'occasion de la pensée 55, où l'auteur parle de la haine pour les favoris, quel est, dit l'abbé de la Roche, le principe de cette haine, sinon un fond de jalousie qui nous fait envier tout le bien que nous voyons dans les autres ? Il est clair qu'il explique ici la jalousie par l'idée que M. de la Rochefoucault devait lui avoir fait prendre de l'envie, d'où il a même emprunté le verbe envier. Au reste ce n'est pas la seule faute qu'il ait faite dans ses remarques sur un texte qui n'exigeait de lui que de l'étude et du respect.
Quoi qu'il en sait, je remarquerai qu'il suit naturellement de tous les exemples que je viens d'indiquer dans différents écrivains, que ce qu'enseigne l'abbé Girard au sujet des différences qui distinguent les synonymes, n'est rien moins qu'arbitraire ; qu'il est fondé sur le bon usage de notre langue ; et qu'il ne s'agit, pour en établir les décisions sur cet objet, que d'en extraire avec intelligence les preuves répandues dans nos ouvrages les plus accrédités et les plus dignes de l'être. Ce n'est pas non plus une chose qui appartient en propre à notre idiôme. M. Gottsched vient de donner (1758, à Leipsick) des observations sur l'usage et l'abus de plusieurs termes et façons de parler de la langue allemande : elles sont, dit M. Roux (annales typogr. Aout 1760. bell. lett. n. clviij.), dans le goût de celles de Vaugelas sur la langue française, et on en trouve plusieurs qui ressemblent beaucoup aux synonymes de l'abbé Girard.
Il y a longtemps que les savants ont remarqué que la synonymie n'était pas exacte dans les mots les plus ressemblans. " Les Latins, dit M. du Marsais (trop. part. III. art. XIIe pag. 304.), sentaient mieux que nous ces différences délicates, dans le temps même qu'ils ne pouvaient les exprimer... Varron (de ling. lat. 1. Ve sub fin.), dit que c'est une erreur de confondre agère, facère et gerere, et qu'ils ont chacun leur destination particulière ". Voici le texte de Varron : propter similitudinem agendi, et faciendi, et gerendi, quidam error his qui putant esse unum ; potest enim quis aliquid facère et non agère, ut poèta facit fabulam, et non agit ; contrà actor agit, et non facit ; et sic à poètâ fabula fit et non agitur, ab actore agitur et non fit ; contrà imperator qui dicitur res gerere, in eo neque agit neque facit, sed gerit, id est sustinet, translatum ab his qui onera gerunt quòd sustinent.
Cicéron observe (tusc. II. n. 15.) qu'il y a de la différence entre dolere et laborare, lors même que ce dernier mot est pris dans le sens du premier. Interest aliquid inter laborem et dolorem ; sunt finitima omninò, sed tamen differt aliquid ; labor est functio quaedam vel animi vel corporis gravioris operis vel muneris ; dolor autem motus asper in corpore... Aliud, inquam, est dolere, aliud laborare. Cùm varices secabantur Cn. Mario, dolebat ; cùm aestu magno ducebat agmen, laborabat. Cette remarque de l'orateur romain n'est que l'application du principe général qu'il n'y a point de mots tout à fait synonymes dans les langues, principe qu'il a exprimé très-clairement et tout-à-la-fais justifié dans ses topiques (n. 34) : quanquam enim vocabula propè idem valere videantur, tamen quia res differebant, nomina rerum distare voluerunt.
Non-seulement Cicéron a remarqué, comme grammairien, les différences délicates des synonymes, mais il les a suivies dans la pratique comme écrivain intelligent et habile. Voici comme il différencie dans la pratique amare et diligère.
Quis erat qui putaret ad eum amorem quem erga te habebam posse aliquid accedere ? Tantum accessit, ut mihi nunc denique amare videar, anteà dilexisse. (ep. famil. ix. 14.) et ailleurs : Quid ego tibi commendem eum quem tu ipse diligis ? Sed tamen ut scires eum non à me diligi solùm, verùm etiam amari, ob eam rem tibi haec scribo. (ib. XIIIe 47.)
Les deux adjectifs gratus et jucundus que nous sommes tentés de croire entièrement synonymes, et que nos traducteurs les plus scrupuleux traduiraient peut-être indifféremment de la même manière, si des circonstances marquées ne les déterminaient à y faire une attention spéciale ; Cicéron en a très-bien senti la différence, et en a tiré un grand parti. Répondant à Atticus qui lui avait appris une triste nouvelle, il lui dit : ista veritas etiamsi jucunda non est, mihi tamen grata est. (ep. ad Attic. IIIe 24.) et dans une lettre qu'il écrit à Lucretius après la mort de sa fille Tullia : amor tuus gratus et optatus ; dicerem jucundum, nisi hoc verbum ad tempus perdidissem. (ep. famil. Ve 15.)
On voit par-là avec quelle circonspection on doit étudier la propriété des termes, et de la langue dont on veut traduire, et de celle dans laquelle on traduit, ou même dans laquelle on veut écrire ses propres pensées. " Nous avons, dit M. du Marsais (Trop. III. XIIe pag. 304.) quelques recueils des anciens grammairiens sur la propriété des mots latins : tels sont Festus, de verborum significatione ; Nonius Marcellus, de variâ significatione sermonum, (voyez Vetères grammatici.) On peut encore consulter un autre recueil qui a pour titre, Autores linguae latinae. De plus, nous avons un grand nombre d'observations répandues dans Varron, de lingua latina : [il fait partie des grammatici vetères ] dans les commentaires de Donat et de Servius : elles font voir les différences qu'il y a entre plusieurs mots que l'on prend communément pour synonymes. Quelques auteurs modernes ont fait des réflexions sur le même sujet : tels sont le P. Vasseur, jésuite, dans ses Remarq. sur la langue latine ; Scioppius, Henri Etienne, de latinitate falsò suspectâ, et plusieurs autres ". Je puis ajouter à ces auteurs, celui des Recherches sur la langue latine. (2 vol. in-12. Paris, chez Mouchet 1750.) Tout l'ouvrage est partagé en quatre parties ; et la troisième est entièrement destinée à faire voir, par des exemples comparés, qu'il n'y a point d'expressions tout à fait synonymes entr'elles, dans la langue latine.
Au reste, ce qui se prouve dans chaque langue, par l'autorité des bons écrivains dont la manière constate l'usage, est fondé sur la raison même ; et par conséquent il doit en être de même dans toutes les langues formées et polies. " S'il y avait des synonymes parfaits, dit encore M. du Marsais, (ibid. p. 308.) il y aurait deux langues dans une même langue. Quand on a trouvé le signe exact d'une idée, on n'en cherche pas un autre. Les mots anciens et les mots nouveaux d'une langue sont synonymes : maints est synonyme de plusieurs ; mais le premier n'est plus en usage ; c'est la grande ressemblance de signification, qui est cause que l'usage n'a conservé que l'un de ces termes, et qu'il a rejeté l'autre comme inutile. L'usage, ce [prétendu] tyran des langues, y opère souvent des merveilles, que l'autorité de tous les souverains ne pourrait jamais y opérer.
Qu'une fausse idée des richesses ne vienne pas ici, dit l'abbé Girard, (Préf. des Synon. pag. 12.) faire parade de la pluralité et de l'abondance. J'avoue que la pluralité des mots fait la richesse des langues ; mais ce n'est pas la pluralité purement numérale.... C'est celle qui vient de la diversité, telle qu'elle brille dans les productions de la nature.... Je ne fais donc cas de la quantité des mots que par celle de leur valeur. S'ils ne sont variés que par les sons ; et non par le plus ou le moins d'énergie, d'étendue et de précision, de composition ou de simplicité, que les idées peuvent avoir ; ils me paraissent plus propres à fatiguer la mémoire, qu'à enrichir et faciliter l'art de la parole. Protéger le nombre des mots sans égard au sens, c'est, ce me semble, confondre l'abondance avec la superfluité. Je ne saurais mieux comparer un tel goût qu'à celui d'un maître-d'hôtel qui ferait consister la magnificence d'un festin dans le nombre des plats plutôt que dans celui des mets. Qu'importe d'avoir plusieurs termes pour une seule idée ? N'est-il pas plus avantageux d'en avoir pour toutes celles qu'on souhaite d'exprimer " ? On doit juger de la richesse d'une langue, dit M. du Marsais, (Trop. pag. 309.) par le nombre des pensées qu'elle peut exprimer, et non par le nombre des articulations de la voix : et il semble en effet que l'usage de tous les idiomes, tout indélibéré qu'il parait, ne perde jamais de vue cette maxime d'économie ; jamais il ne légitime un mot synonyme d'un autre, sans proscrire l'ancien, si la synonymie est entière ; et il ne laisse subsister ensemble ces mêmes mots, qu'autant qu'ils sont réellement différenciés par quelques idées accessoires qui modifient la principale.
" Les synonymes des choses, dit M. le Président de Brosses, dans un mémoire dont j'ai déjà tiré bon parti ailleurs, viennent de ce que les hommes les envisagent sous différentes faces, et leur donnent des noms relatifs à chacune de ces faces. Si la rose est un être existant réellement et de soi dans la nature, sa manière d'exciter l'idée étant nette et distincte, elle n'a que peu ou point de synonymes, par exemple, fleur ; mais si la chose est une perception de l'homme relative à lui-même, et à l'idée d'ordre qui se forme à lui-même pour sa convenance, et qui n'est qu'en lui, non dans la nature, alors comme chaque homme a sa manière de considérer et de se former un ordre, la chose abonde en synonymes " (mais dans ce cas-là même, les différentes origines des synonymes démontrent la diversité des aspects accidentels de la même idée principale, et justifient la doctrine de la distinction réelle des synonymes) ; " par exemple, une certaine étendue de terrain se nomme région, eu égard à ce qu'elle est régie par le même prince ou par les mêmes lois : province, eu égard à ce que l'on y vient d'un lieu à un autre (provenire.) " [L'i et le c de provincia me feraient plutôt croire que ce mot vient de procul et de vincère, conformément à ce qu'en dit Hégésippe cité par Calepin (verb. provincia) ; scribit enim Hegesippus, dit-il, Romanos cùm vincendo in suam potestatem redigèrent procul positas regiones, appelavisse provincias : ou bien du verbe vincire, qui rendrait le nom de provincia applicable aux régions mêmes qui se soumettraient volontairement et par choix à un gouvernement : ce qui se confirme par ce que remarque Cicéron (Verrin. iv.) que la Sicîle est la première qui ait été appelée province, parce qu'elle fut la première qui se confia à l'amitié et à la bonne foi du peuple romain ; mais toutes ces étymologies rentrent également dans les vues de M. le président de Brosses, et dans les miennes] : " contrée, parce qu'elle comprend une certaine étendue circonvoisine (tractus, contractus, contrada) : district, en tant que cette étendue est considérée comme à part et séparée d'une autre étendue voisine (districtus, distractus) : pays, parce qu'on a coutume de fixer les habitations près des eaux : car c'est ce que signifie le latin pagus, du grec , fons : état, en tant qu'elle subsiste dans la forme qui y est établie, &c.... Tous ces termes passent dans l'usage : on les généralise dans la suite, et on les emploie sans aucun égard à la cause originelle de l'institution. Cette variété de mots met dans les langues beaucoup d'embarras et de richesses : elle est très-incommode pour le vulgaire et pour les philosophes qui n'ont d'autre but en parlant que de s'expliquer clairement : elle aide infiniment au poète et à l'orateur, en donnant une grande abondance à la partie matérielle de leur style. C'est le superflu qui fournit au luxe, et qui est à charge dans le cours de la vie à ceux qui se contentent de la simplicité. "
De la diversité des points de vue énoncés par les mots synonymes, je conclurais bien plutôt que l'abondance en est pour les philosophes une ressource admirable, puisqu'elle leur donne lieu de mettre dans leurs discours toute la précision et la netteté qu'exige la justesse la plus métaphysique ; mais j'avoue que le choix peut leur donner quelque embarras, parce qu'il est aisé de se méprendre sur des différences quelquefois assez peu sensibles. " Je ne disconviens pas qu'il n'y ait des occasions où il soit assez indifférent de choisir ; mais je soutiens qu'il y en a encore plus où les synonymes ne doivent ni ne peuvent figurer l'un pour l'autre, surtout dans les ouvrages médités et composés avec réflexion. S'il n'est question que d'un habit jaune, on peut prendre le souci ou le jonquille ; mais s'il faut assortir, on est obligé à consulter la nuance " (préf. des synon.)
M. de la Bruyere remarque (caract. des ouvrages d'esprit) qu'entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées, il n'y en a qu'une qui soit la bonne : que tout ce qui ne l'est point, est faible, et ne satisfait pas un homme d'esprit qui veut se faire entendre. " Ainsi, dit M. du Marsais, (trop. pag. 307), ceux qui se sont donné la peine de traduire les auteurs latins en un autre latin, en affectant d'éviter les termes dont ces auteurs se sont servis, auraient pu s'épargner un travail qui gâte plus le goût qu'il n'apporte de lumière. L'une et l'autre pratique (il parle de la méthode de faire le thème en deux façons) est une fécondité stérîle qui empêche de sentir la propriété des termes, leur énergie, et la finesse de la langue. " (E. R. M. B.)