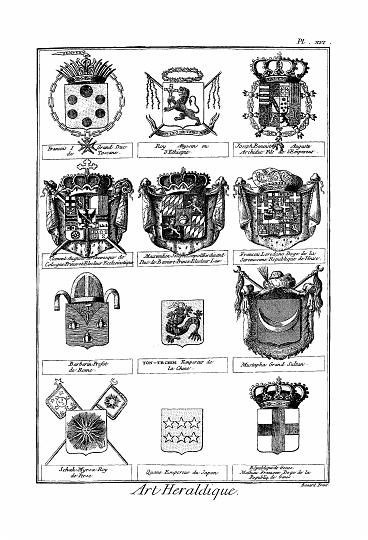(LANGUE) ; c'est la langue dans laquelle sont écrits les livres saints que nous ont transmis les Hébreux qui l'ont autrefois parlée. C'est sans contredit, la plus ancienne des langues connues ; et s'il faut s'en rapporter aux Juifs, elle est la première du monde. Comme langue savante, et comme langue sacrée, elle est depuis bien des siècles le sujet et la matière d'une infinité de questions intéressantes, qui toutes n'ont pas toujours été discutées de sens froid, surtout par les rabbins, et qui pour la plupart, ne sont pas encore éclaircies, peut-être à cause du temps qui couvre tout, peut-être encore parce que cette langue n'a pas été aussi cultivée qu'elle aurait dû l'être des vrais savants. Son origine, ses révolutions, son génie, ses propriétés, sa grammaire, sa prononciation, enfin les caractères de son écriture, et la ponctuation qui lui sert de voyelles, sont l'objet des principaux problèmes qui la concernent ; s'ils sont résolus pour les Juifs qui se noient avec délices dans un océan de minuties et de fables, ils ne le sont pas encore pour l'homme qui respecte la religion et le bon sens, et qui ne prend pas le merveilleux pour la vérité. Nous présenterons donc ici ces différents objets ; et sans nous flatter du succès, nous parlerons en historiens et en littérateurs ; 1°. de l'écriture de la langue hébraïque ; 2°. de sa ponctuation ; 3°. de l'origine de la langue et de ses révolutions chez les Hébreux ; 4°. de ses révolutions chez les différents peuples où elle parait avoir été portée par les Phéniciens ; et 5°. de son génie, de son caractère, de sa grammaire, et de ses propriétés.
I. L'alphabet hébreu est composé de vingt-deux lettres, toutes réputées consonnes, sans en excepter même l'aleph, le hé, le vau et jod, que nous nommons voyelles, mais qui chez les Hébreux n'ont aucun son fixe ni aucune valeur sans la ponctuation, qui seule contient les véritables voyelles de cette langue, comme nous le verrons au deuxième article. On trouvera les noms et les figures des caractères hébreux, ainsi que leur valeur alphabétique et numérique dans nos Planches de Caractères ; on y a joint les caractères samaritains qui leur disputent l'antériorité. Ces deux caractères ont été la matière de grandes discussions entre les Samaritains et les Juifs ; le Pentateuque qui s'est transmis jusqu'à nous par ces deux écritures ayant porté chacun de ces peuples à regarder son caractère comme le caractère primitif, et à considérer en même temps son texte comme le texte original.
Ils se sont fort échauffés de part et d'autre à ce sujet, ainsi que leurs partisans, et ils ont plutôt donné des fables ou des systèmes, que des preuves ; parce que telle est la fatalité des choses qu'on croit toucher à la religion, de ne pouvoir presque jamais être traitées à l'amiable et de sens froid. Les uns ont consideré le caractère hébreu comme une nouveauté que les Juifs ont rapportée de Babylone au retour de leur captivité ; et les autres ont regardé le caractère samaritain comme le caractère barbare des colonies assyriennes qui repeuplèrent le royaume des dix tribus dispersés sept cent ans environ avant J. C. Quelques-uns plus raisonnables ont cherché à les mettre d'accord en leur disant que leur pères avaient eu de tout temps deux caractères, l'un profane, et l'autre sacré ; que le samaritain avait été le profane ou le vulgaire, et que celui qu'on nomme hébreu, avait été le caractère sacré ou sacerdotal. Ce sentiment favorable à l'antiquité de deux alphabets, qui contiennent le même nombre de lettres, et qui semblent par-là avoir en effet appartenu au même peuple, donne la place d'honneur à celui du texte hébreu ; mais il s'est trouvé des Juifs qui l'ont rejeté, parce qu'ils ne veulent point de concurrents dans leurs antiquités, et qu'il n'y a d'ailleurs aucun monument qui puisse constater le double usage de ces deux caractères chez les anciens Israèlites. Enfin les savants qui sont entrés dans cette discussion, après avoir longtemps flotté d'opinions en opinions, semblent être décidés aujourd'hui, quelques-uns à regarder encore le caractère hébreu comme ayant été inventé par Esdras ; le plus grand nombre comme un caractère chaldéen, auquel les Juifs se sont habitués dans leur captivité ; et presque tous sont d'accord avec les plus éclairés des rabbins, à donner l'antiquité et la primauté au caractère samaritain.
Cette grande question aurait été plutôt décidée, si dans les premiers temps où l'on en a fait un problème, les intéressés eussent pris la voie de l'observation et non de la dispute. Il fallait d'abord comparer les deux caractères l'un avec l'autre, pour voir en quoi ils différent, en quoi ils se ressemblent, et quel est celui dans lequel on reconnait le mieux l'antique. Il fallait ensuite rapprocher des deux alphabets les lettres grecques nommées lettres phéniciennes par les Grecs eux-mêmes, parce qu'elles étaient originaires de la Phénicie. Comme cette contrée diffère peu de la Palestine, il était assez naturel d'examiner les caractères d'écritures qui en sont sortis, pour remarquer s'il n'y aurait point entr'eux et les caractères hébreux et samaritains des rapports communs qui puissent donner quelque lumière sur l'antiquité des deux derniers ; c'est ce que nous allons faire ici.
Le simple coup-d'oeil fait apercevoir une différence sensible entre les deux caractères orientaux ; l'hébreu net, distinct, régulier, et presque toujours carré, est commode et courant dans l'Ecriture ; le samaritain plus bizarre, et beaucoup plus composé, présente des figures qui ressemblent à des hieroglyphes, et même à quelques-unes de ces lettres symboliques qui sont encore en usage aux confins de l'Asie. Il est difficîle et long à former, et tient ordinairement beaucoup plus de place ; nous pouvons ensuite remarquer que plusieurs caractères hébreux, comme aleph, beth, zain, heth, theth, lamed, mem, nun, resch, et schin, ne sont que des abréviations des caractères samaritains qui leur correspondent, et que l'on a rendus plus courants et plus commodes ; d'où nous pouvons déjà conclure que le caractère samaritain est le plus ancien ; sa rusticité fait son titre de noblesse.
La comparaison des lettres grecques avec les samaritaines ne leur est pas moins avantageuse. Si l'on en rapproche les majuscules alpha, gamma, delta, epsilon, zeta, heta, lambda, pi, ro et sigma, on les reconnaitra aisément dans les lettres correspondantes aleph, gimel, daleth, hé, zain, heth, lamed, phé, resch et schin,
avec cette différence cependant que dans le grec elles sont pour la plupart tournées en sens contraire, suivant l'usage des Occidentaux qui ont écrit de gauche à droite, ce que les Orientaux avaient figuré de droite à gauche. De cette dernière observation il résulte que le caractère que nous nommons samaritain était d'usage dans la Phénicie dès les premiers temps historiques, et même auparavant, puisque l'arrivée des Phéniciens et de leur alphabet chez les Grecs se cache pour nous dans la nuit des temps mythologiques.
Nos observations ne seront pas moins favorables à l'antiquité des caractères hébreux. Si l'on compare les minuscules
Le vient de l'ajin ; et la prononciation de ces deux lettres varie de même chez les Hébreux comme chez les Grecs.]
des Grecs avec eux, on reconnaitra de même qu'elles en ont pour la plupart été tirées, comme les majuscules l'ont été du samaritain, et l'on remarquera qu'elles sont aussi représentées en sens contraire. Par cette double analogie des lettres grecques avec les deux alphabets orientaux, nous devons donc juger 1°. que de tout ce qui a été tant de fois débité sur la nouveauté du caractère hébreu ; sur Esdras, qu'on en a fait l'inventeur ; et sur Babylone, d'où l'on dit que les captifs l'ont apporté, ne sont que des fables qui démontrent le peu de connaissance qu'ont eu les Juifs de leur histoire littéraire, puisqu'ils ont ignoré l'antiquité de leurs caractères, qui avaient été communiqués aux Européens plus de mille ans avant ce retour de Babylone : 2°. que les deux caractères nommés aujourd'hui hébreu et samaritain, ont originairement appartenu au même peuple, et particulièrement aux anciens habitants de la Phénicie ou Palestine, et que le samaritain cependant doit avoir quelque antériorité sur l'hébreu, puisqu'il a visiblement servi à sa construction, et qu'il a produit les majuscules grecques ; étant vraisemblable que les premières écritures ont consisté en grandes lettres, et que les petites n'ont été inventées et adoptées que lorsque cet art est devenu plus commun et d'un usage plus fréquent.
Au tableau de comparaison que nous venons de faire de ces trois caractères, il n'est pas non plus inutîle de joindre le coup-d'oeil des lettres latines ; quoiqu'elles soient censées apportées en Italie par les Grecs, elles ont aussi des preuves singulières d'une relation directe avec les Orientaux. On ne nommera ici que C, L, P, q et r, qui n'ont point tiré leur figure de la Grèce, et qui ne peuvent être autres que le caph, le lamed, le phé final, le qoph, et le resch de l'alphabet hébreu, vus et dessinés en sens contraire :
ce qui présente un nouveau monument de l'antiquité des lettres hébraïques. Comme nous ne pouvons fixer les temps où les navigateurs de la Phénicie ont porté leurs caractères et leur écriture aux différents peuples de la Méditerranée, il nous est encore plus impossible de désigner la source d'où les Phéniciens et les Israélites les avaient eux-mêmes tirés ; ce n'a pu être sans-doute que des Egyptiens ou des Chaldéens, deux des plus anciens peuples connus, dont les colonies se sont répandues de bonne heure dans la Palestine. Mais en vain désirerions-nous savoir quelque chose de plus précis sur l'origine de ces caractères et sur leur inventeur ; le temps où les Egyptiens et les Chaldéens ont abandonné leurs symboles primitifs et leurs hiéroglyphes, pour transmettre l'Histoire par l'écriture, n'a point de date dans aucune des annales du monde : nous n'oserions même assurer que ces caractères hébreux et samaritains aient été les premiers caractères des sons. La lettre carrée des Hébreux est trop simple pour avoir été la première inventée ; et celle des Samaritains n'est peut-être point assez composée ; d'ailleurs ni l'une ni l'autre ne semblent être prises dans la nature ; et c'est l'argument le plus fort contre elles, parce qu'il est plus que vraisemblable que les premières lettres alphabétiques ont eu la figure d'animaux, ou de parties d'animaux, de plantes, et d'autres corps naturels dont on avait déjà fait un si grand usage dans l'âge des symboles ou des hiéroglyphes. Ce que l'on peut penser de plus raisonnable sur nos deux alphabets, c'est qu'étant dépourvus de voyelles, ils paraissent avoir été un des premiers degrés par où il a fallu que passât l'esprit humain pour amener l'écriture à sa perfection. Quant au primitif inventeur, laissons les rabbins le voir tantôt dans Adam, tantôt dans Moïse, tantôt dans Esdras ; laissons aux Mythologistes le soin de le célébrer dans Thoth, parce que othoth signifie des lettres ; et ne rougissons point d'avouer notre ignorance sur une anecdote aussi ténébreuse qu'intéressante pour l'histoire du genre humain. Passons aux questions qui concernent la ponctuation, qui dans l'écriture hébraïque tient lieu des voyelles dont elle est privée.
II. Quoique les Hébreux aient dans leur alphabet ces quatre lettres aleph, he, vau et jod, c'est-à-dire a, e, u ou o, et i, que nous nommons voyelles, elles ne sont regardées dans l'hébreu que comme des consonnes muettes, parce qu'elles n'ont aucun son fixe et propre, et qu'elles ne reçoivent leur valeur que des différents points qui se posent dessus ou dessous, et devant ou après elles : par exemple, vaut o, vaut i, vaut e, vaut o, etc. plus ordinairement ces points et plusieurs autres petits signes conventionnels se posent sous les vraies consonnes, valent seuls autant que nos cinq voyelles, et tiennent presque toujours lieu de l'aleph, du hé, du vau, et du jod, qui sont peu souvent employés dans les livres sacrés. Pour écrire lacac, lecher, on écrit c ; pour paredes, jardin, s ; pour marar, être amer, r ; pour pharaq, briser, pq ; pour garah, batailler, h, etc. Tel est l'artifice par lequel les Hébreux suppléent au défaut des lettres fixes que les autres nations se sont données pour désigner les voyelles ; et il faut avouer que leurs signes sont plus riches et plus féconds que nos cinq caractères, en ce qu'ils indiquent avec beaucoup plus de variété les longues et les breves, et même les différentes modifications des sons que nous sommes obligés d'indiquer par des accens, à l'imitation des Grecs qui en avaient encore un bien plus grand nombre que nous qui n'en avons pas assez. Il arrive cependant, et il est arrivé quelques inconvénients aux Orientaux, de n'avoir exprimé leurs voyelles que par des signes aussi déliés, quelquefois trop vagues, et plus souvent encore sous-entendus. Les voyelles ont extrêmement varié dans les sons ; elles ont changé dans les mots, elles ont été omises, elles ont été ajoutées et déplacées à l'égard des consonnes qui forment la racine des mots : c'est ce qui fait que la plupart des expressions occidentales qui sont en grand nombre sorties de l'Orient, sont et ont été presque toujours méconnaissables. Nous ne disons plus paredes, marar, pharac, et garah, mais paradis, amer, phric, ou phrac, et guerroyer. Ces changements de voyelles sont une des clés des étymologies, ainsi que la connaissance des différentes finales que les nations d'Europe ont ajoutées à chaque mot oriental, suivant leur dialecte et leur goût particulier.
Indépendamment des signes que l'on nomme dans l'hébreu points-voyelles, il a encore une multitude d'accens proprement dits, qui servent à donner de l'emphase et de l'harmonie à la prononciation, à régler le ton et la cadence, et à distinguer les parties du discours, comme nos points et nos virgules. L'écriture hébraïque n'est donc privée d'aucun des moyens nécessaires pour exprimer correctement le langage, et pour fixer la valeur des signes par une multitude de nuances qui donnent une variété convenable aux figures et aux expressions qui pourraient tromper l'oeil et l'oreille : mais cette écriture a-t-elle toujours eu cet avantage ? c'est ce que l'on a mis en problème. Vers le milieu du seizième siècle, Elie Lévite, juif allemand, fut le premier qui agita cette intéressante et singulière question ; on n'avait point avant lui soupçonné que les points-voyelles que l'on trouvait dans plusieurs exemplaires des livres saints, puissent être d'une autre main que de la main des auteurs qui avaient originairement écrit et composé le texte ; et l'on n'avait pas même songé à séparer l'invention et l'origine de ces points, de l'invention et de l'origine des lettres et de l'écriture. Ce juif, homme d'ailleurs fort lettré pour un juif et pour son temps, entreprit le premier de réformer à cet égard les idées reçues ; il osa recuser l'antiquité des points-voyelles, et en attribuer l'invention et le premier usage aux Massoretes, docteurs de Tibériade, qui fleurissaient au cinquième siècle de notre ere. Sa nation se révolta contre lui, elle le regarda comme un blasphémateur, et les savants de l'Europe comme un fou. Au commencement du dix-septième siècle, Louis Capelle, professeur à Saumur, prit sa défense, et soutint la nouvelle opinion avec vigueur ; plusieurs se rangèrent de son parti : mais en adoptant le système de la nouveauté de la ponctuation, ils se divisèrent tous sur les inventeurs et sur la date de l'invention ; les uns en firent honneur aux Massoretes, d'autres à deux illustres rabbins du onzième siècle, et la multitude crut au-moins devoir remonter jusqu'à Esdras et à la grande synagogue. Ces nouveaux critiques eurent dans Cl. Buxtorf un puissant adversaire, qui fut secondé d'un grand nombre de savants de l'une et de l'autre religion ; mais quoique le nouveau système parut à plusieurs intéresser l'intégrité des livres sacrés, il ne fut cependant point proscrit, et l'on peut dire qu'il forme aujourd'hui le sentiment le plus général.
Pour éclaircir une telle question autant qu'il est possible de le faire, il est à propos de connaître quels ont été les principaux moyens que les deux partis ont employés : ils nous exposeront l'état des choses ; et nous faisant connaître quelles sont les causes de l'incertitude où l'on est tombé à ce sujet, peut-être nous mettront-ils à portée de juger le fond même de la question.
Le Pentateuque samaritain, qui de tous les textes porte le plus le sceau de l'antiquité, n'a point de ponctuation ; les paraphrastes chaldéens qui ont commencé à écrire un siècle ou deux avant J. C. ne s'en sont point servis non plus. Les livres sacrés que les Juifs lisent encore dans leurs synagogues, et ceux dont se servent les Cabalistes, ne sont point ponctués : enfin dans le commerce ordinaire des lettres, les points ne sont d'aucun usage. Tels ont été les moyens de Louis Capelle et de ses partisans, et ils n'ont point manqué de s'autoriser aussi du filence général de l'antiquité juive et chrétienne sur l'existence de la ponctuation. Contre des moyens si forts et si positifs on a opposé l'impossibilité morale qu'il y aurait eu à transmettre pendant des milliers d'années un corps d'histoire raisonnée et suivie avec le seul secours des consonnes ; et la traduction de la Bible que nous possédons a été regardée comme la preuve la plus forte et la plus expressive que l'antiquité juive n'avait point été privée des moyens nécessaires et des signes indispensables pour en perpétuer le sens et l'intelligence. On a dit que le secours des voyelles nécessaire à toute langue et à toute écriture, avait été encore bien plus nécessaire à la langue des Hébreux qu'à toute autre ; parce que la plupart des mots ayant souvent plus d'une valeur, l'absence des voyelles en aurait augmenté l'incertitude pour chaque phrase en raison de la combinaison des sens dont un grouppe de consonnes est susceptible avec toutes voyelles arbitraires. Cette dernière considération est réellement effrayante pour qui sait la fécondité de la combinaison de 4 ou 5 signes avec 4 ou 5 autres ; aussi les défenseurs de l'antiquité des points voyelles n'ont-ils pas craint d'avancer que sans eux le texte sacré n'aurait été pendant des milliers d'années qu'un nez de cire (instar nasi cerei, in diversas formas mutabilis fuisset. Leusden, phil. heb. disc. 14.), qu'un monceau de sable battu par le vent, qui d'âge en âge aurait perdu sa figure et sa forme primitive. Envain leurs adversaires appelaient à leur secours une tradition orale pour en conserver le sens de bouche en bouche, et pour en perpétuer l'intelligence d'âge en âge. On leur disait que cette tradition orale n'était qu'une fable, et n'avait jamais servi qu'à transmettre des fables. En vain osaient-ils prétendre que les inventeurs modernes des points voyelles avaient été inspirés du Saint-Esprit pour trouver et fixer le véritable sens du texte sacré et pour ne s'en écarter jamais. Ce nouveau miracle prouvait aux autres l'impossibilité de la chose, parce que la traduction des livres saints ne doit pas être une merveille supérieure à celle de leur composition primitive. A ces raisons générales on en a joint de particulières et en grand nombre : on a fait remarquer que les paraphrastes chaldéens, qui n'ont point employé de ponctuations dans leurs commentaires ou Targum, se sont servis très-fréquemment de ces consonnes muettes, aleph, vau, et jod, peu usitées dans les textes sacrés, où elles n'ont point de valeur par elles-mêmes, mais qui sont si essentielles dans les ouvrages des paraphrastes, qu'on les y appelle matres lectionis, parce qu'elles y fixent le son et la valeur des mots, comme dans les livres des autres langues. Les Juifs et les rabbins font aussi de ces caractères le même usage dans leurs lettres et leurs autres écrits, parce qu'ils évitent de cette façon la longueur et l'embarras d'une ponctuation pleine de minuties.
Pour répondre à l'objection tirée du silence de l'antiquité, on a présenté les ouvrages même des Massoretes qui ont fait des notes critiques et grammaticales sur les livres sacrés, et en particulier sur les endroits dont ils ont cru la ponctuation altérée ou changée. On a trouvé de pareilles autorités dans quelques livres de docteurs fameux et de cabalistes, connus pour être encore plus anciens que la Masore ; c'est ce qui est exposé et démontré avec le plus grand détail dans le livre de Cl. Buxtorf, de antiq. punct. cap. 5. part. I. et dans le Philolog. heb. de Leusden. Quant au silence que la foule des auteurs et des écrivains du moyen âge a gardé à cet égard, il ne pourrait être étonnant, qu'autant que l'admirable invention des points voyelles serait une chose aussi récente qu'on voudrait le prétendre. Mais si son origine sort de la nuit des temps les plus reculés, comme il est très-vraisemblable, leur silence alors ne doit pas nous surprendre ; ces auteurs auront Ve les points voyelles ; ils s'en seront servis comme les Massoretes, mais sans parler de l'invention ni de l'inventeur ; parce qu'on ne parle pas ordinairement des choses d'usage, et que c'est même là la raison qui nous fait ignorer aujourd'hui une multitude d'autres détails qui ont été vulgaires et très-communs dans l'antiquité. On a cependant plusieurs indices que les anciennes versions de la Bible qui portent les noms des Septante et de S. Jérôme, ont été faites sur des textes ponctués ; leurs variations entr'elles et entre toutes les autres versions qui ont été faites depuis, ne sont souvent provenues que d'une ponctuation quelquefois différente entre les textes dont ils se sont servis ; d'ailleurs, comme ces variations ne sont point considérables, qu'elles n'influent que sur quelques mots, et que les récits, les faits, et l'ensemble total du corps historique, est toujours le même dans toutes les versions connues ; cette uniformité est une des plus fortes preuves qu'on puisse donner, que tous les traducteurs et tous les âges ont eu un secours commun et un même guide pour déchiffrer les consonnes hébraïques. S'il se pouvait trouver des Juifs qui n'eussent point appris leur langue dans la Bible, et qui ne connussent point la ponctuation, il faudrait pour avoir une idée des difficultés que présente l'interprétation de celles qui ne le sont pas, exiger d'eux qu'ils en donnassent une nouvelle traduction, on verrait alors quelle est l'impossibilité de la chose, ou quelles fables ils nous feraient, s'ils étaient encore en état d'en faire.
A tous ces arguments si l'on voulait en ajouter un nouveau, peut-être pourrait-on encore faire parler l'écriture des Grecs en faveur de l'antiquité de la ponctuation hébraïque et de ses accens, comme nous l'avons fait ci-devant parler en faveur des caractères. Quoique les Grecs aient eu l'art d'ajouter aux alphabets de Phénicie les voyelles fixes et déterminées dans leur son, leurs voyelles sont encore cependant tellement chargées d'accens, qu'il semblerait qu'ils n'ont pas osé se défaire entièrement de la ponctuation primitive. Ces accens sont dans leur écriture aussi essentiels, que les points le sont chez les Hébreux ; et sans eux il y aurait un grand nombre de mots dont le sens serait variable et incertain. Cette façon d'écrire moyenne entre celle des Hébreux et la nôtre, nous indique sans-doute un des degrés de la progression de cet art ; mais quoi qu'il en sait, on ne peut s'empêcher d'y reconnaître l'antique usage de ces points voyelles, et de cette multitude d'accens que nous trouvons chez les Hébreux. Si le seizième siècle a donc Ve naître une opinion contraire, peut-être n'y en a-t-il pas d'autre cause que la publicité des textes originaux rendus communs par l'Imprimerie encore moderne ; comme elle multiplia les Bibles hébraïques, qui ne pouvaient être que très-rares auparavant, plus d'yeux en furent frappés, et plus de gens en raisonnèrent ; le monde vit alors le spectacle nouveau de l'ancien art d'écrire, et le silence des siècles fut nécessairement rompu par des opinions et des systèmes, dont la contrariété seule devrait suffire pour indiquer toute l'antiquité de l'objet où l'imagination a voulu, ainsi que les yeux, apercevoir une nouveauté.
La discussion des points voyelles serait ici terminée toute en leur faveur, si les adversaires de son antiquité n'avaient encore à nous opposer deux puissantes autorités. Le Pentateuque samaritain n'a point de ponctuation, et les Bibles hébraïques que lisent les rabbins dans leurs synagogues pour instruire leur peuple, n'en ont point non plus ; et c'est une règle chez eux que les livres ponctués ne doivent jamais servir à cet usage. Nous répondons à ces objections 1°. que le Pentateuque samaritain n'a jamais été assez connu ni assez multiplié, pour que l'on puisse savoir ou non, si tous les exemplaires qui en ont existé ont tous été généralement dénués de ponctuation. Mais il suit de ce que ceux que nous avons en sont privés, que nous n'y pouvons connaître que par leur analogie avec l'hébreu, et en s'aidant aussi des trois lettres matres lectionis. 2°. Que les rabbins qui lisent des Bibles non ponctuées n'ont nulle peine à le faire, parce qu'ils ont tous appris à lire et à parler leur langue dans des Bibles qui ont tout l'appareil grammatical, et qui servent à l'intelligence de celles qui ne l'ont pas. D'ailleurs qui ne sait que ces rabbins toujours livrés à l'illusion, ne se servent de Bibles sans voyelles pour instruire leur troupeau, que pour y trouver, à ce qu'ils disent, les sources du Saint-Esprit plus riches et plus abondantes en instruction ; parce qu'il n'y a pas en effet un mot dans les Bibles de cette espèce, qui ne puisse avoir une infinité de valeur pour une imagination échauffée, qui veut se repaitre de chimère, et qui veut en entretenir les autres ?
C'est par cette même raison, que les Cabalistes font aussi si peu de cas de la ponctuation ; elle les gênerait, et ils ne veulent point être gênés dans leurs extravagances ; ils veulent en toute liberté supposer les voyelles, analyser les lettres, décomposer les mots, et renverser les syllabes ; comme si les livres sacrés n'étaient pour eux qu'un répertoire d'anagrammes et de logogryphes. Voyez CABALE. L'abus que ces prétendus sages ont fait de la Bible dans tous les temps, et les rêveries inconcevables où les rabbins, le texte à la main, se plongent dans leurs synagogues, semblent ici nous avertir tacitement de l'origine des livres non ponctués, et nous indiquer leur source et leur principe dans les déreglements de l'imagination ; les Bibles muettes ne pourraient-elles point être les filles du mystère, puisqu'elles ont été pour les Juifs l'occasion de tant de fables mystérieuses ? Ce soupçon qui mérite d'être approfondi, si l'on veut connaître les causes qui ont répandu dans le monde des livres ponctués et non ponctués, et les suites qu'elles ont eu, nous conduit au véritable point de vue sous lequel on doit nécessairement considérer l'usage et l'origine même des points voyelles ; ce que nous allons dire fera la plus essentielle partie de leur histoire ; et comme cette partie renferme une des plus intéressantes anecdotes de l'histoire du monde, on prévient qu'il ne faut pas confondre les temps avec les temps, ni les auteurs sacrés avec les sages d'Egypte ou de Chaldée. Nous allons parler d'un âge qui a sans-doute été de beaucoup antérieur au premier écrivain des Hébreux.
Plus l'on réfléchit sur les opérations de ceux qui les premiers ont essayé de représenter les sons par des caractères, et moins l'on peut concevoir qu'ils aient précisément oublié de donner des signes aux voyelles qui sont les mères de tous les sons possibles, et sans lesquelles on ne peut rien articuler. L'écriture est le tableau du langage ; c'est-là l'objet et l'essence de cette inestimable invention ; or comme il n'y a point et qu'il ne peut y avoir de langage sans voyelles, ceux qui ont inventé l'écriture pour être utîle au genre humain en peignant la parole, n'ont donc pu l'imaginer indépendamment de ce qui en fait la partie essentielle, et de ce qui en est naturellement inaliénable. Leusden et quelques autres adversaires de l'antiquité des points voyelles, ont avancé en discutant cette même question, que les consonnes étaient comme la matière des mots, et que les voyelles en étaient comme la forme : ils n'ont fait en cela qu'un raisonnement faux, et d'ailleurs inutîle ; ce sont les voyelles qui doivent être regardées comme la matière aussi simple qu'essentielle de tous les sons, de tous les mots, et de toutes les langues ; et ce sont les consonnes qui leur donnent la forme en les modifiant en mille et mille manières, et en nous les faisant articuler avec une variété et une fécondité infinie. Mais de façon ou d'autre, il faut nécessairement dans l'écriture comme dans le langage, le concours de cette matière et de cette forme, pour faire sur nos organes l'impression distincte que ni la forme ni la matière ne peuvent produire séparément. Nous devons donc encore en conclure qu'il est de toute impossibilité, que l'invention des signes des consonnes ait pu être naturellement séparée de l'invention des signes des voyelles, ou des points voyelles, qui sont la même chose.
Pourquoi donc nous est-il parvenu des livres sans aucune ponctuation ? C'est ici qu'il faut en demander la raison primitive à ces sages de la haute antiquité, qui ont eu pour principe que la science n'était point faite pour le vulgaire, et que les avenues en devaient être fermées au peuple, aux profanes, et aux étrangers. On ne peut ignorer que le goût du mystère a été celui des savants des premiers âges ; c'était lui qui avait déjà en partie présidé à l'invention des hieroglyphes sacrés qui ont devancé l'écriture ; et c'est lui qui a tenu les nations pendant une multitude de siècles dans des ténèbres qu'on ne peut pénétrer, et dans une ignorance profonde et universelle, dont deux mille ans d'un travail assez continu n'ont point encore réparé toutes les suites funestes. Nous ne chercherons point ici quels ont été les principes d'un tel système ; il suffit de savoir qu'il a existé, et d'en voir les tristes suites, pour y découvrir l'esprit qui a dû présider à la primitive invention des caractères des sons, et qui en a fait deux classes séparées, quoiqu'elles n'eussent jamais dû l'être. Cette précieuse et inestimable découverte n'a point été dès son origine livrée et communiquée aux hommes dans son entier ; les signes des consonnes ont été montrés au vulgaire ; mais les signes des voyelles ont été mis en réserve comme une clef et un secret qui ne pouvait être confié qu'aux seuls gardiens de l'arbre de la science. Par une suite de l'ancienne politique, l'invention nouvelle ne fut pour le peuple qu'un nouveau genre d'hiéroglyphe plus simple et plus abrégé, à la vérité, que les précédents, mais dont il fallut toujours qu'il allât de même chercher le sens et l'intelligence dans la bouche des sages, et chez les administrateurs de l'instruction publique. Heureux sans-doute ont été les peuples auxquels cette instruction a été donnée saine et entière ; heureuses ont été les sociétés où les organes de la science n'ont point, par un abus trop conséquent de leur funeste politique, regardé comme leur patrimoine et leur domaine le dépôt qui ne leur était que commis et confié ; mais quand elles auraient eu toutes ce rare bonheur, en est-il une seule qui ait été à l'abri des guerres destructives, et des révolutions qui renversent tout, et principalement les Arts ? Les nations ont donc été détruites, les sages ont été dispersés, souvent ils ont péri et leur mystère avec eux. Après ces événements il n'est plus resté que les monuments énigmatiques de la science primitive, devenus mystérieux et inintelligibles par la perte ou la rareté de la clé des voyelles. Peut-être le peuple juif est-il le seul qui par un bienfait particulier de la Providence, ait heureusement conservé cette clé de ses annales par le secours de quelques livres ponctués qui auront échappé aux diverses désolations de leur patrie ; mais quant à la plupart des autres nations, il n'est que trop vraisemblable qu'il a été pour elles un temps fatal, où elles ont perdu tout moyen de relever l'édifice de leur histoire. Il fallut ensuite recourir à la tradition ; il fallut évertuer l'imagination pour déchiffrer des fragments d'annales toutes écrites en consonnes ; et la privation des exemplaires ponctués, presque tous péris avec ceux qui les avaient si mystérieusement gardés, donna nécessairement lieu à une science nouvelle, qui fit respecter les écritures non ponctuées, et qui en répandit le goût dépravé chez divers peuples : ce fut de deviner ce qu'on ne pouvait plus lire ; et comme l'appareil de l'écriture et des livres des anciens sages avait quelque chose de merveilleux, ainsi que tout ce qu'on ne peut comprendre, on s'en forma une très-haute idée ; on n'y chercha que des choses sublimes, et ce qui n'y avait jamais été sans-doute, comme la médecine universelle, le grand œuvre, ses secrets, la magie, et toutes ces sciences occultes que tant d'esprits faux et de têtes creuses ont si longtemps cherchées dans certains chapitres de la Bible, qui ne contiennent que des hymnes ou des généalogies, ou des dimensions de bâtiment. Il en fut aussi de même quant à l'histoire générale des peuples et aux histoires particulières des grands hommes. Les nations qui dans des temps plus anciens avaient déjà abusé des symboles primitifs et des premiers hiéroglyphes, pour en former des êtres imaginaires qui s'étaient confondus avec des êtres réels, abusèrent de même de l'écriture sans consonnes, et s'en servirent pour composer ou amplifier les légendes de tous les fantômes populaires. Tout mot qui pouvait avoir quelque rapport de figure à un nom connu, fut censé lui appartenir, et renfermer une anecdote essentielle sur le personnage qui l'avait porté ; mais comme il n'y a pas de mots écrits en simples consonnes qui ne puissent offrir plusieurs valeurs, ainsi que nous l'avons déjà dit, l'embarras du choix fit qu'on les adopta toutes, et que l'on fit de chacune un trait particulier de son histoire. Cet abus est une des sources des plus vraies et des plus fécondes de la fable ; et voilà pourquoi les noms d'Orphée, de Mercure, d'Isis, etc. font allusion chacun à cinq ou six racines orientales qui ont toutes la singulière propriété de nous retracer une anecdote de leurs légendes ; ce que nous disons de ces trois noms, on peut le dire de tous les noms fameux dans les mythologies des nations. De-là sont provenues ces variétés si fréquentes entre nos étymologistes qui n'ont jamais pu s'accorder, parce que chacun d'eux s'est affectionné à la racine qu'il a saisie ; de-là l'incertitude où ils nous ont laissé, parce qu'ils ont tous eu raison en particulier, et qu'il a paru néanmoins impossible de les concilier ensemble. Il n'était cependant rien de plus facîle ; et puisque les Vossius, les Bocharts, les Huets, les Leclerc, avaient tous eu des suffrages en particulier ; au lieu de se critiquer les uns les autres, ils devaient se donner la main, et concourir à nous découvrir une des principales sources de la Mythologie, et à nous dévoiler par-là un des secrets de l'antiquité. Nous nommons ceci un secret, parce qu'il en a été réellement un dans l'art de composer et d'écrire dans les temps où le défaut d'invention et de génie, autant que la corruption des monuments historiques, obligeait les auteurs à tirer les anecdotes de leur roman des noms même de leurs personnages. Ce secret, à la vérité, ne couvre qu'une absurdité ; mais il importe au monde de la connaître ; et pour nous former à cet égard une juste idée du travail des anciens en ce genre, et nous apprendre les moyens de le décomposer, il ne faut que contempler un cabaliste méditant sur une Bible non ponctuée : s'il trouve un mot qui le frappe, il l'envisage sous toutes les formes, il le tourne et le retourne, il l'anagrammatise, et par le secours des voyelles arbitraires il en épuise tous les sens possibles, avec lesquels il construit quelque fable ou quelque mystérieuse absurdité ; ou pour mieux dire, il ne fait qu'un pur logogryphe, dont la clé se trouve dans le mot dont il s'est échauffé l'imagination, quoique ce mot n'ait souvent par lui-même aucun rapport à ses illusions. Nos logogryphes modernes sont sans-doute une branche de cette antique cabale, et cet art puérîle fait encore l'amusement des petits esprits. Telle a été enfin la véritable opération des fabulistes et des romanciers de l'antiquité, qui ont été en certains âges les seuls écrivains et les seuls historiens de presque toutes les nations. Ils abusèrent de même des écritures mystérieuses que les malheurs des temps avaient dispersées par le monde, et qui se trouvaient séparées des voyelles qui en avaient été la clé primitive. Ces siècles de mensonge ne finirent en particulier chez les Grecs, que vers les temps où les voyelles vulgaires ayant été heureusement inventées, l'abus des mots devint nécessairement plus difficîle et plus rare ; on se dégouta insensiblement de la fable ; les livres se transmirent sans altération ; peu-à-peu l'Europe vit naître chez elle l'âge de l'Histoire, et elle n'a cessé de recueillir le fruit de sa précieuse invention, par l'empire de la science qu'elle a toujours possédé depuis cette époque. Quant aux nations de l'Asie qui n'ont jamais voulu adopter les lettres voyelles de la Grèce comme la Grèce avait adopté leurs consonnes ; elles ont presque toujours conservé un invincible penchant pour le mystère et pour la fable ; elles ont eu dans tous les âges grand nombre d'écrivains cabalistiques, qui en ont imposé par de graves puérilités et par d'importantes bagatelles ; et quoiqu'il y ait eu des temps où les ouvrages des Européens les ont éclairés à leur tour, et leur ont servi de modèle pour composer d'excellentes choses en différents genres, ils ont affecté toujours dans leur diction des métathèses ou anagrammes ridicules, des allusions et des jeux de mots ; et la plupart de leurs livres nous présentent le mélange le plus bizarre de ces pensées hautes et sublimes qui ne leur manquent pas, avec un style affecté et puérile.
Cette histoire des points voyelles nous offre sans-doute la plus forte preuve que l'on puisse donner de leur indispensable nécessité. Nous avons Ve dans quelles erreurs sont tombées les nations qui les ont perdus par accident, ou négligés par ignorance et par mauvais gout. Jettons actuellement nos yeux sur cet heureux coin du monde où cette même écriture, qui n'était pour une infinité de peuples qu'une écriture du mensonge et du délire, était pour le peuple juif et sous la main de l'Esprit-saint, l'écriture de la sagesse et de la vérité.
On ne peut douter que Moyse élevé dans les arts et les sciences de l'Egypte, ne se soit particulièrement servi de l'écriture * ponctuée pour faire connaître ses lais, et qu'il n'en ait remis à l'ordre sacerdotal qu'il institua, des exemplaires soigneusement écrits en consonnes et en points voyelles, pour perpétuer par leur moyen le sens et l'intelligence d'une loi dont il avait si fort et si souvent recommandé l'exercice le plus exact et la pratique la plus sevère. Ce sage législateur ne pouvait ignorer le danger des lettres sans voyelles ; il ne pouvait pas non plus ignorer les fables qui en étaient déjà issues de son temps : il n'a donc pu manquer à une précaution que l'écriture de son siècle exigeait nécessairement, et de laquelle dépendait le succès de la législation. Il y aurait même lieu de croire qu'il en répandit aussi des exemplaires parmi le peuple, puisqu'il en a ordonné à tous la lecture et la méditation assidue ; mais il est difficîle à cet égard de penser que les copies en aient été fort fréquentes, attendu que sans le secours de l'impression on n'a pu, dans ces premiers âges et chez un peuple qui fournissait 600 mille combattants, multiplier les livres en raison des hommes ; nous ne devons sans-doute voir dans ce précepte que l'ordre de fréquenter assidument les instructions publiques et journalières, où les prêtres faisaient la lecture et l'explication de cette loi. On nous répondra sans-doute que chaque israélite était obligé dans sa jeunesse de la transcrire, et que les enfants des rois n'étaient pas eux-mêmes exemts de ce devoir. Mais si cette remarque nous fait connaître la véritable étendue du précepte de Moyse, il y a toute apparence qu'il en a été de l'observance de ce précepte comme à l'égard de tant d'autres, que les Hébreux n'ont point pratiqués, et qu'ils ont négligés ou oubliés presqu'aussitôt après le premier commandement qui leur en avait été fait ; on sait que leur infidélité sur tous les points de leur loi a été presque aussi continue qu'inconcevable. Conduits par Dieu même dans le désert, ils y négligent la circoncision pendant quarante ans, et toute la génération
* Comme le langage de l'Egypte n'a été qu'une dialecte assez semblable aux langues de Phénicie et de Palestine, on conjecture que l'écriture a dû être aussi la même. Ceci est d'autant plus vraisemblable, que les Hébreux écrivent de droite à gauche ainsi qu'écrivaient les Egyptiens, selon Hérodote.
de cet âge mérite d'y être exterminée. Sont-ils établis en Canaan ? ils y courent sans-cesse de Moloch à Baal, et de Baal à Astaroth. Qui pourrait le croire ? les descendants même de Moyse se font prêtres d'idoles. Sous les rais, leur frénésie n'a point à peine de relâche ; dix tribus abandonnent Moyse pour les veaux de Béthel ; et si Juda rentre quelquefois en lui-même, ses idolatries l'enveloppent aussi dans la ruine d'Israèl. Pendant dix siècles enfin ce peuple idolâtre et stupide fut presque semblable en tout aux nations incirconcises ; excepté qu'il avait le bonheur de posséder un livre précieux qu'il négligea toujours, et une loi sainte qu'il oublia au point que ce fut une merveille sous Josias de trouver un livre de Moyse, et que sous Esdras il fallut renouveller la fête des tabernacles, qui n'avait point été célebrée depuis Josué. La conduite des Juifs dans tous les temps qui ont précédé le retour de Babylone, est donc un monument constant de la rareté où ont dû être les ouvrages de son premier législateur. Délaissés dans l'arche et dans le sanctuaire à la garde des enfants d'Aaron, ceux-ci qui ne participèrent que trop souvent eux-mêmes aux désordres de leur nation, prirent sans-doute aussi l'esprit mystérieux des ministres idolâtres : peut-être qu'en n'en laissant paraitre que des exemplaires sans voyelles pour se rendre les maîtres et les arbitres de la loi des peuples, contribuèrent-ils à la faire méconnaître et oublier ; peut-être ne s'en servaient-ils dès lors que pour la recherche des choses occultes, comme leurs descendants le font encore, et ne les firent-ils servir de même qu'à des études absurdes et puériles, indignes de la majesté et de la gravité de leurs livres. Ce soupçon ne se justifie que trop, quand on se rappelle toutes les antiques fables dont la Cabale s'autorise sous les noms de Salomon et des prophetes, et il doit nous faire entrevoir quelle fut la raison pour laquelle Ezéchias fit bruler les ouvrages du plus savant des rois : c'est que les esprits faux et superstitieux abusaient sans-doute dès lors de ses hautes et sublimes recherches sur la nature, comme ils abusent encore de son nom et des écrits des prophetes qui l'ont suivi ou précédé. Au reste, que ce soit l'idolatrie d'Israèl qui ait occasionné la rareté des livres de Moyse, ou que leur rareté ait occasionné cette idolatrie, il faut encore ici convenir que la nature même de l'écriture a pu occasionner l'une et l'autre. Jamais cette antique façon de peindre la parole en abrégé, n'a été faite dans son origine pour être commune et vulgaire parmi le peuple : l'écriture sans consonnes est une énigme pour lui ; et celle même qui porte des points voyelles peut être si facilement altérée dans sa ponctuation et dans toutes ses minuties grammaticales, qu'il a dû y avoir un grand nombre de raisons essentielles pour l'ôter de la main de la multitude et de la main de l'étranger.
Un esprit inquiet et surpris pourra nous dire : Se peut-il faire que Dieu ayant donné une loi à son peuple, et lui en ayant si sévérement recommandé l'observation, ait pu permettre que l'écriture en fût obscure et la lecture difficîle ? comment ce peuple pouvait-il la méditer et la pratiquer ? Nous pourrions répondre qu'il a dépendu de ceux qui ont été les organes de la science et les canaux publics de l'instruction, de prévenir les égarements des peuples en remplissant eux-mêmes leurs devoirs selon la raison et selon la vérité : mais il en est sans-doute une cause plus haute qu'il ne nous appartient pas de pénétrer. Ce n'est pas à nous, aveugles mortels, à questionner la Providence : que ne lui demandons-nous aussi pourquoi elle s'est plu à ne parler aux Juifs qu'en parabole ; pourquoi elle leur a donné des yeux afin qu'ils ne vissent point, et des oreilles afin qu'ils n'entendissent point, et pourquoi de toutes les nations de l'antiquité elle a choisi particulièrement celle dont la tête était la plus dure et la plus grossière ? C'est ici qu'il faut se taire, orgueilleuse raison ; celui qui a permis l'égarement de sa nation favorite, est le même qui a puni l'égarement du premier homme, et personne n'y peut connaître que sa sagesse éternelle.
Si les crimes et les erreurs des Hébreux, semblables aux crimes et aux erreurs des autres nations, nous indiquent qu'ils ont pendant plusieurs âges négligé les livres de Moyse, et abusé de l'ancienne écriture pour se repaitre de chimères et se livrer aux mêmes folies qu'encensait le reste de la terre ; la conservation de ces livres précieux qui n'ont pu parvenir jusqu'à nous qu'à-travers une multitude de hazards, est cependant une preuve sensible que la Providence n'a jamais cessé de veiller sur eux, comme sur un dépôt moins fait pour les anciens hébreux que pour leur postérité et pour les nations futures.
Ce ne fut que dans les siècles qui suivirent le retour de la captivité de Babylone, que les Juifs se livrèrent à l'étude et à la pratique de leur loi, sans aucun retour vers l'idolatrie. Outre le souvenir des grands châtiments que leurs pères avaient essuyés, et qui était bien capable de les retenir d'abord ; ils conçurent sans-doute aussi quelque émulation pour l'étude, par leur commerce avec les grandes nations de l'Asie, et surtout par la fréquentation des Grecs, qui portèrent bientôt dans cette partie du monde leur politesse, leur goût et leur empire. Ce fut alors que la Judée fit valoir les livres de Moyse et des prophetes : elle les étudia profondément : elle eut une foule de commentateurs, d'interpretes et de savants : il se forma même différentes sectes de sages ou de philosophes ; et ce goût général pour les lettres et la science fut une cause seconde, mais puissante, qui retint les Juifs pour jamais dans l'exercice constant de leur religion : tant il est vrai qu'un peuple idiot et stupide ne peut être un peuple religieux, et que l'empire de l'ignorance ne peut être celui de la vérité.
Les premiers siècles après ce retour furent le bel âge de la nation juive : alors la loi triompha comme si Moyse ne l'eut donnée que dans ces instants. Pleins de vénération pour son nom et pour sa mémoire, les Juifs travaillèrent avec autant d'ardeur à la recherche de ses livres qu'à la reconstruction de leur temple. On ignore par quelle voie, en quel temps et en quel lieu ces livres si longtemps négligés se retrouvèrent. Les Juifs à cet égard exaltent peut-être trop les services qu'ils ont reçus d'Esdras dans ces premiers temps ; il leur tint presque lieu d'un second Moyse, * et c'est à lui ainsi qu'à la grande synagogue qu'ils attribuent la collection et la révision des livres sacrés, et même la ponctuation que nous y voyons aujourd'hui. Ils prétendent qu'il fut avec ses collègues secondé des lumières surnaturelles pour en retrouver l'intelligence qui s'était perdue : quelques-uns ont même poussé le merveilleux au point d'assurer qu'il les avait écrits de mémoire sous la dictée du Saint-Esprit. Mais le Pentateuque entre les mains des Samaritains
* Il est vraisemblable que le nom d'Esdras a donné lieu à toutes les traditions qui le concernent. Ce nom, tel qu'il est écrit dans le texte, se devrait dire Ezra ; et dérivé d'azar, il a secouru, on l'interprete secours, parce qu'Esdras a été d'un grand secours aux Juifs au retour de leur captivité. Mais il y en a eu d'autres qui l'ont aussi cherché dans zehar, il a institué, il a enseigné, et qui sous ce point de vue ont regardé Esdras comme l'instituteur de la plupart de leurs usages, et comme leur plus grand docteur. Le changement de dialecte d'Ezra en Esdra, parce que le z tourne en sd comme en ds, l'a fait encore chercher dans sadar, il a arrangé, il a mis en ordre. D'où ils ont aussi tiré cette conséquence, qu'Esdras avait été l'ordonnateur, le réviseur, et l'éditeur des livres sacrés. Tel est le grand art des Juifs dans la composition de leurs histoires traditionnelles : c'est donc avec bien de la raison que les Chrétiens ont rejeté ce qu'ils débitent sur Esdras, et tants d'autres anecdotes qui n'ont pas de meilleurs fondements.
ennemis des Juifs, dément une fable aussi absurde : nous devons donc être certains que la restauration des livres de Moyse et le renouvellement de la loi n'ont été faits que sur de très-antiques exemplaires et sur des textes ponctués, sans lesquels il eut été de toute impossibilité à un peuple qui avait négligé ses livres, son écriture et sa langue, d'en retrouver le sens et d'en accomplir les préceptes. Depuis cette époque, le zèle des Juifs pour leurs livres sacrés ne s'est jamais ralenti. Détruits par les Romains et dispersés par le monde, ils en ont toujours eu un soin religieux, les ont étudiés sans-cesse, et n'ont jamais souffert qu'on fit le plus léger changement non-seulement dans le fond ou la forme de leurs livres, mais encore dans les caractères et la ponctuation ; y toucher, serait commettre un sacrilège ; et ils ont à l'égard du plus petit accent ce respect idolâtre et superstitieux qu'on leur connait pour tout ce qui appartient à leurs antiquités. Il n'y a point pour eux de lettres qui ne soient saintes, qui ne renferment quelque mystère particulier ; chacune d'elles a même sa légende et son histoire. Mais il est superflu d'entrer dans cet étonnant détail : tout réel qu'il est, il paraitrait incroyable, aussi-bien que les peines infinies qu'ils se sont données pour faire le dénombrement de tous les caractères de la Bible, pour savoir le nombre général de tous ensemble, le nombre particulier de chacun, et leur position respective à l'égard les uns des autres et à l'égard de chaque partie du livre ; vastes et minucieuses entreprises, que des Juifs seuls étaient capables de concevoir et d'exécuter. Bien éloignés de cette servitude judaïque, nos savants commencent à prendre le goût des Bibles sans ponctuation, et peut-être en cela tombent-ils d'un excès dans un autre. Si nous n'étions point dans un siècle éclairé, où il n'est plus au pouvoir des hommes de ramener l'âge de la fable, nous penserions à l'aspect des nouvelles éditions des Bibles non ponctuées, que la Mythologie voudrait renaître.
Il n'est pas nécessaire sans-doute, en terminant ce qui concerne l'écriture hébraïque, de dire qu'elle se figure de droite à gauche ; c'est une singularité que peu de gens ignorent. Nous n'oserions déterminer si cette méthode a été aussi naturelle dans son temps, que la nôtre l'est aujourd'hui pour nous. Les nations se sont fait sur cela différents usages. Diodore, liv. III. parle d'un peuple des Indes qui écrivait de haut en bas : l'ancienne écriture de Fohi nous est représentée de même par les voyageurs. Les Egyptiens, selon Hérodote, écrivaient, ainsi que les Phéniciens, de droite à gauche ; et les Grecs ont eu quelques monuments fort anciens, dont ils appelaient l'écriture , parce qu'à l'imitation du labour des sillons, elle allait successivement de gauche à droite et de droite à gauche. Peut-être que le caprice, le mystère, ou quelqu'usage antérieur aux premières écritures, ont produit ces variétés ; peut-être n'y a-t-il d'autre cause que la commodité de chaque peuple relativement aux instruments et autres moyens dont on s'est d'abord servi pour graver, dessiner ou écrire : mais de simples conjectures ne méritent pas d'allonger notre article.
III. L'histoire de la langue hébraïque n'est chez les rabbins qu'un tissu de fables, et qu'un ample sujet de questions ridicules et puériles. Elle est, selon eux, la langue dont le Créateur s'est servi pour commander à la nature au commencement du monde ; c'est de la bouche de Dieu même que les anges et le premier homme l'ont apprise. Ce sont les enfants de celui-ci qui l'ont transmise de race en race et d'âge en âge, au-travers des révolutions du monde physique et moral, et qui l'ont fait passer sans interruption et sans altération de la famille des justes au peuple d'Israèl qui en est sorti. C'est une langue enfin dont l'origine est toute céleste, et qui retournant un jour à sa source, sera la langue des bienheureux dans le ciel, comme elle a été sur la terre la langue des saints et des prophetes. Mais laissons-là ces pieuses réveries, dont la religion ni la raison de notre âge ne peuvent plus s'accommoder, et fuyons cet excès qui a toujours été si fatal aux Juifs, qui ont idolatré leur langue et les mots de leur langue en négligeant les choses. Si le respect que nous avons pour les paroles de la Divinité, nous a porté à donner le titre de sainte à la langue hébraïque, nous savons que ce n'est qu'un attribut relatif que nous devons également donner aux langues chaldéenne, syriaque, et grecque, toutes les fois que le Saint-Esprit s'en est servi : nous savons d'ailleurs que la Divinité n'a point de langage, et qu'on ne doit donner ce nom qu'aux bonnes inspirations qu'elle met au fond de nos cœurs, pour nous porter au bien, à la vérité, à la paix, et pour nous les faire aimer. Voilà la langue divine ; elle est de tous les âges et de tous les lieux, et son efficacité l'emporte sur les langues de la terre les plus éloquentes et les plus énergiques.
La langue hébraïque est une langue humaine, ainsi que toutes celles qui se sont parlées et qui se parlent ici bas ; comme toutes les autres, elle a eu son commencement, son règne et sa fin, et comme elles encore, elle a eu son génie particulier, ses beautés et ses défauts. Sortie de la nuit des temps, nous ignorons son origine historique ; et nous n'oserions avancer avec la confiance des Juifs, qu'elle est antérieure aux anciens desastres du monde. S'il était permis cependant d'hazarder quelques conjectures raisonnables, fondées sur l'antiquité même de cette langue et sur sa pauvreté, nous dirions qu'elle n'a commencé qu'après les premiers âges du monde renouvellé ; qu'il a pu se faire que ceux même qui ont échappé aux destructions, aient eu pour un temps une langue plus riche et plus formée, qui aurait été sans-doute une de celles de l'ancien monde ; mais que la postérité de ces débris du genre humain n'ayant produit d'abord que de petites sociétés qui ont dû nécessairement être longtemps misérables et toutes occupées de leurs besoins et de leur subsistance, il a dû arriver que leur langage primitif se sera appauvri, aura dégénéré de race en race, et n'aura plus formé qu'un idiome de famille, qu'une langue pauvre, concise et sauvage pendant plusieurs siècles, qui sera ensuite devenue la mère des langues qui ont été propres et particulières aux premiers peuples et à leur colonie. Il en est des langues comme des nations : elles sont riches, fécondes, étendues en proportion de la grandeur et de la puissance des sociétés qui les parlent ; elles sont arides et pauvres chez les Sauvages ; et elles se sont agrandies et embellies partout où la population, le commerce, les sciences et les passions ont agrandi l'esprit humain. Elles ont aussi été sujettes à toutes les révolutions morales et politiques où ont été exposées les puissances de la terre ; elles se sont formées, elles ont régné, elles ont dégénéré, et se sont éteintes avec elles. Jugeons donc quels terribles effets ont dû faire sur les premières langues des hommes, ces coups de la Providence, qui peuvent éteindre les nations en un clin-d'oeil, et qui ont autrefois frappé la terre, comme nous l'apprennent nos traditions religieuses et tous les monuments de la nature. Si les arts ne furent point épargnés, si les inventions se perdirent, et s'il a fallu des siècles pour les retrouver et les renouveller, à plus forte raison les langues qui en avaient été la source, le canal et le monument, se perdirent-elles de même, et furent-elles ensevelies dans la ruine commune. Le très-petit nombre de traditions qui nous restent sur les temps antérieurs à ces révolutions, et la multitude de fables par lesquelles on a cherché à y suppléer, serait en cas de besoin une preuve de nos conjectures : mais ne sont-elles que des conjectures ?
Il est donc très-peu vraisemblable que l'origine de la langue hébraïque puisse remonter au-delà du renouvellement du monde : tout au plus est-elle une des premières qui ait été formée et fixée lorsque des nations en corps ont commencé à reparaitre, et qu'elles ont pu s'occuper à d'autres objets qu'à leurs besoins. Nous disons tout au plus, parce que malgré la simplicité de la langue hébraïque, elle est quelquefois trop riche en synonymes, dont grand nombre de verbes et plusieurs substantifs ont une singulière quantité ; ce qui suppose une aisance d'esprit et une abondance dont le génie des premières familles n'a pu être susceptible pendant longtemps, et ce qui décele des richesses acquises ailleurs après l'agrandissement des sociétés.
Pour nous prouver toute l'antériorité de leur langage, les Juifs nous montrent les noms des premiers hommes, dont l'interprétation convenable ne peut se trouver que chez eux : toute fondée que soit cette remarque, quoiqu'il y ait plusieurs de ces noms qui tiennent plus au chaldéen qu'à l'hébreu, il n'y a qu'une aveugle prévention qui puisse s'en faire un titre, et l'on n'y voit autre chose sinon que ce sont des auteurs hébreux et chaldéens qui nous ont transmis le sens primitif de ces noms propres en les traduisant en leur langue : s'ils eussent été grecs, ils eussent donné des noms grecs, et des noms latins s'ils eussent été latins ; parce qu'il a été aussi ordinaire que naturel à tous les anciens peuples de rendre le sens des noms traditionnels en leur langue. Ils y étaient forcés, parce que ces noms faisaient souvent une partie de l'histoire, et qu'il fallait traduire les uns en traduisant l'autre, afin de les rendre mutuellement intelligibles, et parce que le renouvellement des arts et des sciences exigeait nécessairement le renouvellement des noms. La Mythologie qui n'a que trop connu cet ancien usage de traduire les noms pour expliquer l'histoire, nous montre souvent l'abus qu'elle en a fait, en les dérivant de sources étrangères, et en personnifiant quelquefois des êtres naturels et métaphysiques : ses méprises en ce genre sont, comme on sait, une des sources de la fable. Mais nous devons à cet égard rendre la justice qui est dû. aux écrivains divinement inspirés : c'est par eux que la foi nous apprend que le premier homme a été appelé terre ou terrestre, et la première femme la vie. La raison concourt même à nous dire que l'homme est terre et que la femme donne la vie ; mais ni l'une ni l'autre ne nous ont jamais fait connaître quels sont les premiers mots par lesquels ont été désignés la terre et la vie.
Il est de plus fort incertain quel nom de peuple la langue hébraïque a pu porter dans son origine. Ce n'a point été le nom des Hébreux, qui malgré l'antiquité de leur famille, n'ont été qu'un peuple nouveau vis-à-vis des Chaldéens d'où Abraham est sorti, et vis-à-vis des Cananéens et Egyptiens, où ce patriarche et ses enfants ont si longtemps voyagé en simples particuliers. Si la langue de la Bible est celle d'Abraham, elle ne peut être que la langue même de l'ancienne Chaldée : si elle ne l'est point, elle ne doit être qu'une langue nouvelle ou étrangère. Entre ces deux alternatives il est un milieu sans-doute auquel nous devons nous arrêter. Abraham, chaldéen de famille et de naissance, n'ayant pu parler autrement que chaldéen, il est plus que vraisemblable que sa postérité a dû conserver son langage pendant quelques générations, et qu'ensuite leur commerce et leurs liaisons avec les Cananéens, les Arabes et les Egyptiens l'ayant peu-à-peu changé, il en est résulté une nouvelle dialecte propre et particuculière aux Israélites : d'où nous devons présumer que la langue hébraïque, telle que nous l'avons dans la Bible, ne doit pas remonter plus d'un siècle avant les écrits de Moyse : le chaldéen d'Abraham en a été le principe ; il est ensuite fondu avec le cananéen, qui n'en était lui-même qu'une ancienne branche. La langue de la basse Egypte, qui devait peu différer de celle de Canaan, a contribué de son côté à l'altérer ou à l'enrichir, ainsi que la langue arabe, comme on le voit particulièrement dans le livre de Job. Pour trouver dans l'histoire quelques traces de cette filiation de la langue hébraïque, et des révolutions qu'a subi le chaldéen primitif chez les différents peuples, il faut remarquer dans l'Ecriture qu'Abraham ne se sert point d'interprete chez les Cananéens ni chez les Egyptiens, parce qu'alors leurs dialectes différaient peu sans-doute du chaldéen de ce patriarche. Elieser et Jacob qui habitèrent chez les mêmes peuples, et qui firent chacun un voyage en Chaldée, n'avaient point non plus oublié leur langue originaire, puisqu'ils conversèrent au premier abord avec les pasteurs de cette contrée et avec toute la famille d'Abraham ; mais Jacob néanmoins s'était déjà familiarisé avec la langue de Canaan, puisqu'en se séparant de Laban, il eut soin de donner un nom d'une autre dialecte au monument auquel Laban donna un nom chaldéen. Il y avait alors cent quatrevingt ans qu'Abraham avait quitté sa terre natale. Ainsi la dialecte hébraïque avait déjà pu se former. Ce seul exemple peut nous faire juger de la différence que le temps continua de mettre dans le langage de ce peuple naissant. Dans ce même intervalle, les langues cananéenne et égyptienne faisaient aussi des progrès chacune de leur côté ; et il fallut que Joseph en Egypte se servit d'interprete pour parler à ses frères.
Ces différences n'ont cependant jamais été assez grandes pour rendre toutes ces langues méconnaissables entr'elles, quoique le chaldéen d'Abraham ait dû souffrir de grands changements dans l'intervalle de plus de quatorze cent ans qui s'est écoulé depuis ce patriarche jusqu'à Daniel. Il différait moins alors de la langue de Moyse, que l'italien, le français et l'espagnol ne diffèrent entr'eux, quoiqu'ils soient moins éloignés des siècles de la latinité qui les a tous formés. Sur quoi nous devons observer qu'il ne faut jamais dans l'Ecriture prendre le nom de langue à la rigueur ; lorsqu'en parlant des Chaldéens, des Cananéens, des Egyptiens, des Amalécites, des Ammonites, etc. elle nous dit quelquefois que tel ou tel peuple parlait un langage inconnu, cela ne peut signifier qu'une dialecte différente, qu'un autre accent, et qu'une autre prononciation ; et il faut avouer que tous ces divers modes ont dû être extrémement variés, puisqu'on rencontre en plusieurs endroits de l'Ecriture des preuves que les Hébreux se sont servis d'interpretes vis-à-vis de tous ces peuples, quoique le fond de leur langue fût le même, comme nous en pouvons juger par les livres et les vestiges qui en sont restés, où toutes ces langues s'expliquent les unes par les autres. Il nous manque sans-doute, pour apprécier leurs différences, les oreilles des peuples qui les ont parlé. Il fallait être Athénien pour reconnaître au langage que Demosthène était étranger dans Athènes ; et il faudrait de même être Hébreu ou Chaldéen, pour saisir toutes les différences de prononciation qui diversifiaient si considérablement toutes ces anciennes dialectes, quoiqu'issues d'une même source. Au reste, nous ne devons point être étonnés de remarquer dans toutes ces contrées de l'Asie le langage d'Abraham ; il était sorti d'un pays et d'un peuple qui dans presque tous les temps a étendu sur elles sa puissance et son empire, tantôt par les armes et toujours par les sciences. L'Euphrate a successivement été le siège des Chaldéens, des Assyriens, des Babyloniens et des Perses ; et ces énormes puissances n'ayant jamais cessé de donner le ton à cette partie occidentale de l'Asie, il a bien fallu que la langue dominante fût celle du peuple dominant. C'est ainsi qu'on a Ve en Europe et en différents temps le grec et le latin devenir des langues générales : et cet empire des langues, qui est la suite de l'empire des nations, en est en même temps le monument le plus constant et le plus durable.
Celle de toutes ces dialectes chaldéennes avec laquelle la langue d'Abraham et de Jacob a contracté cependant le plus d'affinité, a été sans contredit la dialecte cananéenne ou phénicienne. Les colonies de ces peuples commerçans chez les nations riveraines de la Méditerranée et de l'Océan, ont laissé par-tout une multitude de vestiges qui nous prouvent que la langue d'Abraham s'était intimement incorporée avec celle de Phénicie, pour former la langue de Moyse, que l'Ecriture pour cette raison sans doute appelle quelquefois la langue de Canaan. Les auteurs qui ont traité de l'une, ont cru aussi devoir traiter de l'autre ; et c'est à leur exemple, que pour ne point laisser incomplet ce qui concerne la langue hébraïque, nous parlerons de la langue de Phénicie et de ses révolutions chez les différents peuples où elle a été portée, après que nous aurons suivi chez les Hébreux les révolutions de la langue de Moyse.
La langue des Israélites se trouvant fixée par les ouvrages de Moyse, n'a plus été sujette à aucune variation, comme on le voit par les ouvrages des prophetes qui lui ont succédé d'âge en âge jusqu'à la captivité de Babylone. On pourrait donc regarder les dix siècles que renferme cet espace de temps comme la mesure certaine de la durée de la langue hébraïque. Après ce long règne, elle fut, diton, oubliée des Hébreux, qui dans les soixante-dix ans de leur captivité, s'habituèrent tellement à la dialecte chaldéenne qui se parlait alors à Babylone, qu'à leur retour en Judée ils n'eurent plus d'autre langue vulgaire. Un oubli aussi prompt nous parait cependant si extraordinaire, qu'il y a lieu d'être étonné qu'on ait jusqu'ici reçu sans méfiance ce que les traditions judaïques nous ont transmis pour nous rendre raison de la révolution qui s'est faite autrefois dans la langue de leurs pères. Quoiqu'il soit fort certain qu'au temps d'Esdras et de Daniel les Hébreux ne parlaient et n'écrivaient plus qu'en Chaldéen, d'un autre côté il est si peu vraisemblable que tout un peuple ait oublié sa langue en soixante et dix ans, qu'une tradition aussi suspecte du côté du vrai que du côté de la nature, aurait dû faire soupçonner qu'ils l'avaient déjà oubliée et négligée longtemps avant cette époque. Si notre sentiment est nouveau, il n'en est peut-être pas moins raisonnable, et nous pouvons le fortifier de quelques observations. Nous remarquerons donc que cette captivité n'emmena point tous les Hébreux, qu'il en resta beaucoup en Judée, et que de tous ceux qui furent enlevés, il en revint plusieurs qui vécurent encore assez de temps pour voir le second temple qui fut long à construire, et pour pleurer sur les ruines du premier. Nous ajouterons que cette captivité à laquelle on donne soixante et dix ans, parce qu'elle commença pour quelques-uns au premier siège de Jérusalem en 606 avant Jesus-Christ, et qu'elle finit en 536, ne dura néanmoins pour le plus grand nombre que cinquante-trois ans, à compter de 586, époque de la ruine totale du temple, après le troisième et dernier siège. Or dans un intervalle aussi court, une nation entière n'a pu oublier sa langue, ni s'habituer à une langue étrangère, à-moins qu'elle n'y fût déjà disposée par un usage plus ancien et par un oubli antérieur de sa langue naturelle. D'ailleurs la durée que l'on accorde communément à la langue hébraïque, est une durée excessive, surtout pour une langue orientale, qui plus que toutes les autres sont susceptibles d'altération. Il n'en faut point chercher d'autre preuve que dans ce Chaldéen même auquel on dit que les Juifs se sont habitués dans leur captivité. Il différait dès-lors du chaldéen d'Abraham ; il s'était perfectionné et enrichi par des finales plus sonores, et par des expressions empruntées non-seulement des Perses, des Medes, et autres nations voisines, mais aussi des nations les plus éloignées, témoin le sumphoneiah, du IIIe chap. de Daniel, . 5. 10. 15. mot grec qui dès le temps de Cyrus avait déjà pénétré à Babylone. Les Hébreux eux-mêmes ne s'y furent pas plutôt familiarisés, qu'ils continuèrent à le corrompre de leur côté. Le chaldéen d'Onkelos n'est plus le chaldéen d'Esdras ; et celui des Paraphrastes, qui ont continué ses commentaires, en diffère infiniment. S'il fallait donc juger des révolutions qu'a dû essuyer le premier langage des Juifs, par celles où celui qui passe pour avoir été leur second, a été exposé, à peine pourrions-nous donner quatre ou cinq siècles d'intégrité et de durée à la langue de Moyse.
Il est vrai que la Bible à la main on essayera de nous prouver par les ouvrages des prophetes de tous les âges, antérieurs à la captivité, que l'hébreu de Moyse n'a point cessé d'être vulgaire jusqu'à cet événement. Mais par le même raisonnement ne tentera-t-on pas aussi de nous prouver que le latin a toujours été vulgaire, en nous montrant tous les ouvrages qui ont été successivement écrits en cette langue, depuis une longue suite de siècles ? Il faudrait être sans-doute bien prévenu, ou, pour mieux dire, bien aveugle, pour hasarder un tel paradoxe. Une langue peut être celle des savants, sans être celle du peuple ; et ce n'est que lorsqu'elle n'appartient plus à ce dernier, qu'elle arrive à l'immutabilité, ce caractère essentiel des langues mortes, où les langues vivantes ne peuvent jamais parvenir. La véritable induction que nous devons donc tirer de cette longue succession d'ouvrages tous écrits dans la dialecte de Moyse, c'est qu'après lui elle a été la dialecte particulière des prophetes, et que de vulgaire qu'elle avait été dans les premiers temps, elle n'a plus été qu'une langue savante, et peut-être même qu'une langue sacrée qui ne s'est plus altérée, parce qu'elle s'est conservée dans le sanctuaire, où elle a été hors des atteintes de la multitude, qui, comme le dit l'Ecriture, s'habituait facilement aux dialectes et aux usages des nations étrangères qu'elle fréquentait. Le génie de la langue hébraïque est tellement le même dans tous les écrits des prophetes, quoique composés en des âges fort distants les uns des autres, que si le caractère particulier de chaque écrivain ne se faisait connaître dans chaque livre, on penserait que tous ces ouvrages n'ont été que d'un seul temps et d'une seule plume ; ut ferè quis putare posset omnes illos libros eodem tempore esse conscriptos. (Voyez la note entière *.) La construction,
* Plurimum etiam ad perfectionem linguae hebraeae facit ejusdem constantia in omnibus libris veteris Testamenti. Miratus saepissime fui quod tanta sit linguae hebraeae convenientia in omnibus libris veteris Testamenti, cum sciamus libros illos a diversis viris qui saepe proprium stylum expresserunt, diversis temporibus, et diversis in locis esse conscriptos. Scribatur liber a diversis viris in eadem civitate habitantibus, videbimus ferè majorem differentiam in illo libro, vel respectu styli, vel copulationis litterarum, vel respectu aliarum circumstantiarum, quam in totis Bibliis. Verum si liber sit scriptus, verbi causa, à Teutonio et Frisio, vel si intercedat inter scriptores differentia mille annorum, quanta in multis libris veteris Testamenti respectu scriptionis intercessit, eheu ! quanta esset differentia linguae ! Qui unam scripturam intelligit, vix alteram intelligeret : imo erit tanta differentia, ut vix ullas eas linguas, ob differentiam temporis et loci ita discrepantes, regulis Grammaticoe et Syntaxeos comprehendere possit. Verum in veteri Testamento tanta est constantia, tanta convenientia in copulatione litterarum, et constructione vocum, ut fère quis putare posset omnes illos libros eodem tempore, iisdem in locis, à diversis tamen authoribus esse conscriptos. Leusden. Philologus hebrœus dissertatio 17.
l'appareil des mots, la syntaxe, le caractère de la langue enfin sont si semblables et si monotones partout, qu'un esprit inquiet et soupçonneux en pourrait tirer des conséquences aussi conttaires à l'antiquité et à l'intégrité de ces livres précieux, que notre observation leur est au contraire favorable. L'immutabilité de leur style et de leur diction, dont celle de Moyse a toujours été le modèle, s'est communiquée aux faits et à la mémoire des faits ; et c'était le seul moyen de les transmettre jusqu'à nous, malgré l'inconstance et les égarements d'une nation capricieuse et volage. Tous les sages de l'antiquité qui ont, aussi-bien que le sacerdoce hébreu, connu les avantages des langues mortes, n'ont point manqué de se servir de même, dans leurs annales, d'une langue particulière et sacrée : c'était un usage général, que la religion, d'accord en cela avec la politique, avait établi chez tous les anciens peuples. Le génie de l'antiquité concourt donc avec la fortune des langues, à justifier nos réflexions. Il n'est point d'ailleurs difficîle de juger que la langue de Moyse avait dû se corrompre parmi son peuple ; nous avons Ve ci-devant combien il avait négligé ses livres, son écriture et sa loi. La même conduite lui fit aussi négliger son langage ; l'oubli de l'un était une suite nécessaire de l'autre. Pour nous peindre les Hébreux pendant les dix siècles presque continus de leurs désordres et de leur idolatrie, nous pouvons sans doute nous représenter les Guèbres aujourd'hui répandus dans l'Inde avec les livres de Zoroastre qu'ils conservent encore sans les pouvoir lire et sans les entendre ; ils n'y connaissent que du blanc et du noir : et telle a dû être pendant l'idolatrie d'Israèl la position du commun des Juifs vis-à-vis des livres de leur législateur. Si leur conduite présente nous fait connaître à quel point ils les considèrent et les respectent aujourd'hui, leur conduite primitive doit nous montrer quel a été pour ce religieux dépôt l'excès de leur indifférence. Jamais livres n'ont couru de plus grands risques de se perdre et de devenir inintelligibles ; et il n'en est point cependant sur qui la Providence ait plus veillé : c'est sans doute un miracle qu'un exemplaire en ait été trouvé par le saint roi Josias, qui s'en servit pour retirer pendant un temps le peuple de ses désordres : mais si un Achab, une Jézabel, ou une Athalie les eut trouvés, qui doute que ces livres précieux n'eussent eu chez les Hébreux même le sort qu'ont eu chez les Romains les livres de Numa, que le hasard retrouva, et que la politique brula, pour ne point changer la religion, c'est-à-dire la superstition établie ?
Ce fut vraisemblablement par le seul canal des savants, des prêtres, et particulièrement des voyans ou prophetes qui se succédèrent les uns aux autres, que la langue et les ouvrages de Moyse se sont conservés ; ceux-ci seuls en ont fait leur étude, ils y puisaient la loi et la science ; et selon qu'ils étaient bien ou mal intentionnés, ils égaraient les peuples, ou les retiraient de leurs égarements. Le langage du législateur devint pour eux un langage sacré, qui seul eut le privilège d'être employé dans les annales, dans les hymnes, et surtout dans les livres prophétiques, qui après avoir été interpretés au peuple, ou lus en langue vulgaire, étaient ensuite déposés au sanctuaire, pour être un monument inaltérable vis-à-vis des nations futures que ces diverses prophéties devaient un jour intéresser.
On nous demandera dans quel temps la langue de Moyse a cessé d'être en usage parmi les Hébreux ; c'est ce qu'il n'est pas facîle de déterminer : ce n'est pas en un seul temps, mais en plusieurs, qu'une langue s'altère et se corrompt. Nous pouvons conjecturer cependant, que ce fut en grande partie sous les juges, et dans ces cinq ou six siècles où la nation juive n'eut rien de fixe dans son gouvernement et dans sa religion, et qu'elle suivait en tout ses délires et ses caprices. Nous fixons notre conjecture à ces temps, parce que sous les rois nous remarquons dans les noms propres un génie et une tournure toute différente des anciens noms sonores, emphatiques, et presque tous composés ; ils n'ont plus ce caractère antique, et cette simplicité des noms propres de tous les âges antérieurs. Quoique notre remarque soit délicate, on en doit sentir la justesse, parce que chez les anciens les noms propres n'ayant point été héréditaires, ont dû toujours appartenir aux dialectes vulgaires, et que la langue sacrée ou historique n'a pu les changer en traduisant les faits. Nous pouvons donc de leur dissimilitude chez les Hébreux en tirer cette conclusion, que le génie de leur langue avait changé et changeait d'âge en âge, par la fréquentation des diverses nations dont ils ont toujours été ou les alliés ou les esclaves. C'est de même par le caractère de la plupart de leurs noms propres, dans les derniers siècles qui ont précédé Jesus-Christ, que l'on juge aussi que les Hébreux se sont ensuite familiarisés avec le grec, parce que leurs noms dans les Macchabées et dans l'historien Josephe, sont souvent tirés de cette langue. Il est vrai que ces deux ouvrages sont écrits en grec ; mais quand ils le seraient en hébreu, leurs auteurs n'en auraient pu changer les noms, et dans l'un ou l'autre texte, ils nous serviraient de même à juger des liaisons qu'avaient contracté les Hébreux avec les conquérants de l'Asie.
Mais quelle a été la langue d'Israèl après celle de son législateur, et avant le Chaldéen d'Esdras et de Daniel ? c'est ce qu'il est impossible de fixer ; ce ne pourrait être au reste qu'une dialecte particulière de celle de Moyse corrompue par des dialectes étrangères. Les dix tribus en avaient une qui en différait déjà, comme on le voit par le Pentateuque samaritain, qui n'est plus le pur hébreu de la Bible ; et nous sçavons par Esdras, que les Juifs presque confondus avec les peuples voisins, avaient adopté leurs différents idiomes, et parlaient les uns la langue d'Azot, et d'autres celle de Moab, d'Ammon, etc. Cela seul peut nous suffire avec ce que nous avons dit ci-dessus, pour entrevoir toutes les variations et les révolutions de la langue hébraïque vulgaire pendant dix siècles, et jusqu'au temps où nous trouvons les Juifs tout à fait familiarisés et habitués au chaldéen : dès-lors il ne pouvait y avoir que bien du temps qu'ils avaient perdu l'usage de la langue de leurs ancêtres : car par les efforts qu'ils firent du temps d'Esdras pour rétablir leur culte et leurs usages, il est à croire qu'ils eussent aussi tenté de rétablir leur langage, s'il n'eut été suspendu que par le court espace de leur captivité. S'ils ont donc sur ce changement des traditions contraires à nos observations, mettons-les au nombre de tant d'autres anecdotes sans date et sans époque, qu'ils ont inventé, et dont ils veulent bien se satisfaire.
La langue de Babylone devenue celle de Judée, fut aussi sujette à de semblables révolutions ; les Juifs la parlèrent jusqu'à leur dernière destruction par les Romains, mais ce fut en l'altérant de génération en génération, par un bizarre mélange de syrien, d'arabe et de grec. Dispersés ensuite parmi les nations, ils n'ont plus eu d'autre langue vulgaire que celle des différents peuples chez lesquels ils se sont habitués ; aujourd'hui ils parlent français en France, et allemand au-delà du Rhin. La langue de Moyse est leur langue savante ; ils l'apprennent comme nous apprenons le grec et le latin, moins pour la parler que pour s'instruire de leur loi : beaucoup de Juifs même ne la sçavent point ; mais ils ne manquent pas d'en apprendre par cœur les passages qui leur servent de prières journalières, parce que, selon leurs préjugés, c'est la seule langue dans laquelle il convient de parler à la Divinité. D'ailleurs si quelques-uns parlent l'hébreu comme nous essayons de parler le grec et le latin, c'est avec une grande diversité dans la prononciation ; chaque nation de juif a la sienne : enfin il y a un grand nombre d'expressions dont ils ont eux-mêmes perdu le sens, aussi-bien que les autres peuples. Telles sont en particulier presque tous les noms de pierres, d'arbres, de plantes, d'animaux, d'instruments, et de meubles, dont l'intelligence n'a pu être transmise par la tradition, et dont les savants d'après la captivité n'ont pu donner une interprétation certaine ; nouvelle preuve que cette langue était dès lors hors d'usage et depuis plusieurs siècles.
IV. Nous avons quitté dans l'article précédent la langue d'Abraham, pour en suivre les révolutions chez les Hébreux, sous le nom de langue de Moyse ; et nous avons promis de la reprendre dans ce nouvel article, pour la suivre sous le nom des Cananéens ou Phéniciens, qui l'ont répandue en différentes contrées de l'occident. Ce n'est pas que la langue de ce patriarche ait été dans son temps la langue de Phénicie ; mais nous avons dit que sa famille qui vécut dans cette contrée et qui s'y établit à la fin, incorpora tellement sa langue originaire avec celle de ces peuples maritimes, que c'est essentiellement de ce mélange que s'est formé la langue de Moyse, que l'écriture pour cette raison appelle aussi quelquefois langue de Canaan. Que les Phéniciens, auxquels les Grecs ont avoué devoir leur écriture et leurs premiers arts, aient été les mêmes peuples que l'Ecriture appelle Cananéens, il n'en faudrait point d'autre témoignage que ce nom même qu'elle leur donne, puisqu'il signifie dans la langue de la Bible, des marchands, et que nous sçavons par l'Histoire que les Phéniciens ont été les plus grands commerçans et les plus fameux navigateurs de la haute antiquité ; l'Ecriture nous les fait encore reconnaître d'une manière aussi certaine que par leur nom, en assignant pour demeure à ces Cananéens toutes les côtes de la Palestine, et entr'autres les villes de Sidon et de Tyr, centre du commerce des Phéniciens. Nous pourrions même ajouter que ces deux noms de peuples n'ont point été différents dans leur origine, et qu'ils n'ont l'un et l'autre qu'une seule et même racine : mais nous laisserons de côté cette discussion étymologique, pour suivre notre principal objet. *
Quoique la vraie splendeur des Phéniciens remonte au-delà des temps historiques de la Grèce et de l'Italie, et qu'il ne soit resté d'eux ni monuments ni annales, on sçait cependant qu'il n'y a point eu de peuples en occident qui aient porté en plus d'endroits leur commerce et leur industrie. Nous ne le sçavons, il est vrai, que par les obscures traditions de la Grèce ; mais les modernes les ont éclairées par la langue de la Bible, avec laquelle on peut suivre ces anciens peuples comme à la piste chez toutes les nations afriquaines et européennes, où ils ont avec leur commerce porté leurs fables, leurs divinités et leur langage ; preuve incontestable sans doute, que la langue d'Abraham s'était intimement fondue avec celle des Phéniciens, pour en former, comme nous avons dit, la dialecte de Moyse.
Ces peuples qui furent en partie exterminés et dispersés par Josué, avaient dès les premiers temps commercé avec l'Europe grossière et presque sauvage, comme nous commerçons aujourd'hui avec l'Amérique ; ils y avaient établi de même des comptoirs et des colonies qui en civilisèrent les habitants par leur commerce, qui en adoucirent les mœurs en s'alliant avec eux, et qui leur donnèrent peu-à-peu le goût des arts, en les amusant de leurs cérémonies et de leurs fables ; premiers pas par où les hommes prennent le goût de la société, de la religion, et de la science.
Avec les lettres phéniciennes, qui ne sont autres, comme nous avons vu, que ces mêmes lettres qu'adopta aussi la postérité d'Abraham, ces peuples portèrent leur langage en diverses contrées occidentales ; et du mélange qui s'en fit avec les langues nationales de ces contrées, il y a tout lieu de penser qu'il s'en forma en Afrique le carthaginois, et en Europe le grec, le latin, le celtique, etc. Le carthaginois en particulier, comme étant la plus moderne de leurs colonies, semblait au temps de S. Augustin n'être encore qu'une dialecte de la langue de Moyse : aussi Bochart, sans autre interprete que la Bible, a-t-il traduit fort heureusement un fragment carthaginois que Plaute nous a conservé.
La langue grecque nous offre aussi, mais non dans la même mesure, un grand nombre de racines phéniciennes qu'on retrouve dans la Bible, et qui chez les Grecs paraissent visiblement avoir été ajoutées à un fond primitif de langue nationale.
Il en est de même du latin ; et quoiqu'on n'ait pas fait encore de recherche particulière à ce sujet, parce qu'on est prévenu que cette langue doit beaucoup aux Grecs, elle contient néanmoins, et bien plus que le grec lui-même, une abondance singulière de mots phéniciens qui se sont latinisés.
Nous ne parlerons point de l'Etrusque et de quelques anciennes langues qui ne nous sont connues que par quelques mots où l'on aperçoit cependant de semblables vestiges : mais nous n'oublierons point d'indiquer le celtique, comme une de ces langues avec lesquelles le phénicien s'est allié. On n'ignore point que le breton en particulier n'en est encore aujourd'hui qu'une dialecte ; mais nous renvoyons au dictionnaire de cette province, qui depuis peu d'années a été donné au public, et au dictionnaire celtique dont on lui a déjà présenté un volume, et dont la suite est attendue avec impatience.
Nous pourrions aussi nommer à la suite de ces langues mortes plusieurs de nos langues vivantes, qui toutes du plus au moins contiennent non-seulement des mots phéniciens grécisés et latinisés, que nous tenons de ces deux derniers peuples, mais aussi un bien plus grand nombre d'autres qu'ils n'ont point eu, et que nos pères n'ont pu acquérir que par le canal direct des commerçans de Phénicie, auxquels le bassin de la Méditerranée et le passage de l'Océan ont ouvert l'entrée de toutes les nations maritimes de l'Europe. C'est ainsi que l'Amérique à son tour offrira à ses peuples futurs des langues nouvelles qu'auront produit les divers mélanges de leurs langues sauvages avec celles de nos colonies européennes.
Ce serait un ouvrage aussi curieux qu'utile, que
* Les Phéniciens se disaient issus de Cna ; selon l'usage de l'antiquité, ils devaient donc être appelés les enfants de Cna, comme on disait les enfants d'Heber, pour désigner les Hébreux. En prononçant ce nom de peuple à la façon de la Bible, nous dirions, Benei-Ceni, ou Benei-Cini. Il y a apparence que le dernier a été d'usage, surtout chez les étrangers, qui changeant encore le b en ph, comme il leur arrivait souvent, et contractant les lettres à cause de l'absence des voyelles, ont fait d'un seul mot Phenicini, d'où Phoenix, Poenus, Punicus, et Phenicien. Quant au nom de Cna, il n'est autre que la racine contractée de Canaan, et signifie marchand : aussi était-il regardé comme un surnom de Mercure, dieu du Commerce.
les étymologies françaises uniquement tirées de la Bible. On ose dire que la récolte en serait très-abondante, et que ce pourrait être l'ouvrage le plus intéressant qui aurait jamais été fait sur les langues, par le soin que l'on aurait de faire la généalogie des mots, quand ils auraient successivement passé dans l'usage de plusieurs peuples, et de montrer leur déguisement quand ils ont été séparément adoptés de diverses nations. Ce qu'on propose pour le français, se peut également proposer pour plusieurs autres langues de l'Europe, où il est peu de nation qui ne soit dans le cas de pouvoir entreprendre un tel ouvrage avec succès : peut-être qu'à la fin ces différentes recherches mettraient à portée de faire le dictionnaire raisonné des langues de l'Europe ancienne et moderne. Le phénicien serait presque la base de ce grand édifice, parce qu'il y a peu de nos contrées où le commerce ne l'ait autrefois porté, et que depuis ces temps les nations européennes se sont si fort mélangées, ainsi que leurs langues propres ou acquises, que les différences qui se trouvent entr'elles aujourd'hui, ne sont qu'apparentes et non réelles.
Au reste, l'entreprise de ces recherches particulières ou générales, ne pourrait point se conduire par les mêmes principes dont nous nous servons pour chercher nos étymologies dans le grec et le latin, qui en passant dans nos langues se sont si peu corrompues, que l'on peut presque toujours les chercher et les trouver par des voies régulières. Il n'en est pas de même du phénicien ; toutes les nations de l'Europe en ont étrangement abusé, parce que les langues orientales leur ont toujours été fort étrangères, et que l'écriture en était singulière et difficîle à lire. On peut se rappeler ce que nous avons dit du travail des cabalistes et des anciens mythologistes, qui ont anagrammatisé les lettres, altéré les syllabes pour y chercher des sens mystérieux ; les anciens européens ont fait la même chose, non dans le même dessein, mais par ignorance, et parce que la nature d'une écriture abrégée et renversée porte naturellement à ces méprises ceux qui n'y sont point familiarisés. Ils ont souvent lu de droite à gauche ce qu'il fallait lire de gauche à droite, et par-là ils ont renversé les mots et presque toujours les syllabes. C'est ainsi que de cathenoth, vêtements, l'inverse thounecath a donné tunica ; que luag, avaler, a donné gula, gueule ; hemer, vin, merum. Taraph, prendre, s'est changé en raphta, d'où raptus chez les Latins, et attraper chez les Français. De geber, le maître, et de gebereth, la maîtresse, nos pères ont fait berger et bergerete. Notre adjectif blanc vient de laban et leban, qui signifient la même chose dans le phénicien ; mais leban a donné belan, et par contraction blan. De laban les Latins ont fait albon, d'où albus et albanus ; et par le changement du b en p, fort commun chez les anciens, on a dit aussi alphan, d'où l'alphos des Grecs. Avec une multitude d'expressions semblables, toutes analysées et décomposées, un dictionnaire raisonné pourrait offrir encore le dénouement d'une infinité de jeux de mots, et même d'usages anciens et modernes, fondés sur cette ancienne langue, et dont nous ne connaissons plus le sel et la valeur, quoiqu'ils se soient transmis jusqu'à nous.
Si, à l'exemple des anciens, notre cérémonial exige une triple salutation ; si ces anciens plus superstitieux que nous jetaient trois cris sur la tombe des morts, en leur disant un triple adieu ; s'ils appelaient trois fois Hécate aux déclins de la lune ; s'ils faisaient des sacrifices expiatoires sur trois autels, à la fin des grands périodes ; et s'ils avaient enfin une multitude d'autres usages de ce genre, c'est que l'expression de la paix et du salut qu'on invoquait ou que l'on se souhaitait dans ces circonstances, était presque le même mot que celui qui désignait le nombre trois dans les langues phéniciennes et carthaginoises ; le nœud de ces usages énygmatiques se trouve dans ces deux mots schalom et schalos. Par une allusion du même genre, nous disons aussi, tout ce qui reluit n'est pas or : or signifie reluire ; et ce proverbe avait beaucoup plus de sel chez les orientaux, qui se plaisaient infiniment dans ces sortes de jeux de mots.
Si notre jeunesse nomme sabot le volubîle buxum de Virgile, on en voit la raison dans la Bible, où sabav signifie tourner. Si nos Vanniers appellent osier le bois flexible qu'ils emploient, c'est qu'oseri signifie liant, et ce qui sert à lier. Si les nourrices en disant à leurs enfants, paye chopine, les habituent à frapper dans la main ; et après les marchés faits si le peuple prononce le même mot, fait la même action et Ve au cabaret, c'est que chopen signifie la paume de la main, et que chez les Phéniciens on disait frapper un traité, pour dire faire un traité. Ceci nous apprend que le nom vulgaire de la mesure de vin qui se bait parmi le peuple après un accord, ne vient que de l'action qui l'a précédée. Telles seraient les connaissances que l'étude de la langue phénicienne offrirait tantôt à la Grammaire et tantôt à l'Histoire. Ces exemples pris entre mille de l'un et de l'autre genre, engageront peut-être un jour quelques savants à la tirer de son obscurité ; elle est la première des langues savantes, et d'ailleurs elle n'est autre que celle de la Bible, dont il n'est point de page qui n'offre quelques phénomènes de cette espèce. C'est ce qui nous a engagé à proposer un ouvrage qui contribuerait infiniment à développer le génie de la langue hébraïque et des peuples qui l'ont parlée, et qui nous ferait connaître la singulière propriété qu'elle a de pouvoir se déguiser en cent façons, par des inversions peu communes dans nos langues européennes, mais qui proviennent dans celles de l'Asie, de l'absence des voyelles, et de la façon d'écrire de gauche à droite, qui n'a point été naturelle à tous les peuples.
V. Il nous reste à parler plus particulièrement du génie de la langue hébraïque et de son caractère. C'est une langue pauvre de mots et riche de sens ; sa richesse a été la suite de sa pauvreté, parce qu'il a fallu nécessairement charger une même expression de diverses valeurs, pour suppléer à la disette des mots et des signes. Elle est à-la-fais très-simple et très-composée ; très-simple, parce qu'elle ne fait qu'un cercle étroit autour d'un petit nombre de mots ; et très-composée, parce que les figures, les métaphores, les comparaisons, les allusions y sont très-multipliées, et qu'il y a peu d'expression où l'on n'ait besoin de quelque réflexion, pour juger s'il faut la prendre au sens naturel ou au sens figuré. Cette langue est expressive et énergique dans les hymnes et les autres ouvrages où le cœur et l'imagination parlent et dominent. Mais il en est de cette énergie comme de l'expression d'un étranger qui parle une langue qui ne lui est pas encore assez familière pour qu'elle se prête à toutes ses idées ; ce qui l'oblige, pour se faire entendre, à des efforts de génie qui mettent dans sa bouche une force qui n'est pas naturelle à ceux qui la parlent d'habitude.
Il n'y a point de langue pauvre et même sauvage, qui ne soit vive, touchante, et plus souvent sublime, qu'une langue riche qui fournit à toutes les idées et à toutes les situations. Cette dernière à la vérité a l'avantage de la netteté, de la justesse, et de la précision ; mais elle est ordinairement privée de ce nerf surnaturel et de ce feu dont les langues pauvres et dont les langues primitives ont été animées. Une langue telle que la française, par exemple, qui fuit les figures et les allusions, qui ne souffre rien que de naturel, qui ne trouve de beauté que dans le simple, n'est que le langage de l'homme réduit à la raison. La langue hébraïque au contraire est la vraie langue de la poésie, de la prophétie, et de la révélation ; un feu céleste l'anime et la transporte : quelle ardeur dans ses cantiques ! quelles sublimes images dans les visions d'Isaïe ! que de pathétique et de touchant dans les larmes de Jérémie ! on y trouve des beautés et des modes en tout genre. Rien de plus capable que ce langage pour élever une âme poétique, et nous ne craignons point d'assurer que la Bible, en un grand nombre d'endroits supérieure aux Homères et aux Virgiles, peut inspirer encore plus qu'eux ce génie rare et particulier qui convient à ceux qui se livrent à la Poésie. On y trouve moins à la vérité, de ce que nous appelons méthode, et de cette liaison d'idées où se plait le flegme de l'occident : mais en faut-il pour sentir ? Il est fort singulier, et cependant fort vrai, que tout ce qui compose les agréments et les ornements du langage, et tout ce qui a formé l'éloquence, n'est dû qu'à la pauvreté des langues primitives ; l'art n'a fait que copier l'ancienne nature, et n'a jamais surpassé ce qu'elle a produit dans les temps les plus arides. De-là sont venues toutes ces figures de Rhétorique, ces fleurs, et ces brillantes allégories où l'imagination déploie toute sa fécondité. Mais il en est souvent aujourd'hui de toutes ces beautés comme des fleurs transportées d'un climat dans un autre ; nous ne les goutons plus comme autrefois, parce qu'elles sont déplacées dans nos langues qui n'en ont pas un besoin réel, et qu'elles ne sont plus pour nous dans le vrai ; nous en sentons le jeu, et nous en voyons l'artifice que les anciens ne voyaient pas. Pour nous, c'est le langage de l'art ; pour eux, c'était celui de la nature.
La vivacité du génie oriental a fort contribué aussi à donner cet éclat poétique à toutes les parties de la Bible qui en ont été susceptibles, comme les hymnes et les prophéties. Dans ces ouvrages, les pensées triomphent toujours de la stérilité de la langue, et elles ont mis à contribution le ciel, la terre et toute la nature, pour peindre les idées où ce langage se refusait. Mais il n'en est pas de même du simple récitatif et du style des annales. Les faits, la clarté, et la précision nécessaire ont gêné l'imagination sans l'échauffer ; aussi la diction est-elle toujours seche, aride, concise, et cependant pleine de répétitions monotones ; le seul ornement dont il parait qu'on a cherché à l'embellir, sont des consonnances recherchées, des paronomasies, des métathèses, et des allusions dans les mots qui présentent les faits avec une appareil qui ne nous paraitrait aujourd'hui qu'affectation, s'il fallait juger des anciens selon notre façon de penser, et de leur style par le nôtre.
Caïn va-t-il errer dans la terre de Nod, après le meurtre d'Abel, l'auteur pour exprimer fugitif, prend le dérivé de nadad, vagari, pour faire allusion au nom de la contrée où il va.
Abraham part-il pour aller à Gerare, ville d'Abimelech ; comme le nom de cette ville sonne avec les dérivés de gur et de ger, voyager et voyageur, l'Ecriture s'en sert par préférence à tout autre terme, parce que peregrinatus est in Gerarâ présente par un double aspect peregrinatus est in peregrinatione.
Nabal refuse-t-il à David la subsistance, on voit à la suite que chez Nabal était la folie, que l'Ecriture exprime alors par nebalah.
Ces sortes d'allusions si fréquentes dans la Bible tiennent à ce goût que l'on y remarque aussi de donner toujours l'étymologie des noms propres : chacune de ces étymologies presente de même un jeu de mots qui sonnait sans-doute agréablement aux oreilles des anciens peuples ; elles ne sont point toujours régulièrement tirées ; et il a paru aux Savants qu'elles étaient plus souvent des approximations et des allusions, que des étymologies vraiment grammaticales. On trouve même dans la Bible plusieurs allusions différentes à l'occasion d'un même nom propre. Nous nous bornerons à un exemple déjà connu. Le nom de Moyse, en hébreu Moschéh, que le vulgaire interprete retiré des eaux, ne signifie point à la lettre retiré, ni encore moins retiré des eaux, mais retirant ou celui qui retire. Si cependant la fille de Pharaon lui a donné ce nom en le sauvant du Nil, c'est qu'elle ne savait pas l'hébreu correctement, ou qu'elle s'est servie d'une dialecte différente, ou qu'elle n'a cherché qu'une allusion générale au verbe maschah, retirer. Mais il est une autre allusion à laquelle le nom de Moschéh convient davantage ; c'est dans ces endroits si fréquents, où il est dit, Maise qui vous a ou qui nous a retiré d'Egypte. Ici l'allusion est vraiment grammaticale et régulière, puisqu'elle peut présenter littéralement, le retireur qui nous a retirés d'Egypte. C'est un genre de pléonasme historique fort commun dans l'Ecriture, et duquel il faut bien distinguer les pleonasmes de Rhétorique, qui y sont encore plus communs ; sans quoi on courait le risque de personnifier des verbes et autres expressions du discours, ainsi qu'il est arrivé dans la Mythologie des peuples qui ont abusé des langues de l'orient.
Cette fréquence d'allusions recherchées dans une langue où les consonnances étaient d'ailleurs si naturelles, à cause du fréquent retour des mêmes expressions, a de quoi nous étonner sans-doute ; mais il est vraisemblable que la stérilité des mots qui obligeait de les ramener souvent, est ce qui a donné lieu par la suite à les rechercher avec empressement. Ce qui n'était d'abord que l'effet de la nécessité a été regardé comme un agrément ; et l'oreille qui s'habitue à tout y a trouvé une grâce et une harmonie dont il a fallu orner une multitude d'endroits qui pouvaient s'en passer. Au reste, de tous les agréments de la diction, c'est à celui-là particulièrement que tous les anciens peuples se sont plu, parce qu'il est presque naturel aux premiers efforts de l'esprit humain ; et que l'abondance n'ayant point été un des caractères de leur langue primitive, ils n'ont point cru devoir user du peu qu'ils avaient avec cette sobriété et cette délicatesse moderne, enfants du luxe des langues. Nous en voyons même encore tous les jours des exemples parmi le peuple, qui est à l'égard du monde poli ce que les premiers âges du monde renouvellé sont pour les nôtres. On le voit chez toutes les nations qui se forment, ou qui ne se sont pas encore livrées à l'étude. On ne trouve plus dans Cicéron ces jeux sur les noms et sur les mots si fréquents dans Plaute ; et chez nous les progrès de l'esprit et du génie ont supprimé ces concetti qui ont fait les agréments de notre première littérature. Nous remarquerons seulement que nous avons conservé la rime qui n'est qu'une de ces anciennes consonnances si familières aux premiers peuples, dont nos pères l'ont sans-doute héritée. Quoique son origine se perde pour nous dans des siècles ténébreux, nous pouvons soupçonner que cette rime ne peut être qu'un présent oriental, puisque ce nom même de rime qui n'a de racine dans aucune langue d'Europe, peut signifier dans celles de l'orient l'élévation de la voix, ou un son élevé.
Nous ne sommes point entrés dans ce détail pour faire des reproches aux écrivains hébreux qui n'ont point été les inventeurs de leur langue, et qui ont été obligés de se servir de celle qui était en usage de leur temps et dans leur nation. Ils n'ont fait que se conformer au génie et au caractère de la langue reçue et à la tournure de l'esprit national dont Dieu a bien voulu emprunter le goût et le langage. Toutes les nations orientales ont eu, comme les Hébreux, ce style familier en allusion ; et ceux d'entr'eux qui ont voulu écrire en langues européennes, n'ont pas manqué de se dévoiler par là ; tels sont entr'autres ceux qui ont composé les sibylles vraies ou fausses dont nous avons quelques fragments. Il ne faut que ce passage apocalyptique pour y reconnaître le pays de leurs auteurs :
Articles populaires Logique
OBÉIR
v. n. (Grammaire) c'est se soumettre à la volonté d'un autre. Celui qui commande est censé supérieur, et celui qui obéit subalterne. On obéit à Dieu, en suivant sa loi ; aux rais, en remplissant leurs lois ; à la nécessité, aux passions, etc.Obéir se prend encore dans un sens différent, lorsqu'il se dit d'un corps roide, inflexible, qu'on ne plie pas à volonté ; le fer trempé n'obéit pas, etc.
Lire la suite...