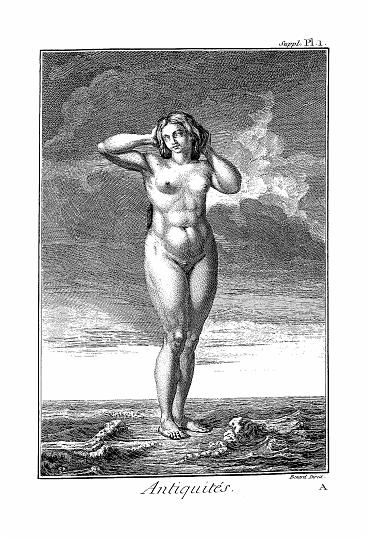Antiquité romaine
- Détails
- Écrit par Denis Diderot (*)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Antiquité romaine
- Affichages : 1987
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Antiquité romaine
- Affichages : 1977
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Antiquité romaine
Romulus divisa le peuple Romain en trois tribus, qui formèrent trente curies, parce que chaque tribu fut composée de dix curies, c'est-à-dire de mille hommes. Les cérémonies des fêtes se faisaient dans un lieu sacré destiné à chaque curie, dont le prêtre ou le sacrificateur s'appela curion, à sacris curandis, parce qu'il avait soin des sacrifices. Le peuple s'assemblait par curies dans la place de Rome appelée comitium, pour y gérer toutes les affaires de la république. Il ne se prenait aucune résolution, soit pour la paix, soit pour la guerre, que dans ces assemblées. C'est là qu'on créait les rais, qu'on élisait les magistrats et les prêtres, qu'on établissait des lais, et qu'on administrait la justice. Le roi de concert avec le sénat, convoquait ces assemblées, et décidait par un sénatus-consulte du jour qu'on devait les tenir, et des matières qu'on y devait traiter. Il fallait un second sénatus-consulte pour confirmer ce qui y avait été arrêté. Le prince ou premier magistrat présidait à ces assemblées, qui étaient toujours précédées par des auspices et par des sacrifices, dont les patriciens étaient les seuls ministres.
- Affichages : 2023
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Antiquité romaine
- Affichages : 3320
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Antiquité romaine
Les Romains ayant chassé leurs rais, se virent obligés de créer un dictateur dans les périls extrêmes de la république, comme, par exemple, lorsqu'elle était agitée par de dangereuses séditions, ou lorsqu'elle était attaquée par des ennemis redoutables. Dès que le dictateur était nommé, il se trouvait revêtu de la suprême puissance ; il avait droit de vie et de mort, à Rome comme dans les armées, sur les généraux et sur tous les citoyens, de quelque rang qu'ils fussent : l'autorité et les fonctions des autres magistrats, à l'exception de celle des tribuns du peuple, cessaient, ou lui étaient subordonnées : il nommait le général de la cavalerie qui était à ses ordres, qui lui servait de lieutenant, &, si l'on peut parler ainsi, de capitaine des gardes : vingt-quatre licteurs portaient les faisceaux et les haches devant lui, et douze seulement les portaient devant le consul : il pouvait lever des troupes, faire la paix ou la guerre selon qu'il le jugeait à-propos, sans être obligé de rendre compte de sa conduite, et de prendre l'avis du sénat et du peuple : en un mot il jouissait d'un pouvoir plus grand que ne l'avaient jamais eu les anciens rois de Rome ; mais comme il pouvait abuser de ce vaste pouvoir si suspect à des républicains, on prenait toujours la précaution de ne le lui déférer tout au plus que pour six mois.
- Affichages : 2120
Page 1 sur 20