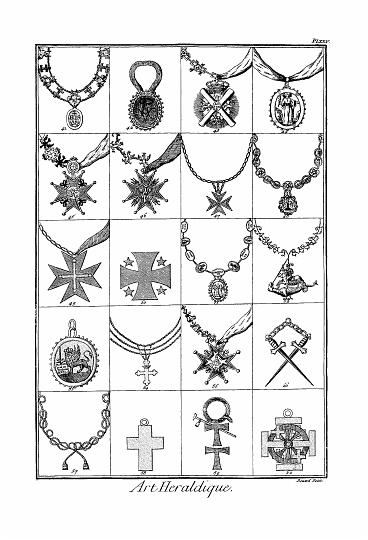S. m. (Logique et Grammaire) il y a trois choses à considérer dans les mots, le matériel, l'étymologie, et la valeur. Le matériel des mots comprend tout ce qui concerne les sons simples ou articulés qui constituent les syllabes qui en sont les parties intégrantes, et c'est ce qui fait la matière des articles SON, SYLLABE, ACCENT, PROSODIE, LETTRES, CONSONNE, VOYELLE, DIPHTONGUE, etc. L'étymologie comprend ce qui appartient à la première origine des mots, à leurs générations successives et analogiques, et aux différentes altérations qu'ils subissent de temps à autre, et c'est la matière des articles ETYMOLOGIE, FORMATION, ONOMATOPEE, METAPLASME avec ses espèces, EUPHONIE, RACINE, LANGUE article IIIe § 22. &c.
Pour ce qui concerne la valeur des mots, elle consiste dans la totalité des idées qui en constituent le sens propre et figuré. Un mot est pris dans le sens propre lorsqu'il est employé pour exciter dans l'esprit l'idée totale que l'usage primitif a eu intention de lui faire signifier : et il est pris dans un sens figuré lorsqu'il présente à l'esprit une autre idée totale à laquelle il n'a rapport que par l'analogie de celle qui est l'objet du sens propre. Ainsi le sens propre est antérieur au sens figuré, il en est le fondement ; c'est donc lui qui caractérise la vraie nature des mots, et le seul par conséquent qui doive être l'objet de cet article : ce qui appartient au sens figuré est traité aux articles FIGURE, TROPE avec ses espèces, &c.
La voie analytique et expérimentale me parait, à tous égards et dans tous les genres, la plus sure que puisse prendre l'esprit humain pour réussir dans ses recherches. Ce principe justifié négativement par la chute de la plupart des hypothèses qui n'avaient de réalité que dans les têtes qui les avaient conçues, et positivement par les succès rapides et prodigieux de la physique moderne, aura par-tout la même fécondité, et l'application n'en peut être qu'heureuse, même dans les matières grammaticales. Les mots sont comme les instruments de la manifestation de nos pensées : des instruments ne peuvent être bien connus que par leurs services ; et les services ne se devinent point ; on les éprouve ; on les voit, on les observe. Les différents usages des langues sont donc, en quelque manière, les phénomènes grammaticaux, de l'observation desquels il faut s'élever à la généralisation des principes et aux notions universelles.
Or le premier coup-d'oeil jeté sur les langues, montre sensiblement que le cœur et l'esprit ont chacun leur langage. Celui du cœur est inspiré par la nature et n'a presque rien d'arbitraire, aussi est-il également entendu chez toutes les nations, et il semble même que les brutes qui nous environnent en aient quelquefois l'intelligence, le vocabulaire en est court, il se réduit aux seules interjections, qui ont par-tout les mêmes radicaux, parce qu'elles tiennent à la constitution physique de l'organe. Voyez INTERJECTION. Elles désignent dans celui qui s'en sert une affection, un sentiment ; elles ne l'excitent pas dans l'âme de celui qui les entend, elles ne lui en présentent que l'idée. Vous conversez avec votre ami que la goutte retient au lit ; tout-à-coup il vous interrompt par ahi, ahi ! Ce cri arraché par la douleur est le signe naturel et l'existence de ce sentiment dans son âme, mais il n'indique aucune idée dans son esprit. Par rapport à vous, ce mot vous communique-t-il la même affection ? Non ; vous n'y tiendriez pas plus que votre ami, et vous deviendriez son écho : il ne fait naître en vous que l'idée de l'existence de ce sentiment douloureux dans votre ami, précisément comme s'il vous eut dit : voilà que je ressens une vive et subite douleur. La différence qu'il y a, c'est que vous êtes bien plus persuadé par le cri interjectif, que vous ne le seriez par la proposition froide que je viens d'y substituer : ce qui prouve, pour le dire en passant, que cette proposition n'est point, comme le parait dire le P. Buffier, Grammaire française n °. 163. et 164. l'équivalent de l'interjection ouf, ni d'aucune autre : le langage du cœur se fait aussi entendre au cœur, quoique par occasion il éclaire l'esprit.
Je donnerais à ce premier ordre des mots le nom d'affectifs, pour le distinguer de ceux qui appartiennent au langage de l'esprit, et que je désignerais par le titre d'énonciatifs. Ceux-ci sont en plus grand nombre, ne sont que peu ou point naturels, et doivent leur existence et leur signification à la convention usuelle et fortuite de chaque nation. Deux différences purement matérielles, mais qui tiennent apparemment à celles de la nature même, semblent les partager naturellement en deux classes ; les mots déclinables dans l'une, et les indéclinables dans l'autre. Voyez INDECLINABLES. Ces deux propriétés opposées sont trop uniformément attachées aux mêmes espèces dans tous les idiomes, pour n'être pas des suites nécessaires de l'idée distinctive des deux classes, et il ne peut être qu'utîle de remonter, par l'examen analytique de ces caractères, jusqu'à l'idée essentielle qui en est le fondement ; mais il n'y a que la déclinabilité qui puisse être l'objet de cette analyse, parce qu'elle est positive et qu'elle tient à des faits, au-lieu que l'indéclinabilité n'est qu'une propriété négative, et qui ne peut nous rien indiquer que par son contraire.
I. Des mots déclinables. Les variations qui résultent de la déclinabilité des mots, sont ce qu'on appelle en Grammaire, les nombres, les cas, les genres, les personnes, les temps, et les modes.
1°. Les nombres sont des variations qui désignent les différentes quotités. Voyez NOMBRE. C'est celle qui est la plus universellement adoptée dans les langues ; et la plus constamment admise dans toutes les espèces de mots déclinables : savoir les noms, les pronoms, les adjectifs, et les verbes. Ces quatre espèces de mots doivent donc avoir une signification fondamentale commune, au-moins jusqu'à un certain point : une propriété matérielle qui leur est commune, suppose nécessairement quelque chose de commun dans leur nature, et la nature des signes consiste dans leur signification, mais il est certain qu'on ne peut nombrer que des êtres ; et par conséquent il semble nécessaire de conclure que la signification fondamentale, commune aux quatre espèces de mots déclinables, consiste à présenter à l'esprit des idées des êtres, soit réels, soit abstraits, qui peuvent être les objets de notre pensée.
Cette conclusion n'est pas conforme, je l'avoue, aux principes de la Grammaire générale, partie II. chap. j. ni à ceux de M. du Marsais, de M. Duclos, de M. Fromant ; elle perd en cela l'avantage d'être soutenue par des autorités d'autant plus pondérantes, que tout le monde connait les grandes lumières de ces auteurs respectables : mais enfin des autorités ne sont que des motifs et non des preuves ; et elles ne doivent servir qu'à confirmer des conclusions déduites légitimement de principes incontestables, et non à établir des principes peu ou point discutés. J'ose me flatter que la suite de cette analyse démontrera que je ne dis ici rien de trop : je continue.
Si les quatre espèces de mots déclinables présentent également à l'esprit des idées des êtres ; la différence de ces espèces doit donc venir de la différence des points de vue sous lesquels elles font envisager les êtres. Cette conséquence se confirme par la différence même des lois qui règlent par-tout l'emploi des nombres relativement à la diversité des espèces.
A l'égard des noms et des pronoms, ce sont les besoins réels de l'énonciation, d'après ce qui existe dans l'esprit de celui qui parle, qui règlent le choix des nombres. C'est tout autre chose des adjectifs et des verbes ; ils ne prennent les terminaisons numériques que par une sorte d'imitation, et pour être en concordance avec les noms ou les pronoms auxquels ils ont rapport, et qui sont comme leurs originaux.
Par exemple, dans ce début de la première fable de Phèdre, ad rivum eumdem lupus et agnus venerant siti compulsi ; les quatre noms rivum, lupus, agnus, et siti, sont au nombre singulier, parce que l'auteur ne voulait et ne devait effectivement désigner qu'un seul ruisseau, un seul loup, un seul agneau, et un seul et même besoin de boire. Mais c'est par imitation et pour s'accorder en nombre avec le nom rivum, que l'adjectif eumdem est au singulier. C'est par la même raison d'imitation et de concordance que le verbe venerant et l'adjectif-verbe ou le participe compulsi, sont au nombre pluriel ; chacun de ces mots s'accorde ainsi en nombre avec la collection des deux noms singuliers, lupus et agnus, qui font ensemble pluralité.
Les quatre espèces de mots réunies en une seule classe par leur déclinabilité, se trouvent ici divisées en deux ordres caractérisés par des points de vue différents.
Les inflexions numériques des noms et des pronoms se décident dans le discours d'après ce qui existe dans l'esprit de celui qui parle : mais quand on se décide par soi-même pour le nombre singulier ou pour le nombre pluriel, on ne peut avoir dans l'esprit que des êtres déterminés : les noms et les pronoms présentent donc à l'esprit des êtres déterminés ; c'est là le point de vue commun qui leur est propre.
Mais les adjectifs et les verbes ne se revêtent des terminaisons numériques que par imitation ; ils ont donc un rapport nécessaire aux noms ou aux pronoms leurs corrélatifs : c'est le rapport d'identité qui suppose que les adjectifs et les verbes ne présentent à l'esprit que des êtres quelconques et indéterminés, voyez IDENTITE, et c'est-là le point de vue commun qui est propre à ces deux espèces, et qui les distingue des deux autres.
2°. La même doctrine que nous venons d'établir sur la théorie des nombres, se déduit de même de celle des cas. Les cas en général sont des terminaisons différentes qui ajoutent à l'idée principale du mot l'idée accessoire d'un rapport déterminé à l'ordre analytique de l'énonciation. Voyez CAS, et les articles des différents cas. La distinction des cas n'est pas d'un usage universel dans toutes les langues, mais elle est possible dans toutes, puisqu'elle existe dans quelques-unes, et cela suffit pour en faire le fondement d'une théorie générale.
La première observation qu'elle fournit, c'est que les quatre espèces de mots déclinables reçoivent les inflexions des cas dans les langues qui les admettent, ce qui indique dans les quatre espèces une signification fondamentale commune : nous avons déjà Ve qu'elle consiste à présenter à l'esprit les idées des êtres réels ou abstraits qui peuvent être les objets de nos pensées ; et l'on déduirait la même conséquence de la nature des cas, par la raison qu'il n'y a que des êtres qui soient susceptibles des rapports, et qui puissent en être les termes.
La seconde observation qui nait de l'usage des cas, c'est que deux sortes de principes en règlent le choix, comme celui des nombres : ce sont les besoins de l'énonciation, d'après ce qui existe dans l'esprit de celui qui parle, qui fixent le choix des cas pour les noms et pour les pronoms ; c'est une raison d'imitation et de concordance qui est décidée pour les adjectifs et pour les verbes.
Ainsi le nom rivum, dans la phrase de Phèdre, est à l'accusatif, parce qu'il est le complément de la préposition ad, et que le complément de cette préposition est assujetti par l'usage de la langue latine à se revêtir de cette terminaison ; les noms lupus et agnus sont au nominatif, parce que chacun d'eux exprime une partie grammaticale du sujet logique du verbe venerant, et que le nominatif est le cas destiné par l'usage de la langue latine à désigner ce rapport à l'ordre analytique. Voilà des raisons de nécessité ; en voici d'imitation : l'adjectif eumdem est à l'accusatif, pour s'accorder en cas avec son corrélatif rivum ; l'adjectif-verbe, ou le participe compulsi, est au nominatif, pour s'accorder aussi en cas avec les noms lupus et agnus auxquels il est appliqué.
Ceci nous fournit encore les mêmes conséquences déjà établies à l'occasion des nombres. La diversité des motifs qui décident les cas, divise pareillement en deux ordres les quatre espèces de mots déclinables ; et ces deux ordres sont précisément les mêmes qui ont été distingués par la diversité des principes qui règlent le choix des nombres. Les noms et les pronoms sont du premier ordre, les adjectifs et les verbes sont du second.
Les cas désignent des rapports déterminés, et les cas des noms et des pronoms se décident d'après ce qui existe dans l'esprit de celui qui parle : or on ne peut fixer dans son esprit que les rapports des êtres déterminés, parce que des êtres indéterminés ne peuvent avoir des rapports fixes. Il suit donc encore de ceci que les noms et les pronoms présentent à l'esprit des êtres déterminés.
Au contraire les cas des adjectifs et des verbes ne servent qu'à mettre ces espèces des mots en concordance avec leurs corrélatifs : nous pouvons donc en conclure encore que les adjectifs et les verbes ne présentent à l'esprit que des êtres indéterminés, puisqu'ils ont besoin d'une déterminaison accidentelle pour pouvoir prendre tel ou tel cas.
3°. Le système des nombres et celui des cas sont les mêmes pour les noms et pour les pronoms ; et l'on en conclut également que les uns et les autres présentent à l'esprit des êtres déterminés, ce qui constitue l'idée commune ou générique de leur essence. Mais par rapport aux genres, ces deux parties d'oraison se séparent et suivent des lois différentes.
Chaque nom a un genre fixe et déterminé par l'usage, ou par la nature de l'objet nommé, ou par le choix libre de celui qui parle : ainsi pater (pere) est du masculin, mater (mere) est du féminin, par nature ; baculus (bâton) est du masculin, mensa (table) est du féminin, par usage ; finis en latin, duché en français, sont du masculin ou du féminin, au gré de celui qui parle. Voyez GENRE. Les pronoms au contraire n'ont point de genre fixe ; de sorte que sous la même terminaison ou sous des terminaisons différentes, ils sont tantôt d'un genre et tantôt d'un autre, non au gré de celui qui parle, mais selon le genre même du nom auquel le pronom a rapport : ainsi en grec, ego en latin, ich en allemand, io en italien, je en français, sont masculins dans la bouche d'un homme, et féminins dans celle d'une femme ; au contraire il est toujours masculin, et elle toujours féminin, quoique ces deux mots, au genre près, aient le même sens, ou plutôt ne soient que le même mot, avec différentes inflexions et terminaisons.
Voilà donc entre le nom et le pronom un rapport d'identité fondé sur le genre ; mais l'identité suppose un même être présenté dans l'une des deux espèces de mots d'une manière précise et déterminée, et dans l'autre, d'une manière vague et indéfinie. Ce qui précède prouve que les noms et les pronoms présentent également à l'esprit des êtres déterminés : il faut donc conclure ici que ces deux espèces différent entr'elles par l'idée déterminative : l'idée précise qui détermine dans les noms, est vague et indéfinie dans les pronoms ; et cette idée est sans doute le fondement de la distinction des genres, puisque les genres appartiennent exclusivement aux noms, et ne se trouvent dans les pronoms que comme la livrée des noms auxquels ils se rapportent.
Les genres ne sont, par rapport aux noms, que différentes classes dans lesquelles on les a distribués assez arbitrairement ; mais à-travers la bizarrerie de cette distribution, la distinction même des genres et dénominations qu'on leur a données dans toutes les langues qui les ont reçus, indiquent assez clairement que dans cette distribution on a prétendu avoir égard à la nature des êtres exprimés par les noms. Voyez GENRE. C'est précisément l'idée déterminative qui les caractérise, l'idée spécifique qui les distingue des autres espèces : les noms sont donc une espèce de mots déclinables, qui présentent à l'esprit des êtres déterminés par l'idée de leur nature.
Cette conclusion acquiert un nouveau degré de certitude, si l'on fait attention à la première division des noms en appelatifs et en propres, et à la soudivision des appelatifs en génériques et en spécifiques. L'idée déterminante dans les noms appelatifs, est celle d'une nature commune à plusieurs ; dans les noms propres, c'est l'idée d'une nature individuelle ; dans les noms génériques, l'idée déterminante est celle d'une nature commune à toutes les espèces comprises sous un même genre et à tous les individus de chacune de ces espèces ; dans les noms spécifiques, l'idée déterminante est celle d'une nature qui n'est commune qu'aux individus d'une seule espèce. Animal, homme, brute, chien, cheval, etc. sont des noms appelatifs ; animal est générique à l'égard des noms homme et brute, qui sont spécifiques par rapport à animal ; brute est générique à l'égard des noms chien, cheval, etc. et ceux-ci sont spécifiques à l'égard de brute : Ciceron, Médor, Bucéphale, sont des noms propres compris sous les spécifiques homme, chien, cheval.
Il en est encore des adjectifs et des verbes, par rapport aux genres, comme par rapport aux nombres et aux cas : ce sont des terminaisons différentes qu'ils prennent successivement selon le genre propre du nom auquel ils ont rapport, qu'ils imitent en quelque manière, et avec lequel ils s'accordent. Ainsi dans la même phrase de Phèdre, l'adjectif eumdem a une inflexion masculine pour s'accorder en genre avec le nom rivum, auquel il se rapporte ; et l'adjectif-verbe ou participe compulsi, a de même la terminaison masculine pour s'accorder en genre avec les deux noms lupus et agnus, ses corrélatifs. Il en résulte donc encore que ces deux espèces de mots présentent à l'esprit des êtres indéterminés.
4°. La distribution physique des noms en différentes classes que l'on nomme genres, et leur division métaphysique en appelatifs génériques, spécifiques et propres, sont également fondées sur l'idée déterminative qui caractérise cette espèce. La division des pronoms doit avoir un fondement pareil, si l'analogie qui règle tout d'une manière plus ou moins marquée, ne nous manque pas ici. Or on divise les pronoms par les personnes, et l'on distingue ceux de la première, ceux de la seconde, et ceux de la troisième.
Les personnes sont les relations des êtres à l'acte même de la parole ; et il y en a trois, puisqu'on peut distinguer le sujet qui parle, celui à qui on adresse la parole, et enfin l'être, qui est simplement l'objet du discours, sans le prononcer et sans être apostrophé. Voyez PERSONNE. Or les usages de toutes les langues déposent unanimement que l'une de ces trois relations à l'acte de la parole, est déterminément attachée à chaque pronom : ainsi en grec, ego en latin, ich en allemand, io en italien ; je en français, expriment déterminément le sujet qui produit ou qui est censé produire l'acte de la parole, de quelque nature que soit ce sujet, mâle ou femelle, animé même ou inanimé, réel ou abstrait ; en grec, tu en latin, du ou ihr en allemand, tu, que l'on prononcera tou en italien, tu ou vous en français, marquent déterminément le sujet auquel on adresse la parole, etc. Les noms au contraire n'ont point de relation fixe à la parole, c'est-à-dire point de personne fixe ; sous la même terminaison, ou sous des terminaisons différentes, ils sont tantôt d'une personne et tantôt d'une autre, selon l'occurrence. Ainsi dans cette phrase, ego Joannes vidi, le nom Joannes est de la première personne par concordance avec ego, comme ego est du masculin par concordance avec Joannes ; le pronom ego détermine la personne qui est essentiellement vague dans Joannes, comme le nom Joannes détermine la nature qui est essentiellement indéterminée dans ego : dans Joannes vidisti, le même nom Joannes est de la seconde personne, parce qu'il exprime le sujet à qui on parle, et en cette occurrence on change quelquefois la terminaison, domine pour dominus : dans Joannes vidit le nom Joannes est de la troisième personne, parce qu'il exprime l'être dont on parle sans lui adresser la parole.
De même donc que sous le nom de genres on a rapporté les noms à différentes classes qui ont leur fondement commun dans la nature des êtres ; on a pareillement, sous le nom de personne, rapporté les pronoms à des classes différenciées par les diverses relations des êtres à l'acte de la parole. Les personnes sont à l'égard des pronoms, ce que les genres sont à l'égard des noms, parce que l'idée de la relation à l'acte de la parole, est l'idée caractéristique des pronoms, comme l'idée de la nature est celle des noms. L'idée de la relation à l'acte de la parole, qui est essentielle et précise dans les pronoms, demeure vague et indéterminée dans les noms ; comme l'idée de la nature, qui est essentielle et précise dans les noms, demeure vague et indéterminée dans les pronoms. Ainsi les êtres déterminés dans les noms par l'idée précise de leur nature, sont susceptibles de toutes les relations possibles à la parole ; et réciproquement, les êtres déterminés dans les pronoms par l'idée précise de leur relation à l'acte de la parole, peuvent être rapportés à toutes les natures.
Les adjectifs et les verbes sont toujours des mots qui présentent à l'esprit des êtres indéterminés, puisqu'à tous égards ils ont besoin d'être appliqués à quelque nom ou à quelque pronom, pour pouvoir prendre quelque terminaison déterminative. Les personnes, par exemple, qui ne sont dans les verbes que des terminaisons, suivent la relation du sujet à l'acte de la parole, et les verbes prennent telle ou telle terminaison personnelle, selon cette relation de leurs sujets à l'acte de la parole, ego Joannes vidi, tu Joannes vidisti, Joannes vidit.
5°. Le fil de notre analyse nous a menés jusqu'ici à la véritable notion des noms et des pronoms.
Les noms sont des mots qui présentent à l'esprit des êtres déterminés par l'idée précise de leur nature ; et de-là la division des noms en appelatifs et en propres, et celle des appelatifs en génériques et en spécifiques ; de-là encore une autre division des noms en substantifs et abstractifs, selon qu'ils présentent à l'esprit des êtres réels ou purement abstraits. Voyez NOM.
Les pronoms sont des mots qui présentent à l'esprit des êtres déterminés par l'idée précise de leur relation à l'acte de la parole ; et de-là la division des pronoms par la première, la seconde et la troisième personne. Voyez PRONOM.
Mais nous ne connaissons encore de la nature des adjectifs et des verbes, qu'un caractère générique, savoir que les uns et les autres présentent à l'esprit des êtres indéterminés ; et il nous reste à trouver la différence caractéristique de ces deux espèces. Cependant les deux espèces de variations accidentelles qui nous restent à examiner, savoir les temps et les modes, appartiennent au verbe exclusivement. Par quel moyen pourrons-nous donc fixer les caractères spécifiques de ces deux espèces ? Revenons sur nos pas.
Quoique les uns et les autres ne présentent à l'esprit que des êtres indéterminés, les uns et les autres renferment pourtant dans leur signification une idée très-précise : par exemple, l'idée de la bonté est très-précise dans l'adjectif bon, et l'idée de l'amour ne l'est pas moins dans le verbe aimer, quoique l'être en qui se trouve ou la bonté ou l'amour y soit très-indéterminé. Cette idée précise de la signification des adjectifs et des verbes, doit être notre ressource, si nous saisissons quelques observations des usages connus.
Une singularité frappante, unanimément admise dans toutes les langues, c'est que l'adjectif n'a reçu aucune variation relative aux personnes qui caractérisent les pronoms. Les adjectifs mêmes dérivés des verbes qui sous le nom de participe réunissent en effet la double nature des deux parties d'oraison, n'ont reçu nulle part les inflexions personnelles, quoiqu'on en ait accordé à d'autres modes du verbe. Au contraire tous les adjectifs, tant ceux qui ne sont qu'adjectifs, que les participes, ont reçu, du-moins dans les langues qui les comportent, des inflexions relatives aux genres, dont on a Ve que la distinction porte sur la différence spécifique des noms, c'est-à-dire sur la nature des êtres déterminés qu'ils expriment.
Cette préférence universelle des terminaisons génériques sur les terminaisons personnelles pour les adjectifs, ne semble-t-elle pas insinuer que l'idée particulière qui fixe la signification de l'adjectif, doit être rapportée à la nature des êtres ?
L'indétermination de l'être présenté à l'esprit par l'adjectif seul, nous indique une seconde propriété générale de cette idée caractéristique ; c'est qu'elle peut être rapportée à plusieurs natures : ceci se confirme encore par la mobilité des terminaisons de l'adjectif, selon le genre du nom auquel on l'applique ; la diversité des genres suppose celle des natures, du-moins des natures individuelles.
L'unité d'objet qui résulte toujours de l'union de l'adjectif avec le nom, démontre que l'idée particulière qui constitue la signification individuelle de chaque adjectif, est vraiment une idée partielle de la nature totale de cet objet unique exprimé par le concours des deux parties d'oraison. Quand je dis, par exemple, loi, je présente à l'esprit un objet unique déterminé : j'en présente un autre également unique et déterminé, quand je dis loi évangélique : un autre quand je dis nos lais. L'idée de loi se trouve pourtant toujours dans ces trois expressions, mais c'est une idée totale dans le premier exemple, et dans les deux autres ce n'est plus qu'une idée partielle qui concourt à former l'idée totale, avec l'autre idée partielle qui constitue la signification propre ou de l'adjectif évangélique dans le second exemple, ou de l'adjectif nos dans le troisième. Ce qui convient proprement à nos lois ne peut convenir ni à la loi évangélique ni à la loi en général : de même ce qui convient proprement à la loi évangélique, ne peut convenir ni à nos lois ni à la loi en général : c'est que ce sont des idées totales toutes différentes ; mais ce qui est vrai de la loi en général, est vrai en particulier de la loi évangélique et de nos lais, parce que les idées ajoutées à celle de loi ne détruisent pas celle de loi, qui est toujours la même en soi.
Il résulte donc de ces observations que les adjectifs sont des mots qui présentent à l'esprit des êtres indéterminés, désignés seulement par une idée précise qui peut s'adapter à plusieurs natures.
Dans l'exposition synthétique des principes de Grammaire, telle qu'on doit la faire à ceux qu'on enseigne, cette notion des adjectifs sera l'origine et la source de toutes les métamorphoses auxquelles les usages des langues ont assujetti cette espèce de mots, puisqu'elle en est ici le résultat analytique : non-seulement elle expliquera les variations des nombres, des genres et des cas, et la nécessité d'appliquer un adjectif à un nom pour en tirer un service réel, mais elle montrera encore le fondement de la division des adjectifs en adjectifs physiques et en adjectifs métaphysiques, et de la transmutation des uns en noms et des autres en pronoms.
Les adjectifs physiques sont ceux qui désignent les êtres indéterminés par une idée précise qui, étant ajoutée à celle de quelque nature déterminée, constitue avec elle une idée totale toute différente, dont la compréhension est augmentée : tels sont les adjectifs pieux, rond, semblable ; car quand on dit un homme pieux, un vase rond, des figures semblables, on exprime des idées totales qui renferment dans leur compréhension plus d'attributs que celles que l'on exprime quand on dit simplement un homme, un vase, des figures. C'est que l'idée précise de la signification individuelle de cette sorte d'adjectifs, est une idée partielle de la nature totale : d'où il suit que si l'on ne veut envisager les êtres dans le discours que comme revêtus de cet attribut exprimé nettement par l'adjectif, il arrive souvent que l'adjectif est employé comme un nom, parce que l'attribut qui y est précis constitue alors toute la nature de l'objet que l'on a en vue. C'est ainsi que nous disons le bon, le vrai, l'honnête, l'utile, les Français, les Romains, les Africains, &c.
Les adjectifs métaphysiques sont ceux qui désignent les êtres indéterminés par une idée précise qui, étant ajoutée à celle de quelque nature déterminée, constitue avec elle une idée totale, dont la compréhension est toujours la même, mais dont l'étendue est restreinte : tels sont les adjectifs le, ce, plusieurs ; car quand on dit le roi, ce livre, plusieurs chevaux, on exprime des idées totales qui renferment encore dans leur compréhension les mêmes attributs que celles que l'on exprime quand on dit simplement roi, livre, cheval, quoique l'étendue en soit plus restreinte, parce que l'idée précise de la signification individuelle de cette sorte d'adjectifs, n'est que l'idée d'un point de vue qui assigne seulement une quotité particulière d'individus. De-là vient que si l'on ne veut envisager dans le discours les êtres dont on parle que comme considérés sous ce point de vue exprimé nettement par l'adjectif, il arrive souvent que l'adjectif est employé comme pronom, parce que le point de vue qui est précis est alors la relation unique qui détermine l'être dont on parle : c'est ainsi que nous disons, j'approuve CE que vous avez fait.
Peut-être qu'il aurait été aussi bien de faire de ces deux espèces d'adjectifs deux parties d'oraison différentes, qu'il a été bien de distinguer ainsi les noms et les pronoms : la possibilité de changer les adjectifs physiques en noms et les adjectifs métaphysiques en pronoms, indique de part et d'autre les mêmes différences ; et la distinction effective que l'on a faite de l'article, qui n'est qu'un adjectif métaphysique, aurait pu et dû s'étendre à toute la classe sous ce même nom. Voyez ADJECTIF et ARTICLE.
6°. Les temps sont des formes exclusivement propres au verbe, et qui expriment les différents rapports d'existence aux diverses époques que l'on peut envisager dans la durée. Il parait par les usages de toutes les langues qui ont admis des temps, que c'est une espèce de variation exclusivement propre au verbe, puisqu'il n'y a que le verbe qui en soit revêtu, et que les autres espèces de mots n'en paraissent pas susceptibles ; mais il est constant aussi qu'il n'y a pas une seule partie de la conjugaison du verbe qui n'exprime d'une manière ou d'une autre quelqu'un de ces rapports d'existence à une époque (Voyez TEMS), quoique quelques grammairiens célèbres, comme Sanctius, aient cru et affirmé le contraire, faute d'avoir bien approfondi la nature des temps. Cette forme tient donc à l'essence propre du verbe, à l'idée différencielle et spécifique de sa nature ; cette idée fondamentale est celle de l'existence, puisque comme le dit M. de Gamaches, dissert. I. de son Astronomie physique, le temps est la succession même attachée à l'existence de la nature, et qu'en effet l'existence successive des êtres est la seule mesure du temps qui soit à notre portée, comme le temps devient à son tour la mesure de l'existence successive.
Cette idée de l'existence est d'ailleurs la seule qui puisse fonder la propriété qu'a le verbe, d'entrer nécessairement dans toutes les propositions qui sont les parties intégrantes de nos discours. Les propositions sont les images extérieures et sensibles de nos jugements intérieurs ; et un jugement est la perception de l'existence d'un objet dans notre esprit sous tel ou tel attribut. Voyez l'introd. à la Philosoph. par s'Gravesande, liv. II. ch. vij ; et la rech. de la Vérité, liv. I. ch. j. IIe ces deux philosophes peuvent aisément se concilier sur ce point. Pour être l'image fidéle du jugement, une proposition doit donc énoncer exactement ce qui se passe alors dans l'esprit, et montrer sensiblement un sujet, un attribut, et l'existence intellectuelle du sujet sous cet attribut.
7°. Les modes sont les diverses formes qui indiquent les différentes relations des temps du verbe à l'ordre analytique ou aux vues logiques de l'énonciation. Voyez MODE. On a comparé les modes du verbe au cas du nom : je vais le faire aussi, mais sous un autre aspect. Tous les temps expriment un rapport d'existence à une époque ; c'est-là l'idée commune de tous les temps, ils sont synonymes à cet égard ; et voici ce qui en différencie la signification : les présents expriment la simultanéité à l'égard de l'époque, les prétérits expriment l'antériorité, les futurs la postériorité ; les temps indéfinis ont rapport à une époque indéterminée, et les définis à une époque déterminée ; parmi ceux-ci, les actuels ont rapport à une époque co-incidente avec l'acte de la parole, les antérieurs à une époque précédente, les postérieurs à une époque subséquente, etc. ce sont là comme les nuances qui distinguent des mots synonymes quant à l'idée principale ; ce sont des vues métaphysiques ; en voici de grammaticales. Les noms latins anima, animus, ments, spiritus, synonymes par l'idée principale qui fonde leur signification commune, mais différents par les idées accessoires comme par les sons, reçoivent des terminaisons analogues que l'on appelle cas ; mais chacun les forme à sa manière, et la déclinaison en est différente ; anima est de la première, animus est de la seconde, ments de la troisième, spiritus de la quatrième. Il en est de même des temps du verbe, synonymes par l'idée fondamentale qui leur est commune, mais différents par les idées accessoires ; chacun d'eux reçoit pareillement des terminaisons analogues que l'on nomme modes, mais chacun les forme à sa manière ; amo, amem, amare, amants, sont les différents modes du présent indéfini ; amavi, amaverim, amavisse, sont ceux du prétérit, etc. en sorte que les différentes formes d'un même temps, selon la diversité des modes, sont comme les différentes formes d'un même nom, selon la diversité des cas ; et les différents temps d'un même mode, sont comme différents noms synonymes au même cas ; les cas et les modes sont également relatifs aux vues de l'énonciation.
Mais la différence des cas dans les noms n'empêche pas qu'ils ne gardent toujours la même signification spécifique ; ce sont toujours des mots qui présentent à l'esprit des êtres déterminés par l'idée de leur nature. La différence des modes ne doit donc pas plus altérer la signification spécifique des verbes. Or nous avons Ve que les formes temporelles portent sur l'idée fondamentale de l'existence d'un sujet sous un attribut ; voilà donc la notion que l'analyse nous donne des verbes : les verbes sont des mots qui présentent à l'esprit des êtres indéterminés, désignés seulement par l'idée de l'existence sous un attribut.
De-là la première division du verbe, en substantif ou abstrait, et en adjectif ou concret, selon qu'il énonce l'existence sous un attribut quelconque et indéterminé, ou sous un attribut précis et déterminé.
De-là la sous-division du verbe adjectif ou concret, en actif, passif ou neutre, selon que l'attribut déterminé de la signification du verbe est une action du sujet ou une impression produite dans le sujet sans concours de sa part, ou un attribut qui n'est ni action, ni passion, mais un simple état du sujet.
De-là enfin, toutes les autres propriétés qui servent de fondement à toutes les parties de la conjugaison du verbe, lesquelles, selon une remarque générale que j'ai déjà faite plus haut, doivent dans l'ordre synthétique, découler de cette notion du verbe, puisque cette notion en est le résultat analytique. Voyez VERBE.
II. Des mots indéclinables. La déclinabilité dont on vient de faire l'examen, est une suite et une preuve de la possibilité qu'il y a d'envisager sous différents aspects, l'idée objective de la signification des mots déclinables. L'indéclinabilité des autres espèces de mots est donc pareillement une suite et une preuve de l'immutabilité de l'aspect sous lequel on y envisage l'idée objective de leur signification. Les idées des êtres, réels ou abstraits qui peuvent être les objets de nos pensées, sont aussi ceux de la signification des mots déclinables ; c'est pourquoi les aspects en sont variables : les idées objectives de la signification des mots indéclinables sont donc d'une toute autre espèce, puisque l'aspect en est immuable ; c'est tout ce que nous pouvons conclure de l'opposition des deux classes générales de mots : et pour parvenir à des notions plus précises de chacune des espèces indéclinables, qui sont les prépositions, les adverbes, et les conjonctions ; il faut les puiser dans l'examen analytique des différents usages de ces mots.
1°. Les prépositions dans toutes les langues, exigent à leur suite un complément, sans lequel elles ne présentent à l'esprit qu'un sens vague et incomplet ; ainsi les prépositions françaises avec, dans, pour, ne présentent un sens complet et clair, qu'au moyen des compléments ; avec le roi, dans la ville, pour sortir : c'est la même chose des prépositions latines, cùm, in, ad ; il faut les complete r ; cùm rege, in urbe, ad exeundum.
Une seconde observation essentielle sur l'usage des prépositions, c'est que dans les langues dont les noms ne se déclinent point, on désigne par des prépositions la plupart des rapports dont les cas sont ailleurs les signes : manus Dei, c'est en français, la main de Dieu ; dixit Deo, c'est il a dit à Dieu.
Cette dernière observation nous indique que les prépositions désignent des rapports : l'application que l'on peut faire des mêmes prépositions à une infinité de circonstances différentes, démontre que les rapports qu'elles désignent font abstraction de toute application, et que les termes en sont indéterminés. Qu'on me permette un langage étranger sans doute à la grammaire, mais qui peut convenir à la Philosophie, parce qu'elle s'accommode de droit de tout ce qui peut mettre la vérité en évidence : les calculateurs disent que 3 est à 6, comme 5 est à 10, comme 8 est à 16, comme 25 est à 50, etc. que veulent-ils dire ? que le rapport de 3 à 6 est le même que le rapport de 5 à 10, que le rapport de 8 à 16, que le rapport de 25 à 50 ; mais ce rapport n'est aucun des nombres dont il s'agit ici ; et on le considère avec abstraction de tout terme, quand on dit que 1/2 en est l'exposant. C'est la même chose d'une préposition ; c'est, pour ainsi dire, l'exposant d'un rapport considéré d'une manière abstraite et générale, et indépendamment de tout terme antécédent et de tout terme conséquent. Aussi disons-nous avec la même préposition, la main de Dieu, la colere de ce prince, les désirs de l'âme ; et de même contraire à la paix, utîle à la nation, agréable à mon père, etc. les Grammairiens disent que les trois premières phrases sont analogues entr'elles, et qu'il en est de même des trois dernières ; c'est le langage des Mathématiciens, qui disent que les nombres 3 et 6, 5 et 10 sont proportionnels ; car analogie et proportion, c'est la même chose, selon la remarque même de Quintilien : Analogia praecipuè, quam, proximè ex. graeco transferentes in latinum, proportionem vocaverunt, liv. I.
Nous pouvons donc conclure de ces observations que les prépositions sont des mots qui désignent des rapports généraux avec abstraction de tout terme antécédent et conséquent. De-là la nécessité de donner à la préposition un complément qui en fixe le sens, qui par lui-même est vague et indéfini ; c'est le terme conséquent du rapport, envisagé vaguement dans la préposition. De-là encore le besoin de joindre la préposition avec son complément à un adjectif, ou à un verbe, ou à un nom appelatif, dont le sens général se trouve modifié et restreint par l'idée accessoire de ce rapport ; l'adjectif, le verbe, ou le nom appelatif, en est le terme antécédent, l'utilité de la Métaphysique, courageux sans témérité ; aimer avec fureur ; chacune de ces phrases exprime un rapport complet ; on y voit l'antécédent, l'utilité, courageux, aimer ; le conséquent, la métaphysique, témérité, fureur ; et l'exposant, de, sans, avec.
2°. Par rapport aux adverbes, c'est une observation importante, que l'on trouve dans une langue plusieurs adverbes qui n'ont dans une autre langue aucun équivalent sous la même forme, mais qui s'y rendent par une préposition avec un complément qui énonce la même idée qui constitue la signification individuelle de l'adverbe ; eminus, de loin ; cominùs, de près ; utrinque, des deux côtés, etc. on peut même regarder souvent comme synonymes dans une même langue ces deux expressions, par l'adverbe et par la préposition avec son complement ; prudenter, prudemment, ou cum prudentiâ, avec prudence. Cette remarque, qui se présente d'elle-même dans bien des cas, a excité l'attention des meilleurs grammairiens, et l'auteur de la Grammaire gen. part. II. ch. XIIe dit que la plupart des adverbes ne sont que pour signifier en un seul mot, ce qu'on ne pourrait marquer que par une préposition et un nom ; sur quoi, M. Duclos remarque que la plupart ne dit pas assez, que tout mot qui peut être rendu par une préposition et un nom est un adverbe, et que tout adverbe peut s'y rappeler ; M. du Marsais avait établi le même principe, article ADVERBE.
Les adverbes ne différent donc des prépositions, qu'en ce que celles-ci expriment des rapports avec abstraction de tout terme antécédent et conséquent, au lieu que les adverbes renferment dans leur signification le terme conséquent du rapport. Les adverbes sont donc des mots qui expriment des rapports généraux, déterminés par la désignation du terme conséquent.
De-là la distinction des adverbes, en adverbes de temps, de lieu, d'ordre, de quantité, de cause, de manière, selon que l'idée individuelle du terme conséquent qui y est renfermé a rapport au temps, au lieu, à l'ordre, à la quantité, à la cause, à la manière.
De-là vient encore, contre le sentiment de Sanctius et de Scioppius, que quelques adverbes peuvent avoir ce qu'on appelle communément un régime, lorsque l'idée du terme conséquent peut se rendre par un nom appelatif ou par un adjectif, dont la signification, trop générale dans l'occurrence, ou essentiellement relative, exige l'addition d'un nom qui la détermine ou qui la complete ; ainsi dans ubi terrarum, tunc temporis, on peut dire que terrarum et temporis sont les compléments déterminatifs des adverbes ubi et tunc, puisqu'ils déterminent en effet les noms généraux renfermés dans la signification de ces adverbes ; ubi terrarum, c'est-à-dire, en prenant l'équivalent de l'adverbe, in quo loco terrarum ; tunc temporis, c'est-à-dire, in hoc puncto ou spatio temporis ; et l'on voit qu'il n'y a point là de rédondance ou de pléonasme, comme le dit Scioppius dans sa Grammaire philosoph. (de syntaxi adverbii). Il prétend encore que dans naturae convenienter vivère, le datif naturae est régi par le verbe vivère, de la même manière que quand Plaute a dit (Poen.), vivère sibi et amicis : mais il est clair que les deux exemples sont bien différents ; et si l'on rend l'adverbe convenienter par son équivalent ad modum convenientem, tout le monde verra bien que le datif naturae est le complément relatif de l'adjectif convenientem.
Ne nous contentons pas d'observer la différence des prépositions et des adverbes ; voyons encore ce qu'il y a de commun entre ces deux espèces : l'une et l'autre énonce un rapport général, c'est l'idée générique fondamentale des deux ; l'une et l'autre fait abstraction du terme antécédent, parce que le même rapport pouvant se trouver dans différents êtres, on peut l'appliquer sans changement à tous les sujets qui se présenteront dans l'occasion. Cette abstraction du terme antécédent ne suppose donc point que dans aucun discours le rapport sera envisagé de la sorte ; si cela avait lieu, ce serait alors un être abstrait qui serait désigné par un nom abstractif : l'abstraction dont il s'agit ici, n'est qu'un moyen d'appliquer le rapport à tel terme antécédent qui se trouvera nécessaire aux vues de l'énonciation.
Ceci nous conduit donc à un principe essentiel ; c'est que tout adverbe, ainsi que toute phrase qui renferme une préposition avec son complément, sont des expressions qui se rapportent essentiellement à un mot antécédent dans l'ordre analytique, et qu'elles ajoutent à la signification de ce mot, une idée de relation qui en fait envisager le sens tout autrement qu'il ne se présente dans le mot seul : aimer tendrement ou avec tendresse, c'est autre chose qu'aimer tout simplement. Si l'on envisage donc la préposition et l'adverbe sous ce point de vue commun, on peut dire que ce sont des mots supplétifs, puisqu'ils servent également à suppléer les idées accessoires qui ne se trouvent point comprises dans la signification des mots auxquels on les rapporte, et qu'ils ne peuvent servir qu'à cette fin.
A l'occasion de cette application nécessaire de l'adverbe à un mot antécédent ; j'observerai que l'étymologie du nom adverbe, telle que la donne Sanctius (Minerv. III. 13.), n'est bonne qu'autant que le nom latin verbum sera pris dans son sens propre pour signifier mot, et non pas verbe, parce que l'adverbe supplée aussi souvent à la signification des adjectifs, et même à celle d'autres adverbes, qu'à celle des verbes : adverbium, dit ce grammairien, videtur dici quasi ad verbum, quia verbis velut adjectivum adhaeret. La grammaire générale, part. II. ch. XIIe et tous ceux qui l'ont adopté, ont souscrit à la même erreur.
3°. Plusieurs conjonctions semblent au premier aspect ne servir qu'à lier un mot avec un autre : mais si l'on y prend garde de près, on verra qu'en effet elles servent à lier les propositions partielles qui constituent un même discours. Cela est sensible à l'égard de celles qui amènent des propositions incidentes, comme praeceptum Apollinis monet UT se quisque noscat : (Tuscul. I. 22.) Ce principe n'est pas moins évident à l'égard des autres, quand toutes les parties des deux propositions liées sont différentes entr'elles ; par exemple, Moïse priait ET Josué combattait. Il ne peut donc y avoir de doute que dans le cas où divers attributs sont énoncés du même sujet, ou le même attribut de différents sujets ; par exemple, Ciceron était orateur ET philosophe, lupus et agnus venerant. Mais il est aisé de ramener à la loi commune les conjonctions de ces exemples : le premier se réduit aux deux propositions liées, Ciceron était orateur ET Ciceron était philosophe, lesquelles ont un même sujet ; le second veut dire pareillement, lupus venerat ET agnus venerat, les deux mots attributifs à venerat étant compris dans le pluriel venerant.
Qu'il me soit permis d'établir ici quelques principes, dont je ne ferais que m'appuyer s'ils avaient été établis à l'article CONJONCTION.
Le premier, c'est qu'on ne doit pas regarder comme une conjonction, même en y ajoutant l'épithète de composée, une phrase qui renferme plusieurs mots comme l'ont fait tous les Grammairiens, excepté M. l'abbé Girard. En effet une conjonction est une sorte de mot, et chacun de ceux qui entrent dans l'une de ces phrases que l'on traite de conjonctions, doit être rapporté à sa classe. Ainsi on n'a pas dû regarder comme des conjonctions, les phrases si ce n'est, c'est-à-dire, pourvu que, parce que, à condition que, au surplus, c'est pourquoi, par conséquent, &c.
En adoptant ce principe, M. l'abbé Girard est tombé dans une autre méprise : il a écrit de suite les mots élémentaires de plusieurs de ces phrases, comme si chacune n'était qu'un seul mot ; et l'on trouve dans son système des conjonctions, deplus, dailleurs pourvuque, amoins, bienque, nonplus, tandisque, parceque, dautantque, parconséquent, entantque, aureste, dureste ; ce qui est contraire à l'usage de notre orthographe, et conséquemment aux véritables idées des choses. On doit écrire de plus, d'ailleurs, pourvu que, à moins, bien que, non plus, tandis que, parce que, d'autant que, par conséquent, en tant que, au reste, du reste.
Un second principe qu'il ne faut plus que rappeler, c'est que tout mot qui peut être rendu par une préposition avec son complément est un adverbe : d'où il suit qu'aucun mot de cette espèce ne doit entrer dans le système des conjonctions ; en quoi peche celui de M. l'abbé Girard, copié par M. du Marsais.
Cette conséquence est évidente d'abord pour toutes les phrases où notre orthographe montre distinctement une préposition et son complément, comme à moins, au reste, d'ailleurs, de plus, du reste, par conséquent. L'auteur des vrais principes s'explique ainsi lui-même : Par conséquent n'est mis au rang des conjonctions " qu'autant qu'on l'écrit de suite sans en faire deux mots ; autrement chacun doit être rapporté à sa classe : et alors par sera une préposition, conséquent un adjectif pris substantivement ; ces deux mots ne changent point de nature, quoiqu'employés pour énoncer le membre conjonctif de la phrase ". (tom. II. pag. 284.) Mais il est constant qu'une préposition avec son complement est l'équivalent d'un adverbe, et que tout mot qui est l'équivalent d'une préposition avec son complément est un adverbe ; d'où il suit que quand on écrirait de suite parconséquent, il n'en serait pas moins adverbe, parce que l'étymologie y retrouverait toujours les mêmes éléments, et la Logique le même sens.
C'est par la même raison que l'on doit regarder comme de simples adverbes, les mots suivants réputés communément conjonctions.
Cependant, néanmoins, pourtant, toutefois, sont adverbes ; l'abréviateur de Richelet le dit expressément des deux derniers, qu'il explique par les premiers, quoiqu'à l'article néanmoins il désigne ce mot comme conjonction. Lorsque cependant est relatif au temps, c'est un adverbe qui veut dire pendant ce temps ; et quand il est synonyme de néanmoins, pourtant, toutefois, il signifie, comme les trois autres, malgré ou nonobstant cela, avec les différences délicates que l'on peut voir dans les synonymes de l'abbé Girard.
Enfin c'est évidemment en fin, c'est-à-dire pour fin, pour article final, finalement, adverbe.
C'est la même chose d'afin, au lieu de quoi l'on disait anciennement à celle fin, qui subsiste encore dans les patais de plusieurs provinces, et qui en est la vraie interprétation.
Jusque, regardé par Vaugelas (Rem. 515.) comme une préposition, et par l'abbé Girard, comme une conjonction, est effectivement un adverbe, qui signifie à-peu-près sans discontinuation, sans exception, etc. Le latin usque, qui en est le correspondant et le radical, se trouve pareillement employé à-peu-près dans le sens de jugiter, assiduè, indesinenter, continuè ; et ce dernier veut dire in spatio (temporis aut loci) continuo ; ce qui est remarquable, parce que notre jusque s'emploie également avec relation au temps et au lieu.
Pourvu signifie sous la condition ; et c'est ainsi que l'explique l'abréviation de Richelet, c'est donc un adverbe.
Quant signifie relativement, par rapport.
Surtout vient de sur tout, c'est-à-dire principalement : il est si évidemment adverbe, qu'il est surprenant qu'on se soit avisé d'en faire une conjonction.
Tantôt répété veut dire, la première fais, dans un temps, et la seconde fais, dans un autre temps : TANTOT caressante et TANTOT dédaigneuse, c'est-à-dire caressante dans un temps et dédaigneuse dans un autre. Les Latins répètent dans le même sens l'adverbe nunc, qui ne devient pas pour cela conjonction.
Remarquez que dans tous les mots que nous venons de voir, nous n'avons rien trouvé de conjonctif qui puisse autoriser les Grammairiens à les regarder comme conjonctions. Il n'en est pas de même de quelques autres mots, qui étant analysés, renferment en effet la valeur d'une préposition avec son complément, et de plus un mot simple qui ne peut servir qu'à lier.
Par exemple, ainsi, aussi, donc, partant signifient et par cette raison, et pour cette cause, et par conséquent, et par résultat : ce sont des adverbes, si vous voulez, mais qui indiquent encore une liaison : et comme l'expression déterminée du complément d'un rapport, fait qu'un mot, sous cet aspect, n'est plus une préposition, quoiqu'il la renferme encore, mais un adverbe ; l'expression de la liaison ajoutée à la signification de l'adverbe doit faire pareillement regarder le mot comme conjonction, et non comme adverbe, quoiqu'il renferme encore l'adverbe.
C'est la même chose de lorsque, quand, qui veulent dire dans le temps que ; quoique, qui signifie malgré la raison, ou la cause, ou le motif que ; puisque, qui veut dire par la raison supposée ou posée qui (posito quod, qui en est peut-être l'origine, plutôt que post-quam assigné comme tel par Ménage) ; si, c'est-à-dire sous la condition que, &c.
La facilité avec laquelle on a confondu les adverbes et les conjonctions, semble indiquer d'abord que ces deux sortes de mots ont quelque chose de commun dans leur nature ; et ce que nous venons de remarquer en dernier lieu met la chose hors de doute, en nous apprenant que toute la signification de l'adverbe est dans la conjonction, qui y ajoute de plus l'idée de liaison entre des propositions. Concluons donc que les conjonctions sont des mots qui désignent entre les propositions, une liaison fondée sur les rapports qu'elles ont entr'elles.
De-là la distinction des conjonctions en copulatives, adversatives, disjonctives, explicatives, périodiques, hypothétiques, conclusives, causatives, transitives et déterminatives, selon la différence des rapports qui fondent la liaison des propositions.
Les conjonctions copulatives, &, ni, (& en latin &, ac, atque, que, nec, neque) ; désignent entre des propositions semblables, une liaison d'unité, fondée sur leur similitude.
Les conjonctions adversatives mais, quoique, (& en latin sed, at, quamvis, etsi, &c.) désignent entre des propositions opposées à quelques égards, une liaison d'unité, fondée sur leur compatibilité intrinseque.
Les conjonctions disjonctives ou, soi, (ve, vel, aut, seu, sive,) désignent entre des propositions incompatibles, une liaison de choix, fondée sur leur incompatibilité même.
Les conjonctions explicatives savoir, (quippe, nempe, nimirùm, scilicet, videlicet,) désignent entre les propositions, une liaison d'identité ; fondée sur ce que l'une est le développement de l'autre.
Les conjonctions périodiques quand, lorsque, (quandò,) désignent entre les propositions, une liaison positive d'existence, fondée sur leur relation à une même époque.
Les conjonctions hypothétiques si, sinon, (si, nisi, sin,) désignent entre les propositions, une liaison conditionnelle d'existence, fondée sur ce que la seconde est une suite de la première.
Les conjonctions conclusives ainsi, aussi, donc, partant, (ergo, igitur, &c.) désignent entre les propositions, une liaison nécessaire d'existence, fondée sur ce que la seconde est renfermée éminemment dans la première.
Les conjonctions causatives car, puisque, (nam, enim, etenim, quoniam, quia,) désignent entre les propositions, une liaison nécessaire d'existence, fondée sur ce que la première est renfermée éminemment dans la seconde.
Les conjonctions transitives or, (atqui, autem, &c.) désignent entre les propositions, une liaison d'affinité, fondée sur ce qu'elles concourent à une même fin.
Les conjonctions déterminatives que, pourquoi, (quòd, quàm, cùm, ut, cur, quare, &c.) désignent entre les propositions, une liaison de détermination, fondée sur ce que l'une, qui est incidente, détermine le sens vague de quelque partie de l'autre, qui est principale.
On voit par ce détail la vérité d'une remarque de M. l'abbé Girard, (tom. II. pag. 257.) " que les conjonctions font proprement la partie systématique du discours ; puisque c'est par leur moyen qu'on assemble les phrases, qu'on lie les sens, et que l'on compose un tout de plusieurs portions, qui, sans cette espèce, ne paraitraient que comme des énumérations ou des listes de phrases, et non comme un ouvrage suivi et affermi par les liens de l'analogie ". C'est précisément pour cela que je divise la classe des mots indéclinables en deux ordres de mots, qui sont les supplétifs et les discursifs : les adverbes et les prépositions sont du premier ordre, on en a Ve la raison ; les conjonctions sont du second ordre, parce qu'elles sont les liens des propositions, en quoi consiste la force, l'âme et la vie du discours.
Je vais rapprocher dans un tableau raccourci les notions sommaires qui resultent du détail de l'analyse que nous venons de faire.
Cette seule exposition sommaire des différents ordres de mots est suffisante pour faire apercevoir combien d'idées différentes se réunissent dans la signification d'un seul mot énonciatif ; et cette multiplication d'idées peut aller fort loin, si on y ajoute encore celles qui peuvent être désignées par les différentes formes accidentelles que la déclinabilité peut faire prendre aux mots qui en sont susceptibles, telles que sont, par exemple, dans amaverat, les idées du mode, du nombre, de la personne, du temps et dans celle du temps, les idées du rapport d'existence à l'époque, et du rapport de l'époque au moment de la parole.
Cette complexité d'idées renfermées dans la signification d'un même mot, est la seule cause de tous les mal-entendus dans les arts, dans les sciences, dans les affaires, dans les traités politiques et civils ; c'est l'obstacle le plus grand qui se présente dans la recherche de la vérité, et l'instrument le plus dangereux dans les mains de la mauvaise foi. On devrait être continuellement en garde contre les surprises de ces mal-entendus : mais on se persuade au contraire que, puisqu'on parle la même langue que ceux avec qui l'on traite, on attache aux mots les mêmes sens qu'ils y attachent eux-mêmes ; inde mali labes.
Les Philosophes présentent contre ce mal une foule d'observations solides, subtiles, détaillées, mais par-là même difficiles à saisir ou à retenir : je n'y connais qu'un remède, qui est le résultat de toutes les maximes détaillées de la Philosophie : expliquez-vous avant tout, avant que d'entamer une discussion ou une dispute, avant que d'avouer un principe ou un fait ; avant que de conclure un acte ou un traité. L'application de ce remède suppose que l'on fait expliquer, et que l'on est en état de distinguer tout ce qu'une saine Logique peut apercevoir dans la signification des mots ; ce qui prouve, en passant, l'importance de l'étude de la Grammaire bien entendue, et l'injustice ainsi que le danger qu'il peut y avoir à n'en pas faire assez de cas.
Or, 1°. il faut distinguer dans les mots la signification objective et la signification formelle. La signification objective, c'est l'idée fondamentale qui est l'objet de la signification du mot, et qui peut être désignée par des mots de différentes espèces : la signification formelle, c'est la manière particulière dont le mot présente à l'esprit l'objet dont il est le signe, laquelle est commune à tous les mots de la même espèce, et ne peut convenir à ceux des autres espèces.
Le même objet pouvant donc être signifié par des mots de différentes espèces, on peut dire que tous ces mots ont une même signification objective, parce qu'ils représentent tous la même idée fondamentale ; mais chaque espèce ayant sa manière propre de présenter l'objet dont il est le signe, la signification formelle est nécessairement différente dans des mots de diverses espèces, quoiqu'ils puissent avoir une même signification objective. Communément ils ont dans ce cas, une racine générative commune, qui est le type matériel de l'idée fondamentale qu'ils représentent tous ; mais cette racine est accompagnée d'inflexions et de terminaisons, qui, en désignant la diversité des espèces, caractérisent en même temps la signification formelle. Ainsi la racine commune am dans aimer, amitié, ami, amical, amicalement, est le type de la signification objective commune à tous ces mots, dont l'idée fondamentale est celle de ce sentiment affectueux qui lie les hommes par la bienveillance ; mais les diverses inflexions ajoutées à cette racine, désignent tout-à-la-fais la diversité des espèces, et les différentes significations formelles qui y sont attachées.
C'est pour avoir confondu la signification objective et la signification formelle du verbe, que Sanctius, le grammairien le plus savant et le plus philosophe de son siècle, a cru qu'il ne fallait point admettre de modes dans les verbes : il croyait qu'il était question des modes de la signification objective, qui s'expriment en effet dans la langue latine communément par l'ablatif du nom abstrait qui en est le signe naturel, et souvent par l'adverbe qui renferme la même idée fondamentale ; au lieu qu'il n'est question que des modes de la signification formelle, c'est-à-dire des diverses nuances, pour ainsi dire, qu'il peut y avoir dans la manière de présenter l'idée objective. Voyez MODE.
2°. Il faut encore distinguer dans la signification objective des mots l'idée principale et les idées accessoires. Lorsque plusieurs mots de la même espèce représentent une même idée objective, variée seulement de l'une à l'autre par des nuances différentes qui naissent de la diversité des idées ajoutées à la première ; celle qui est commune à tous ces mots, est l'idée principale ; et celles qui y sont ajoutées et qui différencient les signes, sont des idées accessoires. par exemple, amour et amitié sont des noms abstractifs, qui présentent également à l'esprit l'idée de ce sentiment de l'âme qui porte les hommes à se réunir ; c'est l'idée principale de la signification objective de ces deux mots : mais le nom amour ajoute à cette idée principale, l'idée accessoire de l'inclination d'un sexe pour l'autre ; et le nom amitié y ajoute l'idée accessoire d'un juste fondement, sans distinction de sexe. On trouvera dans les mêmes idées accessoires la différence des noms substantifs amant et ami, des adjectifs amoureux et amical, des adverbes amoureusement et amicalement.
C'est sur la distinction des idées principales et accessoires de la signification objective, que porte la différence réelle des mots honnêtes et déshonnêtes, que les Cyniques traitaient de chimérique ; et c'était pour avoir négligé de démêler dans les mots les différentes idées accessoires que l'usage peut y attacher, qu'ils avaient adopté le système impudent de l'indifférence des termes, qui les avait ensuite mené jusqu'au système plus impudent encore de l'indifférence des actions par rapport à l'honnêteté. Voyez DESHONNETE.
Quand on ne considère dans les mots de la même espèce, qui désignent une même idée objective principale, que cette seule idée principale, ils sont synonymes : mais ils cessent de l'être quand on fait attention aux idées accessoires qui les différencient. Voyez SYNONYMES. Dans bien des cas on peut les employer indistinctement et sans choix ; c'est surtout lorsqu'on ne veut et qu'on ne doit présenter dans le discours que l'idée principale, et qu'il n'y a dans la langue aucun mot qui l'exprime seule avec abstraction de toute idée accessoire ; alors les circonstances font assez connaître que l'on fait abstraction des idées accessoires que l'on désignerait par le même mot en d'autres occurrences : mais s'il y avait dans la langue un mot qui signifiât l'idée principale seule et abstraite de toute autre idée accessoire, ce serait en cette occasion une faute contre la justesse, de ne pas s'en servir plutôt que d'un autre auquel l'usage aurait attaché la signification de la même idée modifiée par d'autres idées accessoires.
Dans d'autres cas, la justesse de l'expression exige que l'on choisisse scrupuleusement entre les synonymes, parce qu'il n'est pas toujours indifférent de présenter l'idée principale sous un aspect ou sous un autre. C'est pour faciliter ce choix important, et pour mettre en état d'en sentir le prix et les heureux effets, que M. l'abbé Girard a donné au public son livre des synonymes français ; c'est pour augmenter ce secours que l'on a répandu dans l'Encyclopédie différents articles de même nature ; et il serait à souhaiter que tous les gens de lettres recueillissent les observations que le hasard peut leur offrir sur cet objet, et les publiassent par les voies ouvertes au public : il en résulterait quelque jour un excellent dictionnaire, ce qui est plus important qu'on ne le pense peut-être ; parce qu'on doit regarder la justesse de l'élocution non-seulement comme une source d'agrément et d'élégance, mais encore comme l'un des moyens les plus propres à faciliter l'intelligence et la communication de la vérité.
Aux mots synonymes, caractérisés par l'identité du sens principal, malgré les différences matérielles, on peut opposer les mots homonymes, caractérisés au contraire par la diversité des sens principaux, malgré l'identité ou la ressemblance dans le matériel. Voyez HOMONYMES. C'est surtout contre l'abus des Homonymes que l'on doit être en garde, parce que c'est la ressource la plus facile, la plus ordinaire et la plus dangereuse de mauvaise foi.
3°. La distinction de l'idée principale et des idées accessoires a lieu à l'égard de la signification formelle, comme à l'égard de la signification objective.
L'idée principale de la signification formelle, est celle du point de vue spécifique qui caractérise l'espèce du mot, adaptée à l'idée totale de la signification objective : et les idées accessoires de la signification formelle, sont celles des divers points de vue accidentels, désignés ou désignables par les différentes formes que la déclinabilité peut faire prendre à un même mot. Par exemple, amare, amabam, amavissent, sont trois mots dont la signification objective renferme la même idée totale, celle du sentiment général de bienveillance que nous avons déjà Ve appartenir à d'autres mots pris dans notre langue ; en outre, ils présentent également à l'esprit des êtres indéterminés, désignés seulement par l'idée de l'existence sous l'attribut de ce sentiment : voilà ce qui constitue l'idée principale de la signification formelle de ces trois mots. Mais les inflexions et les terminaisons qui les différencient, indiquent des points de vue différents ajoutés à l'idée principale de la signification formelle : dans amare, on remarque que cette signification doit être entendue d'un sujet quelconque, parce que le mode est infinitif ; que l'existence en est envisagée comme simultanée avec une époque, parce que le temps est présent ; que cette époque est une époque quelconque, parce que ce présent est indéfini : dans amabam et amavissent, on voit que la signification doit être entendue d'un sujet déterminé, parce que les modes sont personnels ; que ce sujet déterminé doit être de la première personne et au nombre singulier pour amabam, de la troisième personne et du nombre pluriel pour amavissent ; que l'existence du sujet est envisagée relativement à une époque antérieure au moment de la parole dans chacun de ces deux mots, parce que les temps en sont antérieurs, mais qu'elle est simultanée dans amabam qui est un présent, et antérieure dans amavissent qui est un prétérit, etc.
C'est sur la distinction des idées principales et accessoires de la signification formelle, que porte la diversité des formes dont les mots se revêtent selon les vues de l'énonciation ; formes spécifiques, qui, dans chaque idiôme, caractérisent à-peu-près l'espèce du mot ; et formes accidentelles, que l'usage de chaque langue a fixées relativement aux vues de la syntaxe, et dont le choix bien entendu est le fondement de ce que l'on nomme la correction du style, qui est l'un des signes les plus certains d'une éducation cultivée.
Je finirai cet article par une définition du mot la plus exacte qu'il me sera possible. L'auteur de la Grammaire générale (part. II. ch. j.) dit que " l'on peut définir les mots des sons distincts et articulés dont les hommes ont fait des signes pour signifier leurs pensées ". Mais il manque beaucoup à l'exactitude de cette définition. Chaque syllabe est un son distinct et souvent articulé, qui quelquefois signifie quelque chose de nos pensées : dans amaveramus, la syllabe am est le signe de l'attribut sous lequel existe le sujet ; av indique que le temps est prétérit (Voyez TEMS) ; er marque que c'est un prétérit défini ; am final désigne qu'il est antérieur ; us marque qu'il est dans la première personne du pluriel ; y a-t-il cinq mots dans amaveramus ? La préposition française ou latine à, la conjonction ou, l'adverbe y, le verbe latin eo, sont des sons non-articulés, et ce sont pourtant des mots. Quand on dit que ce sont des signes pour signifier les pensées, on s'exprime d'une manière incertaine ; car une proposition entière, composée même de plusieurs mots, n'exprime qu'une pensée ; n'est-elle donc qu'un mot ? Ajoutez qu'il est peu correct de dire que les hommes ont fait des signes pour signifier ; c'est un pléonasme.
Je crois donc qu'il faut dire qu'un mot est une totalité de sons, devenue par usage, pour ceux qui l'entendent, le signe d'une idée totale.
1°. Je dis qu'un mot est une totalité de sons ; parce que, dans toutes les langues, il y a des mots d'une et de plusieurs syllabes, et que l'unité est une totalité aussi-bien que la pluralité. D'ailleurs, j'exclus par-là les syllabes qui ne sont que des sons partiels, et qui ne sont pas des mots, quoiqu'elles désignent quelquefois des idées, même complexes.
2°. Je n'ajoute rien de ce qui regarde l'articulation ou la non-articulation des sons ; parce qu'il me semble qu'il ne doit être question d'un état déterminé du son, qu'autant qu'il serait exclusivement nécessaire à la notion que l'on veut donner : or, il est indifférent à la nature du mot d'être une totalité de sons articulés ou de sons non-articulés ; et l'idée seule du son, faisant également abstraction de ces deux états opposés, n'exclut ni l'un ni l'autre de la notion du mot : son simple, son articulé, son aigu, son grave, son bref, son allongé, tout y est admissible.
3°. Je dis qu'un mot est le signe d'une idée totale ; et il y a plusieurs raisons pour m'exprimer ainsi. La première, c'est qu'on ne peut pas disconvenir que souvent une seule syllabe, ou même une simple articulation, ne soit le signe d'une idée, puisqu'il n'y a ni inflexion ni terminaison qui n'ait sa signification propre : mais les objets de cette signification ne sont que des idées partielles, et le mot entier est nécessaire à l'expression de l'idée totale. La seconde raison, c'est que si l'on n'attachait pas à la signification du mot une idée totale, on pourrait dire que le mot, diversement terminé, demeure le même, sous prétexte qu'il exprime toujours la même idée principale ; mais l'idée principale et les idées accessoires sont également partielles, et le moindre changement qui arrive dans l'une ou dans l'autre est un changement réel pour la totalité ; le mot alors n'est plus le même, c'en est un autre, parce qu'il est le signe d'une autre idée totale. Une troisième raison, c'est que la notion du mot ainsi entendue est vraie, de ceux même qui équivalent à des propositions entières, comme oui, non, allez, morieris, etc. car toute une proposition ne sert qu'à faire naître dans l'esprit de ceux qui l'entendent une idée plus précise, et plus développée du sujet.
4°. J'ajoute qu'un mot est signe pour ceux qui l'entendent. C'est que l'on ne parle en effet que pour être entendu ; ce qui se passe dans l'esprit d'un homme, n'a aucun besoin d'être représenté par des signes extérieurs, qu'autant qu'on veut le communiquer au-dehors ; et que les signes sont pour ceux à qui ils manifestent les objets signifiés. Ce n'est d'ailleurs que pour ceux qui entendent que les interjections sont des signes d'idées totales, puisqu'elles n'indiquent dans celui qui les prononce naturellement que des sentiments.
5°. Enfin, je dis qu'un mot devient par usage le signe d'une idée totale, afin d'assigner le vrai et unique fondement de la signification des mots. " Les mots, dit le père Lami (Rhét. liv. I. ch. iv.), ne signifient rien par eux-mêmes, ils n'ont aucun rapport naturel avec les idées dont ils sont les signes ; et c'est ce qui cause cette diversité prodigieuse de langues : s'il y avait un langage naturel, il serait connu de toute la terre et en usage par-tout ". C'est une vérité que j'ai exposée en détail et que je crois avoir bien établie à l'article LANGUE (art. I. sub fin.). Mais si les mots ne signifient pas par nature, ils signifient donc par institution ; quel en est l'auteur ? Tous les hommes, ou du-moins tous les sages d'une nation, se sont-ils assemblés pour régler dans une délibération commune la signification de chaque mot, pour en choisir le matériel, pour en fixer les dérivations et les déclinaisons ? Personne n'ignore que les langues ne se sont pas formées ainsi. La première a été inspirée, en tout ou en partie, aux premiers auteurs du genre humain : et c'est probablement la même langue que nous parlons tous, et que l'on parlera toujours et par-tout, mais altérée par les changements qui y survinrent d'abord à Babel en vertu de l'opération miraculeuse du Tout-Puissant, puis par tous les autres qui naissent insensiblement de la diversité des temps, des climats, des lumières, et de mille autres circonstances diversement combinées. " Il dépend de nous, dit encore le père Lami (ibid. ch. vij.), de comparer les choses comme nous voulons " ; (ce choix des comparaisons n'est peut-être pas toujours si arbitraire qu'il l'assure, et il tient souvent à des causes dont l'influence est irrésistible pour les nations, quoiqu'elle put être nulle pour quelques individus ; mais du moins est-il certain que nous comparons très-différemment, et cela suffit ici : car c'est " ce qui fait, ajoute-t-il, cette grande différence qui est entre les langues. Ce que les Latins appellent fenêtra, les Espagnols l'appellent ventana, les Portugais janella ; nous nous servons aussi de ce nom croisée pour marquer la même chose. Fenestra, ventus, janua, crux, sont des mots latins. Le français, l'espagnol, le portugais viennent du latin ", (c'est-à-dire, que ces trois idiômes ont emprunté beaucoup de mots dans la langue latine, et c'est tout :) " mais les Espagnols considérant que les fenêtres donnent passage aux vents, les appellent ventana de ventus : les Portugais ayant regardé les fenêtres comme de petites portes, ils les ont appelées janella de janua : nos fenêtres étaient autrefois partagées en quatre parties avec des croix de pierre ; on les appelait pour cela des croisées de crux : les Latins ont considéré que l'usage des fenêtres est de recevoir la lumière ; le nom fenêtra vient du grec qui signifie reluire. C'est ainsi que les différentes manières de voir les choses portent à leur donner différents noms ". Et c'est ainsi, puis-je ajouter, que la diversité des vues introduit en divers lieux des mots très-différents pour exprimer les mêmes idées totales ; ce qui diversifie les idiômes, quoiqu'ils viennent tous originairement d'une même source. Mais ces différents mots, risqués d'abord par un particulier qui n'en connait point d'autre pour exprimer ses idées telles qu'elles sont dans son esprit, n'en deviennent les signes universels pour toute la nation, qu'après qu'ils ont passé de bouche en bouche dans le même sens ; et ce n'est qu'alors qu'ils appartiennent à l'idiôme national. Ainsi c'est l'usage qui autorise les mots, qui en détermine le sens et l'emploi, qui en est l'instituteur véritable et l'unique approbateur.
Mais d'où nous vient le terme de mot ? On trouve dans Lucilius, non audet dicère mutum (il n'ose dire un mot) ; et Cornutus, qui enseigna la Philosophie à Perse, et qui fut depuis son commentateur, remarque sur la première satyre de son disciple, que les Romains disaient proverbialement, mutum nullum emiseris (ne dites pas un seul mot). Festus témoigne que mutire, qu'il rend par loqui, se trouve dans Ennius ; ainsi mutum et mutire, qui paraissent venir de la même racine, ont un fondement ancien dans la langue latine.
Les Grecs ont fait usage de la même racine, et ils ont , discours ; , parleur ; et , parler.
D'après ces observations, Ménage dérive mot du latin mutum ; et croit que Périon s'est trompé d'un degré, en le dérivant immédiatement du grec .
Il se peut que nous l'ayons emprunté des Latins, et les Latins des Grecs ; mais il n'est pas moins possible que nous le tenions directement des Grecs, de qui, après tout, nous en avons reçu bien d'autres : et la décision tranchante de Ménage me parait trop hasardée, n'ayant d'autre fondement que la priorité de la langue grecque sur la latine.
J'ajoute qu'il pourrait bien se faire que les Grecs, les Latins, et les Celtes de qui nous descendons, eussent également trouvé ce radical dans leur propre fonds, et que l'onomatopée l'eut consacré chez tous au même usage, par un tour d'imagination qui est universel parce qu'il est naturel. Ma, mê, mé, mi, meu, mo, mu, mou, sont dans toutes les langues les premières syllabes articulées, parce que m est la plus facîle de toutes les articulations (voyez LANGUE, art. III. §. IIe n. 1.) ; ces syllabes doivent donc se prendre assez naturellement pour signifier les premières idées qui se présentent ; et l'on peut dire que l'idée de la parole est l'une des plus frappantes pour des êtres qui parlent. On trouve encore dans le poète Lucilius, non laudare hominem quemquam, nec mu facère unquàm ; où l'on voit ce mu indéclinable, montré comme l'un des premiers éléments de la parole. Il est vraisemblable que les premiers instituteurs de la langue allemande l'envisagèrent à-peu-près de même, puisqu'ils appelèrent mut, la pensée, par une métonymie sans doute du signe pour la chose signifiée : et ils donnèrent ensuite le même nom à la substance de l'âme, par une autre métonymie de l'effet pour la cause. Voyez METONYMIE. (B. E. R. M.)
MOT, TERME, EXPRESSION, (Synonyme) Le mot, dit l'abbé Girard, est de la langue ; l'usage en décide. Le terme est du sujet ; la convenance en fait la bonté. L'expression est de la pensée ; le tour en fait le mérite.
La pureté du langage dépend des mots ; sa précision dépend des termes ; et son brillant dépend des expressions.
Tout discours travaillé demande que les mots soient français ; que les termes soient propres ; et que les expressions soient nobles.
Un mot hasardé choque moins qu'un mot qui a vieilli. Les termes d'art sont aujourd'hui moins ignorés dans le grand monde ; il en est pourtant qui n'ont de grâce que dans la bouche de ceux qui font profession de ces arts. Les expressions trop recherchées font à l'égard du discours, ce que le fard fait à l'égard de la beauté du sexe ; employées pour embellir, elles enlaidissent. (D.J.)
MOT CONSACRE, (Grammaire) On appelle mots consacrés certains mots particuliers qui ne sont bons qu'en certains endroits ou occasions ; et on leur a peut-être donné ce nom, parce que ces mots ont commencé par la religion, dont les mystères n'ont pu être exprimés que par des mots faits exprès. Trinité, incarnation, nativité, transfiguration, annonciation, visitation, assomption, fils de perdition, portes de l'enfer, vase d'élection, homme de péché, etc. sont des mots consacrés, aussi-bien que cène, cénacle, fraction de pain, actes des Apôtres, etc.
De la religion on a étendu ce mot de consacré aux Sciences et aux Arts ; de sorte que les mots propres des Sciences et des Arts s'appellent des mots consacrés, comme gravitation, raréfaction, condensation, et mille autres, en matière de Physique ; allegro, adagio, aria, arpeggio, en Musique, etc.
Il faut se servir sans difficulté des mots consacrés dans les matières de religion, Sciences et Arts ; et qui voudrait dire, par exemple, la fête de la naissance de Notre-Seigneur, la fête de la visite de la Vierge, ne dirait rien qui vaille : l'usage veut qu'on dise la nativité et la visitation, en parlant de ces deux mystères, etc. Ce n'est pas qu'on ne puisse dire la naissance de Notre-Seigneur, et la visite de la Vierge : par exemple, la naissance de Notre-Seigneur est bien différente de celle des princes ; la visite que rendit la Vierge à sa cousine n'avait rien des visites profanes du monde. L'usage veut aussi qu'on dise le cénacle ; et ceux qui diraient une chambre haute pour le cénacle, et le souper pour la cène, s'exprimeraient fort mal. (D.J.)
MOT BON, (Opérat. de l'esprit) un bon mot, est un sentiment vivement et finement exprimé ; il faut que le bon mot naisse naturellement et sur le champ ; qu'il soit ingénieux, plaisant, agréable ; enfin, qu'il ne renferme point de raillerie grossière, injurieuse, et piquante.
Le plupart des bons mots, consistent dans des tours d'expressions, qui sans gêner, offrent à l'esprit deux sens également vrais ; mais dont le premier qui saute d'abord aux yeux, n'a rien que d'innocent, au lieu que l'autre qui est le plus caché, renferme souvent une malice ingénieuse.
Cette duplicité de sens, est dans un homme destitué de génie, un manque de précision et de connaissance de la langue ; mais dans un homme d'esprit, cette même duplicité de sens est une adresse, par laquelle il fait naître deux idées différentes ; la plus cachée dévoîle à ceux qui ont un peu de sagacité une satyre délicate, qu'elle recele à une pénétration moins vive.
Quelquefois le bon mot n'est autre chose que l'heureuse hardiesse d'une expression appliquée à un usage peu ordinaire. Quelquefois aussi la force d'un bon mot ne consiste point dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on ne dit pas, et qu'on fait sentir comme une conséquence naturelle de nos paroles, sur laquelle on a l'adresse de porter l'attention de ceux qui nous écoutent.
Le bon mot est plutôt imaginé que pensé ; il prévient la méditation et le raisonnement ; et c'est en partie pourquoi tous les bons mots ne sont pas capables de soutenir la presse. La plupart perdent leur grâce, dès qu'on les rapporte détachés des circonstances qui les ont fait naître ; circonstances qu'il n'est pas aisé de faire sentir à ceux qui n'en ont pas été les témoins.
Mais, quoique le bon mot ne soit pas l'effet de la méditation, il est sur pourtant que les saillies de ceux qui sont habitués à une exacte méthode de raisonner, se sentent de la justesse de l'esprit. Ces personnes ont enseigné à leur imagination, quelque vive qu'elle sait, à obéir à la sévérité du raisonnement. C'est peut-être faute de cette exactitude de raisonnement, que plusieurs anciens se sont souvent trompés sur la nature des bons mots, et de la fine plaisanterie.
Ceux qui ont beaucoup de feu, et dont l'imagination est propre aux saillies et aux bons mots, doivent avoir soin de se procurer un fonds de justesse et de discernement qui ne les abandonne pas même dans leur grande vivacité. Il leur importe encore d'avoir un fonds de vertu qui les empêche de laisser rien échapper qui soit contraire à la bienséance, et aux ménagements qu'ils doivent avoir pour ceux que leurs bons mots regardent. (D.J.)
MOT-DU-GUET, ou simplement mot, est un mot ou sentence, en terme de guerre, qui sert aux soldats à se reconnaître pendant la nuit, et à découvrir les espions, ou autres gens mal intentionnés : on s'en sert aussi pour prévenir les surprises. Dans une armée, le mot se donne par le général au lieutenant ou au major général de jour, lequel le donne au major de brigade : de-là il passe aux aides-majors, qui le donnent aux officiers de l'état-major, ensuite aux sergens de chaque compagnie, qui le donnent à leurs subalternes.
Dans les garnisons, après que les portes sont fermées, le commandant donne le mot au major de la place, et il lui dit ce qu'il y a à faire pour le lendemain. Il faut remarquer que celui qui commande dans un château, fort, réduit, ou citadelle, doit tous les jours envoyer prendre l'ordre de celui qui commande dans la ville, quand même celui-ci serait d'un rang inférieur au sien, sans que celui qui commande dans la ville, puisse pour cela prétendre aucun commandement dans la citadelle, château, fort, ou réduit, à-moins qu'il n'en fût gouverneur. Après que les portes sont fermées, le major se rend sur la place, où il trouve les sergens de la garnison rangés en cercle avec chacun un caporal de la compagnie derrière lui. Les caporaux des compagnies dont les sergens manquent, se placent hors du cercle, joignant les sergens dans le rang de leurs compagnies ; les tambours majors des bataillons à deux pas derrière les sergens ; à quatre pas du cercle, on place les caporaux qui ont suivi leurs sergens, présentant leurs armes en-dehors, pour empêcher que qui que ce soit n'approche du cercle, pour écouter l'ordre, il ne doit entrer dans le cercle que le major, l'aide-major de la place, et les officiers majors des régiments, le caporal du consigne du corps de la place portant le falot, et celui qui tient le registre de la garde des rondes.
Le major entre dans le cercle avec les officiers majors des régiments qui assistent à l'ordre, et les autres qu'on a déjà dit. Il dit aux sergens et aux tambours majors s'il y a quelque chose qui les regarde, ce qu'il y a à faire pour le lendemain, comme revue, conseil de guerre, ou autre chose, si quelque bataillon doit prendre les armes pour faire l'exercice, et tout le reste ; s'il y a conseil de guerre, il demande aux majors des régiments le nombre d'officiers nécessaire pour le tenir. Il fait ensuite nommer les officiers qui doivent monter la garde le lendemain, et ceux qui doivent faire la ronde cette même nuit ; il fait tirer leur ronde par leurs sergens ; il donne le mot aux officiers majors des régiments, et après aux sergens, en commençant par celui de la première compagnie, à qui il le dit à l'oreille. Ce sergent le donne à celui qui le suit, et ainsi de l'un à l'autre, jusqu'à ce que le mot revienne au major par le sergent de la gauche, ainsi qu'il l'a donné. S'il ne lui revenait pas comme il le lui a donné, il regarde à quel sergent il a manqué, le redresse jusqu'à ce que tous le sachent, après quoi il les congédie. Les sergens doivent être découverts dès qu'on donne le mot, jusqu'à ce que le dernier l'ait rendu au major. Lorsqu'il y a de la cavalerie dans une place, elle reçoit l'ordre du major de la place tout ainsi que l'infanterie.
Dès que l'ordre est donné et le cercle rompu, les sergens de chaque bataillon forment un cercle à part ; le tambour major derrière eux, le major, ou aide-major du bataillon leur dit ce qu'il y a à faire pour le détail du bataillon, et tout ce que le commandant lui a dit. Pour cela il faut que le major aille tous les jours chez le commandant du bataillon quelque temps avant qu'on donne l'ordre, lui demander ce qu'il y a de particulier à ordonner. Il est à observer que si le commandant veut faire prendre les armes, il faut qu'il en fasse demander la permission au commandant de la place, lequel le fait dire au cercle général par le major. Après que le major du bataillon a donné l'ordre à son cercle particulier, les sergens vont le porter à leurs officiers, à qui ils doivent dire bien fidèlement tout ce qui a été dit à l'ordre. Le major Ve le porter au colonel, à l'aide-major, au lieutenant colonel, quoique le colonel soit présent. S'ils n'y sont ni l'un ni l'autre, l'officier major Ve le porter à celui qui commande le régiment, l'aide-major de la place Ve le porter à l'inspecteur général, un sergent Ve le porter à l'inspecteur particulier. L'usage est le même pour l'ingénieur général, ou directeur des fortifications, et l'ingénieur particulier... et le dernier sergent de la garnison qui se trouve être de garde, Ve le porter au lieutenant ou commissaire d'artillerie qui est dans la place.
Les sergens qui sont de garde, n'assistent pas à ce cercle particulier, ni ne doivent aller porter l'ordre à leurs officiers de compagnie, mais seulement à ceux avec lesquels ils sont de garde. Il doit y avoir tous les jours un sergent par compagnie avec son caporal à l'ordre ; et s'il y en a un de garde, son camarade doit s'y trouver pour l'aller porter à ses officiers, et pour le détail de la compagnie, dont celui qui est de garde ne doit pas se mêler. Lorsqu'il manque des sergens à une compagnie, un caporal Ve à l'ordre avec son fusil. Tous les sergens doivent avoir leurs halebardes lorsqu'ils vont à l'ordre, et qu'ils vont le porter à leurs officiers. Histoire de la milice française, par le père Daniel.
MOT, (Histoire moderne) on le dit aussi des armoiries et des devises. Voyez ARMOIRIES et DEVISE.
Ce qu'on appelle le mot dans les armoiries, est une courte sentence ou phrase écrite sur un rouleau qu'on place ordinairement au-dessus de l'écusson, et quelquefois au-dessous. Tantôt ce mot fait allusion au nom ou à quelques pièces des armes de la personne à qui appartiennent les armes, et tantôt il n'a rapport ni au nom ni au blason.
Le mot, dit Guillin, est un ornement extérieur attaché à la cotte d'armes ; il présente, ajoute-t-il, une idée de celui à qui les armes appartiennent, mais exprimée succinctement et avec force en trois ou quatre paroles au plus, écrites sur une bande ou compartiment qu'on place au pied de l'écusson ; et comme ce mot tient la dernière place dans les armes, on le blasonne aussi le dernier. A la rigueur, il devrait exprimer quelque chose de relatif à ces armes ; mais l'usage a fait admettre toute sorte de sentences expressives ou non. Voyez BLASON.
Cette coutume d'employer un mot ou symbolique, ou comme cri de guerre pour s'animer, se reconnaître, et se rallier dans les combats, est très-ancienne : l'Histoire sacrée et profane nous en fournissent également des exemples. Nos ancêtres faisaient choix du mot le plus propre à exprimer leur passion dominante, comme la piété, l'amour, la valeur, etc. ou quelque événement extraordinaire qui leur fût arrivé. On trouve plusieurs mots de cette dernière sorte qui se sont perpétués dans les familles, quoiqu'ils ne convinssent proprement qu'à la première personne qui se l'était attribué.
Le mot de la maison royale de France est espérance ; et dans quelques écussons lilia non laborant neque nent, par allusion à la loi salique, qui exclut les femmes de la couronne : celui de la maison royale d'Angleterre est Dieu et mon droit. L'ordre de la Jarretière a pour mot, honni soit qui mal y pense ; et le duc de Nortfolk ces paroles, sola virtus invicta : le duc de Bedfort celles-ci, che sara sara : celui de Devonshire, cavendo tutus, par allusion au nom de sa maison, qui est Cavendish. Le duc de Kinston, dont le nom est Pierrepont, a pour mot Pie reponete : le comte de Radnor, quae supra, parce qu'il porte trois étoiles dans ses armes : le lord Klinton, dont le nom est Fortescue, prend celui-ci, Forte scutum, salus ducum.
On peut voir sous l'article cri de guerre, les mots que prennent ou prenaient plusieurs des premières maisons de France. Le mot d'une devise s'appelle aussi l'âme de la devise. Voyez DEVISE.
MOT, terme de Commerce, et particulièrement de détail : il se dit du prix que le marchand demande de sa marchandise, ou de celui que l'acheteur en offre. Ce drap est de vingt francs, c'est mon dernier mot : vous n'en offrez que seize, vous ne serez pas pris au mot.
On dit qu'on a été pris au mot, quand le marchand livre sa marchandise à l'acheteur sur la première offre que celui-ci en a faite.
Un marchand qui n'a qu'un mot, est celui qui ne surfait pas. On dit que les Quakres d'Angleterre et les Anabaptistes de Hollande qui exercent le trafic, en usent ainsi et avec succès. Dictionnaire de Commerce.
MOT, sonner un ou deux mots, (Vénerie) c'est sonner un ou deux tons longs du cors, qui est le signal du piqueur pour appeler ses compagnons.
MOT
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Logique
- Catégorie : Grammaire & Logique
- Affichages : 2448