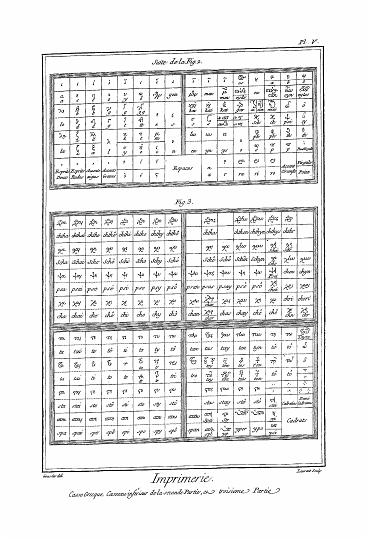(Grammaire) il s'est dit d'abord des petits corps ou fruits que les arbres et les plantes produisent ; qui leur servent de semences, ou qui les contiennent. Ainsi on dit un grain de raisin, un grain de blé, d'orge, d'avoine, de seigle. On a étendu cette dénomination à d'autres petits corps, à des fragments, à des configurations ; et on dit un grain d'or pour une petite portion d'or : la molécule diffère du grain, en ce qu'elle est plus petite ; il faut plusieurs molécules réunies pour faire un grain. On a dit le grain de l'acier, pour ces inégalités qui offrent à la fracture d'un morceau d'acier l'image d'une crystallisation régulière, surtout si le refroidissement n'a pas été subit ; car le refroidissement précipité gâte cette apparence, de même que l'évaporation hâtée altère la régularité des crystaux : un grain de chapelet, pour un petit corps rond de verre, d'ivoire, de bois, ou d'autre matière, percé de part en part d'un trou qui sert à l'enfiler avec un certain nombre d'autres, à l'aide desquels celui qui s'en sert sait le compte exact des pater et des ave qu'il récite : les grains, pour la collection générale des fromentacés qui servent à la nourriture de l'homme et des animaux ; les gros grains sont ceux qui servent à la nourriture de l'homme ; les menus, ceux qui servent à la nourriture des animaux : un grain de métal, pour un petit globule rond de métal qu'on obtient dans la réduction d'une petite portion de mine ou de chaux métallique, et qu'on trouve à la pointe d'une des matières qui ont servi de flux ou de fondant : un grain de vérole, pour une pustule considérée séparément ; il se dit et de la pustule et de la tache qu'elle laisse communément. Grain a encore d'autres acceptions ; c'est un poids, une monnaie, etc. Voyez les articles suivants, mais surtout l'article GRAINS (Economie politiq.) où ce terme est considéré selon son objet le plus important.
GRAINS, (Economie polit.) Les principaux objets du Commerce en France, sont les grains, les vins et eaux-de-vie, le sel, les chanvres et les lins, les laines, et les autres produits que fournissent les bestiaux : les manufactures des toiles et des étoffes communes peuvent augmenter beaucoup la valeur des chanvres, des lins, et des laines, et procurer la subsistance à beaucoup d'hommes qui seraient occupés à des travaux si avantageux. Mais on aperçoit aujourd'hui que la production et le commerce de la plupart de ces denrées sont presque anéantis en France. Depuis longtemps les manufactures de luxe ont séduit la nation ; nous n'avons ni la soie ni les laines convenables pour fabriquer les belles étoffes et les draps fins ; nous nous sommes livrés à une industrie qui nous était étrangère ; et on y a employé une multitude d'hommes, dans le temps que le royaume se dépeuplait et que les campagnes devenaient désertes. On a fait baisser le prix de nos blés, afin que la fabrication et la main-d'œuvre fussent moins chères que chez l'étranger : les hommes et les richesses se sont accumulés dans les villes ; l'Agriculture, la plus féconde et la plus noble partie de notre commerce, la source des revenus du royaume, n'a pas été envisagée comme le fond primitif de nos richesses ; elle n'a parut intéresser que le fermier et le paysan : on a borné leurs travaux à la subsistance de la nation, qui par l'achat des denrées paye les dépenses de la culture ; et on a cru que c'était un commerce ou un trafic établi sur l'industrie, qui devait apporter l'or et l'argent dans le royaume. On a défendu de planter des vignes ; on a recommandé la culture des mûriers ; on a arrêté le débit des productions de l'Agriculture et diminué le revenu des terres, pour favoriser des manufactures préjudiciables à notre propre commerce.
La France peut produire abondamment toutes les matières de premier besoin ; elle ne peut acheter de l'étranger que des marchandises de luxe : le trafic mutuel entre les nations est nécessaire pour entretenir le Commerce. Mais nous nous sommes principalement attachés à la fabrication et au commerce des denrées que nous pouvions tirer de l'étranger ; et par un commerce de concurrence trop recherché, nous avons voulu nuire à nos voisins, et les priver du profit qu'ils retiraient de nous par la vente de leurs marchandises.
Par cette politique nous avons éteint entr'eux et nous un commerce réciproque qui était pleinement à notre avantage ; ils ont interdit chez eux l'entrée de nos denrées, et nous achetons d'eux par contrebande et fort cher les matières que nous employons dans nos manufactures. Pour gagner quelques millions à fabriquer et à vendre de belles étoffes, nous avons perdu des milliards sur le produit de nos terres ; et la nation parée de tissus d'or et d'argent, a cru jouir d'un commerce florissant.
Ces manufactures nous ont plongés dans un luxe desordonné qui s'est un peu étendu parmi les autres nations, et qui a excité leur émulation : nous les avons peut-être surpassées par notre industrie ; mais cet avantage a été principalement soutenu par notre propre consommation.
La consommation qui se fait par des sujets est la source des revenus du souverain ; et la vente du superflu à l'étranger augmente les richesses des sujets. La prospérité de l'état dépend du concours de ces deux avantages : mais la consommation entretenue par le luxe est trop bornée ; elle ne peut se soutenir que par l'opulence ; les hommes peu favorisés de la fortune ne peuvent s'y livrer qu'à leur préjudice et au désavantage de l'état.
Le ministère plus éclairé sait que la consommation qui peut procurer de grands revenus au souverain, et qui fait le bonheur de ses sujets, est cette consommation générale qui satisfait aux besoins de la vie. Il n'y a que l'indigence qui puisse nous réduire à boire de l'eau, à manger de mauvais pain, et à nous couvrir de haillons ; tous les hommes tendent par leurs travaux à se procurer de bons aliments et de bons vêtements : on ne peut trop favoriser leurs efforts ; car ce sont les revenus du royaume, les gains et les dépenses du peuple qui font la richesse du souverain.
Le détail dans lequel nous allons entrer sur les revenus que peuvent procurer d'abondantes récoltes de grains, et sur la liberté dans le commerce de cette denrée prouvera suffisamment combien la production des matières de premier besoin, leur débit et leur consommation intéressent tous les différents états du royaume, et fera juger de ce que l'on doit aujourd'hui attendre des vues du gouvernement sur le rétablissement de l'Agriculture.
Nous avons déjà examiné l'état de l'Agriculture en France, les deux sortes de culture qui y sont en usage, la grande culture ou celle qui se fait avec les chevaux, et la petite culture ou celle qui se fait avec les bœufs, la différence des produits que donnent ces deux sortes de culture, les causes de la dégradation de notre agriculture, et les moyens de la rétablir. Voyez FERMIERS, (Economie politiq.)
Nous avons Ve que l'on cultive environ 36 millions d'arpens de terre, et que nos récoltes nous donnent, année commune, à-peu-près 45 millions de septiers de blé ; savoir 11 millions produits par la grande culture, et 34 millions par la petite culture (a). Nous allons examiner le revenu que 45 millions
(a) Si les cultivateurs étaient assez riches pour traiter les 36 millions d'arpens par la grande culture, conformément aux six millions qui sont traités actuellement par cette culture, la récolte annuelle serait environ de 66 millions de septiers, au lieu de 44 millions, comme on Ve le prouver par l'examen de l'état actuel de la grande culture.
de septiers de blé peuvent procurer au Roi, conformément aux deux sortes de culture qui les produisent : nous examinerons aussi ce qu'on en retire pour la dixme, pour le loyer des terres, et pour le gain du cultivateur ; nous comparerons ensuite ces revenus avec ceux que produirait le rétablissement parfait de notre agriculture, l'exportation étant permise ; car sans cette condition, nos récoltes qui ne sont destinées qu'à la consommation du royaume, ne peuvent pas augmenter, parce que si elles étaient plus abondantes, elles feraient tomber le blé en non-valeur ; les cultivateurs ne pourraient pas en soutenir la culture, les terres ne produiraient rien au Roi ni aux propriétaires. Il faudrait donc éviter l'abondance du blé dans un royaume où l'on n'en devrait recueillir que pour la subsistance de la nation. Mais dans ce cas, les disettes sont inévitables, parce que quand la récolte donne du blé pour trois ou quatre mois de plus que la consommation de l'année, il est à si bas prix que ce superflu ruine le laboureur, et néanmoins il ne suffit pas pour la consommation de l'année suivante, s'il survient une mauvaise récolte : ainsi il n'y a que la facilité du débit à bon prix, qui puisse maintenir l'abondance et le profit.
Etat de la grande culture des grains. La grande culture est actuellement bornée environ à six millions d'arpens de terre, qui comprennent principalement les provinces de Normandie, de la Beauce, de l'Isle-de-France, de la Picardie, de la Flandre française, du Hainault, et peu d'autres. Un arpent de bonne terre bien traité par la grande culture, peut produire 8 septiers et davantage, mesure de Paris, qui est 240 livres pesant ; mais toutes les terres traitées par cette culture, ne sont pas également fertiles ; car cette culture est plutôt pratiquée par un reste d'usage conservé dans certaines provinces, qu'à raison de la qualité des terres. D'ailleurs une grande partie de ces terres est tenue par de pauvres fermiers hors d'état de les bien cultiver : c'est pourquoi nous n'avons évalué du fort au faible le produit de chaque arpent de terre qu'à cinq septiers, semence prélevée. Nous fixons l'arpent à 100 perches, et la perche à 22 pieds. (b)
Les six millions d'arpens de terre traités par cette culture entretiennent tous les ans une sole de deux millions d'arpens ensemencés en blé ; une sole de deux millions d'arpens ensemencés en avoine et autres grains de Mars ; et une sole de deux millions d'arpens qui sont en jachères, et que l'on prépare à rapporter du blé l'année suivante.
Pour déterminer avec plus d'exactitude le prix commun du blé dans l'état actuel de la grande culture en France, lorsque l'exportation est défendue, il faut faire attention aux variations des produits des récoltes et des prix du blé, selon que les années sont plus ou moins favorables à nos moissons.
(b) C'est un cinquième plus par arpent, que la mesure de l'arpent donnée par M. de Vauban ; ainsi les récoltes doivent produire, selon cette mesure, un cinquième de plus de grain que cet auteur ne l'a estimé par arpent.
Les 87 liv. total des cinq années, frais déduits, divisées en cinq années, donnent par arpent 17 liv. 8 s. de produit net.
Les cinq années donnent 25 septiers, ce qui fait cinq septiers année commune. Ainsi pour savoir le prix commun de chaque septier, il faut diviser le total ci-dessus par 5, ce qui établira le prix commun de chaque septier de blé à 15 liv. 9 s.
Chaque arpent produit encore la dixme, qui d'abord a été prélevée sur la totalité de la récolte, et qui n'est point entrée dans ce calcul. Elle est ordinairement le treizième en-dedans de toute la récolte ou le douzième en-dehors. Ainsi, pour avoir le produit en entier de chaque arpent, il faut ajouter à 77 liv. 8 s. le produit de la dixme, qui se prend sur le total de la récolte, semence comprise. La semence évaluée en argent est 10 liv. 6 s. qui avec 77 liv. 8 s. font 87 liv. 14 s. dont 1/12 pris en-dehors pour la dixme, est 7 livres. Ainsi avec la dixme le produit total, semence déduite, est 84 liv. 16 s.
Ces 84 liv. 16 s. se partagent ainsi :
La culture de chaque arpent qui produit la récolte en blé, est de deux années. Ainsi le fermier paye deux années de fermage sur les 17 liv. 8 s. du produit net de cette récolte ; il doit aussi payer la taille sur cette même somme, et y trouver un gain pour subsister.
Elle doit donc être distribuée à-peu-près ainsi :
(c) Le prix commun réglé, comme on fait ordinairement, sur les prix différents des années, sans égard aux frais, et au plus ou moins de récolte chaque année, n'est un prix commun que pour les acheteurs qui achetent pour leur subsistance la même quantité de blé chaque année. Ce prix est ici le cinquième de 87 liv. qui est 17 liv. 8 s. C'est à-peu-près le prix commun de la vente de nos blés à Paris depuis longtemps ; mais le prix commun pour les fermiers, qui sont les vendeurs, n'est qu'environ 15 liv. 9 sols, à cause de l'inégalité des récoltes.
(d) On ne parle point ici des années stériles, parce qu'elles sont fort rares, et que d'ailleurs on ne peut déterminer le prix qu'elles donnent aux blés.
(e) Voyez le détail de ces frais, aux articles FERMIERS et FERMES.
(f) Nous ne nous réglons pas ici sur l'imposition réelle de la taille ; nous supposons une imposition qui laisse quelque profit au fermier, et un revenu au propriétaire, qui soutienne un peu les richesses de la nation et l'entretien des terres.
S'il paye plus de taille qu'il n'est marqué ici, et s'il paye par arpent pour chaque année de fermage plus de 5 liv. 5 s. ses pertes sont plus considérables, à moins que ce ne soit des terres très-bonnes (g) qui le dédommagent par le produit. Ainsi le fermier a intérêt qu'il n'y ait pas beaucoup de blé ; car il ne gagne un peu que dans les mauvaises années : je dis un peu, parce qu'il a peu à vendre, et que la consommation qui se fait chez lui à haut prix, augmente beaucoup sa dépense. Les prix des différentes années réduits aux prix communs de 15 liv. 9 s. le fermier gagne, année commune, 14 s. par septier ou 3 liv. 10 s. par arpent.
La sole de deux millions d'arpens en blé donne en total, à cinq septiers de blé par arpent, et la dixme y étant ajoutée, 10, 944, 416 septiers, dont la valeur en argent est 169, 907, 795 liv.
De cette somme totale de 169, 907, 795. liv. il y a
Il y a aussi par la grande culture deux millions d'arpens ensemencés chaque année en avoine, ou autres grains de Mars. Nous les supposerons tous ensemencés en avoine, pour éviter des détails inutiles qui nous rameneraient à-peu-près au même produit, tous ces grains étant à-peu-près de la même valeur, étant vrai aussi que l'avoine forme effectivement la plus grande partie de ce genre de récolte. On estime qu'un arpent donne, dixme prélevée, deux septiers d'avoine double mesure du septier de blé. Le septier est évalué 9 liv. Il faut retrancher un sixième des deux septiers pour la semence ; reste pour le produit de l'arpent 15 liv. ou un septier et 2/3. Ajoutez la dixme, le produit total est 16 livres 10 s. dont il y a
Les deux millions d'arpens en avoine donnent, y compris la dixme, et soustraction faite de la semence, 3, 675, 000 septiers, qui valent en argent 33, 330, 333 liv. 7 s. dont il y a :
(g) Les gros fermiers qui exploitent de grandes fermes et de bonnes terres qu'ils cultivent bien, gagnent davantage, quoique de bonnes terres soient affermées à un plus haut prix ; car une terre qui produit beaucoup, procure un plus grand bénéfice sur les frais et sur la semence. Mais il s'agit ici d'une estimation générale du fort au faible, par rapport à la différente valeur des terres, et aux différents états d'aisance des fermiers. On verra ci-après dans les détails, les différents rapports des revenus des terres avec les frais de culture : il est nécessaire d'y faire attention, pour juger des produits de l'agriculture relativement aux revenus des propriétaires, aux profits des fermiers, à la taille et à la dixme ; car on apercevra, à raison des divers produits, des rapports fort différents.
(h) On ne met ici que les frais de moisson, parce que les frais de culture sont compris avec ceux du blé. Voyez l'article FERMIERS (Econom. polit.)
TOTAL des produits de la récolte du blé et de celle de l'avoine, traités par la grande culture.
Etat de la petite culture des grains. Nous avons observé à l'article FERMIER, déjà cité, que dans les provinces où l'on manque de laboureurs assez riches pour cultiver les terres avec des chevaux, les propriétaires ou les fermiers qui font valoir les terres sont obligés de les faire cultiver par des paysans auxquels ils fournissent des bœufs pour les labourer. Nous avons Ve que les frais qu'exige cette culture, ne sont pas moins considérables que ceux de la culture qui se fait avec les chevaux ; mais qu'au défaut de l'argent qui manque dans ces provinces, c'est la terre elle-même qui subvient aux frais. On laisse des terres en friche pour la pâture des bœufs de labour, on les nourrit pendant l'hiver avec les foins que produisent les prairies ; et au lieu de payer des gages à ceux qui labourent, on leur cede la moitié du produit que fournit la récolte.
Ainsi, excepté l'achat des bœufs, c'est la terre elle-même qui avance tous les frais de la culture, mais d'une manière fort onéreuse au propriétaire, et encore plus à l'état ; car les terres qui restent incultes pour le pâturage des bœufs, privent le propriétaire et l'état du produit que l'on en tirerait par la culture. Les bœufs dispersés dans ces pâturages ne fournissent point de fumier ; les propriétaires confient peu de troupeaux à ces métayers ou paysans chargés de la culture de la terre, ce qui diminue extrêmement le produit des laines en France. Mais ce défaut de troupeaux prive les terres de fumier ; et faute d'engrais, elles ne produisent que de petites récoltes, qui ne sont évaluées dans les bonnes années qu'au grain cinq, c'est-à-dire au quintuple de la semence, ou environ trois septiers par arpent, ce qu'on regarde comme un bon produit. Aussi les terres abandonnées à cette culture ingrate sont-elles peu recherchées ; un arpent de terre qui se vend 30 ou 40 liv. dans ces pays-là, vaudrait 2 ou 300 liv. dans des provinces bien cultivées. Ces terres produisent à peine l'intérêt du prix de leur acquisition, surtout aux propriétaires absens : si on déduit des revenus d'une terre assujettie à cette petite culture, ce que produiraient les biens occupés pour la nourriture des bœufs ; si on en retranche les intérêts au denier dix des avances pour l'achat des bœufs de labour, qui diminuent de valeur après un nombre d'années de service, on voit qu'effectivement le propre revenu des terres cultivées est au plus du fort au faible de 20 ou 30 sous par arpent. Ainsi, malgré la confusion des produits et les dépenses de cette sorte de culture, le bas prix de l'acquisition de ces terres s'est établi sur des estimations exactes vérifiées par l'intérêt des acquéreurs et des vendeurs.
Voici l'état d'une terre qui produit, année commune, pour la part du propriétaire environ 3000 liv. en blé, semence prélevée, presque tout en froment ; les terres sont bonnes, et portent environ le grain cinq. Il y en a 400 arpens en culture, dont 200 arpens forment la sole de la récolte de chaque année ; et cette récolte est partagée par moitié entre les métayers et le propriétaire. Ces terres sont cultivées par dix charrues tirées chacune par quatre gros bœufs ; les quarante bœufs valent environ 8000 liv. dont l'intérêt mis au denier dix, à cause des risques et de la perte sur la vente de ces bœufs, quand ils sont vieux et maigres, est 800 liv. Les prés produisent 130 charrais de foin qui sont consommés par les bœufs : de plus il y a cent arpens de friches pour leur pâturage ; ainsi il faut rapporter le produit des 3000 liv. en blé pour la part du propriétaire.
Ainsi ces quatre cent arpens de bonnes terres ne donnent pas par arpent 1 l. 10 s. de revenu (i) : mais dans le cas dont il sera parlé ci-après, chaque arpent serait affermé 10 liv. les 400 arpens rapporteraient au propriétaire 4000 liv. au lieu de 575. Aussi ne devra-t-on pas être étonné de la perte énorme qu'on apercevra dans les revenus des terres du royaume.
Les terres médiocres sont d'un si petit revenu, que selon M. Dupré de Saint-Maur (essai sur les monn.), celles de Sologne et du Berry au centre du royaume, ne sont guère louées que sur le pied de 15 sols l'arpent, les prés, les terres, et les friches ensemble ; encore faut-il faire une avance considérable de bestiaux qu'on donne aux fermiers, sans retirer que le capital à la fin du bail. " Une grande partie de la Champagne, de la Bretagne, du Maine, du Poitou, des environs de Bayonne, etc. dit le même auteur, ne produisent guère davantage ". (k) Le Languedoc est plus cultivé et plus fertîle ; mais ces avantages sont peu profitables, parce que le blé qui est souvent retenu dans la province, est sans débit ; et il y a si peu de commerce, que dans plusieurs en droits de cette province, comme dans beaucoup d'autres pays, les ventes et les achats ne s'y font que par troc ou l'échange des denrées mêmes.
Les petites moissons que l'on recueille, et qui la plupart étant en seigle (l) fournissent peu de fourrages, contribuent peu à la nourriture des bestiaux, et on n'en peut nourrir que par le moyen des paturages ou des terres qu'on laisse en friche : c'est pourquoi on ne les épargne pas. D'ailleurs les métayers, toujours fort pauvres, emploient le plus qu'ils peuvent les bœufs que le propriétaire leur fournit, à faire des charrais à leur profit pour gagner quelque argent, et les propriétaires sont obligés de tolérer cet abus pour se conserver leurs métayers : ceux-ci, qui trouvent plus de profit à faire des charrais qu'à cultiver, négligent beaucoup la culture des terres. Lorsque ces métayers laissent des terres en friche pendant longtemps, et qu'elles se couvrent d'épines et de buissons, elles restent toujours dans cet état, parce qu'elles couteraient beaucoup plus que la valeur à esserter et défricher.
Dans ces provinces, les paysans et manouvriers n'y sont point occupés comme dans les pays de grande culture, par des riches fermiers qui les emploient aux travaux de l'agriculture et au gouvernement des bestiaux ; les métayers trop pauvres leur procurent peu de travail. Ces paysans se nourrissent de mauvais pain fait de menus grains qu'ils cultivent eux-mêmes, qui coutent peu de culture, et qui ne sont d'aucun profit pout l'état.
Le blé a peu de débit faute de consommation dans ces pays ; car lorsque les grandes villes sont suffisamment fournies par les provinces voisines, le blé ne se vend pas dans celles qui en sont éloignées ; on est forcé de le donner à fort bas prix, ou de le garder pour attendre des temps plus favorables pour le débit : cette non valeur ordinaire des blés en fait encore négliger davantage la culture ; la part de la récolte qui est pour le métayer, devient à peine suffisante pour la nourriture de sa famille ; et quand la récolte est mauvaise, il est lui-même dans la disette : il faut alors que le propriétaire y supplée. C'est pourquoi les récoltes qu'on obtient par cette culture ne sont presque d'aucune ressource dans les années de disette, parce que dans les mauvaises années elles suffisent à-peine pour la subsistance du propriétaire et du colon. Ainsi la cherté du blé dans les mauvaises années ne dédommage
(i) Il faut même supposer de bonnes années, et que le prix du foin ne passe pas 10 liv. ou que la longueur des hivers n'en fasse pas consommer par les bœufs une plus grande quantité ; car un peu moins de produit ou un peu plus de dépense, anéantit ce petit revenu.
(k) On peut juger de-là combien est mal fondée l'opinion de ceux qui croient que la campagne est dépeuplée, parce que les grands propriétaires se sont emparés de toutes les terres, en sorte que les paysans ne peuvent pas en avoir pour cultiver à leur profit : on voit que le fermage des terres est à si bas prix, qu'il leur serait très-facîle d'en affermer autant qu'ils en voudraient ; mais il y a d'autres raisons qui s'y opposent, et que nous examinerons dans la suite : car il faut dissiper des préjugés vulgaires qui voilent des vérités qu'il est intéressant d'approfondir.
(l) Ceux qui sont assujettis à la petite culture, sont peu attachés au fourrage que produit le froment, parce qu'ils en font peu d'usage ; et ils préfèrent volontiers la culture du seigle, parce qu'il vient plus surement dans les terres maigres. D'ailleurs il y a toujours quelque partie de la sole des terres ensemencées qui portent des grains de Mars, que nous confondrons ici avec le blé, pour éviter de petits détails peu utiles. On peut compenser la valeur de ces différents grains par un prix commun un peu plus bas que celui du froment.
point de la non-valeur de cette denrée dans les bonnes années ; il n'y a que quelques propriétaires aisés qui peuvent attendre les temps favorables pour la vente du blé de leur récolte, qui puissent en profiter.
Il faut donc, à l'égard de cette culture, n'envisager la valeur du blé que conformément au prix ordinaire des bonnes années ; mais le peu de débit qu'il y a alors dans les provinces éloignées de la capitale, tient le blé à fort bas prix : ainsi nous ne devons l'évaluer qu'à 12 liv. le septier, froment et seigle, dans les provinces où les terres sont traitées par la petite culture. C'est en effet dans ces provinces, que le prix du blé ne peut soutenir les frais pécuniaires de la grande culture ; qu'on ne cultive les terres qu'aux dépens des terres mêmes, et qu'on en tire le produit que l'on peut en les faisant valoir avec le moins de dépenses qu'il est possible.
Ce n'est pas parce qu'on laboure avec des bœufs, que l'on tire un si petit produit des terres ; on pourrait par ce genre de culture, en faisant les dépenses nécessaires, tirer des terres à-peu-près autant de produit que par la culture qui se fait avec les chevaux : mais ces dépenses ne pourraient être faites que par les propriétaires ; ce qu'ils ne feront pas tant que le commerce du blé ne sera pas libre, et que les non-valeurs de cette denrée ne leur laisseront apercevoir qu'une perte certaine.
On estime qu'il y a environ trente millions d'arpens de terres traitées par la petite culture ; chaque arpent du fort au faible produisant, année commune, le grain quatre, ou trente-deux boisseaux non compris la dixme ; de ces trente-deux boisseaux il faut en retrancher huit pour la semence. Il reste deux septiers qui se partagent par moitié entre le propriétaire et le métayer. Celui-ci est chargé de la taille et de quelques frais inévitables.
Trente millions d'arpens de terres traitées par la petite culture, sont divisés en deux soles qui produisent du blé alternativement. Il y a quinze millions d'arpens qui portent du blé tous les ans, excepté quelques arpens que chaque métayer réserve pour ensemencer en grains de Mars : car il n'y a point par cette culture de sole particulière pour ces grains. Nous ne distinguerons point dans les quinze millions d'arpens, la petite récolte des graines de Mars, de celle du blé ; l'objet n'est pas assez considérable pour entrer dans ce détail. D'ailleurs la récolte de chaque arpent de blé est si faible, que ces deux sortes de récoltes diffèrent peu l'une de l'autre pour le produit.
Les 24 liv. ou les deux septiers se distribuent ainsi :
Le produit total de 26 liv. 13 s. par chaque arpent se partage donc ainsi :
La récolte en blé des 15 millions d'arpens traités par la petite culture, donne, la dixme comprise et la semence prélevée, 33, 150, 000 septiers, qui valent en argent 397, 802, 040 liv. dont il y a :
TOTAL des produits de la grande et de la petite culture réunis.
Etat d'une bonne culture des grains. La gêne dans le commerce des grains, le défaut d'exportation, la dépopulation, le manque de richesses dans les campagnes, l'imposition indéterminée des subsides, la levée des milices, l'excès des corvées, ont réduit nos récoltes à ce petit produit. Autrefois avec un tiers plus d'habitants qui augmentaient la consommation, notre culture fournissait à l'étranger une grande quantité de grains ; les Anglais se plaignaient en 1611, de ce que les François apportaient chez eux des quantités de blé si considérables et à si bas prix, que la nation n'en pouvait soutenir la concurrence dans ses marchés (m) ; il se vendait alors en France 18 l. de notre monnaie actuelle : c'était un bas prix dans ce siècle. Il fallait donc que nos récoltes produisissent dans ce temps-là au-moins 70 millions de septiers de blé ; elles en produisent aujourd'hui environ 45 millions : un tiers d'hommes de plus en consommait 20 millions au-delà de notre consommation actuelle, et le royaume en fournissait encore abondamment à l'étranger ;
(m) Traité des avantages et des désavantages de la Grande-Bretagne.
cette abondance était une heureuse suite du gouvernement économique de M. de Sully. Ce grand ministre ne désirait, pour procurer des revenus au roi et à la nation, et pour soutenir les forces de l'état, que des laboureurs, des vignerons, et des bergers.
Le rétablissement de notre culture suppose aussi l'accroissement de la population ; les progrès de l'un et de l'autre doivent aller ensemble ; le prix des grains doit surpasser les frais de culture : ainsi il faut que la consommation intérieure et la vente à l'étranger, entretiennent un profit certain sur le prix des grains. La vente à l'étranger facilite le débit, ranime la culture, et augmente le revenu des terres ; l'accroissement des revenus procure de plus grandes dépenses qui favorisent la population, parce que l'augmentation des dépenses procure des gains à un plus grand nombre d'hommes. L'accroissement de la population étend la consommation ; la consommation soutient le prix des denrées qui se multiplient par la culture à-proportion des besoins des hommes, c'est-à-dire à-proportion que la population augmente. Le principe de tous ces progrès est donc l'exportation des denrées du cru ; parce que la vente à l'étranger augmente les revenus ; que l'accroissement des revenus augmente la population ; que l'accroissement de la population augmente la consommation ; qu'une plus grande consommation augmente de plus en plus la culture, les revenus des terres et la population ; car l'augmentation des revenus augmente la population, et la population augmente les revenus.
Mais tous ces accroissements ne peuvent commencer que par l'augmentation des revenus ; voilà le point essentiel et le plus ignoré ou du-moins le plus négligé en France : on n'y a pas même reconnu dans l'emploi des hommes, la différence du produit des travaux qui ne rendent que le prix de la main-d'œuvre, d'avec celui des travaux qui paient la main-d'œuvre et qui procurent des revenus. Dans cette inattention on a préféré l'industrie à l'Agriculture, et le commerce des ouvrages de fabrication au commerce des denrées du cru : on a même soutenu des manufactures et un commerce de luxe au préjudice de la culture des terres.
Cependant il est évident que le gouvernement n'a point d'autres moyens pour faire fleurir le Commerce, et pour soutenir et étendre l'industrie, que de veiller à l'accroissement des revenus ; car ce sont les revenus qui appellent les marchands et les artisans, et qui paient leurs travaux. Il faut donc cultiver le pied de l'arbre, et ne pas borner nos soins à gouverner les branches ; laissons-les s'arranger et s'étendre en liberté, mais ne négligeons pas la terre qui fournit les sucs nécessaires à leur végétation et à leur accroissement. M. Colbert tout occupé des manufactures, a cru cependant qu'il fallait diminuer la taille, et faire des avances aux cultivateurs, pour relever l'Agriculture qui dépérissait ; ce qu'il n'a pu concilier avec les besoins de l'état : mais il ne parle pas des moyens essentiels, qui consistent à assujettir la taille à une imposition réglée et à établir invariablement la liberté du commerce des grains : l'Agriculture fut négligée ; les guerres qui étaient continuelles, la milice qui dévastait les campagnes, diminuèrent les revenus du royaume ; les traitants, par des secours perfides, devinrent les suppôts de l'état ; la prévoyance du ministre s'était bornée à cette malheureuse ressource, dont les effets ont été si funestes à la France *.
La culture du blé est fort chère ; nous avons beaucoup plus de terres qu'il ne nous en faut pour cette culture ; il faudrait la borner aux bonnes terres, dont le produit surpasserait de beaucoup les frais d'une bonne culture. Trente millions d'arpens de bonnes terres formeraient chaque année une sole de 10 millions d'arpens qui porteraient du blé : de bonnes terres bien cultivées, produiraient au-moins, année commune, six septiers par arpent, semence prélevée : ainsi la sole de dix millions d'arpens donnerait, la dixme comprise, au-moins 65 millions de septiers de blé. (n) La consommation intérieure venant à augmenter, et la liberté du commerce du blé étant pleinement rétablie, le prix de chaque septier de blé, année commune, peut être évalué à 18 liv. un peu plus ou moins, cela importe peu ; mais à 18 liv. le produit serait de 108 liv. non compris la dixme.
Pour déterminer plus surement le prix commun du blé, l'exportation étant permise, il faut faire attention aux variations des produits des récoltes et des prix du blé selon ces produits. On peut juger de l'état de ces variations dans le cas de l'exportation, en se reglant sur celles qui arrivent en Angleterre, où elles ne s'étendent depuis nombre d'années, qu'environ depuis 18 jusqu'à 22 l. Il est facîle de comprendre pourquoi ces variations y sont si peu considérables : l'Agriculture a fait de très-grands progrès dans ce royaume ; les récoltes, quelque faibles qu'elles y soient, sont toujours plus que suffisantes pour la subsistance des habitants. Si notre agriculture était en bon état, nous recueillerions dans une mauvaise année à-peu-près autant de blé que nous en fournit aujourd'hui une bonne récolte : ainsi on ne pourrait, sans des accidents extraordinaires, éprouver la disette dans un royaume où les moindres récoltes jointes à ce qui resterait nécessairement des bonnes années, seraient toujours au-dessus des besoins des habitants. On peut en juger par l'exposition que nous allons donner des variations des récoltes que produit une bonne culture selon la diversité des années. On y remarquera qu'une mauvaise récolte de 10 millions d'arpens donne 40 millions de septiers de blé sans la récolte d'une même quantité d'arpens ensemencés en grains de Mars.
* Le financier citoyen, chap. IIIe et IVe
(n) Nous supposons que chaque arpent produise six septiers, semence prélevée : nous savons cependant qu'un bon arpent de terre bien cultivé doit produire davantage. Nous avons jugé à-propos, pour une plus grande sûreté dans l'estimation, de nous fixer à ce produit ; mais afin qu'on puisse juger de ce que peut rapporter un arpent de terre, dans le cas dont il s'agit ici, nous en citerons un exemple tiré de l'article FERME, donné par M. le Roy, lieutenant des chasses du parc de Versailles. " J'ai actuellement, dit l'auteur, sous les yeux une ferme qui est de plus de trois cent arpens, dont les terres sont bonnes sans être du premier ordre. Elles étaient il y a quatre ans entre les mains d'un fermier qui les labourait assez bien, mais qui les fumait très-mal, parce qu'il vendait ses pailles, et nourrissait peu le bétail. Ces terres ne rapportaient que trois à quatre septiers de blé par arpent dans les meilleures années ; il s'est ruiné, et on l'a contraint de remettre sa ferme à un autre cultivateur plus industrieux. Tout a changé de face ; la dépense n'a point été épargnée ; les terres encore mieux labourées qu'elles n'étaient, ont été couvertes de troupeaux et de fumier : en deux ans elles ont été améliorées au point de rapporter dix septiers de blé par arpent, et d'en faire espérer encore plus par la suite. Ce succès sera répété toutes les fois qu'il sera tenté. Multiplions nos troupeaux, nous doublerons presque nos récoltes. Puisse cette persuasion frapper également les fermiers et les propriétaires ! Si elle devenait générale, si elle était encouragée, nous verrions bientôt l'Agriculture faire des progrès rapides, nous lui devrions l'abondance avec tous ses effets.
Dont il y aurait de produit net 40 l. distribuées ainsi :
66 liv. de frais, et 20 liv. pour la taille et le fermage, font 96 liv. par arpent : le produit étant six septiers, le septier couterait, année commune, au fermier 16 liv. Dans une année abondante, à huit septiers par arpent, le septier lui coute 12 livres ; étant vendu 16 liv. il gagne 4 liv. Dans une mauvaise année, à quatre septiers par arpent, le septier lui coute 24 liv. étant vendu 20 liv. il perd 4 liv. Les années bonnes et mauvaises, réduites à une année commune, il gagne par septier 1 liv. 13 s. ou environ 10 liv. par arpent.
La récolte en blé de dix millions d'arpens donne, année commune, la dixme comprise levée sur toute la récolte, le fonds de la semence compris, 65, 555, 500 septiers, semence prélevée, qui valent en argent 1, 159, 500, 000 liv. dont il y a :
Il y aurait de même une sole de dix millions d'arpens qui produirait des grains de Mars, et dont chaque arpent de bonne terre et bien cultivée produirait, année commune, au-moins deux septiers, semence prélevée et la dixme non comprise ; le septier évalué un peu au-dessous des 2/3 du prix du blé, vaudrait environ 10 liv.
Les 21 liv. 17 s. se distribuent ainsi :
Les dix millions d'arpens en avoine donneraient, la dixme comprise 21, 944, 441 septiers, qui valent en argent 218, 500, 000 liv. dont il y a :
Les produits de la récolte des dix millions d'arpens en blé et de la récolte des dix millions d'arpens en grains de Mars réunis produiraient :
(o) Nous mettons le prix plus bas qu'en Angleterre, quoique le blé de France soit meilleur ; mais si nous en vendions à l'étranger, la concurrence pourrait faire baisser le prix de part et d'autre.
(p) Dans la grande culture actuelle en France, on a remarqué ci-devant que le fermier perd dans les bonnes années ; ici il gagne, mais il perd dans les mauvaises : ainsi il a intérêt qu'il y ait beaucoup de blé : au lieu que dans l'autre cas l'abondance ruine le fermier, et celui-ci ne peut se dédommager un peu que dans les mauvaises années.
(q) Le prix commun des acheteurs serait le cinquième de 90 liv. qui est 18 liv. c'est environ le prix commun ordinaire de la vente de nos blés dans ces derniers temps ; ainsi l'exportation n'augmenterait pas le prix du blé pour les acheteurs : elle l'augmenterait pour les fermiers de 2 liv. 4 sols par septiers ; ce serait sur 65 millions de septiers, 160 millions de bénéfice pour l'Agriculture, sans que le blé augmentât de prix pour l'acheteur. Voilà l'avantage de l'exportation. Ainsi on ne doit pas s'étonner des progrès de l'Agriculture en Angleterre.
(r) Pour les terres chargées du droit de champart ou de la dixme agrière, les fermiers ne paient pas tant de taille ; mais ce qui manquerait se répandrait sur ceux qui afferment cette espèce de dixme.
Dont il y a :
Il y a, outre les trente millions dont on vient d'apprécier le produit, trente autres millions d'arpens de terre cultivables de moindre valeur que les terres précédentes, qui peuvent être employées à différentes productions ; les meilleures à la culture des chanvres, des lins, des légumes, des seigles, des orges, des prairies artificielles des menus grains ; les autres selon leurs différentes qualités peuvent être plantés en bois, en vignes, en mûriers, en arbres à cidre, en noyers, chataigniers, ou ensemencés en blé noir, en faux seigle, en pommes de terre, en navets, en grosses raves, et en d'autres productions pour la nourriture des bestiaux. Il serait difficîle d'apprécier les differents produits de ces trente millions d'arpens ; mais comme ils n'exigent pas pour la plupart de grands frais pour la culture, on peut, sans s'exposer à une grande erreur, les évaluer du fort au faible pour la distribution des revenus environ à un tiers du produit des trente autres millions d'arpens, dont il y auroit
RECAPITULATION des différents produits de la bonne culture réunie. Les soixante millions d'arpens de terres cultivables en France donneraient :
(f) Les frais ne se font pas tous en argent ; la nourriture des chevaux et celle des domestiques sont fournies en nature par les récoltes, ainsi il n'y a guère que la moitié de ces frais qui participe à la circulation de l'argent. Il n'en est pas de même des frais de la culture des vignes, et des dépenses pour les récoltes des vins ; car ces avances se font presque toutes en argent : ainsi on voit toujours que plus de la moitié de la masse d'argent monnoyé qu'il y a dans le royaume, doit circuler dans les campagnes pour les frais de l'agriculture.
COMPARAISON des produits de la culture actuelle du royaume avec ceux de la bonne culture.
(t) On suppose dans ces deux états de culture, la taille égale environ à un tiers du revenu des propriétaires. La capitation et les taxes particulières jointes à la taille, montent aujourd'hui l'imposition totale à-peu-près à l'égal de la moitié des revenus ou à 40 millions. Suivant cette proportion, l'imposition totale monterait dans la bonne culture à 200 millions, au lieu de 40 millions. Nous comprenons dans les deux cas, sous le même point de vue, les pays d'états et les pays d'élections, qui en effet paient ensemble aujourd'hui en taille, dons gratuits et capitation, environ 40 millions sur des terres du royaume employées à la culture des grains.
(u) Dans l'état actuel, les frais ne produisent que 30 pour cent ; et dans une bonne culture, où le débit des grains serait favorisé, comme en Angleterre, par l'exportation, les frais produiraient environ cent pour cent.
(x) Notez que dans cette comparaison on ne suppose aucune augmentation dans le prix commun des grains ; car il n'est pas vraisemblable que l'exportation en fit augmenter le prix : mais elle excluerait les non-valeurs et les chertés. Elle produit constamment cet avantage en Angleterre, quoiqu'on n'y exporte qu'environ un million de septiers (ce qui n'est pas un vingtième de la récolte), ne trouvant pas chez l'étranger à en vendre davantage.
Observations sur les avantages de la culture des grains. Les frais de la culture restent dans le royaume, et le produit total est tout entier pour l'état. Les bestiaux égalent au-moins la moitié de la richesse annuelle des récoltes ; ainsi le produit de ces deux parties de l'Agriculture seraient environ de trois milliards : celui des vignes est de plus de cinq cent millions, et pourrait être beaucoup augmenté, si la population s'accraissait dans le royaume, et si le commerce des vins et eaux-de-vie était moins gêné (y). Les produits de l'Agriculture seraient au-moins de quatre milliards, sans y comprendre les produits des chanvres, des bois, de la pêche, etc. Nous ne parlons pas non plus des revenus des maisons, des rentes, du sel, des mines, ni des produits des Arts et Métiers, de la Navigation, etc. qui augmenteraient à proportion que les revenus et la population s'accraitraient ; mais le principe de tous ces avantages est dans l'Agriculture, qui fournit les matières de premier besoin, qui donne des revenus au roi et aux propriétaires, des dixmes au clergé, des profits aux cultivateurs. Ce sont ces premières richesses, toujours renouvellées, qui soutiennent tous les autres états du royaume, qui donnent de l'activité à toutes les autres professions, qui font fleurir le Commerce, qui favorisent la population, qui animent l'industrie, qui entretiennent la prospérité de la nation. Mais il s'en faut beaucoup que la France jouisse de tous ces milliards de revenus que nous avons entre-vu qu'elle pourrait tirer d'elle-même. On n'estime guère qu'à deux milliards la consommation ou la dépense annuelle de la nation. Or la dépense est à-peu-près égale aux revenus, confondus avec les frais de la main-d'œuvre, qui procurent la subsistance aux ouvriers de tous genres, et qui sont presque tous payés par les productions de la terre ; car, à la réserve de la pêche et du sel, les profits de la navigation ne peuvent être eux-mêmes fort considérables, que par le commerce des denrées de notre cru. On regarde continuellement l'Agriculture et le Commerce comme les deux ressources de nos richesses ; le Commerce, ainsi que la main-d'œuvre, n'est qu'une branche de l'Agriculture : mais la main-d'œuvre est beaucoup plus étendue et beaucoup plus considérable que le Commerce. Ces deux états ne subsistent que par l'Agriculture. C'est l'Agriculture qui fournit la matière de la main-d'œuvre et du Commerce, et qui paye l'une et l'autre : mais ces deux branches restituent leurs gains à l'Agriculture, qui renouvelle les richesses, qui se dépensent et se consomment chaque année. En effet, sans les produits de nos terres, sans les revenus et les dépenses des propriétaires et des cultivateurs, d'où naitrait le profit du Commerce et le salaire de la main-d'œuvre ? La distinction du Commerce d'avec l'Agriculture, est une abstraction qui ne présente qu'une idée imparfaite, et qui séduit des auteurs qui écrivent sur cette matière, même ceux qui en ont la direction, et qui rapportent au commerce productif le commerce intérieur qui ne produit rien, qui sert la nation, et qui est payé par la nation.
On ne peut trop admirer la supériorité des vues de M. de Sully : ce grand ministre avait saisi les vrais principes du gouvernement économique du royaume, en établissant les richesses du roi, la puissance de l'état, le bonheur du peuple, sur les revenus des terres, c'est-à-dire sur l'Agriculture et sur le commerce extérieur de ses productions ; il disait que sans l'exportation des blés, les sujets seraient bientôt sans argent et le souverain sans revenus. Les prétendus avantages des manufactures de toute espèce ne l'avaient pas séduit ; il ne protegeait que celles des étoffes de laine, parce qu'il avait reconnu que l'abondance des récoltes dépendait du débit des laines, qui favorise la multiplication des troupeaux nécessaires pour fertiliser les terres.
Les bonnes récoltes produisent beaucoup de fourrages pour la nourriture des bestiaux ; les trente millions d'arpens de terres médiocres seraient en partie destinés aussi à cet usage. L'auteur des Prairies artificielles décide très-judicieusement qu'il faut à-peu-près la même quantité d'arpens de prairies artificielles qu'il y a de terre ensemencée en blé chaque année. Ainsi pour trente millions d'arpens, il faudrait dix millions d'arpens de prairies artificielles pour nourrir des bestiaux qui procureraient assez de fumier pour fournir un bon engrais aux terres qui chaque année doivent être ensemencées en blé. Cette pratique est bien entendue ; car si on se procure par l'engrais de la terre un septier de blé de plus par chaque arpent, on double à-peu-près le profit. Un arpent de blé qui porte cinq septiers à 15 liv. le septier, donne, tous frais déduits, 20 liv. de revenu ; mais un septier de plus doublerait presque lui seul le revenu d'un arpent ; car si un arpent donne six septiers, le revenu est 35 liv. et s'il en portait sept, le revenu serait 50 liv. ou 3/5 de revenu de plus que dans le premier cas : le revenu n'est pas simplement à raison du produit, mais à raison du produit et des frais. Or l'augmentation des frais est en bestiaux qui ont aussi leur produit ; ainsi les profits d'une culture imparfaite ne sont pas comparables à ceux d'une bonne culture.
Ainsi on voit que la fortune du fermier en état de faire les frais d'une bonne culture, dépend du produit
(y) L'auteur du livre intitulé le financier citoyen, dont les intentions peuvent être louables, est trop attaché aux droits des aides : il parait n'avoir pas envisagé dans le vrai point de vue les inconvénients de ces droits ; il ne les regarde que du côté des consommateurs, qui sont libres, dit-il, de faire plus ou moins de dépense en vin. Mais ce plus ou moins de dépense est un objet important par rapport aux revenus des vignes, et aux habitants occupés à les cultiver. Cette culture emploie beaucoup d'hommes, et peut en employer encore davantage ; ce qui mérite une grande attention par rapport à la population : d'ailleurs les terres employées en vignes sont d'un grand produit. Le grand objet du gouvernement est de veiller à l'augmentation des revenus, pour le bien de l'état et pour le fonds des impositions ; car les terres qui produisent beaucoup, peuvent soutenir une forte imposition. Les vignes produisent tous les ans, ainsi chaque arpent peut fournir pour la taille le double de chaque arpent de terre cultivé en blé ; ce qui produirait au roi à peu près autant que les droits des aides, qui ruinent un commerce essentiel au royaume, et desolent les vignerons par les rigueurs de la régie et les vexations des commis. Dans le système d'une bonne culture, la taille bien régie doit être la principale source des revenus du roi. C'est une partie qu'on n'a point approfondie, et qui n'est connue que par les abus destructifs contre lesquels on s'est toujours récrié, et auxquels on n'a point encore remédié. Voyez IMPOTS. Il parait que l'auteur tient aussi un peu au préjugé vulgaire par rapport à l'industrie. L'industrie procure la subsistance à une multitude d'hommes, par le payement de la main-d'œuvre ; mais elle ne produit point de revenus, et elle ne peut se soutenir que par les revenus des citoyens qui achetent les ouvrages des artisans. Il défend l'imposition sur l'industrie, dans la crainte de l'anéantir ; mais l'industrie subsistera toujours dans un royaume à raison des revenus, par rapport aux ouvrages nécessaires, et par rapport aux ouvrages de luxe : l'imposition peut seulement en augmenter un peu le prix. Mais cette partie intéresse fort peu le commerce extérieur, qui ne peut nous enrichir que par la vente de nos productions. L'auteur est entiérement décidé en faveur des fermes générales bien ordonnées ; il y trouve les revenus du roi assurés, des intérêts pour les seigneurs sous des noms empruntés, des fortunes honnêtes pour les fermiers et sous-fermiers, des appointements pour les commis ; mais il veut que les financiers aient de la probité. Un autre avantage qu'il aperçoit dans les fermes, c'est qu'elles peuvent s'augmenter sans nuire à l'Agriculture, à l'Industrie, ni au Commerce. Il est vrai du-moins que dans des royaumes incultes, c'est peut-être le seul moyen pour tirer des revenus pour le souverain, et des intérêts pour les seigneurs ; mais dans un état riche par ses biens et par le commerce de ses productions, ce moyen onéreux n'est pas nécessaire, et les seigneurs soutiennent leurs dépenses par les produits de leurs terres.
d'un septier ou deux de plus par arpent de terre ; et quoiqu'il en partage la valeur pour la taille et pour le fermage, son gain en est beaucoup plus considérable, et la meilleure portion est toujours pour lui ; car il recueille des fourrages à-proportion avec lesquels il nourrit des bestiaux qui augmentent son profit.
Il ne peut obtenir cet avantage que par le moyen des bestiaux ; mais il gagnerait beaucoup aussi sur le produit de ces mêmes bestiaux. Il est vrai qu'un fermier borné à l'emploi d'une charrue, ne peut prétendre à un gain considérable ; il n'y a que ceux qui sont assez riches pour se former de plus grands établissements, qui puissent retirer un bon profit, et mettre par les dépenses qu'ils peuvent faire, les terres dans la meilleure valeur.
Celui qui n'occupe qu'une charrue, tire sur ce petit emploi tous les frais nécessaires pour la subsistance et l'entretien de sa famille ; il faut même qu'il fasse plus de dépense à proportion pour les différents objets de son entreprise : n'ayant qu'une charrue il ne peut avoir, par exemple, qu'un petit troupeau de moutons, qui ne lui coute pas moins pour le berger, que ce que couterait un plus grand troupeau qui produirait un plus grand profit. Un petit emploi et un grand emploi exigent donc, à bien des égards, des dépenses qui ne sont pas de part et d'autre dans la même proportion avec le gain. Ainsi les riches laboureurs qui occupent plusieurs charrues, cultivent beaucoup plus avantageusement pour eux et pour l'état, que ceux qui sont bornés à une seule charrue ; car il y a épargne d'hommes, moins de dépense, et un plus grand produit : or les frais et les travaux des hommes ne sont profitables à l'état, qu'autant que leurs produits renouvellent et augmentent les richesses de la nation. Les terres ne doivent pas nourrir seulement ceux qui les cultivent, elles doivent fournir à l'état la plus grande partie des subsides, produire des dixmes au clergé, des revenus aux propriétaires, des profits aux fermiers, des gains à ceux qu'ils emploient à la culture. Les revenus du roi, du clergé, des propriétaires, les gains du fermier et de ceux qu'il emploie, tournent en dépenses, qui se distribuent à tous les autres états et à toutes les autres professions. Un auteur * a reconnu ces vérités fondamentales lorsqu'il dit : " que l'assemblage de plusieurs riches propriétaires de terres qui résident dans un même lieu, suffit pour former ce qu'on appelle une ville, où les marchands, les fabriquans, les artisans, les ouvriers, les domestiques se rassemblent, à proportion des revenus que les propriétaires y dépensent : auquel cas la grandeur d'une ville est naturellement proportionnée au nombre des propriétaires des terres, ou plutôt au produit des terres qui leur appartiennent. Une ville capitale se forme de la même manière qu'une ville de province ; avec cette différence que les gros propriétaires de tout l'état résident dans la capitale.
Les terres cultivées en détail par de petits fermiers, exigent plus d'hommes et de dépenses, et les profits sont beaucoup plus bornés. Or les hommes et les dépenses ne doivent pas être prodigués à des travaux qui seraient plus profitables à l'état, s'ils étaient exécutés avec moins d'hommes et moins de frais. Ce mauvais emploi des hommes pour la culture des terres serait préjudiciable, même dans un royaume fort peuplé ; car plus il est peuplé, plus il est nécessaire de tirer un grand produit de la terre : mais il serait encore plus désavantageux dans un royaume qui ne serait pas assez peuplé ; car alors il faudrait être plus attentif à distribuer les hommes aux travaux les plus nécessaires et les plus profitables à la nation. Les avantages de l'Agriculture dépendant donc beaucoup de la réunion des terres en grosses-fermes, mises dans la meilleure valeur par de riches fermiers.
La culture qui ne s'exécute que par le travail des hommes, est celle de la vigne ; elle pourrait occuper un plus grand nombre d'hommes en France, si on favorisait la vente des vins, et si la population augmentait. Cette culture et le commerce des vins et des eaux-de-vie sont trop gênés ; c'est cependant un objet qui ne mérite pas moins d'attention que la culture des grains.
Nous n'envisageons pas ici le riche fermier comme un ouvrier qui laboure lui-même la terre ; c'est un entrepreneur qui gouverne et qui fait valoir son entreprise par son intelligence et par ses richesses. L'agriculture conduite par de riches cultivateurs est une profession très-honnête et très-lucrative, réservée à des hommes libres en état de faire les avances des frais considérables qu'exige la culture de la terre, et qui occupe les paysans et leur procure toujours un gain convenable et assuré. Voilà, selon l'idée de M. de Sully, les vrais fermiers ou les vrais financiers qu'on doit établir et soutenir dans un royaume qui possède un grand territoire ; car c'est de leurs richesses que doit naître la subsistance de la nation, l'aisance publique, les revenus du souverain, ceux des propriétaires, du clergé, une grande dépense distribuée à toutes les professions, une nombreuse population, la force et la prospérité de l'état.
Ce sont les grands revenus qui procurent les grandes dépenses ; ce sont les grandes dépenses qui augmentent la population, parce qu'elles étendent le commerce et les travaux, et qu'elles procurent des gains à un grand nombre d'hommes. Ceux qui n'envisagent les avantages d'une grande population que pour entretenir de grandes armées, jugent mal de la force d'un état. Les militaires n'estiment les hommes qu'autant qu'ils sont propres à faire des soldats ; mais l'homme d'état regrette les hommes destinés à la guerre, comme un propriétaire regrette la terre employée à former le fossé qui est nécessaire pour conserver le champ. Les grandes armées l'épuisent ; une grande population et de grandes richesses le rendent redoutable. Les avantages les plus essentiels qui résultent d'une grande population, sont les productions et la consommation, qui augmentent ou font mouvoir les richesses pécuniaires du royaume. Plus une nation qui a un bon territoire et un commerce facile, est peuplée, plus elle est riche ; et plus elle est riche, plus elle est puissante. Il n'y a peut-être pas moins aujourd'hui de richesses pécuniaires dans le royaume, que dans le siècle passé : mais pour juger de l'état de ces richesses, il ne faut pas les considérer simplement par rapport à leur quantité, mais aussi par rapport à leur circulation relative à la quantité, au débit et au bon prix des productions du royaume. Cent septiers de blé à 20 liv. le septier, sont primitivement une richesse pécuniaire quatre fois aussi grande que 50 septiers à 10 livres le septier : ainsi la quantité des richesses existe aussi réellement dans la valeur des productions, que dans les espèces d'or et d'argent, surtout quand le commerce avec l'étranger assure le prix et le débit de ces productions.
Les revenus sont le produit des terres et des hommes. Sans le travail des hommes, les terres n'ont aucune valeur. Les biens primitifs d'un grand état sont les hommes, les terres et les bestiaux. Sans les produits de l'agriculture, une nation ne peut avoir d'autre ressource que la fabrication et le commerce de trafic ; mais l'une et l'autre ne peuvent se soutenir que par les richesses de l'étranger : d'ailleurs de telles ressources
* Cantillon, essai sur le Commerce, chap. Ve VIe
sont fort bornées et peu assurées, et elles ne peuvent suffire qu'à de petits états.
Observations sur la taille levée sur la culture des grains. On ne doit imposer les fermiers à la taille qu'avec beaucoup de retenue sur le profit des bestiaux, parce que ce sont les bestiaux qui font produire les terres : mais sans étendre la taille sur cette partie, elle pourrait par l'accroissement des revenus monter à une imposition égale à la moitié du prix du fermage : ainsi en se conformant aux revenus des propriétaires des terres qui seraient de quatre cent millions, la taille ainsi augmentée et bornée-là pour toute imposition sur les fermages, produirait environ 200 millions, et cela non compris celle qui est imposée sur les rentiers et propriétaires taillables, sur les maisons, sur les vignes, sur les bois taillables, sur le fermage particulier des prés, sur les voituriers, sur les marchands, sur les paysans, sur les artisans, manouvriers, etc.
Sur les 200 millions de taille que produirait la culture des grains, il faut en retrancher environ 1/20 pour l'exemption des nobles et privilégiés, qui font valoir eux-mêmes la quantité de terres permise par les ordonnances, ainsi il resterait 190 millions, mais il faut ajouter la taille des fermiers des dixmes, qui étant réunies à ces 190 millions, formerait au-moins pour le total de la taille 200 millions. (z)
La proportion de la taille avec le loyer des terres, est la règle la plus sure pour l'imposition sur les fermiers, et pour les garantir des inconvénients de l'imposition arbitraire ; le propriétaire et le fermier connaissent chacun leur objet, et leurs intérêts réciproques fixeraient au juste les droits du roi. (a)
Il serait bien à désirer qu'on put trouver une règle aussi sure pour l'imposition des métayers. Mais si la culture se rétablissait, le nombre des fermiers augmenterait de plus en plus, celui des métayers diminuerait à proportion : or une des conditions essentielles pour le rétablissement de la culture et l'augmentation des fermiers, est de réformer les abus de la taille arbitraire, et d'assurer aux cultivateurs les fonds qu'ils avancent pour la culture des terres. On doit surtout s'attacher à garantir les fermiers, comme étant les plus utiles à l'état, des dangers de cette imposition. Aussi éprouve-t-on que les désordres de la taille sont moins destructifs dans les villes taillables que dans les campagnes ; parce que les campagnes produisent les revenus, et que ce qui détruit les revenus détruit le royaume. L'état des habitants des villes est établi sur les revenus, et les villes ne sont peuplées qu'à proportion des revenus des provinces. Il est donc essentiel d'assujettir dans les campagnes l'imposition de la taille à une règle sure et invariable, afin de multiplier les riches fermiers, et de diminuer de plus en plus le nombre des colons indigens, qui ne cultivent la terre qu'au désavantage de l'état.
Cependant on doit apercevoir que dans l'état actuel de la grande et de la petite culture, il est difficîle de se conformer d'abord à ces règles ; c'est pourquoi nous avons pour la sûreté de l'imposition proposé d'autres moyens à l'article FERMIER : mais dans la suite le produit du blé ou le loyer des terres fourniraient la règle la plus simple et la plus convenable pour l'imposition proportionnelle de la taille sur les cultivateurs. Dans l'état présent de l'agriculture, un arpent de terre traité par la grande culture produisant 74 livres, ne peut donner qu'environ 1/20 du produit total du prix du blé pour la taille. Un arpent traité par la petite culture produisant 24 liv. donne pour la taille 1/24. Un arpent qui serait traité par la bonne culture, les autres conditions posées, produisant 106 l. donnerait pour la taille environ 1/11 ; ainsi par la seule différence des cultures, un arpent de terre de même valeur produirait ici pour la taille 10 liv. là il produit 3 liv. 10 s. ailleurs il ne produit qu'une livre. On ne peut donc établir pour la taille aucune taxe fixe sur les terres dont le produit est si susceptible de variations par ces différentes cultures ; on ne peut pas non plus imposer la taille proportionnellement au produit total de la récolte, sans avoir égard aux frais et à la différence de la quantité de semence, relativement au profit, selon les différentes cultures : ainsi ceux qui ont proposé une dixme pour la taille (b), et ceux qui ont proposé une taille
(z) Nous ne supposons ici qu'environ 10 millions de taille sur les fermiers des dixmes, mais le produit des dixmes n'étant point chargé des frais de culture il est susceptible d'une plus forte taxe : ainsi la dixme qui est affermée, c'est-à-dire qui n'est pas réunie aux cures, pouvant monter à plus de 100 millions par le rétablissement, leur culture pourrait avec justice être imposée à plus de 20 millions de taille. En effet, elle ne serait pas, dans ce cas même, proportionnée à celle des cultivateurs ; et ceux qui affermeraient leurs dixmes, profiteraient encore beaucoup sur le rétablissement de notre culture.
(a) Peut-être que la taille égale à la moitié du fermage paraitra forcée, et cela peut être vrai en effet ; mais au-moins cette taille étant fixée, les fermiers s'y conformeraient en affermant les terres. Voilà l'avantage d'une taille qui serait fixée : elle ne serait point ruineuse, parce qu'elle serait prévue par les fermiers ; au lieu que la taille arbitraire peut les ruiner, étant sujets à des augmentations successives pendant la durée des baux, et ils ne peuvent éviter leur perte par aucun arrangement sur le prix du fermage. Mais toutes les fois que le fermier connaitra par le prix du bail la taille qu'il doit payer, il ne laissera point tomber sur lui cette imposition, ainsi elle ne pourra pas nuire à la culture ; elle sera prise sur le produit de la ferme, et la partie du revenu du propriétaire en sera meilleure et plus assurée ; parce que la taille n'apportera point d'obstacle à la culture de son bien ; au contraire, la taille imposée sans règle sur le fermier, rend l'état de celui-ci incertain ; son gain est limité par ses arrangements avec le propriétaire, il ne peut se prêter aux variations de cette imposition : si elle devient trop forte, il ne peut plus faire les frais de la culture, et le bien est dégradé. Il faut toujours que l'imposition porte sur le fonds, et jamais sur la culture ; et qu'elle ne porte sur le fonds que relativement à sa valeur et à l'état de la culture, et c'est le fermage qui en décide.
On peut soupçonner que la taille proportionnelle aux baux pourrait occasionner quelqu'intelligence frauduleuse entre les propriétaires et les fermiers, dans l'exposé du prix du fermage dans les baux ; mais la sûreté du propriétaire exigerait quelque clause, ou quelqu'acte particulier inusité et suspect qu'il faudrait défendre : telle serait, par exemple, une reconnaissance d'argent prêté par le propriétaire au fermier. Or comme il est très-rare que les propriétaires prêtent d'abord de l'argent à leurs fermiers, cet acte serait trop suspect, surtout si la date était dès les premiers temps du bail, ou si l'acte n'était qu'un billet sous seing privé. En ne permettant point de telles conventions, on excluerait la fraude. Mais on pourrait admettre les actes qui surviendraient trois ou quatre ans après le commencement du bail, s'ils étaient passés pardevant notaire, et s'ils ne changeaient rien aux clauses du bail ; car ces actes postérieurs ne pourraient pas servir à des arrangements frauduleux à l'égard du prix du fermage, et ils peuvent devenir nécessaires entre le propriétaire et le fermier, à cause des accidents qui quelquefois arrivent aux bestiaux ou aux moissons pendant la durée d'un bail, et qui engageraient un propriétaire à secourir son fermier. L'argent avancé sous la forme de pot-de-vin par le fermier, en diminution du prix du bail, est une fraude qu'on peut reconnaître par le trop bas prix du fermage, par comparaison avec le prix des autres terres du pays S'il y avait une différence trop marquée, il faudrait anéantir le bail, et exclure le fermier.
(b) On a Ve par les produits des différentes cultures, que la taille convertie en dixme sur la culture faite avec les bœufs, monterait à plus des deux tiers du revenu des propriétaires. D'ailleurs la taille ne peut pas être fixée à-demeure sur le revenu actuel de cette culture, parce que les terres ne produisant pas les revenus qu'elles donneraient lorsqu'elles seraient mieux cultivées, il arriverait qu'elles se trouveraient taxées sept ou huit fois moins que celles qui seraient actuellement en pleine valeur.
Dans l'état actuel de la grande culture, les terres produisent davantage ; mais elles donnent la moitié moins de revenu qu'on n'en retirerait dans le cas de la liberté du commerce des grains. Dans l'état présent, la dixme est égale à la moitié du fermage, la taille convertie en dixme serait encore fort onéreuse ; mais dans le cas d'exportation, les terres donneraient plus de revenu ; la dixme ne se trouverait qu'environ égale à un tiers du fermage. La taille convertie en dixme, ne serait plus dans une proportion convenable avec les revenus ; car elle pourrait alors être portée à l'égal de la moitié des revenus, et être beaucoup moins onéreuse que dans l'état présent ; ainsi les proportions de la taille et de la dixme avec le fermage sont fort différents, selon les différents produits des terres. Dans la petite culture la taille serait forte, si elle égalait la moitié de la dixme ; elle serait faible dans une bonne culture, si elle n'était égale qu'à la totalité de la dixme. Les proportions de la taille avec le produit sont moins discordantes dans les différents états de culture ; mais toujours le sont-elles trop pour pouvoir se prêter à une règle générale : c'est tout ensemble le prix des grains, l'état de la culture, et la qualité des terres, qui doivent former la base de l'imposition de la taille à raison du produit net du revenu du propriétaire. C'est ce qu'il faut observer aussi dans l'imposition du dixième sur les terres cultivées avec des bœufs aux frais des propriétaires ; car si on prenait le dixième du produit, ce serait dans des cas la moitié du revenu, et dans d'autres le revenu tout entier qu'on enleverait.
réelle sur les terres, n'ont pas examiné les irrégularités qui naissent des différents genres de culture, et les variations qui en résultent. Il est vrai que dans les pays d'états on établit communément la taxe sur les terres, parce que ces pays étant bornés à des provinces particulières où la culture peut être à-peu-près uniforme, on peut régler l'imposition à-peu-près sur la valeur des terres, et à la différente quantité de semence, relativement au produit des terres de différente valeur ; mais on ne peut pas suivre cette règle généralement pour toutes les autres provinces du royaume. On ne peut donc dans l'état actuel établir une taille proportionnelle, qu'en se réglant sur la somme imposée préalablement sur chaque paraisse, selon l'état de l'agriculture de la province ; et cette taille imposée serait repartie, comme il est dit à l'article FERMIER, proportionnellement aux effets visibles d'agriculture, déclarés tous les ans exactement par chaque particulier. On pourrait même, quand les revenus se réduisent au produit des grains, éviter ces déclarations ; et lorsque la bonne culture y serait entièrement établie, on pourrait simplifier la forme par une imposition proportionnelle aux loyers des terres. Le laboureur, en améliorant sa culture et en augmentant ses dépenses, s'attendrait, il est vrai, à payer plus de taille, mais il serait assuré qu'il gagnerait plus aussi, et qu'il ne serait plus exposé à une imposition ruineuse, si la taille n'augmentait que proportionnellement à l'accroissement de son gain.
Ainsi on pourrait dès-à-présent imposer la taille proportionnelle aux baux, dans les pays où les terres sont cultivées par des fermiers. Il ne serait peut-être pas impossible de trouver aussi une règle à-peu-près semblable, pour les pays où les propriétaires font cultiver par des métayers ; on sait à-peu-près le produit de chaque métairie ; les frais étant déduits, on connaitrait le revenu du propriétaire ; on y proportionnerait la taille, ayant égard à ne pas enlever le revenu même du propriétaire, mais à établir l'imposition sur la portion du métayer, proportionnellement au revenu net du maître. S'il se trouvait dans cette imposition proportionnelle quelques irrégularités préjudiciables aux métayers, elles pourraient se réparer par les arrangements entre ces métayers et les propriétaires : ainsi ces inconvénients inséparables des règles générales se réduiraient à peu de chose, étant supportés par le propriétaire et le métayer. Il me parait donc possible d'établir dès aujourd'hui pour la grande et pour la petite culture, des règles fixes et générales pour l'imposition proportionnelle de la taille.
Nous avons Ve par le calcul des produits de la grande culture actuelle, que la taille imposée à une somme convenable, se trouve être à-peu-près égale à un tiers du revenu des propriétaires. Dans cette culture les terres étant presque toutes affermées, il est facîle de déterminer l'imposition proportionnellement aux revenus fixés par les baux.
Mais il n'en est pas de même des terres traitées par la petite culture, qui sont rarement affermées ; car on ne peut connaître les revenus des propriétaires que par les produits. Nous avons Ve par les calculs de ces produits, que dans la petite culture la taille se trouvait aussi à-peu-près à l'égal du tiers des revenus des propriétaires ; mais ces revenus qui d'ailleurs sont tous indécis, peuvent être envisagés sous un autre aspect que celui sous lequel nous les avons considérés dans ces calculs : ainsi il faut les examiner sous cet autre aspect, afin d'éviter la confusion qui pourrait naître des différentes manières de considérer les revenus des propriétaires qui font cultiver par des métayers, et qui avancent des frais pécuniaires, et emploient une grande portion des biens fonds de chaque métairie pour la nourriture des bœufs de labour. Nous avons exposé ci-devant pour donner un exemple particulier de cette culture, l'état d'une terre qui peut rendre au propriétaire, année commune, pour 3000 livres de blé, semence prélevée. On voit le détail des différents frais compris dans les 3000 livres ; savoir 1050 liv. pour les avances pécuniaires, qui reduisent les 3000 livres à 1950 livres.
Il y a 1375 livres de revenus de prairies et friches pour la nourriture des bœufs ; ainsi les terres qui portent les moissons ne contribuent à cette somme de 1950 livres que pour 575 livres, parce que le revenu des prairies et friches fait partie de ce même revenu de 1950 livres. Si la taille était à l'égal du tiers de ces 1950 livres, elle monterait à 650 livres, qui payées par cinq métayers par portion égale, seraient pour chacun 131 livres.
Ces métayers ont ensemble la moitié du grain, c'est-à-dire pour 3000 livres : ainsi la part pour chacun est 600 liv. Si chaque fermier, à raison du tiers de 1950 liv. payait 131 liv. de taille, il ne lui resterait pour ses frais particuliers, pour sa subsistance et l'entretien de sa famille, que 479 liv. 16 sous.
D'ailleurs nous avons averti dans le détail de l'exemple que nous rappelons ici, que le fonds de la terre est d'un bon produit, relativement à la culture faite avec les bœufs, et qu'il est d'environ un quart plus fort que les produits ordinaires de cette culture : ainsi dans le dernier cas où les frais sont les mêmes, le revenu du propriétaire ne serait que de 1450 livres, et la part de chaque métayer 453 liv. Si la taille était à l'égal du tiers du revenu du propriétaire, elle monterait à 497 livres ; ce qui serait pour la taxe de chaque métayer 102 livres : il ne lui resterait de son produit que 348 livres, qui ne pourraient pas suffire à ses dépenses ; il faudrait que la moitié pour le moins de la taille des cinq métayers, retombât sur le propriétaire qui est chargé des grandes dépenses de la culture, et a un revenu incertain.
Ainsi selon cette manière d'envisager les revenus casuels des propriétaires qui partagent avec des métayers, si on imposait la taille à l'égal du tiers de ces revenus, les propriétaires payeraient pour la taille au-moins un tiers de plus sur leurs terres, que les propriétaires dont les terres sont affermées, et dont le revenu est déterminé par le fermage sans incertitude et sans soin ; car par rapport à ceux-ci, la taille qui serait égale au tiers de leur revenu, est en-dehors de ce même revenu, qui est réglé et assuré par le bail ; au lieu que si la taille suivait la même proportion dans l'autre cas, la moitié au-moins retomberait sur le revenu indécis des propriétaires. Or la culture avec des métayers est fort ingrate et fort difficîle à régir pour les propriétaires, surtout pour ceux qui ne résident pas dans leurs terres, et qui paient des régisseurs ; elle se trouverait trop surchargée par la taille, si elle était imposée dans la même proportion que dans la grande culture.
Mais la proportion serait juste à l'égard de l'une et de l'autre, si la taille était à l'égal du tiers ou de la moitié des revenus des propriétaires dans la grande et dans la petite culture, où les terres sont affermées, et où les propriétaires ont un revenu décidé par le fermage : elle serait juste aussi, si elle était environ égale au quart du revenu casuel du propriétaire qui fait valoir par le moyen de métayers, ce quart serait à-peu-près le sixième de la part du métayer.
Ainsi en connaissant à-peu-près le produit ordinaire d'une métairie, la taille proportionelle et fixe serait convenablement et facilement réglée pendant le bail du métayer, au sixième ou au cinquième de la moitié de ce produit qui revient au métayer.
Il y a des cas où les terres sont si bonnes, que le métayer n'a pour sa part que le tiers du produit de la métairie : dans ces cas mêmes le tiers lui est aussi avantageux que la moitié du produit d'une métairie dont les terres seraient moins bonnes : ainsi la taille établie sur le même pied dans ce cas-là, ne serait pas d'un moindre produit que dans les autres, mais elle serait faible proportionnellement au revenu du propriétaire qui aurait pour sa part les deux tiers de la récolte ; elle pourrait alors être mise à l'égal du tiers du revenu : ainsi en taxant les métayers dans les cas où la récolte se partage par moitié, au sixième ou au cinquième de leur part du produit des grains de la métairie, on aurait une règle générale et bien simple pour établir une taille proportionnelle, qui augmenterait au profit du roi à mesure que l'agriculture ferait du progrès par la liberté du commerce des grains, et par la sûreté d'une imposition déterminée.
Cette imposition réglée sur les baux dans la grande culture, se trouverait être à-peu-près le double de celle de la petite culture ; parce que les produits de l'une sont bien plus considérables que les produits de l'autre.
Je ne sais pas si, relativement à l'état actuel de la taille, les taxes que je suppose rempliraient l'objet ; mais il serait facîle de s'y conformer, en suivant les proportions convenables. Voyez IMPOT.
Si ces règles étaient constamment et exactement observées, si le commerce des grains était libre, si la milice épargnait les enfants des fermiers, si les corvées étaient abolies (c), grand nombre de propriétaires taillables réfugiés dans les villes sans occupation, retourneraient dans les campagnes faire valoir paisiblement leurs biens, et participer aux profits de l'agriculture. C'est par ces habitants aisés qui quitteraient les villes avec sûreté, que la campagne se repeuplerait de cultivateurs en état de rétablir la culture des terres. Ils payeraient la taille comme les fermiers, sur les profits de la culture, proportionnellement aux revenus qu'ils retireraient de leurs terres, comme si elles étaient affermées ; et comme propriétaires taillables, ils payeraient de plus pour la taille de leur bien même, le dixième du revenu qu'ils retireraient du fermage de leurs terres, s'ils ne les cultivaient pas eux-mêmes. L'intérêt fait chercher les établissements honnêtes et lucratifs. Il n'y en a point où le gain soit plus certain et plus irréprochable que dans l'agriculture, si elle était protégée : ainsi elle serait bien-tôt rétablie par des hommes en état d'y porter les richesses qu'elle exige. Il serait même très-convenable pour favoriser la noblesse et l'agriculture, de permettre aux gentilshommes qui font valoir leurs biens, d'augmenter leur emploi en affermant des terres, et en payant l'imposition à raison du prix du fermage ; ils trouveraient un plus grand profit, et contribueraient beaucoup aux progrès de l'agriculture. Cette occupation est plus analogue à leur condition, que l'état de marchands débitants dans les villes, qu'on voudrait qui leur fût accordé. Ce surcrait de marchands dans les villes serait même fort préjudiciable à l'agriculture, qui est beaucoup plus intéressante pour l'état que le trafic en détail, qui occupera toujours un assez grand nombre d'hommes.
L'état du riche laboureur serait considéré et protégé ; la grande agriculture serait en vigueur dans tout le royaume ; la culture qui se fait avec les bœufs disparaitrait presqu'entièrement, parce que le profit procurerait par-tout aux propriétaires de riches fermiers en état de faire les frais d'une bonne culture ; si la petite culture se conservait encore dans quelques pays où elle paraitrait préférable à la grande culture, elle pourrait elle-même prendre une meilleure forme par l'attrait d'un gain qui dédommagerait amplement les propriétaires des avances qu'ils feraient : le métayer alors pourrait payer sur sa part de la récolte la même taille que le fermier ; car si un métayer avait pour sa part 18 ou 20 boisseaux de blé par arpent de plus qu'il n'en recueille par la petite culture ordinaire, il trouverait en payant quatre ou cinq fois plus de taille, beaucoup plus de profit qu'il n'en retire aujourd'hui. L'état de la récolte du métayer pourrait donc fournir aussi une règle sure pour l'imposition d'une taille proportionnelle.
Voilà donc au-moins des règles simples, faciles et sures pour garantir les laboureurs de la taxe arbitraire, pour ne pas abolir les revenus de l'état par une imposition destructive, pour ranimer la culture des terres et rétablir les forces du royaume.
L'imposition proportionnelle des autres habitants de la campagne, peut être fondée aussi sur des profits ou sur des gains connus ; mais l'objet étant beaucoup moins important, il suffit d'y apporter plus de ménagement que d'exactitude ; car l'erreur serait de peu de conséquence pour les revenus du roi, et un effet beaucoup plus avantageux qui en résulterait, serait de favoriser la population.
La taille dans les villes ne peut se rapporter aux mêmes règles : c'est à ces villes elles-mêmes à en proposer qui leur conviennent. Je ne parlerai pas de la petite maxime de politique que l'on attribue au gouvernement, qui, dit-on, regarde l'imposition arbitraire comme un moyen assuré pour tenir les sujets dans la soumission : cette conduite absurde ne peut pas être imputée à de grands ministres, qui en connaissent tous les inconvénients et tout le ridicule. Les sujets taillables sont des hommes d'une très-médiocre fortune, qui ont plus besoin d'être encouragés que d'être humiliés ; ils sont assujettis souverainement à la puissance royale et aux lois ; s'ils ont quelque bien, ils n'en sont que plus dépendants, que
(c) Les fermiers un peu aisés font prendre à leurs enfants des professions dans les villes, pour les garantir de la milice ; et ce qu'il y a de plus désavantageux à l'agriculture, c'est que non-seulement la campagne perd les hommes destinés à être fermiers, mais aussi les richesses que leurs pères employaient à la culture de la terre. Pour arrêter ces effets destructifs, M. de la Galaisière, intendant de Lorraine, a exempté de la milice par une ordonnance, les charretiers et fils des fermiers, à raison des charrues que leur emploi exige. Les corvées dont on charge les paysans, sont très-desavantageuses à l'état et au roi, parce qu'en réduisant les paysans à la misere, on les met dans l'impuissance de soutenir leurs petits établissements ; d'où résulte un grand dommage sur les produits, sur la consommation et sur les revenus : ainsi loin que ce soit une épargne pour l'état de ménager de cette manière les frais des travaux publics, il les paye très-cher, tandis qu'ils lui couteraient fort peu, s'il les faisait faire à ses frais ; c'est-à-dire par de petites taxes générales dans chaque province, pour le payement des ouvriers. Toutes les provinces reconnaissent tellement les avantages des travaux qui facilitent le Commerce, qu'elles se prêtent volontiers à ces sortes de contributions, pourvu qu'elles soient employées surement et fidèlement à leurs destinations.
plus susceptibles de crainte et de punition. L'arrogance rustique qu'on leur reproche est une forme de leur état, qui est fort indifférente au gouvernement ; elle se borne à résister à ceux qui sont à-peu-près de leur espèce, qui sont encore plus arrogans, et qui veulent dominer. Cette petite imperfection ne dérange point l'ordre ; au contraire elle repousse le mépris que le petit bourgeois affecte pour l'état le plus recommandable et le plus essentiel. Quel avantage donc prétendrait-on retirer de l'imposition arbitraire de la taille, pour reprimer des hommes que le ministère a intérêt de protéger ? serait-ce pour les exposer à l'injustice de quelques particuliers qui ne pourraient que leur nuire au préjudice du bien de l'état ?
Observations sur l'exportation des grains. L'exportation des grains, qui est une autre condition essentielle au rétablissement de l'agriculture, ne contribuerait pas à augmenter le prix des grains. On peut en juger par le prix modique qu'en retirent nos voisins qui en vendent aux étrangers ; mais elle empêcherait les non-valeurs du blé. Ce seul effet, comme nous l'avons remarqué p. 819. éviterait à l'agriculture plus de 150 millions de perte. Ce n'est pas l'objet de la vente en lui-même qui nous enrichirait ; car il serait fort borné, faute d'acheteurs. Voyez FERMIER, p. 533. VI. vol. En effet, notre exportation pourrait à peine s'étendre à deux millions de septiers.
Je ne répondrai pas à ceux qui craignent que l'exportation n'occasionne des disettes * ; puisque son effet est au contraire d'assurer l'abondance, et que l'on a démontré que les moissons des mauvaises années surpasseraient celles que nous recueillons actuellement dans les années ordinaires : ainsi je ne parlerai pas non plus des projets chimériques de ceux qui proposent des établissements de greniers publics pour prévenir les famines, ni des inconvéniens, ni des abus inséparables de pareilles précautions. Qu'on réfléchisse seulement un peu sur ce que dit à cet égard un auteur anglais (d).
" Laissons aux autres nations l'inquiétude sur les moyens d'éviter la famine ; voyons-les éprouver la faim au milieu des projets qu'elles forment pour s'en garantir : nous avons trouvé par un moyen bien simple, le secret de jouir tranquillement et avec abondance du premier bien nécessaire à la vie ; plus heureux que nos pères, nous n'éprouvons point ces excessives et subites différences dans le prix des blés, toujours causées plutôt par crainte que par la réalité de la disette.... En place de vastes et nombreux greniers de ressource et de prévoyance, nous avons de vastes plaines ensemencées.
Tant que l'Angleterre n'a songé à cultiver que pour sa propre subsistance, elle s'est trouvée souvent au-dessous de ses besoins, obligée d'acheter des blés étrangers : mais depuis qu'elle s'en est fait un objet de commerce, sa culture a tellement augmenté, qu'une bonne récolte peut la nourrir cinq ans ; et elle est en état maintenant de porter les blés aux nations qui en manquent.
Si l'on parcourt quelques-unes des provinces de la France, on trouve que non-seulement plusieurs de ses terres restent en friche, qui pourraient produire des blés ou nourrir des bestiaux, mais que les terres cultivées ne rendent pas à beaucoup près à proportion de leur bonté ; parce que le laboureur manque de moyen pour les mettre en valeur.
Ce n'est pas fans une joie sensible que j'ai remarqué dans le gouvernement de France un vice dont les conséquences sont si étendues, et j'en ai félicité ma patrie ; mais je n'ai pu m'empêcher de sentir en même temps combien formidable serait devenue cette puissance, si elle eut profité des avantages que ses possessions et ses hommes lui offraient ". O sua si bona norint ! (e)
Il n'y a donc que les nations où la culture est bornée à leur propre subsistance, qui doivent redouter les famines. Il semble au contraire que dans le cas d'un commerce libre des grains, on pourrait craindre un effet tout opposé. L'abondance des productions que procurerait en France l'agriculture portée à un haut degré, ne pourrait-elle pas les faire tomber en non-valeur ? On peut s'épargner cette inquiétude ; la position de ce royaume, ses ports, ses rivières qui le traversent de toutes parts, réunissent tous les avantages pour le commerce ; tout favorise le transport et le débit de ses denrées. Les succès de l'agriculture y rétabliraient la population et l'aisance ; la consommation de toute espèce de productions premières ou fabriquées, qui augmenterait avec le nombre de ses habitants, ne laisserait que le petit superflu qu'on pourrait vendre à l'étranger. Il est vrai qu'on pourrait redouter la fertilité des colonies de l'Amérique et l'accroissement de l'agriculture dans ce nouveau monde, mais la qualité des grains en France est si supérieure à celle des grains qui naissent dans ces pays-là, et même dans les autres, que nous ne devons pas craindre l'égalité de concurrence ; ils donnent moins de farine, et elle est moins bonne ; celle des colonies qui passe les mers, se déprave facilement, et ne peut se conserver que fort peu de temps ; celle qu'on exporte de
* Voyez le traité de la police des grains, par M. Herbert.
(d) Avant. et désavant. de la Grande-Bretagne.
(e) Si, malgré des raisons si décisives, on avait encore de l'inquiétude sur les disettes dans le cas d'exportation, il est facîle de se rassurer ; car on peut, en permettant l'exportation, permettre aussi l'importation des blés étrangers sans exiger de droits : par-là le prix du blé ne pourra pas être plus haut chez nous que chez les autres nations qui en exportent. Or on sait par une longue expérience qu'elles sont dans l'abondance, et qu'elles éprouvent rarement de cherté ; ainsi la concurrence de leurs blés dans notre pays, empêcherait nos marchands de fermer leurs greniers dans l'espérance d'une cherté, et l'inquiétude du peuple ne ferait point augmenter le prix du blé par la crainte de la famine ; ce qui est presque toujours l'unique cause des chertés excessives. Mais quand on le voudra, de telles causes disparaitront à la vue des bateaux de blés étrangers qui arriveraient à Paris. Les chertés n'arrivent toujours que par le défaut de liberté dans le commerce du blé. Les grandes disettes réelles sont très-rares en France, et elles le sont encore plus dans les pays où la liberté du commerce du blé soutient l'Agriculture. En 1709, la gelée fit par-tout manquer la récolte ; le septier de blé valait en France 100 livres de notre monnaie actuelle, et on ne le vendait en Angleterre que 43 liv. ou environ le double du prix ordinaire dans ces temps-là ; ainsi ce n'était pas pour la nation une grande cherté. Dans la disette de 1693 et 1694, le blé coutait moitié moins en Angleterre qu'en France, quoique l'exportation ne fût établie en Angleterre que depuis trois ou quatre ans : avant cette exportation, les Anglais essuyaient souvent de grandes chertés, dont nous profitions par la liberté du commerce de nos grains sous les règnes d'Henri IV. de Louis XIII. et dans les premiers temps du règne de Louis XIV. L'abondance et le bon prix entretenait les richesses de la nation : car le prix commun du blé en France était souvent 25 liv. et plus de notre monnaie, ce qui formait annuellement une richesse dans le royaume de plus de trois milliarts, qui reduits à la monnaie de ces temps-là, étaient environ 1200 millions. Cette richesse est diminuée aujourd'hui de cinq sixiemes. L'exportation ne doit pas cependant être illimitée ; il faut qu'elle sait, comme en Angleterre, interdite, lorsque le blé passe un prix marqué par la loi. L'Angleterre vient d'essuyer une cherté, parce que le marchand est contrevenu à cette règle par des abus et des monopoles que le gouvernement a tolérés, et qui ont toujours de funestes effets dans un état qui a recours à des ressources si odieuses ; ainsi la nation a éprouvé une cherté dont l'exportation même l'avait préservée depuis plus de soixante ans. En France, les famines sont fréquentes, parce que l'exportation du blé y était souvent défendue ; et que l'abondance est autant désavantageuse aux fermiers, que les disettes sont funestes aux peuples. Le prétexte de remédier aux famines dans un royaume, en interceptant le commerce des grains entre les provinces, donne encore lieu à des abus qui augmentent la misere, qui détruisent l'Agriculture, et qui anéantissent les revenus du royaume.
France est préférée, parce qu'elle est plus profitable, qu'elle fait de meilleur pain, et qu'on peut la garder longtemps. Ainsi nos blés et nos farines seront toujours mieux vendus à l'étranger. Mais une autre raison qui doit tranquilliser, c'est que l'agriculture ne peut pas augmenter dans les colonies, sans que la population et la consommation des grains n'y augmente à proportion ; ainsi leur superflu n'y augmentera pas en raison de l'accroissement de l'agriculture.
Le défaut de débit et la non-valeur de nos denrées qui ruinent nos provinces, ne sont que l'effet de la misere du peuple et des empêchements qu'on oppose au commerce de nos productions. On voit tranquillement dans plusieurs provinces les denrées sans débit et sans valeur ; on attribue ces désavantages à l'absence des riches, qui ont abandonné les provinces pour se retirer à la cour et dans les grandes villes ; on souhaiterait seulement que les évêques, les gouverneurs des provinces, et tous ceux qui par leur état devraient y résider, y consommassent effectivement leurs revenus ; mais ces idées sont trop bornées ; ne voit-on pas que ce ne serait pas augmenter la consommation dans le royaume, que ce ne serait que la transporter des endroits où elle se fait avec profusion, dans d'autres où elle se ferait avec économie ? Ainsi cet expédient, loin d'augmenter la consommation dans le royaume, la diminuerait encore. Il faut procurer par-tout le débit par l'exportation et la consommation intérieure, qui avec la vente à l'étranger soutient le prix des denrées. Mais on ne peut attendre ces avantages que du commerce général des grains, de la population, et de l'aisance des habitants qui procureraient toujours un débit et une consommation nécessaire pour soutenir le prix des denrées.
Pour mieux comprendre les avantages du commerce des grains avec l'étranger, il est nécessaire de faire quelques observations fondamentales sur le commerce en général, et principalement sur le commerce des marchandises de main-d'œuvre, et sur le commerce des denrées du cru ; car pour le commerce de trafic qui ne consiste qu'à acheter pour revendre, ce n'est que l'emploi de quelques petits états qui n'ont pas d'autres ressources que celle d'être marchands. Et cette sorte de commerce avec les étrangers ne mérite aucune attention dans un grand royaume ; ainsi nous nous bornerons à comparer les avantages des deux autres genres de commerce, pour connaître celui qui nous intéresse le plus.
Maximes de Gouvernement économique.
I. Les travaux d'industrie ne multiplient pas les richesses. Les travaux de l'agriculture dédommagent des frais, paient la main-d'œuvre de la culture, procurent des gains aux laboureurs : et de plus ils produisent les revenus des biens-fonds. Ceux qui achetent les ouvrages d'industrie, paient les frais, la main-d'œuvre, et le gain des marchands ; mais ces ouvrages ne produisent aucun revenu au-delà.
Ainsi toutes les dépenses d'ouvrages d'industrie ne se tirent que du revenu des biens-fonds ; car les travaux qui ne produisent point de revenus ne peuvent exister que par les richesses de ceux qui les paient.
Comparez le gain des ouvriers qui fabriquent les ouvrages d'industrie, à celui des ouvriers que le laboureur emploie à la culture de la terre, vous trouverez que le gain de part et d'autre se borne à la subsistance de ces ouvriers ; que ce gain n'est pas une augmentation de richesses ; et que la valeur des ouvrages d'industrie est proportionnée à la valeur même de la subsistance que les ouvriers et les marchands consomment. Ainsi l'artisan détruit autant en subsistance, qu'il produit par son travail.
Il n'y a donc pas multiplication de richesses dans la production des ouvrages d'industrie, puisque la valeur de ces ouvrages n'augmente que du prix de la subsistance que les ouvriers consomment. Les grosses fortunes de marchands ne doivent point être vues autrement ; elles sont les effets de grandes entreprises de commerce, qui réunissent ensemble des gains semblables à ceux des petits marchands ; de même que les entreprises de grands travaux forment de grandes fortunes par les petits profits que l'on retire du travail d'un grand nombre d'ouvriers. Tous ces entrepreneurs ne font des fortunes que parce que d'autres font des dépenses. Ainsi il n'y a pas d'accroissement de richesses.
C'est la source de la subsistance des hommes, qui est le principe des richesses. C'est l'industrie qui les prépare pour l'usage des hommes. Les propriétaires, pour en jouir, paient les travaux d'industrie ; et par-là leurs revenus deviennent communs à tous les hommes.
Les hommes se multiplient donc à proportion des revenus des biens-fonds. Les uns font naître ces richesses par la culture ; les autres les préparent pour la jouissance ; ceux qui en jouissent paient les uns et les autres.
Il faut donc des biens-fonds, des hommes et des richesses pour avoir des richesses et des hommes. Ainsi un état qui ne serait peuplé que de marchands et d'artisans, ne pourrait subsister que par les revenus des biens-fonds des étrangers.
II. Les travaux d'industrie contribuent à la population et à l'accroissement des richesses. Si une nation gagne avec l'étranger par sa main-d'œuvre un million sur les marchandises fabriquées chez elle, et si elle vend aussi à l'étranger pour un million de denrées de son cru, l'un et l'autre de ces produits sont également pour elle un surcrait de richesses, et lui sont également avantageux, pourvu qu'elle ait plus d'hommes que le revenu du sol du royaume n'en peut entretenir ; car alors une partie de ces hommes ne peuvent subsister que par des marchandises de main-d'œuvre qu'elle vend à l'étranger.
Dans ce cas une nation tire du sol et des hommes tout le produit qu'elle en peut tirer ; mais elle gagne beaucoup plus sur la vente d'un million de marchandises de son cru, que sur la vente d'un million de marchandises de main-d'œuvre, parce qu'elle ne gagne sur celle-ci que le prix du travail de l'artisan, et qu'elle gagne sur les autres le prix du travail de la culture et le prix des matières produites par le sol. Ainsi dans l'égalité des sommes tirées de la vente de ces différentes marchandises, le commerce du cru est toujours par proportion beaucoup plus avantageux.
III. Les travaux d'industrie qui occupent les hommes au préjudice de la culture des biens-fonds, nuisent à la population et à l'accroissement des richesses. Si une nation qui vend à l'étranger pour un million de marchandises de main-d'œuvre, et pour un million de marchandises de son cru, n'a pas assez d'hommes occupés à faire valoir les biens-fonds, elle perd beaucoup sur l'emploi des hommes attachés à la fabrication des marchandises de main-d'œuvre qu'elle vend à l'étranger ; parce que les hommes ne peuvent alors se livrer à ce travail, qu'au préjudice du revenu du sol, et que le produit du travail des hommes qui cultivent la terre, peut être le double et le triple de celui de la fabrication des marchandises de main-d'œuvre.
IV. Les richesses des cultivateurs font naître les richesses de la culture. Le produit du travail de la culture peut être nul ou presque nul pour l'état, quand le cultivateur ne peut pas faire les frais d'une bonne culture. Un homme pauvre qui ne tire de la terre par son travail que des denrées de peu de valeur, comme des pommes de terre, du blé noir, des châtaignes, etc. qui s'en nourrit, qui n'achète rien et ne vend rien, ne travaille que pour lui seul : il vit dans la misere ; lui, et la terre qu'il cultive, ne rapportent rien à l'état.
Tel est l'effet de l'indigence dans les provinces où il n'y a pas de laboureurs en état d'employer les paysans, et où ces paysans trop pauvres ne peuvent se procurer par eux-mêmes que de mauvais aliments et de mauvais vêtements.
Ainsi l'emploi des hommes à la culture peut être infructueux dans un royaume où ils n'ont pas les richesses nécessaires pour préparer la terre à porter de riches moissons. Mais les revenus des biens-fonds sont toujours assurés dans un royaume bien peuplé de riches laboureurs.
V. Les travaux de l'industrie contribuent à l'augmentation des revenus des biens-fonds, et les revenus des biens-fonds soutiennent les travaux d'industrie. Une nation qui, par la fertilité de son sol, et par la difficulté des transports, aurait annuellement une surabondance de denrées qu'elle ne pourrait vendre à ses voisins, et qui pourrait leur vendre des marchandises de main-d'œuvre faciles à transporter, aurait intérêt d'attirer chez elle beaucoup de fabriquans et d'artisans qui consommeraient les denrées du pays, qui vendraient leurs ouvrages à l'étranger, et qui augmenteraient les richesses de la nation par leurs gains et par leur consommation.
Mais alors cet arrangement n'est pas facîle ; parce que les fabriquans et artisans ne se rassemblent dans un pays qu'à proportion des revenus actuels de la nation ; c'est-à-dire à proportion qu'il y a des propriétaires ou des marchands qui peuvent acheter leurs ouvrages à-peu-près aussi cher qu'ils les vendraient ailleurs, et qui leur en procureraient le débit à mesure qu'ils les fabriqueraient ; ce qui n'est guère possible chez une nation qui n'a pas elle-même le débit de ses denrées, et où la non-valeur de ces mêmes denrées ne produit pas actuellement assez de revenu pour établir des manufactures et des travaux de main-d'œuvre.
Un tel projet ne peut s'exécuter que fort lentement. Plusieurs nations qui l'ont tenté ont même éprouvé l'impossibilité d'y réussir.
C'est le seul cas cependant où le gouvernement pourrait s'occuper utilement des progrès de l'industrie dans un royaume fertile.
Car lorsque le commerce du cru est facîle et libre, les travaux de main-d'œuvre sont toujours assurés infailliblement par les revenus des biens-fonds.
VI. Une nation qui a un grand commerce de denrées de son cru, peut toujours entretenir, du-moins pour elle, un grand commerce de marchandises de main-d'œuvre. Car elle peut toujours payer à proportion des revenus de ses biens-fonds les ouvriers qui fabriquent les ouvrages de main-d'œuvre, dont elle a besoin.
Ainsi le commerce d'ouvrages d'industrie appartient aussi surement à cette nation, que le commerce des denrées de son cru.
VII. Une nation qui a peu de commerce de denrées de son cru, et qui est réduite pour subsister à un commerce d'industrie, est dans un état précaire et incertain. Car son commerce peut lui être enlevé par d'autres nations rivales qui se livreraient avec plus de succès à ce même commerce.
D'ailleurs cette nation est toujours tributaire et dépendante de celles qui vendent les matières de premier besoin. Elle est réduite à une économie rigoureuse, parce qu'elle n'a point de revenu à dépenser ; et qu'elle ne peut étendre et soutenir son trafic, son industrie et sa navigation, que par l'épargne ; au lieu que celles qui ont des biens-fonds, augmentent leurs revenus par leur consommation.
VIII. Un grand commerce intérieur de marchandises de main-d'œuvre ne peut subsister que par les revenus des biens-fonds. Il faut examiner dans un royaume la proportion du commerce extérieur et du commerce intérieur d'ouvrages d'industrie ; car si le commerce intérieur de marchandises de main-d'œuvre était, par exemple, de trois millions, et le commerce extérieur d'un million, les trois quarts de tout ce commerce de marchandises de main-d'œuvre seraient payées par les revenus des biens-fonds de la nation, puisque l'étranger n'en payerait qu'un quart.
Dans ce cas, les revenus des biens-fonds seraient la principale richesse du royaume. Alors le principal objet du gouvernement serait de veiller à l'entretien et à l'accroissement des revenus des biens-fonds.
Les moyens consistent dans la liberté du commerce et dans la conservation des richesses des cultivateurs. Sans ces conditions, les revenus, la population, et les produits de l'industrie s'anéantissent.
L'agriculture produit deux sortes de richesses : savoir le produit annuel des revenus des propriétaires, et la restitution des frais de la culture.
Les revenus doivent être dépensés pour être distribués annuellement à tous les citoyens, et pour subvenir aux subsides de l'état.
Les richesses employées aux frais de la culture, doivent être réservées aux cultivateurs, et être exemptes de toutes impositions ; car si on les enleve, on détruit l'agriculture, on supprime les gains des habitants de la campagne, et on arrête la source des revenus de l'état.
IX. Une nation qui a un grand territoire, et qui fait baisser le prix des denrées de son cru pour favoriser la fabrication des ouvrages de main-d'œuvre, se détruit de toutes parts. Car si le cultivateur n'est pas dédommagé des grands frais que la culture exige, et s'il ne gagne pas, l'agriculture périt ; la nation perd les revenus de ses biens-fonds ; les travaux des ouvrages de main-d'œuvre diminuent, parce que ces travaux ne peuvent plus être payés par les propriétaires des biens-fonds ; le pays se dépeuple par la misere et par la désertion des fabriquans, artisans, manouvriers et paysans, qui ne peuvent subsister qu'à proportion des gains que leur procurent les revenus de la nation.
Alors les forces du royaume se détruisent ; les richesses s'anéantissent, les impositions surchargent les peuples, et les revenus du souverain diminuent.
Ainsi une conduite aussi mal entendue suffirait seule pour ruiner un état.
X. Les avantages du commerce extérieur ne consistent pas dans l'accroissement des richesses pécuniaires. Le surcrait de richesses que procure le commerce extérieur d'une nation, peut n'être pas un surcrait de richesses pécuniaires, parce que le commerce extérieur peut se faire avec l'étranger par échange d'autres marchandises qui se consomment par cette nation. Mais ce n'est pas moins pour cette même nation une richesse dont elle jouit, et qu'elle pourrait par économie convertir en richesses pécuniaires pour d'autres usages.
D'ailleurs les denrées envisagées comme marchandises, sont tout ensemble richesses pécuniaires et richesses réelles. Un laboureur qui vend son blé à un marchand, est payé en argent ; il paye avec cet argent le propriétaire, la taille, ses domestiques, ses ouvriers, et achète les marchandises dont il a besoin. Le marchand qui vend le blé à l'étranger, et qui achète de lui une autre marchandise, ou qui commerce avec lui par échange, revend à son retour la marchandise qu'il a rapportée, et avec l'argent qu'il reçoit, il rachette du blé. Le blé envisagé comme marchandise, est donc une richesse pécuniaire pour les vendeurs, et une richesse réelle pour les acheteurs.
Ainsi les denrées qui peuvent se vendre, doivent toujours être regardées indifféremment dans un état comme richesses pécuniaires et comme richesses réelles, dont les sujets peuvent user comme il leur convient.
Les richesses d'une nation ne se règlent pas par la masse des richesses pécuniaires. Celles-ci peuvent augmenter ou diminuer sans qu'on s'en aperçoive ; car elles sont toujours effectives dans un état par leur quantité, ou par la célérité de leur circulation, à raison de l'abondance et de la valeur des denrées. L'Espagne qui jouit des trésors du Pérou, est toujours épuisée par ses besoins. L'Angleterre soutient son opulence par ses richesses réelles ; le papier qui y représente l'argent a une valeur assurée par le commerce et par les revenus des biens de la nation.
Ce n'est donc pas le plus ou le moins de richesses pécuniaires qui décide des richesses d'un état ; et les défenses de sortir de l'argent d'un royaume au préjudice d'un commerce profitable, ne peuvent être fondées que sur quelque préjugé désavantageux.
Il faut pour le soutien d'un état de véritables richesses, c'est-à-dire des richesses toujours renaissantes, toujours recherchées et toujours payées, pour en avoir la jouissance, pour se procurer des commodités, et pour satisfaire aux besoins de la vie.
XI. On ne peut connaître par l'état de la balance du commerce entre diverses nations, l'avantage du commerce et l'état des richesses de chaque nation. Car des nations peuvent être plus riches en hommes et en biens-fonds que les autres ; et celles-ci peuvent avoir moins de commerce intérieur, faire moins de consommation, et avoir plus de commerce extérieur que celles-là.
D'ailleurs quelques-unes de ces nations peuvent avoir plus de commerce de trafic que les autres. Le commerce qui leur rend le prix de l'achat des marchandises qu'elles revendent, forme un plus gros objet dans la balance, sans que le fond de ce commerce leur soit aussi avantageux que celui d'un moindre commerce des autres nations, qui vendent à l'étranger leurs propres productions.
Le commerce des marchandises de main-d'œuvre en impose aussi, parce qu'on confond dans le produit le prix des matières premières, qui doit être distingué de celui du travail de fabrication.
XII. C'est par le commerce intérieur et par le commerce extérieur, et surtout par l'état du commerce intérieur, qu'on peut juger de la richesse d'une nation. Car si elle fait une grande consommation de ses denrées à haut prix, ses richesses seront proportionnées à l'abondance et au prix des denrées qu'elle consomme ; parce que ces mêmes denrées sont réellement des richesses en raison de leur abondance et de leur cherté ; et elles peuvent par la vente qu'on en pourrait faire, être susceptibles de tout autre emploi dans les besoins extraordinaires. Il suffit d'en avoir le fond en richesses réelles.
XIII. Une nation ne doit point envier le commerce de ses voisins quand elle tire de son sol, de ses hommes, et de sa navigation, le meilleur produit possible. Car elle ne pourrait rien entreprendre par mauvaise intention contre le commerce de ses voisins, sans déranger son état, et sans se nuire à elle-même ; surtout dans le commerce réciproque qu'elle a établi avec eux.
Ainsi les nations commerçantes rivales, et même ennemies, doivent être plus attentives à maintenir ou à étendre, s'il est possible, leur propre commerce, qu'à chercher à nuire directement à celui des autres. Elles doivent même le favoriser, parce que le commerce réciproque des nations se soutient mutuellement par les richesses des vendeurs et des acheteurs.
XIV. Dans le commerce réciproque, les nations qui vendent les marchandises les plus nécessaires ou les plus utiles, ont l'avantage sur celles qui vendent les marchandises de luxe. Une nation qui est assurée par ses biens-fonds d'un commerce de denrées de son cru, et par conséquent aussi d'un commerce intérieur de marchandises de main-d'œuvre, est indépendante des autres nations. Elle ne commerce avec celles-ci que pour entretenir, faciliter, et étendre son commerce extérieur ; et elle doit, autant qu'il est possible, pour conserver son indépendance et son avantage dans le commerce réciproque, ne tirer d'elles que des marchandises de luxe, et leur vendre des marchandises nécessaires aux besoins de la vie.
Elles croiront que par la valeur réelle de ces différentes marchandises, ce commerce réciproque leur est plus favorable. Mais l'avantage est toujours pour la nation qui vend les marchandises les plus utiles et les plus nécessaires.
Car alors son commerce est établi sur le besoin des autres ; elle ne leur vend que son superflu, et ses achats ne portent que sur son opulence. Ceux-là ont plus d'intérêt de lui vendre, qu'elle n'a besoin d'acheter ; et elle peut plus facilement se retrancher sur le luxe, que les autres ne peuvent épargner sur le nécessaire.
Il faut même remarquer que les états qui se livrent aux manufactures de luxe, éprouvent des vicissitudes fâcheuses. Car lorsque les temps sont malheureux, le commerce de luxe languit, et les ouvriers se trouvent sans pain et sans emploi.
La France pourrait, le commerce étant libre, produire abondamment les denrées de premier besoin, qui pourraient suffire à une grande consommation et à un grand commerce extérieur, et qui pourraient soutenir dans le royaume un grand commerce d'ouvrages de main-d'œuvre.
Mais l'état de sa population ne lui permet pas d'employer beaucoup d'hommes aux ouvrages de luxe ; et elle a même intérêt pour faciliter le commerce extérieur des marchandises de son cru, d'entretenir par l'achat des marchandises de luxe, un commerce réciproque avec l'étranger.
D'ailleurs elle ne doit pas prétendre pleinement à un commerce général. Elle doit en sacrifier quelques branches les moins importantes à l'avantage des autres parties qui lui sont les plus profitables, et qui augmenteraient et assureraient les revenus des biens-fonds du royaume.
Cependant tout commerce doit être libre, parce qu'il est de l'intérêt des marchands de s'attacher aux branches de commerce extérieur les plus sures et les plus profitables.
Il suffit au gouvernement de veiller à l'accroissement des revenus des biens du royaume, de ne point gêner l'industrie, de laisser aux citoyens la facilité et le choix des dépenses.
De ranimer l'agriculture par l'activité du commerce dans les provinces où les denrées sont tombées en non-valeur.
De supprimer les prohibitions et les empêchements préjudiciables au commerce intérieur et au commerce réciproque extérieur.
D'abolir ou de modérer les droits excessifs de rivière et de péage, qui détruisent les revenus des provinces éloignées, où les denrées ne peuvent être commerçables que par de longs transports ; ceux à qui ces droits appartiennent, seront suffisamment dédommagés par leur part de l'accroissement général des revenus des biens du royaume.
Il n'est pas moins nécessaire d'éteindre les privilèges surpris par des provinces, par des villes, par des communautés, pour leurs avantages particuliers.
Il est important aussi de faciliter par-tout les communications et les transports des marchandises par les réparations des chemins et la navigation des rivières (f).
Il est encore essentiel de ne pas assujettir le commerce des denrées des provinces à des défenses et à des permissions passageres et arbitraires, qui ruinent les campagnes sous le prétexte captieux d'assurer l'abondance dans les villes. Les villes subsistent par les dépenses des propriétaires qui les habitent ; ainsi en détruisant les revenus des biens-fonds, ce n'est ni favoriser les villes, ni procurer le bien de l'état.
Le gouvernement des revenus de la nation ne doit pas être abandonné à la discrétion ou à l'autorité de l'administration subalterne et particulière.
On ne doit point borner l'exportation des grains à des provinces particulières, parce qu'elles s'épuisent avant que les autres provinces puissent les regarnir ; et les habitants peuvent être exposés pendant quelques mois à une disette que l'on attribue avec raison à l'exportation.
Mais quand la liberté d'exporter est générale, la levée des grains n'est pas sensible ; parce que les marchands tirent de toutes les parties du royaume, et surtout des provinces où les grains sont à bas prix.
Alors il n'y a plus de provinces où les denrées soient en non-valeur. L'agriculture se ranime partout à proportion du débit.
Les progrès du commerce et de l'agriculture marchent ensemble ; et l'exportation n'enlève jamais qu'un superflu qui n'existerait pas sans elle, et qui entretient toujours l'abondance et augmente les revenus du royaume.
Cet accroissement de revenus augmente la population et la consommation, parce que les dépenses augmentent et procurent des gains qui attirent les hommes.
Par ces progrès un royaume peut parvenir en peu de temps à un haut degré de force et de prospérité. Ainsi par des moyens bien simples, un souverain peut faire dans ses propres états des conquêtes bien plus avantageuses que celles qu'il entreprendrait sur ses voisins. Les progrès sont rapides ; sous Henri IV. le royaume épuisé, chargé de dettes, devint bientôt un pays d'abondance et de richesses. Voyez IMPOT.
Observations sur la nécessité des richesses pour la culture des grains. Il ne faut jamais oublier que cet état de prospérité auquel nous pouvons prétendre, serait bien moins le fruit des travaux du laboureur, que le produit des richesses qu'il pourrait employer à la culture des terres. Ce sont les fumiers qui procurent de riches moissons ; ce sont les bestiaux qui produisent les fumiers ; c'est l'argent qui donne les bestiaux, et qui fournit les hommes pour les gouverner. On a Ve par les détails précédents, que les frais de trente millions d'arpens de terre traités par la petite culture, ne sont que de 285 millions ; et que ceux que l'on ferait pour 30 millions d'arpens bien traités par la grande culture, seraient de 710 millions ; mais dans le premier cas le produit n'est que de 390 millions : et dans le second il serait de 1, 378, 000 000. De plus grands frais produiraient encore de plus grands profits ; la dépense et les hommes qu'exige de plus la bonne culture pour l'achat et le gouvernement des bestiaux, procurent de leur côté un produit qui n'est guère moins considérable que celui des récoltes.
La mauvaise culture exige cependant beaucoup de travail ; mais le cultivateur ne pouvant faire les dépenses nécessaires, ses travaux sont infructueux ; il succombe : et les bourgeois imbéciles attribuent ses mauvais succès à la paresse. Ils croient sans-doute qu'il suffit de labourer, de tourmenter la terre pour la forcer à porter de bonnes récoltes ; on s'applaudit lorsqu'on dit à un homme pauvre qui n'est pas occupé, Ve labourer la terre. Ce sont les chevaux, les bœufs, et non les hommes, qui doivent labourer la terre. Ce sont les troupeaux qui doivent la fertiliser ; sans ces secours elle récompense peu les travaux des cultivateurs. Ne sait-on pas d'ailleurs qu'elle ne fait point les avances, qu'elle fait au contraire attendre longtemps la moisson ? Quel pourrait donc être le sort de cet homme indigent à qui l'on dit Ve labourer la terre ? Peut-il cultiver pour son propre compte ? trouvera-t-il de l'ouvrage chez les fermiers s'ils sont pauvres ? Ceux-ci dans l'impuissance de faire les frais d'une bonne culture, hors d'état de payer le salaire des domestiques et des ouvriers, ne peuvent occuper les paysans. La terre sans engrais et presqu'inculte ne peut que laisser languir les uns et les autres dans la misere.
Il faut encore observer que tous les habitants du royaume doivent profiter des avantages de la bonne culture, pour qu'elle puisse se soutenir et produire de grands revenus au souverain. C'est en augmentant les revenus des propriétaires et les profits des fermiers, qu'elle procure des gains à tous les autres états, et qu'elle entretient une consommation et des dépenses qui la soutiennent elle-même. Mais si les impositions du souverain sont établies sur les cultivateur même, si elles enlèvent ses profits, la culture dépérit, les revenus des propriétaires diminuent ; d'où résulte une épargne inévitable qui influe sur les stipendiés, les marchands, les ouvriers, les domestiques : le système général des dépenses, des travaux, des gains, et de la consommation, est dérangé ; l'état s'affoiblit ; l'imposition devient de plus en plus destructive. Un royaume ne peut donc être florissant et formidable que par les productions qui se renouvellent ou qui renaissent continuellement de la richesse même d'un peuple nombreux et actif, dont l'industrie est soutenue et animée par le gouvernement.
On s'est imaginé que le trouble que peut causer le gouvernement dans la fortune des particuliers, est
(f) Les chemins ruraux ou de communication avec les grandes routes, les villes et les marchés, manquent ou sont mauvais presque par-tout dans les provinces, ce qui est un grand obstacle à l'activité du Commerce. Cependant il semble qu'on pourrait y remédier en peu d'années ; les propriétaires sont trop intéressés à la vente des denrées que produisent leurs biens, pour qu'ils ne voulussent pas contribuer aux dépenses de la réparation de ces chemins. On pourrait donc les imposer pour une petite taxe réglée au sou la livre de la taille de leurs fermiers, et dont les fermiers et les paysans sans bien seraient exempts. Les chemins à réparer seraient décidés par MM. les intendants dans chaque district, après avoir consulté les habitants, qui ensuite les feraient exécuter par des entrepreneurs. On réparerait d'abord les endroits les plus impraticables, et on perfectionnerait successivement les chemins ; les fermiers et paysans seraient ensuite chargés de les entretenir. On pourrait faire avec les provinces de pareils arrangements pour les rivières qui peuvent être rendues navigables. Il y a des provinces qui ont si-bien reconnu l'utilité de ces travaux, qu'elles ont demandé elles-mêmes à être autorisées à en faire les dépenses ; mais les besoins de l'état ont quelquefois enlevé les fonds que l'on y avait destinés : ces mauvais succès ont étouffé des dispositions si avantageuses au bien de l'état.
indifférent à l'état ; parce que, dit-on, si les uns deviennent riches aux dépens des autres, la richesse existe également dans le royaume. Cette idée est fausse et absurde ; car les richesses d'un état ne se soutiennent pas par elles-mêmes, elle ne se conservent et s'augmentent qu'autant qu'elles se renouvellent par leur emploi dirigé avec intelligence. Si le cultivateur est ruiné par le financier, les revenus du royaume sont anéantis, le commerce et l'industrie languissent ; l'ouvrier manque de travail ; le souverain, les propriétaires, le clergé, sont privés des revenus ; les dépenses et les gains sont abolis ; les richesses renfermées dans les coffres du financier, sont infructueuses, ou si elles sont placées à intérêt, elles surchargent l'état. Il faut donc que le gouvernement soit très attentif à conserver à toutes les professions productrices, les richesses qui leur sont nécessaires pour la production et l'accroissement des richesses du royaume.
Observations sur la population soutenue par la culture des grains. Enfin on doit reconnaître que les productions de la terre ne sont point des richesses par elles-mêmes ; qu'elles ne sont des richesses qu'autant qu'elles sont nécessaires aux hommes, et qu'autant qu'elles sont commerçables : elles ne sont donc des richesses qu'à proportion de leur consommation et de la quantité des hommes qui en ont besoin. Chaque homme qui vit en société n'étend pas son travail à tous ses besoins ; mais par la vente de ce que produit son travail, il se procure ce qui lui manque. Ainsi tout devient commerçable, tout devient richesse par un trafic mutuel entre les hommes. Si le nombre des hommes diminue d'un tiers dans un état, les richesses doivent y diminuer des deux tiers, parce que la dépense et le produit de chaque homme forment une double richesse dans la société. Il y avait environ 24 millions d'hommes dans le royaume il y a cent ans : après des guerres presque continuelles pendant quarante ans, et après la révocation de l'édit de Nantes, il s'en est trouvé encore par le dénombrement de 1700, dix-neuf millions cinq cent mille ; mais la guerre ruineuse de la succession à la couronne d'Espagne, la diminution des revenus du royaume, causée par la gêne du Commerce et par les impositions arbitraires, la misere des campagnes, la désertion hors du royaume, l'affluence de domestiques que la pauvreté et la milice obligent de se retirer dans les grandes villes où la débauche leur tient lieu de mariage ; les désordres du luxe, dont on se dédommage malheureusement par une économie sur la propagation ; toutes ces causes n'autorisent que trop l'opinion de ceux qui réduisent aujourd'hui le nombre d'hommes du royaume à seize millions ; et il y en a un grand nombre à la campagne réduits à se procurer leur nourriture par la culture du blé noir ou d'autres grains de vil prix ; ainsi ils sont aussi peu utiles à l'état par leur travail que par leur consommation. Le paysan n'est utîle dans la campagne qu'autant qu'il produit et qu'il gagne par son travail, et qu'autant que sa consommation en bons aliments et en bons vêtements contribue à soutenir le prix des denrées et le revenu des biens, à augmenter et à faire gagner les fabriquans et les artisans, qui tous peuvent payer au roi des subsides à proportion des produits et des gains.
Ainsi on doit apercevoir que si la misere augmentait, ou que si le royaume perdait encore quelques millions d'hommes, les richesses actuelles y diminueraient excessivement, et d'autres nations tireraient un double avantage de ce desastre : mais si la population se réduisait à moitié de ce qu'elle doit être, c'est-à-dire de ce qu'elle était il y a cent ans, le royaume serait dévasté ; il n'y aurait que quelques villes ou quelques provinces commerçantes qui seraient habitées, le reste du royaume serait inculte ; les biens ne produiraient plus de revenus ; les terres seraient par-tout surabondantes et abandonnées à qui voudrait en jouir, sans payer ni connaître de propriétaires.
Les terres, je le répete, ne sont des richesses que parce que leurs productions sont nécessaires pour satisfaire aux besoins des hommes, et que ce sont ces besoins eux-mêmes qui établissent les richesses : ainsi plus il y a d'hommes dans un royaume dont le territoire est fort étendu et fertile, plus il y a de richesses. C'est la culture animée par le besoin des hommes, qui en est la source la plus féconde, et le principal soutien de la population ; elle fournit les matières nécessaires à nos besoins, et procure des revenus au souverain et aux propriétaires. La population s'accrait beaucoup plus par les revenus et par les dépenses que par la propagation de la nation même.
Observations sur le prix des grains. Les revenus multiplient les dépenses, et les dépenses attirent les hommes qui cherchent le gain ; les étrangers quittent leur patrie pour venir participer à l'aisance d'une nation opulente, et leur affluence augmente encore ses richesses, en soutenant par la consommation le bon prix des productions de l'agriculture, et en provoquant par le bon prix l'abondance de ces productions : car non-seulement le bon prix favorise les progrès de l'agriculture, mais c'est dans le bon prix même que consistent les richesses qu'elle procure. La valeur d'un septier de blé considéré comme richesse, ne consiste que dans son prix : ainsi plus le blé, le vin, les laines, les bestiaux, sont chers et abondants, plus il y a de richesse dans l'état. La non-valeur avec l'abondance n'est point richesse. La cherté avec pénurie est misere. L'abondance avec cherté est opulence. J'entends une cherté et une abondance permanentes ; car une cherté passagère ne procurerait pas une distribution générale de richesses à toute la nation, elle n'augmenterait pas les revenus des propriétaires ni les revenus du Roi ; elle ne serait avantageuse qu'à quelques particuliers qui auraient alors des denrées à vendre à haut prix.
Les denrées ne peuvent donc être des richesses pour toute nation, que par l'abondance et par le bon prix entretenu constamment par une bonne culture, par une grande consommation, et par un commerce extérieur : on doit même reconnaître que relativement à toute une nation, l'abondance et un bon prix qui a cours chez l'étranger, est grande richesse pour cette nation, surtout si cette richesse consiste dans les productions de l'agriculture ; car c'est une richesse en propriété bornée dans chaque royaume au territoire qui peut la produire : ainsi elle est toujours par son abondance et par sa cherté à l'avantage de la nation qui en a le plus et qui en vend aux autres : car plus un royaume peut se procurer de richesses en argent, plus il est puissant, et plus les facultés des particuliers sont étendues, parce que l'argent est la seule richesse qui puisse se prêter à tous les usages, et décider de la force des nations relativement les unes aux autres.
Les nations sont pauvres par-tout où les productions du pays les plus nécessaires à la vie, sont à bas prix ; ces productions sont les biens les plus précieux et les plus commerçables, elles ne peuvent tomber en non-valeur que par le défaut de population et de commerce extérieur. Dans ces cas, la source des richesses pécuniaires se perd dans des pays privés des avantages du Commerce, où les hommes réduits rigoureusement aux biens nécessaires pour exister, ne peuvent se procurer ceux qu'il leur faut pour satisfaire aux autres besoins de la vie et à la sûreté de leur patrie : telles sont nos provinces où les denrées sont à vil prix, ces pays d'abondance et de pauvreté, où un travail forcé et une épargne outrée ne sont pas même des ressources pour se procurer de l'argent. Quand les denrées sont chères, et quand les revenus et les gains augmentent à proportion, on peut par des arrangements économiques, diversifier les dépenses, payer des dettes, faire des acquisitions, établir des enfants, etc. C'est dans la possibilité de ces arrangements que consiste l'aisance qui résulte du bon prix des denrées. C'est pourquoi les villes et les provinces d'un royaume où les denrées sont chères, sont plus habitées que celles où toutes les denrées sont à trop bas prix, parce que ce bas prix éteint les revenus, retranche les dépenses, détruit le Commerce, supprime les gains de toutes les autres professions, les travaux et les salaires des artisans et manouvriers : de plus il anéantit les revenus du Roi, parce que la plus grande partie du Commerce pour la consommation se fait par échange de denrées, et ne contribue point à la circulation de l'argent ; ce qui ne procure point de droits au roi sur la consommation des subsistances de ces provinces, et très-peu sur les revenus des biens.
Quand le Commerce est libre, la cherté des denrées a nécessairement ses bornes fixées par les prix mêmes des denrées des autres nations qui étendent leur commerce par-tout. Il n'en est pas de même de la non-valeur ou de la cherté des denrées causées par le défaut de liberté du Commerce ; elles se succedent tour à tour et irrégulièrement, elles sont l'une et l'autre fort désavantageuses, et dépendent presque toujours d'un vice du gouvernement.
Le bon prix ordinaire du blé qui procure de si grands revenus à l'état, n'est point préjudiciable au bas peuple. Un homme consomme trois septiers de blé : si à cause du bon prix il achetait chaque septier quatre livres plus cher, ce prix augmenterait au plus sa dépense d'un sou par jour, son salaire augmenterait aussi à proportion, et cette augmentation serait peu de chose pour ceux qui la payeraient, en comparaison des richesses qui résulteraient du bon prix du blé. Ainsi les avantages du bon prix du blé ne sont point détruits par l'augmentation du salaire des ouvriers ; car alors il s'en faut beaucoup que cette augmentation approche de celle du profit des fermiers, de celle des revenus des propriétaires, de celle du produit des dixmes, et de celle des revenus du roi. Il est aisé d'apercevoir aussi que ces avantages n'auraient pas augmenté d'un vingtième, peut-être pas même d'un quarantième de plus le prix de la main-d'œuvre des manufactures, qui ont déterminé imprudemment à défendre l'exportation de nos blés, et qui ont causé à l'état une perte immense. C'est d'ailleurs un grand inconvénient que d'accoutumer le même peuple à acheter le blé à trop bas prix ; il en devient moins laborieux, il se nourrit de pain à peu de frais, et devient paresseux et arrogant ; les laboureurs trouvent difficilement des ouvriers et des domestiques ; aussi sont-ils fort mal servis dans les années abondantes. Il est important que le petit peuple gagne davantage, et qu'il soit pressé par le besoin de gagner. Dans le siècle passé où le blé se vendait beaucoup plus cher, le peuple y était accoutumé, il gagnait à proportion, il devait être plus laborieux et plus à son aise.
Ainsi nous n'entendons pas ici par le mot de cherté, un prix qui puisse jamais être excessif, mais seulement un prix commun entre nous et l'étranger ; car dans la supposition de la liberté du commerce extérieur, le prix sera toujours réglé par la concurrence du commerce des denrées des nations voisines.
Ceux qui n'envisagent pas dans toute son étendue la distribution des richesses d'un état, peuvent objecter que la cherté n'est avantageuse que pour les vendeurs, et qu'elle appauvrit ceux qui achetent ; qu'ainsi elle diminue les richesses des uns autant qu'elle augmente celle des autres. La cherté, selon ces idées, ne peut donc pas être dans aucun cas une augmentation de richesses dans l'état.
Mais la cherté et l'abondance des productions de l'Agriculture n'augmentent-elles pas les profits des cultivateurs, les revenus du roi, des propriétaires, et des bénéficiers qui jouissent des dixmes ? ces richesses elles-mêmes n'augmentent-elles pas aussi les dépenses et les gains ? le manouvrier, l'artisan, le manufacturier, etc. ne font-ils pas payer leur temps et leurs ouvrages à proportion de ce que leur coute leur subsistance ? Plus il y a de revenus dans un état, plus le Commerce, les manufactures, les Arts, les Métiers, et les autres professions deviennent nécessaires et lucratives.
Mais cette prospérité ne peut subsister que par le bon prix de nos denrées : car lorsque le gouvernement arrête le débit des productions de la terre, et lorsqu'il en fait baisser les prix, il s'oppose à l'abondance, et diminue les richesses de la nation à proportion qu'il fait tomber les prix des denrées qui se convertissent en argent.
Cet état de bon prix et d'abondance a subsisté dans le royaume tant que nos grains ont été un objet de Commerce, que la culture des terres a été protégée, et que la population a été nombreuse ; mais la gêne dans le commerce des blés, la forme de l'imposition des subsides, le mauvais emploi des hommes et des richesses aux manufactures de luxe, les guerres continuelles, et d'autres causes de dépopulation et d'indigence, ont détruit ces avantages ; et l'état perd annuellement plus des trois quarts du produit qu'il retirait il y a un siècle, de la culture des grains, sans y comprendre les autres pertes qui résultent nécessairement de cette énorme dégradation de l'Agriculture et de la population. Art. de M. QUESNAY le fils.
Pour ne point rendre cet article trop long, nous renvoyons à NIELLE ce qui concerne les maladies des grains.
GRAINS DE PARADIS, ou GRAND CARDAMOME. Voyez CARDAMOME.
GRAIN DE FIN, (Chimie, Métall.) petit bouton de fin qu'on retire du plomb, de la litharge, ou du verre de plomb, etc. qui doivent servir à coupeller l'argent : on l'appelle encore le témoin et le grain de plomb ; dernière expression qui répond à l'idiome allemand qui exprime la même idée.
Si l'on met du plomb marchand seul sur une coupelle, et qu'on l'y traite comme si l'on affinait de l'argent, on trouve pour l'ordinaire à la fin de l'opération un petit point blanc, qui est le fin que contenait ce plomb : mais cette quantité, pour si petite qu'elle sait, se trouve avec le culot qui est formé par le coupellement de l'argent avec le plomb, et l'augmente de poids : il faut donc trouver un moyen de l'en défalquer dans la pesée du bouton de fin ; sans quoi on tomberait dans l'erreur. Pour cela, on scorifie à part la même quantité de plomb qu'on a employée pour l'essai, et on le coupelle pour en avoir le témoin. On met ce témoin dans le plateau des poids avec lesquels on pese le culot ; et par ce moyen en ne comptant que les poids, on soustrait celui du témoin du bouton de fin qui a reçu du plomb la même quantité d'argent étranger à la mine essayée.
C'est ainsi qu'on se dispense des embarras du calcul et des erreurs qu'il peut entraîner. On peut être sur que le bouton de fin a reçu la même accrétion de poids, puisque le plomb et sa quantité sont les mêmes ; il y a pourtant certaines précautions à prendre pour garder cette exactitude : il faut grenailler à la fois une certaine quantité de plomb, et mêler le résultat avec un crible, parce que l'argent ne se distribue pas uniformément dans toute la masse du plomb. Voyez LOTISSAGE. On a pour l'ordinaire autant de témoins qu'on emploie de quantités différentes de grenaille, et la chose parle d'elle-même ; si l'on en fait de nouvelle, il faut recommencer sur nouveaux frais : ainsi il en faut faire beaucoup à-la-fais ; car le plomb de la même minière ne contient pas la même quantité d'argent. Les produits d'une mine changent tous les jours ; et d'ailleurs l'argent n'est pas répandu uniformément dans le même gâteau de plomb, comme nous l'avons déjà insinué, et comme nous le détaillerons plus particulièrement à l'article LOTISSAGE. C'est aussi par la même raison que ceux qui au lieu de grenailler leur plomb d'essai le réduisent en lamines qu'ils coupent de la grandeur que prescrit ce poids, et dont ils enveloppent l'essai, sont sujets à tomber dans l'erreur.
Mais il ne suffit pas de s'être assuré de la quantité d'argent que contient le plomb, il faut aussi examiner sous ce même point de vue tout ce qui sert aux essais et qui peut être soupçonné d'en augmenter le bouton ; la litharge, le verre de plomb, le cuivre et le fer, etc. il faut avoir le grain de plomb de tous ces corps. Il est vrai que la plupart du temps l'erreur qui en pourrait résulter ne serait pas considérable ; mais elle le deviendrait si elle était répétée, c'est-à-dire si elle était une somme de celles qui pourraient venir de plusieurs causes à-la-fais.
S'il se trouve de l'argent dans le plomb, le bismuth (car celui-ci sert aussi à coupeller) la litharge, etc. c'est qu'il n'y est pas en assez grande quantité pour défrayer des dépenses de l'affinage. D'ailleurs il y a des auteurs qui prétendent que si l'on coupelle de nouveau le plomb qui a été bu par la coupelle, on y trouve toujours de l'argent : ainsi il ne peut y avoir de plomb sans argent, quoiqu'on dise qu'il s'en trouve. Voyez CRAMER, PLOMB, FOURNEAU, à la section des fourneaux de fusion ; MINE PERPETUELLE DE BECHER, ESSAI, AFFINAGE et RAFFINAGE DE L'ARGENT, et GRENAILLER.
GRAIN DE PLOMB, (Chimie, Métallurg.) Voyez GRAIN DE FIN.
GRAIN, (Physique) on appelle de ce nom tous les coups de vent orageux qui sont accompagnés de pluie, de tonnerre, et d'éclairs, et l'on se sert du terme de grain sec pour désigner ceux qui sont sans pluie. Voyez OURAGAN. Histoire natur. du Sénégal, par M. Adanson.
GRAIN, (Art militaire) dans l'artillerie est une opération dont on se sert pour corriger le défaut des lumières des pièces de canon et mortiers qui se sont trop élargies.
Ce grain n'est autre chose que de nouveau métal que l'on fait couler dans la lumière pour la boucher entièrement. Pour que ce nouveau métal s'unisse plus facilement avec l'ancien, on fait chauffer la pièce très-fortement, pour lui donner à-peu-près le même degré de chaleur que le métal fondu que l'on y coule : quand ce métal est refroidi, on perce une nouvelle lumière à la pièce ; pour que le nouveau métal ne coule pas dans l'âme du canon par la lumière, on y introduit du sable bien refoulé jusque vers les anses.
Comme il est assez difficîle que le nouveau métal dont on remplit la lumière s'unisse parfaitement avec l'ancien, le chevalier de Saint-Julien propose, dans son livre de la forge de Vulcain, d'élargir la lumière de deux pouces jusqu'à l'âme du canon, comme à l'ordinaire ; de faire ensuite autour de cette ouverture, à trois ou quatre pouces de distance, quatre trous en quatre endroits différents, disposés de manière qu'ils aillent se rencontrer obliquement vers le milieu de l'épaisseur de la lumière ; il faut que ces trous aient au moins chacun un pouce de diamètre. Il faut après cela prendre un instrument de bois à-peu-près comme un refouloir, qui soit exactement du calibre de la pièce ; sur la tête de cette espèce de refouloir, il faut faire une entaille d'un demi-pouce de profondeur, coupée également suivant sa circonférence, en sorte que le fond de cette entaille donne une superficie convexe, parallèle à celle de sa partie supérieure. On doit garnir l'entaille d'une ligne ou deux d'épaisseur, en lui donnant toujours la forme convexe ; après cela, il faut faire fondre cinq ou six cent livres de métal, bien chauffer le canon, et introduire dedans le refouloir dont nous venons de parler ; son entaille doit répondre au trou de la lumière. Le canon étant ensuite placé de manière que le trou de la lumière se trouve bien perpendiculaire à l'horizon, il faut faire couler le métal dans tous les trous que l'on a percés, et après les en avoir remplis, et laissé refroidir le tout, la lumière se trouvera exactement bouchée et en état de résister à tout l'effort de la poudre dont le canon sera chargé dans la suite ; c'est ce que cette construction rend évident. Il est question après cela de retirer le refouloir ; pour le faire plus facilement, on a la précaution de le construire de deux pièces, et en tirant celle de dessous, l'autre se détache aisément. On perce ensuite une nouvelle lumière, avec un instrument appelé foret ; et c'est la raison pour laquelle on dit indifféremment, dans l'usage ordinaire, percer ou forer une lumière. Voyez CANON. (Q)
GRAIN, (Poids) c'est la soixante-douzième partie d'une dragme en France. Il y en a conséquemment 24 en un denier ; 28 4/5 en un sterling ; 14 2/5 en une maille ; 7 1/5 en un felin.
En Allemagne la dragme n'a que soixante grains. Cette dragme et ces grains sont différents de ceux de France. Les grains d'Angleterre et de Hollande le sont aussi, etc. Voyez la section du poids de proportion à l'article POIDS FICTIF.
Le carat de diamants en France pese quatre grains réels. Celui de l'or est un poids imaginaire. Voyez CARAT et POIDS FICTIF.
Le poids de semelle pour l'argent est de trente-six grains réels. Celui pour l'or est de six grains, aussi réels en France. Voyez POIDS FICTIF.
Pour les matières précieuses, le grain réel se divise en 1/2, en 1/4, en 1/8, etc. et il est toujours constamment de même poids ; mais le grain imaginaire, ou qui est une division d'un poids représentant, a une valeur proportionnée à ce poids. Voyez POIDS FICTIF.
La lentille des Romains, lents, pesait un grain ; leur aereole, aereolus, le cholcus des Grecs pesait deux grains. La silique des Romains, le cération des Grecs, le kirac des Arabes, 4 grains. Le danich des Arabes, huit grains. L'obole des Romains, l'onolosat des Arabes, 12 grains. La dragme des Romains, 72 grains.
En Pharmacie, le grain est ordinairement le plus petit poids. Ce n'est pas qu'on ne prenne des médicaments composés, où une drogue simple n'entre que pour un demi-grain, un tiers, un quart, etc. de grain ; mais ces fractions ne sont pas séparées de la masse totale, et se pesent en commun. Cependant il arrive quelquefois qu'une drogue simple est ordonnée à la quantité d'un demi-grain ; et pour lors il faut avoir un poids particulier, pour n'être pas obligé de partager la pesée d'un grain. Ces poids sont faits d'une petite lame de laiton, assez étendue pour porter l'empreinte de sa valeur ; et il faut convenir que ces sortes de poids sont plus justes que ceux qui leur ont donné leur nom. Je veux parler des grains d'orge qui ont servi d'abord à diviser notre denier, ou le scrupule de la Médecine en 24 parties. Il est vrai qu'on avait la précaution de les prendre médiocrement gros ; mais la masse n'est pas dans tous en même proportion avec le volume. D'ailleurs ces sortes de poids étaient sujets aux vicissitudes du sec et de l'humide, qui devaient y apporter des changements considérables, sans compter qu'ils étaient rongés des insectes qui les diminuaient tout-d'un-coup d'un demi-grain, et conséquemment le médicament pesé : en sorte qu'on devait être exposé à des inexactitudes continuelles. Dans les formules, le grain a pour caractère ses deux premières lettres. Ainsi, prenez de tartre stibié gr. IIe signifie qu'on en prenne deux grains.
GRAIN, en terme de Raffineur, est proprement le sucre coagulé qui forme ces sels luisans et semblables par leur grosseur aux grains de sable. On appelle encore de ce nom dans les raffineries, des sirops que la chaleur fait candir et attacher au fond du pot. Voyez POT.
GRAIN D'ORGE, (Médecine) maladie fréquente dans les cochons qu'on engraisse, et qui consiste en quantité de petites pelotes dures de la grosseur d'un grain d'orge, répandues sur toute la membrane cellulaire ; ces grains ont leur siège dans les bulbes des poils, qui sont de vrais follicules adipeux, où l'injection d'eau et même de matière céracée, pénètre aisément par les artères. (D.J.)
GRAIN D'ORGE, outil dont se servent les Tourneurs ; il parait être composé des biseaux droit et gauche. Voyez nos Planches du tour, où il est représenté Ve par-dessous.
GRAIN DE VENT, (Marine) se dit d'un nuage, d'un tourbillon en forme d'orage, qui ne fait que passer, mais qui donne du vent ou de la pluie, et souvent les deux ensemble : lorsqu'on l'aperçoit de loin, on se prépare, et l'on se tient aux drisses et aux écoutes pour les larguer s'il est nécessaire, ou faire d'autres manœuvres selon le besoin. Il y a des grains si forts et si subits, qu'ils causent bien du désordre dans les voiles et les manœuvres. On dit un grain pesant, lorsque le vent est très-fort. (Z)
Articles populaires Logique
PLEIN
REMPLI, adj. (Synonyme) il n'en peut plus tenir dans ce qui est plein. On n'en peut pas mettre davantage dans ce qui est rempli. Le premier a un rapport particulier à la capacité du vaisseau ; et le second à ce qui doit être reçu dans cette capacité.Aux nôces de Cana les pots furent remplis d'eau, et par miracle ils se trouvèrent pleins de vin. Girard. (D.J.)
PLEIN, s. m. en Physique, est un terme usité pour signifier cet état des choses où chaque partie de l'espace ou de l'étendue est supposée entièrement remplie de matière. Voyez MATIERE et ESPACE.
Lire la suite...