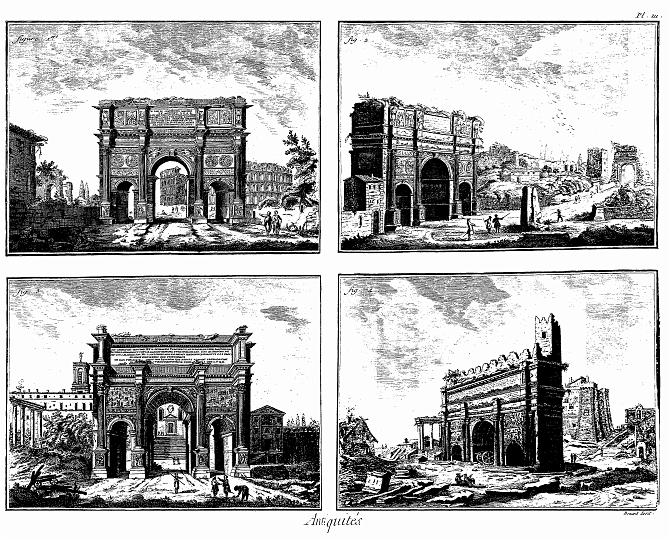(Géographie moderne) ou Regio, ou Regge, en latin Rhegium Lepidi, et quelquefois simplement Regium ; ville d'Italie, dans le Modénais, capitale d'un duché auquel elle donne le nom ; elle est au midi de l'Apennin, dans une campagne fertile, à 6 lieues au nord-ouest de Modéne.
Cette ville située sur la voie émilienne, a été colonie romaine. On prétend qu'elle doit son origine à un Lepidus ; mais l'histoire n'en dit rien, et personne n'a pu indiquer jusqu'à présent quel était ce Lepidus. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Goths ruinèrent cette ville de fond-en-comble, et contraignirent ses habitants de l'abandonner. Elle s'est remise en splendeur depuis ce temps-là, et est aujourd'hui bien peuplée, ayant de belles rues et des maisons bien bâties.
Son évêché établi dès l'an 450, est suffragant de Bologne. La cathédrale est décorée de tableaux des grands maîtres. On y voit entr'autres un S. George et une Ste. Catherine du Carrache, une Vierge du Guide, un S. Jean et un S. Paul du Guerchin. L'église de S. Prosper est aussi embellie d'un Christ mort et des trois Maries, de Louis Carrache.
On dit que Charlemagne a été le second fondateur de la Reggio de Lombardie ; ses murailles sont épaisses ; il ne règne tout-autour aucune éminence qui commande la ville, et elle est défendue par une bonne citadelle. Les coteaux voisins sont couverts de maisons de plaisance, de vignobles et de jardins qui produisent des fruits délicieux. Long. suivant Harris, 31. 16. 15''latit. 42. 15.
L'Arioste (Ludovico Ariosto) naquit à Reggio dans le Modénais, l'an 1474, et immortalisa sa patrie. Sa famille tenait un rang si distingué dans la ville, que le marquis Obiso de la maison d'Est, honora cette famille de son alliance, en épousant Lippa Ariosta, femme d'une grande beauté et de beaucoup d'esprit. Le père de l'Arioste était gouverneur de Reggio dans le temps que son fils y prit naissance. Sa mère sorrait de la noble famille de Malaguzza. Louis Ariosto était son fils ainé ; mais comme il avait quatre frères et cinq sœurs, sa fortune se trouvait modique. Il dit lui-même que Mercure n'avait pas été trop des amis de sa famille, et qu'aucun d'eux ne lui avait fait sa cour. Il ne se conduisit pas différemment, et dès sa plus tendre jeunesse il ne montra d'autre inclination que celle du beau génie qui le portait à la Poésie. Ce fut en vain que son père le pressa de s'appliquer uniquement à l'étude de la Jurisprudence ; il se plaignit de son malheur à cet égard dans les vers suivants au Bembe :
Ah lasso ! quando hebbi al pegaseo melo
L'eta disposta, et che le fresche guancie
Non si videano ancor fiorrir d'un pelo.
Mio padre mi cacciò con spiedi e lancie
Non che con sproni a volger testi et chiose,
Et mi occupò cinque anni in quelle ciancie.
Ma poiche vide pero fruttuose
L'opre, et il tempo in van gettersi, dopo
Molto contrasto in libertà mi pose.
Milton s'est trouvé dans le même cas que l'Arioste, et fit à son père une très-belle pièce en vers latins, pour l'engager à lui laisser suivre son goût pour la Poésie. Il lui expose combien cet art était estimé parmi les anciens, et les avantages qu'il procure ; il lui représente qu'il ne doit pas naturellement être si ennemi des muses, possédant la Musique aussi bien qu'il faisait, et que par cela même il n'est pas surprenant que son fils ait de l'inclination pour la Poésie, puisqu'il y a tant de relation entr'elle et la Musique.
Nec tu perge, precor, sacras contemnere musas,
Nec vanas inopesque puta, quarum ipse peritus
Munere, mille sonos numeris componis adaptos,
Millibus et vocum modulis variare coronam
Doctus, Arionii meritò sis nominis haeres.
Nunc tibi quid mirum, si me genuisse poetam
Contigerit, charo si tam propè sanguine juncti,
Cognatas artes, studiumque affine sequamur ?
Ipse volents Phoebus se dispartire duobus,
Altera dona mihi, dedit altera dona parenti,
Dividuumque Deum genitorque, puerque tenemus.
Il témoigne ensuite combien il méprise tous les trésors du Pérou, en comparaison de la science ; il déclare qu'il a plus d'obligation à son père de lui avoir fait connaître les belles-lettres, que Phaèton n'en eut eu à Apollon, quand même il aurait conduit surement son char ; et il se promet à lui-même, de s'élever au-dessus du reste des hommes, de se rendre supérieur à tous les traits de l'envie, et de s'acquérir une gloire immortelle.
I nunc, confer opes, quisquis malesanus avitas
Austriaci gazas, pervanaque regna peroptas.
Quae potuit majora pater tribuisse, velipse
Jupiter, excepto, donasset ut omnia coelo ?
Jamque nec obscurus populo miscebor inerti,
Vitabuntque oculos vestigia nostra profanos.
Este procùl vigiles curae procùl este querelae,
Invidiaeque acies transverso tortilis hirquo,
Saeva nec anguiferos extende calumnia rictus :
In me triste nihil, foedissima turba, potestis,
Nec vestri sum juris ego ; securaque tutus
Pectora, vipereo gradiar sublimis ab ictu.
Les charmes enchanteurs qu'offre l'espoir de la gloire, et l'enthousiasme qui les anime, rend les grands génies, tels que l'Arioste et Milton, insensibles à toutes les vues d'intérêt, et leur fait goûter une satisfaction si délicieuse, qu'elle les dédommage de tout le reste.
L'Arioste, en suivant ses études, composait toujours quelques pièces de poésie. A la tragédie de Pyrame et de Thisbé, il fit succéder des satyres et des comédies. Un jour son père était dans une grande colere contre lui, et le gronda fortement ; l'Arioste l'écouta avec beaucoup d'attention sans rien répondre. Quand son père s'en fut allé, le frère d'Arioste lui demanda pourquoi il n'avait rien allégué pour sa justification, il lui répondit qu'il travaillait actuellement à une comédie, et qu'il en était à une scène, où un vieillard réprimandait son fils ; et que quand son père avait commencé à parler, il lui était venu dans l'esprit de l'observer avec soin pour peindre d'après nature, et qu'ainsi il n'avait été attentif qu'à remarquer son ton de voix, ses gestes et ses expressions, s'en s'embarrasser de se défendre.
Ayant perdu ce père à l'âge de 24 ans, il se livra sans obstacle à son penchant. Il possédait parfaitement la langue latine ; mais il préféra d'écrire en italien, soit qu'il crut qu'il ne pourrait s'élever jusqu'au premier rang des poètes latins qui était déjà occupé par Sannazar, Bembo, Nauger, Sadolet, et autres ; soit qu'il jugeât l'italien plus du goût de son siècle, soit enfin qu'il voulut enrichir sa langue d'ouvrages qui la fissent estimer des autres nations. Il accepta cependant différentes commissions d'affaires d'état en divers endroits d'Italie, sans vouloir s'écarter de son pays. Il refusa d'accompagner le cardinal d'Est en Hongrie, préférant, dit-il, une vie tranquille à toute autre.
E più mi piace di poser le polize
Membra, che di vantarle, ch'agli scithi
Sien state, agli indi, agli ethiopi, ed altre.
Le duc de Ferrare le fit en son absence, gouverneur de Graffignana. Après qu'il fut de retour, Arioste choisit de passer le reste de sa vie dans la retraite, et continua ses études dans une maison qu'il avait fait bâtir à Ferrare. Cette maison était simple ; et comme quelqu'un lui demanda, pourquoi il ne l'avait pas rendue plus magnifique, ayant si noblement décrit dans son Roland tant de palais somptueux, de beaux portiques, et d'agréables fontaines ; il répondit qu'on assemblait bien plutôt et plus aisément des mots que des pierres. Il avait fait graver au-dessus de la porte de sa maison, un distique, que peu de ceux qui bâtissent aujourd'hui, seraient en droit de mettre sur leurs édifices :
Parva, sed apta mihi, sed nulli obnoxia, sed non
Sordida, parta meo sed tamen aere domus.
L'Arioste se trouvait alors dans une situation aisée, ayant été comblé de présents considérables du duc de Ferrare, du pape Léon X. qui sans des raisons politiques, l'aurait élevé à la pourpre ; du cardinal Farnese, du cardinal Bibiena, du marquis de Vasto, et de plusieurs autres personnes du premier rang. Son goût aidé de la fortune, lui permettait de faire tous les changements qui lui venaient dans l'esprit pour orner son domicîle ; mais il avouait lui-même qu'il en usait avec sa maison comme avec ses vers, qu'il corrigeait si souvent, qu'il leur ôtait ces grâces et cette beauté que produit le premier feu de la composition.
Cependant, quelques défauts qu'il ait pu trouver dans ses vers, il est certain que toute l'Italie les admire. Il avait encore le talent de lire parfaitement bien, et il animait d'une façon particulière tout ce qu'il prononçait. Aussi souffrait-il infiniment d'entendre lire ses ouvrages de mauvaise grâce. On raconte à ce sujet, que passant un jour devant la boutique d'un potier, il entendit que cet homme récitait une stance du Roland (la trente-deuxième du premier livre), où Renaud crie à son cheval de s'arrêter :
Ferma, bajardo mio, deh ferma il piede,
Che l'esser senza te troppo mi noce, &c.
mais le potier déclamait ces vers si mal, qu'Arioste indigné brisa avec une canne qu'il avait à la main, quelques pots qui étaient sur le devant de la boutique. Le potier lui fit des reproches fort vifs de ce qu'il en agissait ainsi avec un pauvre homme qui ne l'avait jamais offensé. Vous ignorez, lui répondit l'Arioste, l'injure que vous venez de me faire en face ; j'ai brisé deux ou trois pots qui ne valaient pas cinq sols, et vous avez estropié une de mes plus belles stances, qui vaut une somme considérable. Il s'apaisa pourtant, et lui paya ses pots.
Il était simple et frugal pour sa table : ce qui lui a fait dire dans quelque endroit de ses ouvrages, qu'il aurait pu vivre du temps que les hommes se nourrissaient de gland. Malgré sa sobriété et la faiblesse de son tempérament, il ne put se garantir des pieges de l'amour. Il eut deux fils de sa première maîtresse. Il lia dans la suite une intrigue avec une belle femme nommée Genevra. Il devint encore épris d'une autre dame parente de son ami Nicolo Vespucci. C'est pour cette dernière qu'il fit en 1513, le sonnet qui commence :
Non so s'io potrò ben chiuder in versi.
Ayant un jour trouvé cette maîtresse occupée à une espèce de cote-d'armes pour un de ses fils, qui devait se trouver à une revue, il fit la comparaison qu'on trouve dans la 54. stance du 24. livre de Roland, touchant la blessure que Zerbin, prince d'Ecosse, avait reçue de Mandricard. Quoique je n'ose entreprendre d'excuser les amours de l'Arioste, dit Harrington, cependant je me persuade que Ve le célibat où ce poète a vécu, et la puissance des attraits des charmantes diablesses qui l'ont séduit, il n'aura pas de peine à obtenir sa grâce de la plupart de ceux qui liront sa vie.
C'est dommage qu'il n'ait connu les pays étrangers que par récit ; car il en eut tiré beaucoup d'utilité pour l'embellissement de ses portraits ; mais il ne voulut point sortir de sa patrie, et même il témoigne dans une de ses satyres, son peu de goût pour toute espèce de voyage, et son amour pour les seules beautés de son pays.
Che vuol andare a torno, a torno vada,
Vegga Inghilterra, Ungheria ; Francia e Spagna :
A me piace habitar la mia contrada.
Vista ho Toscana, Lombardia, Romagna,
Quel monte che divide, e quel che serra
Italia, e un mare el'altro che la bagna ;
Questo mi basta ; il resto della terra,
Senza mai pagar l'hoste, andro cercando
Con Tolomeo, sia il mondo in pace o in guerra.
Il mourut à Ferrare en 1534, âgé de 59 ans. Il eut toujours de grands égards pour sa mère, qu'il traitait avec beaucoup de respect dans sa vieillesse, et il en parle souvent dans ses satyres et dans ses autres ouvrages. Il dit dans un endroit :
L'eta di cara madre, mi percuote di pieta il cuore.
Sa bienfaisance, sa conduite, son honnêteté le firent aimer de tous les gens de bien pendant sa vie, et regretter de tous les honnêtes gens après sa mort.
Il prit pour modèle Homère et Virgîle dans son Orlando. Virgîle commence ainsi :
Arma virumque cano.
l'Arioste :
Le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori,
Le cortesie, laudaci impresi io canto.
Virgîle finit par la mort de Turnus, l'Arioste par celle de Rodomont :
Bestemmiando fuggi l'alma sdegnosa,
Che fu si altera al mondo, e si orgogliosa.
Virgîle loue extrêmement Enée pour plaire à Auguste, qui disait en être descendu : Arioste relève Roger, pour faire honneur à la maison d'Est. Enée avait sa Didon qui le retenait ; Roger était captivé par Alcine.
Arioste s'était d'abord fait connaître par des satyres, ensuite par des comédies dans lesquelles on remarque beaucoup d'art et de comique ; celle intitulée gli suppositi, les supposés, mêlée de prose et de vers, fut la plus estimée. Il y règne un juste milieu entre le ton élevé et le bas, ton qu'aimait l'antiquité. Il est le premier qui ait employé pour le theâtre comique, le verso sdrucciolo ; ce sont des vers de dix syllabes ; il est évident qu'il avait dessein par ce moyen d'approcher le langage comique, le plus qu'il était possible, du discours ordinaire. Il a fait aussi quelques poésies latines qui ont été insérées dans le premier tome des délices des poètes d'Italie, et qui y sont confondues avec celles de divers autres poètes de médiocre réputation.
Enfin l'Arioste songea sérieusement à son grand poème de Roland le furieux, et le commença à peu près à l'âge de 30 ans. C'est le plus fameux de ses ouvrages, quoiqu'on en ait porté des jugements très-différents. Le premier de tous, celui du cardinal Hippolite d'Est, ne lui fut pas favorable ; car, quoiqu'il lui fût dédié, il dit à l'auteur, après l'avoir lu, où diable avez-vous pris tant de fadaises, seigneur Arioste ? Cependant Muret et Paul Jove ont cru que l'ouvrage passerait à l'immortalité ; et l'on peut dire qu'il en a assez bien pris le chemin, puisqu'il y a peu de pays où il n'ait été imprimé, ni de langues répandues en Europe, dans lesquelles il n'ait été traduit. Jamais pièce ne fut remplie de tant de choses différentes, de combats, d'enchantements, d'aventures bizarres, que ce poème de l'Arioste ; et il parait qu'il n'a rien oublié de ce que son génie et son industrie ont pu lui suggérer pour les ornements de son ouvrage.
Il n'a pourtant pas donné à son style ce caractère de sublime et de grandeur qui convient à la poésie épique ; et même plusieurs critiques osent douter que ce soit un véritable poème épique, à en juger suivant les règles de l'art. Ils disent que l'unité de l'action n'est point dans le Roland, et que ce poème n'est régulier ni dans l'ordonnance, ni dans la proportion des parties. L'auteur mêle presque par-tout le faux avec le vrai, et fait jurer le vrai Dieu par l'eau du Styx. Ici le poète a trop de feu : ailleurs il est trop rempli d'événements prodigieux et surnaturels, qui ressemblent aux imaginations creuses d'un malade. Ses héros ne nous offrent que des paladins ; et son poème respire un air de chevalerie romanesque, plutôt qu'un esprit héroïque.
De plus, on lui reproche des épisodes trop affectées, peu vraisemblables, et souvent hors d'œuvre. Non-seulement il ôte à ses héros la noblesse de leur condition pour les faire badiner, mais il ôte quelquefois aux femmes leur caractère qui est la pudeur et la timidité. On trouve encore que le poète parle trop lui-même en propre personne par voie de digression, et qu'il finit ses narrations si brusquement, qu'à moins d'une grande attention, on perd le fil de l'histoire. On juge bien que la critique judicieuse n'a jamais pu approuver une pensée extravagante de l'Arioste, qui dit d'un de ses héros, que dans la chaleur du combat, ne s'étant pas aperçu qu'on l'avait tué, il combattit toujours vaillamment, tout mort qu'il était :
Il pover'huomo che non s'en'era accorto,
Andava combattendo, et era morto.
Enfin, pour abréger, l'on répète assez communément cet ancien bon mot, que le tombeau de l'Arioste est dans le Tasse.
Malgré toutes ces critiques, l'auteur de Roland a eu, et a encore un grand nombre de partisans en Italie, tels que MM. de la Crusca, le Mazzoni, Simon Fornari, Paul Beni, et Louis Dolce qui a entrepris sa défense. M. Scipion Maffei a beaucoup contribué à soutenir les admirateurs du poète de Reggio, lorsqu'il a dit dans son discours : " le divin Arioste est au-dessus de tous nos éloges par son admirable poème. Sa rime est si riche qu'elle ne parait jamais être venue après coup ; on dirait qu'elle est née avec la pensée, et qu'elle n'en est que l'agrément ; ses négligences sont heureuses ; ses fautes même ont des grâces ; il n'est pas donné à tout le monde d'en commettre de pareilles. "
Mais il ne faut pas se prévaloir de ce jugement de M. Maffei, pour prétendre que Roland le furieux n'a de concurrent que le Godefroi du Tasse, et que ce dernier même ne doit pas aspirer à la supériorité ; le marquis Maffei ne le pensait pas sans doute ; car il ajoute après ses éloges de l'Arioste, qu'il n'est pas exempt de taches. En effet, le burlesque y nait quelquefois du sérieux, contre le goût et l'attente du lecteur. Il franchit en divers endroits les bornes que prescrit la bienséance. L'hyperbole fréquente détruit souvent le vraisemblable, si nécessaire même dans la fiction ; et des digressions inutiles interrompent encore plus souvent le fil du discours. Enfin le génie de l'Arioste parait semblable à ces terres fertiles qui produisent des fleurs et des chardons tout ensemble ; et quoique presque tous les morceaux de son poème soient très-beaux, que sa versification soit aisée, sa diction pure et élégante, et ses descriptions pleines d'agréments, cependant l'ouvrage entier n'est point le premier poème de l'Italie.Il s'en est fait nombre d'éditions, soit sans commentaires, soit avec des commentaires. On estime surtout celles de Venise en 1562, en 1568 et 1584 in-4°.
Le chevalier Jean Harrington traduisit Roland en vers héroïques anglais, et le dédia à la reine Elisabeth. La troisième édition de cet ouvrage curieux, et heureusement versifié, parut à Londres en 1634, in-fol. avec une défense ingénieuse de l'Arioste, et un abrégé de la vie de ce poète, recueilli de divers auteurs italiens, et en particulier de Sansovino.Gabriel Chappuys Tourangeau mit au jour à Lyon, en 1582 et 1583 in-8 °. une traduction française en prose de l'Orlando ; mais cette version est tombée dans un profond oubli, surtout depuis que M. Mirabaud de l'académie française a donné lui-même une nouvelle traduction du poème de l'Arioste.Je n'ai pu me dispenser de m'étendre sur ce grand poète, parce que son mérite comparé au Tasse, partage encore aujourd'hui une partie des beaux esprits d'Italie.
Pancirole (Gui) célèbre jurisconsulte et littérateur, naquit en 1523, à Reggio en Lombardie, professa avec beaucoup d'honneur, d'abord à Padoue, et ensuite à Turin ; mais ayant éprouvé que l'air du Piémont était fort contraire à ses yeux, il revint à Padoue en 1582, et y passa le reste de sa vie dans sa première chaire avec mille ducats d'appointement. Il mourut en 1599, après avoir mis au jour plusieurs ouvrages, dont j'indiquerai les principaux.
Le premier est ses consilia, qui parurent à Venise en 1578, in-fol.
2. Notitia dignitatum tùm Orientis, tùm Occidentis ultrà Arcadii Honoriique tempora. Venise 1593 et 1602 in-fol. Lyon 1608, et Geneve 1623 in-fol. Le même ouvrage est inséré dans le tome VII. des antiquités rom. de Graevius. Les savants ont donné de grands éloges au commentaire de Pancirole sur la notice des dignités de l'empire. On y lit avec plaisir ce qui concerne les légions de Rome et la magistrature romaine ; mais il s'y trouve plusieurs erreurs en Géographie.
3. De claris legum interpretibus, libri IV. Venise, 1635 et 1655, in-4 °. Francfort, 1721, in-4°. Cette dernière édition, supérieure aux précédentes, a été donnée par M. Hoffman qui a joint d'autres ouvrages sur le même sujet.
4. Rerum memorabilium, libri duo : quorum prior deperditarum, posterior noviter inventarum, est. Norimbergae, 1599, en 2 vol. in-8°. Lipsiae, 1707, in-4 °. L'ouvrage avait d'abord été fait en italien. Il a été traduit en français par Pierre de la Noue, sous ce titre : les antiquités perdues, et des choses nouvellement inventées. Lyon, 1608, in-8 °. (Le chevalier DE JAUCOURT. )
REGGIO, le duché de, (Géographie moderne) duché en Italie, au couchant du Modénais. Il se partage en cinq petits états, qui appartiennent au duc de Modène. Reggio est la capitale. (D.J.)
REGGIO
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Géographie moderne
- Affichages : 1457