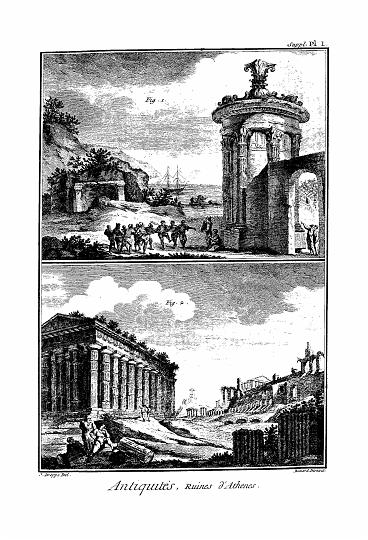(Géographie moderne) ville d'Italie, capitale de la république, et sur le golfe de même nom, au centre des Lagunes, à 1 lieue de la Terre-ferme, à 33 de Ravenne, à 40 au nord-est de Florence, à 50 au levant de Milan, à 87 au nord de Rome, et à 95 de Vienne en Autriche. Long. suivant Cassini, 30. 11. 30. lat. 45. 25. et Long. suivant Manfredi, 30. 12. 45. lat. 45. 33.
Elle doit sa naissance aux malheurs dont l'Italie fut affligée dans le cinquième siècle, par les ravages des Goths et des Visigoths. Quelques familles de Padoue se retirèrent à Rialto : les autres îles des Lagunes devinrent ensuite le refuge de ceux qui se dérobèrent aux fureurs d'Attila dans le sac d'Aquilée, et de quelques villes des environs, que le roi des Huns détruisit ; les misérables restes de toutes ces villes peuplèrent les îles des Lagunes, et y bâtirent des cabanes, qui furent les fondements de la superbe Venise, aujourd'hui l'une des plus belles, des plus considérables, et des plus puissantes villes de l'Europe.
De quelque endroit qu'on y aborde, soit du côté de la terre-ferme, soit du côté de la mer, l'aspect en est toujours également singulier. On commence à l'apercevoir de quelques milles de loin, comme si elle flottait sur la surface de la mer, et environnée d'une forêt de mâts de vaisseaux et de barques, qui laissent peu-à-peu distinguer ses principaux édifices, et en particulier ceux du palais et de la place de saint Marc.
Cette ville est toute bâtie sur pilotis, et a été fondée non-seulement dans les endroits où la mer parut au commencement découverte, mais encore où l'eau avait beaucoup de profondeur, afin qu'en rapprochant par ce moyen un grand nombre de petites îles qui environnaient celle de Rialto, qui était la principale, et les joignant par des ponts, on put en former le vaste corps de la ville, dont la grandeur, la situation et la majesté extérieure font un effet admirable. Tout le monde connait les beaux vers de Sannazar à la gloire de Venise, et elle a eu raison de les graver sur le marbre.
Viderat Adriaticis Venetam Neptunus in undis
Stare urbem, et toto dicère jura mari :
I, nunc tarpeias, quantùmvis Jupiter arces
Objice, et illa tui moenia Martis, ait.
Si Tiberim Pelago confers, urbem aspice utramque,
Illam homines dices, hanc posuisse deos.
Quoique Venise soit ouverte de toutes parts, sans portes, sans murailles, sans fortifications, sans citadelle et sans garnison ; elle est cependant une des plus fortes places de l'Europe. On y compte environ cent cinquante mille habitants, soixante-douze paroisses dont les églises sont fort petites, une trentaine de couvens de religieux, et au-moins autant de monastères de religieuses, outre plusieurs confrairies de pénitens, qu'on appelle écoles. Elle contient un assemblage prodigieux des plus beaux tableaux de la peinture ; elle possède tous ceux de Tintoret, de Paul Véronèse, et les plus précieux ouvrages du Titien.
Un très-grand nombre de canaux qui donnent de toutes parts entrée dans la ville, et la traversent de tous les sens, la divisent en une si grande quantité d'iles, qu'il y a des maisons seules entourées d'eau des quatre côtés ; mais s'il n'y a point d'endroits à Venise où l'on ne puisse aborder en gondole, il n'y en a guère aussi où l'on ne puisse aller à pied, par le moyen de plus de quatre cent ponts, qui procurent la communication d'un grand nombre de petites rues qui percent la ville, et de plusieurs quais qui bordent les canaux.
Il est vrai que la plupart de ces quais sont si peu larges, que deux personnes ont de la peine à passer de front ; les plus spacieux n'ont ni appui, ni balustrades, et sont coupés vis-à-vis de chaque maison par des marches qui descendent dans les canaux, afin de pouvoir entrer commodément dans les gondoles, et en sortir.
Ces fréquentes descentes qu'on appelle des rives, étrécissent si fort ces quais, que les passants sont obligés, surtout pendant la nuit, de se ranger près des maisons, pour ne pas s'exposer à tomber dans l'eau. La profondeur du grand canal est considérable ; mais celle des autres canaux n'est que de 5 à 6 pieds, lorsque par la marée l'eau est à la plus grande hauteur.
A l'égard des ponts, la plupart sont de pierre et de brique, et ils sont si délicatement bâtis, que l'arche n'a ordinairement que 8 pouces d'épaisseur. Les bords et le milieu sont de chaînes de pierre dure, et assez élevés pour donner passage aux gondoles et aux grandes barques, qui vont incessamment par les canaux. On y monte de chaque côté par quatre ou cinq marches d'une pierre blanche, qui approche de la nature du marbre, &qui devient si glissante, que pendant la pluie et la gelée, il est difficîle de s'empêcher de tomber ; et comme ces ponts n'ont point de garde-fous, la chute n'est pas peu dangereuse.
rien ne contribue davantage à la beauté de Venise, que son grand canal, qui a près de 2 milles de longueur, et 50 à 60 de largeur. Comme il fait plusieurs retours dans le milieu de la ville, on la traverse souvent deux à trois fois pour aller en gondole par le chemin le plus court d'un côté de la ville à l'autre. Son eau est toujours assez belle à cause de so profondeur, et du courant du flux et du reflux : les galeres et les grandes barques chargées y trouvent assez de fonds. Il est bordé des plus beaux palais ; mais outre qu'il lui manque un quai continué d'un bout à l'autre, les palais qui le bordent sont entremêlés de petites maisons qui les déparent.
Ce grand canal qui partage Venise en deux partie presque égales, n'a que le seul pont de Rialto qui se trouve au centre de la ville ; c'est un pont fort large, et tout bâti de pierres de taille aussi dures que le marbre ; il a couté 250000 ducats ; mais comme l'incommodité serait trop grande pour les habitants, si l'on était obligé d'aller chercher le pont toutes les fois qu'on veut passer d'un côté de la ville à l'autre, ily a de distance en distance dans toute la longueur du canal, des gondoliers établis par la police, pour porter les passants à un prix réglé en quelqu'endroit qu'ils veulent aller.
Toutes les rues sont pavées de briques, mises sur le côté ; et comme il n'y passe ni carrosses, ni chevaux, ni charettes, ni trainaux, on y marche fort commodément. Les bouts de chaque rue ont été tenus assez larges, et on a ménagé un grand nombre de petites places, outre celle que chaque église a devant son portail.
On a pratiqué dans toutes ces places, des citernes publiques d'eau de pluie, qui se ramasse dans des gouttières de pierre placées au haut des maisons, et tombe par des tuyaux dans les éponges des citernes. Ceux qui veulent avoir encore de meilleure eau et en plus grande quantité, en envaient remplir des bateaux dans la Brente, et la font jeter dans leurs citernes, où elle se purifie et devient très-bonne à boire.
La place de S. Marc fait du côté de la mer, le plus bel aspect de Venise. Il y a toujours vis-à-vis de cette place une galere armée, prête à défendre le palais dans quelque émotion populaire. Elle sert encore à l'apprentissage des forçats, dont on équipe les galeres de la république. Cette place est fermée du côté de l'orient par le palais ducal de S. Marc, qui est un gros bâtiment carré, enrichi de deux portiques l'un sur l'autre. On voit au premier étage de ce palais, un grand nombre de chambres dans lesquelles s'assemblent autant de différents magistrats pour y rendre la justice. La première rampe du second étage conduit aux appartements du doge ; la seconde mène aux salles du collège de prégadi, du scrutin, du conseil des dix, des inquisiteurs d'état, et du grand-conseil ; les murailles sont tapissées çà et là de tableaux des maîtres de l'école Lombarde, et d'autres célébres peintres.
L'église de S. Marc est proprement la chapelle du doge, et on y fait toutes les cérémonies solennelles. Cette église est collégiale, et n'a aucune juridiction au-dehors. Les vingt-six chanoines qui la composent, ainsi que le primicier ou le doyen du chapitre, sont à la nomination du doge ; c'est toujours un noble vénitien qui est pourvu de la dignité de primicier, dont le revenu est d'environ 5000 ducats, sans une abbaye qu'on y joint ordinairement.
L'église de S. Marc est remarquable par ses richesses qu'on appelle communément le trésor de Venise ; cependant il faut distinguer le trésor de l'église, du trésor de la république. Les reliques sont le trésor de l'église ; et parmi ces reliques, on voit des châsses d'or et d'argent enrichies de pierreries, avec une bonne quantité d'argenterie pour l'usage et pour l'ornement de l'autel.
Dans un lieu joignant celui où l'on garde les reliques, on voit les richesses du trésor de la république, arrangées sur les tablettes d'une grande armoire, dont le fonds est de velours noir, pour le faire éclater davantage. Une balustrade dans laquelle se tient le procurateur qui en a les clés, empêche qu'on ne puisse approcher d'assez près pour y atteindre de la main. Les richesses de ce trésor consistent en corcelets d'or, couronne ducale, quantité de vases d'agate, de cornaline, etc.
La république avait autrefois dans son trésor des richesses beaucoup plus considérables, entr'autres une chaîne d'or qu'on étendait le long du portique du palais, et douze à quinze millions d'or monnoyé qu'on étalait aux yeux du peuple dans certains jours de solennités ; mais la guerre de Candie a épuisé et le prix de la chaîne, et les douze ou quinze millions d'or monnoyés.
L'arsenal de Venise est le fondement des forces de l'état. Son enceinte est fermée de murailles, flanquées de petites tours. On fabrique dans cette enceinte les vaisseaux, les galeres, et les galéasses. Les salles de l'arsenal sont remplies de toutes sortes d'armes, pour les troupes de terre et de mer. Sous ces mêmes salles sont des magasins séparés qui contiennent toutes sortes d'attirail et d'équipage de guerre. L'arsenal se gouverne comme une petite république. On y fait bonne garde, et les ouvriers y travaillent sous l'autorité de trois nobles vénitiens, qui résident dans l'arsenal, et qu'on ne change que tous les trois ans. La république entretient ordinairement trois ou quatre cent ouvriers dans son arsenal pendant la paix.
Outre les avantages que Venise partage avec les autres villes maritimes, elle en retire encore un particulier de sa situation au milieu des lagunes, qui sont comme le centre où aboutissent diverses rivières, entr'autres le Pô, l'Adige, la Brente, la Piave, et quantité de canaux que la république a fait creuser pour le commerce étranger, commerce sans lequel Venise serait bientôt misérable, et qui même est à présent réduit à celui d'Allemagne et de Constantinople : mais la banque de Venise dont le fonds est fixé à cinq millions de ducats, conserve encore son crédit.
Les Venitiens, suivant la coutume fanfaronne d'Italie, ont donné une description superbe de leur capitale, sous le titre de Splendor orbis Venetiarum, 2. vol. in-fol. avec figures. Crasso (Lorenzo) a de son côté publié en italien les éloges des hommes de Lettres nés à Venise ; cette bibliographie parut en 1666, en 2. vol. in 4 °. Il est certain que Venise a produit depuis la renaissance des Lettres des savants distingués en tout genre ; on en jugera par mon triage.
Entre les papes natifs de cette ville, j'y trouve Eugène IV. Paul II. et Alexandre VIII.
Eugène IV. appelé auparavant Gabrieli Condolmerio, était d'une famille obscure ; il fut élu cardinal en 1408, et pape en 1431, pendant la tenue du concîle de Bâle. Les pères de ce concîle déclarèrent que le pontife de Rome n'avait ni le droit de dissoudre leur assemblée, ni même celui de la transférer. Sur cette déclaration Eugène pour marquer sa puissance, ordonna la dissolution du concile, en convoqua un nouveau à Ferrare, et ensuite à Florence, où l'empereur grec, son patriarche, et plusieurs des prélats grecs, signèrent le grand point de la primatie de Rome. Dans le temps qu'Eugène rendait ce service aux Latins en 1439 ; le concîle de Bâle le déposa du pontificat, et élut Amédée VIII. duc de Savoye, qui s'était fait hermite à Ripaille par une dévotion que le Poggio est bien loin de croire réelle. Cet anti-pape prit le nom de Félix V. et dix ans après, il donna son abdication, qui lui procura de Nicolas V. un indult par lequel le pape s'engage de ne nommer à aucun bénéfice consistorial dans ses états, sans le consentement du souverain ; Eugène mourut en 1447.
Paul II. en son nom Pierre Barbo, neveu par sa mère d'Eugène IV. succéda à Pie II. l'an 1464, et mourut d'apopléxie l'an 1471, à 54 ans. Platine qu'il avait dépouillé de tous ses biens, et mis deux fois très-injustement en prison, ne l'a point ménagé dans ses écrits. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce pape n'aimait pas les gens de Lettres, et qu'il supprima le collège des abréviateurs, composé des plus beaux esprits de Rome : Humanitatis studia ita oderat, ut ejus studiosos uno nomine haereticos appelaret. Il étendit la bulle des cas réservés aux papes, beaucoup plus loin que ses prédécesseurs, afin de s'enrichir davantage. Il obligea les cardinaux de signer toutes les bulles sans leur en donner aucune connaissance. Il envoya en France en 1467, le cardinal d'Arras, pour faire vérifier au parlement les lettres-patentes, par lesquelles le roi Louis XI. avait aboli la pragmatique-sanction ; mais le procureur général et l'université de Paris s'opposèrent à cet enregistrement. C'est encore Paul II. qui par une bulle du 19 Avril 1470, réduisit le jubilé à 25 ans, en espérance, dit Du-Plessis Mornay, de jouir de cette foire l'an 1475 ; mais ce fut son successeur Sixte IV. qui en tira le profit.
Alexandre VIII. de son nom Pierre Ottoboni, succéda à 79 ans au pape Innocent XI. en 1689, et mourut deux ans après. Il avait en mourant fait deux choses ; 1°. fulminé une bulle contre l'assemblée du clergé de France, tenue en 1682, et 2°. distribué à ses neveux tout ce qu'il avait amassé d'argent. Ce dernier trait de sa vie fit dire à Pasquin, qu'il aurait mieux valu pour l'Eglise être sa nièce que sa fille.
Passons aux savants nés à Venise : je trouve d'abord les Barbaro ; et si leur famille n'est pas une des vingtquatre nobles, elle est du-moins la plus illustre dans les Lettres.
Barbarus (Français) réunit les sciences au maniment des affaires d'état ; en même temps qu'il rendit de grands services à sa patrie, il traduisit du grec la vie d'Aristide et de Caton, après avoir donné son ouvrage de re uxoriâ ; il mourut l'an 1454.
La même année naquit son petit-fils Barbarus (Hermolaus) un des savants hommes de son siècle. Les emplois publics dont il fut chargé de très-bonne heure auprès de l'empereur Frédéric, et de Maximilien son fils, ne le détournèrent point de l'étude. Il traduisit du grec plusieurs ouvrages d'Aristote, ainsi que Dioscoride, qu'il mit au jour avec un docte commentaire. Il était ambassadeur de Venise auprès d'Innocent VIII. lorsque le patriarche d'Aquilée vint à mourir. Aussi-tôt le pape lui conféra cette place, qu'il eut l'imprudence d'accepter sans le consentement de ses supérieurs ; la république fut irritée, le bannit, et confisqua ses biens. Cependant il n'étudia jamais avec tant d'application que depuis que sa patrie l'eut maltraité. Sa disgrace nous a procuré le meilleur de ses ouvrages, son édition de Pline, publiée l'an 1492 ; il y corrigea près de cinq mille passages ; il a rompu la glace, et s'il a souvent fait des plaies à son auteur, il l'a aussi très-souvent rétabli ; il mourut à Rome l'an 1493.
Barbarus (Daniel) mort en 1569, à l'âge de 41 ans, avait été ambassadeur en Angleterre, et fut un des pères du concîle de Trente. Il a donné la prattica della perspettiva, Venise 1559 ; et il mit au jour dans la même ville l'an 1567, un commentaire sur Vitruve. Il était en même temps si prévenu pour Aristote, qu'il lui aurait volontiers prêté serment de fidélité, s'il n'avait pas été chrétien.
Bembo (Pierre) en latin Bembus, noble vénitien, l'un des plus polis écrivains du XVIe siècle, naquit en 1470. Il parut beaucoup à la cour du duc de Ferrare, et à celle du duc d'Urbin, qui étaient alors le rendez-vous des plus beaux esprits. Léon X. le nomma son sécretaire avec Sadolet, avant que de sortir du conclave, où il fut promu à la papauté. Paul III. le créa cardinal en 1538, et lui donna un évêché ; il mourut l'an 1547, dans sa 77 année ; Jean de la Caza a écrit sa vie.
Son premier livre est un traité latin, de monte Aetna, qui parut l'an 1486 : à l'âge de vingt-six ans, il écrivit gli Azolani, qui sont des discours d'amour, ainsi nommés, parce qu'on suppose qu'ils furent faits dans le château d'Azolo. Ils ont été traduits en français en 1545 ; on le blâme justement d'avoir donné cet ouvrage, et d'autres poésies encore plus licencieuses, que Scaliger appelait elegantissimas obscaenitates. Nous parlerons de son histoire de Venise à l'article de cette république.
Egnatio (Jean-Baptiste) en latin Egnatius ; célèbre humaniste du XVIe siècle, était disciple d'Ange Politien. Il enseigna les Belles-Lettres dans Venise sa patrie avec une réputation extraordinaire, et n'obtint que dans un âge décrépit la démission de son emploi ; mais on lui conserva une pension de deux cent écus de rente, ducentos aureos nummos, et ses biens furent affranchis de toutes sortes d'impôts. Il laissa sa petite fortune, sa belle bibliothèque, son cabinet de médailles, et sa collection d'antiques, à trois illustres familles de Venise ; il mourut en 1553, âgé de 80 ans.
Ses ouvrages sont 1°. de romanis principibus vel Caesaribus, libri tres. L'abbé de Marolles a traduit ce livre en français l'an 1664, 2°. de Origine Turcarum, 3°. observationes in Ovidium ; 4°. Interpretamenta in familiares epistolas Ciceronis ; 5°. de exemplis illustrium virorum, etc. Mais il parlait mieux qu'il n'écrivait, et ne mérite pas dans ses livres la qualité de cicéronien qu'on lui a donnée.
Corradus rapporte un fait assez curieux sur la facilité de son élocution. Egnatius étant sur le point de finir une harangue, vit entrer le nonce du pape dans l'auditoire ; il recommença son discours, le répéta tout différemment, et avec encore plus d'éloquence que la première fois ; de sorte que ses amis lui conseillèrent de continuer ses harangues, ses leçons, et de ne plus écrire.
Paul et Alde Manuce, ont fait beaucoup d'honneur à leur patrie par leur érudition. Le premier né en 1512, fut nommé par Pie IV. chef de l'Imprimerie apostolique ; il mourut en 1574, à 62 ans. On a de lui, 1°. une édition estimée des œuvres de Cicéron avec des notes et des commentaires : 2°. des épitres en latin et en italien ; 3°. les traités de legibus romanis ; de dierum apud Romanos vetères ratione ; de senatu romano ; de civitate romanâ ; de comitiis Romanorum.
Manuce (Alde) dit le jeune, fils de Paul, et petit-fils d'Alde Manuce, le premier imprimeur de son temps, surpassa la réputation de son père. Il vint à Rome, où il enseigna les humanités, mais avec si peu de profit, qu'il fut obligé pour vivre de vendre la magnifique bibliothèque que son père, son ayeul, et ses grands-oncles, avaient recueillie avec un soin extrême, et qui, dit-on, contenait quatre-vingt mille volumes. Il mourut en 1597, sans autre récompense que les éloges dû. à son mérite. Ses ouvrages principaux, sont des commentaires sur Cicéron, et sur l'art poétique d'Horace, de quaesitis per epistolas libri tres ; commentarius de orthographiâ ; Tractatus de notis veterum, et d'autres livres sur les Belles-Lettres en latin et en italien.
Fra-Paolo Sarpi (Marco) que nous nommons en français le père Paul, est un des hommes illustres dont Venise a le plus de raison de se glorifier. Il naquit en 1552, et montra dès son enfance deux qualités qu'on voit rarement réunies, une mémoire prodigieuse, et un jugement exquis ; il prit l'havit de servite en 1566, et s'appliqua profondément à l'étude des Langues, de l'Histoire, du Droit canon, et de la Théologie ; ensuite il étudia la Philosophie expérimentale, et l'Anatomie. Il fut tiré de son cabinet pour entrer dans les affaires politiques, à l'occasion du fameux différend qui s'éleva entre la république de Venise, et la cour de Rome, au sujet des immunités ecclésiastiques.
Le père Paul choisi par la république pour son théologien, et l'un de ses consulteurs, prit la plume pour la défense de l'état, et écrivit une pièce sur l'excommunication. Cette pièce a paru en français sous le titre de droit des souverains, défendu contre les excommunications, etc. mais dans l'italien, elle est intitulée : Consolation de l'esprit pour tranquilliser les consciences de ceux qui vivent bien, contre les frayeurs de l'interdit publié par Paul V. Il mit au jour plusieurs écrits à l'appui de cet ouvrage, et fit un traité sur l'immunité des lieux sacrés dans l'étendue de la domination vénitienne.
Il eut la plus grande part au traité de l'interdit publié au nom des sept théologiens de la république, dans lequel on prouve en dix-neuf propositions, que cet interdit était contre toutes les lois, que les ecclésiastiques ne pouvaient y déférer avec innocence, et que les souverains en devaient absolument empêcher l'exécution. La cour de Rome le fit citer à comparaitre ; au lieu d'obéir, il publia un manifeste pour prouver l'invalidité de la citation.
Le différend entre la république de Venise et le pape, ayant été terminé en 1607, le père Paul fut compris dans l'accommodement ; mais quelques mois après, il fut attaqué en rentrant dans son monastère, par cinq assassins qui lui donnèrent quinze coups de stylets ; dont il n'y en eut que trois qui le blessèrent dangereusement, deux dans le col et un au visage.
Le sénat se sépara sur le champ à la nouvelle de cet attentat, et la même nuit les sénateurs se rendirent au couvent des Servites, pour les ordres nécessaires aux pansements du malade. On ordonna qu'il serait visité chaque jour par les magistrats de semaine, outre le compte que les médecins viendraient en rendre journellement au sénat. On décerna des récompenses à quiconque indiquerait les assassins, ou tuerait quelqu'un qui voudrait attenter désormais à la vie du père Paul, ou découvrirait quelque conspiration contre sa personne. Enfin après sa guérison, le sénat lui permit de se faire accompagner par des gens armés, et pour augmenter sa sûreté, lui assigna une maison près de S. Marc. La république créa chevalier Aquapendente qui l'avait guéri, et lui fit présent d'une riche chaîne et d'une médaille d'or. C'est ainsi que le sénat montra l'intérêt qu'il prenait à la conservation de ce grand homme, et lui-même prit le parti de vivre plus retiré du monde qu'il n'avait encore fait.
Dans sa retraite volontaire, il écrivit son histoire immortelle du concîle de Trente, dont il avait commencé à recueillir les matériaux depuis très-longtemps. Cette histoire fut imprimée pour la première fois à Londres en 1619, in-fol. et dédiée au roi Jaques I. par l'archevêque de Spalatro. Elle a été depuis traduite en latin, en anglais, en français, et en d'autres langues ; le père le Courayer en a donné une nouvelle traduction française, imprimée à Londres en 1736, en deux volumes in-fol. et réimprimée à Amsterdam la même année, en deux volumes in-4°. c'est une traduction précieuse.
Le style et la narration de cet ouvrage sont si naturels et si mâles, les intrigues y sont si bien développées, et l'auteur y a semé par-tout des réflexions si judicieuses, qu'on le regarde généralement comme le plus excellent morceau d'histoire d'Italie. Fra-Paolo a été très-exactement informé des faits, par les archives de la république de Venise, et par quantité de mémoires de prélats qui s'étaient trouvés à Trente.
Le cardinal Pallavicini n'a remporté d'approbation que celle de la cour de Rome. Il s'avisa trop tard de nous fabriquer l'histoire du concîle de Trente., et sa conduite nous a dispensé d'ajouter foi à ses discours. Il est vrai qu'il nous parle des archives du Vatican, qu'on lui a communiquées, mais c'est une affaire dont on croit ce que l'on veut, surtout quand les pièces ne sont pas publiques ; ajoutez que les sources du Vatican ne sont pas des sources fort pures. Le style pompeux du Pallavicini tombe en pure perte, et la manière dont il traite Fra-Paolo, ne lui a pas acquis des suffrages. On dit qu'en échange des fautes réelles, il a saisi celles d'impression, pour en faire des erreurs à l'auteur.
Le nom de Paolo était devenu si fameux dans toute l'Europe, que les étrangers venaient en Italie pour le voir ; que deux rois tâchèrent par des offres fort avantageuses, de l'attirer dans leurs états ; et que divers princes lui firent l'honneur de lui rendre visite. Je ne dois point oublier dans ce nombre le prince de Condé, qui étant journellement admis aux délibérations du sénat, obtint de ce corps la permission de voir et d'entretenir le fameux Servite, qui s'occupait dans son couvent de choses plus importantes que d'affaires monastiques.
Je sai bien que le cardinal du Perron dit en parlant du père Paul, " je n'ai rien trouvé d'éminent dans ce personnage, et n'ai Ve rien en lui que de commun " ; mais ce jugement sur un homme si supérieur en toutes choses à celui qui le tenait, est inepte, ridicule, plein de malignité et de fausseté.
Paolo mourut couvert de gloire le 14 Janvier 1623. âgé de 71 ans, ayant conservé son jugement et son esprit jusqu'au dernier soupir ; il se leva, s'habilla lui même, lut, et écrivit comme de coutume la veille de sa mort. On lui fit des funérailles très-distinguées. Le sénat lui éleva un monument, et Jean-Antoine Vénério, patrice vénitien, composa l'épitaphe qu'on y grava. Quoique plusieurs rois et princes souhaitassent d'avoir son portrait, il s'excusa constamment de se faire peindre, et même il le refusa à son intime ami Dominique Molini.
Mais voici ce qu'écrivit le chevalier Henri Wotton, dans sa lettre du 17 Janvier 1637, au docteur Collins professeur en théologie à Cambridge. " Puisque je trouve une bonne occasion, Monsieur, si peu de temps après celui où les amis ont coutume de se faire de petits présents d'amitié, permettez-moi de vous envoyer en guise d'étrennes, une pièce qui mérite d'avoir une place honorable chez vous, c'est le portrait au naturel du fameux père Paul, servite, que j'ai fait tirer par un peintre que je lui envoyai, ma maison étant voisine de son monastère. J'y ai depuis mis au bas un titre de ma façon, Concilii tridentini eviscerator : vous verrez qu'il a une cicatrice au visage, qui lui est restée de l'assassinat que la cour de Rome a tenté, un soir qu'il s'en retournait à son couvent : (reliquiae wottonianae) ".
Fra-Paolo, dit le P. le Courayer, à l'imitation d'Erasme, de Cassander, de M. de Thou, et autres grands hommes, observait de la religion romaine, tout ce qu'il en pouvait pratiquer sans blesser sa conscience ; et dans les choses dont il croyait pouvoir s'abstenir par scrupule, il avait soin de ne point scandaliser les faibles. Egalement éloigné de tout extrême, il désapprouvait les abus des Catholiques, et blâmait la trop grande chaleur des Protestants. Il désirait la réformation des papes, et non leur destruction ; il en voulait à leurs abus, et non à leur place ; il était ennemi de la superstition, mais il adoptait les cérémonies ; il s'asservissait sans répugnance à l'autorité de l'église dans toutes les choses de rit et de discipline, mais il souhaitait aussi qu'on les rectifiât ; il haïssait la persécution, mais il condamnait le schisme ; il était catholique en gros, et protestant en détail ; il abhorrait l'inquisition comme le plus grand obstacle aux progrès de la vérité. Enfin il regardait la réformation comme le seul moyen d'abaisser Rome, et l'abaissement de Rome, comme l'unique voie de faire refleurir la pureté de la religion.
Sa vie a été donnée par le père Fulgence, et par le père le Courayer : on peut y joindre son article, qui est dans le dictionnaire historique et critique de M. Chaufepié. M. Amelot de la Houssaye a traduit avec des remarques le traité des bénéfices ecclésiastiques de Fra-Paolo. Il y a une traduction anglaise du même ouvrage, par Thomas Jenkins, lord-maire d'Yorck, avec une nouvelle vie du père Paul, par M. Lockman, Londres 1736, in-8°. Les lettres de Fra-Paolo ont été traduites de l'italien en anglais, par M. Edouard Brown, et cette traduction a paru à Londres en 1693. in-8°.
Paruta (Paul), célèbre écrivain politique du seizième siècle, naquit à Venise en 1540. passa par toutes les grandes charges de sa patrie, fut honoré de plusieurs ambassades, et mourut procurateur de S. Marc, l'an 1598, âgé de 59 ans. M. de Thou fait un grand éloge de Paruta : c'était, dit-il, un homme d'une rare éloquence, et qui démêlait avec beaucoup d'adresse les affaires les plus embarrassées. Vir rarâ in explicandis negotiis solertiâ et eloquentiâ ; quas virtutes variis legationibus in Italia.... exercuit, et scriptis quae magno in pretio inter prudentiae civilis sectatores merito habentur, consignavit.
L'ouvrage de Paruta, intitulé della perfettione della vita politica, libri tre, parut à Venise en 1579, infol. 1586, in-12. 1592, in-4 °. outre plusieurs autres éditions. Il a été traduit en français par Gilbert de la Brosse, sous le titre de perfection de la vie politique, Paris 1682, in-4 °. Il y en a aussi une traduction anglaise, par Henry Cary, comte de Monmouth, imprimée à Londres en 1657, in-4°.
Un autre de ses ouvrages est : Discorsi politici, ne i quali si consideranno diversi fatti illustri e memorabili de principi e di republiche antiche e moderne, divisi in due libri. Venise 1599, in-4°. Genèse1600, in-4°. et Venise 1629, in-4°. Samuel Sturmius en a donné une traduction latine à Brême en 1660, in-12. Le premier livre contient quinze discours, qui roulent sur la forme des anciens états ; le second en renferme dix, qui traitent des assaires de la république de Venise, et des choses arrivées dans les derniers temps. Cet ouvrage et le précédent ont mérité à l'auteur la qualité d'excellent politique.
Je parlerai de son histoire de Venise, en italien, à la fin de l'article de cette république ; c'est assez de dire ici qu'on peut puiser dans tous les ouvrages de cet historiographe, des maximes judicieuses et pleines d'équité pour le gouvernement des états. De-là vient que Boccalini le représente enseignant la politique, et les vertus morales sur le parnasse. Le père Niceron a donné son article dans les Mémoires des hommes illustres, tom. XI. p. 288.
Ramusio (Jean-Baptiste), fut employé par la république de Venise, pendant quarante ans, dans les affaires, et mourut à Padoue l'an 1557, âgé de 72 ans. Il a publié trois volumes de navigations décrites par divers auteurs. Le premier contient la description de l'Afrique ; le second comprend l'histoire de la Tartarie ; le troisième concerne les navigations au nouveau monde. Le total renferme un recueil d'anciens voyages estimés.
Trivisano (Bernard), naquit à Venise en 1652, et s'avança par son mérite aux dignités de sa patrie. Il mourut en 1720, âgé à-peu-près de 69 ans. Son ouvrage le plus considérable parut à Venise en 1704, in-4°. sous le titre de Meditazioni filosofiche, dont Bayle parle avec éloge. Cet auteur, dit-il, n'a point trouvé d'autre voie pour se tirer d'embarras sur la prédestination, que d'élever au-dessus des nues, les privilèges de la liberté humaine. Voyez de plus grands détails dans le Giorn. del' letter. tom. XXXIV. pag. 4. et suiv.
Aux hommes illustres dans les lettres, dont Venise est la patrie, j'ajoute une dame célèbre qui reçut le jour dans cette ville vers l'an 1363, je veux parler de Christine de Pisan, sur laquelle la France a des droits. J'aurais dû commencer ma liste par cette dame, mais elle couronnera l'article de Venise, et l'embellira beaucoup, grâce au détail de sa vie, que j'emprunterai d'un mémoire de M. Boivin le cadet, inseré dans le Recueil de littérature, tom. II. in-4°. pag. 704.
Thomas Pisan, père de Christine, né à Boulogne en Italie, était le philosophe le plus renommé, et peut-être le plus habîle de son siècle. Il vint à Venise, s'y maria, et y fut agrégé au nombre des sénateurs. Il y vivait honorablement dans le temps que sa femme lui donna une fille qui fut nommée Christine ; mais la célébrité du père devint si grande, qu'on le sollicita de la part des rois de France et de Hongrie, de s'attacher à leur service, et l'on lui offrit des conditions fort avantageuses, en considération de son profond savoir.
Thomas Pisan se détermina pour la France, tant à cause du mérite personnel de Charles le Sage, et de la magnificence de sa cour, que par le désir de voir l'université de Paris ; cependant il ne se proposa d'abord que de passer un an dans cette capitale, et laissa sa femme et ses enfants à Boulogne.
Le roi fut charmé de le voir, et ayant connu son mérite, lui donna une place dans son conseil. Ce prince, bien-loin de consentir qu'il retournât au-bout d'un an en Italie, voulut absolument qu'il fit venir sa famille en France, et qu'il s'y établit pour y vivre honorablement des bienfaits dont il avait dessein de le combler. Thomas obéit, et sa famille passa en France. La femme et les enfants de cet astronome, habillés magnifiquement à la lombarde, parurent devant le roi qui les reçut très-gracieusement dans son château du louvre, un jour du mois de Décembre (vers l'an 1368), fort peu de temps après leur arrivée.
Christine qui pouvait avoir alors environ cinq ans, fut élevée à la cour en fille de qualité, et son père cultiva son esprit par l'étude des lettres humaines. Elle fut recherchée en mariage dans sa première jeunesse, par plusieurs personnes, mais un jeune homme de Picardie, nommé Etienne du Castel, qui avait de la naissance, du savoir, et de la probité, l'emporta sur tous ses rivaux. Il épousa Christine qui n'avait encore que quinze ans ; et bientôt après il fut pourvu de la charge de notaire et secrétaire du roi, qu'il exerça avec honneur, aimé et considéré du roi Charles V. son maître.
Christine fut fort satisfaite du choix que son père avait fait d'un tel gendre. Voici de quelle manière elle s'exprime, parlant elle-même de son mariage. " A venir au point de mes fortunes, le temps vint que je approchoie l'aage auquel on seult les filles asséner de mari ; tout fusse-je ancore assez jeunette, nonobstant que par chevaliers, autres nobles, et riches clercs, fusse de plusieurs demandée, (& cette vérité ne soit de nul reputée ventence : car l'auctorité de l'onneur et grant amour que le roy à mon père démontrait, estait de ce cause, non mie valeur). Comme mondit père reputast cellui plus valable, qui le plus science avec bonnes mœurs avait ; ainsi un jone escolier gradué, bien né, et de nobles parents de Picardie, de qui les vertus passaient la richece, à cellui qu'il réputa comme propre fils, je fus donnée. En ce cas ne me plains-je de fortune : car à droit eslire en toutes convenables grâces, si comme autrefois ai dit, à mon gré mieux ne voulsisse. Cellui, pour sa souffisance, tost après nostre susdit bon prince, qui l'ot agréable, lui donna l'office, comme il fut vaquant, de notaire, et son secrétaire à bourses et à gages, et retint de sa cour très-amé serviteur. "
La félicité des nouveaux époux ne fut pas longue. Le roi Charles mourut l'an 1380, âgé de 44 ans. L'astronome déchut de son crédit : on lui retrancha une grande partie de ses gages ; le reste fut mal payé. On peut juger de l'estime que Charles faisait de cet officier par les pensions qu'il lui donnait. Thomas était payé tous les mois de cent francs de gages, c'est-à-dire, si je ne me trompe, de près de 700 liv. par rapport à la monnaie d'aujourd'hui. Ses livrées et les gratifications qu'il recevait n'allaient à guère moins ; et par-dessus tout cela, on lui faisait encore espérer un fonds de terre de 500 livres de revenu (3500 liv. de notre temps), pour lui et pour ses héritiers ; l'astronomie, et particulièrement celle que l'on nomme judiciaire, était à la mode dans ces temps-là, où la plupart des princes, même ceux qui avaient de la piété, étaient tellement prévenus en faveur de cette science superstitieuse, qu'ils n'entreprenaient rien de considérable qu'après l'avoir consultée.
La vieillesse, accompagnée de chagrins et d'infirmités, mit au tombeau Thomas Pisan quelques années après la mort du roi son bienfaiteur. Etienne du Castel, gendre de Thomas, se trouva le chef de sa famille. Il la soutenait encore par sa bonne conduite et par le crédit que sa charge lui donnait, lorsqu'il fut emporté lui-même par une maladie contagieuse en 1389, à l'âge de 34 ans. Christine qui n'en avait alors que vingt-cinq, demeura veuve chargée de trois enfants et de tous les embarras d'un gros ménage. " Or me convint, dit-elle, mettre main à œuvre, ce que moi nourrie en délices et mignotements n'avoïe appris, et être conduisaresse de la nef demourée en la mer ourageuse sans patron ; c'est à savoir le désolé mainage hors de son lieu et pays. A donc m'essourdirent angoisses de toutes pars. Et comme ce soient les més de veufves, plais et procès m'avironérent de tous lez ; et ceux qui me devaient m'assaillirent, afin que ne m'avançasse de leur rien demander ".
Le veuvage de Christine fut effectivement traversé d'une infinité de soins et de disgraces. Elle en passa les premières années à la poursuite des procès qu'elle fut obligée d'intenter contre les débiteurs de mauvaise foi, ou de soutenir contre des chicaneurs qui lui faisaient d'injustes demandes. Enfin après avoir couru longtemps de tribunal en tribunal sans obtenir justice, rebutée par les grosses pertes qu'elle faisait tous les jours, et lasse de mener une vie si contraire à son inclination, elle prit le parti de se renfermer dans son cabinet, et ne chercha plus de consolation que dans la lecture des livres que son père et son mari lui avaient laissés.
Elle-même nous apprend dans son style agréable et naïf, de quelle manière elle se conduisit pour se remettre à l'étude. " Ne me pris pas, dit-elle, comme présomptueuse aux parfondesses des sciences obscures, etc. Ains, comme l'enfant, que au premier on met à l'a, b, c, d, me pris aux histoires anciennes des commencements du monde ; les histoires des Ebrieux, des Assiriens, et des principes des signouries, procédant de l'une en l'autre, dessendant aux Romains, des Français, des Bretons, et autres plusieurs historiographes : après aus déductions des sciences, selon ce que en l'espace du temps y estudia en pos comprendre : puis me pris aus livres des poètes ".
Elle ajoute que le style et les fictions poétiques lui plurent extrêmement. " A donc, dit-elle, fus-je aise, quand j'os trouvé le style à moi naturel, me délitant en leurs soubtiles couvertures, et belles matières, mutiées sous fictions délitables et morales ; et le bel style de leurs mettres et prose, déduite par belle et polie rhétorique ".
Instruite suffisamment de l'histoire et de la fable, et se sentant capable de produire quelque chose d'elle-même, elle suivit son génie, et se mit à la composition en l'année 1399, étant âgée de 35 ans. Six ans après, elle publia le livre intitulé, vision de Christine, dans lequel elle assure qu'elle avait déjà composé quinze volumes. " Depuis l'an 1399, dit-elle, que je commençay jusques à cestui 1405, ouquel encores je ne cesse compilés en ce tandis quinze volumes principaulx, sans les autres particuliers petis dictiez, lesquieulx tous ensemble contiennent environ LXX quayers de grants volume, comme l'expérience en est magnifeste ".
Ses premiers ouvrages furent ce qu'elle appelle de petits dictiés, c'est-à-dire de petites pièces de poésie, des ballades, des lais, des virelais, des rondeaux. Elle avait commencé à en faire dès le temps même de ses procès et des plus grands embarras de son veuvage. La ballade où elle se plaint de ce que les princes ne la daignent entendre est de ces temps-là. C'est elle-même qui nous l'apprend dans le récit de ses bonnes et de ses mauvaises fortunes, où elle dit encore expressément qu'au milieu de ses adversités et de ses plus cruels chagrins elle ne laissait pas de faire des vers. " Ne m'avait ancores tant grévée fortune que ne fusse, dit-elle, accompagnée des musettes des poètes.... Icelles me faisaient rimer complaintes plourables, regraitant mon ami mort, et le bon temps passé, si comme il appert au commencement de mes premiers dictiés ou principe de mes cent ballades, et meismement pour passer temps et pour aucune gayeté attraire à mon cuer douloureux, faire dis amoureux et gays d'autruy sentement, comme je dis en un mien virelay ".
Ce fut apparemment à l'occasion de ces dis amoureux que la médisance publia par-tout que cette veuve était véritablement folle d'amour. Il est vrai que dans ces petites pièces que Christine avoue, il y en a de fort tendres, et que si elle n'avait eu soin d'avertir ses lecteurs, que les sentiments qu'elle y exprime ne sont pas les siens, mais ceux d'autrui, il n'y aurait personne qui n'y fût trompé.
Les mauvais discours que l'on fit d'elle à ce sujet lui donnèrent du chagrin, comme elle le témoigne dans le troisième livre de sa vision. " Ne fu-il pas dit de moi par toute la ville que je amoie par amours, dit-elle. Je te jure m'ame, que icelui ne me cognaisçait, ne, ne savait que je estoie : ne fu onques homme ne créature née qui me veist en public, ne en privé, en lieu où il fut.... Et de ce me soit Dieu tesmoing que je dis voir.... Dont comme celle qui ignocent me sentoie aucune fais, quand on me le disait m'en troubloie, et aucune fois m'en sousrioye, disant, Dieu et icelluy et moi savons bien qu'il n'en est rien ".
Christine eut donc beaucoup à souffrir de la médisance qui attaquait sa réputation ; mais elle put se consoler par son innocence et par le succès de ses ouvrages. Les premières productions de sa muse lui acquirent l'estime non-seulement des Français, mais des étrangers. Le comte de Salisbury, favori de Richard II. roi d'Angleterre, étant venu en France, à l'occasion du mariage de ce prince avec Isabelle, fille de Charles VI. fit connaissance avec Christine, dont les ouvrages lui avaient plu : comme il aimait la poésie, et faisait lui-même des vers, gracieux chevalier, aimant dictiez, et lui-même gracieux dicteur, cette conformité de goût fit qu'il conçut beaucoup d'affection pour Christine ; et lui voyant un fils qu'elle cherchait à placer, il lui offrit de l'emmener avec lui en Angleterre, et de le faire élever avec le sien. Christine y consentit, et son fils, pour lors âgé de treize ans, passa en Angleterre avec ce seigneur anglais en 1398.
A quelque temps de-là, Richard fut détrôné par Henri de Lancastre, et le comte de Salisbury fut décapité, pour sa grant loyauté vers son droit seigneur. Cependant Henri qui venait d'usurper la couronne, vit les dictiés et autres ouvrages que Christine avait envoyés au comte de Salisbury ; il en fut si content, qu'il chercha dès-lors tous les moyens d'attirer à sa cour cette illustre veuve. Ecoutons la raconter ce fait elle-même dans son charmant langage.
" A donc très-joyeusement prist mon enfant vers lui, et tint chièrement et en très-bon estat. Et de fait par deux de ses héraulx, notables hommes venus par-deçà, Lencastre et Faucon, rois d'armes, me manda moult à certes, priant et promettant du bien largement que par-delà je allasse. Et comme de ce, je ne fusse en rien temptée, considérant les choses comme elles étaient, dissimulé tant que mon fils pusse avoir disant grant mercis, et que bien à son commandement estoie ; et à brief parler, tant fit à grant peine et de mes livres me cousta, que congié ot mondit fils de me venir quérir par-deçà pour mener là, qui ancore n'y vais. Et ainsi reffusay l'eschoite de icelle fortune pour moy et pour lui, parce que je ne puis croire que fin de desloyal viengne à bon terme. Or fut joyeuse de voir cil que je amoie, comme mort le m'eust seul fils laissié, et trois ans sans lui os esté ".
Si Christine avait été d'humeur à quitter la France, elle aurait trouvé des établissements dans plus d'une cour étrangère ; mais elle aima mieux demeurer dans ce pays, où d'ailleurs elle était considérée par tous les princes du royaume. Elle s'attacha d'abord d'une façon toute particulière à Philippe, duc de Bourgogne, qui lui donna des marques réelles de son estime en prenant à son service le fils ainé de cette dame nouvellement revenu d'Angleterre, et en lui fournissant à elle-même pendant quelque temps de quoi soutenir son état ; mais elle perdit ce protecteur en 1404, et sa mort, dit-elle, fut le renouvellement des navreures de mes adversités.
La réputation qu'elle s'était acquise et la faveur des grands ne l'avaient pourtant pas mise à son aise. La mauvaise foi de ses débiteurs et la perte de plusieurs procès l'avaient réduite en un état où elle avait besoin non-seulement de protection, mais de secours. Elle avait à sa charge une mère âgée, un fils hors de place, et de pauvres parentes. Elle dit qu'elle était trois fois double, c'est-à-dire qu'elle avait six personnes sur les bras. Avec tout cela elle avoue qu'elle conservait un reste d'ambition fondée sur le souvenir de sa naissance et de son ancien état, et que sa plus grande crainte était de découvrir aux yeux du public le délabrement de ses affaires. " Si te promets, dit-elle à dame Philosophie, que mes semblans et abis, peu apparait entregens le faissel de mes ennuys : ains soubs mantel fourré de gris et soubs surcot d'escarlate n'ont pas souvent renouvellé, mais bien gardé, avoie espesses fois de grands friçons ; et en beau lit et bien ordené, de males nuis : mais le repas estait sobre, comme il affière à femme vefve, et toutes fois vivre convient ".
Au reste quelque soin qu'elle prit de cacher son indigence, il était impossible que l'on ne s'en aperçut ; et c'est, à ce qu'elle assure, ce qui lui faisait le plus de peine, lorsqu'elle était obligée d'emprunter de l'argent, même de ses meilleurs amis. " Mais quand il convenait, dit-elle, que je feisse aucun emprunt où que soit pour eschever plus grant inconvénient, beau sire dieux, comment honteusement à face rougie, tant fust la personne de mon amistié, le requeroïe, et ancore aujourd'hui ne suis garie de cette maladie, dont tant ne me greverait, comme il me semble, quant faire le mestent, un accès de fièvre ".
Christine était âgée de 41 ans lorsqu'elle se plaignait ainsi des disgraces de la fortune ; cependant elle éprouvait des consolations dans ses adversités. De trois enfants que son mari lui avait laissés, il lui restait un fils et une fille, tous deux également recommandables par les qualités du corps et de l'esprit ; c'est du-moins l'idée qu'elle en donne en faisant leur éloge. " N'as-tu pas un fils, lui dit dame Philosophie, aussi bel et gracieux, et bien moriginés, et tel que de sa jonece, qui passe pas vingt ans du temps qu'il a estudié en nos premières sciences et grammaire, on ne trouverait en rhétorique et poétique langage, naturellement à luy propice, gaires plus aperte et plus soubtil que il est, avec le bel entendement et bonne judicative que il a ".
Parlant ensuite de sa fille, elle fait dire à dame Philosophie : " Ton premier fruit est une fille donnée à Dieu et à son service, rendue par inspiration divine, de sa pure voulonté, oultre ton gré, en l'église et noble religion des dames à Paissy, où elle, en fleur de jonece et très-grant beauté, se porte tant notablement en vie contemplative et dévotion, que la joye de la relacion de sa belle vie souvente fois te rend grand reconfort ". Ce passage nous apprend que la fille de Christine était l'ainée de son fils, et qu'elle avait pris le voîle contre le gré de sa mère. Peut-être le mauvais état des affaires de sa famille avait-il contribué à lui faire embrasser ce parti.
Changea-t-il ce triste état des affaires de famille ? c'est ce que nous ignorons. Nous voudrions apprendre que le fils fit un bon mariage, et que Christine fut heureuse sur la fin de ses jours ; car outre qu'elle était aimable de caractère, elle réunissait aux grâces de l'esprit, les agréments de la figure. Nous savons qu'elle était bien faite, et qu'elle avait l'art de se mettre avec beaucoup de gout.
Les portraits que nous avons de Christine dans quelques-uns de ses livres enluminés de son temps, s'accordent avec l'idée qu'elle même a eu soin de nous donner de sa physionomie, lorsqu'entre les avantages dont elle reconnait qu'elle est redevable au Créateur, elle met celui " d'avoir corps sans nulle difformité et assez plaisant, et non maladis, mais bien complexionné ".
De toutes les mignatures où elle est représentée, la plus parfaite, au jugement de M. Boivin, est celle qui se trouve dans le manuscrit 7395, à la tête du livre intitulé, la cité des dames.
On y voit une dame assise sous un dais, la tête penchée sur la main gauche, et le coude appuyé sur un bureau. Elle a le visage rond, les traits réguliers, le teint délicat et assez d'embonpoint. Ses yeux sont fermés, et elle parait sommeiller. Sa coiffure est une espèce de cul-de-chapeau, bleu ou violet, en pain de sucre, ombragé d'une gaze très-déliée, qui étant relevée tout-autour, laisse voir à nud le visage, et ne cache pas même les oreilles. Une chemise extrêmement fine, dont on n'aperçoit que le haut et qui est un peu entr'ouverte, couvre suffisamment les épaules et la gorge. Une robe bleue brodée d'or par le bas, et doublée de feuille-morte, s'ouvre sur le sein, comme aujourd'hui les manteaux de femme, et laisse entrevoir un petit corset de couleur de pourpre bordé d'un passement d'or.
Il ne me reste plus qu'à indiquer les ouvrages de Christine en vers et en prose. Voici d'abord la liste de ses poésies : cent ballades, lais, virelais, rondeaux ; jeux à vendre, ou autrement vente d'amours ; autres ballades ; l'épitre au dieu d'amours ; le débat des deux amants ; le livre des trois jugements ; le livre du dit de Paissy ; le chemin de lonc estude ; les dits moraulx, ou les enseignements que Christine donne à son fils ; le roman d'Othéa, ou l'épistre d'Othéa à Hector ; le livre de mutacion de fortune.
Ses œuvres en prose sont 1°. l'histoire du roi Charles le Sage, qu'elle écrivit par ordre du duc de Bourgogne ; 2°. la vision de Christine ; 3°. la cité des dames ; 4°. les épistres sur le roman de la Rose ; 5°. le livre des faits d'armes et de chevalerie ; 6°. instruction des princesses, dames de cour, et autres lettres à la reine Isabelle en 1405 ; 7°. les proverbes moraulx et le livre de prudence. (D.J.)
VENISE, république de, (Histoire moderne) c'est d'une retraite de pêcheurs que sortit la ville et la république de Venise. Ces pêcheurs chassés de la terre-ferme par les ravages des barbares dans le Ve siècle, se réfugièrent à Rialto, port des Padouans, et ils bâtirent des cabanes qui formèrent une petite bourgade que Padoue gouverna par des tribuns. Attila ayant dévasté Padoue, Pavie, Milan, et détruit la fameuse Aquilée, les misérables restes de ces villes achevèrent de peupler toutes les îles des Lagunes, celles du bord de la mer, et particulièrement le Lido de Malamoque. Comme il ne restait plus à ces peuples aucune espérance de retourner dans leurs habitations, ils pensèrent à s'en construire de plus assurées, et tirèrent pour ce dessein les pierres et le marbre des palais démolis en terre-ferme ; chaque île à l'exemple de Rialto, établit pour sa police des tribuns particuliers.
En 709, les tribuns des douze principales îles des Lagunes, jugeant qu'il était nécessaire de donner une nouvelle forme au gouvernement des îles qui s'étaient extraordinairement peuplées, résolurent de se mettre en république, et d'élire quelqu'un d'entre eux pour en être le chef ; mais comme ils reconnaissaient qu'ils ne pouvaient en user de la sorte contre le droit que la ville de Padoue s'arrogeait dans ces lieux où ils avaient été chercher leur sûreté, ils obtinrent de l'empereur Léon, souverain de tout le pays, et du pape Jean V. la permission d'élire leur prince, auquel ils donnèrent le nom de duc ou de doge. Le premier qu'ils élurent s'appelait Paul-Luce Anafeste.
Il n'y avait point encore de ville de Venise ; Héraclée dont il ne reste aujourd'hui que quelques ruines, fut le premier siege de cette nouvelle république ; ensuite les doges résidèrent à Malamoque et à Rialto, où Pepin roi d'Italie, donna aux habitants cinq milles carrés d'étendue en terre-ferme, avec une pleine liberté de trafiquer par terre et par mer. Le même Pepin voulut que l'île de Rialto jointe aux îles d'alentour, portât le nom de Venise, Venetiae, qui était alors celui de toute la côte voisine des Lagunes.
Telle a été l'origine du nom et de la république de Venise, dont la nécessité du commerce procura bientôt la grandeur et la puissance. Il est vrai qu'elle payait un manteau d'étoffe d'or aux empereurs, pour marque de vassalité ; mais elle acquit la province d'Istrie par son argent et par ses armes.
Les Vénitiens devenant de jour en jour une république redoutable, il fallut dans les croisades s'adresser à eux pour l'équipement des flottes ; ils y gagnèrent des richesses et des terres. Ils se firent payer dans la croisade contre Saladin 85000 marcs d'argent pour transporter seulement l'armée dans le trajet, et se servirent de cette armée même pour s'emparer des côtes de la Dalmatie, dont leur doge prit le titre. La Méditerranée était couverte de leurs vaisseaux, tandis que les barons d'Allemagne et de France bâtissaient des donjons, et opprimaient les peuples.
Gènes rivale de Venise lui fit la guerre, et triompha d'elle sur la fin du xiv. siècle ; mais Gènes ensuite déclina de jour en jour, et Venise s'éleva sans obstacle jusqu'au temps de Louis XII. et de l'empereur Maximilien, intimidant l'Italie, et donnant de la jalousie aux autres puissances qui conspirèrent pour la détruire. Presque tous les potentats ennemis les uns des autres, suspendirent leurs querelles, pour s'unir ensemble à Cambrai contre Venise. Jamais tant de rois ne s'étaient ligués contre l'ancienne Rome. Venise était aussi riche qu'eux tous ensemble. Elle se confia dans cette ressource, et surtout dans la désunion qui se mit bientôt entre tant d'alliés. Il ne tenait qu'à elle d'apaiser Jules II. principal auteur de la ligue ; mais elle dédaigna de demander cette grâce, et elle osa attendre l'orage. C'est peut-être la seule fois qu'elle ait été téméraire.
Les excommunications plus méprisées chez les Vénitiens qu'ailleurs, furent la déclaration du pape. Louis XII. envoya un héraut d'armes annoncer la guerre au doge. Il redemanda le Crémonais qu'il avait cédé lui-même aux Vénitiens, quand ils l'avaient aidé à prendre le Milanais. Il revendiquait le Bressan, Bergame, et d'autres terres sur lesquelles il n'avait aucun droit. Il appuya ses demandes à la tête de son armée, et détruisit les forces vénitiennes à la célèbre journée d'Agnadel, près de la rivière d'Adda. Alors chacun des prétendants se jeta sur son partage ; Jules II. s'empara de toute la Romagne, et pardonna aux Vénitiens qui, revenus de leur première terreur, résistaient aux armes impériales. Enfin il se ligua avec cette république contre les François qui le méritaient, et cette ligue devint funeste à Louis XII.
Sur la fin du même siècle, les Vénitiens entrèrent avec le pape et le roi d'Espagne Philippe II. dans une croisade contre les Turcs. Jamais grand armement ne se fit avec tant de célérité. Philippe II. fournit la moitié des frais ; les Vénitiens se chargèrent des deux tiers de l'autre moitié, et le pape fournit le reste. Dom Juan d'Autriche, ce célèbre bâtard de Charles-quint, commandait la flotte. Sébastien Veniero était général de la mer pour les Vénitiens. Il y avait eu trois doges dans sa maison, mais aucun d'eux n'eut autant de réputation que lui. Les flottes ottomanes et chrétiennes se rencontrèrent dans le golfe de Lépante, où les chrétiens remportèrent une victoire d'autant plus illustre, que c'était la première de cette espèce ; mais le fruit de cette bataille n'aboutit à rien. Les Vénitiens ne gagnèrent aucun terrain, et les Turcs reprirent l'année suivante le royaume de Tunis.
Cependant la république de Venise jouissait depuis la ligue de Cambrai d'une tranquillité intérieure qui ne fut jamais altérée. Les arts de l'esprit étaient cultivés dans la capitale de leur état. On y goutait la liberté et les plaisirs ; on y admirait d'excellents morceaux de peinture, et les spectacles y attiraient tous les étrangers. Rome était la ville des cérémonies, et Venise la ville des divertissements ; elle avait fait la paix avec les Turcs après la bataille de Lépante, et son commerce quoique déchu, était encore considérable dans le Levant ; elle possédait Candie, et plusieurs iles, l'Istrie, la Dalmatie, une partie de l'Albanie, et tout ce qu'elle conserve de nos jours en Italie.
Au milieu de ses prospérités elle fut sur le point d'être détruite en 1618, par une conspiration qui n'avait point d'exemple depuis la fondation de la république. L'abbé de S. Réal qui a écrit cet événement célèbre avec le style de Salluste, y a mêlé quelques embellissements de roman ; mais le fond en est très-vrai. Venise avait eu une petite guerre avec la maison d'Autriche sur les côtes de l'Istrie. Le roi d'Espagne Philippe III. possesseur du Milanès, était toujours l'ennemi secret des Vénitiens. Le duc d'Ossone viceroi de Naples, dom Pedre de Tolede gouverneur de Milan, et le marquis de Bedemar son ambassadeur à Venise, depuis cardinal de la Cueva, s'unirent tous trois pour anéantir la république. Les mesures étaient si extraordinaires, et le projet si hors de vraisemblance, que le sénat tout vigilant et tout éclairé qu'il était, ne pouvait en concevoir de soupçon ; mais tous les conspirateurs étant des étrangers de nations différentes, le sénat instruit de tout par plusieurs personnes, prévint les conjurés, et en fit noyer un grand nombre dans les canaux de Venise. On respecta dans Bedemar le caractère d'Ambassadeur, qu'on pouvait ne pas ménager ; et le sénat le fit sortir secrétement de la ville, pour le dérober à la fureur du peuple.
Venise échappée à ce danger, fut dans un état florissant jusqu'à la prise de Candie. Cette république soutint seule la guerre contre l'empire turc pendant près de 30 ans, depuis 1641 jusqu'à 1669. Le siege de Candie, le plus long et le plus mémorable dont l'histoire fasse mention, dura près de 20 ans ; tantôt tourné en blocus, tantôt ralenti et abandonné, puis recommencé à plusieurs reprises, fait enfin dans les formes deux ans et demi sans relâche, jusqu'à ce que ce monceau de cendres fût rendu aux Turcs avec l'île presque toute entière, en 1669.
Venise s'épuisa dans cette guerre ; le temps était passé où elle s'enrichissait aux dépens du reste de l'Europe, par son industrie et par l'ignorance des autres chrétiens. La découverte du passage du cap de Bonne-Espérance avait détourné la source de ses richesses. En un mot, ce n'était plus cette république qui dans le XVe siècle avait excité la jalousie de tant de rois : elle leur est encore moins redoutable aujourd'hui. La seule politique de son gouvernement subsiste ; mais son commerce anéanti, lui ôte presque toute sa force ; et si la ville de Venise est par sa situation incapable d'être domptée, elle est par sa faiblesse incapable de faire des conquêtes. Essai sur l'histoire générale par M. de Voltaire, t. I. II. III. IV. V.
On ne manque pas d'auteurs sur l'histoire de cette république : voici les principaux par ordre des temps.
1°. Justiniani (Bernard), mort procurateur de S. Marc, l'an 1489, dans la 82 année de son âge, a fait le premier l'histoire de Venise intitulée, de origine urbis Venetiarum, rebusque ejus, ab ipsà ad quadringente simum usque annum gestis historia. Venise 1492 in-fol. et dans la même ville en 1534 in-fol. Cette histoire est divisée en quinze livres, et Ve jusqu'à l'an 809. Elle a été traduite en italien par Louis Domenichi, et imprimée en cette langue à Venise en 1545, et en 1608 in-8°. avec une table des matières.
2°. Sabellicus (Marc-Antoine Coccius), né sur le milieu du XVe siècle, à Viscovaro bourg d'Italie dans la Sabine, fut appelé par le sénat de Venise pour deux emplois honorables et lucratifs ; l'un était celui d'écrire l'histoire de la république, l'autre d'enseigner les belles-lettres. Il s'acquitta mieux du dernier que du premier, car son ouvrage historique, rerum Venetarum historiae, fut rempli de flatteries et de mensonges : c'est qu'il était payé pour être sincère et exact à l'égard de ses écoliers, et pour se garder de l'être à l'égard des narrations. Scaliger remarque que Sabellicus avait avoué lui-même que l'argent des Vénitiens était la source ds ses lumières historiques.
3°. Suazzarini (Dominico), contemporain de Sabellicus, écrivit l'histoire de Venise beaucoup plus abrégée, et tâcha d'imiter le style de Tacite.
4°. Le cardinal Bembo fut nommé par la république en 1530, pour en écrire l'histoire. On voulut qu'il la commençât où Sabellicus l'avait finie (environ l'an 1486), et qu'il la continuât jusque à son temps. Cet intervalle comprenait 44 années ; il ne remplit point cet intervalle, car il termina son ouvrage à la mort de Jules II. Cette histoire est divisée en douze livres, et fut imprimée à Venise l'an 1551, et contrefaite la même année à Paris, chez Michel Vascosan in-4°. On en donna une nouvelle édition à Bâle, l'an 1567, en trois volumes in-8°. avec les autres œuvres de l'auteur. Il ne put tirer aucun profit du travail d'André Navagiero, qui avait eu avant lui la même commission, mais qui ordonna en mourant qu'on brulât tous ses écrits.
Quoique Bembus ait été l'une des meilleures plumes latines du XVIe siècle, il faut avouer qu'il a montré trop d'affectation à ne se servir dans ses écrits, et surtout dans son histoire, que des termes de la pure latinité. On rit de lire dans cet auteur, qu'un pape avait été élu par la faveur des dieux immortels, deorum immortalium beneficiis. Il aimait cette expression ; car il rapporte dans un autre endroit que le sénat de Venise écrivit au pape : " Fiez-vous aux dieux immortels dont vous êtes le vicaire sur la terre ", uti fidat diis immortalibus quorum vicem geris in terris.
Après cela, on ne doit point s'étonner qu'il se soit servi du mot de déesse, en parlant de la sainte Vierge. C'est dans une lettre où Leon X. reproche aux habitants de Recanati d'avoir donné de mauvais bois pour le bâtiment de Notre-Dame de Lorette, et leur commande d'en donner de meilleur, " de peur, dit-il, qu'il ne semble que vous vous soyez mocqué de nous et de la déesse même ", ne tùm nos, tùm etiam deam ipsam, inani lignorum inutilium donatione lusisse videamini.
Les termes que le christianisme a consacrés, comme fides, excommunicatio, ont paru barbares à cet écrivain ; il a mieux aimé se servir de persuasio pour fides, et de aqua et igne interdictio, pour excommunicatio ; mais l'histoire de Venise de Bembo mérite encore plus la critique du côté de la bonne foi, comme Bodin l'a prononcé dans sa méthode sur l'histoire.
5°. Paruta, né à Venise en 1540, et mort procurateur de S. Marc en 1598, comme je l'ai déjà dit en parlant de la ville de Venise, a publié entre autres ouvrages, une grande histoire de Venise, intitulée Istoria venetiana, lib. XIIe Venise, 1605, 1645, et 1704, in-4°. En qualité d'historiographe de la république, il fut chargé de continuer l'histoire du cardinal Bembo qui avait fini à l'année 1513, année de l'élévation de Leon X. au pontificat. Il en écrivit le premier livre en latin, pour se conformer à Bembo, mais il changea de dessein dans la suite, et composa son ouvrage tout en italien. Cet ouvrage contient en douze livres tout ce qui est arrivé de plus considérable à la république depuis l'an 1513 jusqu'en 1552. Il a été joint au recueil des historiens de Venise, publié en 1718 sous ce titre général : Istorici delle Cose veneziane, i quali hanno scritto per publico decreto. Henri Cary a traduit l'histoire de Paruta en anglais ; et sa traduction a été imprimée à Londres en 1658 in-4°.
6°. Morosini (André), né à Venise en 1558, et mort dans les grands emplois de sa patrie l'an 1618 à 60 ans, a fait une histoire latine de la république, qui parut sous ce titre : Historia Veneta ab anno 1521, ad annum 1615. Venetiis 1603, in-fol. Cette histoire est une continuation de celle de Paruta.
7°. Nani (Jean-Baptiste), noble vénitien, fut honoré des premiers emplois de la république, et chargé par le sénat de continuer l'histoire de la république. Il divisa son ouvrage en deux parties ; et imprimait la seconde, lorsqu'il mourut en 1678 âgé de 62 ans. La première partie a été traduite en français, et imprimée en Hollande en 1702 en quatre volumes in-12. L'ouvrage est intéressant ; mais l'auteur dans tout ce qui concerne sa patrie, a plus suivi les sentiments naturels que la vérité de l'histoire ; on en a fait une nouvelle édition en 1720, et elle entre dans le recueil des historiens de Venise.
8°. Le dernier écrivain de cette histoire est le sénateur Diedo, dont l'ouvrage intitulé, Storie della republica di Venezia, a paru à Venise en 1751 en deux volumes in-4°.
Les Français, à qui les langues latine et italienne sont inconnues, peuvent lire Amelot de la Houssaye, histoire du gouvernement de Venise ; S. Disdier, description de la république de Venise ; l'abbé Laugier, histoire de Venise, depuis sa fondation jusqu'à nos jours. Paris, 1762, en cinq vol. in-12. (D.J.)
VENISE, gouvernement de, (Droit politique) ce gouvernement dont les Vénitiens cachent aux étrangers le régime avec tant de soin, commença en 709 par se mettre en république avec un chef auquel on donna le nom de duc ou doge. Ces princes de la république ayant sans cesse augmenté leur puissance, les principaux citoyens résolurent enfin de la modérer. S'étant assemblés dans l'église de S. Marc, ils établirent en 1172 un conseil indépendant, et créèrent douze tribuns qui pourraient s'opposer aux ordonnances du prince. Ces tribuns eurent encore le droit d'élire chaque année quarante personnes par quartier, pour composer le grand conseil qu'on venait de créer, de sorte qu'il était de deux cent quarante citoyens, la ville de Venise étant divisée en six quartiers ; et comme ce conseil se renouvellait tous les ans, chacun avait espérance d'y entrer.
L'ordre de ce gouvernement dura cent dix-sept ans, c'est-à-dire jusqu'en 1289, que le doge Pierre Gradenigo entreprit de changer entièrement la face de la république, et d'établir une véritable aristocratie, en fixant à perpétuité le grand conseil à un nombre de citoyens et à leurs descendants. Il fit passer à la Quarantie criminelle, qui est une chambre souveraine de quarante juges, un decret portant que tous ceux qui avaient composé le grand conseil des quatre années précédentes, seraient ballotés dans cette chambre, et que ceux qui auraient douze balles favorables, composeraient eux et leurs descendants le grand conseil à perpétuité.
La noblesse vénitienne est divisée en différentes classes. La première comprend les familles des douze tribuns qui furent les électeurs du premier doge, et qui se sont presque toutes conservées jusqu'à présent. A ces douze maisons qu'on appelle électorales, on en a joint douze autres, dont l'ancienneté Ve presque de pair avec les douze premières ; mais toutes sont extrêmement déchues de leur ancien éclat par le luxe et la pauvreté.
La seconde classe de la noblesse vénitienne se trouve composée des nobles qui ont pour titre le temps de la fixation du grand conseil, et dont les noms étaient écrits dès ce temps-là dans le livre d'or, qui est le catalogue qu'on fit alors de toutes les familles de la noblesse vénitienne. On met au rang de cette noblesse du second ordre les trente familles qui furent agrégées à la noblesse en 1380, parce qu'elles avaient secouru la république de sommes considérables pendant la guerre contre les Génois.
Dans la troisième classe de la noblesse vénitienne on comprend environ quatre-vingt familles qui ont acheté la noblesse moyennant cent mille ducats, dans le besoin d'argent où la république se trouva réduite par la dernière guerre de Candie. On ne fit aucune distinction entre les personnes qui se présentèrent, c'est-à-dire, depuis le gentilhomme de terre-ferme jusqu'à l'artisan. Cette troisième sorte de noblesse vénitienne ne fut point d'abord employée dans les grandes charges de la république. On lui préférait les nobles d'ancienne origine.
Les citadins qui sont les bonnes familles des citoyens vénitiens, composent un second état entre la noblesse et le peuple. On distingue deux sortes de citadins : les premiers le sont de naissance, étant issus de ces familles, qui avant la fixation du grand-conseil avaient la même part au gouvernement qu'y a présentement la noblesse vénitienne. Le second ordre des citadins est composé de ceux qui ont par mérite ou par argent obtenu ce rang dans la république. Les uns et les autres jouissent des mêmes privilèges. La république fait semblant d'honorer les vrais citadins, et leur donne toutes les charges qu'on tient au-dessous d'un noble vénitien. La dignité de grand-chancelier est le plus haut degré d'élévation où puisse prétendre un citadin. Le rang et la grandeur de cette charge en rendrait la fonction digne d'un des premiers sénateurs, si la république jalouse de son autorité, n'avait réduit cet emploi au seul exercice des choses où la charge l'oblige, sans lui donner ni voix, ni crédit, dans les tribunaux où il a la liberté d'entrer.
La dignité de grand-chancelier, celle de procurateur de S. Marc et celle du doge sont les seules qui se donnent à vie. Voyez les mots DOGE et PROCURATEUR de S. Marc.
Comme la république a voulu conserver dans l'ordre extérieur de son gouvernement une image de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie, elle a représenté un prince souverain dans la personne de son doge : une aristocratie dans le prégadi ou le sénat, et une espèce de démocratie dans le grand-conseil, où les plus puissants sont obligés de briguer les suffrages ; cependant le tout ne forme qu'une pure aristocratie.
Une des choses à quoi le sénat s'est appliqué avec grand soin, a été d'empêcher que les princes étrangers n'eussent aucune connaissance de ses délibérations ni de ses maximes particulières ; et comme il eut été plus facîle à la cour de Rome qu'à aucune autre d'en venir à-bout, et même de former un parti considérable dans le sénat, par le moyen des ecclésiastiques, la république ne s'est pas seulement contentée de leur en interdire l'entrée, elle n'a même jamais souffert que la juridiction ecclésiastique ordinaire se soit établie dans ses états avec la même autorité que la plupart des princes lui ont laissé prendre, et elle a exclu tous les ecclésiastiques, quand même ils seraient nobles vénitiens, de tous les conseils et de tous les emplois du gouvernement.
Le sénat ne nomme aucun vénitien au pape pour le cardinalat, afin de ne tenter aucun de ses sujets à trahir les intérêts de la république, par l'espérance du chapeau. Il est vrai que l'ambassadeur de Venise propose au pape les sujets de l'état qui méritent cet honneur, mais il fait ses sollicitations comme simple particulier, et ne forme aucune demande au nom du sénat. Aussi le cardinalat n'est pas à Venise en aussi grande considération qu'il l'est ailleurs.
Le patriarche de Venise est élu par le sénat ; il ne met à la tête de ses mandements, que N... divinâ miseratione Venetiarum patriarcha, sans ajouter, comme les autres prélats d'Italie, sanctae sedis apostolicae gratiâ.
Sait encore que la république ait eu dessein d'ôter aux ecclésiastiques les moyens d'avoir obligation à d'autres supérieurs qu'au sénat, soit qu'elle n'ait eu d'autre vue que de maintenir l'ancien usage de l'église, elle a laissé l'élection des curés à la disposition des paraissiens, qui doivent choisir celui des prêtres habitués de la même paraisse qui leur parait le plus digne. Tous ceux qui possèdent des maisons en propre dans l'étendue de la paraisse, nobles, citadins et artisans, s'assemblent dans l'église, dans le terme de trois jours après la mort du curé, et procedent à l'élection par la pluralité des voix, faute de quoi la république nomme un curé d'office.
Il est vrai que l'inquisition est établie à Venise ; mais elle y est du-moins sous des conditions qui diminuent l'atrocité de sa puissance. Elle est composée à Venise du nonce du pape, du patriarche de Venise toujours noble vénitien, du père inquisiteur toujours de l'ordre de S. Français, et de deux principaux sénateurs qui sont assistants, et sans le consentement desquels toutes les procédures sont nulles, et les sentences hors d'état d'être mises à exécution.
L'hérésie est presque la seule matière dont l'inquisition de Venise ait droit de connaître ; les désordres qui suivent l'hérésie, ou qui peuvent l'entretenir, ont des juges séculiers qui prennent connaissance de ces matières. Tous ceux qui font profession d'une autre religion que de la catholique, ne sont point soumis à l'inquisition ; et depuis le catalogue des livres défendus, qui fut dressé lorsque la république reçut l'inquisition, il n'est point permis au saint office d'en censurer d'autres que ceux que la république elle-même censure. Outre cela, le sénat entretient deux docteurs qu'on appelle consulteurs d'état, l'un religieux, et l'autre séculier, qui sont chargés d'examiner les bulles, les brefs et les excommunications qui viennent de Rome, et qu'on ne reçoit jamais sans l'approbation de ces deux docteurs.
Le collège, le prégadi et le grand conseil font mouvoir l'état. Le collège est composé du doge, de ses six conseillers, des trois chefs de la quarantie criminelle, des six sages-grands, de cinq sages de terre-ferme, et des cinq sages des ordres, en tout vingt-six personnes. Voyez DOGE, QUARANTIE, SAGES-GRANDS, etc.
Mais toute l'autorité de la république est partagée entre le sénat ou le prégadi (dont il faut consulter l'article en particulier) et le grand-conseil. Le premier règle souverainement les affaires d'état ; le second dispose absolument de toutes les magistratures. Il a droit de faire de nouvelles lois, d'élire les sénateurs, de confirmer les élections du sénat, de nommer à toutes les charges, de créer les procurateurs de S. Marc, les podestats et les gouverneurs qu'on envoie dans les provinces ; enfin le grand-conseil est l'assemblée générale des nobles, où tous ceux qui ont vingt-cinq ans, et qui ont pris la veste, entrent avec le droit de suffrage. De même tous les membres du collège, ceux du conseil des dix, les quarante juges de la quarantie-criminelle, et tous les procurateurs de S. Marc entrent au prégadi, de sorte que son assemblée est d'environ 280 membres, dont une partie a voix délibérative, et le reste n'y est que pour écouter.
Le conseil des dix prend connaissance des affaires criminelles qui arrivent entre les nobles, tant dans la ville que dans le reste de l'état. Voyez DIX conseil des.
Le tribunal des inquisiteurs d'état est composé de trois membres, qui sont deux sénateurs du conseil des dix, et un des conseillers du doge. Ce tribunal fait frémir, et par sa puissance, et parce que les exécutions de ce tribunal sont aussi secrètes que leur jugement. Voyez INQUISITEURS d'état.
Pour prévenir les désordres du luxe, le gouvernement de Venise a établi des magistrats appelés sopra-proveditori alle pompe. Ce sont des sénateurs du premier ordre, qui par des ordonnances sevères ont réglé la table, le train et les habits de la noblesse vénitienne.
La république prend aussi connaissance des affaires générales et particulières des religieux et des religieuses. Elle a établi à cet effet trois sénateurs avec une autorité fort étendue sur la discipline extérieure des couvens ; ces trois magistrats ont un capitaine de sbirres qui visite les parloirs, outre quantité d'espions gagés ; mais cette sévérité apparente est plutôt par montre d'un gouvernement exact, et pour empêcher les supérieurs ecclésiastiques de s'en mêler, que pour guérir un mal qui ne leur parait pas moins nécessaire que peu capable de remède, la jeune noblesse vénitienne faisant un de ses plus grands plaisirs du commerce qu'elle entretient avec les religieuses.
La république gouverne les états de terre-ferme par des nobles qu'elle y envoie, avec les titres de podestats, provéditeurs, gouverneurs, etc. Elle envoie aussi quelquefois dans les provinces trois des premiers sénateurs, auxquels elle donne le nom d'inquisiteurs de terre-ferme, et qui sont chargés d'écouter les plaintes des sujets contre les gouverneurs, et de leur rendre justice ; mais tout cela n'est qu'une pure ostentation.
Il résulte de la connaissance du gouvernement de Venise, que c'est une aristocratie despotique, et que la liberté y règne moins que dans plusieurs monarchies. Ce sont toujours sous différents noms des magistrats d'un même corps, des magistrats qui ont les mêmes principes, les mêmes vues, la même autorité, exécuteurs des lois et législateurs en même temps. Il n'y a point de contrepoids à la puissance patricienne, point d'encouragement aux plébéïens, qui à proprement parler, sont sous le joug de la noblesse, sans espérance de pouvoir le secouer. (D.J.)
VENISE, état de, (Géographie moderne) l'état de la république de Venise se partage en quatorze provinces, dont il y en a six vers le midi ; savoir le Dogado ou duché de Venise, le Padouan, le Vicentin, le Véronais, le Bressan et le Bergamasc. Le Crémasque est au midi du Bressan, et la Polésine de Rovigo est au sud du Crescentin. Les quatre suivantes sont à son nord du midi au septentrion : savoir la Marche Trévisane, le Feltrin, le Bellunèse et le Cadorin. A l'orient de celle-ci sont le Frioul, qui lui est contigu, et l'Istrie sur le golfe de Venise, presque vis-à-vis le Ferrarais. Le Dogado s'étend en long depuis l'embouchure du Lizouzo jusqu'à celle de l'Adige, et comprend les îles des Lagunes, de Venise, de Maran, et tout le quartier qui est vers la côte du golfe, depuis Carvazere jusqu'à Grado, ainsi que plusieurs îles qui sont aux environs de la capitale. (D.J.)
VENISE, terre de, (Histoire naturelle) bolus veneta, nom d'une terre d'un beau rouge, qui s'emploie dans la peinture sous le nom de rouge de Venise. M. Hill observe que cette terre n'est point bolaire, mais une ochre très-fine, douce au toucher, d'un rouge presque aussi vif que celui du minium, et qui colore fortement les doigts. Cette terre est d'un goût astringent, et ne fait point effervescence avec les acides. On la tire de Carinthie d'où elle passe par les mains des Vénitiens qui la falsifient, et qui la débitent au reste de l'Europe pour la peinture. Voyez Hill's, natural history of fossils.
VENITIENS NOBLES, (Histoire moderne) c'est ainsi que l'on nomme à Venise les chefs de la république, parmi lesquels on choisit le doge, les procurateurs de S. Marc, les provéditeurs, les ambassadeurs, et tous ceux qui doivent remplir les fonctions les plus importantes de l'état. On divise les nobles vénitiens en trois classes : la première est celle des nobles qu'on nomme elettorali ; dans cette classe sont les douze plus anciennes familles de la république. La seconde classe est celle des familles qui ont été admises aux privilèges de la noblesse depuis l'an 1380. Enfin la troisième classe est celle des nobles qui ont acquis la noblesse pour de l'argent ; on dit qu'il en coute cent mille ducats pour obtenir cette distinction. On distingue à Venise les nobles de terre-ferme qui habitent la partie du continent qui est sujette à la république ; ces derniers ne sont point si considérés que les nobles de Venise qui sont en possession de la souveraineté.
VENISE
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Géographie moderne
- Affichages : 1483