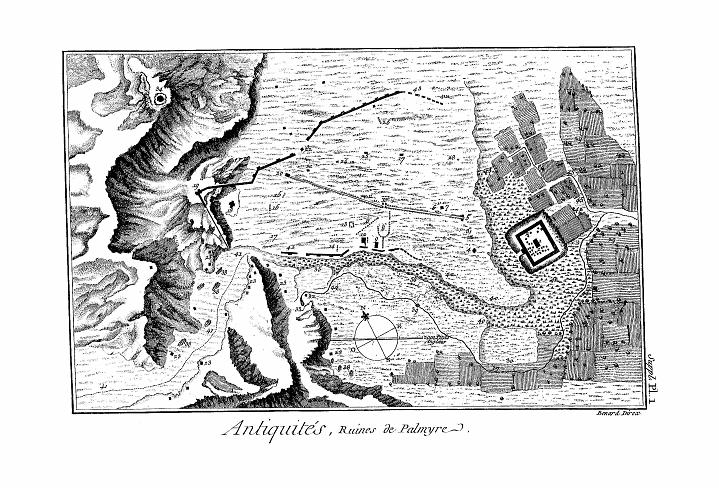(Géographie moderne) grand royaume d'Europe, borné au nord, par la mer Baltique qui le sépare de la Suède ; à l'orient, par la Tartarie et la Moscovie ; au midi, par le Pont-Euxin, la Valachie, la Moldavie, la Transsylvanie et la Hongrie ; à l'occident, par la Poméranie, le Brandebourg, la Silésie et la Moravie.
Ce royaume était autrefois plus vaste ; car il occupait encore la Silésie, la Livonie, les duchés de Smolensko, de Séverie, de Czernichovie, le palatinat de Kiow, etc. il est malgré cela très-étendu ; sa longueur depuis l'extrémité du Marggraviat de Brandebourg, jusqu'aux frontières de Moscovie, est de 210 lieues polonaises. Sa largeur depuis le fond de la Pokucie jusqu'au Parnau, en Livonie, est de près de 200 lieues du même pays ; c'est en grande partie ce qu'on appelait autrefois Sarmatie.
Ce vaste état se divise en trois parties principales, la grande Pologne au nord, la petite Pologne au milieu, et le grand duché de Lithuanie, au sud-est ; Ces trois parties contiennent vingt-sept palatinats, qui ont chacun un gouverneur et un castellan.
Les principales rivières de la Pologne sont la Vistule, le Bogh, la Varte, la Niemen, le Nieper, et le Niester. Cracovie est la capitale du royaume, et Varsovie la résidence la plus ordinaire des rois polonais de naissance. Long. depuis le 33d. jusqu'au 45. lat. du 47d. jusqu'au 56.
L'histoire et le gouvernement de la Pologne, demandent un article à part ; mais les curieux qui forment des bibliothèques considérables, où ils font entrer l'histoire de toutes les monarchies du monde, peuvent recueillir sur la Pologne les livres suivants ; d'abord pour la géographie, Ortelius, Bertius, Cluvier, Briet, Alexandre Guagnini de Vérone, sarmat. europ. descriptio, et mieux encore Andreae Cellarii, noviss. descript. Poloniae. Petri Rzaczinschi, hist. naturalis regni Poloniae, Sandomiriae 1720. in-4°.
Plusieurs auteurs ont compilé l'histoire de ce royaume, entr'autres Matthias Mickow, in chronicis ; Sarnic, annal. Polon. Neughbaveri res Polonorum ; Kedlubek, hist. Polon. Les suivants sont plus estimés, Dlugloss, hist. Polon. Martini Cromer, hist. Polon. Hartknock, de republicâ polonicâ. Simon Okolski, orbis polonus ; enfin, on a recueilli en un corps les meilleurs historiens de Pologne.
Les Français, comme le Laboureur, Davity, Rochefort, Hauteville, Beaujeu, Massuet, etc. n'ont fait qu'effleurer très-superficiellement l'histoire du gouvernement de Pologne ; mais il n'en est pas de même de l'auteur de la vie de Sobieski ; il a recouru aux sources, et a peint avec gout. Voyez l'article suivant. (D.J.)
POLOGNE, histoire et gouvernement de, (Histoire et Droit politique) un tableau général de l'histoire et gouvernement de la Pologne, ne peut qu'être utîle ; mais quand il est aussi-bien dessiné, que l'a fait M. l'abbé Coyer à la tête de sa vie de Sobieski, il plait encore ; il instruit, il intéresse, il offre des réflexions en foule au philosophe et au politique ; on en jugera par l'esquisse que j'en vais crayonner. Qu'on ne la regarde pas cette esquisse comme une superfluité, puisque ce royaume est beaucoup moins connu que les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède et le Danemarck.
D'ailleurs, l'histoire des royaumes héréditaires et absolus, ne produit pas ordinairement le grand intérêt que nous cherchons dans les états libres. La monotonie d'obéissance passive, salutaire si le monarque est bon, ruineuse s'il est méchant, ne met guère sur le théâtre de l'histoire, que des acteurs qui n'agissent qu'au gré d'un premier acteur ; et quand ce premier acteur est sans crainte, il n'a pas le pouvoir lui-même de nous intéresser vivement.
Il n'en est pas ainsi d'un pays dont le roi est électif ; ou ses vertus le portent sur le trône, ou c'est la force qui l'y place. S'il s'élève par ses vertus, le spectacle est touchant ; si c'est par la force, il attire encore les regards en triomphant des obstacles ; et lorsqu'il est au faite de la puissance, il a un besoin continuel de conseil et d'action pour s'y maintenir. Le roi, la loi, et la nation, trois forces qui pesent sans cesse l'une sur l'autre, équilibre difficile. La nation sous le bouclier de la loi, pense, parle, agit avec cette liberté qui convient à des hommes. Le roi, en suivant ou en violant la loi, est approuvé ou contredit, obéi ou désobéi, paisible ou agité.
Les Polonais avant le sixième siècle, lorsqu'ils étaient encore Sarmates, n'avaient point de rais. Ils vivaient libres dans les montagnes et les forêts, sans autres maisons que des chariots, toujours méditant quelque nouvelle invasion ; mauvaises troupes pour se battre à pied, excellentes à cheval. Il est assez étonnant qu'un peuple barbare, sans chef et sans lois, ait étendu son empire depuis le Tanaïs jusqu'à la Vistule, et du Pont-Euxin à la mer Baltique ; limites prodigieusement distantes, qu'ils reculèrent encore en occupant la Bohème, la Moravie, la Silésie, la Lusace, la Misnie, le Mecklenbourg, la Poméranie et les Marches Brandebourgeoises. Les Romains qui soumettaient tout, n'allèrent point affronter les Sarmates.
Ce paradoxe historique montre ce que peuvent la force du corps, une vie dure, l'amour naturel de la liberté, et un instinct sauvage qui sert de lois et de rais. Les nations policées appelaient les Sarmates des brigands, sans faire attention qu'elles avaient commencé elles-mêmes par le brigandage.
Il s'en faut beaucoup que les Polonais, qui prirent ce nom au milieu du sixième siècle, aient conservé tout l'héritage de leurs pères. Il y a longtemps qu'ils ont perdu la Silésie, la Lusace, une grande partie de la Poméranie, la Bohème, et tout ce qu'ils possédaient dans la Germanie. D'autres siècles ont encore amené de nouvelles pertes ; la Livonie, la Podolie, la Volhynie, et les vastes campagnes de l'Ukraine ont passé à d'autres puissances ; c'est ainsi que tant de grands empires se sont brisés sous leur propre poids.
Vers l'an 550, Leck s'avisa de civiliser les Sarmates ; sarmate lui-même, il coupa des arbres, et s'en fit une maison. D'autres cabanes s'élevèrent autour du modèle. La nation jusqu'alors errante se fixa ; et Gnesne, la première ville de Pologne, prit la place d'une forêt. Les Sarmates apparemment connaissaient mal les aigles ; ils en trouvèrent, dit-on, plusieurs nids en abattant des arbres ; c'est de-là que l'aigle a passé dans les enseignes polonaises. Ces fiers oiseaux font leurs aires sur les plus hauts rochers, et Gnesne est dans une plaine. Leck attira les regards de ses égaux sur lui, et déployant des talents pour commander autant que pour agir, il devint leur maître, sous le nom de duc, pouvant prendre également celui de roi.
Depuis ce chef de la nation jusqu'à nos jours, la Pologne a eu d'autres ducs, des vaivodes, aujourd'hui palatins, des rais, des reines, des régentes et des interrègnes. Les interrègnes ont été presqu'autant d'anarchies ; les régentes se sont fait haïr ; les reines en petit nombre n'ont pas eu le temps de se montrer ; les vaivodes ne furent que des oppresseurs. Parmi les ducs et les rais, quelques-uns ont été de grands princes ; les autres ne furent que guerriers ou tyrants. Tel sera toujours à-peu-près le sort de tous les peuples du monde, parce que ce sont des hommes et non les lois qui gouvernent !
Dans cette longue suite de siècles, la Pologne compte quatre classes de souverains ; Leck, Piast, Jagellon, voilà les chefs des trois premières races. La quatrième qui commence à Henri de Valais, forme une classe à part, parce que la couronne y a passé d'une maison à une autre, sans se fixer dans aucune.
La succession dans les quatre classes montre des singularités, dont quelques-unes méritent d'être connues.
L'an 750 les Polonais n'avaient pas encore examiné si une femme pouvait commander à des hommes ; il y avait longtemps que l'Orient avait décidé que la femme est née pour obéir. Venda regna pourtant et glorieusement ; la loi ou l'usage salique de la France fut ensuite adopté par la Pologne ; car les deux reines qu'on y a vues depuis Venda, savoir, Hedwige en 1382 et Anne Jagellon en 1575, ne montèrent sur le trône, qu'en acceptant les époux qu'on leur désigna pour les soutenir dans un poste si élevé. Anne Jagellon avait soixante ans, lorsqu'elle fut élue. Etienne Battori, qui l'épousa pour régner, pensa qu'une reine était toujours jeune.
Des siècles antérieurs avaient ouvert d'autres chemins à la souveraineté. En 804, les Polonais furent embarrassés pour le choix d'un maître ; ils proposèrent leur couronne à la course : pratique autrefois connue dans la Grèce, et qui ne leur parut pas plus singulière, que de la donner à la naissance. Un jeune homme nourri dans l'obscurité la gagna, et il prit le nom de Lesko II. Les chroniques du temps nous apprennent qu'il conserva sous la pourpre, la modestie et la douceur de sa première fortune ; fier seulement et plein d'audace lorsqu'il avait les armes à la main.
Presque tous les Polonais soutiennent que leur royaume fut toujours électif ; cette question les intéresse peu, puisqu'ils jouissent. Si on voulait la décider par une suite de faits pendant six ou sept siècles, on la déciderait contr'eux, en montrant que la couronne dans les deux premières classes, a passé constamment des pères aux enfants ; excepté dans les cas d'une entière extinction de la maison regnante. Si les Polonais alors avaient pu choisir leurs princes, ils auraient pris parmi leurs palatins des sages tout décidés.
Les eut-on Ve aller chercher un moine dans le fond d'un cloitre, pour le porter sur le trône, uniquement parce qu'il était du sang de Piast ? Ce fut Casimir I. fils d'un père détesté, Miecislaw II. et d'une mère encore plus exécrable. Veuve et régente, elle avait fui avec son fils ; on le chercha cinq ans après pour le couronner : la France l'avait reçu. Les ambassadeurs polonais le trouvèrent sous le froc dans l'abbaye de Clugny, où il était profès et diacre. Cette vue les tint d'abord en suspens, ils craignirent que son âme ne fût flétrie sous la cendre et le cilice ; mais faisant réflexion qu'il était du sang royal, et qu'un roi quelconque était préférable à l'interrègne qui les désolait, ils remplirent leur ambassade. Un obstacle arrêtait ; Casimir était lié par des vœux et par les ordres sacrés ; le pape Clément II. trancha le nœud, et le cénobite fut roi. Ce n'est qu'à la fin de la seconde classe, que le droit héréditaire périt pour faire place à l'élection.
Le gouvernement a eu aussi ses révolutions : il fut d'abord absolu entre les mains de Leck, peut-être trop : la nation sentit ses forces, et secoua le joug d'un seul ; elle partagea l'autorité entre des vaivodes ou généraux d'armée, dans le dessein de l'affoiblir. Ces vaivodes assis sur les débris du trône, les rassemblèrent pour en former douze, qui venant à se heurter les uns et les autres, ébranlèrent l'état jusque dans ses fondements. Ce ne fut plus que révoltes, factions, oppression, violence. L'état dans ces terribles secousses, regretta le gouvernement d'un seul, sans trop penser à ce qu'il en avait souffert : mais les plus sensés cherchèrent un homme qui sut régner sur un peuple libre, en écartant la licence. Cet homme se trouva dans la personne de Cracus, qui donna son nom à la ville de Cracovie, en la fondant au commencement du septième siècle.
L'extinction de sa postérité dès la première génération, remit le sceptre entre les mains de la nation, qui ne sachant à qui le confier, recourut aux vaivodes qu'elle avait proscrits. Ceux-ci comblèrent les désordres des premiers ; et cette aristocratie mal constituée ne montra que du trouble et de la faiblesse.
Au milieu de cette confusion, un homme sans nom et sans crédit, pensait à sauver sa patrie : il attira les Hongrois dans un défilé où ils périrent presque tous. Przémislas (c'est ainsi qu'on le nommoit) devint en un jour l'idole du peuple ; et ce peuple sauvage qui ne connaissait encore d'autres titres à la couronne que les vertus, la plaça sur la tête de son libérateur, qui la soutint avec autant de bonheur que de gloire, sous le nom de Lesko I. dans le huitième siècle.
Ce rétablissement du pouvoir absolu ne dura pas longtemps, sans éprouver une nouvelle secousse. Popiel II. le quatrième duc depuis Przémislas, mérita par ses crimes d'être le dernier de sa race ; l'anarchie succéda, et les concurrents au trône s'assemblèrent à Kruswic, bourgade dans la Cujavie. Un habitant du lieu les reçut dans une maison rustique, leur servit un repas frugal, leur montra un jugement sain, un cœur droit et compatissant, des lumières au-dessus de sa condition, une âme ferme, un amour de la patrie, que ces furieux ne connaissaient pas. Des ambitieux qui désespèrent de commander, aiment mieux se soumettre à un tiers qui n'a rien disputé, que d'obéir à un rival. Ils se déterminèrent pour la vertu ; et par-là ils réparèrent en quelque sorte tous les maux qu'ils avaient faits pour parvenir au trône ; Piast regna donc au neuvième siècle.
Les princes de sa maison, en se succédant les uns aux autres, affermissaient leur autorité ; elle parut même devenir plus absolue entre les mains de Boleslas I. dans le dixième siècle. Jusqu'à lui les souverains de Pologne, n'avaient eu que le titre de duc : deux puissances se disputaient alors le pouvoir de faire des rais, l'empereur, et le pape. A examiner l'indépendance des nations les unes des autres, ce n'est qu'à elles-mêmes à titrer leurs chefs. Le pape échoua dans sa prétention : ce fut l'empereur Othon III. qui touché des vertus de Boleslas, le revétit de la royauté, en traversant la Pologne.
On n'aurait jamais cru qu'avec cet instrument du pouvoir arbitraire (un diplome de royauté, donné par un étranger), le premier roi de Pologne eut jeté les premières semences du gouvernement républicain. Cependant ce héros, après avoir eu l'honneur de se signaler par des conquêtes, et la gloire bien plus grande d'en gémir, semblable à Servius Tullius, eut le courage de borner lui-même son pouvoir, en établissant un conseil de douze sénateurs, qui put l'empêcher d'être injuste.
La nation qui avait toujours obéi en regardant du côté de la liberté, en aperçut avec plaisir la première image : ce conseil pouvait devenir un sénat. Nous avons Ve que dès les commencements elle avait quitté le gouvernement d'un seul pour se confier à douze vaivodes. Cette idée passagère de république ne l'avait jamais abandonnée ; et quoique ses princes, après son retour à sa première constitution, se succédassent les uns aux autres par le droit du sang, elle restait toujours persuadée qu'il était des cas où elle pouvait reprendre sa couronne. Elle essaya son pouvoir sur Miecislaw III. prince cruel, fourbe, avare, inventeur de nouveaux impôts : elle le déposa. Ces dépositions se renouvellèrent plus d'une fois ; Uladislas Laskonogi, Uladislas Loketek, se virent forcés à descendre du trône, et Casimir IV. aurait eu le même sort, s'il n'eut fléchi sous les remontrances de ses sujets. Poussés à bout par la tyrannie de Boleslas II. dans le treizième siécle, ils s'en délivrèrent en le chassant.
Une nation qui est parvenue à déposer ses rais, n'a plus qu'à choisir les pierres pour élever l'édifice de sa liberté, et le temps amène tout. Casimir le grand, au quatorzième siécle, pressé de finir une longue guerre, fit un traité de paix, dont ses ennemis exigèrent la ratification par tous les ordres du royaume. Les ordres convoqués refusèrent de ratifier ; et ils sentirent dès ce moment qu'il n'était pas impossible d'établir une république en conservant un roi.
Les fondements en furent jetés avant la mort même de Casimir ; il n'avait point de fils pour lui succéder ; il proposa son neveu Louis, roi de Hongrie. Les Polonais y consentirent ; mais à des conditions qui mettaient des entraves au pouvoir absolu : ils avaient tenté plus d'une fois de le diminuer par des révoltes ; ici c'est avec des traités. Le nouveau maître les déchargeait presque de toute contribution ; il y avait un usage établi, de défrayer la cour dans ses voyages ; il y renonçait. Il s'engageait pareillement à rembourser à ses sujets les dépenses qu'il serait contraint de faire, et les dommages même qu'ils auraient à souffrir dans les guerres qu'il entreprendrait contre les puissances voisines : rien ne coute pour arriver au trône.
Louis y parvint, et les sujets obtinrent encore que les charges et les emplois publics seraient désormais donnés à vie aux citoyens, à l'exclusion de tout étranger, et que la garde des forts et des châteaux ne serait plus confiée à des seigneurs supérieurs au reste de la noblesse, par une naissance qui leur donnait trop de crédit. Louis possesseur de deux royaumes, préférait le séjour de la Hongrie, où il commandait en maître, à celui de la Pologne, où l'on travaillait à faire des lais. Il envoya le duc d'Oppellen pour y gouverner en son nom : la nation en fut extrêmement choquée, et le roi fut obligé de lui substituer trois seigneurs polonais agréables au peuple : Louis mourut sans être regretté.
Ce n'était pas assez à l'esprit républicain, d'avoir mitigé la royauté ; il frappa un autre grand coup, en abolissant la succession ; et la couronne fut déférée à la fille cadette de Louis, à condition qu'elle n'accepterait un époux que de la main de l'état. Parmi les concurrents qui se présentèrent, Jagellon fit briller la couronne de Lithuanie, qu'il promit d'incorporer à celle de Pologne. C'était beaucoup : mais ce n'était rien, s'il n'avait souscrit à la forme républicaine. C'est à ce prix qu'il épousa Hedwige, et qu'il fut roi.
Il y eut donc une république composée de trois ordres : le roi, le sénat, l'ordre équestre, qui comprend tout le reste de la noblesse, et qui donna bientôt des tribuns sous la dénomination de nonces. Ces nonces représentent tout l'ordre équestre dans les assemblées générales de la nation qu'on nomme dietes, et dont ils arrêtent l'activité, quand ils veulent, par le droit de veto. La république romaine n'avait point de roi : mais dans ses trois ordres, elle comptait les plébéïens, qui partageaient la souveraineté avec le sénat et l'ordre équestre ; et jamais peuple ne fut ni plus vertueux, ni plus grand. La Pologne différente dans ses principes, n'a compté son peuple qu'avec le bétail de ses terres. Le sénat qui tient la balance entre le roi et la liberté, voit sans émotion la servitude de cinq millions d'hommes, autrefois plus heureux lorsqu'ils étaient Sarmates.
La république polonaise étant encore dans son enfance, Jagellon parut oublier à quel prix il regnait : un acte émané du trône se trouva contraire à ce qu'il avait juré ; les nouveaux républicains sous ses yeux même, mirent l'acte en pièce avec leurs sabres.
Les rais, qui avant la révolution décidaient de la guerre ou de la paix, faisaient les lais, changeaient les coutumes, abrogeaient les constitutions, établissaient des impôts, disposaient du trésor public, virent passer tous ces ressorts de puissance dans les mains de la noblesse ; et ils s'accoutumèrent à être contredits. Mais ce fut sous Sigismond Auguste, au seizième siécle, que la fierté républicaine se monta sur le plus haut ton.
Ce prince étant mort sans enfants en 1573, on pensa encore à élever de nouveaux remparts à la liberté. On examina les lois anciennes ; les unes furent restreintes, les autres plus étendues, quelques-unes abolies ; et après bien des discussions, on fit un decret qui portait que les rois nommés par la nation, ne tenteraient aucune voie pour se donner un successeur ; et que conséquemment ils ne prendraient jamais la qualité d'héritiers du royaume ; qu'il y aurait toujours auprès de leur personne seize sénateurs pour leur servir de conseil ; et que sans leur aveu, ils ne pourraient ni recevoir des ministres étrangers, ni en envoyer chez d'autres princes ; qu'ils ne leveraient point de nouvelles troupes, et qu'ils n'ordonneraient point à la noblesse de monter à cheval sans l'aveu de tous les ordres de la république ; qu'ils n'admettraient aucun étranger au conseil de la nation ; et qu'ils ne leur conféreraient ni charges, ni dignités, ni starosties ; et qu'enfin ils ne pourraient point se marier, s'ils n'en avaient auparavant obtenu la permission du sénat, et de l'ordre équestre.
Tout l'interrègne se passa à se prémunir contre ce qu'on appelait les attentats du trône. Henri de Valais fut révolté à son arrivée de ce langage républicain qui dominait dans toutes les assemblées de l'état. La religion protestante était entrée dans le royaume sous Sigismond I. et ses progrès augmentaient à proportion des violences qu'on exerçait contre elle. Lorsque Henri arriva à Cracovie, on y savait que Charles IX. son frère venait d'assassiner une partie de ses sujets pour en convertir une autre. On craignait qu'un prince élevé dans une cour fanatique et violente, n'en apportât l'esprit : on voulut l'obliger à jurer une capitulation qu'il avait déjà jurée en France en présence des ambassadeurs de la république, et surtout l'article de la tolérance, qu'il n'avait juré que d'une façon vague et équivoque. Sans l'éloquent Pibrac, on ne sait s'il eut été couronné ; mais quelques mois après, le castellan de Sendomir Ossolenski, fut chargé lui sixième, de déclarer à Henri sa prochaine déposition, s'il ne remplissait plus exactement les devoirs du trône. Sa fuite précipitée termina les plaintes de la nation, et son règne.
C'est par tous ces coups de force, frappés en différents temps, que la Pologne s'est conservé des rois sans les craindre. Un roi de Pologne à son sacre même, et en jurant les pacta conventa, dispense les sujets du serment d'obéissance, en cas qu'il viole les lois de la république.
La puissance législative réside essentiellement dans la diete qui se tient dans l'ancien château de Varsovie, et que le roi doit convoquer tous les deux ans. S'il y manquait, la république a le pouvoir de s'assembler d'elle-même : les diétines de chaque palatinat, précèdent toujours la diete. On y prépare les matières qui doivent se traiter dans l'assemblée générale, et on y choisit les représentants de l'ordre équestre : c'est ce qui forme la chambre des nonces. Ces nonces ou ces tribuns sont si sacrés, que sous le règne d'Auguste II. un colonel saxon en ayant blessé un légèrement pour venger une insulte qu'il en avait reçue, fut condamné à mort et exécuté, malgré toute la protection du roi : on lui fit seulement grâce du bourreau ; il passa par les armes.
Pour connaître le sénat qui est l'âme de la diete, il faut jeter les yeux sur les évêques, les palatins, et les castellans. Ces deux dernières dignités ne sont pas aussi connues que l'épiscopat : un palatin est le chef de la noblesse dans son palatinat. Il préside à ses assemblées ; il la mène au champ électoral pour faire ses rais, et à la guerre lorsqu'on assemble la pospolite ou l'arriere-ban. Il a aussi le droit de fixer le prix des denrées, et de régler les poids et mesures ; c'est un gouvernement de province. Un castellan jouit des mêmes prérogatives dans son district, qui fait toujours partie d'un palatinat, et il représente le palatin dans son absence. Les castellans autrefois étaient gouverneurs des châteaux forts, et des villes royales. Ces gouvernements ont passé aux starostes qui exercent aussi la justice par eux-mêmes, ou par ceux qu'ils commettent. Une bonne institution, c'est un registre dont ils sont dépositaires : tous les biens du district libres ou engagés, y sont consignés : quiconque veut acquérir, achète en toute sûreté.
On ne voit qu'un staroste dans le sénat, celui de Samogitie ; mais on y compte deux archevêques, quinze évêques, trente-trois palatins, et quatre-vingt-cinq castellans ; en tout cent trente-six sénateurs.
Les ministres ont place au sénat sans être sénateurs ; ils sont au nombre de dix, en se répétant dans l'union des deux états.
Le grand maréchal de la couronne.
Le grand maréchal de Lithuanie.
Le grand chancelier de la couronne.
Le grand chancelier de Lithuanie.
Le vice-chancelier de la couronne.
Le vice-chancelier de Lithuanie.
Le grand trésorier de la couronne.
Le grand trésorier de Lithuanie.
Le maréchal de la cour de Pologne.
Le maréchal de la cour de Lithuanie.
Le grand maréchal est le troisième personnage de la Pologne. Il ne voit que le primat et le roi au-dessus de lui. Maitre du palais, c'est de lui que les ambassadeurs prennent jour pour les audiences. Son pouvoir est presque illimité à la cour, et à trois lieues de circonférence. Il y veille à la sûreté du roi, et au maintien de l'ordre. Il y connait de tous les crimes, et il juge sans appel. La nation seule peut réformer ses jugements. C'est lui encore qui convoque le sénat, et qui reprime ceux qui voudraient le troubler. Il a toujours des troupes à ses ordres.
Le maréchal de la cour n'a aucun exercice de juridiction que dans l'absence du grand maréchal.
Le grand chancelier tient les grands sceaux ; le vice-chancelier les petits. L'un des deux est évêque, pour connaître des affaires ecclésiastiques. L'un ou l'autre doit répondre au nom du roi en polonais ou en latin, selon l'occasion. C'est une chose singulière que la langue des Romains, qui ne pénétrèrent jamais en Pologne, se parle aujourd'hui communément dans cet état. Tout y parle latin jusqu'aux domestiques.
Le grand trésorier est dépositaire des finances de la république. Cet argent, que les Romains appelaient le trésor du peuple, aerarium populi, la Pologne se garde bien de le laisser à la direction des rais. C'est la nation assemblée, ou du moins un sénatus-consulte qui décide de l'emploi ; et le grand trésorier ne doit compte qu'à la nation.
Tous ces ministres ne ressemblent point à ceux des autres cours. Le roi les crée ; mais la république seule peut les détruire. Cependant, comme ils tiennent au trône, la source des grâces, et qu'ils sont hommes, la république n'a pas voulu leur accorder voix délibérative dans le sénat.
On donne aux sénateurs le titre d'excellence, et ils prétendent à celui de monseigneur, que les valets, les serfs, et la pauvre noblesse leur prodiguent.
Le chef du sénat est l'archevêque de Gnesne, qu'on nomme plus communément le primat, et dont nous ferons un article à part : c'est assez de dire en passant qu'il est aussi chef de l'église, dignité éminente qui donne à ce ministre de l'humble christianisme tout le faste du trône, et quelquefois toute sa puissance.
Le sénat hors de la diete, remue les ressorts du gouvernement sous les yeux du roi : mais le roi ne peut violenter les suffrages. La liberté se montre jusque dans les formes extérieures. Les sénateurs ont le fauteuil, et on les voit se couvrir dès que le roi se couvre. Cependant le sénat hors de la diete, ne décide que provisionnellement. Dans la diete, il devient législateur conjointement avec le roi et la chambre des nonces.
Cette chambre ressemblerait à celle des communes en Angleterre, si, au lieu de ne représenter que la noblesse, elle représentait le peuple. On voit à sa tête un officier d'un grand poids, mais dont l'office n'est que passager. Il a ordinairement beaucoup d'influence dans les avis de la chambre. C'est lui qui les porte au sénat, et qui rapporte ceux des sénateurs. On le nomme maréchal de la diete, ou maréchal des nonces. Il est à Varsovie ce qu'était le tribun du peuple à Rome ; et comme le patricien à Rome ne pouvait pas être tribun, celui qui était est le tribun des tribuns doit être pris dans l'ordre équestre, et non dans le sénat.
Lorsque la diete est assemblée, tout est ouvert, parce que c'est le bien public dont on y traite. Ceux qui n'y portent que de la curiosité sont frappés de la grandeur du spectacle. Le roi sur un trône élevé, dont les marches sont décorées des grands officiers de la cour ; le primat disputant presque toujours de splendeur avec le roi ; les sénateurs formant deux lignes augustes ; les ministres en face du roi, les nonces en plus grand nombre que les sénateurs, répandus autour d'eux, et se tenant debout : les ambassadeurs et le nonce du pape y ont aussi des places marquées, sauf à la diete à les faire retirer, lorsqu'elle le juge à-propos.
Le premier acte de la diete, c'est toujours la lecture des pacta conventa qui renferment les obligations que le roi a contractées avec son peuple ; et s'il y a manqué, chaque membre de l'assemblée a droit d'en demander l'observation.
Les autres séances pendant six semaines, durée ordinaire de la diete, amènent tous les intérêts de la nation ; la nomination aux dignités vacantes, la disposition des biens royaux en faveur des militaires qui ont servi avec distinction, les comptes du grand trésorier, la diminution ou l'augmentation des impôts selon la conjoncture, les négociations dont les ambassadeurs de la république ont été chargés, et la manière dont ils s'en sont acquittés, les alliances à rompre ou à former, la paix ou la guerre, l'abrogation ou la sanction d'une loi, l'affermissement de la liberté, enfin tout l'ordre public.
Les cinq derniers jours qu'on appelle les grands jours, sont destinés à réunir les suffrages. Une décision pour avoir force de loi, doit être approuvée par les trois ordres d'un consentement unanime. L'opposition d'un seul nonce arrête tout.
Ce privilège des nonces est une preuve frappante des révolutions de l'esprit humain. Il n'existait pas en 1652, lorsque Sicinski, nonce d'Upita, en fit le premier usage. Chargé de malédictions, il échappa avec peine aux coups de sabre ; et ce même privilège contre lequel tout le monde s'éleva pour lors, est aujourd'hui ce qu'il y a de plus sacré dans la république. Un moyen sur d'être mis en piéces, serait d'en proposer l'abolition.
On est obligé de convenir que, s'il produit quelquefois le bien, il fait encore plus de mal. Un nonce peut non-seulement anéantir une bonne décision ; mais s'il s'en prend à toutes, il n'a qu'à protester et disparaitre : la diete est rompue. Il arrive même qu'on n'attend pas qu'elle soit formée pour penser à la dissoudre. Le prétexte le plus frivole devient un instrument tranchant. En 1752 les nonces du palatinat de Kiovie avaient dans leurs instructions d'exiger du roi, avant tout, l'extirpation des francs-maçons, société qui n'effraie que les imbéciles et qui ne faisait aucune sensation en Pologne.
Le remède aux dietes rompues, c'est une confédération dans laquelle on décide à la pluralité des voix, sans avoir égard aux protestations des nonces ; et souvent une confédération s'élève contre l'autre. C'est ensuite aux dietes générales à confirmer ou à casser les actes de ces confédérations. Tout cela produit de grandes convulsions dans l'état, surtout si les armées viennent à s'en mêler.
Les affaires des particuliers sont mieux jugées. C'est toujours la pluralité qui décide ; mais point de juges permanens. La noblesse en crée chaque année pour former deux tribunaux souverains : l'un à Petrikow pour la grande Pologne, l'autre à Lublin pour la petite. Le grand duché de Lithuanie a aussi son tribunal. La justice s'y rend sommairement comme en Asie. Point de procureurs ni de procédures : quelques avocats seulement qu'on appelle juristes, ou bien on plaide sa cause soi-même. Une meilleure disposition encore, c'est que la justice se rendant gratuitement, le pauvre peut l'obtenir. Ces tribunaux sont vraiment souverains ; car le roi ne peut ni les prévenir par évocation, ni casser leurs arrêts.
Puisque j'en suis sur la manière dont la justice s'exerce en Pologne, j'ajouterai qu'elle se rend selon les statuts du royaume, que Sigismond Auguste fit rédiger en un corps en 1520 ; c'est ce qu'on appelle droit polonais. Et quand il arrive certains cas qui n'y sont pas compris, on se sert du droit saxon. Les jugements se rendent dans trois tribunaux supérieurs, à la pluralité des voix, et on peut en appeler au roi. Ces tribunaux jugent toutes les affaires civiles de la noblesse. Pour les criminelles, un gentilhomme ne peut être emprisonné, ni jugé que par le roi et le sénat.
Il n'y a point de confiscation, et la proscription n'a lieu que pour les crimes capitaux au premier chef, qui sont les meurtres, les assassinats, et la conjuration contre l'état. Si le criminel n'est point arrêté prisonnier dans l'action, il n'est pas besoin d'envoyer des soldats pour l'aller investir ; on le cite pour subir le jugement du roi et du sénat. S'il ne comparait pas, on le déclare infâme et convaincu ; par-là il est proscrit, et tout le monde peut le tuer en le rencontrant. Chaque starostie a sa juridiction dans l'étendue de son territoire. On appelle des magistrats des villes au chancelier, et la diete en décide quand l'affaire est importante.
Les crimes de lèze-majesté ou d'état sont jugés en diete. La maxime que l'église abhorre le sang, ne regarde point les évêques polonais. Une bulle de Clément VIII. leur permet de conseiller la guerre, d'opiner à la mort, et d'en signer les decrets.
Une chose encore qu'on ne voit guère ailleurs, c'est que les mêmes hommes qui délibèrent au sénat, qui font des lois en diete, qui jugent dans les tribunaux, marchent à l'ennemi. On aperçoit par-là qu'en Pologne la robe n'est point séparée de l'épée.
La noblesse ayant saisi les rênes du gouvernement, les honneurs et tous les avantages de l'état, a pensé que c'était à elle seule à le défendre, en laissant aux terres tout le reste de la nation. C'est aujourd'hui le seul pays où l'on voie une cavalerie toute composée de gentilshommes, dont le grand duché de Lithuanie fournit un quart, et la Pologne le reste.
L'armée qui en résulte, ou plutôt ces deux armées polonaise et lithuanienne, ont chacune leur grand général indépendant l'un de l'autre. Nous avons dit que la charge de grand maréchal, après la primatie, est la première en dignité : le grand général est supérieur en pouvoir. Il ne connait presque d'autres bornes que celles qu'il se prescrit lui-même. A l'ouverture de la campagne, le roi tient conseil avec les sénateurs et les chefs de l'armée sur les opérations à faire ; et dès ce moment le grand général exécute arbitrairement. Il assemble les troupes, il règle les marches, il décide des batailles, il distribue les récompenses et les punitions, il éleve, il casse, il fait couper des têtes, le tout sans rendre compte qu'à la république dans la diete. Les anciens connétables de France qui ont porté ombrage au trône, n'étaient pas si absolus. Cette grande autorité n'est suspendue que dans le cas où le roi commande en personne.
Les deux armées ont aussi respectivement un général de campagne, qui se nomme petit général. Celui-ci n'a d'autorité que celle que le grand général veut lui laisser ; et il la remplit en son absence. Un autre personnage, c'est le stragénik qui commande l'avant-garde.
La Pologne entretient encore un troisième corps d'armée, infanterie et dragons. L'emploi n'en est pas ancien. C'est ce qu'on appelle l'armée étrangère, presqu'entièrement composée d'allemands. Lorsque tout est complet, ce qui arrive rarement, la garde ordinaire de la Pologne est de quarante-huit mille hommes.
Une quatrième armée la plus nombreuse et la plus inutîle c'est la pospolite ou l'arriere-ban. On verrait dans un besoin plus de cent mille gentilshommes monter à cheval, pour ne connaître que la discipline qui leur conviendrait ; pour se révolter, si on voulait les retenir au-delà de quinze jours dans le lieu de l'assemblée sans les faire marcher ; et pour refuser le service, s'il fallait passer les frontières.
Quoique les Polonais ressemblent moins aux Sarmates leurs ancêtres, que les Tartares aux leurs, ils en conservent pourtant quelques traits. Ils sont francs et fiers. La fierté est assez naturelle à un gentilhomme qui élit son roi, et qui peut être roi lui-même. Ils sont emportés. Leurs représentants, dans les assemblées de la nation, décident souvent les affaires le sabre à la main. Ils font apprendre la langue latine à leurs enfants ; et la plupart des nobles, outre la langue esclavonne, qui leur est naturelle, parlent allemand, français et italien. La langue polonaise est une dialecte de l'esclavonne ; mais elle est mêlée de plusieurs mots allemands.
Ils ont oublié la simplicité et la frugalité des Sarmates leurs ancêtres. Jusqu'à la fin du règne de Sobieski, quelques chaises de bois, une peau d'ours, une paire de pistolets, deux planches couvertes d'un matelas, meublait un noble d'une fortune honnête. Aujourd'hui les vêtements des gentilshommes sont riches : ils portent pour la plupart des bottines couleur de soufre, qui ont le talon ferré, un bonnet fourré, et des vestes doublées de zibeline, qui leur vont jusqu'à mi-jambe ; c'est ainsi qu'ils paraissent dans les dietes ou dans les fêtes de cérémonies. D'autres objets de luxe se sont introduits en Pologne sous Auguste II. et les modes françaises déjà reçues en Allemagne, se sont mêlées à la magnificence orientale, qui montre plus de richesse que de gout. Leur faste est monté si haut, qu'une femme de qualité ne sort guère qu'en carosse à six chevaux. Quand un grand seigneur voyage d'une province à une autre, c'est avec deux cent chevaux, et autant d'hommes. Point d'hôtelleries ; il porte tout avec lui ; mais il déloge les plébéïens qui ne regardent cette haute noblesse que comme un fléau ; elle est de bonne heure endurcie au froid et à la fatigue ; parce que tous les gentilshommes se lavent le visage et le cou avec de l'eau froide, quelque temps qu'il fasse. Ils baignent aussi les enfants dans l'eau froide de très-bonne heure, ce qui endurcit leurs corps à l'âpreté des hivers dès la plus tendre jeunesse.
Un usage excellent des seigneurs, c'est qu'ils passent la plus grande partie de l'année dans leurs terres. Ils se rendent par-là plus indépendants de la cour, qui n'oublie rien pour les corrompre, et ils vivifient les campagnes par la dépense qu'ils y font.
Ces campagnes seraient peuplées et florissantes, si elles étaient cultivées par un peuple libre. Les serfs de Pologne sont attachés à la glèbe ; tandis qu'en Asie même on n'a point d'autres esclaves que ceux qu'on achète, ou qu'on a pris à la guerre : ce sont des étrangers. La Pologne frappe ses propres enfants. Chaque seigneur est obligé de loger son serf. C'est dans une très-pauvre cabane, où des enfants nuds sous la rigueur d'un climat glacé, pêle-mêle avec le bétail, semblent reprocher à la nature de ne les avoir pas habillés de même. L'esclave qui leur a donné le jour verrait tranquillement bruler sa chaumière, parce que rien n'est à lui. Il ne saurait dire mon champ, mes enfants, ma femme ; tout appartient au seigneur, qui peut vendre également le laboureur et le bœuf. Il est rare de vendre des femmes, parce que ce sont elles qui multiplient le troupeau ; population misérable : le froid en tue une grande partie.
Envain le pape Alexandre III. proscrivit dans un concîle la servitude au XIIe siècle, la Pologne s'est endurcie à cet égard plus que le reste du christianisme : malheur au serf si un seigneur ivre s'emporte contre lui. On dirait que ce que la nature a refusé à de certains peuples, c'est précisément ce qu'ils aiment avec le plus de fureur. L'excès du vin et des liqueurs fortes font de grands ravages dans la république. Les casuistes passent légèrement sur l'ivrognerie, comme une suite du climat ; et d'ailleurs les affaires publiques ne s'arrangent que le verre à la main.
Les femmes disputent aux hommes les jeux d'exercice, la chasse, et les plaisirs de la table. Moins délicates et plus hardies que les beautés du midi, on les voit faire sur la neige cent lieues en traineau, sans craindre ni les mauvais gîtes, ni les difficultés des chemins.
Les voyageurs éprouvent en Pologne que les bonnes mœurs valent mieux que les bonnes lois. La quantité des forêts, l'éloignement des habitations, la coutume de voyager de nuit comme de jour, l'indifférence des starostes pour la sûreté des routes, tout favorise le vol et l'assassinat ; dix ans en montrent à peine un exemple.
La Pologne avait déjà cette partie des bonnes mœurs avant que de recevoir le christianisme. Elle fut idolâtre plus longtemps que le reste de l'Europe. Elle avait adopté les dieux grecs qu'elle défigura, parce qu'ignorant les lettres, et ne se doutant pas de l'existence d'Homère ni d'Hésiode, elle n'avait jamais ouvert les archives de l'idolâtrie ; elle marchait au crépuscule d'une tradition confuse.
Vers le milieu du dixième siècle, le duc Miécislaw, premier du nom, cédant aux sollicitations de la belle Dambrowka sa femme, née chrétienne, embrassa la foi, et entreprit de la répandre. Dieu se sert de tout, adorable en tout. Ce sont des femmes sur le trône, qui en engageant leurs maris à se faire baptiser, ont converti la moitié de l'Europe ; Giselle, la Hongrie ; la sœur d'un empereur grec, la Russie ; la fille de Childebert, l'Angleterre ; Clotilde, la France.
Cependant si le christianisme, en s'établissant, avait été par-tout aussi violent qu'en Pologne, il manquerait de deux caractères de vérité qui le faisaient triompher dans les trois premiers siècles, la douceur et la persuasion. L'évêque de Mersebourg, qui vivait au temps de Miécislaw, nous apprend qu'on arrachait les dents à ceux qui avaient mangé de la viande en carême ; qu'on suspendait un adultère ou un fornicateur à un clou par l'instrument de son crime, et qu'on mettait un rasoir auprès de lui, avec la liberté de s'en servir pour se dégager ou de mourir dans cette torture. On voyait d'un autre côté des pères tuer leurs enfants imparfaits, et des enfants dénaturés assommer leurs pères décrépits ; coutume barbare des anciens Sarmates, que les Polonais n'ont quittée qu'au treizième siècle. Le terrible chrétien Miécislaw avait répudié sept femmes payennes pour s'unir à Dambrowka, et lorsqu'il l'eut perdue, il finit, si l'on en croit Baronius et Dithmar, par épouser une religieuse, qui n'oublia rien pour étendre la foi.
Son fils et son successeur, Boleslas I. étouffa sans violence les restes de l'idolâtrie. Humain, accessible, familier, il traita ses sujets comme des malades. Les armes qu'il employa contre leurs préjugés, furent la raison et la mansuétude ; le père leur avait ordonné d'être chrétiens, le fils le leur persuada.
Cet esprit de paix et de douceur dans les rais, passa à la nation. Elle prit fort peu de part à toutes les guerres de religion qui désolèrent l'Europe au XVIe et XVIIe siècle. Elle n'a eu dans son sein ni conspiration des poudres, ni saint Barthelemy, ni sénat égorgé, ni rois assassinés, ni des frères armés contre des frères ; et c'est le pays où l'on a brulé moins de monde pour s'être trompé dans le dogme. La Pologne cependant a été barbare plus longtemps que l'Espagne, la France, l'Angleterre, et l'Allemagne ; ce qui prouve qu'une demi-science est plus orageuse que la grossière ignorance ; et lorsque la Pologne a commencé à discourir, un de ses rais, Sigismond I. prononça la peine de mort contre la religion protestante.
Un paradoxe bien étrange, c'est que tandis qu'il poursuivait avec le fer, des hommes qui contestaient la présence de Jesus-Christ sur les autels, il laissait en paix les Juifs qui en niaient la divinité. Le sang coulait, et devait couler encore plus ; mais la république statua que désormais, les rois en montant sur le trône, jureraient la tolérance de toutes les religions.
On voit effectivement en Pologne des calvinistes, des luthériens, des grecs schismatiques, des mahométants et des juifs. Ceux-ci jouissent depuis longtemps des privilèges que Casimir-le-grand leur accorda en faveur de sa concubine, la juive Esther. Plus riches par le trafic que les naturels du pays, ils multiplient davantage. Cracovie seule en compte plus de vingt mille, qu'on trouve dans tous les besoins de l'état ; et la Pologne qui tolere près de trois cent synagogues, s'appelle encore aujourd'hui le paradis des Juifs : c'est-là qu'ils semblent revenus au règne d'Assuérus, sous la protection de Mardochée.
Il n'est peut-être aucun pays où les rites de la religion romaine soient observés plus strictement. Les Polonais, dès les premiers temps, ne trouvèrent point ces rites assez austères, et commencèrent le carême à la septuagésime ; ce fut le pape Innocent IV. qui abrogea cette surérogation rigoureuse, en récompense des contributions qu'ils lui avaient fournies pour faire la guerre à un empereur chrétien, Ferdinand II. A l'abstinence ordinaire du vendredi et du samedi, ils ont ajouté celle du mercredi.
Les confrairies sanglantes de Flagellans sont aussi communes dans cette partie du nord que vers le midi ; c'est peut-être de-là que le roi de France, Henri III. en rapporta le gout.
Aucune histoire, dans la même étendue de siècles, ne cite autant de miracles. On voit à cinq milles de Cracovie les salines de Bochnia ; c'est sainte Cunégonde, femme de Boleslas le chaste, disent toutes les chroniques, qui les a transportées de Hongrie en Pologne. Comme l'étude de la nature y est moins avancée que dans tout le reste du nord, le merveilleux, qui fut toujours la raison du peuple, y conserve encore plus d'empire qu'ailleurs.
Leur respect pour les papes s'est fait remarquer dans tous les temps. Lorsque Clément II. releva de ses vœux le moine Casimir, pour le porter du cloitre sur le trône en 1041, il imposa aux Polonais des conditions singulières, qui furent observées très-religieusement. Il les obligea à porter désormais les cheveux en forme de couronne monachale, à payer par tête tous les ans à perpétuité, une somme d'argent pour l'entretien d'une lampe très-chère dans la basilique de saint Pierre ; et il voulut qu'aux grandes fêtes, durant le temps du sacrifice, tous les nobles eussent au cou une étole de lin pareille à celle des prêtres : la première condition se remplit encore aujourd'hui.
Ce dévouement outré pour les decrets de Rome, se déborda jusqu'à engloutir la royauté. Boleslas I. avait reçu le titre de roi de l'empereur Othon, l'an 1001. Rome s'en souvint lorsque Boleslas II. versa le sang de l'évêque Stanislas. Dans ce temps-là Hildebrand, qui avait passé de la boutique d'un charron sur la chaire de saint Pierre, sous le nom de Grégoire VII. se rendit redoutable à tous les souverains. Il venait d'excommunier l'empereur Henri IV. dont il avait été précepteur. Il lança ses foudres sur Boleslas, excommunication, dégradation, interdit sur tout le royaume, dispense du serment de fidélité, et défense aux évêques de Pologne de couronner jamais aucun roi sans le consentement exprès du saint siege. On ne sait ce qui étonne le plus, la défense du pontife, ou l'obéissance aveugle des Polonais. Pas un évêque n'osa sacrer le successeur, et cette crainte superstitieuse dura pendant deux siècles, dans les sujets comme dans les princes, jusqu'à Przémislas, qui assembla une diete générale à Gnesne, s'y fit sacrer, et reprit le titre de roi, sans prendre les auspices de Rome.
Aujourd'hui les papes ne tenteraient pas ce qu'ils ont exécuté alors ; mais il est encore vrai que leur puissance est plus respectée en Pologne que dans la plupart des états catholiques. Une nation qui a pris sur elle de faire ses rais, n'a pas osé les proclamer sans la permission du pape. C'est une bulle de Sixte V. qui a donné ce pouvoir au primat. On voit constamment à Varsovie un nonce apostolique avec une étendue de puissance qu'on ne souffre point ailleurs. Il n'en a pourtant pas assez pour soutenir l'indissolubilité du mariage. Il n'est pas rare en Pologne d'entendre dire à des maris, ma femme qui n'est plus ma femme. Les évêques témoins et juges de ces divorces, s'en consolent avec leurs revenus. Les simples prêtres paraissent très-respectueux pour les saints canons, et ils ont plusieurs bénéfices à charge d'ames.
La Pologne, telle qu'elle est aujourd'hui dans le moral et dans le physique, présente des contrastes bien frappans ; la dignité royale avec le nom de république ; des lois avec l'anarchie féodale ; des traits informes de la république romaine avec la barbarie gothique ; l'abondance et la pauvreté.
La nature a mis dans cet état tout ce qu'il faut pour vivre, grains, miel, cire, poisson, gibier ; et tout ce qu'il faut pour l'enrichir, blés, pâturages, bestiaux, laines, cuirs, salines, métaux, minéraux ; cependant l'Europe n'a point de peuple plus pauvre ; la plus grande source de l'argent qui roule en Pologne, c'est la vente de la royauté.
La terre et l'eau, tout y appelle un grand commerce, et le commerce ne s'y montre pas. Tant de rivières et de beaux fleuves, la Duna, le Bog, le Niester, la Vistule, le Niemen, le Borysthène, ne servent qu'à figurer dans les cartes géographiques. On a remarqué depuis longtemps, qu'il serait aisé de joindre par des canaux l'Océan septentrional et la mer Noire, pour embrasser le commerce de l'Orient et de l'Occident ; mais loin de construire des vaisseaux marchands, la Pologne, qui a été insultée plusieurs fois par des flottes, n'a pas même pensé à une petite marine guerrière.
Cet état, plus grand que la France, ne compte que cinq millions d'habitants, et laisse la quatrième partie de ses terres en friche ; terres excellentes, perte d'autant plus déplorable.
Cet état large de deux cent de nos lieues, et long de quatre cent, aurait besoin d'armées nombreuses pour garder ses vastes frontières ; il peut à peine soudoyer quarante mille hommes. Un roi qui l'a gouverné quelque temps, et qui nous montre dans une province de France ce qu'il aurait pu exécuter dans un royaume ; ce prince fait pour écrire et pour agir, nous dit qu'il y a des villes en Europe dont le trésor est plus opulent que celui de la Pologne, et il nous fait entendre que deux ou trois commerçans d'Amsterdam, de Londres, de Hambourg, négocient pour des sommes plus considérables pour leur compte, que n'en rapporte tout le domaine de la république.
Le luxe, cette pauvreté artificielle, est entré dans les maisons de Pologne, et les villes sont dégoutantes par des boues affreuses ; Varsovie n'est pavée que depuis peu d'années.
Le comble de l'esclavage et l'excès de la liberté semblent disputer à qui détruira la Pologne ; la noblesse peut tout ce qu'elle veut. Le corps de la nation est dans la servitude. Un noble Polonais, quelque crime qu'il ait commis, ne peut être arrêté qu'après avoir été condamné dans l'assemblée des ordres : c'est lui ouvrir toutes les portes pour se sauver. Il y a une loi plus affreuse que l'homicide même qu'elle veut réprimer. Ce noble qui a tué un de ses serfs met quinze livres sur la fosse, et si le paysan appartient à un autre noble, la loi de l'honneur oblige seulement à en rendre un ; c'est un bœuf pour un bœuf. Tous les hommes sont nés égaux, c'est une vérité qu'on n'arrachera jamais du cœur humain ; et si l'inégalité des conditions est devenue nécessaire, il faut du-moins l'adoucir par la liberté naturelle et par l'égalité des lois.
Le liberum veto donne plus de force à un seul noble qu'à la république. Il enchaine par un mot les volontés unanimes de la nation ; et s'il part de l'endroit où se tient la diete, il faut qu'elle se sépare. C'était le droit des tribuns romains ; mais Rome n'en avait qu'un petit nombre, et ce furent des magistrats pour protéger le peuple. Dans une diete polonaise on voit trois ou quatre cent tribuns qui l'oppriment.
La république a pris, autant qu'elle a pu, toutes les précautions pour conserver l'égalité dans la noblesse, et c'est pour cela qu'elle ne tient pas compte des décorations du saint empire qui seme l'Europe de princes. Il n'y a de princes reconnus pour tels par les lettres d'union de la Lithuanie, que les Czartoriski, les Sangusko, et les Wieçnowiecki, et encore le titre d'altesse ne les tire pas de l'égalité ; les charges seules peuvent donner des préséances. Le moindre castellan précède le prince sans charge, pour apprendre à respecter la république, plus que les titres et la naissance : malgré tout cela, rien de si rampant que la petite noblesse devant la grande.
Puisque le royaume est électif, il semble que le peuple, qui est la partie la plus nombreuse et la plus nécessaire, devrait avoir part à l'élection : pas la moindre. Il prend le roi que la noblesse lui donne ; trop heureux s'il ne portait pas des fers dans le sein de la liberté. Tout ce qui n'est pas noble vit sans considération dans les villes, ou esclave dans les campagnes ; et l'on sait que tout est perdu dans un état, lorsque le plebéïen ne peut s'élever que par un bouleversement général. Aussi la Pologne n'a-t-elle qu'un petit nombre d'ouvriers et de marchands, encore sont-ils allemands, juifs, ou français.
Dans ses guerres, elle a recours à des ingénieurs étrangers. Elle n'a point d'école de Peinture, point de théâtre ; l'Architecture y est dans l'enfance ; l'Histoire y est traitée sans goût ; les Mathématiques peu cultivées ; la saine Philosophie presque ignorée ; nul monument, nulle grande ville.
Tandis qu'une trentaine de palatins, une centaine de castellans et starostes, les évêques et les grands officiers de la couronne jouent les satrapes asiatiques, 100 mille petits nobles cherchent le nécessaire comme ils peuvent. L'histoire est obligée d'insister sur la noblesse polonaise, puisque le peuple n'est pas compté. Le droit d'élire ses rois est celui qui flatte le plus, et qui la sert le moins. Elle vend ordinairement sa couronne au candidat qui a le plus d'argent ; elle crie dans le champ électoral qu'elle veut des princes qui gouvernent avec sagesse ; et depuis le règne de Casimir le grand, elle a cherché en Hongrie, en Transilvanie, en France et en Allemagne, des étrangers qui n'ont aucune connaissance de ses mœurs, de ses préjugés, de sa langue, de ses intérêts, de ses lois, de ses usages.
Qui verrait un roi de Pologne dans la pompe de la majesté royale, le croirait le monarque le plus riche et le plus absolu : ni l'un ni l'autre. La république ne lui donne que six cent mille écus pour l'entretien de sa maison ; et dans toute contestation, les Polonais jugent toujours que le roi a tort. Comme c'est lui qui préside aux conseils et qui publie les decrets, ils l'appellent la bouche, et non l'âme de la république. Ils le gardent à vue dans l'administration : quatre sénateurs doivent l'observer par-tout, sous peine d'une amande pécuniaire. Son chancelier lui refuse le sceau pour les choses qu'il ne croit pas justes. Son grand chambellan a droit de le fouiller ; aussi ne donne-t-il cette charge qu'à un favori.
Ce roi, tel qu'il est, joue pourtant un beau rôle s'il sait se contenter de faire du bien, sans tenter de nuire. Il dispose non-seulement, comme les autres souverains, de toutes les grandes charges du royaume et de la cour, des évêchés et des abbayes, qui sont presque toutes en commende, car la république n'a pas voulu que des moines qui ont renoncé aux richesses et à l'état de citoyen, possédassent au-delà du nécessaire ; il a encore un autre trésor qui ne s'épuise pas. Un tiers de ce grand royaume est en biens royaux, tenutes, advocaties, starosties, depuis sept mille livres de revenu jusqu'à cent mille ; ces biens royaux, le roi ne pouvant se les approprier, est obligé de les distribuer, et ils ne passent point du père au fils aux dépens du mérite. Cette importante loi est une de celles qui contribuent le plus au soutien de la république. Si cette république n'est pas encore détruite, elle ne le doit qu'à ses lois : c'est une belle chose que les lois ! Un état qui en a et qui ne les enfreint point, peut bien éprouver des secousses ; mais c'est la terre qui tremble entre les chaînes de rochers qui l'empêchent de se dissoudre.
Résumons à-présent les traits frappans du tableau de la Pologne, que nous avons dessiné dans tout le cours de cet article.
Cette monarchie a commencé l'an 550, dans la personne de Leck, qui en fut le premier duc. Au neuvième siècle, l'anarchie qui déchirait l'état finit par couronner un simple particulier qui n'avait pour recommandation qu'une raison droite et des vertus. C'est Piast qui donna une nouvelle race de souverains qui tinrent longtemps le sceptre. Quelques-uns abusèrent de l'autorité, ils furent déposés. On vit alors la nation, qui avait toujours obéi, s'avancer par degrés vers la liberté, mettre habilement les révolutions à profit, et se montrer prête à favoriser le prétendant qui relâcherait davantage les chaînes. Ainsi parvenue peu-à-peu à donner une forme républicaine à l'administration, elle la cimenta, lorsque sur la fin du xiv. siècle ses nobles firent acheter à Jagellon, duc de Lithuanie, l'éclat de la couronne par le sacrifice de sa puissance.
Le Christianisme ne monta sur le trône de Pologne que dans le Xe siècle, et il y monta avec cruauté. Cette auguste religion y a repris finalement l'esprit de douceur qui la caractérise : elle tolere dans l'état des sectes que mal-à-propos elle avait bannies de son sein ; mais en même temps la Pologne est restée superstitieusement soumise aux decrets du pontife de Rome, dont le nonce à Varsovie a un pouvoir très-étendu. Un archevêque, celui de Gnesne, est le chef du sénat comme de l'église ; les autres prélats polonais munis comme lui du privilège d'un pape, ont par ce privilège le droit de teindre leurs mains pacifiques du sang de leurs enfants, en les condamnant à la mort. Il n'y a dans toute la Pologne que trois ou quatre villes qui puissent posséder des terres ; et quoiqu'on soit accoutumé à voir dans l'histoire de ce pays le malheureux sort des paysans, on frémit toujours en contemplant cette dégradation de l'humanité, qui n'a pas encore cédé au christianisme mal épuré de ce royaume.
La puissance souveraine réside dans la noblesse ; elle est représentée par ses nonces ou députés dans les dietes générales. Les lois se portent dans ses assemblées, et obligent le roi même.
Dans l'intervalle de ces parlements de la nation, le sénat veille à l'exécution des lois. Dix ministres du roi, qui sont les premiers officiers de la couronne, ont place dans ce conseil, mais n'y ont point de voix. Les rois de Pologne en nommant à toutes les charges, peuvent faire beaucoup de bien, &, pour ainsi dire, point de mal.
Le gouvernement est en même temps monarchique, et aristocratique. Le roi, le sénat et la noblesse, forment le corps de la république. Les évêques, qui sont au nombre de quinze sous deux archevêques, tiennent le second rang, et ont la presséance au sénat.
On voit dans ce royaume des grands partageant la puissance du monarque, et vendant leurs suffrages pour son élection et pour soutenir leur pompe fastueuse. On ne voit en même temps point d'argent dans le trésor public pour soudoyer les armées, peu d'artillerie, peu ou point de moyens pour entretenir les subsides ; une faible infanterie, presqu'aucun commerce : on y voit en un mot une image blafarde des mœurs et du gouvernement des Goths.
En vain la Pologne se vante d'une noblesse belliqueuse, qui peut monter à cheval au nombre de cent mille hommes : on a Ve dix mille russes, après l'élection du roi Stanislas, disperser toute la noblesse polonaise assemblée en faveur de ce prince, et lui donner un autre roi. On a Ve dans d'autres occasions cette armée nombreuse monter à cheval, s'assembler, se révolter, se donner quelques coups de sabres, et se séparer tout de suite.
L'indépendance de chaque gentilhomme est l'objet des lois de ce pays ; et ce qui en résulte par leur liberum veto, est l'oppression de tous.
Enfin ce royaume du nord de l'Europe use si mal de sa liberté et du droit qu'il a d'élire ses rais, qu'il semble vouloir consoler par-là les peuples ses voisins, qui ont perdu l'un et l'autre de ces avantages.
Pour achever complete ment le tableau de la Pologne, il ne nous reste qu'à crayonner les principaux d'entr'eux qui l'ont gouvernée depuis le VIe siècle jusqu'à ce jour. Dans ce long espace de temps elle compte des chefs intelligens, actifs et laborieux, plus qu'aucun autre état ; et ce n'est pas le hasard qui lui a donné cet avantage, c'est la nature de sa constitution. Dès le xiv. siècle elle a fait ses rois : ce ne sont pas des enfants qui naissent avec la couronne avant que d'avoir des vertus, et qui dans la maturité de l'âge peuvent encore sommeiller sur le trône. Un roi de Pologne doit payer de sa personne dans le sénat, dans les dietes, et à la tête des armées. Si l'on n'admire que les vertus guerrières, la Pologne peut se vanter d'avoir eu de grands princes ; mais si l'on ne veut compter que ceux qui ont voulu la rendre plus heureuse qu'elle ne l'est, il y a beaucoup à rabattre.
Leck la tira des forêts et de la vie errante, pour la fixer et la civiliser. L'histoire ne nous a pas conservé son caractère, mais on sait en général que les fondateurs des empires ont tous eu de la tête et de l'exécution.
Cracus, dans le VIIe siècle, leur donna les premières idées de la justice, en établissant des tribunaux pour décider des différends des particuliers. L'ordre régna où la licence diminuait. Cracovie idolâtre honora longtemps son tombeau : c'était son palladium.
Au IXe siècle, Piast enseigna la vertu en la montrant dans lui-même : ce qu'il ne pouvait obtenir par la force du commandement, il le persuadait par la raison et par l'exemple. Son règne s'écoula dans la paix, et des barbares commencèrent à devenir citoyens.
Dans le Xe siècle, Boleslas Chrobri, plein d'entrailles, les accoutuma à regarder leur souverain comme leur père, et l'obéissance ne leur couta rien.
Casimir I. fit entrevoir les Sciences et les Lettres dans cette terre sauvage, où elles n'étaient jamais entrées. La culture grossière qu'on leur donna attendait des siècles plus favorables pour produire des fruits : ces fruits sont encore bien âpres ; mais le temps qui mûrit tout, achevera peut-être un jour en Pologne ce qu'il a perfectionné en d'autres climats.
Dans le siècle suivant, Casimir II. qui ne fut nommé le juste qu'après l'avoir mérité, commença à protéger les gens de la campagne contre la tyrannie de la noblesse.
Au xiv. siècle, Casimir III. ou Casimir le grand, qu'on appelait aussi le roi des paysans, voulut les mettre en liberté ; et n'ayant pu y réussir, il demandait à ces bonnes gens lorsqu'ils venaient se plaindre, s'il n'y avait chez eux ni pierres ni bâtons pour se défendre. Casimir eut les plus grands succès dans toutes les autres parties du gouvernement. Sous son règne, des villes nouvelles parurent, et servirent de modèle pour rebâtir les anciennes. C'est à lui que la Pologne doit le nouveau corps de lois qui la règle encore à-présent. Il fut le dernier des Piast, race qui a régné 528 ans.
Jagellon fit tout ce qu'il voulut avec une nation d'autant plus difficîle à gouverner, que sa liberté naissante était toujours en garde contre les entreprises de la royauté. Il est étonnant que le trône toujours électif dans sa race, n'en soit pas sorti pendant près de 400 ans ; tandis qu'ailleurs des couronnes héréditaires passaient à des familles étrangères. Cela montre combien les événements trompent la sagesse humaine.
Le fils de Jagellon, Uladislas VI. n'avait que 10 ans lorsqu'on l'éleva au trône, chose bien singulière dans une nation qui pouvait donner sa couronne à un héros tout formé ; c'est qu'on en apercevait déjà l'âme à-travers les nuages de l'enfance. La république nomma autant de régens qu'il y avait de provinces, et des Burrhus se chargèrent d'instruire l'homme de la nation. Il prit les rênes de l'état à 18 ans ; et en deux ans de règne il égala les grands rais. Il triompha des forces de la maison d'Autriche ; il se fit couronner roi de Hongrie ; il fut le premier roi de Pologne qui osa lutter contre la fortune de l'empire Ottoman. Cette hardiesse lui fut fatale ; il périt à la bataille de Varne, à peine avait-il 20 ans ; et la Pologne regrettant également l'avenir et le passé, ne versa jamais de pleurs plus amers.
Elle n'essuya bien ses larmes que dans le XVIe siècle, sous le règne de Sigismond I. Ce prince eut un bonheur rare dans la diete d'élection ; il fut nommé roi par acclamation, sans division des suffrages. Une autre faveur de la fortune lui arriva, parce que les grands hommes savent la fixer. Il abattit la puissance d'un ordre religieux qui désolait la Pologne depuis trois siècles ; je parle des chevaliers teutoniques. Sigismond était doué d'une force extraordinaire, qui le faisait passer pour l'Hercule de son temps ; il brisait les métaux les plus durs, et il avait l'âme aussi forte que le corps. Il a vécu 82 ans, presque toujours victorieux, respecté et ménagé par tous les souverains, par Soliman même, qui ne ménageait rien. Il a peut-être été supérieur à François I. en ce que plus jaloux du bonheur de ses peuples que de sa gloire, il s'appliqua constamment à rendre la nation plus équitable que ses lois, les mœurs plus sociables, les villes plus florissantes, les campagnes plus cultivées, les Arts et les Sciences plus honorés, la religion même plus épurée.
Personne ne lui ressembla plus parmi ses successeurs, qu'Etienne Battori, prince de Transilvanie, à qui la Pologne donna sa couronne, après la fuite d'Henri de Valais. Il se fit une loi de ne distribuer les honneurs et les emplois qu'au mérite ; il réforma les abus qui s'étaient accumulés dans l'administration de la justice ; il entretint le calme au-dedans et au-dehors. Il régna dix ans : c'était assez pour sa gloire, pas assez pour la république.
Sigismond III. prince de Suède, lui succéda sans le remplacer ; il n'eut ni les mêmes qualités ni le même bonheur ; il perdit un royaume héréditaire pour gagner une couronne élective ; il laissa enlever à la Pologne, par Gustave-Adolphe, l'une de ses plus belles provinces, la Livonie. Il avait deux défauts qui causent ordinairement de grands malheurs ; il était borné et obstiné.
Casimir V. (Jean) fut le dernier de la race des Jagellons. Rien de plus varié que la fortune de ce prince. Né fils de roi, il ne put résister à l'envie d'être religieux, espèce de maladie qui attaque la jeunesse, dit l'abbé de Saint-Pierre, et qu'il appelle la petite vérole de l'esprit. Le pape l'en guérit en le faisant cardinal. Le cardinal se changea en roi ; et après avoir gouverné un royaume, il vint en France pour gouverner des moines. Les deux abbayes que Louis XIV. lui donna, celle de S. Germain-des-Prés et celle de S. Martin de Nevers, devinrent pour lui une subsistance nécessaire, car la Pologne lui refusait la pension dont elle était convenue ; et pendant ce temps-là il y avait en France des murmures contre un étranger qui venait ôter le pain aux enfants de la maison. Il voyait souvent Marie Mignot, cette blanchisseuse que le caprice de la fortune avait d'abord placée dans le lit d'un conseiller du parlement de Grenoble, et ensuite dans celui du maréchal de l'Hôpital. Cette femme singulière, deux fois veuve, soutenait à Gourville qu'elle avait épousé secrètement le roi Casimir. Elle était avec lui à Nevers lorsqu'il y tomba malade et qu'il y finit ses jours en 1672.
Michel Wiecnoviecki fut élu roi de Pologne en 1669, après l'abdication de Casimir. Jamais roi n'eut plus besoin d'être gouverné ; et en pareil cas ce ne sont pas toujours les plus éclairés et les mieux intentionnés qui gouvernent. Au bout de quelques années il se forma une ligue pour le détrôner. Les Polonais ont pour maxime que tout peuple qui peut faire un roi, peut le défaire. Ainsi ce qu'on appellerait ailleurs conjuration, ils le nomment l'exercice d'un droit national. Cependant les seigneurs ligués ne poussèrent pas plus loin leur projet, par la crainte de l'empereur, et en considération de la misérable santé du roi, qui finit ses jours l'année suivante sans postérité, à l'âge de 35 ans, après quatre ans de troubles et d'agitations. Si le sceptre peut rendre un mortel heureux, c'est seulement celui qui le sait porter. L'incapacité du roi Michel fit son malheur et celui de l'état ; ses yeux se fermèrent en 1673 la veille de la victoire de Choczin.
Jean Sobieski, qui remporta cette victoire, fut nommé roi de Pologne l'année suivante, et se montra un des grands guerriers du dernier siècle. C'est à l'article OLESKO, lieu de sa naissance, que vous trouverez son caractère. Il mourut à Varsovie dans la 66e année de son âge.
Frédéric Auguste I. électeur de Saxe, devint roi de Pologne au moyen de son abjuration du Luthéranisme, et de l'argent qu'il répandit. Il se ligua en 1700 avec le roi de Danemarck et le czar, contre Charles XII. Il se proposait par cette ligue d'assujettir la Pologne, en se rendant plus puissant par la conquête de la Livonie ; mais les Polonais le déposèrent en 1704, et élurent en sa place Stanislas Lesczinski, palatin de Posnanie, âgé de 26 ans. Les Saxons ayant été battus par ce prince et par le roi de Suède, Auguste se vit obligé de signer un traité de renonciation à la couronne polonaise. La perte de la bataille de Pultowa en 1709, fut le terme des prospérités de Charles XII. Ce revers entraina la chute de son parti. Auguste rentra dans la Pologne, et le Czar victorieux l'y suivit pour l'y maintenir. Le roi Stanislas ne pouvant résister à tant de forces réunies, se rendit à Bender auprès du roi de Suède.
Les événements de la vie du roi Stanislas sont bien remarquables. Son père Raphaël Lesczinski avait été grand général de la Pologne, et ne craignit jamais de déplaire à la cour pour servir la république. Grand par lui-même, plus grand encore dans son fils, dont Louis XV. est devenu le gendre ; les Polonais témoins de sa valeur, et charmés de la sagesse et de la douceur de son gouvernement, pendant le court espace qu'avait duré son règne, l'élurent une seconde fois après la mort d'Auguste (en 1733). Cette élection n'eut pas lieu, par l'opposition de Charles VI. que soutenaient ses armes, et par celles de la Russie. Le fils de l'électeur de Saxe qui avait épousé une nièce de l'empereur, l'emporta de force sur son concurrent ; mais Stanislas conservant toujours de l'aveu de l'Europe le titre de roi, dont il était si digne, fut fait duc de Lorraine, et vint rendre heureux de nouveaux sujets qui se souviendront longtemps de lui.
L'Histoire juge les princes sur le bien qu'ils font. Si jamais la Pologne a quelque grand roi sur le trône pour la rétablir, ce sera celui-là seul, comme le dit M. l'abbé Coyer, " qui regardant autour de lui une terre féconde, de beaux fleuves, la mer Baltique et la mer Noire, donnera des vaisseaux, des manufactures, du commerce, des finances et des hommes à ce royaume ; celui qui abolira la puissance tribunitienne, le liberum veto, pour gouverner la nation par la pluralité des suffrages ; celui qui apprendra aux nobles que les serfs qui les nourrissent, issus des Sarmates leurs ancêtres communs, sont des hommes ; et qui, à l'exemple d'un roi de France plus grand que Clovis et Charlemagne, bannira la servitude, cette peste civîle qui tue l'émulation, l'industrie, les arts, les sciences, l'honneur et la prospérité : c'est alors que chaque Polonais pourra dire :
Nam que erit ille mihi semper deus ".
(D.J.)
POLOGNE, sacre des rois de, (Histoire des cérémonies de Pologne) la Pologne, pour le choix de la scène du couronnement, fait comme la France. Au lieu de sacrer ses rois dans la capitale, elle les mène à grands frais dans une ville moins commode et moins belle, à Cracovie, parce que Ladislas Loketek, au iv. siècle, s'y fit couronner.
Ceux qui aiment les grands spectacles, sans penser à ce qu'ils coutent aux peuples, seraient frappés de celui-ci. On y voit la magnificence asiatique se mêler au goût de l'Europe. Des esclaves éthiopiens, des orientaux en vêtements de couleur du ciel, de jeunes Polonais en robes de pourpre, une armée qui ne veut que briller ; les voitures, les hommes et les chevaux disputant de richesses, l'or effacé par les pierreries : c'est au milieu de ce cortege que le roi élu parait sur un cheval magnifiquement harnaché.
La Pologne, dans l'inauguration de ses rais, leur présente le trône et le tombeau. On commence par les funérailles du dernier roi, dont le corps reste en dépôt jusqu'à ce jour ; mais comme cette pompe funébre ressemble en beaucoup de choses à celle des autres rais, je n'en citerai qu'une singularité. Aussitôt que le corps est posé sur le catafalque dans la cathédrale, un hérault à cheval, armé de pied en cap, entre par la grande porte, court à toute bride, et rompt un sceptre contre le catafalque. Cinq autres courant de même, brisent l'un la couronne, l'autre le globe, le quatrième un cimeterre, le cinquième un javelot, le sixième une lance, le tout au bruit du canon, des trompettes et des tymbales.
Les reines de Pologne ont un intérêt particulier au couronnement. Sans cette solennité, la république, dans leur viduité, ne leur doit point d'apanage, (cet apanage ou douaire est de deux mille ducats assignés sur les salines et sur les starosties de Spiz et de Grodeck), et même elle cesse de les traiter de reines. Il s'est pourtant trouvé deux reines qui ont sacrifié tous ces avantages à leur religion, l'épouse d'Alexandre au XVIe siècle, et celle d'Auguste II. au XVIIe siècle : la première professait la religion grecque, la seconde le luthéranisme qu'Auguste venait d'abjurer ; ni l'une ni l'autre ne furent couronnées.
La pompe finit par un usage assez singulier. Un évêque de Cracovie assassiné par son roi dans l'onzième siècle, étant à son tribunal, c'est-à-dire dans la chapelle où son sang fut versé, cite le nouveau roi comme s'il était coupable de ce forfait. Le roi s'y rend à pied, et répond comme ses prédécesseurs " que ce crime est atroce, qu'il en est innocent, qu'il le déteste, et en demande pardon en implorant la protection du saint martyr sur lui et sur le royaume ". Il serait à souhaiter que dans tous les états, on conservât ainsi les monuments des crimes des rais. La flatterie ne leur trouve que des vertus.
Ensuite le roi, suivi du sénat et des grands officiers tous à cheval, se rend à la place publique. Là sur un théâtre élevé, couvert des plus riches tapis de l'Orient, il reçoit le serment de fidélité des magistrats de Cracovie, dont il ennoblit quelques-uns. C'est la seule occasion où un roi de Pologne puisse faire des nobles. La noblesse ne doit se donner que dans une diete après dix ans au-moins de service militaire. Histoire de Sobieski, par M. l'abbé Coyer. (D.J.)
POLOGNE
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Géographie moderne
- Affichages : 1487