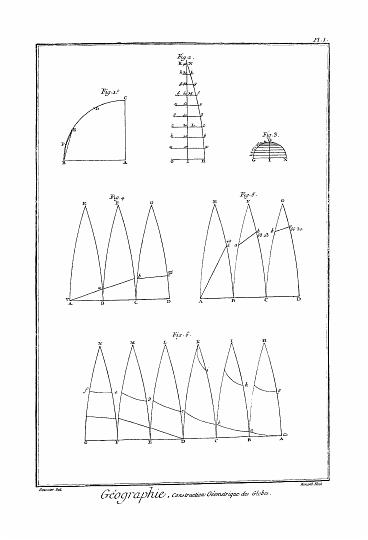(Géographie ancienne) ville d'Italie, sur l'Adige, dans les terres, aux confins de l'ancienne Rhétie. Elle fut fondée, selon Pline, l. III. c. xix. par les Rhétiens et par les Euganéens en commun ; mais Tite-Live, l. V. c. xxxv. fait entendre qu'elle fut bâtie par une troupe de gaulois, qui après avoir passé les Alpes sous la conduite d'Elitovius, s'établirent, ubi nunc, dit-il, Brixia ac Verona urbes sunt. Tout cela néanmoins peut se concilier, en disant que Vérone doit ses commencements aux Rhétiens et aux Euganéens, et que les Gaulois s'étant emparés du Bressan, se rendirent ensuite maîtres du Véronèse. Martial, l. XIV. epigr. 195, parle de Vérone comme d'une ville considérable.
Tantùm magna suo debet Verona Catullo,
Quantùm parva suo Mantua Virgilio.
Tacite qui lui donne le nom de colonie romaine, fait l'éloge de sa beauté et de son opulence. Cn. Pompeius Arabo, père du grand Pompée, avait été le conducteur de la colonie, qui fut renouvellée sous Galien, et honorée du titre de colonia augusta. Un double arc-de-triomphe, qui a été autrefois une des portes de la ville, conserve l'inscription suivante :
Colonia Augusta Verona Nova Gallieniana
Valeriano II. et Lucilio Cons.
Muri Veronensium Fabricati ex die III.
Non. April.
Dedicati Pr. Non. Decembris
Jubente Sanctissimo Gallieno. Aug. N.
Les habitants de cette ville sont communément appelés Veronenses par les anciens auteurs ; cependant on a d'anciennes inscriptions où ils sont nommés Verones.
Vérone fut heureuse sous les empereurs ; mais elle éprouva de tristes malheurs lors de la chute de l'empire d'Occident, et elle a souffert depuis plusieurs révolutions qui l'ont dépouillée de toute son ancienne splendeur.
Elle fut pillée par Attila, et possédée successivement par Odoacre, roi des Herules, par Théodoric, roi des Goths, et par ses successeurs jusqu'à Totila, par les Lombards, par Charlemagne et par sa postérité ; mais lorsque ses descendants perdirent l'empire, il s'éleva plusieurs seigneurs qui tâchèrent de se rendre souverains dans plusieurs villes d'Italie. Cela dura jusqu'à Othon I. qui réunit à l'empire divers états qui en avaient été détachés. Vérone rentra alors dans la masse ; mais elle reçut le pouvoir d'élire ses magistrats ; de sorte qu'elle était proprement une république libre sous le nom de ville impériale.
Cet état dura jusqu'à-ce qu'Actiolin se fût emparé de la puissance souveraine : ce qui ne se fit qu'avec beaucoup d'effusion de sang. Il jouit de la tyrannie trente-trois ans, et mourut l'an 1269. Après cela les Véronais élurent pour général Martin de l'Escale, et se trouvèrent si bien de sa conduite, qu'ils le créèrent dictateur perpétuel.
Ses descendants commandèrent dans Vérone avec beaucoup de réputation, et en furent créés princes par l'empereur l'an 1310. Ils se rendirent formidables par leurs conquêtes, et furent chassés de Vérone l'an 1387, par Jean Galéas, duc de Milan. Ils y rentrèrent l'an 1404 ; mais ils ne la gardèrent guère ; car les Vénitiens s'en emparèrent l'an 1409, et la possèdent encore.
Cette ville se glorifie d'avoir produit des savants illustres depuis la renaissance des lettres, et sous l'ancienne Rome, Catulle, Cornelius Nepos, Macer, Vitruve et Pline le naturaliste.
Catulle (Caïus Valerius Catullus) naquit l'an 666 de Rome ; et quoique S. Jérôme le fasse mourir l'an 696, à l'âge de trente ans, il poussa sa carrière au-moins dix ans de plus. Il ne fut pas gratifié des biens de la fortune ; cependant son esprit fin et délicat le fit rechercher de tous les grands de Rome. Ses poésies plaisent par une simplicité élégante, et par des grâces naïves que la seule nature donne à ses favoris. Il imagina le vers hendécasyllabe, qui est si propre à traiter les petits sujets ; mais il en abusa pour y semer des obscénités qui révoltent la pudeur. Il devait d'autant mieux s'en abstenir, que c'est dans la peinture des sentiments honnêtes que sa muse excelle. Il a l'art de nous attendrir, et il est parvenu à nous faire partager la vive douleur qu'il témoigne de la mort de son frère que nous n'avons jamais connu (épigr. 67, 69, 102.). Admirateur de Sapho, il transporta ou imita dans ses poésies plusieurs morceaux de celles de l'amante de Phaon.
Il savait bien aussi, quand il le voulait, aiguiser des vers satyriques ; témoin son épigramme des deux adultères, César et Mamurra. Cette épigramme a passé jusqu'à nous, et elle est fort bonne, parce qu'elle peint les mœurs de son siècle :
Consule Pompeio primùm duo, Cinna, solebant
Moechi. Illo ah ! facto consule nunc iterùm
Manserunt duo, sed creverunt millia in unum
Singula ; foecundum semen adulterio.
" Cinna, sous le premier consulat de Pompée on ne voyait à Rome que deux adultères : ces deux-là même furent encore seuls sous le second consulat ; mais depuis lors chacun d'eux en a produit des mille ; leur adultère a été fecond ".
Cette pièce ayant paru dans une conjoncture critique pour César, il ne déguisa point qu'il en recevait un grand tort ; mais il se contenta d'obliger le poète à lui faire satisfaction, et le soir même il l'invita à souper.
Nous n'avons pas toutes les œuvres de Catulle, et entr'autres son poème dont parle Pline, l. XXVIII. c. IIe sur les enchantements pour se faire aimer, sujet que Théocrite avait traité avant lui. La première édition des œuvres de Catulle parut à Venise en 1488 avec les commentaires d'Antoine Parthenius. Scaliger en donna une nouvelle dans laquelle il corrigea plusieurs passages avec autant de sagacité que d'érudition. Enfin les deux meilleures éditions sont celles de Graevius à Utrecht en 1680, d'Isaac Vossius à Leyde en 1684. et de Padoue en 1737.
Macer (Emilius) vivait vers l'an de Rome 738, et mourut en Asie, selon S. Jérôme. Il écrivit sur les serpens, les plantes et les oiseaux, au rapport de Quintilien. Il fit encore un poème de la ruine de Troie pour servir de supplément à l'iliade d'Homère. Ovide parle souvent des ouvrages de ce poète, ils sont tous perdus ; car le poème des plantes que nous avons sous le nom de Macer, n'est pas de celui qui vivait du temps d'Auguste, et c'est d'ailleurs un livre fort médiocre.
Si Cornelius Nepos n'est pas de Vérone, il était du-moins du territoire de cette ville, puisqu'il naquit à Hostilie, selon Catulle, qui pouvait en être bien informé. Cet historien latin florissait du temps de Jules-César, était des amis de Cicéron et d'Atticus, et vécut jusqu'à la sixième année de l'empire d'Auguste. Il avait composé les vies des historiens grecs ; car il en fait mention dans celle de Dion, en parlant de Philistus. Ce qu'il dit dans la vie de Caton et d'Annibal, prouve aussi qu'il avait écrit les vies des capitaines et des historiens latins ; enfin il avait laissé d'autres ouvrages qui sont perdus. Nous n'avons plus de lui que les vies des plus illustres généraux d'armée de la Grèce et de Rome, dont il n'a pas tenu à Aemilius Probus de s'attribuer la gloire. On prétend qu'ayant trouvé cet ouvrage de Nepos, il s'avisa de le donner sous son nom, pour s'insinuer dans les bonnes grâces de Théodose ; mais la suite des temps a dévoilé cette supercherie.
On a deux traductions françaises des vies des capitaines illustres de Cornelius Nepos : l'une du sieur de Claveret, publiée en 1663, l'autre toute moderne de M. le Gras, alors de la congrégation de l'oratoire, imprimée à Paris en 1729, in-12 ; mais nous aurions besoin d'une nouvelle traduction plus élégante, plus travaillée, et qui fût embellie de savantes notes historiques et critiques, afin que l'historien latin devint un ouvrage répandu dans toutes les bibliothèques des gens de gout, qui aiment à s'instruire de la vie des hommes célèbres de l'antiquité.
Vitruve (Marcus Vitruvius Pollio) vivait sous le règne d'Auguste, vers le commencement de l'ère chrétienne. Savant dans la science des proportions, il mit au jour un excellent ouvrage d'architecture divisé en dix livres, et les dédia au même empereur. Cet ouvrage est d'autant plus précieux, que c'est le seul en ce genre qui nous soit venu des anciens. Nous en avons une belle traduction française enrichie de notes par M. Claude Perrault, dont la première édition parut à Paris en 1673, fol. et la seconde en 1684, chez Coignard.
Pline (Caïus Plinius secundus) vit le jour sous l'empire de Tibere, l'an 774 de Rome, qui est le 20e de l'ère chrétienne, et mourut sous Titus, âgé de 56 ans. Ce grand homme est de tous les écrivains du monde celui que l'Encyclopédie a cité le plus. Il intéresse singulièrement l'humanité par sa fin tragique, et les savants de l'univers par ses écrits, qui sont dans les arts et dans les sciences les monuments les plus précieux de toute l'antiquité. Pline le jeune nous a donné dans une de ses lettres (lettre 5, l. III.) l'histoire des ouvrages de son oncle, et dans une autre lettre (lettre 16, l. VI.) la relation de sa mort. Je lis ces deux lettres pour la vingtième fais, et je crois devoir les transcrire ici toutes entières ; les gens de goût verront bien qu'il n'en fallait rien retrancher.
A Marcus. Vous me faites un grand plaisir de lire avec tant de passion les ouvrages de mon oncle, et de vouloir les connaître tous, et les avoir tous. Je ne me contenterai pas de vous les indiquer, je vous marquerai encore dans quel ordre ils ont été faits. C'est une connaissance qui n'est pas sans agréments pour les gens de lettres.
Lorsqu'il commandait une brigade de cavalerie, il a composé un livre de l'art de lancer un javelot à cheval ; et dans ce livre l'esprit et l'exactitude se font également remarquer ; il en a fait deux autres de la vie de Pomponius Secundus, dont il avait été singulièrement aimé, et il crut devoir cette marque de reconnaissance à la mémoire de son ami. Il nous en a laissé vingt autres des guerres d'Allemagne, où il a renfermé toutes celles que nous avons eu avec les peuples de ces pays. Un songe lui fit entreprendre cet ouvrage. Lorsqu'il servait dans cette province, il crut voir en songe Drusus Néron, qui après avoir fait de grandes conquêtes, y était mort. Ce prince le conjurait de ne le pas laisser enseveli dans l'oubli.
Nous avons encore de lui trois livres intitulés l'homme de lettres, que leur grosseur obligea mon oncle de partager en six volumes. Il prend l'orateur au berceau, et ne le quitte point, qu'il ne l'ait conduit à la plus haute perfection. Huit livres sur les façons de parler douteuses. Il fit cet ouvrage pendant les dernières années de l'empire de Néron, où la tyrannie rendait dangereux tout genre d'étude plus libre et plus élevé. Trente et un pour servir de suite à l'histoire qu'Aufidius Bassus a écrite. Trente-sept de l'histoire naturelle. Cet ouvrage est d'une étendue, d'une érudition infinie, et presque aussi varié que la nature elle-même.
Vous êtes surpris, comme un homme, dont le temps était si rempli, a pu écrire tant de volumes, et y traiter tant de différents sujets, la plupart si épineux, et si difficiles. Vous serez bien plus étonné, quand vous saurez qu'il a plaidé pendant quelque-temps, et qu'il n'avait que cinquante-six ans quand il est mort. On sait qu'il en a passé la moitié dans les embarras, que les plus importants emplois, et la bienveillance des princes lui ont attirés. Mais c'était une pénétration, une application, une vigilance incroyable. Il commençait ses veilles aux fêtes de Vulcain, qui se célébraient ordinairement au mois d'Aout, non pas pour chercher dans le ciel des présages, mais pour étudier. Il se mettait à l'étude en été dès que la nuit était tout à fait venue ; en hiver, à une heure du matin, au plus tard à deux, souvent à minuit. Il n'était pas possible de moins donner au sommeil, qui quelquefois le prenait et le quittait sur les livres.
Avant le jour il se rendait chez l'empereur Vespasien, qui faisait aussi un bon usage des nuits. De-là, il allait s'acquitter de ce qui lui avait été ordonné. Ses affaires faites, il retournait chez lui ; et ce qui lui restait de temps, c'était encore pour l'étude. Après le diner (toujours très-simple et très-léger, suivant la coutume de nos peres), s'il se trouvait quelques moments de loisir, en été il se couchait au soleil. On lui lisait quelque livre, il en faisait ses remarques et ses extraits ; car jamais il n'a rien lu sans extrait. Aussi avait-il coutume de dire, qu'il n'y a si mauvais livres, où l'on ne puisse apprendre quelque chose.
Après s'être retiré du soleil, il se mettait le plus souvent dans le bain d'eau froide. Il mangeait un morceau, et dormait très-peu de temps. Ensuite, et comme si un nouveau jour eut recommencé, il reprenait l'étude jusqu'au temps de souper. Pendant qu'il soupait, nouvelle lecture, nouveaux extraits, mais en courant.
Je me souviens qu'un jour le lecteur ayant mal prononcé quelques mots, un de ceux qui étaient à table l'obligea de recommencer. Quoi ! ne l'avez-vous pas entendu ? (dit mon oncle). Pardonnez-moi (répondit son ami). Et pourquoi donc (reprit-il) le faire répeter ? Votre interruption nous coute plus de dix lignes. Voyez si ce n'était pas être bon ménager du temps.
L'été il sortait de table avant que le jour nous eut quitté, en hiver, entre sept et huit : et tout cela, il le faisait au milieu du tumulte de Rome, malgré toutes les occupations que l'on y trouve, et le faisait, comme si quelque loi l'y eut forcé. A la campagne le seul temps du bain était exempt d'étude : je veux dire le temps qu'il était dans l'eau : car pendant qu'il en sortait, et qu'il se faisait essuyer, il ne manquait point de lire ou de dicter.
Dans ses voyages, c'était la seule application : comme si alors il eut été plus dégagé de tous les autres soins, il avait toujours à ses côtés son livre, ses tablettes et son copiste. Il lui faisait prendre ses gants en hiver, afin que la rigueur même de la saison ne put dérober un moment à l'étude. C'était par cette raison, qu'à Rome il n'allait jamais qu'en chaise.
Je me souviens qu'un jour il me censura de m'être promené. Vous pouviez, dit-il, mettre ces heures à profit. Car il comptait pour perdu, tout le temps que l'on n'employait pas aux sciences. C'est par cette prodigieuse assiduité, qu'il a su achever tant de volumes, et qu'il m'a laissé cent soixante tomes remplis de ses remarques, écrites sur la page et sur le revers en tres-petits caractères ; ce qui les multiplie beaucoup. Il me contait, qu'il n'avait tenu qu'à lui, pendant qu'il était procureur de César en Espagne, de les vendre à Larcius Licinius, quatre cent mille sesterces, environ quatre-vingt mille livres de notre monnaie ; et alors ces mémoires n'étaient pas tout à fait en si grand nombre.
Quand vous songez à cette immense lecture, à ces ouvrages infinis qu'il a composés ; ne croiriez-vous pas, qu'il n'a jamais été ni dans les charges, ni dans la faveur des princes ? Mais quand on vous dit tout le temps qu'il a ménagé pour les belles-lettres ; ne commencez-vous pas à croire, qu'il n'a pas encore assez lu et assez écrit ? Car d'un côté, quels obstacles les charges et la cour ne forment-elles point aux études ? Et de l'autre que ne peut point une si constante application ? C'est donc avec raison que je me mocque de ceux qui m'appellent studieux, moi qui en comparaison de lui, suis un franc fainéant. Cependant je donne à l'étude tout ce que les devoirs et publics et particuliers me laissent de temps. Eh ! qui, parmi ceux-mêmes qui consacrent toute leur vie aux belles-lettres, pourra soutenir cette comparaison ; et ne pas rougir, comme si le sommeil et la mollesse partageaient ses jours ?
Je m'aperçais que mon sujet m'a emporté plus loin que je ne m'étais proposé. Je voulais seulement vous apprendre ce que vous désiriez savoir, quels ouvrages mon oncle a composés. Je m'assure pourtant, que ce que je vous ai mandé ne vous fera guère moins de plaisir que leur lecture. Non-seulement cela peut piquer encore davantage votre curiosité ; mais vous piquer vous-même d'une noble envie de faire quelque chose de semblable. Adieu.
A Tacite.
Vous me priez de vous apprendre au vrai, comment mon oncle est mort, afin que vous en puissiez instruire la postérité. Je vous en remercie ; car je conçais que sa mort sera suivie d'une gloire immortelle, si vous lui donnez place dans vos écrits. Quoiqu'il ait péri par une fatalité, qui a désolé de très-beaux pays, et que sa perte, causée par un accident mémorable, et qui lui a été commun avec des villes et des peuples entiers, doive éterniser sa mémoire : quoiqu'il ait fait bien des ouvrages qui dureront toujours, je compte pourtant que l'immortalité des vôtres contribuera beaucoup à celle qu'il doit attendre. Pour moi, j'estime heureux ceux à qui les dieux ont accordé le don, ou de faire des choses dignes d'êtres écrites, ou d'en écrire de dignes d'être lues : et plus heureux encore ceux qu'ils ont favorisés de ce double avantage. Mon oncle tiendra son rang entre les derniers, et par vos écrits, et par les siens ; et c'est ce qui m'engage à exécuter plus volontiers des ordres que je vous aurais demandés.
Il était à Misene, où il commandait la flotte. Le 23 d'Aout, environ une heure après midi, ma mère l'avertit qu'il paraissait un nuage d'une grandeur et d'une figure extraordinaire. Après avoir été couché quelque temps au soleil, selon sa coutume, et avoir bu de l'eau froide, il s'était jeté sur un lit où il étudiait. Il se lève et monte en un lieu d'où il pouvait aisément observer ce prodige. Il était difficîle de discerner de loin de quelle montagne ce nuage sortait. L'événement a découvert depuis que c'était du mont Vésuve. Sa figure approchait de celle d'un arbre, et d'un pin plus que d'aucun autre ; car après s'être élevé fort haut en forme de tronc, il étendait une espèce de branches. Je m'imagine qu'un vent souterrain le poussait d'abord avec impétuosité, et le soutenait. Mais soit que l'impression diminuât peu-à-peu, soit que ce nuage fût affaissé par son propre poids, on le voyait se dilater et se répandre. Il paraissait tantôt blanc, tantôt noirâtre, et tantôt de diverses couleurs, selon qu'il était plus chargé ou de cendre, ou de terre.
Ce prodige surprit mon oncle, qui était très-savant ; et il le crut digne d'être examiné de plus près. Il commande que l'on appareille sa frégate légère ; et me laisse la liberté de le suivre. Je lui répondis que j'aimais mieux étudier ; et par hazard il m'avait lui-même donné quelque chose à écrire. Il sortait de chez lui ses tablettes à la main, lorsque les troupes de la flotte qui étaient à Rétine, effrayées par la grandeur du danger (car ce bourg est précisément sur Misene, et on ne s'en pouvait sauver que par la mer), vinrent le conjurer de vouloir bien les garantir d'un si affreux péril. Il ne changea pas de dessein, et poursuivit avec un courage héroïque, ce qu'il n'avait d'abord entrepris que par simple curiosité. Il fait venir des galeres, monte lui-même dessus, et part, dans le dessein de voir quel secours on pouvait donner non seulement à Rétine, mais à tous les autres bourgs de cette côte, qui sont en grand nombre, à cause de sa beauté. Il se presse d'arriver au lieu d'où tout le monde fuit, et où le péril paraissait plus grand ; mais avec une telle liberté d'esprit, qu'à mesure qu'il apercevait quelque mouvement, ou quelque figure extraordinaire dans ce prodige, il faisait ses observations, et les dictait.
Déja sur ces vaisseaux volait la cendre plus épaisse et plus chaude, à mesure qu'ils approchaient. Déja tombaient autour d'eux des pierres calcinées et des cailloux tout noirs, tout brulés, tout pulvérisés par la violence du feu. Déja la mer semblait refluer, et le rivage devenir inaccessible par des morceaux entiers de montagnes dont il était couvert ; lorsqu'après s'être arrêté quelques moments, incertain s'il retournerait, il dit à son pilote, qui lui conseillait de gagner la plaine mer ; la fortune favorise le courage. Tournez du côté de Pomponianus.
Pomponianus était à Stabie, en un endroit séparé par un petit golfe, que forme insensiblement la mer sur ces rivages qui se courbent. Là, à la vue du péril qui était encore éloigné, mais qui semblait s'approcher toujours, il avait retiré tous ses meubles dans ses vaisseaux, et n'attendait, pour s'éloigner, qu'un vent moins contraire. Mon oncle, à qui ce même vent avait été très-favorable, l'aborde, le trouve tout tremblant, l'embrasse, le rassure, l'encourage ; et pour dissiper par sa sécurité la crainte de son ami, il se fait porter au bain.
Après s'être baigné, il se met à table, et soupe avec toute sa gaieté, ou (ce qui n'est pas moins grand) avec toutes les apparences de sa gaieté ordinaire. Cependant on voyait luire de plusieurs endroits du mont Vésuve de grandes flammes et des embrasements, dont les ténèbres augmentaient l'éclat.
Mon oncle, pour rassurer ceux qui l'accompagnaient, leur disait, que ce qu'ils voyaient bruler, c'était des villages que les paysans alarmés avaient abandonnés, et qui étaient demeurés sans secours. Ensuite il se coucha, et dormit d'un profond sommeil ; car comme il était puissant, on l'entendait ronfler de l'antichambre.
Mais enfin la cour par où l'on entrait dans son appartement, commençait à se remplir si fort de cendres, que pour peu qu'il eut resté plus longtemps, il ne lui aurait plus été libre de sortir. On l'éveille. Il sort et Ve se joindre à Pomponianus, et les autres qui avaient veillé. Ils tiennent conseil, et délibèrent s'ils se renfermeront dans la maison, ou s'ils tiendront la campagne : car les maisons étaient tellement ébranlées par les fréquents tremblements de terre, que l'on aurait dit qu'elles étaient arrachées de leurs fondements, et jetées tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et puis remises à leurs places. Hors de la ville la chute des pierres, quoique légères et desséchées par le feu, était à craindre.
Entre ces périls on choisit la rase campagne. Chez ceux de sa suite, une crainte surmonta l'autre ; chez lui, la raison la plus forte l'emporta sur la plus faible. Ils sortent donc, et se couvrent la tête d'oreillers attachés avec des mouchoirs : ce fut toute la précaution qu'ils prirent contre ce qui tombait d'enhaut.
Le jour recommençait ailleurs : mais dans le lieu où ils étaient, continuait une nuit la plus sombre et la plus affreuse de toutes les nuits, et qui n'était un peu dissipée que par la lueur d'un grand nombre de flambeaux, et d'autres lumières. On trouva bon de s'approcher du rivage, et d'examiner de près ce que la mer permettait de tenter ; mais on la trouva fort grosse et fort agitée d'un vent contraire. Là, mon oncle ayant demandé de l'eau, et bu deux fais, se coucha sur un drap qu'il fit étendre. Ensuite des flammes qui parurent plus grandes, et une odeur de soufre, qui annonçait leur approche, mirent tout le monde en fuite. Il se lève appuyé sur deux valets, et dans le moment tombe mort. Je m'imagine qu'une fumée trop épaisse le suffoqua d'autant plus aisément qu'il avait la poitrine faible, et souvent la respiration embarrassée.
Lorsque l'on commença à revoir la lumière (ce qui n'arriva que trois jours après) on retrouva au même endroit son corps entier, couvert de la même robe qu'il portait, quand il mourut, et dans la posture plutôt d'un homme qui repose, que d'un homme qui est mort. Pendant ce temps ma mère et moi nous étions à Misene : mais cela ne regarde plus votre histoire. Vous ne voulez être informé que de la mort de mon oncle. Je finis donc, et je n'ajoute plus qu'un mot. C'est que je ne vous ai rien dit, ou que je n'aye vu, ou que je n'aye appris dans ces moments, où la vérité de l'action qui vient de se passer n'a pu encore être altérée. C'est à vous de choisir ce qui vous paraitra plus important.
Il y a bien de la différence entre écrire une lettre, ou une histoire ; entre écrire pour un ami, ou pour la postérité. Adieu.
De tous les écrits de Pline l'ancien, il ne nous reste que son histoire naturelle, ouvrage immense par son objet, et par son exécution ; mais l'auteur est encore plus estimable par la beauté de son esprit, par sa manière de penser grande et forte, et par les traits lumineux qui brillent dans cet ouvrage. Le coloris de son pinceau ne passera jamais dans aucune traduction.
Cependant la destinée de ce grand écrivain, est que tout le monde l'admire, et que personne n'ajoute foi à ses récits ; mais pour le justifier en deux mots, il n'a eu aucun intérêt à s'abuser lui-même, et à tromper son siècle, ni les siècles suivants. J'ajoute qu'on découvre tous les jours des faits que l'on regardait dans ses écrits comme d'agréables imaginations qu'il avait rapportées tout-au-plus sur la foi de gens auxquels il avait trop déféré.
L'édition que le P. Hardouin a donné de ce bel ouvrage, est le fruit d'un grand travail, d'un don de conjectures souvent heureux, d'une lecture prodigieuse, et d'une fidélité de mémoire surprenante. (D.J.).
VERONA
- Détails
- Écrit par Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie parente: Histoire
- Catégorie : Geographie ancienne
- Affichages : 839