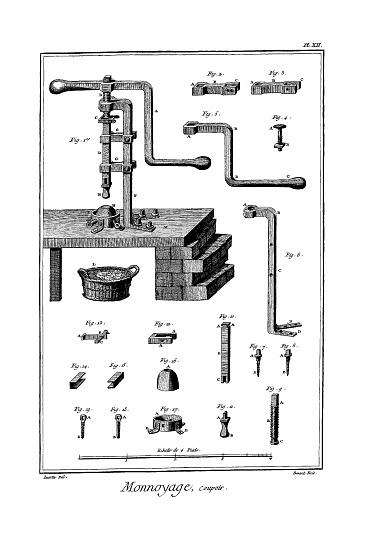S. f. (Morale) on appelle ainsi une femme livrée à la débauche publique, surtout lorsqu'elle exerce ce métier honteux avec une sorte d'agrément et de décence, et qu'elle sait donner au libertinage l'attrait que la prostitution lui ôte presque toujours. Les courtisannes semblent avoir été plus en honneur chez les Romains que parmi nous, et chez les Grecs que chez les Romains. Tout le monde connait les deux Aspasies, dont l'une donnait des leçons de politique et d'éloquence à Socrate même ; Phryné, qui fit rebâtir à ses dépens la ville de Thebes détruite par Alexandre, et dont les débauches servirent ainsi en quelque manière à réparer le mal fait par le conquérant ; Laïs qui tourna la tête à tant de philosophes, à Diogène même qu'elle rendit heureux, à Aristippe, qui disait d'elle, je possède Laïs, mais Laïs ne me possède pas (grande leçon pour tout homme sage) ; enfin la célèbre Léontium, qui écrivit sur la philosophie, et qui fut aimée d'Epicure et de ses disciples. Notre fameuse Ninon Lenclos peut être regardée comme la Léontium moderne ; mais elle n'a pas eu beaucoup de semblables, et rien n'est plus rare parmi nous que les courtisannes philosophes, si ce n'est pas même profaner ce dernier nom que de le joindre au premier. Nous ne nous étendrons pas beaucoup sur cet article, dans un ouvrage aussi grave que celui-ci. Nous croyons devoir dire seulement, indépendamment des lumières de la religion, et en nous bornant au pur moral, que la passion pour les courtisannes énerve également l'âme et le corps, et qu'elle porte les plus funestes atteintes à la fortune, à la santé, au repos et au bonheur. On peut se rappeler à cette occasion le mot de Démosthène, je n'achète pas si cher un repentir ; et celui de l'empereur Adrien, à qui l'on demandait pourquoi l'on peint Venus nue ; il répondit, quia nudos dimittit.
Mais les femmes fausses et coquettes ne sont-elles pas plus méprisables en un sens, et plus dangereuses encore pour le cœur et pour l'esprit, que ne le sont les courtisannes ? C'est une question que nous laisserons à décider.
Un célèbre philosophe de nos jours examine dans son histoire naturelle, pourquoi l'amour fait le bonheur de tous les êtres, et le malheur de l'homme. Il répond que c'est qu'il n'y a dans cette passion que le physique de bon ; et que le moral, c'est-à-dire le sentiment qui l'accompagne, n'en vaut rien. Ce philosophe n'a pas prétendu que ce moral n'ajoute pas au plaisir physique, l'expérience serait contre lui ; ni que le moral de l'amour ne soit qu'une illusion, ce qui est vrai, mais ne détruit pas la vivacité du plaisir (& combien peu de plaisirs ont un objet réel !) Il a voulu dire sans doute que ce moral est ce qui cause tous les maux de l'amour, et en cela on ne saurait trop être de son avis. Concluons seulement de-là, que si des lumières supérieures à la raison ne nous promettaient pas une condition meilleure, nous aurions beaucoup à nous plaindre de la Nature, qui en nous présentant d'une main le plus séduisant des plaisirs, semble nous en éloigner de l'autre par les écueils dont elle l'a environné, et qui nous a, pour ainsi dire, placés sur le bord d'un précipice entre la douleur et la privation.
Qualibus in tenebris vitae quantisque periclis
Degitur hoc aevi quodcumque est ?
Au reste, quand nous avons parlé ci-dessus de l'honneur que les Grecs rendaient aux courtisannes, nous n'en avons parlé que relativement aux autres peuples : on ne peut guère douter en effet que la Grèce n'ait été le pays où ces sortes de femmes ont été le plus honorées, ou si l'on veut le moins méprisées. M. Bertin, de l'académie royale des Belles-lettres, dans une dissertation lue à cette académie en 1752, et qu'il a bien voulu nous communiquer, s'est proposé de prouver contre une foule d'auteurs anciens et modernes, que les honneurs rendus aux courtisannes chez les Grecs, ne l'étaient point par le corps de la nation, et qu'ils étaient seulement le fruit de l'extravagante passion de quelques particuliers. C'est ce que l'auteur entreprend de faire voir par un grand nombre de faits bien rapprochés, qu'il a tirés principalement d'Athenée et de Plutarque, et qu'il oppose aux faits qu'on a coutume d'alléguer en faveur de l'opinion commune. Comme le mémoire de M. Bertin n'est pas encore imprimé en Mars 1754 que nous écrivons ceci, nous ne croyons pas devoir entrer dans un plus grand détail, et nous renvoyons nos lecteurs à sa dissertation, qui nous parait très-digne d'être lue. (O)