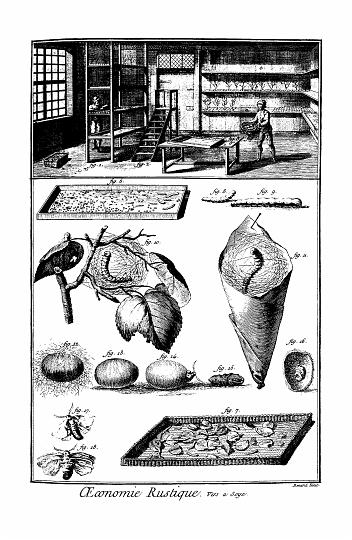S. f. (Morale) La liberté réside dans le pouvoir qu'un être intelligent a de faire ce qu'il veut, conformément à sa propre détermination. On ne saurait dire que dans un sens fort impropre, que cette faculté ait lieu dans les jugements que nous portons sur les vérités, par rapport à celles qui sont évidentes ; elles entraînent notre consentement, et ne nous laissent aucune liberté. Tout ce qui dépend de nous, c'est d'y appliquer notre esprit ou de l'en éloigner. Mais dès que l'évidence diminue, la liberté rentre dans ses droits, qui varient et se règlent sur les degrés de clarté ou d'obscurité : les biens et les maux en sont les principaux objets. Elle ne s'étend pas pourtant sur les notions générales du bien et du mal. La nature nous a faits de manière, que nous ne saurions nous porter que vers le bien, et qu'avoir horreur du mal envisagé en général ; mais dès qu'il s'agit du détail, notre liberté a un vaste champ, et peut nous déterminer de bien des côtés différents, suivant les circonstances et les motifs. On se sert d'un grand nombre de preuves, pour montrer que la liberté est une prérogative réelle de l'homme ; mais elles ne sont pas toutes également fortes. M. Turretin en rapporte douze : en voici la liste. 1°. Notre propre sentiment qui nous fournit la conviction de la liberté. 2°. Sans liberté, les hommes seraient de purs automates, qui suivraient l'impulsion des causes, comme une montre s'assujettit aux mouvements dont l'horloger l'a rendue susceptible. 3°. Les idées de vertu et de vice, de louange et de blâme qui nous sont naturelles, ne signifieraient rien. 4°. Un bienfait ne serait pas plus digne de reconnaissance que le feu qui nous échauffe. 5°. Tout devient nécessaire ou impossible. Ce qui n'est pas arrivé ne pourrait arriver. Ainsi tous les projets sont inutiles ; toutes les règles de la prudence sont fausses, puisque dans toutes choses la fin et les moyens sont également nécessairement déterminés. 6°. D'où viennent les remords de la conscience, et qu'ai-je à me reprocher si j'ai fait ce que je ne pouvais éviter de faire ? 7°. Qu'est-ce qu'un poète, un historien, un conquérant, un sage législateur ? Ce sont des gens qui ne pouvaient agir autrement qu'ils ont fait. 8°. Pourquoi punir les criminels, et récompenser les gens de bien ? Les plus grands scélérats sont des victimes innocentes qu'on immole, s'il n'y a point de liberté. 9°. A qui attribuer la cause du péché, qu'à Dieu ? Que devient la Religion avec tous ses devoirs ? 10°. A qui Dieu donne-t-il des lais, fait-il des promesses et des menaces, prépare-t-il des peines et des récompenses ? à de pures machines incapables de choix ? 11°. S'il n'y a point de liberté, d'où en avons-nous l'idée ? Il est étrange que des causes nécessaires nous aient conduit à douter de leur propre nécessité. 12°. Enfin les fatalistes ne sauraient se formaliser de quoi que ce soit qu'on leur dit, et de ce qu'on leur fait.
Pour traiter ce sujet avec précision, il faut donner une idée des principaux systèmes qui le concernent. Le premier système sur la liberté, est celui de la fatalité. Ceux qui l'admettent, n'attribuent pas nos actions à nos idées, dans lesquelles seules réside la persuasion, mais à une cause mécanique, laquelle entraîne avec soi la détermination de la volonté ; de manière que nous n'agissons pas, parce que nous le voulons, mais que nous voulons, parce que nous agissons. C'est là la vraie distinction entre la liberté et la fatalité. C'est précisément celle que les Stoïciens reconnaissaient autrefois, et que les Mahométans admettent encore de nos jours. Les Stoïciens pensaient donc que tout arrive par une aveugle fatalité ; que les événements se succedent les uns aux autres, sans que rien puisse changer l'étroite chaîne qu'ils forment entr'eux ; enfin que l'homme n'est point libre. La liberté, disaient-ils, est une chimère d'autant plus flatteuse, que l'amour-propre s'y prête tout entier. Elle consiste en un point assez délicat, en ce qu'on se rend témoignage à soi-même de ses actions, et qu'on ignore les motifs qui les ont fait faire : il arrive de-là, que méconnaissant ces motifs, et ne pouvant rassembler les circonstances qui l'ont déterminé à agir d'une certaine manière, chaque homme se félicite de ses actions, et se les attribue.
Le fatum des Turcs vient de l'opinion où ils sont que tout est abreuvé des influences célestes, et qu'elles règlent la disposition future des événements.
Les Esséniens avaient une idée si haute et si décisive de la providence, qu'ils croyaient que tout arrive par une fatalité inévitable, et suivant l'ordre que cette providence a établi, et qui ne change jamais. Point de choix dans leur système, point de liberté. Tous les événements forment une chaîne étroite et inaltérable : ôtez un seul de ces événements, la chaîne est rompue, et toute l'économie de l'univers est troublée. Une chose qu'il faut ici remarquer, c'est que la doctrine qui détruit la liberté, porte naturellement à la volupté ; et qui ne consulte que son gout, son amour-propre et ses penchans, trouve assez de raisons pour la suivre et pour l'approuver : cependant les mœurs des Esséniens et des Stoïciens ne se ressentaient point du désordre de leur esprit.
Spinosa, Hobbes et plusieurs autres ont admis de nos jours une semblable fatalité.
Spinosa a répandu cette erreur dans plusieurs endroits de ses ouvrages ; l'exemple qu'il allegue pour éclaircir la matière de la liberté, suffira pour nous en convaincre. " Concevez, dit-il, qu'une pierre, pendant qu'elle continue à se mouvoir, pense et sache qu'elle s'efforce de continuer autant qu'elle peut son mouvement ; cette pierre par cela même qu'elle a le sentiment de l'effort qu'elle fait pour se mouvoir, et qu'elle n'est nullement indifférente entre le mouvement et le repos, croira qu'elle est très-libre, et qu'elle persévère à se mouvoir uniquement parce qu'elle le veut. Et voilà quelle est cette liberté tant vantée, et qui consiste seulement dans le sentiment que les hommes ont de leurs appétits, et dans l'ignorance des causes de leurs déterminations ". Spinosa ne dépouille pas seulement les créatures de la liberté, il assujettit encore son Dieu à une brute et fatale necessité : c'est le grand fondement de son système. De ce principe il s'ensuit qu'il est impossible qu'aucune chose qui n'existe pas actuellement, ait pu exister, et que tout ce qui existe, existe si nécessairement qu'il ne saurait n'être pas ; et enfin qu'il n'y a pas jusqu'aux manières d'être, et aux circonstances de l'existence des choses, qui n'aient dû être à tous égards précisément ce qu'elles sont aujourd'hui. Spinosa admet en termes exprès ces conséquences, et il ne fait pas difficulté d'avouer qu'elles sont des suites naturelles de ses principes.
On peut réduire tous les arguments dont Spinosa et ses sectateurs se sont servis pour soutenir cette absurde hypothèse, à ces deux. Ils disent 1°. que puisque tout effet présuppose une cause, et que, de la même manière que tout mouvement qui arrive dans un corps lui est causé par l'impulsion d'un autre corps, et le mouvement de ce second par l'impulsion d'un troisième ; et ainsi chaque volition, et chaque détermination de la volonté de l'homme, doit nécessairement être produite par quelque cause extérieure, et celle-ci par une troisième ; d'où ils concluent que la liberté de la volonté n'est qu'une chimère. Ils disent en second lieu que la pensée avec tous ses modes, ne sont que des qualités de la matière ; et par conséquent qu'il n'y a point de liberté de volonté, puisqu'il est évident que la matière n'a pas en elle-même le pouvoir de commencer le mouvement, ou de se donner à elle-même la moindre détermination.
En troisième lieu, ils ajoutent que ce que nous sommes dans l'instant qui Ve suivre, dépend si nécessairement de ce que nous sommes dans l'instant présent, qu'il est métaphysiquement impossible que nous soyons autres. Car, continuent-ils, supposons une femme qui soit entrainée par sa passion à se jeter tout-à-l'heure entre les bras de son amant ; si nous imaginons cent mille femmes entièrement semblables à la première, d'âge, de tempérament, d'éducation, d'organisation, d'idées, telles en un mot, qu'il n'y ait aucune différence assignable entr'elles et la première : on les voit toutes également soumises à la passion dominante, et précipitées entre les bras de leurs amants, sans qu'on puisse concevoir aucune raison pour laquelle l'une ne ferait pas ce que toutes les autres feront. Nous ne faisons rien qu'on puisse appeler bien ou mal, sans motif. Or il n'y a aucun motif qui dépende de nous, soit eu égard à sa production, soit eu égard à son énergie. Prétendre qu'il y a dans l'âme une activité qui lui est propre ; c'est dire une chose inintelligible, et qui ne résout rien. Car il faudra toujours une cause indépendante de l'âme qui détermine cette activité à une chose plutôt qu'à une autre ; et pour reprendre la première partie du raisonnement, ce que nous sommes dans l'instant qui Ve suivre, dépend donc absolument de ce que nous sommes dans l'instant présent ; ce que nous sommes dans l'instant présent, dépend donc de ce que nous étions dans l'instant précédent ; et ainsi de suite, en remontant jusqu'au premier instant de notre existence, s'il y en a un. Notre vie n'est donc qu'un enchainement d'instants d'existences et d'actions nécessaires ; notre volonté, un acquiescement à être ce que nous sommes nécessairement dans chacun de ces instants, et notre liberté une chimère ; ou il n'y a rien de démontré en aucun genre ou cela l'est. Mais ce qui confirme surtout ce système, c'est le moment de la délibération, le cas de l'irrésolution. Qu'est-ce que nous faisons dans l'irrésolution ? nous oscillons entre deux ou plusieurs motifs, qui nous tirent alternativement en sens contraire. Notre entendement est alors comme créateur et spectateur de la nécessité de nos balancements. Supprimez tous les motifs qui nous agitent, alors inertie et repos nécessaires. Supposez un seul et unique motif ; alors une action nécessaire. Supposez deux ou plusieurs motifs conspirants, même nécessité, et plus de vitesse dans l'action. Supposez deux ou plusieurs motifs opposés et à-peu-près de forces égales, alors oscillations, oscillations semblables à celles des bras d'une balance mise en mouvement, et durables jusqu'à ce que le motif le plus puissant fixe la situation de la balance et de l'âme. Et comment se pourrait-il faire que le motif le plus faible fût le motif déterminant ? Ce serait dire qu'il est en même temps le plus faible et le plus fort. Il n'y a de différence entre l'homme automate qui agit dans le sommeil, et l'homme intelligent qui agit et qui veille, sinon que l'entendement est plus présent à la chose ; quant à la nécessité, elle est la même. Mais, leur dit-on, qu'est-ce que ce sentiment intérieur de notre liberté ? l'illusion d'un enfant qui ne réfléchit sur rien. L'homme n'est donc pas différent d'un automate ? Nullement différent d'un automate qui sent ; c'est une machine plus composée ? Il n'y a donc plus de vicieux et de vertueux ? non, si vous le voulez ; mais il y a des êtres heureux ou malheureux, bienfaisants et malfaisants. Et les récompenses et les châtiments ? Il faut bannir ces mots de la Morale ; on ne récompense point, mais on encourage à bien faire ; on ne châtie point, mais on étouffe, on effraye ? Et les lais, et les bons exemples, et les exhortations, à quoi servent-elles ? Elles sont d'autant plus utiles, qu'elles ont nécessairement leurs effets. Mais, pourquoi distinguez vous par votre indignation et par votre colere, l'homme qui vous offense, de la tuîle qui vous blesse ? c'est que je suis déraisonnable, et qu'alors je ressemble au chien qui mord la pierre qui l'a frappé. Mais cette idée de liberté que nous avons, d'où vient-elle ? De la même source qu'une infinité d'autres idées fausses que nous avons ? En un mot, concluent-ils, ne vous effarouchez pas à contre-temps. Ce système qui vous parait si dangereux, ne l'est point ; il ne change rien au bon ordre de la société. Les choses qui corrompent les hommes seront toujours à supprimer ; les choses qui les améliorent, seront toujours à multiplier et à fortifier. C'est une dispute de gens aisifs, qui ne mérite point la moindre animadversion de la part du législateur. Seulement notre système de la nécessité assure à toute cause bonne, ou conforme à l'ordre établi, son bon effet ; à toute cause mauvaise ou contraire à l'ordre établi, son mauvais effet ; et en nous prêchant l'indulgence et la commisération pour ceux qui sont malheureusement nés, nous empêche d'être si vains de ne pas leur ressembler ; c'est un bonheur qui n'a dépendu de nous en aucune façon.
En quatrième lieu, ils demandent si l'homme est un être simple tout spirituel, ou tout corporel, ou un être composé. Dans les deux premiers cas, ils n'ont pas de peine à prouver la nécessité de ses actions ; et si on leur répond que c'est un être composé de deux principes, l'un matériel et l'autre immatériel, voici comment ils raisonnent. Ou le principe spirituel est toujours dépendant du principe immatériel, ou toujours indépendant. S'il en est toujours dépendant, nécessité aussi absolue que si l'être était un, simple et tout matériel, ce qui est vrai. Mais si on leur soutient qu'il en est quelquefois dépendant, et quelquefois indépendant ; si on leur dit que les pensées de ceux qui ont la fièvre chaude et des fous ne sont pas libres, au lieu qu'elles le sont dans ceux qui sont sains : ils répondent qu'il n'y a ni uniformité ni liaison dans notre système, et que nous rendons les deux principes indépendants, selon le besoin que nous avons de cette supposition pour nous défendre, et non selon la vérité de la chose. Si un fou n'est pas libre, un sage ne l'est pas davantage ; et soutenir le contraire, c'est prétendre qu'un poids de cinq livres peut n'être pas emporté par un poids de six. Mais si un poids de cinq livres peut n'être pas emporté par un poids de six, il ne le sera pas non plus par un poids de mille ; car alors il résiste à un poids de six livres par un principe indépendant de sa pesanteur ; et ce principe, quel qu'il sait, n'aura pas plus de proportion avec un poids de mille livres qu'avec un poids de six livres, parce qu'il saut alors qu'il soit d'une nature différente de celle des poids.
Voilà certainement les arguments les plus forts qu'on puisse faire contre notre sentiment. Pour en montrer la vanité, je leur opposerai les trois propositions suivantes : La première est qu'il est faux que tout effet soit le produit de quelque cause externe ; qu'au contraire il faut de toute nécessité reconnaître un commencement d'action, c'est-à-dire un pouvoir d'agir indépendamment d'aucune action précédente, et que ce pouvoir peut être et est effectivement dans l'homme. Ma seconde proposition est que la pensée et la volonté ne sont ni ne peuvent être des qualités de la matière. La troisième enfin, que quand bien même l'âme ne serait pas une substance distincte du corps, et qu'on supposerait que la pensée et la volonté ne sont que des qualités de la matière ; cela même ne prouverait pas que la liberté de la volonté fût une chose impossible.
Je dis, 1°. que tout effet ne peut pas être produit par des causes externes, mais qu'il faut de toute nécessité reconnaître un commencement d'action, c'est-à-dire, un pouvoir d'agir indépendamment d'aucune action antécédente, et que ce pouvoir est actuellement dans l'homme. Cela a déjà été prouvé dans l'article du CONCOURS.
Je dis en second lieu, que la pensée et la volonté n'étant point des qualités de la matière, elles ne peuvent pas par conséquent être soumises à ses lois ; car tout ce qui est fait ou composé d'une chose, il est toujours cette même chose dont il est composé. Par exemple, tous les changements, toutes les compositions, toutes les divisions possibles de la figure ne sont autre chose que figure ; et toutes les compositions, tous les effets possibles du mouvement ne seront jamais autre chose que mouvement. Si donc il y a eu un temps où il n'y ait eu dans l'univers autre chose que matière et que mouvement, il faudra dire qu'il est impossible que jamais il y ait pu avoir dans l'univers autre chose que matière et que mouvement. Dans cette supposition, il est aussi impossible que l'intelligence, la réflexion et toutes les diverses sensations aient jamais commencé à exister ; qu'il est maintenant impossible que le mouvement soit bleu ou rouge, et que le triangle soit transformé en un son. Voyez l'article de l'AME, où cela a été prouvé plus au long.
Mais quand même j'accorderais à Spinosa et à Hobbes que la pensée et la volonté peuvent être et sont en effet des qualités de la matière, tout cela ne déciderait point en leur faveur la question présente sur la liberté, et ne prouverait pas qu'une volonté libre fût une chose impossible ; car, puisque nous avons déjà démontré que la pensée et la volonté ne peuvent pas être des productions de la figure et du mouvement, il est clair que tout homme qui suppose que la pensée et la volonté sont des qualités de la matière, doit supposer aussi que la matière est capable de certaines propriétés entièrement différentes de la figure et du mouvement. Or si la matière est capable de telles propriétés, comment prouvera-t-on que les effets de la figure et du mouvement, étant tous nécessaires, les effets des autres propriétés de la matière entièrement distinctes de celles-là, doivent être pareillement nécessaires ? Il parait par là que l'argument dont Hobbes et ses sectateurs font leur grand bouclier, n'est qu'un pur sophisme ; car ils supposent d'un côté que la matière est capable de pensée et de volonté, d'où ils concluent que l'âme n'est qu'une pure matière. Sachant d'un autre côté que les effets de la figure et du mouvement doivent tous être nécessaires, ils en concluent que toutes les opérations de l'âme sont nécessaires ; c'est-à-dire, que lorsqu'il s'agit de prouver que l'âme n'est que pure matière, ils supposent la matière capable non seulement de figure et de mouvement, mais aussi d'autres propriétés inconnues. Au contraire, s'agit-il de prouver que la volonté et les autres opérations de l'âme sont des choses nécessaires, ils dépouillent la matière de ces prétendues propriétés inconnues, et n'en font plus qu'un pur solide, composé de figure et de mouvement.
Après avoir satisfait à quelques objections qu'on fait contre la liberté, attaquons à notre tour les partisans de l'aveugle fatalité. La liberté brille dans tout son jour, soit qu'on la considère dans l'esprit, soit qu'on l'examine par rapport à l'empire qu'elle exerce sur le corps. Et 1°. quand je veux penser à quelque chose, comme à la vertu que l'aimant a d'attirer le fer ; n'est-il pas certain que j'applique mon âme à méditer cette question toutes les fois qu'il me plait, et que je l'en détourne quand je veux ? Ce serait chicaner honteusement que de vouloir en douter. Il ne s'agit plus que d'en découvrir la cause. On voit, 1°. que l'objet n'est pas devant mes yeux ; je n'ai ni fer ni aimant, ce n'est donc pas l'objet qui m'a déterminé à y penser. Je sais bien que quand nous avons Ve une fois quelque chose, il reste quelques traces dans le cerveau qui facilitent la détermination des esprits. Il peut arriver de-là que quelquefois ces esprits coulent d'eux-mêmes dans ces traces, sans que nous en sachions la cause ; ou même un objet qui a quelque rapport avec celui qu'ils représentent, peut les avoir excités et réveillés pour agir, alors l'objet vient de lui-même se présenter à notre imagination. De même, quand les esprits animaux sont émus par quelque forte passion, l'objet se représente malgré nous ; et quoi que nous fassions, il occupe notre pensée. Tout cela se fait ; on n'en disconvient pas. Mais il n'est pas question de cela : car outre toutes ces raisons qui peuvent exciter en mon esprit une telle pensée, je sens que j'ai le pouvoir de la produire toutes les fois que je veux. Je pense à ce moment pourquoi l'aimant attire le fer ; dans un moment, si je veux, je n'y penserai plus, et j'occuperai mon esprit à méditer sur le flux et le reflux de la mer. De-là je passerai, s'il me plait, à rechercher la cause de la pesanteur ; ensuite je rappellerai, si je veux, la pensée de l'aimant, et je la conserverai tant qu'il me plaira. On ne peut agir plus librement. Non seulement j'ai ce pouvoir, mais je sens et je sais que je l'ai. Puis donc que c'est une vérité d'expérience, de connaissance et de sentiment, on doit plutôt la considérer comme un fait incontestable que comme une question dont on doive disputer. Il y a donc sans contredit, au-dedans de moi, un principe, une cause supérieure qui régit mes pensées, qui les fait naître, qui les éloigne, qui les rappelle en un instant et à son commandement ; et par conséquent il y a dans l'homme un esprit libre, qui agit sur soi-même comme il lui plait.
A l'égard des opérations du corps, le pouvoir absolu de la volonté n'est pas moins sensible. Je veux mouvoir mon bras, je le remue aussi-tôt ; je veux parler, et je parle à l'instant, etc. On est intérieurement convaincu de toutes ces vérités, personne ne les nie : rien au monde n'est capable de les obscurcir. On ne peut donner ni se former une idée de la liberté, quelque grande, quelque indépendante qu'elle puisse être, que je n'éprouve et ne reconnaisse en moi-même à cet égard. Il est ridicule de dire que je crois être libre, parce que je suis capable et susceptible de plusieurs déterminations occasionnées par divers mouvements que je ne connais pas : car je sais, je connais et je sens que les déterminations, qui font que je parle, ou que je me tais, dépendent de ma volonté ; nous ne sommes donc pas libres seulement en ce sens, que nous avons la connaissance de nos mouvements, et que nous ne sentons ni force ni contrainte ; au contraire, nous sentons que nous avons chez nous le maître de la machine qui en conduit les ressorts comme il lui plait. Malgré toutes les raisons et toutes les déterminations qui me portent et me poussent à me promener, je sens et je suis persuadé que ma volonté peut à son gré arrêter et suspendre à chaque instant l'effet de tous ces ressorts cachés qui me font agir. Si je n'agissais que par ces ressorts cachés, par les impressions des objets, il faudrait nécessairement que j'accomplisse tous les mouvements qu'ils seraient capables de produire ; de même qu'une bille poussée acheve sur la table du billard tout le mouvement qu'elle a reçu.
On pourrait alléguer plusieurs occasions dans la vie humaine, où l'empire de cette liberté s'exerce avec tant de pouvoir qu'elle dompte les corps, et en réprime avec violence tous les mouvements. Dans l'exercice de la vertu, où il s'agit de résister à une forte passion, tous les mouvements du corps sont déterminés par la passion ; mais la volonté s'y oppose et les reprime par la seule raison du devoir. D'un autre côté, quand on fait réflexion sur tant de personnes qui se sont privées de la vie, sans y être poussées, ni par la folie, ni par la fureur, etc. mais par la seule vanité de faire parler d'eux, ou pour montrer la force de leur esprit, etc. il faut nécessairement reconnaître ce pouvoir de la liberté plus fort que tous les mouvements de la nature. Quel pouvoir ne faut-il pas exercer sur ce corps pour contraindre de sang-froid la main à prendre un poignard pour se l'enfoncer dans le cœur.
Un des plus beaux esprits de notre siècle a voulu essayer jusqu'à quel point on pouvait soutenir un paradoxe. Son imagination libertine a osé se jouer sur un sujet aussi respectable que celui de la liberté. Voici l'objection dans toute sa force. Ce qui est dépendant d'une chose, a certaines proportions avec cette même chose-là ; c'est-à-dire, qu'il reçoit des changements, quand elle en reçoit selon la nature de leur proportion. Ce qui est indépendant d'une chose, n'a aucune proportion avec elle ; en sorte qu'il demeure égal, quand elle reçoit des augmentations et des dimensions. Je suppose, continue-t-il, avec tous les Métaphysiciens, 1°. que l'âme pense suivant que le cerveau est disposé, et qu'à de certaines dispositions matérielles du cerveau, et à de certains mouvements qui s'y font, répondent certaines pensées de l'âme. 2°. Que tous les objets même spirituels auxquels on pense, laissent des dispositions matérielles, c'est-à-dire des traces dans le cerveau. 3°. Je suppose encore un cerveau où soient en même temps deux sortes de dispositions matérielles contraires et d'égale force ; les unes qui portent l'âme à penser vertueusement sur un sujet, les autres qui la portent à penser vicieusement. Cette supposition ne peut être refusée ; les dispositions matérielles contraires se peuvent aisément rencontrer ensemble dans le cerveau au même degré, et s'y rencontrent même nécessairement toutes les fois que l'âme délibere, et ne sait quel parti prendre. Cela supposé, je dis, ou l'âme se peut absolument déterminer dans cet équilibre des dispositions du cerveau à choisir entre les pensées vertueuses et les pensées vicieuses, ou elle ne peut absolument se déterminer dans cet équilibre. Si elle peut se déterminer, elle a en elle-même le pouvoir de se déterminer, puisque dans son cerveau tout ne tend qu'à l'indétermination, et que pourtant elle se détermine ; donc ce pouvoir qu'elle a de se déterminer est indépendant des dispositions du cerveau ; donc il n'a nulle proportion avec elles ; donc il demeure le même, quoiqu'elles changent ; donc si l'équilibre du cerveau subsistant, l'âme se détermine à penser vertueusement, elle n'aura pas moins le pouvoir de s'y déterminer, quand ce sera la disposition matérielle à penser vicieusement qui l'emportera sur l'autre ; donc à quelque degré que puisse monter cette disposition matérielle aux pensées vicieuses, l'âme n'en aura pas moins le pouvoir de se déterminer au choix des pensées vertueuses ; donc l'âme a en elle-même le pouvoir de se déterminer malgré toutes les dispositions contraires du cerveau ; donc les pensées de l'âme sont toujours libres. Venons au second cas.
Si l'âme ne peut se déterminer absolument, cela ne vient que de l'équilibre supposé dans le cerveau ; et l'on conçoit qu'elle ne se déterminera jamais, si l'une des dispositions ne vient à l'emporter sur l'autre, et qu'elle se déterminera nécessairement pour celle qui l'emportera ; donc le pouvoir qu'elle a de se déterminer au choix des pensées vertueuses ou vicieuses, est absolument dépendant des dispositions du cerveau ; donc, pour mieux dire, l'âme n'a en elle-même aucun pouvoir de se déterminer, et ce sont les dispositions du cerveau qui la déterminent au vice ou à la vertu ; donc les pensées de l'âme ne sont jamais libres. Or, rassemblant les deux cas ; ou il se trouve que les pensées de l'âme sont toujours libres, ou qu'elles ne le sont jamais en quelque cas que ce puisse être ; or il est vrai et reconnu de tous que les pensées des enfants, de ceux qui rêvent, de ceux qui ont la fièvre chaude, et des fous, ne sont jamais libres.
Il est aisé de reconnaître le nœud de ce raisonnement. Il établit un principe uniforme dans l'âme ; en sorte que le principe est toujours ou indépendant des dispositions du cerveau, ou toujours dépendant ; au lieu que dans l'opinion commune, on le suppose quelquefois dépendant, et d'autres fois indépendant.
On dit que les pensées de ceux qui ont la fièvre chaude et des fous ne sont pas libres, parce que les dispositions matérielles du cerveau sont atténuées et élevées à un tel degré, que l'âme ne leur peut résister ; au lieu que dans ceux qui sont sains, les dispositions du cerveau sont modérées, et n'entraînent pas nécessairement l'âme. Mais, 1°. dans ce système, le principe n'étant pas uniforme, il faut qu'on l'abandonne ; si je puis expliquer tout par un qui le sait. 2°. Si, comme nous l'avons dit plus haut, un poids de cinq livres pouvait n'être pas emporté par un poids de six, il ne le serait pas non plus par un poids de mille ; car s'il résistait à un poids de six livres par un principe indépendant de la pesanteur : ce principe, quel qu'il fût, d'une nature toute différente de celle des poids, n'aurait pas plus de proportion avec un poids de mille livres, qu'avec un poids de six. Ainsi, si l'âme résiste à une disposition matérielle du cerveau qui la porte à un choix vicieux, et qui, quoique modérée, est pourtant plus forte que la disposition matérielle à la vertu, il faut que l'âme résiste à cette même disposition matérielle du vice, quand elle sera infiniment au-dessus de l'autre ; parce qu'elle ne peut lui avoir résisté d'abord que par un principe indépendant des dispositions du cerveau, et qui ne doit pas changer par les dispositions du cerveau. 3°. Si l'âme pouvait voir très-clairement, malgré une disposition de l'oeil qui devrait affoiblir la vue, on pourrait conclure qu'elle verrait encore malgré une disposition de l'oeil qui devrait empêcher entièrement la vision, en tant qu'elle est matérielle. 4°. On convient que l'âme dépend absolument des dispositions du cerveau sur ce qui regarde le plus ou le moins d'esprit. Cependant, si sur la vertu ou le vice, les dispositions du cerveau ne déterminent l'âme que lorsqu'elles sont extrêmes, et qu'elles lui laissent la liberté lorsqu'elles sont modérées ; en sorte qu'on peut avoir beaucoup de vertu, malgré une disposition médiocre au vice : il devrait être aussi qu'on peut avoir beaucoup d'esprit, malgré une disposition médiocre à la stupidité, ce qu'on ne peut pas admettre. Il est vrai que le travail augmente l'esprit, ou pour mieux dire, qu'il fortifie les dispositions du cerveau, et qu'ainsi l'esprit croit précisément autant que le cerveau se perfectionne.
En cinquième lieu, je suppose que toute la différence qui est entre un cerveau qui veille et un cerveau qui dort, est qu'un cerveau qui dort est moins rempli d'esprits, et que les nerfs y sont moins tendus ; de sorte que les mouvements ne se communiquent pas d'un nerf à l'autre, et que les esprits qui rouvrent une trace n'en rouvrent pas une autre qui lui est liée. Cela supposé, si l'âme est en pouvoir de résister aux dispositions du cerveau, lorsqu'elles sont faibles, elle est toujours libre dans les songes, où les dispositions du cerveau qui la portent à de certaines choses sont toujours très-foibles. Si l'on dit que c'est qu'il ne se présente à elle que d'une sorte de pensées qui n'offrent point matière de délibération ; je prends un songe où l'on délibère si l'on tuera son ami, ou si l'on ne le tuera pas, ce qui ne peut être produit que par des dispositions matérielles du cerveau qui soient contraires ; et en ce cas il parait que, selon les principes de l'opinion commune, l'âme devrait être libre.
Je suppose qu'on se réveille lorsqu'on était résolu à tuer son ami, et que dès qu'on est réveillé on ne le veut plus tuer ; tout le changement qui arrive dans le cerveau, c'est qu'il se remplit d'esprits, que les nerfs se tendent : il faut voir comment cela produit la liberté. La disposition matérielle du cerveau qui me portait en songe à tuer mon ami, était plus forte que l'autre. Je dis, ou le changement qui arrive à mon cerveau fortifie également toutes les deux, et elles demeurent dans la même disposition où elles étaient ; l'une restant, par exemple, trois fois plus forte que l'autre ; et vous ne sauriez concevoir pourquoi l'âme est libre, quand l'une de ces dispositions a dix degrés de force, et l'autre trente, et pourquoi elle n'est pas libre quand l'une de ces dispositions n'a qu'un degré de force, et l'autre trois.
Si ce changement du cerveau n'a fortifié que l'une de ces dispositions, il faut pour établir la liberté, que ce soit celle contre laquelle je me détermine, c'est-à-dire, celle qui me portait à vouloir tuer mon ami ; et alors vous ne sauriez concevoir pourquoi la force qui survient à cette disposition vicieuse est nécessaire, pour faire que je puisse me déterminer en faveur de la disposition vertueuse qui demeure la même ; ce changement parait plutôt un obstacle à la liberté. Enfin, s'il fortifie une disposition plus que l'autre, il faut encore que ce soit la disposition vicieuse ; et vous ne sauriez concevoir non plus pourquoi la force qui lui survient est nécessaire pour faire que l'une puisse faire embrasser l'autre qui est toujours plus faible, quoique plus forte qu'auparavant.
Si l'on dit que ce qui empêche pendant le sommeil la liberté de l'âme, c'est que les pensées ne se présentent pas à elle avec assez de netteté et de distinction ; je réponds que le défaut de netteté et de distinction dans les pensées, peut seulement empêcher l'âme de se déterminer avec assez de connaissance ; mais qu'il ne la peut empêcher de se déterminer librement, et qu'il ne doit pas ôter la liberté, mais seulement le mérite ou le démérite de la résolution qu'on prend. L'obscurité et la confusion des pensées fait que l'âme ne sait pas assez surquoi elle délibère ; mais elle ne fait pas que l'âme soit entrainée nécessairement à un parti, autrement si l'âme était nécessairement entrainée, ce serait sans doute par celles de ses idées obscures et confuses qui le seraient le moins ; et je demanderais, pourquoi le plus de netteté et de distinction dans les pensées la déterminerait nécessairement pendant que l'on dort, et non pas pendant que l'on veille ; et je ferais revenir tous les raisonnements que j'ai faits sur les dispositions matérielles.
Reprenons maintenant l'objection par parties. J'accorde d'abord les trois principes que pose l'objection. Cela posé, voyons quel argument on peut faire contre la liberté. Ou l'âme, nous dit-on, se peut absolument déterminer dans l'équilibre des dispositions du cerveau à choisir entre les pensées vertueuses et les pensées vicieuses, ou elle ne peut absolument se déterminer dans cet équilibre. Si elle peut se déterminer ; elle a en elle-même le pouvoir de se déterminer. Jusqu'ici il n'y a point de difficulté ; mais d'en conclure que le pouvoir qu'a l'âme de se déterminer est indépendant des dispositions du cerveau, c'est ce qui n'est pas exactement vrai. Si vous ne voulez dire par-là que ce qu'on entend ordinairement, savoir que la liberté ne réside pas dans le corps, mais seulement que l'âme en est le siege, la source et l'origine, je n'aurai sur cela aucune dispute avec vous ; mais si vous voulez en inférer que, quelles que soient les dispositions matérielles du cerveau, l'âme aura toujours le pouvoir de se déterminer au choix qui lui plaira ; c'est ce que je vous nierai. La raison en est, que l'âme pour se déterminer librement, doit nécessairement exercer toutes ses fonctions, et que pour les exercer, elle a besoin d'un corps prêt à obéir à tous ses commandements, de même qu'un joueur de luth, doit avoir un luth dont toutes les cordes soient tendues et accordées, pour jouer les airs avec justesse : or il peut fort bien se faire que les dispositions matérielles du cerveau soient telles que l'âme ne puisse exercer toutes ses fonctions, ni par conséquent sa liberté : car la liberté consiste dans le pouvoir qu'on a de fixer ses idées, d'en rappeler d'autres pour les comparer ensemble, de diriger le mouvement de ses esprits, de les arrêter dans l'état où ils doivent être pour empêcher qu'une idée ne s'échappe, de s'opposer au torrent des autres esprits qui viendraient à la traverse imprimer à l'âme malgré elle d'autres idées. Or le cerveau est quelquefois tellement disposé, que ce pouvoir manque absolument à l'âme, comme cela se voit dans les enfants, dans ceux qui rêvent, etc. Posons un vaisseau mal fabriqué, un gouvernail mal-fait, le pilote avec tout son art, ne pourra point le conduire comme il souhaite : de même aussi un corps mal formé, un tempérament dépravé produira des actions déréglées. L'esprit humain ne pourra pas plus apporter de remède à ce dérèglement pour le corriger, qu'un pilote au désordre du mouvement de son vaisseau.
Mais enfin, direz-vous, le pouvoir que l'âme a de se déterminer, est-il absolument dépendant des dispositions du cerveau, ou ne l'est-il pas ? Si vous dites que ce pouvoir de l'âme est absolument dépendant des dispositions du cerveau, vous direz aussi que l'âme ne se déterminera jamais, si l'une des dispositions du cerveau ne vient à l'emporter sur l'autre, et qu'elle se déterminera nécessairement pour celle qui l'emportera. Si au contraire vous supposez que ce pouvoir est indépendant des dispositions du cerveau, vous devez reconnaître pour libres les pensées des enfants, de ceux qui rêvent, etc. Je réponds que le pouvoir que l'âme a de se déterminer est quelquefois dépendant des dispositions du cerveau, et d'autres fois indépendant. Il est dépendant toutes les fois que le cerveau qui sert à l'âme d'organe et d'instrument pour exercer ses fonctions, n'est pas bien disposé ; alors les ressorts de la machine étant détraqués, l'âme est entrainée sans pouvoir exercer sa liberté. Mais le pouvoir de se déterminer est indépendant des dispositions matérielles du cerveau, lorsque ces dispositions sont modérées, que le cerveau est plein d'esprits, et que les nerfs sont tendus. La liberté sera d'autant plus parfaite que l'organe du cerveau sera mieux constitué, et que ses dispositions seront plus modérées. Je ne saurais vous marquer quelles sont les bornes au-delà desquelles s'évanouit la liberté. Tout ce que je sais, c'est que le pouvoir de se déterminer sera absolument indépendant des dispositions du cerveau, toutes les fois que le cerveau sera plein d'esprits, que ses fibres seront fermes, qu'elles seront tendues, et que les ressorts de la machine ne seront point démontés, ni par les accidents, ni par les maladies. Le principe, dites-vous, n'est pas uniforme dans l'âme. Il est bien plus conforme à la Philosophie de supposer l'âme ou toujours libre ou toujours esclave. Et moi, je dis que l'expérience est la seule vraie Physique. Or que nous dit-elle cette expérience ? Elle nous dit que nous sommes quelquefois emportés malgré nous ; d'où je conclus, donc nous sommes quelquefois maîtres de nous ; la maladie prouve la santé, et la liberté est la santé de l'âme. Voyez dans le deuxième discours sur la liberté ce raisonnement paré et embelli par M. de Voltaire de toutes les grâces de la Poésie.
La liberté, dis-tu, t'est quelquefois ravie :
Dieu te la devait-il immuable, infinie,
Egale en tout état, en tout temps, en tout lieu ?
Tes destins sont d'un homme, et tes vœux sont d'un Dieu.
Quoi ! dans cet océan, cet atome qui nage
Dira : L'immensité doit être mon partage.
Non, tout est faible en toi, changeant, et limité ;
Ta force, ton esprit, tes membres, ta beauté.
La nature, en tout sens, a des bornes prescrites ;
Et le pouvoir humain serait seul sans limites ?
Mais, dis-moi : quand ton cœur formé de passions
Se rend, malgré lui-même, à leurs impressions,
Qu'il sent dans ses combats sa liberté vaincue,
Tu l'avais donc en toi, puisque tu l'as perdue.
Une fiévre brulante attaquant tes ressorts,
Vient à pas inégaux miner ton faible corps.
Mais quoi ! par ce danger répandu sur ta vie,
Ta santé pour jamais n'est point anéantie,
On te voit revenir des portes de la mort,
Plus ferme, plus content, plus tempérant, plus fort.
Connais mieux l'heureux don, que ton chagrin reclame,
La liberté, dans l'homme, est la santé de l'âme.
On la perd quelquefois. La soif de la grandeur,
La colere, l'orgueil, un amour suborneur,
D'un désir curieux les trompeuses saillies ;
Hélas ! combien le cœur a-t-il de maladies !
Si un poids de cinq livres, dites-vous, pouvait n'être pas emporté par un poids de six, il ne le serait pas non plus par un poids de mille. Ainsi, si l'âme résiste à une disposition matérielle du cerveau qui la porte à un choix vicieux, et qui, quoique pourtant modérée, est plus forte que la disposition matérielle à la vertu ; il faut que l'âme résiste à cette même disposition matérielle du vice, quand elle sera infiniment au-dessus de l'autre. Je réponds qu'il ne s'ensuit nullement que l'âme puisse résister à une disposition matérielle du vice, quand elle sera infiniment au-dessus de la disposition matérielle à la vertu, précisément parce qu'elle aura résisté à cette même disposition matérielle du vice, quand elle était un peu plus forte que l'autre. Quand de deux dispositions contraires, qui sont dans le cerveau, l'une est infiniment plus forte que l'autre, il peut se faire que dans cet état, le mouvement naturel des esprits soit trop violent, et que par conséquent la force de l'âme n'ait nulle proportion avec celle de ces esprits qui l'emportent nécessairement. Quoique le principe par lequel je me détermine soit indépendant des dispositions du cerveau, puisqu'il réside dans mon âme, on peut dire néanmoins qu'il les suppose comme une condition, sans laquelle il deviendrait inutile. Le pouvoir de se déterminer n'est pas plus dépendant des dispositions du cerveau, que le pouvoir de peindre, de graver et d'écrire ; l'art du pinceau, du burin et de la plume ; et de même qu'on ne peut bien écrire, bien graver et bien peindre, si l'on n'a une bonne plume, un bon burin et un pinceau ; ainsi, l'on ne peut agir avec liberté, à moins que le cerveau ne soit bien constitué. Mais aussi de même que le pouvoir d'écrire, de graver et de peindre est absolument indépendant de la plume, du burin et du pinceau ; le pouvoir de se déterminer ne l'est pas moins des dispositions du cerveau.
On convient, dira-t-on, que l'âme dépend absolument des dispositions du cerveau sur ce qui regarde le plus ou le moins d'esprit : cependant, si sur la vertu et sur le vice, les dispositions du cerveau ne déterminent l'âme, que lorsqu'elles sont extrêmes, et qu'elles lui laissent la liberté lorsqu'elles sont modérées : en sorte qu'on peut avoir beaucoup de vertu, malgré une disposition médiocre au vice, il devrait être aussi qu'on peut avoir beaucoup d'esprit malgré une disposition médiocre à la stupidité. J'avoue que je ne sens pas assez le fin de ce raisonnement. Je ne saurais concevoir, pourquoi, pouvant avoir beaucoup de vertu malgré une disposition médiocre au vice, je pourrais aussi avoir beaucoup d'esprit malgré une disposition médiocre à la stupidité. Le plus ou le moins d'esprit dépend du plus ou du moins de délicatesse des organes : il consiste dans une certaine conformation du cerveau, dans une heureuse disposition des fibres. Toutes ces choses n'étant nullement soumises au choix de ma volonté, il ne dépend pas de moi de me mettre en état d'avoir, si je veux, beaucoup de discernement et de pénétration. Mais la vertu et le vice dépendent de ma volonté ; je ne nierai pourtant pas que le tempérament n'y contribue beaucoup, et ordinairement on se fie plus à une vertu qui est naturelle et qui a sa source dans le sang, qu'à celle qui est un pur effet de la raison, et qu'on a acquise à force de soins.
Je suppose, continue-t-on, qu'on se réveille, lorsqu'on était résolu à tuer son ami, et que dès qu'on est réveillé, on ne veut plus le tuer. La disposition matérielle du cerveau qui me portait en songe à vouloir tuer mon ami, était plus forte que l'autre. Je dis, ou le changement qui arrive à mon cerveau fortifie également toutes les deux, ou elles demeurent dans la même disposition où elles étaient, l'une restant p. ex. trois fois plus forte que l'autre. Vous ne sauriez concevoir pourquoi l'âme est libre, quand l'une de ces dispositions a dix degrés de force, et l'autre trente ; et pourquoi elle n'est pas libre quand l'une de ces dispositions n'a qu'un degré de force, et l'autre que trois. Cette objection n'a de force, que parce qu'on ne démêle pas assez exactement les différences qui se trouvent entre l'état de veille et celui du sommeil. Si je ne suis pas libre dans le sommeil, ce n'est pas, comme le suppose l'objection, parce que la disposition matérielle du cerveau, qui me porte à tuer mon ami, est trois fois plus forte que l'autre. Le défaut de liberté vient du défaut d'esprit et du relâchement des nerfs. Mais que le cerveau soit une fois rempli d'esprits, et que les nerfs soient tendus, je serai toujours également libre, soit que l'une de ces dispositions ait dix degrés de force, et l'autre trente ; soit que l'une de ces dispositions n'ait qu'un degré de force, et l'autre que trois. Si vous en voulez savoir la raison, c'est que le pouvoir qui est dans l'âme de se déterminer est absolument indépendant des dispositions du cerveau, pourvu que le cerveau soit bien constitué, qu'il soit rempli d'esprits et que les nerfs soient tendus.
L'action des esprits dépend de trois choses, de la nature du cerveau sur lequel ils agissent, de leur nature particulière et de la quantité, ou de la détermination de leur mouvement. De ces trois choses, il n'y a précisément que la dernière dont l'âme puisse être maîtresse. Il faut donc que le pouvoir seul de mouvoir les esprits suffise pour la liberté. Or, 1°. dites-vous, si le pouvoir de diriger le mouvement des esprits suffit pour la liberté, les enfants doivent être libres, puisque leur âme doit avoir ce pouvoir. 2°. Pourquoi l'âme des fous ne serait-elle pas libre aussi ? Elle peut encore diriger le mouvement de ses esprits. 3°. L'ame ne devrait jamais avoir plus de facilité à diriger le mouvement de ses esprits que pendant le sommeil, et par conséquent elle ne devrait jamais être plus libre. Je réponds, que le pouvoir de diriger le mouvement de ses esprits ne se trouve ni dans les enfants, ni dans les fous, ni dans ceux qui dorment. La nature du cerveau des enfants s'y oppose. La substance en est trop tendre et trop molle ; les fibres en sont trop délicates, pour que leur âme puisse fixer et arrêter à son gré les esprits qui doivent couler de toutes parts, parce qu'ils trouvent par-tout un passage libre et aisé. Dans les fous, le mouvement naturel de leurs esprits est trop violent, pour que leur âme en soit la maîtresse. Dans cet état, la force de l'âme n'a nulle proportion avec celle des esprits qui l'emportent nécessairement. Enfin, le sommeil ayant détendu la machine du corps, et en ayant amorti tous les mouvements, les esprits ne peuvent couler librement. Vouloir que l'âme dans cet assoupissement, où tous les sens sont enchainés, et où tous les ressorts sont relâchés, dirige à son gré le mouvement des esprits ; c'est exiger qu'un joueur de lyre fasse resonner sous son archet une lyre dont les cordes sont détendues.
Un des arguments les plus terribles qu'on ait jamais opposé contre la liberté, est l'impossibilité d'accorder avec elle la prescience de Dieu. Il y a eu des philosophes assez déterminés pour dire que Dieu peut très-bien ignorer l'avenir, à-peu-près, s'il est permis de parler ainsi, comme un roi peut ignorer ce que fait un général à qui il aura donné la carte blanche ; c'est le sentiment des Sociniens.
D'autres soutiennent, que l'argument pris de la certitude de la prescience divine ne touche nullement à la question de la liberté ; parce que la prescience, disent-ils, ne renferme point d'autre certitude, que celle qui se rencontrerait également dans les choses, encore qu'il n'y eut point de prescience. Tout ce qui existe aujourd'hui existe certainement, et il était hier et de toute éternité aussi certainement vrai qu'il existerait aujourd'hui, qu'il est maintenant certain qu'il existe. Cette certitude d'évenement est toujours la même, et la prescience n'y change rien. Elle est par rapport aux choses futures, ce que la connaissance est aux choses présentes, et la mémoire aux choses passées : or, l'une et l'autre de ces connaissances ne suppose aucune nécessité d'exister dans la chose ; mais seulement une certitude d'évenement qui ne laisserait pas d'être, quand bien même ces connaissances ne seraient pas. Jusqu'ici, tout est intelligible. La difficulté est et sera toujours à expliquer, comment Dieu peut prévoir les choses futures, ce qui ne parait pas possible, à moins de supposer une chaîne de causes nécessaires ; nous pouvons cependant nous en faire quelque espèce d'idée générale. Un homme d'esprit prévait le parti que prendra dans telle occasion un homme, dont il connait le caractère. A plus forte raison Dieu, dont la nature est infiniment plus parfaite, peut-il par la prévision avoir une connaissance beaucoup plus certaine des événements libres. J'avoue que tout cela me parait très hazardé, et que c'est un aveu plutôt qu'une solution de la difficulté. J'avoue, enfin, qu'on fait contre la liberté, d'excellentes objections ; mais on en fait d'aussi bonnes contre l'éxistence de Dieu ; et comme malgré les difficultés extrêmes, contre la création et contre la providence, je crois néanmoins la providence et la création ; aussi je me crois libre, malgré les puissantes objections que l'on fera toujours contre cette malheureuse liberté. Eh ! comment ne la croirais-je pas ? Elle porte tous les caractères d'une première vérité. Jamais opinion n'a été si universelle dans le genre humain. C'est une vérité pour l'éclaircissement de laquelle il n'est pas nécessaire d'approfondir les raisonnements des livres : c'est ce que la nature crie ; c'est ce que les bergers chantent sur les montagnes, les poètes sur les théâtres ; c'est ce que les plus habiles docteurs enseignent dans les chaires ; c'est ce qui se répète et se suppose dans toutes les conjonctures de la vie. Le petit nombre de ceux qui, par affectation de singularité, ou par des réflexions outrées, ont voulu dire ou imaginer le contraire, ne montrent-ils pas eux-mêmes par leur conduite, la fausseté de leurs discours ? Donnez-moi, dit l'illustre Fénelon, un homme qui fait le profond philosophe, et qui nie le libre arbitre : je ne disputerai point contre lui : mais je le mettrai à l'épreuve dans les plus communes occasions de la vie, pour le confondre par lui-même. Je suppose que la femme de cet homme lui soit infidèle, que son fils lui désobéit et le méprise, que son ami le trahit, que son domestique le vole ; je lui dirai, quand il se plaindra d'eux, ne savez-vous pas qu'aucun d'eux n'a tort, et qu'ils ne sont pas libres de faire autrement ? Ils sont, de votre aveu, aussi invinciblement nécessités à vouloir ce qu'ils veulent, qu'une pierre l'est à tomber, quand on ne la soutient pas. N'est-il donc pas certain que ce bizarre philosophe qui ose nier le libre arbitre dans l'école, le supposera comme indubitable dans sa propre maison, et qu'il ne sera pas moins implacable contre ces personnes, que s'il avait soutenu toute sa vie le dogme de la plus grande liberté ?
Vais de la liberté cet ennemi mutin,
Aveugle partisan d'un aveugle destin.
Entends comme il consulte, approuve ou délibere,
Entends de quel reproche il couvre un adversaire.
Vais comment d'un rival il cherche à se vanger ;
Comme il punit son fils et le veut corriger.
Il le croyait donc libre ? Oui, sans doute ; et lui-même
Dément à chaque pas son funeste système.
Il mentait à son cœur, en voulant expliquer
Le dogme absurde à croire, absurde à pratiquer.
Il reconnait en lui le sentiment qu'il brave ;
Il agit, comme libre, et parle comme esclave.
M. Voltaire, 2. disc. sur la liberté.
M. Bayle s'est appliqué surtout à ruiner l'argument pris du sentiment vif que nous avons de notre liberté. Voici ses raisons : " Disons aussi que le sentiment clair et net que nous avons des actes de notre volonté, ne peut pas faire discerner si nous nous les donnons nous-mêmes, ou si nous les recevons de la même cause qui nous donne l'existence : il faut recourir à la réflexion pour faire ce discernement. Or je mets en fait que par des méditations purement philosophiques on ne peut jamais parvenir à une certitude bien fondée que nous sommes la cause efficiente de nos volitions ; car toute personne qui examinera bien les choses, connaitra évidemment que si nous n'étions qu'un sujet purement passif à l'égard de la volonté, nous aurions les mêmes sentiments d'expérience que nous avons lorsque nous croyons être libres. Supposez par plaisir que Dieu ait réglé de telle sorte les lois de l'union de l'âme et du corps, que toutes les modalités de l'âme soient liées nécessairement entr'elles avec l'interposition des modalités du cerveau, vous comprendrez qu'il ne vous arrivera que ce que nous éprouvons ; il y aura dans notre âme la même suite de pensées depuis la perception des objets des sens, qui est la première démarche, jusqu'aux volitions les plus fixes, qui sont la dernière démarche. Il y aura dans cette suite le sentiment des idées, celui des affirmations, celui des irrésolutions, celui des velléités, et celui des volitions : car soit que l'acte de vouloir nous soit imprimé par une cause extérieure, soit que nous le produisions nous-mêmes, il sera également vrai que nous voulons, et que nous sentons ce que nous voulons ; et comme cette cause extérieure peut mêler autant de plaisir qu'elle veut dans la volition qu'elle imprime, nous pourrions sentir quelquefois que les actes de notre volonté nous plaisent infiniment.... Ne comprenez-vous pas clairement qu'une girouette à qui l'on imprimerait toujours tout-à-la-fais le mouvement vers un certain point de l'horizon, et l'envie de se tourner de ce côté-là, serait persuadée qu'elle se mouvrait d'elle-même pour exécuter les désirs qu'elle formerait ? Je suppose qu'elle ne saurait point qu'il y eut des vents, ni qu'une cause extérieure fit changer tout-à-la-fais et sa situation et ses désirs. Nous voilà naturellement dans cet état, &c ".
Tous ces raisonnements de M. Bayle sont fort beaux, mais c'est dommage qu'ils ne soient pas persuasifs : ils confondent les nôtres ; et cependant je ne sais comment ils ne font aucune impression sur nous. Hé bien, pourrais-je dire à M. Bayle, vous dites que je ne suis pas libre : votre propre sentiment ne peut vous arracher cet aveu. Selon vous il n'est pas bien décidé qu'il soit au pur choix et au gré de ma volonté de remuer ma main ou de ne pas la remuer : s'il en est ainsi, il est donc déterminé nécessairement que d'ici à un quart-d'heure je leverai trois fois la main de suite, ou que je ne la leverai pas ainsi trois fais. Je ne puis donc rien changer à cette détermination nécessaire ? Cela supposé, en cas que je gage pour un parti plutôt que pour l'autre, je ne puis gagner que d'un côté. Si c'est sérieusement que vous prétendez que je ne suis pas libre, vous ne pourrez jamais sensément refuser une offre que je vais vous faire : c'est que je gage mille pistoles contre vous une, que je ferai, au sujet du mouvement de ma main, tout le contraire de ce que vous gagerez ; et je vous laisserai prendre à votre gré l'un ou l'autre parti. Est-il offre plus avantageuse ? Pourquoi donc n'accepterez-vous jamais la gageure sans passer pour fou et sans l'être en effet ? Que si vous ne la jugez pas avantageuse, d'où peut venir ce jugement, sinon de celui que vous formez nécessairement et invinciblement que je suis libre ; en sorte qu'il ne tiendrait qu'à moi de vous faire perdre à ce jeu non-seulement mille pistoles la première fois que nous les gagerions, mais encore autant de fois que nous recommencerions la gageure.
Aux preuves de raison et de sentiment, nous pouvons joindre celles que nous fournissent la morale et la religion. Otez la liberté, toute la nature humaine est renversée, et il n'y a plus aucune trace d'ordre dans la société. Si les hommes ne sont pas libres dans ce qu'ils font de bien et de mal, le bien n'est plus bien, et le mal n'est plus mal. Si une nécessité inévitable et invincible nous fait vouloir tout ce que nous voulons, notre volonté n'est pas plus responsable de son vouloir qu'un ressort de machine est responsable du mouvement qui lui est imprimé : en ce cas il est ridicule de s'en prendre à la volonté, qui ne veut qu'autant qu'une autre cause distinguée d'elle la fait vouloir. Il faut remonter tout droit à cette cause comme je remonte à la main qui remue le bâton, sans m'arrêter au bâton qui ne me frappe qu'autant que cette main le pousse. Encore une fais, ôtez la liberté, vous ne laissez sur la terre ni vice, ni vertu, ni mérite ; les récompenses sont ridicules et les châtiments sont injustes : chacun ne fait que ce qu'il doit, puisqu'il agit selon la nécessité ; il ne doit ni éviter ce qui est inévitable, ni vaincre ce qui est invincible. Tout est dans l'ordre, car l'ordre est que tout cede à la nécessité. La ruine de la liberté renverse avec elle tout ordre et toute police, confond le vice et la vertu, autorise toute infamie monstrueuse, éteint toute pudeur et tout remords, dégrade et défigure sans ressource tout le genre humain. Une doctrine si énorme ne doit point être examinée dans l'école, mais punie pas les magistrats.
Ah, sans la liberté, que seraient donc nos âmes !
Mobiles agités par d'invincibles flammes,
Nos vœux, nos actions, nos plaisirs, nos dégouts,
De notre être, en un mot, rien ne serait à nous.
D'un artisan suprême impuissantes machines,
Automates pensans, mus par des mains divines,
Nous serions à jamais de mensonge occupés,
Vils instruments d'un Dieu qui nous aurait trompés.
Comment, sans liberté, serions-nous ses images ?
Que lui reviendrait il de ses brutes ouvrages ?
On ne peut donc lui plaire, on ne peut l'offenser ;
Il n'a rien à punir, rien à récompenser.
Dans les cieux, sur la terre, il n'est plus de justice :
Caton fut sans vertus, Catilina sans vice.
Le destin nous entraîne à nos affreux penchans,
Et ce chaos du monde est fait pour les mécans.
L'oppresseur insolent, l'usurpateur avare,
Cartouche, Mirwéis, ou tel autre barbare ;
Plus coupable enfin qu'eux le calomniateur
Dira, je n'ai rien fait, Dieu seul en est l'auteur ;
Ce n'est pas moi, c'est lui qui manque à ma parole,
Qui frappe par mes mains, pille, brule, viole.
C'est ainsi que le Dieu de justice et de paix
Serait l'auteur du trouble, et le dieu des forfaits.
Les tristes partisans de ce dogme effroyable,
Diraient-ils rien de plus s'ils adoraient le diable ?
Le second système sur la liberté est celui dans lequel on soutient que l'âme ne se détermine jamais sans cause et sans une raison prise d'ailleurs que du fond de la volonté : c'est-là surtout le système favori de M. Léibnitz. Selon lui la cause des déterminations n'est point physique, elle est morale, et agit sur l'intelligence même, de manière qu'un homme ne peut jamais être poussé à agir librement, que par des moyens propres à le persuader. Voilà pourquoi il faut des lais, et que les peines et les récompenses sont nécessaires. L'espérance et la crainte agissent immédiatement sur l'intelligence : cette liberté est opposée à la nécessité physique ou fatale, mais elle ne l'est point à la nécessité morale, laquelle, pourvu qu'elle soit seule, ne s'étend qu'à des choses contingentes, et ne porte pas la moindre atteinte à la liberté. De ce genre est celle qui fait qu'un homme qui a l'usage de sa raison, si on lui offre le choix entre de bons aliments et du poison, se détermine pour les premiers. La liberté dans ce cas est entière, et cependant le contraire est impossible. Qui peut nier que le sage, lorsqu'il agit librement, ne suive nécessairement le parti que la sagesse lui prescrit ?
La nécessité hypothétique n'est pas moins compatible avec la liberté : tous ceux qui l'ont regardée comme destructive de la liberté ont confondu le certain et le nécessaire. La certitude marque simplement qu'un événement aura lieu, plutôt que son contraire, parce que les causes dont il dépend se trouvent disposées à produire leur effet ; mais la nécessité emporte la cause même par l'impossibilité absolue du contraire. Or la détermination des futurs contingens, fondement de la nécessité hypothétique, vient simplement de la nature de la vérité : elle ne touche point aux causes ; et ne détruisant point la contingence, elle ne saurait être contraire à la liberté. Ecoutons M. Léibnitz. " La nécessité hypothétique est celle que la supposition ou hypothèse de la prévision et préordination de Dieu impose aux futurs contingens ; mais ni cette prescience ni cette préordination ne dérogent point à la liberté : car Dieu, porté par la suprême raison à choisir entre plusieurs suites de choses ou mondes possibles celui où les créatures libres prendraient telles ou telles résolutions, quoique non sans concours, a rendu par-là tout également certain et déterminé une fois pour toutes, sans déroger par-là à la liberté de ces créatures ; ce simple decret du choix ne changeant point, mais actualisant seulement leurs natures libres qu'il voyait dans ses idées ".
Le troisième système sur la liberté est celui de ceux qui prétendent que l'homme a une liberté qu'ils appellent d'indifférence, c'est-à-dire que dans les déterminations libres de la volonté, l'âme ne choisit point en conséquence des motifs, mais qu'elle n'est pas plus portée pour le oui que pour le non, et qu'elle choisit uniquement par un effet de son activité, sans qu'il y ait aucune raison de son choix, sinon qu'elle l'a voulu.
Ce qu'il y a de certain, c'est, 1°. qu'il n'y a point en Dieu de liberté d'équilibre ou d'indifférence. Un être tel que Dieu, qui se représente avec le plus grand degré de précision les différences infiniment petites des choses, voit sans doute le bon, le mauvais, le meilleur, et ne saurait vouloir que conformément à ce qu'il voit ; car autrement il agirait sans raison ou contre la raison, deux suppositions également injurieuses. Dieu suit donc toujours les idées que son entendement infini lui présente comme préférables aux autres ; il choisit entre plusieurs plans possibles le meilleur ; il ne veut et ne fait rien que par des raisons suffisantes fondées sur la nature des êtres et sur ses divins attributs.
2°. Les bienheureux dans le ciel n'ont pas non plus cette liberté d'équilibre : aucun bien ne peut balancer Dieu dans leur cœur. Il ravit d'abord tout l'amour de la volonté, et fait disparaitre tout autre bien comme le grand jour fait disparaitre les ombres de la nuit.
La question est donc de savoir si l'homme est libre de cette liberté d'indifférence ou d'équilibre. Voici les raisons de ceux qui soutiennent la négative.
1°. La chose parait impossible. Il est question de choisir entre A et B ; vous dites que, toutes choses mises à part, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Vous choisissez A, pourquoi ? parce que je le veux, dites-vous ; mais pourquoi voulez-vous A plutôt que B ? vous répliquez, parce que je le veux : Dieu m'a donné cette faculté. Mais que signifie je veux vouloir, ou je veux parce que je veux ? Ces paroles n'ont d'autre sens que celui, je veux A ; mais vous n'avez pas encore satisfait à ma question : pourquoi ne voulez-vous point B ? est-ce sans raison que vous le rejetez ? Si vous dites A me plait parce qu'il me plait, ou cela ne signifie rien, ou doit être entendu ainsi, A me plait à cause de quelque raison qui me le fait paraitre préférable à B : sans cela le néant produirait un effet, conséquence que sont obligés de digérer les défenseurs de la liberté d'équilibre.
2°. Cette liberté est opposée au principe de la raison suffisante : car si nous choisissons entre deux ou plusieurs objets, sans qu'il y ait une raison qui nous porte vers l'un plutôt que vers l'autre, voilà une détermination qui arrive sans aucune cause. Les défenseurs de l'indifférence répondent que cette détermination n'arrive pas sans cause, puisque l'âme elle-même, entant que principe actif, est la cause efficiente de toutes ses actions. Cela est vrai, mais la détermination de cette action, la préférence qui lui est donnée sur le parti opposé, d'où lui vient-elle ? " Vouloir, dit M. Léibnitz, qu'une détermination vienne d'une pleine indifférence absolument indéterminée, c'est vouloir qu'elle vienne naturellement de rien. L'on suppose que Dieu ne donne pas cette détermination : elle n'a point de source dans l'âme, ni dans le corps, ni dans les circonstances, puisque tout est supposé indéterminé ; et la voilà pourtant qui parait et qui existe sans préparation, sans que Dieu même puisse voir ou faire voir comment elle existe ". Un effet ne peut avoir lieu sans qu'il y ait dans la cause qui le doit produire une disposition à agir de la manière qu'il le faut pour produire cet effet. Or un choix, un acte de la volonté est un effet dont l'âme est la cause. Il faut donc, pour que nous fassions un tel choix, que l'âme soit disposée à le faire plutôt qu'un autre : d'où il résulte qu'elle n'est pas indéterminée et indifférente.
3°. La doctrine de la parfaite indifférence détruit toute idée de sagesse et de vertu. Si je choisis un parti, non parce que je le trouve conforme aux lois de la sagesse, mais sans aucune raison vraie ou fausse, bonne ou mauvaise, et uniquement par une impétuosité aveugle qui se détermine au hasard, quelle louange pourrai-je mériter s'il arrive que j'aie bien choisi, puisque je n'ai point pris ce parti parce qu'il était le meilleur, et que j'aurais pu faire le contraire avec la même facilité ? Comment supposer en moi de la sagesse, si je ne me détermine pas par des raisons ? La conduite d'un être doué d'une pareille liberté, serait parfaitement semblable à celle d'un homme qui déciderait toutes ses actions par un coup de dez ou en tirant à la courte paille : ce serait en vain que l'on ferait des recherches sur les motifs par lesquels les hommes agissent : ce serait en vain qu'on leur proposerait des lais, des peines et des récompenses, si tout cela n'opère pas sur leur volonté indifférente à tout.
4°. La liberté d'indifférence est incompatible avec la nature d'un être intelligent qui, dès-là qu'il se sent et se connait, aime essentiellement son bonheur, et par conséquent aime aussi tout ce qu'il croit pouvoir y contribuer. Il est ridicule de dire que ces objets sont indifférents à un tel être, et que, lorsqu'il connait clairement que de deux partis l'un lui est avantageux et l'autre lui est nuisible, il puisse choisir aussi aisément l'un que l'autre. Déjà il ne peut pas approuver l'un comme l'autre ; or donner son approbation en dernier ressort, c'est la même chose que se déterminer : voilà donc la détermination qui vient des raisons ou des motifs. De plus, on conçoit dans la volonté l'effort d'agir qui en fait même l'essence, et qui la distingue du simple jugement. Or un esprit n'étant point susceptible d'une impulsion mécanique, qui est-ce qui pourrait l'inciter à agir, si ce n'est l'amour qu'il a pour lui-même et pour son propre bonheur ? C'est-là le grand mobîle de tous les esprits ; jamais ils n'agissent que quand ils désirent d'agir : or qu'est-ce qui rend ce désir efficace, sinon le plaisir qu'on trouve à le satisfaire ? Et d'où peut naître ce désir, si ce n'est de la réprésentation de la perception de l'objet ? Un être intelligent ne peut donc être porté à agir que par quelque motif, quelque raison prise d'un bien réel ou apparent qu'il se promet de son action.
Tous ces raisonnements, quelque spécieux qu'ils paraissent, n'ont rien d'assez solide à quoi ne répondent les défenseurs de la liberté d'indifférence. M. King, archevêque de Dublin, l'a soutenue en Dieu même, dans son livre sur l'origine du mal ; mais en disant que rien n'est bon ni mauvais en Dieu par rapport aux créatures avant son choix, il enseigne une doctrine qui Ve à rendre la justice arbitraire, et à confondre la nature du juste et de l'injuste. M. de Crouzas plaide en sa faveur dans la plupart de ses ouvrages. Mais il y a des philosophes qui s'y sont pris autrement pour soutenir l'indifférence : d'abord ils avouent qu'une pareille liberté ne saurait convenir à Dieu ; mais, continuent-ils, il faut raisonner tout autrement à l'égard des intelligences bornées et subalternes. Renfermées dans une certaine sphère d'activité plus ou moins grande, leurs idées n'atteignent que jusqu'à un certain degré dans la connaissance des objets ; et en conséquence il doit leur arriver de prendre pour égales des choses qui ne le sont point du tout. Les apparences font ici le même effet que la réalité ; et l'on ne disconviendra pas, que lorsqu'il s'agit de juger, de se déterminer, d'agir, il importe peu que les choses soient égales ou inégales, pourvu que les impressions qu'elles font sur nous soient les mêmes. On prévait bien que les antagonistes de l'indifférence se hâteront de nier que des impressions égales puissent résulter d'objets inégaux. Mais cette supposition n'a pourtant rien qui ne suive nécessairement de la limitation qui fait le caractère essentiel de la créature. Dès-là que notre intelligence est bornée, ce qui différencie les objets doit nous échapper infailliblement, lorsqu'il est de nature à ne pouvoir être aperçu que par une vue extrêmement fixe et délicate. Et de-là, que suit-il ? sinon, que dans plusieurs occasions l'âme doit se trouver dans un état de doute et de suspension, sans savoir précisément à quel parti se déterminer. C'est aussi ce que justifie une expérience fréquente.
Ces principes posés, il en résulte que la liberté d'équilibre est moins une prérogative dont nous devions nous glorifier, qu'une imperfection dans notre nature et nos connaissances, qui croit ou décroit en raison réciproque de nos lumières. Dieu prévoyant que notre âme, par une suite de son imperfection, serait souvent irrésolue et comme suspendue entre deux partis, lui a donné le pouvoir de sortir de cette suspension, par une détermination dont le principe fût elle-même. Ce n'est point supposer que le rien produise quelque chose. Est-ce en effet alléguer un rien, quand on donne la volonté pour cause de nos actions en certains cas ? Que deviendrait cette activité qui est le propre des intelligences, si l'âme dans l'occasion ne pouvait agir par elle-même, et sans être mise en action par une puissance étrangère ?
Il y a d'ailleurs mille cas dans la vie où le parfait équilibre a lieu ; par exemple, quand il s'agit de choisir entre deux louis-d'or qu'on me présente. Si l'on s'avise de me soutenir sérieusement que je suis nécessité, et qu'il y a une raison en faveur de celui que j'ai pris ; pour réponse je me mets à rire, tant je suis intimement persuadé qu'il est en mon pouvoir de prendre un des deux louis-d'or, plutôt que l'autre, et qu'il n'y a point pour ce choix de raison prévalente, puisque ces deux louis-d'or sont entièrement semblables, ou qu'ils me paraissent tels.
De tout ce que nous avons dit sur la liberté, on en peut conclure que son essence consiste dans l'intelligence qui enveloppe une connaissance distincte de l'objet de la délibération. Dans la spontanéïté avec laquelle nous nous déterminons, et dans la contingence, c'est-à-dire dans l'exclusion de la nécessité logique ou métaphysique, l'intelligence est comme l'âme de la liberté, et le reste en est comme le corps et la base. La substance libre se détermine par elle-même, et cela suivant le motif du bien aperçu par l'entendement qui l'incline sans la nécessiter. Si à ces trois conditions, vous ajoutez l'indifférence d'équilibre, vous aurez une définition de la liberté, telle qu'elle se trouve dans les hommes pendant cette vie mortelle, et telle qu'elle a été définie nécessaire par l'Eglise pour mériter et démériter dans l'état de la nature corrompue. Cette liberté n'exclut pas seulement la contrainte (jamais elle ne fut admise par les fatalistes mêmes) ni la nécessité physique, absolue, fatale (ni les calvinistes, ni les jansénistes ne l'ont jamais reconnue) mais encore la nécessité morale, soit qu'elle soit absolue, soit qu'elle soit relative. La liberté catholique est dégagée de toute nécessité, suivant cette définition : ad merendum et demerendum in statu naturae lapsae, non requiritur in homine libertas à necessitate, sed sufficit libertas à coactione. Cette proposition ayant été condamnée comme hérétique, et cela dans le sens de Jansenius ; on ne souscrit à la décision de l'Eglise qu'autant qu'on reconnait une liberté exempte de cette nécessité à laquelle Jansenius l'asservissait. Or cette nécessité n'est que morale ; donc pour être catholique, il faut admettre une liberté libre de la nécessité morale, et par conséquent une liberté d'indifférence ou d'équilibre. Ce qu'il ne faut pas entendre en ce sens, que la volonté ne panche jamais plus d'un côté que de l'autre, cet équilibre est ridicule et démenti par l'expérience ; mais plutôt en ce sens que la volonté domine ses penchans. Elle ne les domine pourrant pas tellement que nous soyons toujours les maîtres de nos volitions directement. Le pouvoir de l'âme sur ses inclinations est souvent une puissance qui ne peut être exercée que d'une manière indirecte ; à-peu-près comme Bellarmin voulait que les papes eussent droit sur le temporel des rais. A la vérité, les actions externes qui ne surpassent point nos forces, dépendent absolument de notre volonté ; mais nos volitions ne dépendent de la volonté que par certains détours adroits, qui nous donnent moyen de suspendre nos résolutions ou de les changer. Nous sommes les maîtres chez nous, non pas comme Dieu l'est dans le monde, mais comme un prince sage l'est dans ses états, ou comme un bon père de famille l'est dans son domestique.
LIBERTE NATURELLE, (Droit naturel) droit que la nature donne à tous les hommes de disposer de leurs personnes et de leurs biens, de la manière qu'ils jugent la plus convenable à leur bonheur, sous la restriction qu'ils le fassent dans les termes de la loi naturelle, et qu'ils n'en abusent pas au préjudice des autres hommes. Les lois naturelles sont donc la règle et la mesure de cette liberté ; car quoique les hommes dans l'état primitif de nature, soient dans l'indépendance les uns à l'égard des autres, ils sont tous sous la dépendance des lois naturelles, d'après lesquelles ils doivent diriger leurs actions.
Le premier état que l'homme acquiert par la nature, et qu'on estime le plus précieux de tous les biens qu'il puisse posséder, est l'état de liberté ; il ne peut ni se changer contre un autre, ni se vendre, ni se perdre ; car naturellement tous les hommes naissent libres, c'est-à-dire, qu'ils ne sont pas soumis à la puissance d'un maître, et que personne n'a sur eux un droit de propriété.
Et vertu de cet état, tous les hommes tiennent de la nature même, le pouvoir de faire ce que bon leur semble, et de disposer à leur gré de leurs actions et de leurs biens, pourvu qu'ils n'agissent pas contre les lois du gouvernement auquel ils se sont soumis.
Chez les Romains un homme perdait sa liberté naturelle, lorsqu'il était pris par l'ennemi dans une guerre ouverte, ou que pour le punir de quelque crime, on le réduisait à la condition d'esclave. Mais les Chrétiens ont aboli la servitude en paix et en guerre, jusques-là, que les prisonniers qu'ils font à la guerre sur les infidèles, sont censés des hommes libres ; de manière que celui qui tuerait un de ces prisonniers, serait regardé et puni comme homicide.
De plus, toutes les puissances chrétiennes ont jugé qu'une servitude qui donnerait au maître un droit de vie et de mort sur ses esclaves, était incompatible avec la perfection à laquelle la religion chrétienne appelle les hommes. Mais comment les puissances chrétiennes n'ont-elles pas jugé que cette même religion, indépendamment du droit naturel, reclamait contre l'esclavage des negres ? c'est qu'elles en ont besoin pour leurs colonies, leurs plantations, et leurs mines. Auri sacra fames !
LIBERTE CIVILE, (Droit des nations) c'est la liberté naturelle dépouillée de cette partie qui faisait l'indépendance des particuliers et la communauté des biens, pour vivre sous des lois qui leur procurent la sûreté et la propriété. Cette liberté civîle consiste en même temps à ne pouvoir être forcé de faire une chose que la loi n'ordonne pas, et l'on ne se trouve dans cet état, que parce qu'on est gouverné par des lois civiles ; ainsi plus ces lois sont bonnes, plus la liberté est heureuse.
Il n'y a point de mots, comme le dit M. de Montesquieu, qui ait frappé les esprits de tant de manières différentes, que celui de liberté. Les uns l'ont pris pour la facilité de déposer celui à qui ils avaient donné un pouvoir tyrannique ; les autres pour la facilité d'élire celui à qui ils devaient obéir ; tels ont pris ce mot pour le droit d'être armé, et de pouvoir exercer la violence ; et tels autres pour le privilège de n'être gouvernés que par un homme de leur nation, ou par leurs propres lais. Plusieurs ont attaché ce nom à une forme de gouvernement, et en ont exclu les autres. Ceux qui avaient gouté du gouvernement républicain, l'ont mise dans ce gouvernement, tandis que ceux qui avaient joui du gouvernement monarchique, l'ont placée dans la monarchie. Enfin, chacun a appelé liberté, le gouvernement qui était conforme à ses coutumes et à ses inclinations : mais la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tous de même ce pouvoir. Il est vrai que cette liberté ne se trouve que dans les gouvernements modérés, c'est-à-dire dans les gouvernements dont la constitution est telle, que personne n'est contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet.
La liberté civîle est donc fondée sur les meilleures lois possibles ; et dans un état qui les aurait en partage, un homme à qui on ferait son procès selon les lais, et qui devrait être pendu le lendemain, serait plus libre qu'un bacha ne l'est en Turquie. Par conséquent, il n'y a point de liberté dans les états où la puissance législative et la puissance exécutrice sont dans la même main. Il n'y en a point à plus forte raison dans ceux où la puissance de juger est réunie à la législatrice et à l'exécutrice.
LIBERTE POLITIQUE, (Droit politique) la liberté politique d'un état est formée par des lois fondamentales qui y établissent la distribution de la puissance législative, de la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et de la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil, de manière que ces trois pouvoirs sont liés les uns par les autres.
La liberté politique du citoyen, est cette tranquillité d'esprit qui procede de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu'on ait cette sûreté il faut que le gouvernement soit tel, qu'un citoyen ne puisse pas craindre un citoyen. De bonnes lois civiles et politiques assurent cette liberté ; elle triomphe encore, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime.
Il y a dans le monde une nation qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique ; et si les principes sur lesquels elle la fonde sont solides, il faut en reconnaître les avantages. C'est à ce sujet, que je me souviens d'avoir oui dire à un beau génie d'Angleterre, que Corneille avait mieux peint la hauteur des sentiments qu'inspire la liberté politique, qu'aucun de leurs poètes, dans ce discours que tient Viriate à Sertorius.
Affranchissons le Tage, et laissons faire au Tibre :
La liberté n'est rien quand tout le monde est libre.
Mais il est beau de l'être, et voir tout l'univers
Soupirer sous le joug, et gémir dans les fers.
Il est beau d'étaler cette prérogative
Aux yeux du Rhône esclave, et de Rome captive,
Et de voir envier aux peuples abattus,
Ce respect que le fort garde pour les vertus.
Sertorius, act. IV. sc. vj.
Je ne prétends point décider que les Anglais jouissent actuellement de la prérogative dont je parle ; il me suffit de dire avec M. de Montesquieu, qu'elle est établie par leurs lois ; et qu'après tout, cette liberté politique extrême ne doit point mortifier ceux qui n'en ont qu'une modérée, parce que l'excès même de la raison n'est pas toujours désirable, et que les hommes en général s'accommodent presque toujours mieux des milieux que des extrémités. (D.J.)
LIBERTE DE PENSER, (Morale) Ces termes, liberté de penser, ont deux sens ; l'un général, l'autre borné. Dans le premier ils signifient cette généreuse force d'esprit qui lie notre persuasion uniquement à la vérité. Dans le second, ils expriment le seul effet qu'on peut attendre, selon les esprits forts, d'un examen libre et exact, je veux dire, l'inconviction. Autant que l'un est louable et mérite d'être applaudi, autant l'autre est blamable, et mérite d'être combattu. La véritable liberté de penser tient l'esprit en garde contre les préjugés et la précipitation. Guidée par cette sage Minerve, elle ne donne aux dogmes qu'on lui propose, qu'un degré d'adhésion proportionné à leur degré de certitude. Elle croit fermement ceux qui sont évidents ; elle range ceux qui ne le sont pas parmi les probabilités ; il en est sur lesquels elle tient sa croyance en équilibre ; mais si le merveilleux s'y joint, elle en devient moins crédule ; elle commence à douter, et se méfie des charmes de l'illusion. En un mot elle ne se rend au merveilleux qu'après s'être bien prémunie contre le penchant trop rapide qui nous y entraîne. Elle ramasse surtout toutes ses forces contre les préjugés que l'éducation de notre enfance nous fait prendre sur la religion, parce que ce sont ceux dont nous nous défaisons le plus difficilement ; il en reste toujours quelque trace, souvent même après nous en être éloignés ; lassés d'être livrés à nous-mêmes, un ascendant plus fort que nous, nous tourmente et nous y fait revenir. Nous changeons de mode, de langage ; il est mille choses sur lesquelles insensiblement nous nous accoutumons à penser autrement que dans l'enfance ; notre raison se porte volontiers à prendre ces nouvelles formes ; mais les idées qu'elle s'est faites sur la religion, sont d'une espèce respectable pour elle ; rarement ose-t-elle les examiner ; et l'impression que ces préjugés ont faite sur l'homme encore enfant, ne périt communément qu'avec lui. On ne doit pas s'en étonner ; l'importance de la matière jointe à l'exemple de nos parents que nous voyons en être réellement persuadés, sont des raisons plus que suffisantes pour les graver dans notre cœur, de manière qu'il soit difficîle de les en effacer. Les premiers traits que leurs mains impriment dans nos âmes, en laissent toujours des impressions profondes et durables ; telle est notre superstition, que nous croyons honorer Dieu par les entraves où nous mettons notre raison ; nous craignons de nous démasquer à nous-mêmes, et de nous surprendre dans l'erreur, comme si la vérité avait à redouter de paraitre au grand jour.
Je suis bien éloigné d'en conclure qu'il faille pour cela décider au tribunal de la fière raison, les questions qui ne sont que du ressort de la foi. Dieu n'a point abandonné à nos discussions des mystères qui, soumis à la spéculation, paraitraient des absurdités. Dans l'ordre de la révélation, il a posé des barrières insurmontables à tous nos efforts ; il a marqué un point où l'évidence cesse de luire pour nous ; et ce point est le terme de la raison ; mais là où elle finit, ici commence la foi, qui a droit d'exiger de l'esprit un parfait assentiment sur des choses qu'il ne comprend pas ; mais cette soumission de l'aveugle raison à la foi, n'ébranle pas pour cela ses fondements, et ne renverse pas les limites de la connaissance. Eh quoi ? Si elle n'avait pas lieu en matière de religion, cette raison que quelques-uns décrient si fort, nous n'aurions aucun droit de tourner en ridicule les opinions avec les cérémonies extravagantes qu'on remarque dans toutes les religions, excepté la véritable. Qui ne voit que c'est-là ouvrir un vaste champ au fanatisme le plus outré, et aux superstitions les plus insensées ? Avec de pareils principes, il n'y a rien qu'on ne croie, et les opinions les plus monstrueuses, la honte de l'humanité, sont adoptées. La religion qui en est l'honneur, et qui nous distingue le plus des brutes, n'est-elle pas souvent la chose en quoi les hommes paraissent les moins raisonnables ? Nous sommes faits d'une étrange manière ; nous ne saurions nous tenir dans un juste milieu. Si l'on n'est superstitieux, on est impie. Il semble qu'on ne puisse être docîle par raison, et fidèle en philosophe. Je laisse ici à décider laquelle des deux est la plus déraisonnable et la plus injurieuse à la religion, ou de la superstition ou de l'impiété. Quoi qu'il en sait, les bornes posées entre l'une et l'autre, ont eu moins à souffrir de la hardiesse de l'esprit, que de la corruption du cœur. La superstition est devenue impie, et l'impiété elle-même est devenue superstitieuse ; oui, dans toutes les religions de la terre, la liberté de penser qui insulte aux bons croyans, comme à des âmes faibles, à des esprits superstitieux, à des génies serviles, est quelquefois plus crédule et plus superstitieuse qu'on ne le pense. Quel usage de raison puis-je apercevoir dans des hommes qui craient par autorité qu'il ne faut pas croire à l'autorité ? Quels sont la plupart de ces enfants qui se glorifient de n'avoir point de religion ? A les entendre parler, ils sont les seuls sages, les seuls philosophes dignes de ce nom ; ils possèdent eux seuls l'art d'examiner la vérité ; ils sont seuls capables de tenir leur raison dans un équilibre parfait, qui ne saurait être détruit que par le poids des preuves. Tous les autres hommes, esprits paresseux, cœurs serviles et lâches, rampent sous le joug de l'autorité, et se laissent entraîner sans résistance, par les opinions reçues. Mais combien n'en voyons-nous pas dans leur société qui se laissent subjuguer par un enfant plus habile. Qu'il se trouve parmi eux un de ces génies heureux, dont l'esprit vif et original soit capable de donner le ton ; que cet esprit d'ailleurs éclairé se précipite dans l'inconviction, parce qu'il aura été la dupe d'un cœur corrompu : son imagination forte, vigoureuse, et dominante, exercera sur leurs sentiments un pouvoir d'autant plus despotique, qu'un secret penchant à la liberté prêtera à ses raisons victorieuses une force nouvelle. Elle fera passer son enthousiasme dans les jeunes imaginations, les fléchira, les pliera à son gré, les subjuguera, les renversera.
Le traité de la liberté de penser, de Collins, passe parmi les inconvaincus, pour le chef-d'œuvre de la raison humaine ; et les jeunes inconvaincus se cachent derrière ce redoutable volume, comme si c'était l'égide de Minerve. On y abuse de ce que présente de bon ce mot, liberté de penser, pour la réduire à l'irreligion ; comme si toute recherche libre de la vérité, devait nécessairement y aboutir. C'est supposer ce qu'il s'agissait de prouver, savoir si s'éloigner des opinions généralement reçues, est un caractère distinctif d'une raison asservie à la seule évidence. La paresse et le respect aveugle pour l'autorité, ne sont pas les seules entraves de l'esprit humain. La corruption du cœur, la vaine gloire, l'ambition de s'ériger en chef de parti, n'exercent que trop souvent un pouvoir tyrannique sur notre âme, qu'elles détournent avec violence de l'amour pur de la vérité.
Il est vrai que les inconvaincus en imposent et doivent en imposer par la liste des grands hommes, parmi les anciens, qui selon eux se sont distingués par la liberté de penser, Socrate, Platon, Epicure, Ciceron, Virgile, Horace, Pétrone, Corneille Tacite. Quels noms pour celui qui porte quelque respect aux talents et à la vertu ! mais cette logique est-elle bien assortie avec le dessein de nous porter à penser librement ! Pour montrer que ces illustres anciens ont pensé librement, citer quelques passages de leurs écrits, où ils s'élèvent au-dessus des opinions vulgaires, des dieux de leur pays, n'est-ce pas supposer que la liberté de penser est l'apanage des incrédules, et par conséquent supposer ce qu'il s'agissait de prouver. Nous ne dirons pas que pour se persuader que ces grands hommes de l'antiquité ont été entièrement libres dans leurs recherches, il faudrait avoir pénétré les secrets mouvements de leur cœur, dont il est impossible que leurs ouvrages nous donnent une connaissance suffisante ; que si les incrédules sont capables de cette force incompréhensible de pénétration, ils sont fort habiles ; mais que s'ils ne le sont pas, il est constant que par un sophisme très-grossier qui suppose évidemment ce qui est en question, ils veulent nous engager à respecter comme d'excellents modèles, des sages prétendus, dont l'intérieur leur est inconnu, comme au reste des hommes. Cette manière de raisonner ferait le procès à tous les honnêtes gens qui ont écrit pour ou contre quelque système que ce sait, et accuserait d'hypocrisie à Paris, à Rome, à Constantinople, dans tous les lieux de la terre, et dans tous les temps, ceux qui ont fait et qui font honneur aux nations. Mais ce qui nous fâche, c'est qu'un auteur ne se contente pas de nous donner pour modèles de la liberté de penser, quelques-uns des plus fameux sages du Paganisme ; mais qu'il étale encore à nos yeux des écrivains inspirés, et qu'il s'imagine prouver qu'ils ont pensé librement, parce qu'ils ont rejeté la religion dominante. Les prophetes, dit-il, se sont déchainés contre les sacrifices du peuple d'Israel ; donc les prophetes ont été des patrons de la liberté de penser. Serait-il possible que celui qui se mêle d'écrire, fût d'une infidélité ou d'une ignorance assez distinguée pour croire tout de bon que ces saints hommes eussent voulu détourner le peuple d'Israel du culte lévitique ? N'est-il pas beaucoup plus raisonnable d'interprêter leurs sentiments par leur conduite, et d'expliquer l'irrégularité de quelques expressions, ou par la véhemence du langage oriental qui ne s'asservit pas toujours à l'exactitude des idées, ou par un violent mouvement de l'indignation qu'inspirait à des hommes saints l'abus que les peuples corrompus faisaient des préceptes d'une saine religion ? N'y a-t-il aucune difference entre l'homme inspiré par son Dieu, et l'homme qui examine, discute, raisonne, réfléchit tranquillement et de sang froid ?
On ne peut nier qu'il n'y ait eu et qu'il n'y ait parmi les inconvaincus des hommes du premier mérite ; que leurs ouvrages ne montrent en cent endroits de l'esprit, du jugement, des connaissances ; qu'ils n'aient même servi la religion, en en décriant les véritables abus ; qu'ils n'aient forcé nos théologiens à devenir plus instruits et plus circonspects ; et qu'ils n'aient infiniment contribué à établir entre les hommes l'esprit sacré de paix et de tolérance : mais il faut aussi convenir qu'il y en a plusieurs dont on peut demander avec Swift, " qui aurait soupçonné leur existence, si la religion, ce sujet inépuisable, ne les avait pourvus abondamment d'esprit et de syllogismes ? Quel autre sujet renfermé dans les bornes de la nature et de l'art, aurait été capable de leur procurer le nom d'auteurs profonds, et de les faire lire ? Si cent plumes de cette force avaient été emploiées pour la défense du Christianisme, elles auraient été d'abord livrées à un oubli éternel. Qui jamais se serait avisé de lire leurs ouvrages, si leurs défauts n'en avaient été comme cachés et ensevelis sous une forte teinture d'irreligion ". L'impiété est d'une grande ressource pour bien des gens. Ils trouvent en elle les talents que la nature leur refuse. La singularité des sentiments qu'ils affectent, marque moins en eux un esprit supérieur, qu'un violent désir de le paraitre. Leur vanité trouvera-t-elle son compte à être simples approbateurs des opinions les mieux démontrées ? Se contenteront-ils de l'honneur subalterne d'en appuyer les preuves, ou de les affermir par quelques raisons nouvelles ? Non ; les premières places sont prises, les secondes ne sauraient satisfaire leur ambition. Semblables à César, ils aiment mieux être les premiers dans un bourg, que les secondes personnes à Rome ; ils briguent l'honneur d'être chefs de parti, en ressuscitant de vieilles erreurs, ou en cherchant des chicanes nouvelles dans une imagination que l'orgueil rend vive et féconde. Voyez l'art. INTOLERANCE et JESUS-CHRIST. (G)
LIBERTES DE L'EGLISE GALLICANE, (Jurisprudence) Elles consistent dans l'observation d'un grand nombre de points de l'ancien Droit commun et canonique concernant la discipline ecclésiastique que l'Eglise de France a conservée dans toute sa pureté, sans souffrir que l'on admit aucune des nouveautés qui se sont introduites à cet égard dans plusieurs autres églises.
L'auteur anonyme d'un traité des libertés de l'Eglise gallicane, dont il est parlé dans les œuvres de Bayle, tome I. p. 320. édit. de 1737, se trompe, lorsqu'il suppose que l'on n'a commencé à parler de nos libertés que sous le règne de Charles VI.
M. de Marca en son traité des libertés de l'Eglise gallicane, soutient que les libertés furent reclamées dès l'an 461 au premier concîle de Tours, et en 794, au concîle de Francfort.
Mais la première fois que l'on ait qualifié de libertés, le droit et la possession qu'a l'Eglise de France de se maintenir dans ses anciens usages, fut du temps de saint Louis, sous la minorité duquel, au mois d'Avril 1228, on publia en son nom une ordonnance adressée à tous ses sujets dans les diocèses de Narbonne, Cahors, Rhodès, Agen, Arles et Nimes, dont le premier articles porte, que les églises du Languedoc jouiront des libertés et immunités de l'Eglise gallicane : libertatibus et immunitatibus utantur quibus utitur Ecclésiastesia gallicana.
Les canonistes ultramontains prétendent que l'on ne pourrait autoriser nos libertés, qu'en les regardant comme des privilèges et des concessions particulières des papes, qui auraient bien voulu mettre des bornes à leur puissance, en faveur de l'Eglise gallicane : et comme on ne trouve nulle part un tel privilège accordé à cette église, ces canonistes concluent de là que nos libertés ne sont que des chimères.
D'autres par un excès de zèle pour la France, font consister nos libertés dans une indépendance entière du saint siege, ne laissant au pape qu'un vain titre de l'Eglise, sans aucune juridiction.
Mais les uns et les autres s'abusent également ; nos libertés, suivant les plus illustres prélats de l'Eglise de France, les docteurs les plus célèbres, et les canonistes les plus habiles, ne consistant, comme on l'a déjà dit, que dans l'observation de plusieurs anciens canons.
Ces libertés ont cependant quelquefois été appelées privilèges et immunités, soit par humilité ou par respect pour le saint siege, ou lorsqu'on n'a pas bien pesé la force des termes ; car il est certain que le terme de privilège est impropre, pour exprimer ce que l'on entend par nos libertés, les privilèges étant des exceptions et des grâces particulières accordées contre le droit commun, au lieu que nos libertés ne consistent que dans l'observation rigoureuse de certains points de l'ancien droit commun et canonique.
En parlant de nos libertés, on les qualifie quelquefois de saintes, soit pour exprimer le respect que l'on a pour elles, et combien elles sont précieuses à l'Eglise de France, soit pour dire qu'il n'est pas permis de les enfreindre sans encourir les peines portées par les lois : sanctae quasi legibus sancitae.
L'Eglise de France n'est pas la seule qui ait ses libertés ; il n'y en a guère qui n'ait retenu quelques restes de l'ancienne discipline ; mais dans toute l'église latine, il n'y a point de nation qui ait conservé autant de libertés que la France, et qui les ait soutenues avec plus de fermeté.
Nous n'avons point de lois particulières qui fixent précisément les libertés de l'Eglise gallicane.
Lorsque quelqu'un a voulu opposer que nous n'avons point de concessions de nos libertés, on a quelquefois répondu par plaisanterie, que le titre est au dos de la donation de Constantin au pape Sylvestre, pour dire que l'on serait bien embarrassé de part et d'autre de rapporter des titres en fait de droits aussi anciens ; mais nous ne manquons point de titres plus réels pour établir nos libertés, puisque les anciens usages de l'Eglise de France qui forment ses libertés, sont fondés sur l'ancien Droit canonique ; et à ce propos il faut observer que sous la première race de nos rais, on observait en France le code des canons de l'Eglise universelle, composé des deux premiers conciles généraux, de cinq conciles particuliers de l'Eglise grecque, et de quelques conciles tenus dans les Gaules. Ce code ayant été perdu depuis le VIIIe siècle, le pape Adrien donna à Charlemagne le code des canons de l'Eglise romaine, compilé par Denis le Petit en 527. Ce compilateur avait ajouté au code de l'Eglise universelle 50 canons des apôtres, 27 du concîle de Chalcédoine, ceux des conciles de Sardique et de Carthage, et les décrétales des papes, depuis Sirice jusqu'à Anastase.
Tel était l'ancien Droit canonique observé en France avec quelques capitulaires de Charlemagne. On regardait comme une entreprise sur nos libertés tout ce qui y était contraire ; et l'on y a encore recours lorsque la cour de Rome veut attenter sur les usages de l'Eglise de France, conformes à cet ancien droit.
Les papes ont eux-mêmes reconnu en diverses occasions la justice qu'il y a de conserver à chaque église ses libertés, et singulièrement celle de l'Eglise gallicane : cap. licet extra de frigidis et cap. in genesi extra de electione.
Nos rois ont de leur part publié plusieurs ordonnances, édits et déclarations, pour maintenir ces précieuses libertés. Les plus remarquables de ces lais, sont la pragmatique de saint Louis en 1268 ; la pragmatique faite sous Charles VII. en 1437 ; le concordat fait en 1516 ; l'édit de 1535, contre les petites dates ; l'édit de Moulins en 1580, et plusieurs autres plus récens.
Le parlement a toujours été très-soigneux de maintenir ces mêmes libertés, tant par les différents arrêts qu'il a rendus dans les occasions qui se sont présentées, que par les remontrances qu'il a faites à ce sujet à nos rais, entr'autres celles qu'il fit au roi Louis XI. en 1461, qui font une des principales pièces qui ont été recueillies dans le traité des libertés de l'Eglise gallicane, par Pierre Pithou.
Quoique le détail de nos libertés soit presqu'infini, parce qu'elles s'étendent sur tout notre Droit canonique ; elles se rapportent néanmoins à deux maximes fondamentales.
La première, que le pape et les autres supérieurs ecclésiastiques n'ont aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel de nos rais, ni sur la juridiction séculière.
La seconde, que la puissance du pape, par rapport au spirituel, n'est point absolue sur la France, mais qu'elle est bornée par les canons et par les coutumes qui sont observés dans le royaume ; de sorte que ce que le pape pourrait ordonner au préjudice de ces règles, est nul.
C'est de ces deux maximes que dérivent toutes les autres que Pierre Pithou a recueillies dans son traité des libertés de l'Eglise gallicane, qu'il dédia au roi, et qui fut imprimé pour la première fois en 1609, avec privilège.
On y joignit plusieurs autres pièces aussi fort importantes concernant les libertés de l'Eglise gallicane, telles que les rémontrances faites au roi Louis, et plusieurs mémoires et traités de Jacques Cappel, Jean du Tillet, du sieur Dumesnil, de Claude Fauchet, de Hotman, Coquille, etc. l'auteur était déjà décédé.
Mais le traité de Pithou sur les libertés de l'Eglise, est un des plus fameux de ce recueil. Quoique cet opuscule ne contienne que huit ou dix pages d'impression, il a acquis parmi nous une telle autorité, qu'on a distingué les à linea qui sont au nombre de 83, comme autant d'articles et de maximes ; et on les cite avec la même vénération que si c'étaient autant de lais.
Ce recueil a depuis été réimprimé plusieurs fois avec des augmentations de diverses pièces, qui ont aussi pour objet nos libertés.
M. Pierre Dupuy publia en 1639, en 2 vol. in-4°. un commentaire sur le traité des libertés de l'Eglise gallicane de Pithou : la dernière édition qui est de 1731 augmentée par l'abbé Lenglet du Fresnoy, compose 4 volumes in-fol. y compris deux volumes de preuves.
Les autres auteurs qui ont écrit depuis sur les libertés de l'Eglise gallicane, n'ont fait aussi pour la plupart que commenter les maximes recueillies par Pithou.
Pour la conservation de nos libertés, on a recours en France à quatre principaux moyens qui sont remarqués par Pithou, art. 75, 76, 77, 78, et 79 ; où il dit que les divers moyens ont été sagement pratiqués par nos ancêtres, selon les occurrences et les temps.
Ces moyens sont, 1°. que l'on confère avec le pape, pour se concilier à l'amiable sur les difficultés qui peuvent s'élever. 2°. De faire un examen scrupuleux des bulles et autres expéditions venant de Rome, afin qu'on ne laisse rien publier contre les droits du roi, ni contre ceux de l'Eglise gallicane. 3°. L'appel au futur concîle ; enfin l'appel comme d'abus aux parlements, en cas d'entreprise sur la juridiction séculière, et de contravention aux usages de l'Eglise de France.
Voyez les traités faits par du Tillet, Hotman, Dupuy, Leschassier, Bouchel, bibl. du Droit franc. let. j. verb. juridict. bibliot. can. tom. I. pag. 543 et 547. D'Hericourt, lois ecclésiast. part. I. chap. 17. (A)
LIBERTE, (Inscript. Med.) La Liberté sur les médailles, tient de la main droite un bonnet qui est son symbole. Tout le monde sait qu'on le donnait à ceux qu'on affranchissait. Appien raconte qu'après l'assassinat de César, un des meurtriers porta par la ville un bonnet au bout d'une pique, en signe de liberté. Il y avait sur le mont Aventin un fameux temple dédié à la Liberté, avec un parvis, autour duquel régnait un portique, qu'on nommait atrium libertatis. Sous ce portique était la célèbre bibliothèque d'Asinius Pollion qui rebâtit cet édifice.
On érigea sous Tibere dans la place publique une statue à la Liberté, dès qu'on sut la mort de Séjan. Josephe rapporte qu'après le massacre de Caïus, Cassius Chéréa vint demander le mot aux consuls, ce qu'on n'avait point Ve de mémoire d'homme, et que le mot qu'ils lui donnèrent, fut liberté.
Caïus étant décédé, on érigea sous Claude un monument à la Liberté ; mais Néron replongea l'empire dans une cruelle servitude. Sa mort rendit encore la joie générale. Tout le peuple de Rome et des provinces prit le bonnet de la liberté ; c'était un triomphe universel. On s'empressa de représenter par-tout dans les statues et sur les monnaies, l'image de la Liberté qu'on croyait renaissante.
Une inscription particulière nous parle d'une nouvelle statue de la Liberté, érigée sous Galba.
La voici telle qu'elle se lit à Rome sur la base de marbre qui soutenait cette statue.
Imaginum domus Aug. cultoribus signum
Libertatis restitutae, Ser. Galbae imperatoris
Aug. curatores anni secundi, C. Turranius
Polubius, L. Calpurnius Zena, C. Murdius
Lalus, C. Turranius Florus C. Murdius
Demosthenes.
Sur le côté gauche de la base est écrit.
Dedic. id. Octob. C. Bellico Natale Cos.
P. Cornelio Scipione Asiatico.
Ces deux consuls furent subrogés l'année 68 de Jesus-Christ.
Ce fut sur le modèle de cette statue ou de quelque autre pareille, qu'on frappa du temps du même empereur tant de monnaies, qui portent au revers, libertas August. libertas restituta, libertas publica. Les provinces à l'imitation de la capitale, dressèrent de pareilles statues. Il y a dans le cabinet du roi de France une médaille grecque de Galba, avec le type de la Liberté, et le mot . (D.J.)
LIBERTE, (Mythol. Iconol.) déesse des Grecs et des Romains. Les Grecs l'invoquaient sous le nom d'Eleuthérie, et quelquefois ils disaient , dieux de la liberté. Les Romains qui l'appelèrent Libertas, eurent cette divinité en singulière vénération, lui bâtirent des temples, des autels en nombre, et lui érigèrent quantité de statues. Tiberius Gracchus lui consacra sur le mont Aventin un temple magnifique, soutenu de colonnes de bronze, et décoré de superbes statues. Il était précédé d'une cour qu'on appelait atrium Libertatis.
Quand Jules César eut soumis les Romains à son empire, ils élevèrent un temple nouveau en l'honneur de cette déesse, comme si leur liberté était rétablie par celui qui en sappa les fondements ; mais dans une médaille de Brutus, on voit la Liberté sous la figure d'une femme, tenant d'une main le chapeau, symbole de la liberté, et deux poignards de l'autre main avec l'inscription, idibus Martiis, aux ides de Mars.
La déesse était encore représentée par une femme vêtue de blanc, tenant le bonnet de la main droite, et de la gauche une javeline ou verge, telle que celle dont les maîtres frappaient leurs esclaves lorsqu'ils les affranchissaient : il y a quelquefois un chat auprès d'elle.
Dans d'autres médailles, elle est accompagnée de deux femmes, qu'on nommait Adioné et Abéodoné, et qu'on regardait comme ses suivantes ; parce que la liberté renferme le pouvoir d'aller et de venir où l'on veut.
Quelques villes d'Italie, comme Bologne, Gènes, Florence, portaient autrefois dans leurs drapeaux, dans leurs armoiries, le mot libertas, et ils avaient raison ; mais cette belle devise ne leur convient plus aujourd'hui : c'est à Londres qu'il appartient d'en faire trophée. (D.J.)
LIBERTE DE COUR, terme de Commerce, c'est l'affranchissement dont jouit un marchand de la juridiction ordinaire des lieux où il fait son négoce, et le privilège qu'a un étranger de porter les affaires concernant son trafic par-devant un juge de sa nation.
Ce terme a particulièrement lieu par rapport aux villes hanséatiques, qui dans tous les comptoirs qu'elles avaient autrefois dans les principales villes de commerce de l'Europe, comme Londres, Anvers, etc. entretenaient une espèce de consul, et sous lui un greffier, par-devant lequel tous les marchands de leur hanse ou ligue devaient se pourvoir en première instance, et dont les jugements se portaient par appel et en dernier ressort, par-devant les juges et magistrats des villes hanséatiques, dont l'assemblée résidait à Lubeck.
Ce qui reste aujourd'hui des villes hanséatiques qui sont réduites à sept ou huit, jouit encore de ce privilège, mais seulement parmi leurs propres négociants. Voyez HANSE et HANSEATIQUES, ou ANSEATIQUES. Dictionnaire de Comm.
LIBERTE, en Peinture, est une habitude de main que le peintre acquiert par la pratique. Légereté et liberté de pinceau, diffèrent en ce que légèreté suppose plus de capacité dans un peintre que liberté ; ces deux termes sont cependant fort analogues.
LIBERTE, parmi les Horlogers, signifie la facilité qu'une pièce a pour se mouvoir. On dit, par exemple, qu'une roue est fort libre, ou qu'elle a beaucoup de liberté, lorsque la plus petite force est capable de la mettre en mouvement. Voyez JEU.
LIBERTE, (Maréchalerie) la liberté de la langue. Voyez LANGUE. Sauteur en liberté. Voyez SAUTEUR.
LIBERTE, FACILITE, LEGERETE, FRANCHISE, (Beaux-arts) ces termes ordinairement synonymes dans les beaux-arts, sont l'expression de l'aisance dans leur pratique, et cette aisance ajoute des grâce aux mérites des ouvrages. Il y a une liberté délicate, que possédent les grands maîtres, et qui n'est sensible qu'aux yeux savants ; mais voyez FRANCHISE de pinceau, de burin, et FACILITE, Peinture. (D.J.)