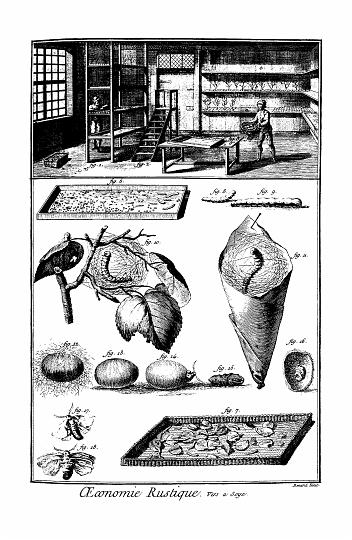S. f. (Morale) les hommes sont faits pour vivre en société ; si l'intention de Dieu eut été que chaque homme vécut seul, et séparé des autres, il aurait donné à chacun d'eux des qualités propres et suffisantes pour ce genre de vie solitaire ; s'il n'a pas suivi cette route, c'est apparemment parce qu'il a voulu que les liens du sang et de la naissance commençassent à former entre les hommes cette union plus étendue qu'il voulait établir entr'eux ; la plupart des facultés de l'homme, ses inclinations naturelles, sa faiblesse, ses besoins, sont autant de preuves certaines de cette intention du Créateur. Telle est en effet la nature et la constitution de l'homme, que hors de la société, il ne saurait ni conserver sa vie, ni développer et perfectionner ses facultés et ses talents, ni se procurer un vrai et solide bonheur. Que deviendrait, je vous prie, un enfant, si une main bienfaisante et secourable ne pourvoyait à ses besoins ? Il faut qu'il périsse si personne ne prend soin de lui ; et cet état de faiblesse et d'indigence, demande même des secours long - temps continués ; suivez-le dans sa jeunesse, vous n'y trouverez que grossiereté, qu'ignorance, qu'idées confuses ; vous ne verrez en lui, s'il est abandonné à lui - même, qu'un animal sauvage, et peut-être féroce ; ignorant toutes les commodités de la vie, plongé dans l'oisiveté, en proie à l'ennui et aux soucis dévorants. Parvient-on à la vieillesse, c'est un retour d'infirmités, qui nous rendent presque aussi dépendants des autres, que nous l'étions dans l'enfance imbécile ; cette dépendance se fait encore plus sentir dans les accidents et dans les maladies ; c'est ce que dépeignait fort bien Séneque, Senec. de benef. l. IV. c. XVIIIe " D'où dépend notre sûreté, si ce n'est des services mutuels ? il n'y a que ce commerce de bienfaits qui rende la vie commode, et qui nous mette en état de nous défendre contre les insultes et les évasions imprévues ; quel serait le sort du genre humain, si chacun vivait à part ? autant d'hommes, autant de proies et de victimes pour les autres animaux, un sang fort aisé à répandre, en un mot la faiblesse même. En effet, les autres animaux ont des forces suffisantes pour se défendre ; tous ceux qui doivent être vagabonds, et à qui leur férocité ne permet pas de vivre en troupes, naissent pour ainsi dire armés, au lieu que l'homme est de toute part environné de faiblesse, n'ayant pour armes ni dents ni griffes ; mais les forces qui lui manquent quand il se trouve seul, il les trouve en s'unissant avec ses semblables ; la raison, pour le dédommager, lui a donné deux choses qui lui rendent sa supériorité sur les animaux, je veux dire la raison et la sociabilité, par où celui qui seul ne pouvait résister à personne, devient le tout ; la société lui donne l'empire sur les autres animaux ; la société fait que non content de l'élement où il est né, il étend son domaine jusque sur la mer ; c'est la même union qui lui fournit des remèdes dans ses maladies, des secours dans sa vieillesse, du soulagement à ses douleurs et à ses chagrins ; c'est elle qui le met, pour ainsi dire, en état de braver la fortune. Otez la sociabilité, vous détruirez l'union du genre humain, d'où dépend la conservation et tout le bonheur de la vie ".
La société étant si nécessaire à l'homme, Dieu lui a aussi donné une constitution, des facultés, des talents qui le rendent très-propre à cet état ; telle est, par exemple, la faculté de la parole, qui nous donne le moyen de communiquer nos pensées avec tant de facilité et de promptitude, et qui hors de la société ne serait d'aucun usage. On peut dire la même chose du penchant à l'imitation, et de ce merveilleux mécanisme qui fait que les passions et toutes les impressions de l'âme, se communiquent si aisément d'un cerveau à l'autre ; il suffit qu'un homme paraisse ému, pour nous émouvoir et nous attendrir pour lui : homo sum, humani à me nihil alienum puto. Si quelqu'un vous aborde avec la joie peinte sur le visage, il excite en nous un sentiment de joie ; les larmes d'un inconnu nous touchent, avant même que nous en sachions la cause, et les cris d'un homme qui ne tient à nous que par l'humanité, nous font courir à son secours, par un mouvement machinal qui précède toute délibération. Ce n'est pas tout, nous voyons que la nature a voulu partager et distribuer différemment les talents entre les hommes, en donnant aux uns une aptitude de bien faire certaines choses, qui sont comme impossibles à d'autres ; tandis que ceux-ci, à leur tour, ont une industrie qu'elle a refusé aux premiers ; ainsi, si les besoins naturels des hommes les font dépendre les uns des autres, la diversité des talents qui les rend propres à s'aider mutuellement, les lie et les unit. Ce sont-là autant d'indices bien manifestes de la destination de l'homme pour la société.
Mais si nous consultons notre penchant, nous sentirons aussi que notre cœur se porte naturellement à souhaiter la compagnie de nos semblables, et à craindre une solitude entière comme un état d'abandon et d'ennui. Que si l'on recherche d'où nous vient cette inclination liante et sociable, on trouvera qu'elle nous a été donnée très-à-propos par l'auteur de notre être, parce que c'est dans la société que l'homme trouve le remède à la plupart de ses besoins, et l'occasion d'exercer la plupart de ses facultés ; c'est-là, surtout, qu'il peut éprouver et manifester ces sentiments, auxquels la nature a attaché tant de douceur, la bienveillance, l'amitié, la compassion, la générosité : car tel est le charme de ces affections sociables, que de-là naissent nos plaisirs les plus purs. Rien en effet de si satisfaisant ni de si flatteur, que de penser que l'on mérite l'estime et l'amitié d'autrui ; la science acquiert un nouveau prix, quand elle peut se produire au dehors ; et jamais la joie n'est plus vive que lorsqu'on peut la faire éclater aux yeux des autres, ou la répandre dans le sein d'un ami ; elle redouble en se communiquant, parce qu'à notre propre satisfaction se joint l'agréable idée que nous en causons aussi aux autres, et que par-là nous les attachons davantage à nous ; le chagrin au contraire diminue et s'adoucit, en le partageant avec quelqu'un, comme un fardeau s'allege quand une personne officieuse nous aide à le porter. Ainsi, tout nous invite à l'état de société ; le besoin nous en fait une nécessité, le penchant nous en fait un plaisir, et les dispositions que nous y apportons naturellement, nous montrent que c'est en effet l'intention de notre créateur. Si le christianisme canonise des solitaires, il ne leur en fait pas moins une suprême loi de la charité et de la justice, et par-là il leur suppose un rapport essentiel avec le prochain ; mais sans nous arrêter à l'état où les hommes peuvent être élevés, par des lumières surnaturelles, considérons-les ici entant qu'ils sont conduits par la raison humaine.
Toute l'économie de la société humaine est appuyée sur ce principe général et simple : je veux être heureux ; mais je vis avec des hommes qui, comme moi, veulent être heureux également chacun de leur côté : cherchons le moyen de procurer notre bonheur, en procurant le leur, ou du moins sans y jamais nuire. Nous trouvons ce principe gravé dans notre cœur ; si d'un côté, le Créateur a mis l'amour de nous - mêmes, de l'autre, la même main y a imprimé un sentiment de bienveillance pour nos semblables ; ces deux penchans, quoique distincts l'un de l'autre, n'ont pourtant rien d'opposé : et Dieu qui les a mis en nous, les a destinés à agir de concert, pour s'entr'aider, et nullement pour se détruire ; aussi les cœurs bien faits et généreux trouvent-ils la satisfaction la plus pure, à faire du bien aux autres hommes, parce qu'ils ne font en cela que suivre une pente que la nature leur a donnée. Les moralistes ont donné à ce germe de bienveillance qui se développe dans les hommes, le nom de sociabilité. Du principe de la sociabilité, découlent, comme de leur source, toutes les lois de la société, et tous nos devoirs envers les autres hommes, tant généraux que particuliers. Tel est le fondement de toute la sagesse humaine, la source de toutes les vertus purement naturelles, et le principe général de toute la morale et de toute la société civile.
1°. Le bien commun doit être la règle suprême de notre conduite, et nous ne devons jamais chercher notre avantage particulier, au préjudice de l'avantage public ; c'est ce qu'exige de nous l'union que Dieu a établie entre les hommes.
2°. L'esprit de sociabilité doit être universel ; la société humaine embrasse tous les hommes avec lesquels on peut avoir commerce, puisqu'elle est fondée sur les relations qu'ils ont tous ensemble, en conséquence de leur nature et de leur état. Voyez HUMANITE. Un prince d'Allemagne, duc de Wirtemberg, semblait en être persuadé, lorsqu'un de ses sujets le remerciant de l'avoir protégé contre ses persécuteurs : mon enfant, lui dit le prince, je l'aurais dû faire à l'égard d'un turc ; comment y aurais - je manqué à l'égard d'un de mes sujets ?
3°. L'égalité de la nature entre les hommes, est un principe que nous ne devons jamais perdre de vue. Dans la société c'est un principe établi par la philosophie et par la religion ; quelqu'inégalité que semble mettre entr'eux la différence des conditions, elle n'a été introduite que pour les faire mieux arriver, selon leur état présent, tous à leur fin commune, qui est d'être heureux autant que le comporte cette vie mortelle ; encore cette différence qui parait bien mince à des yeux philosophiques, est-elle d'une courte durée ; il n'y a qu'un pas de la vie à la mort, et la mort met au même terme ce qui est de plus élevé et de plus brillant, avec ce qui est de plus bas et de plus obscur parmi les hommes. Il ne se trouve ainsi, dans les diverses conditions, guère plus d'inégalité que dans les divers personnages d'une même comédie : la fin de la pièce remet les comédiens au niveau de leur condition commune, sans que le court intervalle qu'a duré leur personnage, ait persuadé ou pu persuader à aucun d'eux, qu'il était réellement au - dessus ou au-dessous des autres. Rien n'est plus beau dans les grands, que ce souvenir de leur égalité avec les autres hommes, par rapport à leur nature. Un trait du roi de Suède, Charles XII. peut donner à ce sujet une idée plus haute de ses sentiments, que la plus brillante de ses expéditions. Un domestique de l'ambassadeur de France, attendant un ministre de la cour de Suède, fut interrogé sur ce qu'il attendait, par une personne à lui inconnue, et vétue comme un simple soldat ; il tint peu de compte de satisfaire à la curiosité de cet inconnu ; un moment après, des seigneurs de la cour abordant la personne simplement vétue, la traitèrent de votre majesté, c'était effectivement le roi ; le domestique au désespoir, et se croyant perdu, se jette à ses pieds, et demande pardon de son inconsidération d'avoir pris sa majesté, disait-il, pour un homme. Vous ne vous êtes point mépris, lui dit le roi avec humanité, rien ne ressemble plus à un homme qu'un roi. Tous les hommes, en supposant ce principe de l'égalité qui est entr'eux, doivent y conformer leur conduite, pour se prêter mutuellement les secours dont ils sont capables ; ceux qui sont les plus puissants, les plus riches, les plus accrédités, doivent être disposés à employer leur puissance, leurs richesses, et leur autorité, en faveur de ceux qui en manquent, et cela à proportion du besoin qui est dans les uns, et du pouvoir d'y subvenir qui est dans les autres.
4°. La sociabilité étant d'une obligation réciproque entre les hommes, ceux qui par leur malice, ou leur injustice, rompent le lien de la société, ne sauraient se plaindre raisonnablement, si ceux qu'ils offensent, ne les traitent plus comme amis, ou même s'ils en viennent contr'eux à des voies de fait ; mais si l'on est en droit de suspendre à l'égard d'un ennemi, les actes de la bienveillance, il n'est jamais permis d'en étouffer le principe : comme il n'y a que la nécessité qui nous autorise à recourir à la force contre un injuste aggresseur ; c'est aussi cette même nécessité qui doit être la règle et la mesure du mal que nous pouvons lui faire, et nous devons toujours être disposés à rentrer en amitié avec lui, dès qu'ils nous aura rendu justice, et que nous n'aurons plus rien à craindre de sa part. Il faut donc bien distinguer la juste défense de soi-même, de la vengeance ; la première ne fait que suspendre, par nécessité et pour un temps, l'exercice de la bienveillance, et n'a rien d'opposé à la sociabilité ; mais l'autre étouffant le principe même de la bienveillance, met à sa place un sentiment de haine et d'animosité, vicieux en lui-même, contraire au bien public, et que la loi naturelle condamne formellement.
Ces règles générales sont fertiles en conséquences ; il ne faut faire aucun tort à autrui, ni en parole, ni en action, et l'on doit réparer tout dommage : car la société ne saurait subsister si l'on se permet des injustices.
Il faut être sincère dans ses discours, et tenir ses engagements : car quelle confiance les hommes pourraient-ils prendre les uns aux autres ; et quelle sûreté y aurait-il dans le commerce, s'il était permis de tromper et de violer la foi donnée !
Il faut rendre à chacun non-seulement le bien qui lui appartient, mais encore le degré d'estime et d'honneur qui lui est dû. selon son état et son rang : parce que la subordination est le lien de la société, et que sans cela il n'y aurait aucun ordre dans les familles, ni dans le gouvernement civil.
Mais si le bien public demande que les inférieurs obéissent, le même bien public veut que les supérieurs conservent les droits de ceux qui leur sont soumis, et ne les gouvernent que pour les rendre plus heureux. Tout supérieur ne l'est point pour lui-même, mais uniquement pour les autres ; non pour sa propre satisfaction, et pour sa grandeur particulière, mais pour le bonheur et le repos des autres. Dans l'ordre de la nature, est-il plus homme qu'eux ? a-t-il une âme ou une intelligence supérieure ? et quand il l'aurait, a-t-il plus qu'eux d'envie ou de besoin de vivre satisfait et content ? A regarder les choses par cet endroit, ne serait-il pas bizarre que tous fussent pour un, et que plutôt un ne fût pas pour tous ? d'où pourrait-il tirer ce droit ? de sa qualité d'homme ? elle lui est commune avec les autres : du goût de les dominer ? les autres certainement ne lui cederont pas en ce point : de la possession même où il se trouve de l'autorité ? qu'il voie de qui il la tient, dans quelle vue on la lui laisse, et à quelle condition ; tous devant contribuer au bien de la société, il y doit bien plus essentiellement servir, n'étant supérieur qu'à titre onéreux, et pour travailler au bonheur commun, à proportion de l'élévation que sa qualité lui donne au-dessus des autres. Quelqu'un disait devant le roi de Syrie, Antigone, que les princes étaient les maîtres, et que tout leur était permis : oui, reprit-il, parmi les barbares ; à notre égard, ajouta-t-il, nous sommes maîtres des choses prescrites, par la raison et l'humanité ; mais rien ne nous est permis, que ce qui est conforme à la justice et au devoir.
Tel est le contrat formel ou tacite passé entre tous les hommes, les uns sont au-dessus, les autres au-dessous pour la différence des conditions ; pour rendre leur société aussi heureuse qu'elle le puisse être ; si tous étaient rais, tous voudraient commander, et nul n'obéirait ; si tous étaient sujets, tous devraient obéir, et aucun ne le voudrait faire plus qu'un autre ; ce qui remplirait la société de confusion, de trouble, de dissension ; au lieu de l'ordre et de l'arrangement qui en fait le secours, la tranquillité et la douceur. Le supérieur est donc redevable aux inférieurs, comme ceux-ci lui sont redevables ; l'un doit procurer le bonheur commun par voie d'autorité, et les autres par voie de soumission ; l'autorité n'est légitime, qu'autant qu'elle contribue à la fin pour laquelle a été instituée l'autorité même ; l'usage arbitraire qu'on en ferait, serait la destruction de l'humanité et de la société.
Nous devons travailler tous pour le bonheur de la société à nous rendre maîtres de nous-mêmes ; le bonheur de la société se réduit à ne point nous satisfaire aux dépens de la satisfaction des autres : or les inclinations, les désirs, et les gouts des hommes, se trouvent continuellement opposés les uns aux autres. Si nous comptons de vouloir suivre les nôtres en tout, outre qu'il nous sera impossible d'y réussir, il est encore plus impossible que par-là nous ne mécontentions les autres, et que tôt ou tard le contre - coup ne retombe sur nous ; ne pouvant les faire tous passer à nos gouts particuliers, il faut nécessairement nous monter au goût qui règne le plus universellement, qui est la raison. C'est donc celui qu'il nous faut suivre en tout ; et comme nos inclinations et nos passions s'y trouvent souvent contraires, il faut par nécessité les contrarier. C'est à quoi nous devons travailler sans-cesse, pour nous en faire une salutaire et douce habitude. Elle est la base de toute vertu, et même le premier principe de tout savoir vivre, selon le mot d'un homme d'esprit de notre temps, qui faisait consister la science du monde à savoir se contraindre sans contraindre personne. Bien qu'il se trouve des inclinations naturelles, incomparablement plus conformes que d'autres, à la règle commune de la raison ; cependant il n'est personne qui n'ait à faire effort de ce côté-là, et à gagner sur soi ; ne fût-ce que par une sorte de liaison, qu'ont avec certains défauts les plus heureux tempéraments.
Enfin, les hommes se prennent par le cœur et par les bienfaits, et rien n'est plus convenable à l'humanité, ni plus utîle à la société, que la compassion, la douceur, la bénéficence, la générosité. Ce qui fait dire à Cicéron, " que comme il n'y a rien de plus vrai que ce beau mot de Platon, que nous ne sommes pas nés seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre patrie et pour nos amis ; et que comme disent les Stoïciens, si les productions de la terre sont pour les hommes, les hommes eux-mêmes sont nés les uns pour les autres, c'est-à-dire, pour s'entre-aider et se faire du bien mutuellement ; nous devons tous entrer dans les desseins de la nature, et suivre notre destination en contribuant chacun du sien pour l'utilité commune par un commerce réciproque et perpétuel de services et de bons offices, n'étant pas moins empressés à donner qu'à recevoir, et employant non - seulement nos soins et notre industrie, mais nos biens mêmes à serrer de plus en plus les nœuds de la société humaine ". Puis donc que tous les sentiments de justice et de bonté sont les seuls et vrais liens qui attachent les hommes les uns aux autres, et qui peuvent rendre la société stable, tranquille, et florissante, il faut regarder ces vertus comme autant de devoirs que Dieu nous impose, par la raison que tout ce qui est nécessaire à son but, et par cela même conforme à sa volonté.
Quelque plausibles que puissent être les maximes de la morale, et quelque utilité qu'elles puissent avoir pour la douceur de la société humaine, elles n'auront rien de fixe et qui nous attache inébranlablement sans la religion. Quoique la seule raison nous rende palpables en général les principes des mœurs qui contribuent à la douceur et à la paix que nous devons goûter et faire goûter aux autres dans la société ; il est vrai pourtant qu'elle ne suffit pas en certaines occasions, pour nous convaincre que notre avantage est toujours joint avec celui de la société : il faut quelquefois (& cela est nécessaire pour le bonheur de la société) nous priver d'un bien présent, ou même essuyer un mal certain, pour ménager un bien à venir, et prévenir un mal quoiqu'incertain. Or, comment faire goûter à un esprit qui n'est capable que des choses sensuelles ou actuellement sensibles, le parti de quitter un bien présent et déterminé, pour un bien à venir et indéterminé ; un bien qui dans le moment même le touche vivement du côté de la cupidité, pour un bien qui ne le touche que faiblement du côté de sa raison : sera-t-il arrêté par les reproches de la conscience, quand la religion ne les suscite pas ? par la crainte de la punition, quand la force et l'autorité l'en mettent à couvert ? par le sentiment de la honte et de la confusion, quand il sait dérober son crime à la connaissance d'autrui ? par les règles de l'humanité, quand il est déterminé à traiter les autres sans ménagement, pour se satisfaire lui-même ? par les principes de la prudence, quand la fantaisie ou l'humeur lui tiennent lieu de tous les motifs ? par le jugement des personnes judicieuses et sensées, quand la présomption lui fait préférer son jugement à celui du reste des hommes ? Il est peu d'esprit d'un caractère si outré, mais il peut s'en trouver : il s'en trouve quelquefois, et il doit même s'en trouver un grand nombre, si l'on foule aux pieds les principes de la religion naturelle.
En effet, que les principes et les traités de morale soient mille fois plus sensés encore et plus démonstratifs qu'ils ne sont, qui est-ce qui obligera des esprits libertins de s'y rendre, si le reste du genre humain en adopte les maximes ? en seront-ils moins disposés à les rejeter malgré le genre humain, et à les soumettre au tribunal de leurs bizarreries et de leur orgueil ? Il parait donc que sans la religion il n'est point de frein assez ferme qu'on puisse donner ni aux saillies de l'imagination, ni à la présomption de l'esprit, ni à la source des passions, ni à la corruption du cœur, ni aux artifices de l'hypocrisie. D'un côté vérité, justice, sagesse, prudence d'un Dieu vengeur des crimes, et remunérateur des actions justes, sont des idées qui tiennent si naturellement et si nécessairement les unes aux autres, que les unes ne peuvent subsister, là où les autres sont détruites. Ceci prouve évidemment combien est nécessaire l'union de la religion et de la morale, pour affermir le bonheur de la société.
Mais, 1°. pour mettre cette vérité dans toute son évidence, il faut observer que les vices des particuliers quels qu'ils soient, nuisent au bonheur de la société ; on nous accorde déjà, que certains vices, tels que la calomnie, l'injustice, la violence, nuisent à la société. Je vais plus loin, et je soutiens que les vices mêmes qu'on regarde ordinairement comme ne faisant tort qu'à celui qui en est atteint, sont pernicieux à la société. On entend dire assez communément, par exemple, qu'un homme qui s'enivre ne fait tort qu'à lui-même ; mais pour peu qu'on y fasse d'attention, on s'apercevra que rien n'est moins juste que cette pensée. Il ne faut qu'écouter pour cela les personnes obligées de vivre dans une même famille avec un homme sujet à l'excès du vin. Ce que nous souhaitons le plus dans ceux avec qui nous vivons, c'est de trouver en eux de la raison ; elle ne leur manque jamais à notre égard, que nous n'ayons droit de nous en plaindre. Quelque opposés que puissent être les autres vices à la raison, ils en laissent du moins certaine lueur, certain usage, certaine règle ; l'ivresse ôte toute lueur de la raison ; elle éteint absolument cette particule, cette étincelle de la divinité qui nous distingue des bêtes : elle détruit par - là toute la satisfaction et la douceur, que chacun doit mettre et recevoir dans la société humaine. On a beau comparer la privation de la raison par l'ivresse avec la privation de la raison par le sommeil, la comparaison ne sera jamais sérieuse ; l'une est pressante par le besoin de réparer les esprits qui s'épuisent sans-cesse, et qui servent à l'exercice même de la raison ; au lieu que l'autre supprime tout d'un - coup cet exercice, et à la longue en détruit, pour ainsi dire, les ressorts. Aussi l'auteur de la nature, en nous assujettissant au sommeil, en a - t - il ôté les inconvéniens, et la monstrueuse indécence qui se trouve dans l'ivresse. Bien que celui - ci semble quelquefois avoir un air de gaieté, le plaisir qu'elle peut donner est toujours un plaisir de fou qui n'ôte point l'horreur secrète que nous concevons contre tout ce qui détruit la raison, laquelle seule contribue à rendre constamment heureux ceux avec qui nous vivons.
Le vice de l'incontinence qui parait moins opposé au bonheur de la société, l'est peut-être encore davantage. On conviendra d'abord que quand elle blesse les droits du mariage, elle fait au cœur de l'outragé la plaie la plus profonde : les lois romaines qui servent comme de principes aux autres lois, supposent qu'en ce moment il n'est pas en état de se posséder ; de manière qu'elles semblent excuser en lui le transport par lequel il ôterait la vie à l'auteur de son outrage. Ainsi le meurtre, qui est le plus opposé de l'humanité, semble par-là être mis en parallèle avec l'adultère. Les plus tragiques événements de l'histoire, et les figures les plus pathétiques qu'ait inventé la fable, ne nous montrent rien de plus affreux que les effets de l'incontinence dans le crime de l'adultère ; ce vice n'a guère de moins funestes effets, quand il se rencontre entre des personnes libres ; la jalousie y produit fréquemment les mêmes fureurs. Un homme d'ailleurs livré à cette passion, n'est plus à lui-même ; il tombe dans une sorte d'humeur morne et brute qui le dégoute de ses devoirs ; l'amitié, la charité, la parenté, la république, n'ont point de voix qui se fasse entendre, quand leurs droits se trouvent en compromis avec les attraits de la volupté. Ceux qui en sont atteints, et qui se flattent de n'avoir jamais oublié ce qu'ils doivent à leur état, jugent de leur conduite par ce qu'ils en connaissent ; mais toute passion nous aveugle ; et de toutes les passions, il n'en est point qui aveugle davantage. C'est le caractère le plus marqué que la vérité et la fable attribuent de concert à l'amour ; ce serait une espèce de miracle, qu'un homme sujet aux désordres de l'incontinence, qui donnât à sa famille, à ses amis, à ses citoyens, la satisfaction et la douceur que demanderaient les droits du sang, de la patrie, et de l'amitié ; enfin, la nonchalance, le dégout, la mollesse, sont les moindres et les plus ordinaires inconvénients de ce vice. Le savoir vivre qui est la plus douce et la plus familière des vertus de la vie civile, ne se trouve communément dans la pratique que par l'usage de se contraindre sans contraindre les autres. Combien faut - il davantage se contraindre et gagner sur soi, pour remplir les devoirs les plus importants qu'exigent la droiture, l'équité, la charité, qui sont la base et le fondement de toute société ? Or, de quelle contrainte est capable un homme amolli et efféminé ? Ce n'est pas que malgré ce vice, il ne reste encore de bonnes qualités ; mais il est certain que par-là elles sont extraordinairement affoiblies ; il est donc constant que la société se ressent toujours de la maligne influence des désordres qui paraissent d'abord ne lui donner aucune atteinte. Or, puisque la religion est un frein nécessaire pour les arrêter, il s'ensuit évidemment qu'elle doit s'unir à la morale, pour assurer le bonheur de la société.
2°. Il est certain que les devoirs qui nous règlent par rapport à nous - mêmes, n'aident pas peu à nous régler aussi par rapport aux autres hommes. Il est encore certain que ces deux sortes de devoirs se renforcent beaucoup de notre exactitude à remplir nos devoirs envers Dieu. La crainte de Dieu jointe à un parfait dévouement pour sa volonté, est un motif très-efficace pour engager les hommes à s'acquitter de ce qui les concerne directement eux-mêmes, et à faire pour la société tout ce qu'ordonne la loi naturelle. Otez une fois la religion, vous ébranlez tout l'édifice des vertus morales ; il ne repose sur rien. Concluons que les trois principes de nos devoirs sont trois différents ressorts qui donnent au système de l'humanité le mouvement et l'action, et qu'ils agissent tous à - la - fois pour l'exécution des vues du Créateur.
3°. La société, toute armée qu'elle est des lois, n'a de force que pour empêcher les hommes de violer ouvertement la justice, tandis que les attentats commis en secret, et qui ne sont pas moins préjudiciables au bien public ou commun, échappent à sa rigueur. Depuis même l'invention des sociétés, les voies ouvertes se trouvant prohibées, l'homme est devenu beaucoup plus habîle dans la pratique des voies secrètes, puisque c'est la seule ressource qui lui reste pour satisfaire ses désirs immodérés ; désirs qui ne subsistent pas moins dans l'état de société que dans celui de nature. La société fournit elle - même une espèce d'encouragement à ces manœuvres obscures et criminelles, dont la loi ne saurait prendre connaissance, en ce que ses soins pour la sûreté commune, le but de son établissement, endorment les gens de bien en même temps qu'ils aiguisent l'industrie des scélérats. Ses propres précautions ont tourné contre elle-même, elles ont subtilisé les vices, raffiné l'art du crime : et delà vient que l'on voit assez souvent chez les nations policées des forfaits dont on ne trouve point d'exemple chez les sauvages. Les Grecs avec toute leur politesse, avec toute leur érudition, et avec toute leur jurisprudence, n'acquirent jamais la probité que la nature toute seule faisait reluire parmi les Scythes.
Ce n'est pas tout : les lois civiles ne sauraient empêcher qu'on ne donne quelquefois au droit et à la justice des atteintes ouvertes et publiques ; elles ne le sauraient lorsqu'une prohibition trop sévère donne lieu de craindre quelqu'irrégularité plus grande, ce qui arrive dans les cas où l'irrégularité est l'effet de l'intempérance des passions naturelles. L'on convient généralement qu'il n'y a point d'état grand et florissant où l'on puisse punir l'incontinence de la manière que le mériteraient les funestes influences de ce vice à l'égard de la société. Restreindre ce vice avec trop de sévérité, ce serait donner lieu à des désordres encore plus grands.
Ce ne sont pas là les seuls faibles de la loi : en approfondissant les devoirs réciproques qui naissent de l'égalité des citoyens, on trouve que ces devoirs sont de deux sortes ; les uns que l'on appelle devoirs d'obligation parfaite, parce que la loi civîle peut aisément et doit nécessairement en prescrire l'étroite observation ; les autres que l'on appelle devoirs d'obligation imparfaite, non que les principes de morale n'en exigent en eux-mêmes la pratique avec rigidité, mais parce que la loi ne peut que trop difficilement en prendre connaissance, et que l'on suppose qu'ils n'affectent point si immédiatement le bien être de la société. De cette dernière espèce sont les devoirs de la reconnaissance, de l'hospitalité, de la charité, etc. devoirs sur lesquels les lois en général gardent un profond silence, et dont la violation néanmoins est aussi fatale, quoiqu'à la vérité moins prompte dans ses effets que celle des devoirs d'obligation parfaite. Séneque, dont les sentiments en cette occasion sont ceux de l'antiquité, ne fait point difficulté de dire que rien n'est plus capable de rompre la concorde du genre humain que l'ingratitude.
La société elle-même a produit un nouveau genre de devoirs qui n'existaient point dans l'état de nature ; et quoiqu'entièrement de sa création, elle a manqué de pouvoir pour les faire observer : telle est par exemple, cette vertu surannée et presque hors de mode, que l'on appelle l'amour de la patrie. Enfin la société a non - seulement produit de nouveaux devoirs, sans en pouvoir prescrire une observation étroite et rigide ; mais elle a encore le défaut d'avoir augmenté et enflammé ces désirs désordonnés qu'elle devait servir à éteindre et à corriger ; semblable à ces remèdes qui dans le temps qu'ils travaillent à la guérison d'une maladie, en augmentent le degré de malignité. Dans l'état de nature, on avait peu de choses à souhaiter, peu de désirs à combattre ; mais depuis l'établissement des sociétés, nos besoins ont augmenté à mesure que les rits de la vie se sont multipliés et perfectionnés ; l'accroissement de nos besoins a été suivi de celui de nos désirs, et graduellement de celui de nos efforts, pour surmonter l'obstacle des lois : c'est cet accroissement de nouveaux arts, de nouveaux besoins, de nouveaux désirs, qui a insensiblement amorti l'esprit d'hospitalité et de générosité, et qui lui a substitué celui de cupidité, de venalité et d'avarice.
La nature des devoirs, dont l'observation est nécessaire pour conserver l'harmonie de la société civîle ; les tentations fortes et fréquentes, et les moyens obscurs et secrets qu'on a de les violer ; le faible obstacle que l'infliction des peines ordinaires par les lois oppose à l'infraction de plusieurs de ces devoirs, le manque d'encouragement à les observer, provenant de l'impossibilité où est la société de distribuer de justes récompenses : tous ces défauts, toutes ces imperfections inséparables de la nature de la société même, démontrent la nécessité d'y ajouter la force de quelqu'autre pouvoir coactif, capable d'avoir assez d'influence sur l'esprit des hommes pour maintenir la société, et l'empêcher de retomber dans la confusion et le désordre. Puisque la crainte du mal et l'espérance du bien, qui sont les deux grands ressorts de la nature pour déterminer les hommes, suffisent à peine pour faire observer les lois ; puisque la société civîle ne peut employer l'un qu'imparfaitement, et n'est point en état de faire aucun usage de l'autre ; puisque enfin la religion seule peut réunir ces deux ressorts et leur donner de l'activité, qu'elle seule peut infliger des peines et toujours certaines et toujours justes ; que l'infraction soit ou publique ou secrète, et que les devoirs enfraints soient d'une obligation parfaite ou imparfaite ; puisqu'elle seule peut apprécier le mérite de l'obéissance, pénétrer les motifs de nos actions, et offrir à la vertu des récompenses que la société civîle ne saurait donner, il s'ensuit évidemment que l'autorité de la religion est de nécessité absolue, non seulement pour procurer à la société mille douceurs et mille agréments, mais encore pour assurer l'observation des devoirs, et maintenir le gouvernement civil. Voyez l'article de la PROBITE, et celui des ATHEES.
La religion ayant été démontrée nécessaire au soutien de la société civile, on n'a pas besoin de démontrer qu'on doit se servir de son secours de la manière la plus avantageuse à la société, puisque l'expérience de tous les siècles et de tous les pays nous apprend que leur force réunie suffit à peine pour réfréner les désordres, et empêcher les hommes de tomber dans un état de violence et de confusion. La politique et la religion, l'état et l'Eglise, la société civîle et la société religieuse, lorsqu'on sait les unir et les lier ensemble, s'embellissent et se fortifient réciproquement, mais on ne peut faire cette union qu'on n'ait premièrement approfondi leur nature.
Pour s'assurer de leur nature, le vrai moyen est de découvrir et de fixer quelle est leur fin ou leur but. Les ultramontains ont voulu asservir l'état à l'Eglise ; et les Erastiens, gens factieux qui s'élevèrent en Angleterre du temps de la prétendue réformation, ainsi appelés du nom de Thomas Eraste leur chef, ont voulu asservir l'Eglise à l'état. Pour cet effet, ils anéantissaient toute discipline ecclésiastique, et dépouillaient l'Eglise de tous ses droits, soutenant qu'elle ne pouvait ni excommunier ni absoudre, ni faire des decrets. C'est pour n'avoir point étudié la nature de ces deux différentes sociétés, que les uns et les autres sont tombés à ce sujet dans les erreurs les plus étranges et les plus funestes.
Les hommes en instituant la société civile, ont renoncé à leur liberté naturelle, et se sont soumis à l'empire du souverain civil : or ce ne pouvait pas être dans la vue de se procurer les biens dont ils auraient pu jouir sans cela ; c'était donc dans la vue de quelque bien fixe et précis, qu'ils ne pouvaient se promettre que de l'établissement de la source civîle ; et ce ne peut être que pour se procurer cet objet qu'ils ont armé le souverain de la force de tous les membres qui composent la société, afin d'assurer l'exécution des decrets que l'état rendrait dans cette vue. Or ce bien fixe et précis qu'ils ont eu en vue en s'associant, n'a pu être que celui de se garantir réciproquement des injures qu'ils auraient pu recevoir des autres hommes, et de se mettre en état d'opposer à leur violence une force plus grande, et qui fût capable de punir leur attentat. C'est ce que promet aussi la nature du pouvoir dont la société civîle est revêtue pour faire observer ses lois ; pouvoir qui ne consiste que dans la force et les châtiments, et dont elle ne saurait faire un usage légitime que conformément au but pour lequel elle a été établie. Elle en abuse lorsqu'elle entreprend de l'appliquer à une autre fin ; et cela est si manifeste et si exactement vrai, qu'alors même son pouvoir devient inefficace ; sa force, si puissante pour les intérêts civils ou corporels, ne pouvant rien sur les choses intellectuelles et spirituelles. C'est sur ces principes incontestables que M. Locke a démontré la justice de la tolérance, et l'injustice de la persécution en matière de religion.
Nous disons donc avec ce grand philosophe, que le salut des âmes n'est ni la cause ni le but de l'institution des sociétés civiles. Ce principe établi, il s'ensuit que la doctrine et la morale, qui sont les moyens de gagner le salut, et qui constituent ce que les hommes en général entendent par le mot de religion, ne sont point du district du magistrat. Il est évident que la doctrine n'en est point, parce que le pouvoir du magistrat ne peut rien sur les opinions : par rapport à la morale, la discution de ce point exige une distinction. L'institution et la réformation des mœurs intéressent le corps et l'âme, l'économie civîle et religieuse en tant qu'elles intéressent la religion, le magistrat civil en est exclus ; mais en tant qu'elles intéressent l'état, le magistrat doit y veiller lorsque le cas le requiert, y faire intervenir la force de l'autorité. Que l'on jette les yeux sur tous les codes et les digestes, à chaque action criminelle est désigné son châtiment ; non en tant qu'elle est vice ou qu'elle s'éloigne des règles éternelles du juste ou de l'injuste ; non en tant qu'elle est péché, ou qu'elle s'éloigne des règles prescrites par la révélation extraordinaire de la volonté divine, mais en tant qu'elle est crime, c'est-à-dire à proportion de la malignité de son influence, relativement au bien de la société civile. Si l'on en demande la raison, c'est que la société a pour but, non le bien des particuliers, mais le bien public, qui exige que les lois déploient toute leur sévérité contre les crimes auxquels les hommes sont les plus enclins, et qui attaquent de plus près les fondements de la société.
Différentes raisons et diverses circonstances ont contribué à faire croire que les soins du magistrat s'étendaient naturellement à la religion, en tant qu'elle concerne le salut des ames. Il a lui-même encouragé cette illusion flatteuse, comme propre à augmenter son pouvoir et la vénération des peuples pour sa personne. Le mélange confus des intérêts civils et religieux, lui a fourni les moyens de pouvoir le faire avec assez de facilité.
Dans l'enfance de la société civile, les pères de famille qui remplissaient toujours les fonctions du sacerdoce, étant parvenus ou appelés à l'administration des affaires publiques, portèrent les fonctions de leur premier état dans la magistrature, et exécutèrent en personne ces doubles fonctions. Ce qui n'était qu'accidentel dans son origine, a été regardé dans la suite comme essentiel. La plupart des anciens législateurs ayant trouvé qu'il était nécessaire pour exécuter leurs projets, de prétendre à quelque inspiration et à l'assistance extraordinaire des dieux, il leur était naturel de mêler et de confondre les objets civils et religieux, et les crimes contre l'état, avec les crimes contre les dieux sous l'auspice desquels l'état avait été établi et se conservait. D'ailleurs dans le paganisme outre la religion des particuliers, il y avait un culte et des cérémonies publiques instituées et observées par l'état et pour l'état, comme état. La religion intervenait dans les affaires du gouvernement ; on n'entreprenait, on n'exécutait rien sans l'avis de l'oracle. Dans la suite, lorsque les empereurs romains se convertirent à la religion chrétienne, et qu'ils placèrent la croix sur le diadème, le zèle dont tout nouveau prosélite est ordinairement épris, leur fit introduire dans les institutions civiles des lois contre le péché. Ils firent passer dans l'administration politique les exemples et les préceptes de l'Ecriture, ce qui contribua beaucoup à confondre la distinction qui se trouve entre la société civîle et la société religieuse. On ne doit cependant pas rejeter ce faux jugement sur la religion chrétienne, car la distinction de ces deux sociétés y est si expresse et si formelle, qu'il n'est pas aisé de s'y méprendre. L'origine de cette erreur est plus ancienne, et on doit l'attribuer à la nature de la religion juive, où ces deux sociétés étaient en quelque manière incorporées ensemble.
L'établissement de la police civîle parmi les Juifs étant l'institution immédiate de Dieu même, le plan en fut regardé comme le modèle du gouvernement le plus parfait et le plus digne d'être imité par des magistrats chrétiens. Mais l'on ne fit pas réflexion que cette juridiction à laquelle les crimes et les péchés étaient assujettis, était une conséquence nécessaire d'un gouvernement théocratique, où Dieu présidait d'une manière particulière, et qui était d'une forme et d'une espèce absolument différentes de celles de tous les gouvernements d'institution humaine. C'est à la même cause qu'il faut attribuer les erreurs des Protestants sur la réformation des états, la tête de leurs premiers chefs se trouvant remplie des idées de l'économie judaïque. On ne doit pas être étonné que dans les pays où le gouvernement reçut une nouvelle forme en même temps que les peuples adoptèrent une religion nouvelle, on ait affecté une imitation ridicule du gouvernement des Juifs, et qu'en conséquence le magistrat ait témoigné plus de zèle pour réprimer les péchés, que pour réprimer les crimes. Les ministres prétendus réformés, hommes impérieux, en voulant modéler les états sur leurs vues théologiques, prouvèrent, de l'aveu même des protestants sensés, qu'ils étaient aussi mauvais politiques que mauvais théologiens. A ces causes de la confusion des matières civiles et religieuses, on en peut encore ajouter plusieurs autres. Il n'y a jamais eu de société civîle ancienne ou moderne, où il n'y ait eu une religion favorite établie et protégée par les lois, établissement qui est fondé sur l'alliance libre et volontaire qui se fait entre la puissance ecclésiastique pour l'avantage réciproque de l'un et de l'autre. Or en conséquence de cette alliance, les deux sociétés se prêtent en certaines occasions une grande partie de leur pouvoir, et il arrive même quelquefois qu'elles en abusent réciproquement. Les hommes jugeant par les faits, sans remonter à leur cause et à leur origine, ont cru que la société civîle avait par son essence un pouvoir qu'elle n'a que par emprunt. On doit encore observer que quelquefois la malignité du crime est égale à celle du péché, et que dans ce cas les hommes ont peu considéré si le magistrat punissait l'action comme crime ou comme péché ; tel est, par exemple, le cas du parjure et de la profanation du nom de Dieu, que les lois civiles de tous les états punissent avec sévérité. L'idée complexe de crime et celle de péché étant d'ailleurs d'une nature abstraite, et composée d'idées simples, communes à l'une et à l'autre, elles n'ont pas été également distinguées par tout le monde ; souvent elles ont été confondues, comme n'étant qu'une seule et même idée ; ce qui sans-doute n'a pas peu contribué à fomenter l'erreur de ceux qui confondent les droits respectifs des sociétés civiles et religieuses. Cet examen suffit pour faire voir que c'est le but véritable de la société civile, et quelles sont les causes des erreurs où l'on est tombé à ce sujet.
Le but final de la société religieuse est de procurer à chacun la faveur de Dieu, faveur qu'on ne peut acquérir que par la droiture de l'esprit et du cœur, en sorte que le but intermédiaire de la religion a pour objet la perfection de nos facultés spirituelles. La société religieuse a aussi un but distinct et indépendant de celui de la société civile, il s'ensuit nécessairement qu'elle en est indépendante, et que par conséquent elle est souveraine en son espèce. Car la dépendance d'une société à l'égard de l'autre, ne peut procéder que de deux principes, et d'une cause naturelle, ou d'une cause civile. Une dépendance fondée sur la loi de nature doit provenir de l'essence ou de la génération de la chose. Il ne saurait y en avoir dans le cas dont il s'agit par essence ; car cette espèce de dépendance supposerait nécessairement entre ces deux sociétés une union ou un mélange naturel qui n'a lieu qu'autant que deux sociétés sont liées par leur relation avec un objet commun. Or leur objet loin d'être commun est absolument différent l'un de l'autre, la dernière fin de l'une étant le soin de l'âme, et celle de l'autre le soin du corps et de ses intérêts ; l'une ne pouvant agir que par des voies intérieures, et l'autre au contraire que par des voies extérieures. Pour qu'il y eut une dépendance entre ces sociétés, en vertu de leur génération, il faudrait que l'une dû. son existence à l'autre, comme les corporations, les communautés et les tribunaux la doivent aux villes ou aux états qui les ont créés. Ces différentes sociétés, autant par la conformité de leurs fins et de leurs moyens, que par leurs chartres, ou leurs lettres de création ou d'érection trahissent elles-mêmes, et manifestent leur origine et leur dépendance. Mais la société religieuse n'ayant point un but ni des moyens conformes à ceux de l'état, donne par-là des preuves intérieures de son indépendance ; et elle les confirme par des preuves extérieures, en faisant voir qu'elle n'est pas de la création de l'état, puisqu'elle existait déjà avant la fondation des sociétés civiles. Par rapport à une dépendance fondée sur une cause civile, elle ne peut avoir lieu. Comme les sociétés religieuses et civiles diffèrent entièrement et dans leurs buts, et dans leurs moyens, l'administration de l'une agit dans une sphère si éloignée de l'autre, qu'elles ne peuvent jamais se trouver opposées l'une à l'autre ; en sorte que la nécessité d'état qui exigeait que les lois de la nation missent l'une dans la dépendance de l'autre, ne saurait avoir lieu, si l'office du magistrat civil s'étendait au soin des âmes, l'église ne serait alors entre ses mains qu'un instrument pour parvenir à cette fin. Hobbes et ses sectateurs ont fortement soutenu cette thèse. Si d'un autre côté l'office des sociétés religieuses s'étendait aux soins du corps et de ses intérêts, l'état courait grand risque de tomber dans la servitude de l'église. Car les sociétés religieuses ayant certainement le district le plus noble, qui est le soin des âmes, ayant ou prétendant avoir une origine divine, tandis que la forme des états n'est que d'institution humaine ; si elles ajoutaient à leurs droits légitimes le soin du corps et de ses intérêts, elles réclameraient alors, comme de droit, une supériorité sur l'état dans le cas de compétence ; et l'on doit supposer qu'elles ne manqueraient pas de pouvoir pour maintenir leur droit : car c'est une conséquence nécessaire, que toute société dont le soin s'étend aux intérêts corporels, doit être revêtue d'un pouvoir coactif. Ces maximes n'ont eu que trop de vogue pendant un temps. Les ultramontains habiles dans le choix des circonstances, ont tâché de se prévaloir des troubles intérieurs des états, pour les établir et élever la chaire apostolique au-dessus du trône des potentats de la terre, ils en ont exigé, et quelquefois reçu hommage, et ils ont tâché de le rendre universel. Mais ils ont trouvé une barrière insurmontable dans la noble et digne résistance de l'Eglise gallicane, également fidèle à son Dieu et à son roi.
Nous posons donc comme maxime fondamentale, et comme une conséquence évidente de ce principe, que la société religieuse n'a aucun pouvoir coactif semblable à celui qui est entre les mains de la société civile. Des objets qui diffèrent entièrement de leur nature, ne peuvent s'acquérir par un seul et même moyen. Les mêmes relations produisant les mêmes effets, des effets différents ne peuvent provenir des mêmes relations. Ainsi la force et la contrainte n'agissant que sur l'extérieur, ne peuvent aussi produire que des biens extérieurs, objets des institutions civiles ; et ne sauraient produire des biens intérieurs, objets des institutions religieuses. Tout le pouvoir coactif, qui est naturel à une société religieuse, se termine au droit d'excommunication, et ce droit est utîle et nécessaire, pour qu'il y ait un culte uniforme ; ce qui ne peut se faire qu'en chassant du corps tous ceux qui refusent de se conformer au culte public : il est donc convenable et utîle que la société religieuse jouisse de ce droit d'expulsion. Toutes sortes de société quels qu'en soient les moyens et la fin, doivent nécessairement comme société avoir ce droit, droit inséparable de leur essence ; sans cela elles se dissoudraient d'elles - mêmes, et retomberaient dans le néant, précisément de même que le corps naturel, si la nature, dont les sociétés imitent la conduite en ce point, n'avait pas la force d'évacuer les humeurs vicieuses et malignes ; mais ce pouvoir utîle et nécessaire est tout celui et le seul dont la société religieuse ait besoin ; car par l'exercice de ce pouvoir, la conformité du culte est conservée, son essence et sa fin sont assurées, et le bien-être de la société n'exige rien au-delà. Un pouvoir plus grand dans une société religieuse serait déplacé et injuste.
SOCIETE, (Jurisprudence) signifie en général une union de plusieurs personnes pour quelque objet qui les rassemble. La plus ancienne de toutes les sociétés est celle du mariage, qui est d'institution divine.
Chaque famille forme une société naturelle dont le père est le chef.
Plusieurs familles réunies dans une même ville, bourg ou village, forment une société plus ou moins considérable, selon le nombre de ceux qui la composent, lesquels sont liés entr'eux par leurs besoins mutuels et par les rapports qu'ils ont les uns aux autres ; cette union est ce qu'on appelle société civîle ou politique ; et dans ce sens tous les hommes d'un même pays, d'une même nation et même du monde entier, composent une société universelle.
Outre ces sociétés générales, il se forme encore dans un même état, dans une même ville, ou autre lieu, diverses sociétés particulières ; les unes relatives à la religion, qu'on appelle communautés et congrégations, ordres religieux ; les autres relatives aux affaires temporelles, telles que les communautés d'habitants, les corps de ville ; d'autres relatives à l'administration de la justice, telles que les compagnies établies pour rendre la justice ; d'autres relatives aux arts et aux sciences, telles que les universités, les collèges, les académies, et autres sociétés littéraires ; d'autres encore relativement à des titres d'honneur, telles que les ordres royaux et militaires ; enfin d'autres qui ont rapport aux finances, ou au commerce, ou à d'autres entreprises.
Les sociétés qui se contractent entre marchands, ou entre particuliers, sont une convention entre deux ou plusieurs personnes, par laquelle ils mettent en commun entr'eux tous leurs biens ou une partie, ou quelque commerce, ouvrage, ou autre affaire, pour en partager les profits, et en supporter la perte en commun, chacun selon leur fonds, ou ce qui est réglé par le traité de société.
Quand la part de chacun dans les profits et pertes n'est pas réglée par la convention, elle doit être égale.
Les portions peuvent être réglées d'une manière inégale, soit eu égard à l'inégalité des fonds, ou à ce que l'un met plus de travail et d'industrie que l'autre.
On peut aussi convenir qu'un associé aura plus grande part dans les profits qu'il n'en supportera dans la perte, et même qu'un associé ne supportera rien de la perte, pourvu néanmoins que la perte soit prélevée avant qu'on règle sa part des profits, autrement la société serait léonine.
Aucune société ne peut être contractée que pour un objet honnête et licite, et elle ne doit rien contenir de contraire à l'équité et à la bonne foi, qui doit être l'âme de toutes les sociétés ; du reste, elles sont susceptibles de toutes les clauses et conditions licites.
Pour former une société, il faut le consentement de tous les associés.
On peut avoir quelque chose en commun, comme des cohéritiers, des collégataires, sans être pour cela associés.
L'héritier d'un associé n'est même pas associé, parce qu'il n'a pas été choisi pour tel ; on peut cependant stipuler, que le droit de l'associé décédé passera à son héritier.
Si l'un des associés s'associe une autre personne, ce tiers ne devient point associé des autres, il n'est considéré que comme l'associé particulier de celui qui l'a adjoint avec lui, et c'est ce que l'on appelle vulgairement croupier.
Une société se peut contracter par écrit ou même sans écrit, par un consentement tacite.
Entre marchands les sociétés doivent être rédigées par écrit, et il doit en être déposé un extrait au greffe de la juridiction consulaire.
Les sociétés peuvent être générales de tous biens, ou relatives seulement à un certain objet, auquel cas elles se bornent à cet objet, et aux profits qui en proviennent, et n'embrassent point ce qui vient d'ailleurs.
On ne doit prendre sur les biens de la société que les dépenses licites, et dettes contractées pour le compte de la société ; chaque associé doit payer seul ses dettes particulières, soit sur sa part, ou autrement.
Si la société était de tous biens, chaque associé ne peut disposer que de sa portion, et ne doit prendre sur le fonds commun que son entretien et celui de sa famille.
On peut cependant convenir dans une société générale que les dots des filles se prendront sur le fonds commun à mesure que les filles seront en âge d'être pourvues.
Les associés doivent demeurer unis et se garder fidélité. Chacun d'eux est obligé d'apporter tous ses soins pour l'intérêt commun, et est responsable aux autres de ce qui arrive par son dol, ou par sa faute grossière.
Mais ils ne sont jamais tenus des cas fortuits, à-moins que leur faute n'y ait donné lieu.
Un associé ne peut rien faire contre le gré des autres, ni les engager sans leur fait, à-moins qu'il n'ait été chargé d'eux.
Il n'est pas permis à un associé de retirer son fonds avant la fin de la société.
Mais la société peut se dissoudre avant la fin, du consentement de tous les associés.
Chaque associé peut même renoncer à la société, pourvu que ce soit sans fraude, et que sa renonciation ne soit pas faite à contre-temps.
La société finit aussi lorsque l'objet pour lequel elle avait été contractée est rempli, ou qu'il ne peut plus avoir lieu.
La mort naturelle ou civîle d'un associé fait pareillement finir la société à son égard.
La société étant finie, l'on prélève les dettes, chacun se rembourse de ses avances, et l'on partage ensuite les profits s'il y en a.
L'héritier de l'associé a part aux profits qui étaient déjà acquis, et porte aussi sa part des dettes qui étaient contractées ; il prend les choses en l'état qu'elles étaient au moment du décès. Voyez au digeste et au code le titre pro socio, l'ordonnance du commerce, tit. 4. Savary, et les mots ASSOCIES, COMMANDITE, COMMERCE, MARCHANDS. (A)
SOCIETE ANONYME, est celle qui se contracte sans paraitre sous aucun nom. Ceux qui font ces sociétés travaillent chacun de leur côté sous leurs noms particuliers, pour se rendre ensuite raison l'un à l'autre des profits et pertes qu'ils ont fait dans leurs négociations. Voyez Savary.
SOCIETE CIVILE, s'entend du corps politique que les hommes d'une même nation, d'un même état, d'une même ville ou autre lieu, forment ensemble, et des liens politiques qui les attachent les uns aux autres ; c'est le commerce civil du monde, les liaisons que les hommes ont ensemble, comme sujets d'un même prince, comme concitoyens d'une même ville, et comme sujets aux mêmes lais, et participant aux droits et privilèges qui sont communs à tous ceux qui composent cette même société. Voyez CITE, CITOYEN, ÉTAT, NATION, PEUPLE.
SOCIETE EN NOM COLLECTIF, est celle où le commerce et toutes les affaires communes se font, sous le nom de chacun des associés, qui sont tous dénommés dans les actes comme négociants en compagnie, ou seulement sous le nom d'un ou deux d'entr'eux, avec cette addition et compagnie, qui annonce que ceux qui sont dénommés négocient en compagnie, et qu'ils ont encore quelques autres associés qui ne sont pas dénommés.
SOCIETE EN COMMANDE est confondue par quelques-uns avec la société en commandite. Il semble néanmoins qu'il y ait quelque différence, et que le terme de société en commande convienne plus particulièrement à cette espèce de société qui se contracte entre celui qui donne des bestiaux à cheptel, et le preneur de ces bestiaux, sous la condition d'avoir certaine part aux profits provenans des bestiaux. Voyez BESTIAUX, CHEPTEL, COMMANDE et SOCIETE EN COMMANDITE.
SOCIETE EN COMMANDITE, est celle qui se fait entre deux personnes, dont l'une ne fait que mettre son argent dans la société, sans faire aucune fonction d'associé ; et l'autre donne quelquefois son argent, mais toujours son industrie pour faire sous son nom le commerce des marchandises dont ils sont convenus ensemble. Voyez Savary.
SOCIETE LEONINE est celle où l'un des associés tire pour lui seul tout le profit, ou du moins la plus grande partie, tandis que les autres ne sont participans que des pertes. Le surnom de léonines donné à ces sortes de sociétés, parait avoir été tiré de la fable du lion, où cet animal sous divers prétextes, retient partout la part de ses associés, et garde tout pour lui.
SOCIETE PAR PARTICIPATION, est la même chose que la société anonyme. Elle est ainsi appelée, parce que celui qui promet de payer une partie du prix de la chose que l'on achète en commun, ne le fait qu'à la charge de participer au profit. Voyez SOCIETE ANONYME.
SOCIETE TACITE, est celle qui se contracte sans écrit, et même sans convention expresse, entre deux ou plusieurs personnes, par la demeure commune, mélange de biens, vie, bourse et dépense commune, et autrement que par le mariage. Voyez le traité de le Brun, inséré à la fin de son tr. de la communauté. (A)
SOCIETE D'EDIMBOURG, est le nom d'une académie de médecine, établie dans cette capitale de l'Ecosse. Elle a publié des mémoires estimés, dont plusieurs volumes sont traduits en français.
SOCIETE ROYALE DE LONDRES, (Histoire des acad. moderne) académie de savants, établie à Londres pour la culture des arts et des sciences. Voici ce qu'en dit M. de Voltaire.
Quelques philosophes anglais, sous la sombre administration de Cromwel, s'assemblèrent pour chercher en paix des vérités, tandis que le fanatisme opprimait toute vérité. Charles II. rappelé sur le trône de ses ancêtres par l'inconstance de sa nation, donna des lettres patentes en 1660, à cette académie naissante ; mais c'est tout ce que le gouvernement donna. La société royale, ou plutôt la société libre de Londres, travailla pour l'honneur de travailler.
Ses travaux commencèrent à adoucir les mœurs, en éclairant les esprits. Les Belles-lettres renaquirent, et se perfectionnèrent de jour en jour. On n'avait guère connu du temps de Cromwel, d'autre littérature que celle d'adapter des passages de l'ancien et du nouveau Testament aux dissensions publiques. On s'appliqua sous Charles II. à connaître la nature, et à suivre la route que le chancelier Bacon avait montrée. La science des mathématiques fut portée bientôt à un point que les Archimèdes n'avaient pu même deviner. Un grand homme, un homme étonnant, découvrit les lois primitives de la constitution générale de l'univers ; et tandis que toutes les autres nations se repaissaient de fables, les Anglais trouvèrent les plus sublimes vérités. Les progrès furent rapides et immenses en 30 années : c'est-là un mérite, une gloire qui ne passeront jamais. Le fruit du génie et de l'étude reste ; et les effets de l'ambition et des passions s'anéantissent avec les temps qui les ont produits.
Enfin l'esprit de la nation anglaise acquit, sous le règne de Charles II. une réputation immortelle, quoique le gouvernement n'en eut point. C'est du sein de cette nation savante que sont sorties les découvertes sur la lumière, sur le principe de la gravitation, sur l'abberration des étoiles fixes, sur la géométrie transcendante, et cent autres inventions qui pourraient à cet égard, faire appeler le XVIIe siècle, le siècle des Anglais, aussi-bien que celui de Louis XIV.
M. Colbert, jaloux de cette nouvelle gloire des Anglais, voulut que les François la partageassent ; et à la prière de quelques savants, il fit agréer au roi l'établissement d'une académie des Sciences. Elle fut libre jusques en 1699, comme celle d'Angleterre ; mais elle n'a pas conservé ce précieux avantage.
Au reste, le docteur Sprat, évêque de Rochester, a donné l'histoire détaillée de la société royale de Londres ; et comme cette histoire est traduite en français, tout le monde peut la consulter. (D.J.)
SOCIETE ROYALE DES SCIENCES, c'est sous ce nom que Louis XIV. fonda en 1706, une académie à Montpellier. Les motifs qui l'engagèrent à cet établissement, furent la célébrité de cette ville, sa situation, la température et la sérénité de l'air, qui mettent en état de faire plus facilement qu'en aucun autre endroit, des observations et des recherches utiles et curieuses ; le nombre des savants qui y accouraient de toutes parts, ou qui s'y formaient dans les différentes sciences, et surtout dans une des parties la plus importante de la Physique. Le roi pour exciter davantage l'émulation des membres qu'il y nomma, voulut que la société royale des Sciences demeurât toujours sous sa protection, de la même manière que l'académie royale des Sciences ; qu'elle entretint avec cette académie l'union la plus intime, comme ne faisant ensemble qu'un seul et même corps ; que ces deux académies s'envoyeraient réciproquement un exemplaire de tout ce qu'elles feraient imprimer en leur nom ; qu'elles se chargeraient aussi mutuellement d'examiner les matières importantes ; que leurs membres eussent séance dans les assemblées de l'une et de l'autre ; que la société royale des Sciences enverra toutes les années une des pièces qui y seront lues dans ses assemblées, pour être imprimées dans le recueil des mémoires de l'académie royale des Sciences, etc. Voyez les lettres-patentes et statuts donnés au mois de Février 1706.
Cette société n'a rien oublié pour répondre dans tous les temps aux vues et aux bontés de S. M. toutes les sciences y ont été cultivées avec beaucoup de zèle et de succès ; et quoique la Médecine soit la science favorite de cette ville qui a été son berceau et son premier asîle en France, et quoiqu'on s'y applique avec un soin particulier aux objets qui y sont relatifs, il ne laisse pas d'y avoir des personnes très-distinguées dans les autres parties de la Physique et les Mathématiques. On pourrait en voir la preuve dans plusieurs articles de ce Dictionnaire.