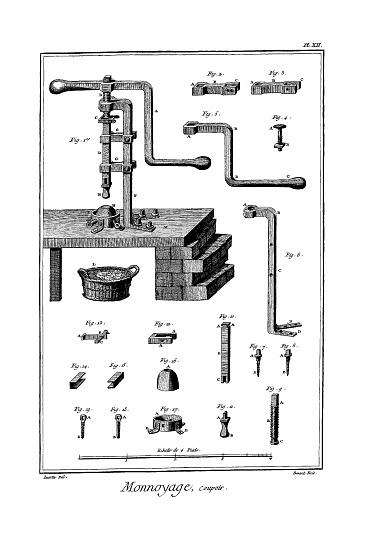(Jurisprudence) On comprend ici sous le terme d'eaux les fleuves, les rivières navigables, et autres ; les ruisseaux, étangs, viviers, pêcheries. Il n'est pas question ici de la mer ; elle fait un objet à part pour lequel il y a des règlements et des officiers particuliers.
Le terme de forêts signifiait anciennement les eaux aussi-bien que les bois, présentement il ne signifie plus que les forêts proprement dites, les bois, garennes, buissons.
Sous les termes conjoints d'eaux et forêts, la Jurisprudence considère les eaux, et tout ce qui y a rapport, comme les moulins, la pêche, le curage des rivières ; elle considère de même les forêts, et tous les bois en général, avec tout ce qui peut y avoir rapport.
Les eaux et forêts du prince, ceux des communautés et des particuliers, sont également l'objet des lais, tant pour déterminer le droit que chacun peut avoir à ces sortes de biens, que pour leur conservation et exploitation.
On entend aussi quelquefois par le terme d'eaux et forêts les tribunaux et les officiers établis pour connaître spécialement de toutes les matières qui ont rapport aux eaux et forêts.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les eaux et forêts ont mérité l'attention des lois ; il parait que dans tous les temps et chez toutes les nations, ces sortes de biens ont été regardés comme les plus précieux.
Les Romains qui avaient emprunté des Grecs une partie de leurs lais, avaient établi plusieurs règles par rapport aux droits de propriété ou d'usage que chacun pouvait prétendre sur l'eau des fleuves et des rivières, sur leurs rivages, sur la pêche, et autres objets qui avaient rapport aux eaux.
La conservation et la police des forêts et des bois parait surtout avoir toujours mérité une attention particulière, tant à cause des grands avantages que l'on en retire par les différents usages auxquels les bois sont propres, et surtout pour la chasse, qu'à cause du long espace de temps qu'il faut pour produire les bois.
Aussi voit-on que dans les temps les plus reculés il y avait déjà des personnes préposées pour veiller à la conservation des bois.
Salomon demanda à Hiram roi de Tyr, la permission de faire couper des cedres et des sapins du Liban pour bâtir le temple.
On lit aussi dans Esdras, lib. II. cap. IIe que quand Nehemias eut obtenu du roi Artaxercès surnommé Longuemain, la permission d'aller rétablir Jerusalem, il lui demanda des lettres pour Asaph garde de ses forêts, afin qu'il lui fit délivrer tout le bois nécessaire pour le rétablissement de cette ville.
Aristote en toute république bien ordonnée désire des gardiens des forêts, qu'il appelle , sylvarum custodes.
Ancus Martius quatrième roi des Romains, réunit les forêts au domaine public, ainsi que le remarque Suétone.
Entre les lois que les décemvirs apportèrent de Grèce, il y en avait qui traitaient de glande, arboribus, et pecorum pastu.
Ils établirent même des magistrats pour la garde et conservation des forêts, et cette commission était le plus souvent donnée aux consuls nouvellement créés, comme il se pratiqua à l'égard de Bibulus et de Jule-César, lesquels étant consuls, eurent le gouvernement général des forêts, ce que l'on désignait par les termes de provinciam ad sylvam et colles ; c'est ce qui a fait dire à Virgile : Si canimus sylvas, sylvae sunt consule dignae. Voyez Suétone en la vie de Jule-César.
Les Romains établirent dans la suite des gouverneurs particuliers dans chaque province pour la conservation des bois, et firent plusieurs lois à ce sujet. Ils avaient des forestiers ou receveurs établis pour le revenu et profit que la république percevait sur les bois et forêts, et des préposés à la conservation des bois et forêts nécessaires au public à divers usages, comme Alexandre Sevère, qui les réservait pour les thermes.
Lorsque les Francs firent la conquête des Gaules, ce pays était pour la plus grande partie couvert de vastes forêts, ce que nos rois regardèrent avec raison comme un bien inestimable.
La conservation des bois paraissait dès-lors un objet si important, que les gouverneurs ou gardiens de Flandres, avant Baudouin surnommé Bras-de-fer, étaient nommés forestiers, à cause que ce pays était alors couvert pour la plus grande partie de la forêt Chambronière : le titre de forestiers convenait d'ailleurs aussi-bien aux eaux qu'aux forêts.
Les rois de la seconde race défendirent l'entrée de leurs forêts, afin que l'on n'y commit aucune entreprise. Charlemagne enjoignit aux forestiers de les bien garder ; mais il faut observer que ce qui est dit des forêts dans les capitulaires, doit quelquefois s'entendre des étangs ou garennes d'eau, qui étaient encore alors comprises sous le terme de forêts.
Aymoin fait mention que Thibaut Filetoupe était forestier du roi Robert, c'est-à-dire inspecteur général de ses forêts. Il y avait aussi dès-lors de simples gardes des forêts, appelés saltuarios et sylvarios custodes.
La plus ancienne ordonnance que l'on ait trouvée des rois de la troisième race, qui ait quelque rapport aux eaux et forêts, est une ordonnance de Louis VI. de l'an 1115, concernant les mesureurs et arpenteurs des terres et bois.
Mais dans le siècle suivant il y eut deux ordonnances faites spécialement sur le fait des eaux et forêts ; l'une par Philippe-Auguste, à Gisors en Novembre 1219 ; l'autre par Louis VIII. à Montargis en 1223.
Les principaux règlements faits par leurs successeurs, par rapport aux eaux et forêts, sont l'ordonnance de Philippe-le-Hardi, en 1280 ; celle de Philippe-le-Bel, en 1291 et en 1309 ; celle de Philippe V. en 1318, de Charles-le-Bel, en 1326 ; du roi Jean, en 1355 ; de Charles V. en 1376 ; de Charles VI. en 1384, 1387, 1402, 1407 et 1415 ; de François I. en 1515, 1516, 1518, 1520, 1523, 1534, 1535, 1539, 1540, 1543, 1544 et 1545 ; d'Henri II. en 1548, 1552, 1554, 1555, 1558 ; de Charles IX. en 1561, 1563, 1566 et 1573 ; d'Henri III. en 1575, 1578, 1579, 1583 et 1586 ; d'Henri IV. en 1597 ; de Louis XIII. en 1637, et de Louis XIV. au mois d'Aout 1669.
Cette dernière ordonnance est celle qu'on appelle communément l'ordonnance des eaux et forêts, parce qu'elle embrasse toute la matière, et résume ce qui était dispersé dans les précédentes ordonnances. Elle est divisée en trente-deux titres différents, qui contiennent chacun plusieurs articles. Elle traite d'abord dans les quatorze premiers titres, de la compétence des officiers des eaux et forêts ; savoir de la juridiction des eaux et forêts en général, des officiers des maitrises, des grands-maîtres, des maîtres particuliers, du lieutenant, du procureur du roi, du garde-marteau, des greffiers, gruyers, huissiers-audienciers, gardes généraux, sergens et gardes des forêts et bois tenus en grueries, grairies, etc. des arpenteurs, des assises, de la table de marbre, des juges en dernier ressort, et des appelations.
Les titres suivants traitent de l'assiette, balivage et martelage, et vente des bois ; des recollements, des ventes, des chablis et des menus marchés ; des ventes et adjudications ; des panages, glandées et paissons ; des droits de pâturage et panage ; des chauffages et autres usages des bois, tant à bâtir qu'à réparer ; des bois à bâtir pour les maisons royales et bâtiments de mer ; des eaux et forêts, bois et garennes tenus à titre de douaire, etc. des bois en gruerie, grairie, tiers et danger ; des bois appartenans aux ecclésiastiques et gens de main-morte ; des bois, prés, marais, landes, pâtis, pêcheries, et autres biens appartenans aux communautés et habitants des paroisses ; des bois appartenans à des particuliers ; de la police et conservation des forêts, eaux et rivières ; des routes et chemins royaux ès forêts et marche-piés des rivières ; des droits de péages, travers et autres ; des chasses, de la pêche, enfin des peines, amendes, restitutions, dommages-intérêts et confiscations.
Nous avons cru ne pouvoir mieux faire que de rapporter ainsi les titres de cette ordonnance, pour faire connaître exactement quelles sont les matières qu'elle embrasse, et que l'on comprend sous les termes d'eaux et forêts.
Depuis l'ordonnance de 1669, il est encore intervenu divers édits, déclarations et arrêts de règlements, pour décider plusieurs cas qui n'étaient pas prévus par l'ordonnance.
Les tribunaux établis pour connaître des matières d'eaux et forêts, et de tout ce qui y a rapport, sont, 1°. les juges en dernier ressort, composés de commissaires du parlement, et d'une partie des officiers de la table de marbre, pour juger les appelations des maitrises, grueries royales, grueries particulières non royales, et de toutes les autres justices seigneuriales, sur le fait des réformations, usages, abus, délits et malversations commis dans les eaux et forêts, et sur les faits de chasse au grand-criminel ; 2°. les tables de marbre du palais de Paris, de Rouen, Dijon, Bordeaux, Metz et autres, pour juger les appelations ordinaires des maitrises ; 3°. les maitrises particulières ; 4°. les grueries royales, 5°. les grueries en titre, non royales, et les autres justices seigneuriales, lesquelles, sans avoir le titre de gruerie, en ont tous les attributs.
La compétence de chacun de ces tribunaux sera expliquée en son lieu, aux mots GRUERIE, JUGES EN DERNIER RESSORT, MAITRISE, TABLES DE MARBRE, et JUSTICE SEIGNEURIALE.
Les officiers des eaux et forêts étaient anciennement nommés forestiers, maîtres des garennes, et depuis, maîtres des eaux et forêts.
Ceux qui ont présentement l'inspection et juridiction sur les eaux et forêts, sont les grands-maîtres, les maîtres particuliers, les gruyers, verdiers.
Il y a aussi dans les tables de marbre, maitrises et grueries, d'autres officiers, tels que des lieutenans, un procureur du roi, un garde-marteau, un greffier, des huissiers-audienciers, des sergens-garde-bois, des sergens-gardes-pêche, des arpenteurs, des receveurs et collecteurs des amendes, etc. Nous expliquerons ce qui concerne ces différents officiers, soit en parlant des tribunaux où ils exercent leurs fonctions, soit dans les articles particuliers de ces officiers, pour ceux qui ont une dénomination propre aux eaux et forêts, tels que les gardes-marteau, gardes-chasse, sergens-à-garde, sergens-forestiers, sergens-gardes-pêche.
Plusieurs matières des eaux et forêts se trouvent déjà expliquées ci-devant aux mots AIRE, ALLUVION, ATTERISSEMENT, BAC, BALIVEAUX, BATARDEAUX, BOIS, BRUYERES, BUCHERONS, BUCHES, CANAUX, CAPITAINERIES, CEPEES, CHABLIS, CHARMES, CHASSE, CHEMINS, CHENE, CHOMMAGE, COLLECTEUR DES AMENDES, CORMIERS, COUPES, CURAGE, DANGER, DEFFENDS, DEFRICHEMENT, DELITS, DOUBLEMENT.
Nous expliquerons le surplus ci-après, aux mots ECUISSER, ECLUSES, ENCROUER, ESHOUPER, ESSARTER, ETALON, ETANT, ETANG, FAUCHAISON, FLOTTAGE, FORETS, FOSSE, FOUEE, FRAY, FURTER, FUTAYE, GARENNES, GISANT, GLANDEE, GORDS, HALOTS, HAUTE-FUTAYE, LANDES, LAPINS, LAYES, MARTEAU, MARTELAGE, MERREIN, MOULINS, NAVIGATION, PAISSONS, PALUDS, PANAGE, PARCS, PAROI, PATURAGE, PATIS, PEAGES, PERTUIS, PECHE, PIES-CORMIERS, POCHES, POISSON, RABOUGRIS, RABOULIERES, RECEPAGE, RECOLLEMENS, RESERVES, RIVERAINS, RIVIERE, ROUTES, RUISSEAU, SEGRAIRIES, SOUCHETAGE, TAILLIS, TERRIERS, TIERS et DANGER, TIERS-LOT, TRIAGE, VENTE, VISITE, USAGE, USAGERS, et plusieurs autres termes qui ont rapport à cette matière. (A)
EAU, (Jurisprudence) suivant le droit romain, l'eau de la mer, celle des fleuves et des rivières en général, et toute eau coulante, étaient des choses publiques dont il était libre à chacun de faire usage.
Il n'en est pas tout à fait de même parmi nous : il n'est pas permis aux particuliers de prendre de l'eau de la mer, de crainte qu'ils n'en fabriquent du sel, qui est un droit que nos rois se sont réservé.
A l'égard de l'eau des fleuves et des rivières navigables, la propriété en appartient au roi, mais l'usage en est public.
Les petites rivières et les eaux pluviales qui coulent le long des chemins, sont aux seigneurs hauts-justiciers : les ruisseaux appartiennent aux riverains.
Il est libre à chacun de puiser de l'eau dans les fleuves, rivières et ruisseaux publics ; mais il n'est point permis d'en détourner le cours au préjudice du public ni d'un tiers, soit pour arroser ses prés, pour faire tourner un moulin, ou pour quelqu'autre usage, sans le consentement de ceux auxquels l'eau appartient.
Le droit actif de prise d'eau peut néanmoins s'acquérir par prescription, soit avec titre ou sans titre, comme les autres droits réels ; par une possession du nombre d'années requis par la loi du lieu.
Mais la faculté de prendre de l'eau ne se prescrit point par le non-usage, surtout tandis que l'écluse où l'on puisait l'eau est détruite.
Celui qui a la source de l'eau dans son fonds, peut en disposer comme bon lui semble pour son usage ; au-lieu que celui dans le fonds duquel elle ne fait simplement que passer, peut bien arrêter l'eau pour son usage, mais il ne peut pas la détourner de son cours ordinaire. Voyez au code de aquaeduct. Franç. Marc, tome I. quest. dlxxxjx. et dxcvij. Henrys, tome II. liv. IV. quest. xxxv. et xxxvij. Basset, tome II. liv. III. tit. VIIe ch. 1 et 7. (A)
EAU BOUILLANTE, (Jurisprudence) servait autrefois d'épreuve et de supplice. Voyez ci-après EPREUVE DE L'EAU BOUILLANTE, et aux mots BOUILLIR, PEINE, SUPPLICE.
EAU CHAUDE, voyez ci-dev. EAU BOUILLANTE.
EAU FROIDE, voyez ci-après EPREUVE DE L'EAU FROIDE. (A)
EAU, (Marine) Faire de l'eau, en terme de marine, ou faire aiguade, c'est remplir des futailles destinées à contenir l'eau nécessaire pour les besoins de l'équipage pendant le cours du voyage. Il faut, autant qu'il est possible, ne choisir que des eaux de bonne qualité et saines, tant pour éviter les maladies que les mauvaises eaux peuvent causer, que parce qu'elles se conservent mieux, et sont moins sujettes à se corrompre.
Eau douce, on donne ce nom aux eaux de fontaine, de rivière, etc.
Eau salée, c'est l'eau de la mer.
Eau saumache, c'est de l'eau qui, sans avoir tout le sel et l'âcreté de l'eau de mer, en tient cependant un peu ; ce qui se trouve quelquefois, lorsqu'on est obligé de prendre de l'eau dans des puits que l'on creuse sur le bord de la mer : on ne s'en sert que dans un grand besoin.
Eau basse, eau haute ou haute eau, morte eau, se disent des eaux de la mer lorsqu'elle monte ou descend. Voyez MAREE.
Faire eau, terme tout différent de faire de l'eau : il se dit d'un vaisseau où l'eau entre par quelqu'ouverture, de quelque cause qu'elle provienne, soit dans un combat par un coup de canon reçu à l'eau, c'est-à-dire dans les parties qui sont sous l'eau ; soit par quelques coutures qui s'ouvrent, ou toute autre voie par où l'eau pénètre dans la capacité du vaisseau.
Eau du vaisseau, c'est la trace que le navire laisse sur l'eau dans l'endroit où il vient de passer ; c'est ce qu'on appelle le sillage, l'ouaiche ou la seillure. Lorsqu'on suit un vaisseau de très-près, et qu'on marche dans son sillage, on dit être dans ses eaux.
Mettre un navire à l'eau, c'est le mettre à la mer, ou le pousser à l'eau de dessus le chantier, après sa construction ou son radoub. Voyez LANCER. (Z)
EAU DE NEF, terme de Rivière, est la portion d'eau qui coule entre deux bateaux sur lesquels sont posées deux pièces de bois, par-dessus lesquelles on décharge le vin.
EAU, (Manège) envisagée par ses usages relativement aux chevaux.
1°. Elle en est la boisson ordinaire.
Je ne sai comment on pourrait accorder les idées d'Aristote, et de quelques écrivains obscurs qui n'ont parlé que d'après lui, avec celles que nous nous formons des effets que cet élément produit dans nos corps et dans celui des animaux. Ce philosophe, à l'étude et aux observations duquel Alexandre en soumit une multitude de toute espèce, ne me parait point aussi superieur dans les détails, qu'il l'a été par rapport aux vues générales. A l'en croire, les chevaux et les chameaux boivent l'eau trouble et épaisse avec plus de plaisir que l'eau claire ; la preuve qu'il en apporte, est qu'ils la troublent eux-mêmes : il ajoute que l'eau chargée de beaucoup de particules hétérogènes, les engraisse, parce que dès-lors leurs veines se remplissent davantage.
La seule exposition des faits allégués par ce grand homme, et des causes sur lesquelles il les appuie, suffirait aujourd'hui pour en demontrer la fausseté ; mais peut-être des personnes pénétrées d'une estime aveugle et outrée pour les opinions des anciens, me reprocheraient de n'avoir qu'un mépris injuste pour ces mêmes opinions : ainsi je crois devoir, en opposant la raison à l'autorité, me mettre à l'abri du blâme auquel s'exposent ceux qui tombent dans l'un ou dans l'autre de ces excès.
Il est singulier que le même naturaliste, qui, pour exprimer le plaisir que le cheval ressent en se baignant, le nomme animal philolutron, philydron, soit étonné de voir qu'il batte et qu'il agite communément l'eau au moment où il y entre, et n'impute cette action de sa part qu'au dessein et à la volonté de la troubler, pour s'en abreuver avec plus de satisfaction. Il me semble qu'en attribuant ces mouvements, que nous ne remarquons que rarement dans les chevaux accoutumés à boire dans la rivière, au désir naturel à l'animal philolutron, de faire rejaillir par ce moyen l'eau sur lui-même, ou de s'y plonger, on ne se serait pas si éloigné de la vraisemblance.
L'expérience est mille fois plus sure que le raisonnement. Présentez à l'animal de l'eau trouble, mais sans odeur ou mauvais gout, et de l'eau parfaitement limpide, il s'abreuvera indifféremment de l'une ou de l'autre : conduisez-le dans une rivière, dès qu'il sera véritablement altéré, il boira sur le champ, et ne cherchera point d'abord à en troubler l'eau : permettez-lui de la battre et de l'agiter à son gré, il s'y couchera infailliblement : examinez enfin ce dont ont été témoins nombre d'écrivains qui ont enrichi le recueil curieux qui a pour titre, Scriptores rei rusticae vetères, etc. et ce dont vous pouvez vous assurer par vous-même, vous verrez que beaucoup de chevaux brulant d'une soif ardente, ne sont point pressés de l'étancher, lorsqu'on ne leur offre à cet effet qu'une eau sale et brouillée. Aristote, Crescentius, Ruellius et quelques autres, prêtent donc à l'animal une intention qu'il n'a point, et ont laissé échapper celle qu'il a réellement, et qui lui est suggérée par un instinct et par un goût qu'ils reconnaissaient néanmoins en lui.
Il n'est pas douteux que c'est ce même goût qui le sollicite et qui l'engage à plonger sa tête plus ou moins profondément dans l'auge ou dans le seau qui contient sa boisson. Cette action, à laquelle il ne se livre que lorsque l'altération n'est pas considérable, a cependant occasionné de nouveaux écarts. Pline en a conclu que les chevaux trempent les nazeaux dans l'eau quand ils s'abreuvent. Jérôme Garembert, quest. xlv. a avancé qu'ils y plongent la tête jusqu'aux yeux, tandis que les ânes et les mulets hument du bord des lèvres. Un naturaliste moderne, qui sans doute n'a vérifié ni l'un ni l'autre de ces faits, et qui n'a peut-être prononcé que sur la foi des Naturalistes qu'il a consultés, n'a pas craint de regarder la froideur de l'eau qui frappe la membrane muqueuse de l'animal au moment où il bait, comme la cause d'une maladie dont la source n'est réellement que dans le sang : il suggère même un expédient assez particulier pour la prévenir. Il conseille à cet effet d'essuyer les nazeaux du cheval chaque fois qu'il a bu. Telle est la triste condition de l'esprit humain, les vérités les plus sensibles se dérobent à lui ; et des écrits dans lesquels brillent l'érudition et le plus profond savoir, sont toujours semés d'une foule d'erreurs.
Ce n'en serait pas une moins grossière que d'imaginer sur le nom et sur la réputation d'Aristote, que l'eau trouble engraisse le cheval, et lui est plus salutaire que d'autre. Pour peu que l'on soit éclairé sur le mécanisme des corps animés, on rejette loin de soi le principe pitoyable sur lequel est établie cette doctrine. Il serait très-difficîle de découvrir la sorte d'élaboration à la faveur de laquelle des corpuscules terrestres et grossiers aideraient à fournir un chyle balsamique, et propre à une assimilation d'où résulterait une homogenéité véritable. Non-seulement le fluide aqueux dissout les humeurs visqueuses, entretient la fluidité du sang, tient tous les émonctoires convenables ouverts, débarrasse tous les conduits, et facilite merveilleusement la plus importante des excrétions, c'est-à-dire la transpiration insensible ; mais sans son secours la nutrition ne saurait être parfaitement opérée : il est le véhicule qui porte le suc nourricier jusque dans les pores les plus tenus et les plus déliés des parties. Il suit de cette vérité et de ces effets, que les seules eaux bienfaisantes seront celles qui, legeres, pures, simples, douces et claires, passeront avec facilité dans tous les vaisseaux excrétoires ; et nous devons penser que celles qui sont crues, pesantes, croupissantes, inactives, terrestres, et imprégnées en un mot de parties hétérogènes grossières, forment une boisson très-nuisible, attendu la peine qu'elles ont de se frayer une route à travers des canaux, à l'extrémité desquels elles ne parviennent jamais sans y causer des obstructions. J'avoue que celles-ci, eu égard à la construction de l'animal, à la force de ses organes digestifs, au genre d'aliments dont il se nourrit, etc. ne sont point aussi pernicieuses pour lui que pour l'homme : nous ne devons pas néanmoins nous dispenser de faire attention aux différentes qualités de celles dont nous l'abreuvons. Les eaux trop vives suscitent de sortes tranchées, des avives considérables. Les eaux de neige provoquent ordinairement une toux violente, un engorgement considérable dans les glandes sublinguales et maxillaires ; elles excitent en même temps dans les jeunes chevaux un flux considérable par les nazeaux, d'une humeur plus ou moins épaisse, et d'une couleur plus ou moins foncée.
Le temps et la manière d'abreuver ces sortes d'animaux, sont des points qui importent essentiellement à leur conservation.
On ne doit jamais, et dans aucune circonstance, les faire boire quand ils ont chaud, quand ils sont essoufflés, et avant de les avoir laissé reposer plus ou moins longtemps. L'heure la plus convenable pour les abreuver, est celle de huit ou neuf heures du matin, et de sept ou huit heures du soir. En été on les abreuve trois fois par jour, et la troisième fois doit être fixée à environ cinq heures après la première. Il est vrai qu'eu égard aux chevaux qui travaillent et aux chevaux qui voyagent, un pareil régime ne saurait être exactement constant ; mais il ne faut point absolument s'écarter et se départir de la maxime qui concerne le cheval hors d'haleine, et qui est en sueur. Nos chevaux de manège ne boivent qu'une heure ou deux après que nos exercices sont finis ; le soir on les abreuve à sept heures, et toujours avant de leur donner l'avoine : cette pratique est préférable à celle de leur donner le grain avant la boisson, à moins que le cheval ayant eu très-chaud, on ne lui donne une mesure d'avoine avant et après qu'il aura bu.
Plusieurs personnes sont en usage d'envoyer leurs chevaux boire à la rivière ; cette habitude, blâmée d'un côté par Xénophon, et louée de l'autre par Camerarius, ne saurait être improuvée, pourvu que l'on soit assuré de la sagesse de ceux qui les y conduisent, qu'on ne les y mène pas dans le temps le plus âpre de l'hiver, et qu'on ait l'attention à leur retour, non-seulement d'avaler avec les mains l'eau dont leurs quatre jambes sont encore mouillées, mais de leur essuyer et de leur sécher parfaitement les pieds.
Ceux qui abreuvent l'animal dans l'écurie doivent, en hiver, avoir grand soin de lui faire boire l'eau sur le champ et aussi-tôt qu'elle est tirée. Dans l'été au contraire il est indispensable de la tirer le soir pour le lendemain matin, et le même matin pour le soir du même jour. Je ne suis point sur ce fait d'accord avec Camerarius ; il invective vainement les palefreniers qui offrent à boire à leurs chevaux de l'eau qui a séjourné dans un vase, parce qu'elle a été exposée à la chute de plusieurs ordures ; il veut qu'elle soit tirée fraichement et présentée aussi-tôt à l'animal : mais les suites funestes d'une pareille méthode observée dans le temps des chaleurs, n'ont que trop énergiquement prouvé la séverité avec laquelle elle doit être proscrite. On peut parer cependant à la froideur de l'eau et à sa trop grande crudité, soit en y trempant les mains, soit en y jetant du son, soit en l'exposant au soleil, soit en la mêlant avec une certaine quantité d'eau chaude, soit enfin en l'agitant avec une poignée de foin, autrement on courait risque de précipiter le cheval dans quelque maladie sérieuse. J'ajouterai qu'il est essentiel de s'opposer à ce qu'il boive tout d'une haleine ; on doit l'interrompre de temps en temps quand il s'abreuve, de manière qu'il ne s'essouffle pas lui-même, et que sa respiration soit libre ; c'est ce que nous appelons couper, rompre l'eau à l'animal.
Une question à décider, est celle de savoir s'il convient mieux d'abreuver un cheval dans la route, ou d'attendre à cet effet que l'on soit arrivé au lieu où l'on doit s'arrêter. Si l'on consultait M. de Soleysel sur cette difficulté, on trouverait qu'il a prononcé pour et contre. Dans le chapitre xxjx. de la seconde partie de son ouvrage, édition de l'année 1712, chez Emery, il charge le bon sens de conclure pour lui, que les chevaux doivent boire en chemin, par la raison que s'ils ont chaud en arrivant, on est un temps infini sans pouvoir les faire boire, et que la soif les empêchant de manger, une heure ou deux s'écoulent, en sorte qu'ils sont obligés de repartir n'ayant ni bu ni mangé, ce qui les met hors d'état de fournir le chemin. Dans le chapitre suivant il recommande expressément de prendre garde aux eaux que les chevaux boivent, particulièrement en voyage, car de-là dépend, dit-il, la conservation de leur vie ou leur destruction ; or le bon sens indique ici une contradiction manifeste : en effet, si je dois d'une part abreuver mon cheval dans la route, plutôt que de patienter jusqu'au moment où j'arriverai ; et si de l'autre il est très-important que je considère la nature des eaux dont je l'abreuve, je demande quels seront les moyens par lesquels je jugerai sainement de la différente qualité de celles que je rencontrerai en cheminant. Je crois donc que la seule inspection n'étant pas capable de donner des lumières suffisantes pour observer avec fruit, la prudence exige qu'on ne fasse jamais boire les chevaux à la première eau que l'on découvre. Il vaut mieux différer jusqu'à ce que l'on soit parvenu dans l'endroit où l'on s'est proposé de prendre du repos et de satisfaire ses autres besoins. Les habitants de ce lieu instruits par l'expérience des eaux plus ou moins favorables à l'animal, dissiperont toutes nos inquiétudes et toutes nos craintes à cet égard ; nous ne nous exposerons point, en un mot, au danger d'abreuver nos chevaux d'une eau souvent mortelle pour eux, telles que celles de la rivière d'Essone sur le chemin de Fontainebleau à Paris, d'une autre petite rivière qui passe dans le Beaujolais, et d'une multitude de petits torrents dans lesquels nul cheval ne bait qu'il ne soit atteint de quelques maladies très-vives et très-aiguès. Le moyen de parer l'inconvénient de la trop grande chaleur et de la sueur de l'animal lorsqu'il arrive, est très-simple : il ne s'agit que de ralentir son allure environ une demi-lieue avant de terminer sa marche ; alors il entre dans son écurie sans qu'on aperçoive aucuns signes de transpiration et de fatigue, et un quart-d'heure de repos suffit, pour qu'il puisse sans péril manger les aliments qu'on lui présente, et ensuite être abreuvé. On doit en user de même relativement aux chevaux de carosse, et aux autres chevaux de tirage. Il est rare qu'ils puissent boire commodément en route, les uns et les autres étant attelés ; mais la précaution de les beaucoup moins presser à mesure que l'on approche de l'alte, est très-utîle et très-sage. Celle d'abreuver les chevaux avant de partir, n'est bonne qu'autant que la boisson précède d'environ une heure l'instant du départ ; des chevaux abreuvés que l'on travaille sur le champ, cheminent moins aisément, avec moins de vivacité et de legereté, et ont beaucoup moins d'haleine.
Selon Aristote, les chevaux peuvent se passer de boisson environ quatre jours ; je ne contredis point ce fait dont je n'ai pas approfondi la vérité : il en est qui boivent naturellement moins les uns que les autres : il en est qui boivent trop peu, ceux-ci sont communément étroits de boyaux : il en est aussi que la fatigue, le dégout, empêche de s'abreuver ; en cherchant à aiguiser leur appétit par différentes sortes de masticatoires, on réveille en eux le désir de la boisson : il en est enfin que des maladies graves mettent hors d'état de prendre aucune sorte d'aliments solides ou liquides ; nous indiquerons en parlant de ces maladies, et quand l'occasion s'en présentera, les moyens d'y remédier.
Je ne place point au rang de ces maux les excraissances qui surviennent dans la partie de la bouche que nous nommons le canal, et que l'on observe à chaque côté de la langue, précisément à l'endroit où se termine le repli formé par la membrane qui revêt intérieurement la mâchoire inférieure. Ces excraissances, assez semblables par leur figure à des nageoires de poissons, sont ce que nous nommons barbes ou barbillons. On doit les envisager uniquement comme un allongement de cette membrane, qui toujours abreuvée par la salive, et plus humectée qu'ailleurs par la grande quantité d'humeurs que les glandes sublinguales filtrent et fournissent à cet endroit, peut se relâcher dans cette portion plus aisément que dans le reste de son étendue, le tissu en étant d'ailleurs naturellement très-foible. Ce prolongement empêche les chevaux de boire aussi librement qu'à l'ordinaire ; ainsi lorsqu'ils témoignent non-seulement quelque répugnance pour la boisson, mais un désir de s'abreuver qu'ils ne peuvent satisfaire que difficilement et avec peine, il faut rechercher si les barbillons n'en sont pas l'unique cause ; en ce cas on tient la bouche du cheval ouverte par le moyen du pas-d'âne (voyez PAS-D'ANE), et l'on retranche entièrement avec des ciseaux la portion prolongée de la membrane ; on peut laver ensuite la bouche de l'animal avec du vinaigre, du poivre, et du sel : pour cet effet on trempe dans cet acide un linge entortillé au bout d'un morceau de bois quelconque ; on en frotte la partie malade, après quoi on retire le pas-d'âne, et on fait mâcher le linge pendant un instant au cheval. Nombre de personnes ajoutent à cette opération, celle de lui donner un coup de corne (voyez PHLEBOTOMIE) : dès-lors on n'emploie point le vinaigre ; et on se contente, quand une suffisante quantité de sang s'est écoulée, de présenter du son sec à l'animal.
Pour opérer avec plus de succès, et sans offenser les parties voisines de celles qu'on doit couper, il est bon de se servir de ciseaux dont les branches soient tellement longues, que la main de l'opérateur ne soit point empêchée par les dents du cheval sur lequel il travaille ; il faut encore que l'extrémité des lames au lieu d'être droite soit recourbée, non de côté, mais en-haut, et que chaque pointe de ces mêmes lames ait un bouton. Voyez ONGLEE.
Il est des circonstances dans lesquelles nous sommes obligés de communiquer à l'eau simple et commune, dont nous abreuvons les chevaux, des vertus qu'elle n'aurait point, si nous n'y faisions quelques additions et des mélanges appropriés aux différents cas qui se présentent.
L'eau blanche est, par exemple, la boisson ordinaire des chevaux malades. Elle ne doit cette couleur qu'au son que nous y ajoutons ; mais il ne suffit pas pour la blanchir d'en jeter, ainsi que plusieurs palefreniers le pratiquent, une ou deux mesures dans l'eau dont est rempli le seau ou l'auge à abreuver. Elle n'en reçoit alors qu'une teinture très-foible et très-légère ; et elle participe moins de la qualité anodine, tempérante et rafraichissante de cet aliment, dont elle est plutôt empreinte par la manière dont on l'exprime, que par la quantité que l'on en emploie très-inutilement. Prenez une jointée de son ; trempez vos deux mains qui en sont saisies dans l'auge ou dans le seau ; exprimez fortement et à plusieurs reprises l'eau dont le son que vous tenez est imbu, le liquide acquerra une couleur véritablement blanche ; laissez ensuite tomber le son dans le fond du vase ; reprenez, s'il en est besoin, une seconde jointée, et agissez-en de même, la blancheur du liquide augmentera ; et le mélange sera d'autant plus parfait, que cette blancheur ne nait que de l'exacte séparation des portions les plus déliées du solide, lesquelles se sont intimement confondues avec celles de l'eau.
Nous n'en usons pas ainsi, lorsque pour soutenir l'animal dans des occurrences d'anéantissement, nous blanchissons sa boisson par le moyen de quelques poignées de farine de froment. Si nous précipitions sur le champ la farine dans l'eau, elle se rassemblerait en une multitude de globules d'une grosseur plus ou moins considérable. Si nous l'y trempions comme le son, pour exprimer ensuite le fluide, il en résulterait une masse que nous aurions ensuite une peine extrême à diviser ; il faut donc, à mesure que l'on ajoute le froment en farine, le broyer sec avec les doigts, et le laisser tomber en poudre, après quoi on agite l'eau et on la met devant l'animal, qui s'en abreuve quand il le peut ou quand il le veut.
L'eau miellée forme encore une boisson très-adoucissante ; il ne s'agit que de mettre une plus ou moins forte dose de miel dans l'eau que l'on veut donner à boire au cheval, et de l'y délayer autant qu'il est possible. Il est néanmoins beaucoup de chevaux auxquels elle répugne, et qui n'en boivent point.
Souvent aussi la maladie et le dégoût sont tels, que nous sommes contraints de ne nourrir l'animal qu'en l'abreuvant. Alors nous donnons à la boisson encore plus de consistance, en y faisant cuire ou de la mie de pain, ou de l'orge mondé, ou de la farine d'orge tamisée ; nous passons ensuite ces espèces de panades, et nous les donnons au cheval avec la corne.
Du reste nous employons les décoctions, les infusions, les eaux distillées, etc.
Je ne puis rapporter qu'un seul exemple de l'efficacité des eaux minérales données en boisson à l'animal ; mais je suis convaincu qu'elles lui seraient très-salutaires, si on les prescrivait à-propos, et si on ajoutait ce secours à tous ceux que nous avons tirés de la Médecine du corps humain. Il était question d'un cheval poussif ; les eaux minérales du Mont-d'or, très-propres à la cure de l'asthme, le rétablirent entièrement.
2°. Les avantages que l'animal retire de l'usage extérieur de l'eau sont sensibles.
On peut dire que ses effets relativement à l'homme et au cheval sont les mêmes. Si l'eau froide excite dans les fibres une véritable constriction, si elle contraint les pores de la peau à se resserrer, c'en est assez pour pénétrer les raisons de la prohibition des bains entiers, eu égard à tout animal en sueur, et pour être instruit du danger éminent qu'il y aurait de le tenir alors le corps plongé dans une rivière. Si en même temps ce fluide doit être envisagé toujours à raison de sa froideur comme un repercussif, on ne doit point être étonné qu'on le prescrive dans les cas de fourbure, de crampes, d'entorses récentes, etc. et qu'on ordonne de l'employer en forme de bains pédilaves, lorsqu'à la suite d'un certain travail ou de trop de repos, ou d'autres causes quelconques, on veut prévenir ou dissiper l'engorgement des jambes en augmentant la force et la résistance des solides, et en les disposant à résister à l'affluence trop prompte et trop abondante des humeurs sur ces parties.
Ce serait perdre un temps précieux, que de rechercher ce que les anciens ont écrit sur cette matière : quel fruit pourrions-nous en attendre ? d'une part nous verrions Buellius soutenir gravement que dès les premiers cinq mois on doit mener le poulain à l'eau, et le faire souvent entrer entièrement dans la rivière afin de lui enseigner à nager : de l'autre nous ne serions que surpris du ton dogmatique et imposant avec lequel Columelle et Camérarius énoncent tous les principes qu'ils ont affecté de répandre sur ce point ; l'un dans son traité sur les chevaux, chapitre v ; et l'autre dans son hippocom. Abandonnons donc ces auteurs ; les propriétés que nous avons assignées à l'eau froide suffiront pour indiquer les cas où elle nous conduira à la guérison de l'animal.
Je ne conçais pas pourquoi nous bannissons ou nous oublions les bains d'eau chaude. Il est constant qu'ils ne peuvent que ramollir des fibres roides, tendues, et resserrées par les spasmes ; ils procurent un relâchement dans toute l'habitude du corps ; ils facilitent la circulation, ouvrent les pores, raréfient le sang, facilitent la dilatation du cœur et des artères, et disposent enfin l'animal aux effets des médicaments qui doivent lui être administrés dans nombre de maladies. Je les ai employés très-souvent ; et les épreuves que j'en ai faites m'ont persuadé que les succès qui suivraient cette pratique, sont tels qu'ils doivent nous faire passer sur les difficultés que nous offrent d'abord l'appareil et les préparations de ces sortes de remèdes. Les douches d'eau simple et commune, froide ou chaude, injectée de loin sur l'animal avec une longue et grande seringue, semblable à celle dont les Maréchaux se servent communément pour donner des lavements, ou versée de haut par le moyen d'une forte éponge que l'on exprime, sont encore d'une ressource admirable dans une multitude d'occasions. Celles d'eau commune dans laquelle on a fait bouillir des plantes qui ont telles et telles qualités selon le genre des maux que l'on doit combattre, ne sont pas d'une moindre utilité ; et personne n'ignore les effets salutaires des fomentations et des bains artificiels résolutifs, astringens, anodins, fortifiants, émolliens, etc. suivant les vertus communiquées à l'eau par les plantes médicinales auxquelles on l'associe. Plusieurs se servent de temps en temps du bouillon de tripe ou de l'eau dans laquelle on a lavé la vaisselle, mit harspuolen, pour laver les jambes des chevaux : ces espèces de fomentations onctueuses ne sont pas à dédaigner ; elles maintiennent les fibres dans un degré de souplesse qui en facilite le jeu, et elles préviennent ces retractions fréquentes des tendons qui arquent la jambe, et qui boutent ou boulletent presque tous les chevaux après un certain temps de service.
Les douches d'eaux minérales enfin, les applications des boues ou des sédiments épais de ces mêmes eaux, sont des remèdes recommandables. J'ai Ve deux chevaux de prix entièrement délaissés à la suite d'un effort de reins, auquel on n'avait pu radicalement remédier, et qui pouvaient à peine trainer leur derrière lorsqu'ils avaient cheminé l'espace d'une demi-lieue ; les douches des eaux d'Aix en Savoie leur rendirent toute leur force et toute leur vigueur.
Chevaux qui craignent l'eau, chevaux qui s'y couchent. Rien n'est plus incommode que le vice dont sont atteints les premiers, et rien n'est en même temps plus dangereux que le défaut des seconds ; je suggérerai ici en peu de mots les moyens de corriger l'un et l'autre.
Les chevaux qui redoutent l'eau au point de se défendre vivement, lorsqu'on veut les faire entrer dans une rivière, soit pour les abreuver, soit pour les y baigner, ou pour la leur faire guéer dans une route, ne peuvent être la plupart affectés de terreur que conséquemment au bruit ou à la vivacité de son cours. Il ne s'agirait que d'y accoutumer leurs oreilles et leurs yeux prudemment et avec patience : la dureté, les coups, la rigueur, la surprise, sont de vaines armes pour les vaincre ; et l'expérience nous apprend que l'effroi des châtiments est souvent plus préjudiciable, que celui du premier objet appréhendé. Tâchons donc toujours de leur donner l'habitude de reconnaître et de sentir l'objet qu'ils craignent. Si nous n'imputons leur desobéissance qu'à l'étonnement que leur cause le bruit de l'eau lorsqu'ils en abordent, il est bon de les attacher pendant quelque temps dans le voisinage d'un moulin, insensiblement on les en approche, et enfin on les tient vis-à-vis la roue de ce même moulin, entre deux piliers, régulièrement une heure ou deux dans la journée, ayant soin de les flatter et de leur donner du pain, ou quelques poignées d'avoine. On pratique ensuite la même chose, relativement à l'effroi qu'occasionne en eux la rapidité des eaux qui roulent ; après quoi on tente de les conduire dans la rivière même, en observant d'y faire entrer un autre cheval avant eux, et de le leur faire suivre en les caressant. On doit avoir attention de ne les y point d'abord mener trop avant ; il n'est question dans le commencement que de les déterminer à obéir : on les y maintient plus ou moins de temps, et on les ramène à l'écurie. On gagne par cette voie peu-à-peu l'animal ; et non-seulement, si les coups n'ont pas précédé cette méthode et ne l'ont pas rebuté, il n'aura pas besoin de l'exemple d'un autre cheval pour se soumettre, mais il passera enfin sans peine la rivière entière, dès que le cavalier qui le monte l'en sollicitera.
Il en est qui par une forte exception au terme générique d'animal philolutron, se gendarment au moindre attouchement et à l'impression la plus légère de l'eau, ou de quelqu'autre liquide sur leur peau. Cette répugnance quelquefois naturelle, mais provenant le plus souvent de la brutalité des palefreniers qui les épongent, cessera de subsister, si on les mouille légèrement et avec douceur, et si les caresses accompagnent cette action, qu'il faut répéter dans l'écurie presque toutes les heures, et qui doit nécessairement précéder celle de les mener à l'eau. Au surplus, si cette crainte a sa source dans la nature de l'animal, il redoutera la rivière. Quand elle n'a pour cause que la rigueur des traitements qu'il a essuyés, il y entre et y nage franchement sans aucun effroi : c'est ce dont j'ai été témoin plusieurs fais, et spécialement eu égard à un cheval qu'un écuyer sexagénaire s'occupait à châtier et assommer de coups de fouet à l'écurie, sous prétexte de le mettre sur les hanches, et le tout tandis qu'on lui lavait les crins. Cet animal qu'il faisait baigner trois fois par jour pendant une heure au moins, dans l'espérance, disait-il, de l'apprivoiser, semblait se plaire dans l'eau : mais dès qu'on l'abordait en tenant une éponge, et qu'on voulait surtout entreprendre d'en peigner et d'en mouiller la crinière, il se défendait avec fureur. Ce même écuyer m'ayant consulté, et m'ayant ingénument avoué qu'il était l'auteur des désordres de son cheval, j'imaginai de l'en corriger, en l'exposant plusieurs jours sous une gouttière, de manière que l'eau qui en tombait frappait directement sur son encolure. Dans ce même temps, un palefrenier le flattait, lui présentait du pain, lui maniait les crins ; il y passa bien-tôt l'éponge et le peigne, et l'animal fut enfin réduit.
Quelquefois l'appréhension du cheval que l'on veut embarquer, nait de l'aspect seul du bateau : alors on doit le familiariser avec l'objet ; quelquefois aussi elle est suscitée par le bruit que font les pieds sur les planches : en ce cas il faut recourir à une partie de l'expédient que j'ai proposé dans mon nouveau Newkastle, pour dissiper la frayeur dont sont saisis quelques chevaux, qui refusent et se défendent, lorsqu'ils ont à peine fait deux pas sur un pont de bois : substituez des plateaux de chêne au pavé qui garnit la place qu'ils occupent dans l'écurie, le cheval étant sur ces plateaux, ses pieds feront le même bruit que lorsqu'il entrera ou remuera dans le bateau, et il sera conséquemment forcé de s'y accoutumer.
On risque souvent sa vie avec ceux qui se couchent dans l'eau. Il en est qui se dérobent à cet effet si subtilement, et d'une manière si imperceptible, que le cavalier n'a pas même le temps de se servir de sa main et de ses jambes pour les soutenir et pour les en empêcher. On ne saurait leur faire perdre ce vice sans une grande attention à leur mouvement, qu'il est nécessaire de prévenir. Je dois néanmoins avertir qu'il est rare que les éperons et les autres châtiments suffisent pour les en guérir ; mais j'ai éprouvé sur un des plus beaux chevaux limousins, dont cette dangereuse habitude diminuait considérablement le prix, un moyen qui le rendit très-docile, et qui lui ôta jusqu'au désir de se coucher. Je le montai, après m'être pourvu de deux ou trois flacons de verre recouverts d'osier, et remplis d'eau ; je le menai à un ruisseau, et je saisis exactement le temps où il commençait à fléchir les jambes, pour lui casser sur la nuque un de ces mêmes flacons : le bruit du verre, l'eau qui passait au-travers de l'osier, et qui coulait dans ses oreilles, fit sur lui une telle impression, qu'il se hâta de traverser ce ruisseau ; je le lui fis repasser, et j'usai du même châtiment : au bout de cinq ou six jours, l'animal gagnait avec rapidité, et sans aucun dessein de s'arrêter, l'autre côté du torrent : et depuis cette leçon il n'a jamais donné le moindre signe de la plus légère envie de se plonger dans l'eau. On peut encore prendre, au lieu des flacons, deux balles de plomb, percées et suspendues à une petite ficelle ; on les lui laisse tomber dans les oreilles lorsqu'il est prêt à se coucher ; et s'il continue son chemin, on les retire. (e)
EAUX, (Manège et Maréchall.) maladie cutanée qui tire sa dénomination du premier de ses symptômes, et à laquelle sont très-sujets les jeunes chevaux, qui n'ont pas jeté ou qui n'ont jeté qu'imparfaitement, ainsi que tous les chevaux de tout âge qui sont épais, dont les jarrets sont pleins et gras, dont les jambes sont chargées de poils, et qui ont été nourris dans des terrains gras et marécageux, etc.
Elle se décele par une humeur foetide, et par une sorte de sanie, qui sans ulcérer les parties, suintent d'abord à-travers les pores de la peau qui revêt les extrémités inférieures de l'animal, spécialement les postérieures. Dans le commencement, on les aperçoit aux paturons : à mesure que le mal fait des progrès, il s'étend, il monte jusqu'au boulet, et même jusqu'au milieu du canon ; la peau s'amortit, devient blanchâtre, se détache aisément et par morceaux ; et le mal cause l'enflure totale de l'extrémité qu'il attaque. Selon les degrés d'acrimonie et de purulence de la matière qui flue, et selon le plus ou le moins de corrosion des téguments, la partie affectée est plus ou moins dégarnie de poil : l'animal qui ne boitait point d'abord, souffre et boite plus ou moins : et il arrive enfin que la liaison du sabot et de la couronne à l'endroit du talon, est en quelque façon détruite.
Lorsque je remonte aux causes de la maladie dont il s'agit, je ne peux m'empêcher d'y voir et d'y reconnaître le principe d'une multitude d'autres maux que nous ne distinguons de celui-ci qu'attendu leur situation, et dont les noms et les divisions ne servent qu'à multiplier inutilement les difficultés, et qu'à éloigner le maréchal du seul chemin qui le conduirait au but qu'il se propose. Tels sont les arêtes ou les queues de rat, les grappes, les mules traversines, la crapaudine humorale, les crevasses, le peigne, le mal d'âne, etc. qui ne sont, ainsi que les eaux, que des maladies cutanées, produites par une même cause générale interne, ou par une même cause générale externe : quelquefois par l'une et l'autre ensemble.
Supposons, quant à la première, une lymphe plus ou moins âcre, et plus ou moins épaisse ; sa viscosité l'empêchant de s'évaporer par la transpiration, elle gonflera les tuyaux excrétoires de la peau, et elle ne pourra que séjourner dans le tissu de ce tégument, sur lequel elle fera diverses impressions, selon la différence de son caractère. Si elle n'est pas infiniment grossière et infiniment visqueuse, les embarras et les engorgements qu'elle formera, ne seront pas fort considérables : il en résultera une crasse farineuse, comme dans ce que nous nommons peignes secs. Est-elle chargée de beaucoup de parties sulphureuses, qui par l'évaporation de ce qu'il y avait de plus tenu et de plus aqueux, s'unissent et se dessechent, et ses sels sont-ils fortement embarrassés et émoussés par ces parties ? elle produira des croutes : c'est ce que nous voyons dans les arêtes ou queues de rat crustacées. Enfin est-elle imprégnée de beaucoup de sels dont l'action se développe, attendu le peu de parties sulphureuses qu'elle contient, et qui seules pourraient y former obstacle ? elle déchirera, elle rongera le tissu de la partie où elle sera arrêtée, les houpes nerveuses et les petits vaisseaux cutanés, corrodés ; l'animal ressentira ou des douleurs ou des picotements incommodes : il en découlera une sanie plus ou moins épaisse, et plus ou moins foetide : et telle est celle qui suinte dans la maladie qui fait l'objet de cet article, dans les arêtes humides, dans les peignes avec écoulement, et dans toutes les autres affections qui ne partent que d'une seule et même source. Que si d'un autre côté ces maladies auxquelles non-seulement le vice de la lymphe, mais encore l'obstruction des tuyaux excrétoires donnent lieu, ont été simplement occasionnées par des causes externes, capables de favoriser cette obstruction, elles seront plus aisément vaincues ; et ces causes externes n'étant que la crasse, la boue, et d'autres matières irritantes, il s'ensuit que nous pouvons placer, sans crainte de nous égarer, les porreaux et les javarts dans la même cathégorie, soit que nous les envisagions comme ayant leur principe dans l'intérieur, soit que nous les considérions comme provenant de l'extérieur. Du reste, s'il y a cause externe et cause interne tout ensemble, le mal sera plus rebelle : mais le succès ne saurait en être douteux. J'avoue cependant que les eaux ont été quelquefois suivies de maux extrêmement dangereux, comme de fics, ou crapauds, de javarts encornés, etc. Mais cet événement n'a rien d'étonnant, lorsque l'on considère que toutes les maladies qui ont jusqu'ici extérieurement attaqué l'animal, n'ont été combattues qu'avec des remèdes externes, comme si la cause ne résidait pas dans l'intérieur : or s'attacher simplement à dessécher des eaux, des solandres, des crevasses, etc. c'est pallier le mal, c'est négliger d'aller à son principe, c'est détourner seulement, et jeter sur d'autres parties l'humeur, qui ne peut acquérir que des degrés de perversion, capables de susciter des maladies véritablement funestes.
On doit débuter dans le traitement de celle-ci, par les remèdes généraux, et non par l'application des dessiccatifs, plutôt nuisibles dans les commencements, que salutaires ; il faut conséquemment pratiquer une légère saignée à la jugulaire ; le même soir du jour de cette saignée, donner à l'animal un lavement émollient, afin de le disposer au breuvage purgatif qu'on lui administrera le lendemain matin, et dans lequel on n'oubliera point de faire entrer l'aquila alba, ou le mercure doux. Selon les progrès du mal, on réitérera le breuvage, que l'on fera toujours précéder par le lavement émollient. Le cheval suffisamment évacué, on le mettra à l'usage du crocus metallorum, donné chaque matin dans du son (car on lui retranchera l'avoine) à la dose de demi-once, dans laquelle on mêlera d'abord trente grains d'oethiops minéral fait sans feu, que l'on augmentera chaque jour de cinq grains jusqu'à la dose de soixante ; on continuera le crocus et l'oethiops à cette même dose de soixante grains, encore sept ou huit jours, plus ou moins, selon les effets de ces médicaments : effets dont on jugera par l'inspection des parties, sur lesquelles le mal avait établi son siège. La tisane des bois est encore, dans ces sortes de cas, d'un très-grand secours ; on fait bouillir de salsepareille, squine, sassafras, gayac, égale quantité, c'est-à-dire trois onces de chacun, dans environ quatre pintes d'eau, jusqu'à réduction de moitié ; on passe cette décoction ; on y ajoute deux onces de crocus metallorum ; on remue, et l'on agite bien le tout ; on humecte le son que l'on présente le matin à l'animal, avec une chopine de cette tisane que l'on charge plus ou moins proportionnément au besoin et à l'état du malade ; et si le cheval refusait cet aliment ainsi détrempé, on lui donnerait la boisson avec la corne. La poudre de vipere n'est pas d'une moins grande ressource : on prend des viperes desséchées, on les pulvérise, et l'on jette la poudre d'une vipere entière, chaque jour, dans le son. Souvent elle répugne au cheval : alors on la mêle avec du miel, et l'on en fait plusieurs pilules, que l'on fait avaler à l'animal.
Quant aux remèdes qu'il convient d'employer extérieurement, on ne doit jamais en tenter l'usage, que lorsque l'animal a été suffisamment évacué, et qu'on la tenu quelques jours à celui du crocus et de l'oethiops, ou de la tisane, ou des viperes. Jusque-là il suffit de couper le poil, de graisser la partie malade, et il est important de laisser fluer la matière morbifique ; mais une partie de cette même matière s'étant échappée au moyen des purgatifs, et par les autres médicaments qui ont provoqué une plus abondante secrétion de l'humeur perspirable, il est temps alors d'en venir aux remèdes externes : ceux-ci ne peuvent être suggérés que par le plus ou le moins de malignité des symptômes qui se manifestent au-dehors. Il est rare qu'après l'administration des médicaments que j'ai prescrits, ils se montrent tels qu'on les a vus ; souvent l'enflure est dissipée, la partie se desseche d'elle-même, et il ne s'agit alors que de la laver avec du vin chaud, et de la maintenir nette et propre : quelquefois aussi on aperçoit encore un leger écoulement : dans cette circonstance il s'agit de substituer au vin dont on se servait, de l'eau-de-vie et du savon ; et si le flux est plus considérable, on bassinera l'extrémité affectée avec de l'eau, dans laquelle on aura fait bouillir de la couperose blanche et de l'alun, ou avec de l'eau seconde ; et l'on ne craindra pas de repurger l'animal, qui parviendra à une entière guérison sans le secours de cette foule de recettes d'eaux, d'emmiellures, et d'onguents, vainement prescrits par M. de Soleysel, et par Gaspard Saunier.
J'ai observé qu'il peut arriver que la liaison du sabot et de la couronne commence à se détruire : alors on desséchera les eaux à cet endroit seul, en y mettant de l'onguent pompholix, et on les laissera fluer par-tout ailleurs, jusqu'au moment où on pourra recourir aux remèdes externes que j'ai recommandés. Il peut se faire aussi qu'ensuite des érosions et des plaies faites conséquemment à la grande acrimonie de l'humeur, les chairs surmontent : alors on se servira de legers caustiques, que l'on mêlera avec de l'aegyptiac pour les consumer, et on suivra dans le traitement la même méthode que dans celui des plaies ordinaires.
Les eaux qui endommagent quelquefois la queue, qui occasionnent la chute des crins dont le tronçon est garni, et qui en changent la couleur, doivent être regardées comme une humeur dartreuse, contre laquelle on procédera en employant les remèdes avec lesquels on a combattu les autres eaux. Cette sorte de dartre qui reconnait les mêmes causes, est quelquefois tellement opiniâtre, que je n'ai pu la dissiper qu'en frottant tout le tronçon dont j'avais fait couper les crins avec l'onguent napolitain, après néanmoins avoir administré intérieurement les remèdes généraux et spécifiques.
La crainte de ne pas trouver l'occasion de parler dans le cours de cet ouvrage, des arêtes ou queues de rat, des crevasses, et de la crapaudine humorale, m'oblige à en dire un mot ici ; d'autant plus que ces maladies ayant, ainsi que je l'ai remarqué, le même principe que celle sur laquelle je viens de m'étendre, ne demandent pas un traitement différent.
Le siège des arêtes ou queues de rat est fixé sur la partie postérieure de la jambe, c'est-à-dire le long du tendon. Il en est de deux espèces : les unes sont crustacées, les autres coulantes. Les premières sont sans écoulement de matière ; les secondes se distinguent par des croutes humides et visqueuses, qui laissent des impressions dans le tissu de la peau, d'où il découle une sérosité ou une lymphe roussâtre, âcre, et corrosive, qui ronge communément les téguments. Ces croutes qui rarement affectent les extrémités antérieures, et qui sont plus ou moins élevées, sont appelées, par quelques personnes, des grappes.
Les crevasses sont situées dans le pli des paturons, soit au-devant, soit au derrière de l'animal ; elles sont comme autant de gersures ou de fentes, d'où suintent des eaux plus ou moins foetides, et qui sont accompagnées souvent d'enflure et d'une inflammation plus ou moins forte. Quelques-uns les confondent avec ce que nous nommons mules traversines : mais l'erreur est d'autant plus excusable, que les unes et les autres ne diffèrent que par la situation ; car les dernières s'annoncent par les mêmes signes dans le pli de l'articulation du paturon avec le boulet. L'onguent pompholix succédant aux remèdes intérieurs, est un dessiccatif des plus convenables et des plus efficaces.
La crapaudine humorale nait le plus souvent de cause interne, et elle est infiniment plus dangereuse que cette sorte d'ulcère que nous appelons du même nom, et qui ne provient que d'une atteinte que le cheval se donne lui-même à l'extrémité du paturon sur le milieu de cette partie, en passageant et en chevalant : cette atteinte se traite de la même manière que les plaies. Quant à la crapaudine dont il est question, elle est située comme l'autre sur le devant du paturon, directement au-dessus de la couronne : d'abord on aperçoit sur cette partie une espèce de gale d'environ un pouce de diamètre, le poil tombe, et la matière qui en découle est extrêmement puante ; elle est même quelquefois si corrosive et tellement âcre, qu'elle sépare l'ongle et qu'elle provoque la chute du sabot. Voyez PIES. On conçoit par conséquent combien il importe d'y remédier promptement, et d'en arrêter les progrès ; ce que l'on ne peut faire qu'au moyen des médicaments ordonnés pour les eaux. Elle produit encore des soies ou pieds de bœuf. Voyez SOIES, PIES, etc. (e)
EAU, chez les Jouailliers, est proprement la couleur ou l'éclat des diamants et des perles. Elle est ainsi appelée, parce qu'on croyait autrefois qu'ils étaient formés d'eau. Voyez PIERRE PRECIEUSE, etc.
Ainsi on dit, cette perle est d'une belle eau. Voyez PERLE. L'eau de ce diamant est trouble. Voyez DIAMANT.
Ce terme s'emploie aussi quelquefois, quoique moins proprement, pour signifier la couleur d'autres pierres précieuses. Voyez PIERRE PRECIEUSE, etc. Chambers.
* EAU, (donner l') Drap. Teintur. Tann. Chapel. Cette manière de parler est synonyme à lustrer ou à apprêter. On lustre une étoffe en la mouillant légèrement, et en la passant, soit à la presse, soit à la calendre à froid ou à chaud.
EAU, (donner une) Plumas. c'est passer les plumes naturellement noires dans un bain de teinture, moins pour les teindre que pour les lustrer, et leur communiquer plus d'éclat.
EAU-FORTE, (jeter l') Relieur. On met l'eau-forte mitigée avec trois quarts d'eau sur le veau qui couvre les livres, lorsque l'on veut faire paraitre sur le veau de grosses ou petites taches, ou d'autres figures, selon que le relieur la dirige. Elle imite aussi les taches du caffé au lait, quand la jaspure est plus serrée.
Les cartons et le veau étant battus, on glaire le livre ; et quand la glaire est seche, on jette l'eau forte par grosses ou petites gouttes. On dit, jeter l'eau-forte.
EAU DE SENTEUR, (Distillat.) On appelle ainsi la partie odoriférante de différentes substances, telles que l'orange, la mille-fleur, le nard, le napse, la rose, l'oeillet, etc. qui en sont extraites par la distillation ou l'infusion, ou l'expression, que les distillateurs de profession et les parfumeurs vendent, ou dont ils se servent pour donner de l'odeur à leurs marchandises. Voyez l'article DISTILLATION.
EAUX ET FORESTS
- Détails
- Écrit par Auteur anonyme
- Catégorie parente: Morale
- Catégorie : Jurisprudence
- Affichages : 1250